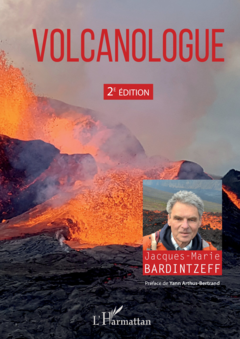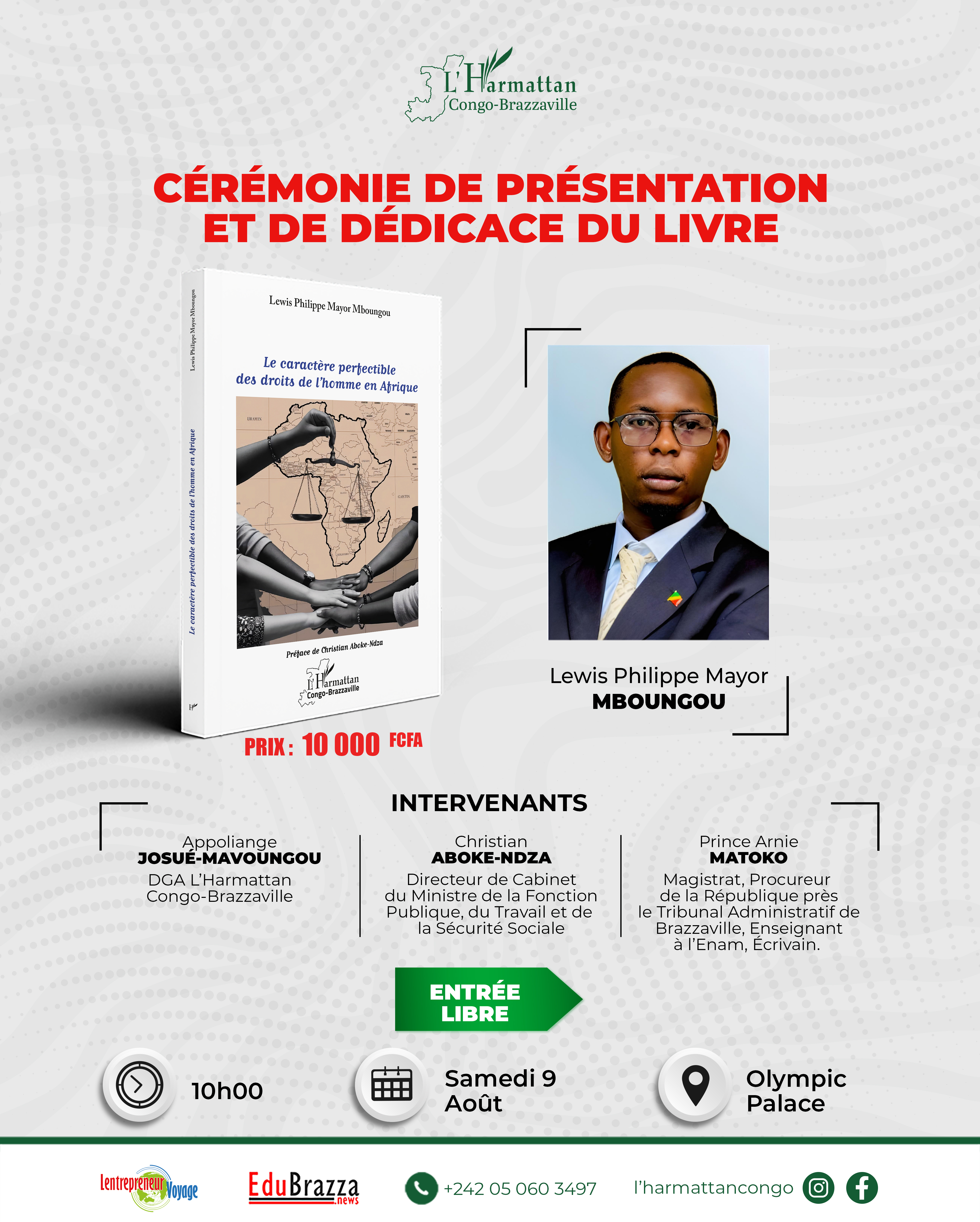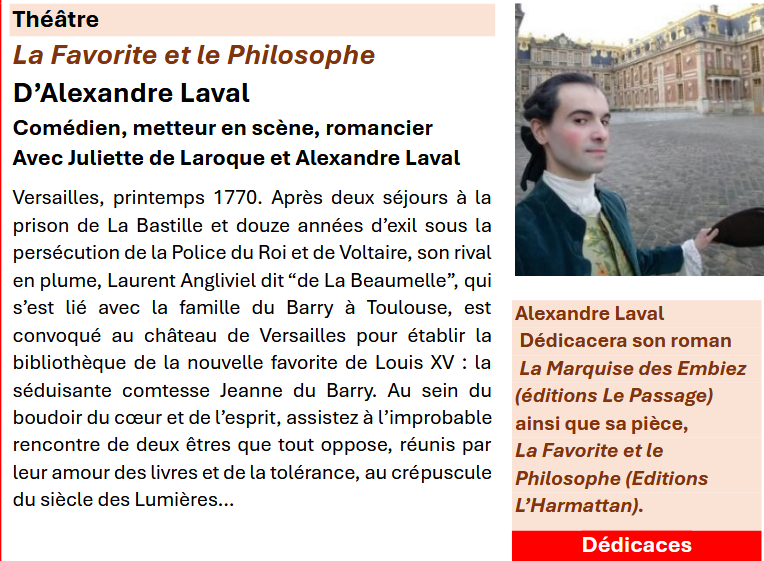4
livres
Vous avez vu 11 livre(s) sur 4
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
le masque et l'histoire
LE MASQUE ET L'HISTOIRE
Objet universel de toutes les sociétés archaïques ou modernes, le masque tient une place étonnante dans le cours de la civilisation et son usage remonte à la plus haute antiquité où déjà, fait pour être porté, il est souvent conçu en matériaux légers et sa valeur initiatique reste obscure et paradoxale. Simulacre facial, il dissimule, cache, et camoufle. Appartenant au domaine du paraître, le masque permet à l'homme, doté d'une dualité originelle, d'accéder à la métamorphose de son être, à la révélation de son inconscient. Ses caractéristiques, d'abord exclusivement rituelles, conservent tout au long de son histoire le principe de transgression qui est à la base de toute forme de déguisement. Doté d'un pouvoir surnaturel, il permet d'échapper temporairement à la vie quotidienne en donnant libre cours aux instincts les plus refoulés et en faisant ressortir les aspects de l'homme que la vie sociale occulte normalement ; il révèle même parfois quelques facettes inconnues.
Problématique originelle du masque
Le masque comme objet de métamorphose
Appartenant au domaine du paraître, le masque permet à l'homme d'accéder à la métamorphose de son être. C'est chez les peuples primitifs que l'on trouve les plus grands créateurs de masques. Vivant souvent nus sans aucun problème pour révéler leur corps aux yeux d'autrui, ils ont paradoxalement poussé l'art du déguisement à son paroxysme le plus significatif. C'est ce qui donne au masque toute sa valeur d'objet de métamorphose. Le masque fait oublier la différence entre l'être et le paraître, aux frontières infimes que la conscience n'atteint pas. L'individu, en transformant son image, modifie son être. Le masque symbolise ce désir, c'est un exceptionnel instrument de métamorphose.
Le masque d'homme n'est jamais le masque d'un homme. Le visage étant tout le temps le visage de quelqu'un, le masque ne peut être un visage. L'homme masqué par contre devient l'autre, celui qui est sans visage puisqu'il est capable de les prendre tous. Dans un grand nombre de cultures le masque fait partie de tout un rituel et il est bien souvent sacré. A travers toutes les métamorphoses qu'il permet, il montre et expose beaucoup plus qu'il ne dissimule. Le personnage masqué n'est pas simplement un être dont l'identité nous est inconnue. En assouvissant ce désir de transformation, il cherche à accéder à une nouvelle modalité de l'être. Seul le masque est capable de procéder à la métamorphose de l'homme en un être qui lui est supérieur.
Selon Oscar Wilde, "Un masque raconte beaucoup plus qu'un visage et l'homme est peu lui même lorsqu'il parle à la première personne; donnez lui un masque et il dira la vérité",. Riche de symboles, le masque est un outil pour l'homme en quête de son identité et de cohésion sociale. Porté sur le visage, il laisse percer le regard et la parole, indispensables à la relation communautaire. Grâce au masque, la communication s'instaure de façon plus libre et plus familière. L'homme se donne l'illusion de faire tomber les barrières et les distances sociales.
Le masque comme objet d'identification
Il existe plusieurs sortes de masques, chacun pourvu d'une fonction différente. Masques de parade, de théâtre, de danse mais aussi masques funéraires servent de lien entre deux mondes antagonistes, celui de la vie et de la mort, du visible et de l'invisible. Les sentiments chez l'homme possèdent leurs propres masques. En effet, si les émotions profondes laissent une marque sur le visage de l'homme, le fait de ne rien laisser paraître sur ce même visage constitue en soi un masque d'impassibilité. On peut dire qu'un visage n'est autre qu'un masque, celui dont le miroir renvoie le reflet. C'est une espèce d'analogie entre la face humaine et le miroir. Celui-ci renvoie à l'homme une image à laquelle il a pris l'habitude de s'identifier, une image rassurante qu'il fait sienne, une image en harmonie avec sa personne. Cependant, nos rêves sont peuplés de personnali
Signature :
Céline Moretti-Maqua
Lire plus
Objet universel de toutes les sociétés archaïques ou modernes, le masque tient une place étonnante dans le cours de la civilisation et son usage remonte à la plus haute antiquité où déjà, fait pour être porté, il est souvent conçu en matériaux légers et sa valeur initiatique reste obscure et paradoxale. Simulacre facial, il dissimule, cache, et camoufle. Appartenant au domaine du paraître, le masque permet à l'homme, doté d'une dualité originelle, d'accéder à la métamorphose de son être, à la révélation de son inconscient. Ses caractéristiques, d'abord exclusivement rituelles, conservent tout au long de son histoire le principe de transgression qui est à la base de toute forme de déguisement. Doté d'un pouvoir surnaturel, il permet d'échapper temporairement à la vie quotidienne en donnant libre cours aux instincts les plus refoulés et en faisant ressortir les aspects de l'homme que la vie sociale occulte normalement ; il révèle même parfois quelques facettes inconnues.
Problématique originelle du masque
Le masque comme objet de métamorphose
Appartenant au domaine du paraître, le masque permet à l'homme d'accéder à la métamorphose de son être. C'est chez les peuples primitifs que l'on trouve les plus grands créateurs de masques. Vivant souvent nus sans aucun problème pour révéler leur corps aux yeux d'autrui, ils ont paradoxalement poussé l'art du déguisement à son paroxysme le plus significatif. C'est ce qui donne au masque toute sa valeur d'objet de métamorphose. Le masque fait oublier la différence entre l'être et le paraître, aux frontières infimes que la conscience n'atteint pas. L'individu, en transformant son image, modifie son être. Le masque symbolise ce désir, c'est un exceptionnel instrument de métamorphose.
Le masque d'homme n'est jamais le masque d'un homme. Le visage étant tout le temps le visage de quelqu'un, le masque ne peut être un visage. L'homme masqué par contre devient l'autre, celui qui est sans visage puisqu'il est capable de les prendre tous. Dans un grand nombre de cultures le masque fait partie de tout un rituel et il est bien souvent sacré. A travers toutes les métamorphoses qu'il permet, il montre et expose beaucoup plus qu'il ne dissimule. Le personnage masqué n'est pas simplement un être dont l'identité nous est inconnue. En assouvissant ce désir de transformation, il cherche à accéder à une nouvelle modalité de l'être. Seul le masque est capable de procéder à la métamorphose de l'homme en un être qui lui est supérieur.
Selon Oscar Wilde, "Un masque raconte beaucoup plus qu'un visage et l'homme est peu lui même lorsqu'il parle à la première personne; donnez lui un masque et il dira la vérité",. Riche de symboles, le masque est un outil pour l'homme en quête de son identité et de cohésion sociale. Porté sur le visage, il laisse percer le regard et la parole, indispensables à la relation communautaire. Grâce au masque, la communication s'instaure de façon plus libre et plus familière. L'homme se donne l'illusion de faire tomber les barrières et les distances sociales.
Le masque comme objet d'identification
Il existe plusieurs sortes de masques, chacun pourvu d'une fonction différente. Masques de parade, de théâtre, de danse mais aussi masques funéraires servent de lien entre deux mondes antagonistes, celui de la vie et de la mort, du visible et de l'invisible. Les sentiments chez l'homme possèdent leurs propres masques. En effet, si les émotions profondes laissent une marque sur le visage de l'homme, le fait de ne rien laisser paraître sur ce même visage constitue en soi un masque d'impassibilité. On peut dire qu'un visage n'est autre qu'un masque, celui dont le miroir renvoie le reflet. C'est une espèce d'analogie entre la face humaine et le miroir. Celui-ci renvoie à l'homme une image à laquelle il a pris l'habitude de s'identifier, une image rassurante qu'il fait sienne, une image en harmonie avec sa personne. Cependant, nos rêves sont peuplés de personnali
Signature :
Céline Moretti-Maqua
Le masque, élément unificateur des arts au XVIIIème siècle
"C'est ainsi que l'araignée, placée au centre de sa toile, correspond avec tous les fils, vit en quelque sorte dans chacun d'eux et pourrait (si, comme nos sens, ils étaient animés) transmettre à l'un, la perception que les autres lui auraient donnée".
Considérant le masque comme un outil commun dans le processus créateur des artistes dont j'ai utilisé les uvres pour argumenter ma démonstration, je suis convaincue qu'une même inspiration les a conduits à démasquer le masque d'une société en pleine mutation. En tant que concept, l'art est un ensemble de propriétés communes à toutes les pratiques et productions artistiques. L'art est un mode de transmission : il exprime, communique et ses fonctions ne sont pas uniquement esthétiques.
Il transmet tout l'héritage culturel accumulé par les générations. La place qu'il occupe dans la civilisation humaine lui donne une ampleur analogue à celle de la science et de la religion. Lorsqu'un artiste crée, c'est ce qu'il a vu, ressenti ou compris qu'il communique aux autres. Sous forme d'un symbole verbal, visuel ou musical, il partage les fruits de sa pensée, de sa sensibilité, de son imagination. Sa production traduit son drame personnel qui n'est pas celui d'un individu mais qui participe aux mouvements psychiques qui agitent son groupe culturel, voire l'ensemble de l'humanité. Par un ressenti différent, par une façon différente d'exprimer ce ressenti et par des moyens d'expressions différents, une multitude d'artistes peuvent développer un même processus créateur et transmettre un message identique même si ce message n'est pas directement perceptible étant donné d'une part l'infinité d'interprétations de ce message et d'autre part l'impact de l'époque, orientant parfois l'artiste dans la recherche de son style.
À ce niveau de réflexion, il est utile de se poser un certain nombre de questions : dans quelle mesure les arts sont-ils analogues ? Dans quelle mesure diffèrent-ils entre eux ? Dans quelle mesure est il possible de transférer les effets produits par un art dans un autre art ? Quelles correspondances peut-il y avoir entre des structures musicales et des structures visuelles ? C'est pour éclaircir ces questions qu'un certain nombre d'auteurs (comme je l'ai cité plus haut) se sont livrés à des tentatives de classifications. C'est au cours de ces tentatives que s'est précisée une inévitable correspondance entre les différentes formes d'art. Ces tentatives ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Au fil des différentes époques, nombreux sont les penseurs qui ont pressenti, avec une conscience plus ou moins grande, une correspondance entre les sensations produites par la musique et par la peinture. Dès le Moyen Âge, l'architecture des cathédrales et les créations musicales, d'une inspiration essentiellement religieuse, sont générées par un même souci d'unité symbolique. La Renaissance, en se libérant des règles strictes imposées par le clergé, facilite le développement formel et ouvre davantage les arts aux émotions humaines. Au XVIIe siècle, le style baroque donne à l'esthétique du plaisir et de la sensualité une importance démesurée dans un contexte richissime et pompeux : musique, danse et ballet, théâtre, peinture répondent à une même pensée créatrice qui fait l'apogée culturelle de ce siècle. En 1740, dans un traité sur l'optique des couleurs présentant une analyse scientifique des correspondances du sonore et du visuel, Louis Bertrand Castel (1688-1757) présente la musique et la peinture comme illustrations d'un courant général d'origine aussi bien littéraire qu'esthétique ou scientifique. Il assimile les trois couleurs fondamentales, rouge bleu jaune, aux trois notes de l'accord parfait. Il assimile également les sept degrés de la gamme tempérée aux couleurs du spectre. Au XVIIIe siècle, nombreuses sont les études menées à propos des arts : Jean Jacques Rousseau dans son dictionnaire de la musique, à l'article Imitation, écrit :
" La musique semble mettre l'oeil dans l'oreille,
Signature :
Céline Moretti-maqua
Lire plus
Considérant le masque comme un outil commun dans le processus créateur des artistes dont j'ai utilisé les uvres pour argumenter ma démonstration, je suis convaincue qu'une même inspiration les a conduits à démasquer le masque d'une société en pleine mutation. En tant que concept, l'art est un ensemble de propriétés communes à toutes les pratiques et productions artistiques. L'art est un mode de transmission : il exprime, communique et ses fonctions ne sont pas uniquement esthétiques.
Il transmet tout l'héritage culturel accumulé par les générations. La place qu'il occupe dans la civilisation humaine lui donne une ampleur analogue à celle de la science et de la religion. Lorsqu'un artiste crée, c'est ce qu'il a vu, ressenti ou compris qu'il communique aux autres. Sous forme d'un symbole verbal, visuel ou musical, il partage les fruits de sa pensée, de sa sensibilité, de son imagination. Sa production traduit son drame personnel qui n'est pas celui d'un individu mais qui participe aux mouvements psychiques qui agitent son groupe culturel, voire l'ensemble de l'humanité. Par un ressenti différent, par une façon différente d'exprimer ce ressenti et par des moyens d'expressions différents, une multitude d'artistes peuvent développer un même processus créateur et transmettre un message identique même si ce message n'est pas directement perceptible étant donné d'une part l'infinité d'interprétations de ce message et d'autre part l'impact de l'époque, orientant parfois l'artiste dans la recherche de son style.
À ce niveau de réflexion, il est utile de se poser un certain nombre de questions : dans quelle mesure les arts sont-ils analogues ? Dans quelle mesure diffèrent-ils entre eux ? Dans quelle mesure est il possible de transférer les effets produits par un art dans un autre art ? Quelles correspondances peut-il y avoir entre des structures musicales et des structures visuelles ? C'est pour éclaircir ces questions qu'un certain nombre d'auteurs (comme je l'ai cité plus haut) se sont livrés à des tentatives de classifications. C'est au cours de ces tentatives que s'est précisée une inévitable correspondance entre les différentes formes d'art. Ces tentatives ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Au fil des différentes époques, nombreux sont les penseurs qui ont pressenti, avec une conscience plus ou moins grande, une correspondance entre les sensations produites par la musique et par la peinture. Dès le Moyen Âge, l'architecture des cathédrales et les créations musicales, d'une inspiration essentiellement religieuse, sont générées par un même souci d'unité symbolique. La Renaissance, en se libérant des règles strictes imposées par le clergé, facilite le développement formel et ouvre davantage les arts aux émotions humaines. Au XVIIe siècle, le style baroque donne à l'esthétique du plaisir et de la sensualité une importance démesurée dans un contexte richissime et pompeux : musique, danse et ballet, théâtre, peinture répondent à une même pensée créatrice qui fait l'apogée culturelle de ce siècle. En 1740, dans un traité sur l'optique des couleurs présentant une analyse scientifique des correspondances du sonore et du visuel, Louis Bertrand Castel (1688-1757) présente la musique et la peinture comme illustrations d'un courant général d'origine aussi bien littéraire qu'esthétique ou scientifique. Il assimile les trois couleurs fondamentales, rouge bleu jaune, aux trois notes de l'accord parfait. Il assimile également les sept degrés de la gamme tempérée aux couleurs du spectre. Au XVIIIe siècle, nombreuses sont les études menées à propos des arts : Jean Jacques Rousseau dans son dictionnaire de la musique, à l'article Imitation, écrit :
" La musique semble mettre l'oeil dans l'oreille,
Signature :
Céline Moretti-maqua
Masques de parade et masques de théâtre
Depuis l'Antiquité, le passage progressif du masque d'un aspect cultuel ou religieux à un aspect théâtral, le conduit à son apogée dans la commedia dell'arte aux XVIe et XVIIe siècles. Le style et les personnages de la comédie improvisée lui confèrent un pouvoir expressif très fort. Les personnages traditionnels dont nous allons trouver les définitions illustrées enrichissent les acteurs en leur donnant un pouvoir presque diabolique.
Au XVIIIe siècle, l'usage du masque chez des auteurs fondamentaux comme Goldoni, Chiari et Gozzi, dont les points de vue sur la réforme du théâtre vénitien divergent quelque peu engendre une polémique littéraire. Si Goldoni, en effet, se sert du masque pour faire passer ses idées illuministes, Chiari les supprime pour préserver le monde passé de l'Arcadie et Gozzi quant à lui les réhabilite pour retrouver le plaisir simple et naïf des anciennes comédies. Ce point de divergence peut paraître un détail mais il revêt une importance certaine qu'il nous est nécessaire de survoler même si c'est l'uvre de Goldoni qui retiendra notre attention dans une autre partie de cette étude.
Du rite au théâtre
Le masque, originellement destiné à des cérémonies festives s'est peu à peu éloigné du cultuel et du religieux au profit de la littérature et de l'art. Théâtre et carnaval se rejoignent et reposent tous deux sur le déguisement et le masque, communs au spectacle et à la fête. Le carnaval, base de toute la dramaturgie occidentale, est une théâtralisation du combat de l'été et de l'hiver commune à de nombreuses civilisations. Dans l'Antiquité, carnaval et rites dionysiaques donnent naissance au théâtre grec dans lequel, tragédie, comédie et carnaval se fondent dans la part archaïque de l'homme. Les chants narratifs héroïques, origine de la tragédie, issus des chants et churs dionysiaques donnent naissance à des parades carnavalesques, source de la comédie. Tragédie ou comédie sont alors le passage d'un rituel spectaculaire à un spectacle rituel, la tragédie étant liée au culte des morts et la comédie aux esprits de la fertilité.
"Les danses du bouc, animal favori des dieux, se changent en tragédies, les chants des cosmates en comédies et les acteurs, le visage masqué, incarnent des immortels, des héros ou plus simplement des citoyens capables de juger le pouvoir et d'assumer la critique sociale".
Les mythes, la morale, les ancêtres, les choeurs des citoyens et les dieux se donnent alors en spectacle. Le but est de grandir l'homme, d'ennoblir ses pensées.
La comédie ancienne comporte un élément essentiel de la fête carnavalesque. Elle joue un rôle libérateur à travers le temps et l'espace, rejoignant en cela la problématique et l'esprit critique du carnaval. Elle comporte d'une part des churs masqués issus d'anciens cultes zoomorphiques et d'autre part elle trouve sa singularité dans le fait qu'elle est une moquerie rituelle des dieux et des autorités. Elle donne de cette façon l'illusion d'une cité nouvelle. La comédie ancienne apparaît comme une institutionnalisation de fêtes carnavalesques qui auraient pris la forme de représentations théâtrales. A partir du IIIe siècle, certains farceurs jouent leurs parodies sur les places publiques de la Sicile et de l'Italie méridionale, assurant une transition entre le théâtre grec et le théâtre latin. Une tradition d'acteurs ambulants et de farces populaires à caractère de mascarade apparaît alors, ainsi que de nombreuses représentations funèbres à masques comiques. Des paysans dans leur langage coutumier improvisent sur les thèmes de leur vie quotidienne créant des types fixes à partir de personnages caractéristiques. Il s'agit de l'Atellane. Farce burlesque souvent obscène, elle est généralement jouée à la suite d'un spectacle tragique et débouche sur la création de quatre masques carnavalesques qui ne sont pas sans rapport avec les masques de la commedia dell'arte : Maccus, le glouton ; Bucco, le bavard imbécile ; Pappus, le vieux gâteux ; Dossennus, le
Signature :
Céline Moretti-maqua
Lire plus
Au XVIIIe siècle, l'usage du masque chez des auteurs fondamentaux comme Goldoni, Chiari et Gozzi, dont les points de vue sur la réforme du théâtre vénitien divergent quelque peu engendre une polémique littéraire. Si Goldoni, en effet, se sert du masque pour faire passer ses idées illuministes, Chiari les supprime pour préserver le monde passé de l'Arcadie et Gozzi quant à lui les réhabilite pour retrouver le plaisir simple et naïf des anciennes comédies. Ce point de divergence peut paraître un détail mais il revêt une importance certaine qu'il nous est nécessaire de survoler même si c'est l'uvre de Goldoni qui retiendra notre attention dans une autre partie de cette étude.
Du rite au théâtre
Le masque, originellement destiné à des cérémonies festives s'est peu à peu éloigné du cultuel et du religieux au profit de la littérature et de l'art. Théâtre et carnaval se rejoignent et reposent tous deux sur le déguisement et le masque, communs au spectacle et à la fête. Le carnaval, base de toute la dramaturgie occidentale, est une théâtralisation du combat de l'été et de l'hiver commune à de nombreuses civilisations. Dans l'Antiquité, carnaval et rites dionysiaques donnent naissance au théâtre grec dans lequel, tragédie, comédie et carnaval se fondent dans la part archaïque de l'homme. Les chants narratifs héroïques, origine de la tragédie, issus des chants et churs dionysiaques donnent naissance à des parades carnavalesques, source de la comédie. Tragédie ou comédie sont alors le passage d'un rituel spectaculaire à un spectacle rituel, la tragédie étant liée au culte des morts et la comédie aux esprits de la fertilité.
"Les danses du bouc, animal favori des dieux, se changent en tragédies, les chants des cosmates en comédies et les acteurs, le visage masqué, incarnent des immortels, des héros ou plus simplement des citoyens capables de juger le pouvoir et d'assumer la critique sociale".
Les mythes, la morale, les ancêtres, les choeurs des citoyens et les dieux se donnent alors en spectacle. Le but est de grandir l'homme, d'ennoblir ses pensées.
La comédie ancienne comporte un élément essentiel de la fête carnavalesque. Elle joue un rôle libérateur à travers le temps et l'espace, rejoignant en cela la problématique et l'esprit critique du carnaval. Elle comporte d'une part des churs masqués issus d'anciens cultes zoomorphiques et d'autre part elle trouve sa singularité dans le fait qu'elle est une moquerie rituelle des dieux et des autorités. Elle donne de cette façon l'illusion d'une cité nouvelle. La comédie ancienne apparaît comme une institutionnalisation de fêtes carnavalesques qui auraient pris la forme de représentations théâtrales. A partir du IIIe siècle, certains farceurs jouent leurs parodies sur les places publiques de la Sicile et de l'Italie méridionale, assurant une transition entre le théâtre grec et le théâtre latin. Une tradition d'acteurs ambulants et de farces populaires à caractère de mascarade apparaît alors, ainsi que de nombreuses représentations funèbres à masques comiques. Des paysans dans leur langage coutumier improvisent sur les thèmes de leur vie quotidienne créant des types fixes à partir de personnages caractéristiques. Il s'agit de l'Atellane. Farce burlesque souvent obscène, elle est généralement jouée à la suite d'un spectacle tragique et débouche sur la création de quatre masques carnavalesques qui ne sont pas sans rapport avec les masques de la commedia dell'arte : Maccus, le glouton ; Bucco, le bavard imbécile ; Pappus, le vieux gâteux ; Dossennus, le
Signature :
Céline Moretti-maqua
Pour une histoire musicale du masque
L'évolution de la musique au fil des temps, tout comme pour le théâtre ou la peinture, est un élément incontournable de notre étude, en ce sens qu'elle témoigne de l'inévitable association du masque à ses diverses transformations. Ainsi, à l'origine de nos civilisations, masque et musique sont-ils étroitement liés, de par leur essence même. Associés tous les deux à la danse, ils représentent des outils privilégiés de communication avec les forces supérieures. L'Antiquité en fera les instruments fondamentaux de son théâtre. Anonyme et rituelle chez les Grecs nous allons voir comment la chrétienté la remet en question, puis, comment du sacré et semi liturgique, elle devient carrément profane pour s'élargir à la Renaissance en donnant le jour à l'opéra. Afin d'éviter toute dispersion du sujet, car le thème de l'opéra est immense, c'est l'évolution de cet opéra sous l'influence masquée de la commedia dell'arte qui retiendra notre attention. C'est en effet le genre populaire de l'opéra, l'opera buffa, qui permet la conjugaison des livrets de Goldoni et de la musique de Galuppi comme nous le verrons dans la troisième partie à travers l'analyse d'uvres précises et ciblées.
Les origines du masque en musique
Quarante mille ans de musique se sont écoulés, mais il faut attendre un stade de civilisation très avancé pour que la musique apparaisse comme uvre d'art. Ses premières manifestations sont d'ordre magique. La musique est au sens propre du terme, le langage des dieux. En se l'appropriant, l'homme peut entrer en contact avec les dieux ou les esprits, se les rendre favorables, les amadouer ou les contraindre. Il peut aussi par ses chants et ses danses, envoûter le gibier ou éventuellement la tribu ennemie et rendre ainsi efficace la chasse qui conditionne sa survie. La musique règle la vie de la tribu ; elle conditionne aussi bien les mariages ou les rites funéraires que les initiations, les fêtes ou les départs en chasse ou en guerre.
A mesure que la société évolue, le rôle de la musique se diversifie. Jusqu'à l'aube du christianisme, elle demeure inséparable des fêtes, processions ou sacrifices publics et accompagne la naissance des mystères initiatiques, tout comme celle de la tragédie grecque. Elle deviendra, de par ses origines même, un des éléments essentiels du théâtre primitif. La musique imprègne alors la vie individuelle ou sociale des Grecs et se retrouve dans d'innombrables manifestations, religieuses ou non, de la cité. Présente partout, elle est anonyme, rituelle et fonctionnelle. Elle figure d'ailleurs comme une des quatre disciplines majeures du Quadrivium universitaire, aux côtés de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie. Telle qu'elle correspond aux données de sa théorie, la musique grecque vit à peu près jusqu'à la fin du troisième siècle avant d'être supplantée par la rapide croissance d'une musique chrétienne, latine, byzantine ou franque. Une autre civilisation musicale s'instaure alors dans le sillage de la nouvelle religion.
Musique et masque au Moyen Âge
L'Église naissante répudie avec violence tout résidu de mentalité païenne et décide d'abandonner les signes extérieurs de la piété judaïque dont la musique faisait partie. Elle instaure le plain chant qui s'oppose consciemment et volontairement aux excitations malfaisantes de la musique païenne antérieure. Confrontée au problème du rôle de la musique non seulement dans le culte, mais aussi dans la vie courante, l'Église des cinq premiers siècles réagit diversement. Coupable de paganisme pour les uns, moyen privilégié d'approcher Dieu pour les autres, l'existence même de la musique se trouve mise en question avec la propagation de la chrétienté et une nouvelle civilisation musicale peut voir le jour.
D'abord monodique jusqu'au neuvième siècle, elle devient polyphonique et peut se dévélopper de différentes manières et sous différentes formes. D'essence purement religieuse, la musique subit cependant l'introduction de nombreux éléments pro
Signature :
Céline Moretti-maqua
Lire plus
Les origines du masque en musique
Quarante mille ans de musique se sont écoulés, mais il faut attendre un stade de civilisation très avancé pour que la musique apparaisse comme uvre d'art. Ses premières manifestations sont d'ordre magique. La musique est au sens propre du terme, le langage des dieux. En se l'appropriant, l'homme peut entrer en contact avec les dieux ou les esprits, se les rendre favorables, les amadouer ou les contraindre. Il peut aussi par ses chants et ses danses, envoûter le gibier ou éventuellement la tribu ennemie et rendre ainsi efficace la chasse qui conditionne sa survie. La musique règle la vie de la tribu ; elle conditionne aussi bien les mariages ou les rites funéraires que les initiations, les fêtes ou les départs en chasse ou en guerre.
A mesure que la société évolue, le rôle de la musique se diversifie. Jusqu'à l'aube du christianisme, elle demeure inséparable des fêtes, processions ou sacrifices publics et accompagne la naissance des mystères initiatiques, tout comme celle de la tragédie grecque. Elle deviendra, de par ses origines même, un des éléments essentiels du théâtre primitif. La musique imprègne alors la vie individuelle ou sociale des Grecs et se retrouve dans d'innombrables manifestations, religieuses ou non, de la cité. Présente partout, elle est anonyme, rituelle et fonctionnelle. Elle figure d'ailleurs comme une des quatre disciplines majeures du Quadrivium universitaire, aux côtés de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie. Telle qu'elle correspond aux données de sa théorie, la musique grecque vit à peu près jusqu'à la fin du troisième siècle avant d'être supplantée par la rapide croissance d'une musique chrétienne, latine, byzantine ou franque. Une autre civilisation musicale s'instaure alors dans le sillage de la nouvelle religion.
Musique et masque au Moyen Âge
L'Église naissante répudie avec violence tout résidu de mentalité païenne et décide d'abandonner les signes extérieurs de la piété judaïque dont la musique faisait partie. Elle instaure le plain chant qui s'oppose consciemment et volontairement aux excitations malfaisantes de la musique païenne antérieure. Confrontée au problème du rôle de la musique non seulement dans le culte, mais aussi dans la vie courante, l'Église des cinq premiers siècles réagit diversement. Coupable de paganisme pour les uns, moyen privilégié d'approcher Dieu pour les autres, l'existence même de la musique se trouve mise en question avec la propagation de la chrétienté et une nouvelle civilisation musicale peut voir le jour.
D'abord monodique jusqu'au neuvième siècle, elle devient polyphonique et peut se dévélopper de différentes manières et sous différentes formes. D'essence purement religieuse, la musique subit cependant l'introduction de nombreux éléments pro
Signature :
Céline Moretti-maqua
Les représentations picturales du masque des origines au XVIIIème siècle
La fascination du masque sur les plasticiens depuis l'Antiquité nous renseigne sur son importance dans le message artistique et culturel. A travers un historique illustré d'uvres significatives, nous allons examiner rapidement toutes les périodes, pour nous arrêter à Venise au XVIIIe siècle sans nous attarder toutefois sur les peintres les plus représentatifs de l'usage du masque à cette époque, Tiepolo et Longhi. Ils seront en effet largement présentés dans une troisième partie, et leurs uvres majeures feront l'objet d'une analyse plus fine.
Les représentations du masque dans l'Antiquité
Les mythes, premières créations de l'imagination humaine naissent du besoin profond d'une interprétation allégorique de tous les phénomènes de la vie. La crainte de l'homme face aux forces incontrôlables de la nature, ses angoisses métaphysiques, les règles morales sur lesquelles il allait fonder sa vie et les relations avec ses semblables, sont la source d'inspiration de récits fabuleux, au contenu symbolique. Les Grecs, sont parmi les peuples les plus anciens à élaborer des mythes. Ils font naître de leurs esprits des êtres suprêmes, les dieux, qui gouvernent l'univers et déterminent la destinée humaine. Ces dieux, deviennent l'objet de leur culte.
Le masque, présent dans toutes les religions et dans tous les systèmes philosophiques, sorte de subterfuge théologique, permet de matérialiser le face à face entre l'homme et Dieu, ultime et impossible fascination. Heinrich Schliemann en 1876 découvre les fouilles sur l'Acropole de Mycènes et trouve parmi les trésors inhumés des tombes royales les premiers masques en or du monde helladique destinés à couvrir les visages de certains défunts, notamment ceux des rois mycéniens comme ce masque funéraire en or, appelé par les archéologues Masque d'Agamemnon en raison de son expression à la fois austère et noble. Cependant, sa datation ne permet pas de l'attribuer à Agamemnon, qui vécut quatre siècles plus tard.
Hormis les masques mortuaires, de nombreux autres masques sont édifiés en l'honneur de certaines divinités. Bien que ne faisant pas partie des douze dieux de l'Olympe, Dionysos est très présent dans le monde hellénique. Sa vie et ses aventures inspirent la création du drame satirique, de la tragédie et de la comédie, en un mot, du théâtre. Il est donc normal de lui rendre des honneurs particuliers. Il trouve son expression dans le délire et le maniement du masque. Dionysos et sa suite nous présente des acteurs encore vêtus de leur costume de théâtre mais qui ont déjà ôté leur masque qu'ils tiennent en main et se reposent à la suite d'une représentation satirique.
D'autres masques, comme le Gorgoneion, masque de la Gorgone, servent à détourner les influences maléfiques et font souvent partie du trésor des temples. Ils se retrouvent sur les boucliers, poteries, tuiles ou frontons des édifices publics ou privés dans toute l'Antiquité. Sur l'amphore représentée ci-après sont représentés Héracles et Géryon. Le géant à trois corps, protégé par un bouclier décoré d'un Gorgoneïon, attaque avec sa lance Héraclés qui lève son épée.
Mais le masque grec par excellence est sans doute le prosopon ou prosopeion. A usage scénique, cultuel, rituel ou initiatique, il se conçoit comme un visage. Visible, visuel et capable de voir, le prosopon est la face qui se propose à la vue. Partie frontale de la tête, il établit plus efficacement le contact avec autrui. Le prosopon masque est alors un moyen de communication : il parle, il regarde, il exprime. Ces masques de dieux ou de héros qui nous sont présentés à travers la gravure suivante sont utilisés pour les représentations de tragédies grecques. Certaines conventions permettent au public d'identifier les personnages.
Le masque antique, s'il revêt une grande importance chez les Grecs, n'est pas abandonné pour autant chez les Romains. De culture et de conception différentes, le masque romain possède une symbolique tout aussi forte que le masque grec. Le ma
Signature :
Céline Moretti-Maqua
Lire plus
Les représentations du masque dans l'Antiquité
Les mythes, premières créations de l'imagination humaine naissent du besoin profond d'une interprétation allégorique de tous les phénomènes de la vie. La crainte de l'homme face aux forces incontrôlables de la nature, ses angoisses métaphysiques, les règles morales sur lesquelles il allait fonder sa vie et les relations avec ses semblables, sont la source d'inspiration de récits fabuleux, au contenu symbolique. Les Grecs, sont parmi les peuples les plus anciens à élaborer des mythes. Ils font naître de leurs esprits des êtres suprêmes, les dieux, qui gouvernent l'univers et déterminent la destinée humaine. Ces dieux, deviennent l'objet de leur culte.
Le masque, présent dans toutes les religions et dans tous les systèmes philosophiques, sorte de subterfuge théologique, permet de matérialiser le face à face entre l'homme et Dieu, ultime et impossible fascination. Heinrich Schliemann en 1876 découvre les fouilles sur l'Acropole de Mycènes et trouve parmi les trésors inhumés des tombes royales les premiers masques en or du monde helladique destinés à couvrir les visages de certains défunts, notamment ceux des rois mycéniens comme ce masque funéraire en or, appelé par les archéologues Masque d'Agamemnon en raison de son expression à la fois austère et noble. Cependant, sa datation ne permet pas de l'attribuer à Agamemnon, qui vécut quatre siècles plus tard.
Hormis les masques mortuaires, de nombreux autres masques sont édifiés en l'honneur de certaines divinités. Bien que ne faisant pas partie des douze dieux de l'Olympe, Dionysos est très présent dans le monde hellénique. Sa vie et ses aventures inspirent la création du drame satirique, de la tragédie et de la comédie, en un mot, du théâtre. Il est donc normal de lui rendre des honneurs particuliers. Il trouve son expression dans le délire et le maniement du masque. Dionysos et sa suite nous présente des acteurs encore vêtus de leur costume de théâtre mais qui ont déjà ôté leur masque qu'ils tiennent en main et se reposent à la suite d'une représentation satirique.
D'autres masques, comme le Gorgoneion, masque de la Gorgone, servent à détourner les influences maléfiques et font souvent partie du trésor des temples. Ils se retrouvent sur les boucliers, poteries, tuiles ou frontons des édifices publics ou privés dans toute l'Antiquité. Sur l'amphore représentée ci-après sont représentés Héracles et Géryon. Le géant à trois corps, protégé par un bouclier décoré d'un Gorgoneïon, attaque avec sa lance Héraclés qui lève son épée.
Mais le masque grec par excellence est sans doute le prosopon ou prosopeion. A usage scénique, cultuel, rituel ou initiatique, il se conçoit comme un visage. Visible, visuel et capable de voir, le prosopon est la face qui se propose à la vue. Partie frontale de la tête, il établit plus efficacement le contact avec autrui. Le prosopon masque est alors un moyen de communication : il parle, il regarde, il exprime. Ces masques de dieux ou de héros qui nous sont présentés à travers la gravure suivante sont utilisés pour les représentations de tragédies grecques. Certaines conventions permettent au public d'identifier les personnages.
Le masque antique, s'il revêt une grande importance chez les Grecs, n'est pas abandonné pour autant chez les Romains. De culture et de conception différentes, le masque romain possède une symbolique tout aussi forte que le masque grec. Le ma
Signature :
Céline Moretti-Maqua
Le masque à Venise au XVIIIème siècle: Baldassare Galuppi et Pietro Longhi
Le masque à Venise au XVIIIème siècle : Baldassare Galuppi et Pietro Longhi.
L'analyse comparée des sensations visuelles et sonores n'est pas nouvelle; au fil des différentes époques, nombreux sont les penseurs qui ont pressenti, avec une conscience plus ou moins grande, une correspondance entre les sensations produites par la musique et la peinture. Dés le Moyen-âge, l'architecture des cathédrales et les créations musicales, d'une inspiration essentiellement religieuse, sont générées par un même souci d'unité symbolique. La Renaissance, en se libérant des règles strictes imposées par le clergé, facilite le développement formel et ouvre davantage les arts aux émotions humaines. Au XVIIème siècle, le style Baroque donne à l'esthétique du plaisir et de la sensualité une importance démesurée dans un contexte richissime et pompeux: musique, danse et ballet, théâtre, peinture répondent à une même pensée créatrice qui fait l'apogée culturelle de ce siècle.
En 1740, dans un traité sur l'optique des couleurs présentant une analyse scientifique des correspondances du sonore et du visuel, Louis Bertrand Castel (1688-1757) présente la musique et la peinture comme illustrations d'un courant général d'origine aussi bien littéraire qu'esthétique ou scientifique. Il assimile les trois couleurs fondamentales, rouge bleu jaune, aux trois notes de l'accord parfait. Il assimile également les sept degrés de la gamme tempérée aux couleurs du spectre.
Au XVIIIème siècle, nombreuses sont les études menées à propos des arts: Jean Jacques Rousseau dans son dictionnaire de la musique, à l'article Imitation, écrit:
" La musique semble mettre l'oeil dans l'oreille, et la plus grande merveille d'un art qui n'agit que par le mouvement, est de pouvoir former jusqu'à l'image du repos. La nuit, le sommeil, la solitude et le silence entrent dans le nombre des grands tableaux de musique."
Il associe le dessin à la mélodie, l'harmonie à la couleur; pour lui, la richesse harmonique et les couleurs amènent à un plaisir sensuel.
Plus tard, Etienne Souriau, dans sa Correspondance des arts,, classe les arts selon une forme circulaire à deux niveaux. Le premier niveau concerne les arts non représentatifs, abstraits dans leur concept (la musique), le deuxième concerne les arts représentatifs (la peinture). Il définit sept tranches correspondant aux notions de ligne, de volume, de couleur, de lumière, de mouvement, de son articulé, de son musical, chaque notion pouvant s'appliquer aux deux niveaux. Il prétend que chaque époque témoigne d'un caractère multiple et unitaire du langage formel, et que les oeuvres picturales et musicales font appel beaucoup plus à une culture qu'à la nature.
Si les différentes oeuvres sont d'une même essence culturelle, on peut se demander pourquoi il n'existe que peu d'études nous démontrant une éventuelle correspondance entre musique et peinture dans le XVIIIème siècle vénitien, malgré les nombreuses idées nouvelles et réformes socio-culturelles de cette époque. Cette société, toute d'apparence n'a peut être pas suscité l'intérêt qu'elle mérite. En effet cette apparence "masquée" cache une multitude de paradoxes étroitement liés au contexte de l'époque; musique et peinture n'échappent pas à cette influence. Il semble intéressant, au travers des oeuvres du peintre Pietro Longhi et du compositeur Baldassare Galuppi, témoins de leur époque, utilisant le masque comme objet symbolique et didactique, d'essayer d'établir une analogie entre la peinture et la musique du Settecento vénitien.
Un contexte socio culturel
La cité des doges connaît pendant le Settecento une situation économique et politique médiocre. Entrée dans un processus d'évolution inéluctable, Venise se rapproche de son déclin. La noblesse, maintenant décadente, fait l'objet de la critique. La bourgeoisie prend de l'importance et un nouvel esprit contestataire est en gestation. D'abord aveugle et sourde à la lente transformation des moeurs et des idées, Venise se lais
Signature :
Céline Moretti-maqua
Lire plus
L'analyse comparée des sensations visuelles et sonores n'est pas nouvelle; au fil des différentes époques, nombreux sont les penseurs qui ont pressenti, avec une conscience plus ou moins grande, une correspondance entre les sensations produites par la musique et la peinture. Dés le Moyen-âge, l'architecture des cathédrales et les créations musicales, d'une inspiration essentiellement religieuse, sont générées par un même souci d'unité symbolique. La Renaissance, en se libérant des règles strictes imposées par le clergé, facilite le développement formel et ouvre davantage les arts aux émotions humaines. Au XVIIème siècle, le style Baroque donne à l'esthétique du plaisir et de la sensualité une importance démesurée dans un contexte richissime et pompeux: musique, danse et ballet, théâtre, peinture répondent à une même pensée créatrice qui fait l'apogée culturelle de ce siècle.
En 1740, dans un traité sur l'optique des couleurs présentant une analyse scientifique des correspondances du sonore et du visuel, Louis Bertrand Castel (1688-1757) présente la musique et la peinture comme illustrations d'un courant général d'origine aussi bien littéraire qu'esthétique ou scientifique. Il assimile les trois couleurs fondamentales, rouge bleu jaune, aux trois notes de l'accord parfait. Il assimile également les sept degrés de la gamme tempérée aux couleurs du spectre.
Au XVIIIème siècle, nombreuses sont les études menées à propos des arts: Jean Jacques Rousseau dans son dictionnaire de la musique, à l'article Imitation, écrit:
" La musique semble mettre l'oeil dans l'oreille, et la plus grande merveille d'un art qui n'agit que par le mouvement, est de pouvoir former jusqu'à l'image du repos. La nuit, le sommeil, la solitude et le silence entrent dans le nombre des grands tableaux de musique."
Il associe le dessin à la mélodie, l'harmonie à la couleur; pour lui, la richesse harmonique et les couleurs amènent à un plaisir sensuel.
Plus tard, Etienne Souriau, dans sa Correspondance des arts,, classe les arts selon une forme circulaire à deux niveaux. Le premier niveau concerne les arts non représentatifs, abstraits dans leur concept (la musique), le deuxième concerne les arts représentatifs (la peinture). Il définit sept tranches correspondant aux notions de ligne, de volume, de couleur, de lumière, de mouvement, de son articulé, de son musical, chaque notion pouvant s'appliquer aux deux niveaux. Il prétend que chaque époque témoigne d'un caractère multiple et unitaire du langage formel, et que les oeuvres picturales et musicales font appel beaucoup plus à une culture qu'à la nature.
Si les différentes oeuvres sont d'une même essence culturelle, on peut se demander pourquoi il n'existe que peu d'études nous démontrant une éventuelle correspondance entre musique et peinture dans le XVIIIème siècle vénitien, malgré les nombreuses idées nouvelles et réformes socio-culturelles de cette époque. Cette société, toute d'apparence n'a peut être pas suscité l'intérêt qu'elle mérite. En effet cette apparence "masquée" cache une multitude de paradoxes étroitement liés au contexte de l'époque; musique et peinture n'échappent pas à cette influence. Il semble intéressant, au travers des oeuvres du peintre Pietro Longhi et du compositeur Baldassare Galuppi, témoins de leur époque, utilisant le masque comme objet symbolique et didactique, d'essayer d'établir une analogie entre la peinture et la musique du Settecento vénitien.
Un contexte socio culturel
La cité des doges connaît pendant le Settecento une situation économique et politique médiocre. Entrée dans un processus d'évolution inéluctable, Venise se rapproche de son déclin. La noblesse, maintenant décadente, fait l'objet de la critique. La bourgeoisie prend de l'importance et un nouvel esprit contestataire est en gestation. D'abord aveugle et sourde à la lente transformation des moeurs et des idées, Venise se lais
Signature :
Céline Moretti-maqua
Le masque à Venise au XVIIIème siècle : Baldassare Galuppi et Carlo Goldoni
La Venise du XVIIIème siècle, berceau des arts et de la culture, cité auréolée de mystères et de poésie, se complaît à se représenter en ses mille formes différentes, se drapant dans la grandeur d'une existence chimérique symbolisant son statut de république fière et puissante. Musique et chant ne sont pas réservés à une élite mais font partie de la culture populaire, des divertissements que les grands donnent au peuple. C'est à travers l'opera buffa, et notamment à travers l'uvre de Galuppi et Goldoni que l'illustration de cette ville magique est la plus significative. Lieu de recherche stylistique où s'affirment d'excellents compositeurs, ce genre offre un vaste panorama de la société au public. Témoins précieux de l'histoire de la ville éternelle, Galuppi et Goldoni font en effet partie de ces artistes dont on prend plaisir à étudier les subtilités, la finesse, la précision documentaire et le réalisme avec lesquels ils nous renseignent sur leur époque.
Goldoni, maître incontestable de l'opera buffa.
Le livret d'opéra a souvent poser problème tout au long de l'histoire de la musique. Langage verbal et langage musical étant en contradiction sur le plan formel, la liaison parole et musique reste bien souvent une problématique d'importance. Goldoni est sans doute l'auteur qui fournit le plus ample corpus européen de textes comiques pour la musique (quinze intermèdes et cinquante-cinq opéras).
Dans ses livrets le caractère des personnages ne peut avoir toute la profondeur de réalisation des grandes comédies théâtrales. Mais autour des pilônes gracieux de la farce et de l'intermède, l'atmosphère respire la comédie musicale. L'idée de temps n'entre plus dans ses livrets: la nature est mère et guide l'action; les diverses façons des patriciens et de la bourgeoisie vénitienne sont représentées; le goût de l'exotisme est très présent ainsi qu'une certaine malice dans une sphère érotique; une nouvelle présence des arts et des métiers, un intérêt pour le travail de la campagne y est merveilleusement décrit. On découvre alors un spectacle musical, de la fête plus ou moins carnavalesque, qui était traditionnellement adaptés aux théâtres vénitiens.
Il donne à ses personnages une épaisseur et une vérité qui n'étaient pas présentes dans les livrets baroques. "Il a créé" écrit Brunnel
"les demi caractères, des personnages plus nuancés, plus souples, qui ne se réduisent pas à des pantins mais peuvent être émus et émouvants. Le comique de situation dés lors s'intériorise et au déterminisme du geste automatique se substitue la motivation psychologique."
Alors que l'opéra de Metastasio était la célébration de la vie de cour et une exaltation du pouvoir absolu du souverain, l'opéra bouffe de Goldoni s'oriente, lui, vers un illuminisme populaire et devient l'expression la plus caractéristique et la plus mûre de l'opéra italien du Settecento. L'auteur s'attache à insérer dans le drame joyeux la mentalité bourgeoise, faisant du genre bouffe un genre artistique, littéraire et social plus que jamais sérieux. Dans ses intermèdes et ses opéras bouffes, la qualité principale de l'expression domine autant que dans toutes autres compositions.
En réalité, le comique quotidien et la mimesis de la langue de tous les jours acquièrent une réelle primauté sur le langage des rois, des dieux, des héros et des pasteurs.
Malgré son habileté extraordinaire dans l'invention théâtrale, c'est de sa collaboration avec Galuppi que naissent les plus beaux chefs-d'uvre. Ensemble, ils donnent à l'opera buffa la dimension comique qui lui manquait.
Baldassare Galuppi, compositeur au temps de Casanova
Galuppi est certainement un des compositeurs les plus réputés de la Venise du XVIIIème siècle. Il naît à Burano, île proche de Venise en 1706, ce qui lui vaudra le surnom de Buranello, et meurt à Venise en 1785. En 1740, il se tourne vers ce qui allait être sa véritable voix: la composition d'opera buffa. Le sujet de ses opéras correspond souvent à la vie s
Lire plus
Goldoni, maître incontestable de l'opera buffa.
Le livret d'opéra a souvent poser problème tout au long de l'histoire de la musique. Langage verbal et langage musical étant en contradiction sur le plan formel, la liaison parole et musique reste bien souvent une problématique d'importance. Goldoni est sans doute l'auteur qui fournit le plus ample corpus européen de textes comiques pour la musique (quinze intermèdes et cinquante-cinq opéras).
Dans ses livrets le caractère des personnages ne peut avoir toute la profondeur de réalisation des grandes comédies théâtrales. Mais autour des pilônes gracieux de la farce et de l'intermède, l'atmosphère respire la comédie musicale. L'idée de temps n'entre plus dans ses livrets: la nature est mère et guide l'action; les diverses façons des patriciens et de la bourgeoisie vénitienne sont représentées; le goût de l'exotisme est très présent ainsi qu'une certaine malice dans une sphère érotique; une nouvelle présence des arts et des métiers, un intérêt pour le travail de la campagne y est merveilleusement décrit. On découvre alors un spectacle musical, de la fête plus ou moins carnavalesque, qui était traditionnellement adaptés aux théâtres vénitiens.
Il donne à ses personnages une épaisseur et une vérité qui n'étaient pas présentes dans les livrets baroques. "Il a créé" écrit Brunnel
"les demi caractères, des personnages plus nuancés, plus souples, qui ne se réduisent pas à des pantins mais peuvent être émus et émouvants. Le comique de situation dés lors s'intériorise et au déterminisme du geste automatique se substitue la motivation psychologique."
Alors que l'opéra de Metastasio était la célébration de la vie de cour et une exaltation du pouvoir absolu du souverain, l'opéra bouffe de Goldoni s'oriente, lui, vers un illuminisme populaire et devient l'expression la plus caractéristique et la plus mûre de l'opéra italien du Settecento. L'auteur s'attache à insérer dans le drame joyeux la mentalité bourgeoise, faisant du genre bouffe un genre artistique, littéraire et social plus que jamais sérieux. Dans ses intermèdes et ses opéras bouffes, la qualité principale de l'expression domine autant que dans toutes autres compositions.
En réalité, le comique quotidien et la mimesis de la langue de tous les jours acquièrent une réelle primauté sur le langage des rois, des dieux, des héros et des pasteurs.
Malgré son habileté extraordinaire dans l'invention théâtrale, c'est de sa collaboration avec Galuppi que naissent les plus beaux chefs-d'uvre. Ensemble, ils donnent à l'opera buffa la dimension comique qui lui manquait.
Baldassare Galuppi, compositeur au temps de Casanova
Galuppi est certainement un des compositeurs les plus réputés de la Venise du XVIIIème siècle. Il naît à Burano, île proche de Venise en 1706, ce qui lui vaudra le surnom de Buranello, et meurt à Venise en 1785. En 1740, il se tourne vers ce qui allait être sa véritable voix: la composition d'opera buffa. Le sujet de ses opéras correspond souvent à la vie s
L'iconographie bachique à Pompeï : un parcours pictural riche d'interprétations.
L'iconographie bachique à Pompéi : un parcours pictural riche d'interprétations.
Cité de moyenne importance comptant environ 20000 habitants, Pompéi est sans doute parmi les sites archéologiques le plus connu du monde. Cette renommée universelle s'est établie dès le moment de sa redécouverte il y a deux siècles et demi et les fouilles entamées au XVIIIème siècle nous laissaient déjà un témoignage précis de la ville, de ses habitudes et de ses goûts et aspirations. Depuis, l'intérêt pour cette cité n'a fait que s'accroître et engendrer soif de connaissance et curiosité. Fidèle à l'alliance romaine jusqu'en 90 avant J.C, elle a subi de nombreuses influences et s'est affirmée dans un pluralisme, touchant aussi bien l'art et la culture que la vie quotidienne et ses rituels.
Pompéi est véritablement romaine, non seulement parce qu'elle est sous la dépendance de l'état romain, mais surtout parce qu'elle réalise la synthèse des peuples qui au cours des temps se sont succédés sur son sol. Elle se veut un havre de paix où il fait bon vivre. Les pompéiens accordent une grande importance à la philosophie, à ce souvenir non effacé dans le subconscient collectif, des liens de l'homme et de la terre.
La ville, remarquablement conservée, représente un document d'une rare richesse sur la vie romaine au premier siècle de notre ère. Les maisons, fermées sur elles-même, sont de véritables musées, témoins de toute une civilisation. Cette richesse se retrouve dans toutes les demeures et palais, ornés de nombreuses fresques et peintures murales représentant de véritables documentaires sur les us et coutumes des Pompéiens.
I. Le luxe et la richesse du décor
Les intérieurs des villas étonnent par le luxe, la grâce et la sensualité des décorations. Mosaïques et peintures murales sont grandioses et font partie des traditions architecturales. Rien n'est trop beau pour décorer la maison pompéienne qui se doit d'être une invitation au voyage. Dépaysement et rêve sont au centre de ce décor d'évasion qui invite à voyager par l'esprit au delà des murs.
1. L'art de la mosaïque
L'art de la mosaïque est l'un des nombreux emprunts que les romains ont fait aux grecs. Utilisant d'abord la simple association de galets, les artistes ajoutent par la suite des cailloux en petits morceaux, et des tesselles (petits cubes de pierre, de marbre ou de pâte de verre finement taillés), jointes le plus étroitement possible afin de réduire au minimum l'importance des interstices. De dimensions de plus en plus réduites, ces associations permettent la création d'uvres raffinées proches de la peinture. Encore cantonnée dans un rôle secondaire, la mosaÏque sert de complément aux peintures murales ornant les sols de motifs purement décoratifs. L'innovation majeure se trouve dans la décoration des parois et des voûtes, faites de pâtes de verre aux couleurs inédites jusqu'alors (bleu, vert, jaune, or, rouge éclatant) et provoquant d'éclatants jeux de lumière. C'est ce qui fait que la mosaïque va se dissocier de la peinture.
2. L'art pictural
L'art pictural s'épanouit au cours des derniers siècles avant Jésus-Christ et lors des premiers siècles de notre ère chrétienne. Les héros grecs sont les modèles de prédilection des peintres romains. Ils incarnent la grandeur héroïque mais aussi des sentiments plus profonds et une certaine angoisse devant les mystères du monde. Dans le recours à la mythologie, tantôt grave, tantôt ironique ou galant voire érotique, les motifs iconographiques empruntés aux grecs concourent à créer l'illusion d'un monde supérieur dans lequel le spectateur se trouve plongé.
Quatre styles, systèmes de décorations plus que phases stylistiques à proprement parlé, se dégagent de cette peinture. Ils se caractérisent par un traitement différent des équilibres entre les fonds, les encadrements et les sujets.
2.1 Le premier style
Egalement appelé style structurel ou style à incrustation, le premier style s'applique à la peinture réalisée entre 200 et 8
Signature :
Celine Moretti-Maqua
Lire plus
Cité de moyenne importance comptant environ 20000 habitants, Pompéi est sans doute parmi les sites archéologiques le plus connu du monde. Cette renommée universelle s'est établie dès le moment de sa redécouverte il y a deux siècles et demi et les fouilles entamées au XVIIIème siècle nous laissaient déjà un témoignage précis de la ville, de ses habitudes et de ses goûts et aspirations. Depuis, l'intérêt pour cette cité n'a fait que s'accroître et engendrer soif de connaissance et curiosité. Fidèle à l'alliance romaine jusqu'en 90 avant J.C, elle a subi de nombreuses influences et s'est affirmée dans un pluralisme, touchant aussi bien l'art et la culture que la vie quotidienne et ses rituels.
Pompéi est véritablement romaine, non seulement parce qu'elle est sous la dépendance de l'état romain, mais surtout parce qu'elle réalise la synthèse des peuples qui au cours des temps se sont succédés sur son sol. Elle se veut un havre de paix où il fait bon vivre. Les pompéiens accordent une grande importance à la philosophie, à ce souvenir non effacé dans le subconscient collectif, des liens de l'homme et de la terre.
La ville, remarquablement conservée, représente un document d'une rare richesse sur la vie romaine au premier siècle de notre ère. Les maisons, fermées sur elles-même, sont de véritables musées, témoins de toute une civilisation. Cette richesse se retrouve dans toutes les demeures et palais, ornés de nombreuses fresques et peintures murales représentant de véritables documentaires sur les us et coutumes des Pompéiens.
I. Le luxe et la richesse du décor
Les intérieurs des villas étonnent par le luxe, la grâce et la sensualité des décorations. Mosaïques et peintures murales sont grandioses et font partie des traditions architecturales. Rien n'est trop beau pour décorer la maison pompéienne qui se doit d'être une invitation au voyage. Dépaysement et rêve sont au centre de ce décor d'évasion qui invite à voyager par l'esprit au delà des murs.
1. L'art de la mosaïque
L'art de la mosaïque est l'un des nombreux emprunts que les romains ont fait aux grecs. Utilisant d'abord la simple association de galets, les artistes ajoutent par la suite des cailloux en petits morceaux, et des tesselles (petits cubes de pierre, de marbre ou de pâte de verre finement taillés), jointes le plus étroitement possible afin de réduire au minimum l'importance des interstices. De dimensions de plus en plus réduites, ces associations permettent la création d'uvres raffinées proches de la peinture. Encore cantonnée dans un rôle secondaire, la mosaÏque sert de complément aux peintures murales ornant les sols de motifs purement décoratifs. L'innovation majeure se trouve dans la décoration des parois et des voûtes, faites de pâtes de verre aux couleurs inédites jusqu'alors (bleu, vert, jaune, or, rouge éclatant) et provoquant d'éclatants jeux de lumière. C'est ce qui fait que la mosaïque va se dissocier de la peinture.
2. L'art pictural
L'art pictural s'épanouit au cours des derniers siècles avant Jésus-Christ et lors des premiers siècles de notre ère chrétienne. Les héros grecs sont les modèles de prédilection des peintres romains. Ils incarnent la grandeur héroïque mais aussi des sentiments plus profonds et une certaine angoisse devant les mystères du monde. Dans le recours à la mythologie, tantôt grave, tantôt ironique ou galant voire érotique, les motifs iconographiques empruntés aux grecs concourent à créer l'illusion d'un monde supérieur dans lequel le spectateur se trouve plongé.
Quatre styles, systèmes de décorations plus que phases stylistiques à proprement parlé, se dégagent de cette peinture. Ils se caractérisent par un traitement différent des équilibres entre les fonds, les encadrements et les sujets.
2.1 Le premier style
Egalement appelé style structurel ou style à incrustation, le premier style s'applique à la peinture réalisée entre 200 et 8
Signature :
Celine Moretti-Maqua