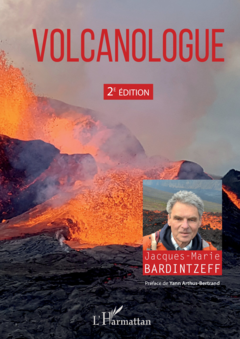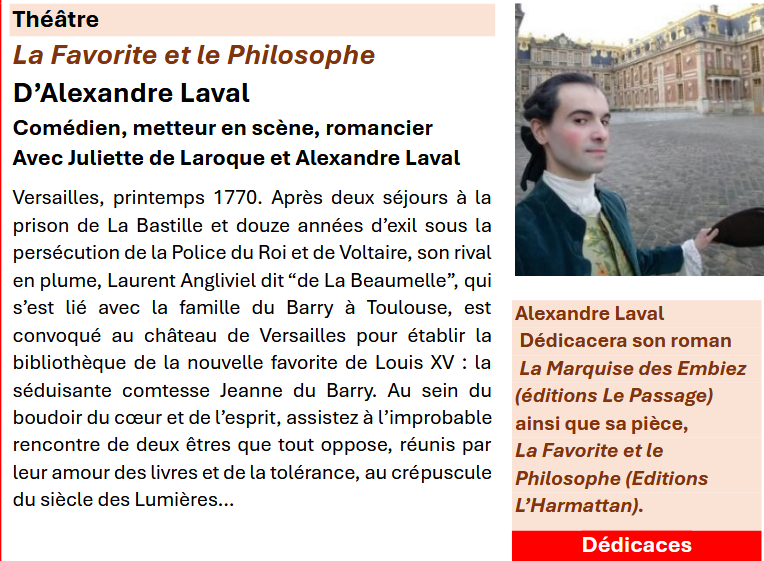Sa'ah François Guimatsia
ContacterSa'ah François Guimatsia
Descriptif auteur
Professeur certifié d'anglais et de français depuis une trentaine d'années au Cameroun, je suis diplômé de l'Ecole Normale Supérieure du Cameroun. J'ai embrassé la carrière d'écrivain en 2009. Après une longue carrière qui m'a fait connaitre toutes les régions du Cameroun, j'ai beaucoup de projets d'écriture qui restent à finaliser. Je suis à la recherche d'un éditeur aux Etats-unis pour mes livres.
Né à l'Ouest du Cameroun, je suis en train de terminer au Centre Linguistique de Douala une longue carrière de professeur certifié de langues. J'ai fait des recherches sur le bilinguisme officiel camerounais, qui m'ont permis de publier plusieurs articles de fond dans la presse locale au Cameroun sur ce sujet.
Structure professionnelle : Chef de département d'anglais au Centre Linguistique de Douala BP 3584 Douala Cameroun, Tel (237) 33429144
Titre(s), Diplôme(s) : Professeur certifié d'anglais/français
Fonction(s) actuelle(s) : Traducteur/Intrerprête (anglais/français)
Vous avez vu 11 livre(s) sur 3
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
L'urgence de nouveaux hommes politiques aujourd'hui au Cameroun
En 2016 et en 2017, des élections présidentielles honnêtes et transparentes ont permis à Donald Trump et à Emmanuel Macron d'accéder au pouvoir suprême respectivement aux Etats-Unis et en France. Le monde entier a suivi les deux processus électoraux avec émerveillement. En démocratie, des scrutins réguliers permettent une réelle oxygénation du champ politique par le renouvellement des personnes, des pratiques et des idées. Mais au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, les élections donnent toujours lieu à des protestations et même à des contestations.
1-Halte à nos atermoiements et balbutiements démocratiques
Déjà en amont, le nombre de députés par circonscription présente des incohérences dans la représentation des régions du pays ; entre deux élections, les opposants se plaignent souvent des entraves administratives à leur déploiement sur le terrain; le parti au pouvoir à tout moment use et abuse des médias et des autres moyens de l'Etat, etc. Les élections sont douloureusement vécues comme un jeu joué d'avance, d'où l'indifférence et la désaffection de la majorité des citoyens par rapport à la chose électorale. En effet le Cameroun qui a 22 millions d'habitants dispose d'un fichier électoral d'environ 5,5 millions d'électeurs, au lieu des 13 à 14 millions qui existent dans la réalité. Pis encore, le jour du scrutin bon nombre d'inscrits s'abstiennent, ou plusieurs noms n'apparaissent pas sur les listes dans les bureaux de vote. Sans compter les électeurs qui, clochardisés par la précarité économique, estiment que leurs voix sont à vendre. Voilà dans quelles conditions sont généralement "élus" ceux qui sont en charge de la gestion du pays à tous les niveaux.
Pourtant un électorat politiquement conscient devrait être le principal moteur du changement politique dans un pays. Si les Camerounais avaient été éclairés et libres dans leurs choix électoraux, ils n'auraient jamais accepté sans réagir les programmes d'ajustement structurel, la concentration excessive du pouvoir, la corruption généralisée, le népotisme et le tribalisme d'Etat, etc. Mais le système gouvernant a d'abord fait perdre au bulletin de vote sa force. Au lieu d'être l'expression de la volonté populaire à un moment précis de la vie politique, voter est devenu une routine lénifiante et insignifiante. Cette façon de faire a précipité plusieurs pays africains dans des imbroglios politiques interminables, et même dans des guerres civiles.
Si on peut sans sourciller déclarer vainqueurs les vaincus à des élections dans un pays, et sans susciter aucune levée de boucliers, cela signifie que l'échelle des valeurs y est inversée. En révélant la corruption des élites dirigeantes, la fraude électorale ouvre d'ailleurs la voie à une décrépitude morale plus généralisée. En effet lorsque les limites morales sont dépassées par les dirigeants, les dérives commencent à aller dans tous les sens ; quand les vicieux sont mis sur un piédestal, sans surprise le vice a le vent en poupe dans tous les secteurs. En clair, les faux résultats électoraux, acceptés parce que manigancés d'en haut lieu, anesthésient le sens moral collectif. A priori ou à posteriori, ils "légitiment" les faux diplômes, la fausse monnaie, les faux médicaments, les faux certificats médicaux, les faux résultats de recensements démographiques, les fausses statistiques économiques, les faux actes de naissance et de mariage, les faux résultats d'enquêtes judiciaires, etc. La liste des domaines atteints par le virus du faux est longue dans un tel contexte. Avec la mauvaise gouvernance électorale, c'est dans tous les secteurs que la norme est écartée et que l'écart qui devient la norme, comme dirait le philosophe Hubert Mono Ndjana. Cela consacre la mal-gouvernance et maintient nos pays dans les affres du sous-développement.
Pendant ce temps, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud, et d'autres pays aujourd'hui émergents ont vaincu la pauvreté, le sectarisme et même le doute sur leurs capacités. Comment ont-ils donc procédé ? Ces pays ont eu des dirigeants clairvoyants, compétents et patriotes, qui avaient chacun une grande vision pour son pays. Avec l'appui des experts, ils ont élaboré des politiques avant-gardistes et des institutions fortes qui ont induit une croissance soutenue et durable dans leurs pays. En outre, ils ont mis en place des mécanismes efficaces de vérification et d'arbitrage pour protéger la fortune publique de la prédation et de la prévarication, sans oublier de nouer avec d'autres pays des liens de coopération mutuellement bénéfiques. Et par-dessus tout, à travers un système éducatif performant et une formation professionnelle pointue, ils ont massivement investi sur le capital humain qui constitue la première richesse des nations. Ils ont promu la culture de la compétence et de la performance dans la gestion des organisations et des systèmes. Toutes ces mesures ont accéléré le développement dans ces pays-là, et cela peut se voir aujourd'hui à l'il nu.
2 - Un tournant politique radical à prendre en 2018
Malgré tous les blocages visibles ou invisibles au Cameroun, et nonobstant tous les obstacles institutionnels (comme la caution financière astronomique exigée de chaque candidat aux élections), de nouvelles têtes pourraient arriver au gouvernement, au parlement, dans les communes et même dans les régions en 2018. On peut le subodorer en voyant les nombreuses actions de terrain déjà engagées par des candidats potentiels. Avec des élections libres et transparentes, on peut espérer l'arrivée aux affaires des gens capables d'améliorer le sort de leurs concitoyens. De tels dirigeants appelleront à leurs côtés des collaborateurs de la même étoffe qu'eux-mêmes. Les hommes politiques qui laissent une trace dans l'Histoire sont ceux qui servent l'intérêt général qui rassemble, et non les intérêts particuliers qui divisent. Quand on voit en 2017 des partis politiques et des entrepreneurs politiques indépendants sillonner le pays et inonder les réseaux sociaux de messages forts, on comprend qu'il ne faudrait pas sous-estimer la capacité de rebond des Camerounais dans le domaine politique.
Parmi les acteurs politiques qui occupent le terrain physique ou médiatique ces derniers temps au Cameroun, il y en a qui (comme Célestin Djamen du SDF) ne jurent que par la réforme préalable du code électoral : sans cela la fraude va continuer à dicter sa loi, parce que l'organe chargé de l'organisation des élections (Elecam) va continuer à fausser le jeu. Ensuite il y a ceux qui, (comme Cabral Libii), lient le changement de régime à une inscription massive des nouveaux électeurs dans le fichier électoral: pour eux, si on atteint 11 millions d'inscrits sur le fichier électoral, cela va automatiquement changer le rapport de force au détriment du pouvoir actuel. Il y a enfin ceux qui, (comme Abel Elimby Lobe et certains partis d'opposition), insistent sur le rassemblement préalable des forces de l'opposition avec une mutualisation effective des moyens et des stratégies. Toutes ces approches variées, sans être mutuellement exclusives, sont en fait les volets forcément liés d'un seul et même combat. Mais les divers protagonistes sur le terrain ne semblent pas encore l'admettre. Pourtant il est évident que la défaite du parti au pouvoir sera impossible si l'opposition ne privilégie pas des stratégies plus solidaires.
Lors des campagnes électorales à venir, les Camerounais devront soupeser et décrypter les programmes en lice par rapport à leurs désillusions passées, à leurs frustrations actuelles et à leurs aspirations pour l'avenir. Les partis devront présenter des programmes et des candidats capables de produire ou d'induire le mieux-être des populations. Il faut absolument que les élections chez nous cessent d'être un théâtre d'imposture cyniquement joué par des acteurs qui utilisent la fraude en comptant sur la pusillanimité des électeurs. C'est cela qui fait qu'après 60 ans d'indépendance, nos pays stagnent ou même régressent: des maladies banales déciment les populations en l'absence d'une couverture sanitaire universelle, le délabrement des infrastructures est très avancé, des milliers de jeunes gens se tuent chaque année en tentant d'émigrer clandestinement vers l'Occident, la criminalité et l'insécurité sont en hausse, la corruption est rampante, les détournements des biens publics et privés se multiplient, etc. Mais les dirigeants sont venus à la politique visiblement pour se servir et non pour servir. Le moment des élections met à nu leur machiavélisme : pour accéder à des positions de pouvoir ou s'y maintenir, ils n'hésitent pas à utiliser l'intimidation, le chantage, la fraude et même l'achat des consciences.
3-Les sept urgences majeures qui attendent les élus de 2018
Au vu de toutes les idées ou propositions politiques qui se bousculent au Cameroun en 2017, on peut penser que les Camerounais sont prêts à essayer d'autres façons de faire la politique en 2018. Mais les nouveaux élus, cette fois-ci plus que jamais, devront avoir les pieds et le cur bien ancrés au Cameroun, la tête et l'esprit en plein dans la mondialisation. L'essentiel ne sera pas le nom ou le passé du parti politique, encore moins l'âge ou le positionnement idéologique des candidats. Tout devra se jouer sur le contenu programmatique proposé pour alléger les souffrances du peuple qui ont atteint un seuil critique. C'est un plan d'action réaliste et bien ficelé que les électeurs vont valider ou refuser de valider. Et dès leur installation au pouvoir, les nouveaux élus seront confrontés à des urgences spécifiques : les réformes vitales différées depuis 1961. Et parmi ces dernières, en voici sept des plus significatives:
a) Un défi culturel à relever immédiatement La culture, ce n'est pas seulement les rythmes, le théâtre, le cinéma, les chants et les danses; elle va bien au-delà des coutumes, des costumes, des arts, des langues et des langages ; elle intègre beaucoup plus que les mythes, les légendes, les contes, les proverbes et les devinettes ; elle ne se limite pas aux carnavals, aux festivals, aux festivités, aux funérailles ou aux exhibitions. La culture, c'est la totalité des créations artistiques et intellectuelles, des constructions idéologiques et philosophiques, des productions scientifiques et techniques d'un peuple tout au long de son histoire, pour s'adapter au monde. Transversale et pluridimensionnelle par définition, la culture comme patrimoine national ne peut pas être gérée seulement par le Ministère de la Culture, car dans chaque secteur d'activité, il y a une dimension culturelle à défendre ou à promouvoir. Comme un ensemble de connaissances, de croyances et de convenances, la culture se nourrit d'enracinement vertical et d'ouverture horizontale. Elle est le socle sur lequel se bâtit la force des nations et même des civilisations. (Voir mon ouvrage Trois piliers pour l'émergence de l'Afrique - Edilivre, Paris, octobre 2015). Mais depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, l'Afrique est dans un tourbillon culturel à la fois déstabilisateur et castrateur. Nos hommes politiques à élire en 2018 devraient être conscients de notre désorientation culturelle, et prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
b) La gouvernance locale à instaurer urgemment L'hypercentralisme administratif actuel au Cameroun, qui refuse d'implémenter la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996, est absolument contreproductif. Il consacre l'inefficacité, l'inertie, l'irresponsabilité et une sujétion paralysante et asservissante à l'Etat central. Il foule aux pieds les principes de la bonne gouvernance (c'est-à-dire la performance, la publicité, la légalité, la participation et la transparence), et fait semblant d'ignorer que la gouvernance de proximité est la norme dans les démocraties modernes. Mais le plus étonnant, c'est que des projets locaux ne sont ni attribués ni suivis par des élus locaux, et les prestataires de ces services ne rendent compte qu'à l'Etat central. Ce jacobisme d'un autre âge, entre autres outrances, concentre d'énormes ressources facilement détournables dans la capitale, tandis que l'arrière-pays croupit dans la déréliction et la misère. Même les maigres ressources (moins de 2% du PIB) consenties aux régions dans le cadre du BIP (Budget d'Investissement Public) paradoxalement restent sous-consommées à la fin de chaque exercice budgétaire pour cause de non maîtrise des procédures de décaissement des fonds. A quoi joue-t-on réellement ? Comme conséquences de ce mode désuet de fonctionnement de l'Etat au Cameroun, l'extrême paupérisation du Grand-Nord et de l'Est, l'enclavement des grands bassins de production agricole, l'exode rural qui dépeuple l'arrière-pays, etc. D'ailleurs la crise anglophone en cours ne s'explique pas autrement. Un remodelage structurel du fonctionnement de l'Etat est donc une urgence aujourd'hui, pour instaurer une gouvernance de proximité, distribuer équitablement les moyens et les ressources aux régions, raccourcir la chaîne de prise de décision et donner à chaque région la possibilité de développer son potentiel dans un canevas constitutionnel bien balisé. On peut parier que cela va faciliter et humaniser la gouvernabilité du pays. La position du régime sur la question est bien connue, et il revient aux responsables politiques attendus en 2018 de franchir le pas d'une gouvernance qui impulse le changement à partir de la commune.
c) La crise anglophone à juguler efficacement Notre bilinguisme officiel est un atout exceptionnel dont la pertinence se confirme chaque jour davantage, à l'intérieur comme à l'international. (Voir mon livre Cinquante ans de bilinguisme au Cameroun - Quelles perspectives en Afrique ? L'Harmattan, Paris, juin 2010). Mais la crise anglophone est venue rappeler la fragilité et la volatilité de nos acquis unitaires depuis 1961. Des négligences liées à l'attentisme ou à la maladresse politique pourraient faire voler en éclats tout ce que nous avons bâti ensemble depuis des décennies. Pour cette raison, le problème anglophone peut hypothéquer l'existence même du Cameroun. Promouvoir notre vivre-ensemble devrait être un subtil jeu de patience et de sapience, en tenant compte de nos spécificités historiques. Cet impératif devrait nous inspirer des actions fortes en profondeur, bien au-delà des gesticulations de surface. Quelques exemples concrets suffisent ici: un système national de transport cohérent qui désenclave toutes les parties du pays, et dont les composantes routière, ferroviaire, aérienne, fluviale et maritime sont bien harmonisées; une politique urbaine intégrationniste qui fait de chacune de nos grandes villes le creuset de l'unité nationale et non un champ de bataille entre les autochtones et les allogènes; un organe officiel de lutte contre les replis identitaires et toute forme d'entre-soi exclusif; un intense tourisme intérieur autour des événements culturels saisonniers organisés dans toutes les régions du pays ; un bilinguisme officiel égalitaire et paritaire, intégral et non-conflictuel, implémenté dans toutes les filières de formation ou d'apprentissage dans le pays, etc. Notre vivre-ensemble est donc une entreprise vaste et complexe qui exige beaucoup d'imagination créatrice de la part des gouvernants. Loin des bâclages à la va-vite et des replâtrages à dose homéopathique, les élus de 2018 devront rechercher des solutions efficientes et définitives au malaise anglophone, et qui soient applicables aux mêmes types de revendications qui existent ailleurs dans le pays.
d) Un système éducatif à rénover méthodiquement Depuis des décennies notre système éducatif produit des diplômés inemployables et voués au chômage, avec un corps enseignant passablement déconsidéré, démotivé et désargenté. Une profonde rénovation dans les objectifs, les méthodes, les contenus et les programmes scolaires s'impose aujourd'hui, afin d'adapter notre institution scolaire aux réalités, aux besoins et aux aspirations d'un Cameroun moderne, ambitieux et multiculturel. Tous les pays aujourd'hui émergents sont passés par là, car comme le disait Nelson Mandela, "l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde". Notre double héritage colonial était un champ ouvert à notre inventivité dans ce domaine, mais nos dirigeants postcoloniaux n'ont pas engagé les réformes judicieuses et ambitieuses qu'il fallait à partir de 1961. Nous y sommes contraints aujourd'hui, et pas seulement à cause de la crise anglophone. Nos programmes scolaires devraient devenir moins théoriques et plus pratiques, avec par exemple l'introduction des disciplines comme l'éducation à la sécurité et aux premiers secours, à la démocratie et au vivre-ensemble, à la santé et à la nutrition, au mariage et à la parenté, aux techniques agricoles et à l'artisanat, etc. On ne peut pas maintenir hors de l'école des connaissances d'utilité si pratique aujourd'hui. C'est avec une telle réforme scolaire que sera éradiquée l'inadéquation formation-emploi, et que sera assuré l'arrimage de notre pays à la société mondiale des savoirs à l'ère du numérique. (Voir mon livre Time for Africa's Emergence ? Bookventure Publishers, USA, septembre 2016). Le défi à relever en matière d'éducation chez nous est donc gigantesque, à la dimension du retard que nous accusons dans ce domaine. Nos élus de 2018 devront être capables d'effectuer sans délai cet indispensable recentrage de notre système éducatif, de la maternelle à l'université.
e) L'hypothèque du franc CFA à lever triomphalement La monnaie est l'un des piliers essentiels de la souveraineté d'un pays. Depuis 1994, le débat sur le franc CFA est en cours, et des économistes de renom dénoncent sans répit son maintien. Cela aurait dû mettre la puce à l'oreille de nos dirigeants au sujet de ce vestige de la colonisation française. Sa dévaluation reste une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, mais nos dirigeants politiques, généralement formatés dans la docilité à l'égard de la France, continuent d'afficher une méfiance et une prudence teintées de couardise. Seule une conception plus affirmée et mieux assumée de notre souveraineté, face à la France et à l'Europe qui changent d'ailleurs elles aussi, peut venir à bout de cet anachronisme infantilisant. Nos pays ont besoin de concevoir et de piloter eux-mêmes leurs politiques monétaires et financières en toute responsabilité, même s'il faut passer par des erreurs qui assagissent. Mais une sujétion aveugle aux diktats extérieurs aux relents colonialistes est une forfaiture inacceptable, après 60 ans d'indépendance. Nos élus de 2018 devront sans états d'âme ranger le franc CFA dans le musée de l'Histoire, et engager avec lucidité des négociations intra-africaines pour une indépendance monétaire (dans l'interdépendance sous-régionale si possible) qui soit flexible, tangible et crédible pour le Cameroun, et sans laquelle l'émergence du pays tant claironnée n'est qu'un leurre.
f) L'environnement à préserver intégralement L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure et concourt à la création des conditions physiques, naturelles, biologiques et socioéconomiques de la vie humaine, végétale et animale. Nous devons absolument le préserver pour les générations futures, d'où la nécessité de lier nos droits économiques à nos devoirs écologiques. En clair, nous devrions agir comme si les générations futures avaient exactement les mêmes droits écologiques que nous. Ainsi tous nos travaux d'infrastructure, d'industrialisation, d'urbanisme, d'agriculture, de pêche, bref toutes nos actions de développement sur terre, en mer et dans l'atmosphère devraient respecter des normes environnementales très strictes. C'est une dette imprescriptible que nous devons à notre belle et unique planète, quel que soit d'ailleurs le pays où nous vivons. En Afrique, déjà nous assistons aux effets dramatiques du dérèglement des saisons, du réchauffement climatique, de l'érosion côtière, de la désertification progressive et des inondations spectaculaires, qui révèlent une fragilisation continue de l'écosystème due aux actions humaines. Mais nos dirigeants politiques, sans se dire climato-sceptiques, ne placent pas encore l'écologie au centre de leurs projets politiques. Ceux qui seront élus en 2018 au Cameroun ne pourront plus éluder la nécessité d'une sérieuse politique environnementale chez nous, comme ailleurs dans le monde.
g) La compétitivité du pays à bâtir systématiquement Avec la mondialisation des échanges, le Cameroun a besoin de nouer des partenariats sûrs et mûrs, c'est-à-dire viables et fiables, avec d'autres entités organisées en Afrique et dans le monde (la CEMAC, la CEDEAO, le G20, le G7, l'UE, les puissances émergentes et même avec son grand voisin le Nigeria, etc.). Par le biais d'un intense marketing politico-économique, notre pays devrait rassurer ses divers partenaires de ses qualités comme vendeur ou comme acheteur de certains biens. Personne dans le monde d'aujourd'hui ne veut d'un partenariat qui ne soit pas gagnant-gagnant. Le Cameroun a donc intérêt à identifier tous les créneaux économiques où il dispose d'un savoir-faire ou des atouts réels, et y consacrer les investissements nécessaires. A cet égard, notons que les industries culturelles (cinéma, musique, etc.), le tourisme et même le sport de haut niveau aujourd'hui assurent à certains pays plus de visibilité et de rayonnement que la diplomatie classique. Notre pays doit construire son attractivité et entretenir sa compétitivité malgré une concurrence mondiale impitoyable. Nos élus de 2018 devraient en être conscients, et faire travailler notre pays pour tenir son rang ou même l'améliorer.
Conclusion
Pour relever le défi de son émergence à l'ère de la mondialisation, le Cameroun doit donc devenir un édifice bâti sur les sept grands piliers suivants: de solides racines et ailes culturelles, une gouvernance vertueuse de proximité, une intégration nationale bien ficelée, une école réformée et recentrée, une souveraineté monétaire assumée, une conscience écologique aigüe et une compétitivité économique entretenue. Les candidats aux scrutins de 2018 au Cameroun auront-ils à cur ces sept révolutions nécessaires et urgentes à faire dans l'intérêt supérieur du pays? Nous aurons le temps de voir. Il est vrai que la notion de responsabilité des élus par rapport aux promesses faites aux électeurs a toujours été le moindre des soucis des politiciens chez nous. Mais cela ne signifie pas que ces derniers ne changeront jamais. Les élus de 2018 seront de nouveaux visages certes, mais ils devront surtout avoir une vision nouvelle de la politique comme mission de service public pour des dirigeants qui aiment vraiment leur pays. Mais en concluant cet article, nous avons la gorge nouée par un petit hic: le Cameroun sera-t-il capable, financièrement, de tenir à dates échues les scrutins prévus en 2018 et de respecter en même temps le cahier des charges de la CAN de football qui se joue sur son sol en 2019 ? Il est à craindre que le pays n'ait les yeux plus gros que le ventre. Mais souhaitons patriotiquement le meilleur pour notre pays, en politique comme en sport.
Le problème anglophone au Cameroun: Comment éteindre le volcan en éruption?
Au lieu d'être en train de rassurer et d'attirer des investisseurs en vue de son émergence en 2035, le Cameroun fait aujourd'hui face à des fléaux comme la corruption systémique, le chômage massif des jeunes, l'insécurité créée par les attaques de Boko Haram, etc. Et plus grave encore, en cette fin d'année 2016, c'est le problème anglophone qui risque de plonger une bonne partie du pays dans le chaos. Il revient aux autorités du pays et aux élites, sans distinction d'affinités politiques et loin de toute récupération politique, de prendre la mesure de cette crise, afin d'y apporter les solutions adéquates en toute responsabilité. Cela ne peut se faire que par le biais d'une médiation républicaine pour un dialogue franc et serein avec les vrais représentants d'une communauté Anglophone exaspérée mais pas désespérée, qui visiblement ne souhaite qu'être considérée et écoutée, au lieu d'être méprisée ou ignorée comme cela semble avoir été le cas jusqu'à présent.
I - Qu'est-ce exactement le problème anglophone?
Le Camerounais francophone moyen ne comprend toujours pas ce que veulent les Anglophones. Mais le pouvoir devrait bien comprendre et ménager ces derniers, au lieu de faire comme si le malaise anglophone n'était qu'une vue de l'esprit. Le problème anglophone, c'est un ensemble de revendications exprimées de diverses façons et à maintes occasions par les Anglophones du Cameroun. Leurs griefs, identitaires et linguistiques en apparence, interpellent les plus hautes autorités sur la forme même de l'Etat. En effet en octobre 1961, les Anglophones ont rejoint les Francophones pour créer une fédération à deux états, mais aujourd'hui ils ne sont plus que deux régions administratives sur les dix que compte le pays. Leurs réclamations devraient être reçues et examinées, acceptées ou rejetées, comme dans toute démocratie digne de de nom. Mais on ne peut pas leur opposer un silence méprisant, les accuser de se définir par rapport à une langue étrangère, ou même les menacer de répression policière. De telles réponses venant des représentants de l'Etat aggravent les tensions intercommunautaires dans un contexte où le droit à manifestation est reconnu à tous.
Les Anglophones du Cameroun ne sont pas tous ceux qui ont l'anglais comme première langue officielle, par opposition à ceux qui parlent le français comme première langue officielle. Comme l'a affirmé le Professeur Simo Bobda (2001), l'anglophonie au Cameroun est un concept plus ethnique, culturel et régional que linguistique. Cette définition exclut les Francophones installés depuis longtemps en zone anglophone même s'ils y possèdent des biens et des liens, comme nous l'avons analysé dans notre livre Cinquante de bilinguisme au Cameroun- Quelles perspectives en Afrique ? (L'Harmattan, Paris, 2010). Cette analyse exclut aussi les Francophones qui maitrisent l'anglais parce qu'ils ont acquis une éducation anglo-saxonne, ou étudié dans des établissements du sous-système anglophone qui prolifèrent en zone francophone. En clair, les Anglophones du Cameroun, c'est bel et bien une identité culturelle bien particulière, un espace géographique limité et un parcours historique spécifique, avant d'être une simple communauté linguistique. Avec cette clarification préalable, on peut mieux appréhender la nature et les contours du problème anglophone qui aujourd'hui fait monter la tension sociopolitique dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du pays.
II - Un bref rappel historique
Lorsque la France et la Grande Bretagne remplacent l'Allemagne au Cameroun en 1916, cela crée des Camerounais de culture anglophone dans 1/5 du territoire d'une part, et ceux de culture francophone dans 4/5 du pays d'autre part. La minorité anglophone a été habituée à une certaine autonomie politique et culturelle par la colonisation britannique, tandis qu'en zone francophone la France a appliqué un centralisme administratif de type jacobin, doublée d'une assimilation linguistique et culturelle, même si le Cameroun n'était pas techniquement une colonie de la France. On comprend donc le malaise des Anglophones au sein d'un Etat fortement centralisé qui, pour le premier président francophone Ahidjo, facilitait le développement du pays dans la paix et l'unité. En 1961, le pays reconstitué n'avait pas d'autre choix que d'adopter le bilinguisme français-anglais adossé au biculturalisme. Il devenait ainsi en Afrique la terre de rencontre du français et de l'anglais, deux des langues les plus prestigieuses dans le monde.
En effet, le Cameroun réunifié allait bénéficier de tout le patrimoine linguistique du français (une belle langue d'origine latine parlée par plus de 400 millions de personnes dans le monde, pleine de raffinement, enrichie et défendue depuis 1539 par des générations d'écrivains et d'intellectuels, et présente dans plus de 70 pays et territoires). Le pays allait aussi bénéficier de l'énorme prestige de l'anglais (une langue parlée par plus d'un milliard de personnes dans le monde, qui s'impose dans des secteurs stratégiques comme la science et la technologie, la communication, la diplomatie, les affaires, etc.). Mais l'anglophonie, ainsi adoptée au départ comme une bénédiction, a finalement contribué à créer au Cameroun le problème anglophone. Pourquoi ? Juste parce que chemin faisant, le bilinguisme officiel s'est fourvoyé dans plusieurs travers: la loi du nombre a conféré la prééminence au français, malgré les dispositions constitutionnelles assurant une égale valeur aux deux langues officielles; la promotion du bilinguisme est restée minimale et juste scolaire, au lieu d'être systématique et portée par des lois linguistiques sectorielles comme par exemple en Afrique du Sud; le bilinguisme est finalement resté assez déséquilibré dans le pays parce qu'il ne s'appuie pas toujours sur le biculturalisme, étant donné que les individus, les institutions et même les autorités le considèrent juste comme souhaitable mais non obligatoire. Au bout du compte, les Anglophones sont socialement comprimés et pratiquement marginalisés, et ne peuvent donc ni enrichir ni impacter le système culturel dominant au Cameoun, d'où leur sentiment d'assimilation pure et simple par les Francophones. Rappelons à cet égard qu'en 1964 dans la revue culturelle Abbia, Bernard Fonlon, dans un article intitulé Construire ou détruire, exprimait déjà clairement ce malaise culturel des Anglophones: "Après la Réunification, on conduit sa voiture maintenant à droite, le franc a remplacé la livre comme monnaie, l'année scolaire a été alignée sur celle des francophones, le système métrique a remplacé les mesures britanniques, mais en vain ai-je cherché une seule institution ramenée du Cameroun anglophone. L'influence culturelle des Anglophones reste pratiquement nulle".
Même lorsque des Anglophones occupent des postes importants, il faudrait des lois pertinentes et contraignantes pour protéger leurs spécificités linguistiques et culturelles. A ce propos, dans son livre intitulé Ma foi, le Cameroun à mettre à neuf (Véritas, Douala, 2011), l'Anglophone et cardinal, son Emminence Christian Tumi écrit: "Les ennuis quotidiens du Premier Ministre anglophone sur certains dossiers, le manque de respect répété, chronique et ouvert dont il est l'objet de la part de certains membres du gouvernement, aggravent une situation déjà fort embarrassante". L'Etat ne peut donc pas utiliser le bilinguisme, à la manière d'un cache-sexe, pour occulter ses échecs criants dans la promotion des autres aspects pourtant essentiels de la convivialité socioculturelle entre les Francophones et les Anglophones.
III - Ce qui inquiète les Anglophones
La principale menace pour l'entité sociologique anglophone survient le 20 mai 1972: Ahmadou Ahidjo organise un référendum pour mettre fin au système fédéral en place depuis 1961. Au sein de la fédération, les Anglophones constituaient un état fédéré et géraient leurs propres affaires locales et régionales. Mais que valent les résultats d'une consultation organisée dans un contexte de parti unique et de dictature? La démarche d'Ahidjo n'était en réalité qu'une manuvre pour neutraliser et assimiler les Anglophones, avec l'appui de la France. A ce sujet, dans son livre cité plus haut, le Cardinal Tumi raconte (à la page 33) qu'un diplomate français à Rome lui avait dit que la politique française au Cameroun consistait surtout à "faire disparaitre la culture anglo-saxonne de la minorité anglophone du Cameroun".
En tout état de cause, les Anglophones ont eu le temps de voir, depuis mai 1972, sous Ahidjo et même après lui, les conséquences néfastes et concrètes de l'Etat unitaire sur leur statut en particulier: la marginalisation politique, l'impossibilité pour eux de diriger certains ministères-clés (Finances, Affaires Etrangères, Administration Territoriale, Education, Défense, etc.), des Francophones nommés autorités administratives en zone anglophone, l'animosité politique croissante entre les deux régions anglophones, la disparition de l'héritage culturel anglophone, le non-respect du Premier Ministre anglophone par des ministres francophones, la publication de la plupart des textes officiels uniquement en français, etc. C'est sans doute après avoir finalement compris l'énorme supercherie que John Ngu Foncha, qui avait conduit les Anglophones à la réunification, a démissionné dans les années 90 et exigé un retour au fédéralisme.
A partir des années 90 avec le multipartisme, les Anglophones voient s'effriter leur conscience de groupe. Après la All Anglophone Conference (AAC) et la rencontre des enseignants et des parents d'élèves anglophones organisées à Buea en 1993, les antagonismes politiques entre les deux régions anglophones sont exacerbés. Pire encore, à travers leurs élites et leurs chefs traditionnels, elles se livrent à une sourde et malsaine concurrence pour les faveurs de l'Etat central. La situation s'aggrave après le passage au pouvoir de deux premiers ministres - Achidi Achu (du Nord-Ouest) et Mafany Musonge (du Sud-Ouest) - en poste de 1992 à 1996 pour le premier, et de 19996 à 2004 pour le second. Ils disent et proclament que politic na njangi : la politique pour eux n'est un jeu d'intérêt, dans lequel le parti au pouvoir ne donne à chaque localité du pays que ce qu'elle lui a donné en termes de bulletins de vote. Cette curieuse conception mercantiliste, alimentaire et non-démocratique de la politique, ainsi conceptualisée par deux leaders Anglophones si haut placés, ouvre la voie à des grenouillages inavouables pour des postes de nomination à la mangeoire, au détriment des hautes valeurs humaines qui ont toujours caractérisé les Anglophones : la retenue, la probité, la transparence, l'honnêteté, le désintéressement et le respect du bien commun. Et c'est sans surprise qu'on voit des Anglophones eux aussi s'embourber dans la fraude, l'achat des consciences, la corruption des chefs traditionnels, le détournement des fonds publics, etc.
Concernant le système éducatif, une sérieuse menace du sous-système anglophone a été la francophonisation de l'enseignement technique et professionnel. En effet, les établissements de cet ordre d'enseignement en zone anglophone ont fonctionné depuis 1972 en français et avec les mêmes programmes qu'en zone francophone, et leurs élèves ont fait le CAP, le Probatoire et le Bac techniques comme en zone francophone, et ceci a continué même après la création du GCE Board. Plus grave, les enseignants de l'enseignement technique ont longtemps été majoritairement francophones jusqu'en 2009, l'année d'ouverture la première Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique à Bambili dans le Nord-Ouest. Par ailleurs, les Anglophones depuis l'époque coloniale ont toujours mis un point d'honneur à inculquer aux jeunes élèves les grandes valeurs civiques (la bonne moralité, la citoyenneté, l'ardeur au travail, l'obéissance, etc.). Cela se faisait à travers des cours bien élaborés de religion et de morale enseignés à tous les niveaux, dans l'enseignement public comme dans le privé laïc et confessionnel. Ces deux matières ont été officiellement disqualifiées en 1976 par un décret présidentiel comme critères d'admission à l'université ou à un emploi au Cameroun. Les Anglophones ont vu en cela une ferme volonté de l'Etat de francophoniser en profondeur leur sous-système scolaire.
Suite à la création des universités anglo-saxonnes après le constat des échecs massifs des étudiants anglophones dans les universités nationales pourtant bilingues, les Anglophones ont noté que les professeurs francophones étaient nommés pour enseigner ou même pour gérer ces établissements dits anglo-saxons. Ceci pouvait être aussi perçu comme une grave atteinte à l'identité culturelle spécifique des Anglophones. Une menace similaire a été la migration des milliers d'élèves francophones dans la zone anglophone, attirés par la qualité reconnue du système éducatif anglophone. En effet beaucoup d'élèves et de parents francophones ont découvert, après la création du GCE Board en 1993 et l'admission du Cameroun au Commonwealth en 1995, que les diplômes anglophones ouvraient plus de portes dans le monde que les diplômes francophones. Du coup, la France n'était plus la seule destination pour faire de bonnes études supérieures, et on pouvait étudier aux Etats-Unis, au Canada, en RSA, en Inde, etc. Et pour bien s'y préparer, rien de mieux que le sous-système anglophone. Ces nouveaux Anglophones, par la langue et la scolarité et non par la culture ou l'origine ethnique, en devenant plus nombreux, pourraient mettre en minorité l'anglophonie originelle.
IV - Ce qui relève de la responsabilité de l'Etat
Tels sont quelques-uns des constats amers faits par les Anglophones. Que devrait faire l'Etat camerounais, face à la montée en puissance du mécontentement et des récriminations des Anglophones ? Leurs griefs sont de nature identitaire, sociopolitique et linguistique, avec toutes les implications psychologiques imaginables. La première mesure à prendre est humaine et communicationnelle : trouver des médiateurs crédibles et intègres, capables de construire les ponts et de détruire les murs, pour faire dialoguer les protagonistes de la crise. Puis devra rapidement suivre une deuxième mesure plus technique et constitutionnelle : le toilettage constitutionnel. La constitution de 1996, en instituant un état unitaire décentralisé n'a manifestement pas réussi à créer le niveau souhaité d'harmonie nationale. La persistance et l'aggravation du malaise des Anglophones en est une preuve patente. Le Cameroun a manifestement besoin d'une forte unité nationale qui se conjugue avec une réelle autonomie des régions. Le système politique qui offre à la fois ces deux choses essentielles a déjà fait ses preuves dans d'autres pays du monde. Il fait la force des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, et même du Nigeria. Il a pour nom le fédéralisme. Il permet aux élus placés à divers niveaux de responsabilité ou de contrôle - local, régional et fédéral - de gérer le pays au quotidien sur la base d'un Etat de droit, dans le strict respect de la transparence, de l'objectivité et de la responsabilité individuelle. Mais les experts et les constitutionnalistes camerounais peuvent toujours concevoir un fédéralisme plus adapté et mieux étoffé.
Les gouvernants et les gouvernés, pour faire avancer l'unité de la nation, devraient cesser d'agiter la francophonisation des uns ou l'anglophonisation des autres comme des épouvantails. D'ailleurs les gouvernés sont parfois en avance sur les gouvernants : de nombreuses familles francophones à Yaoundé et à Douala n'ont pas attendu le feu vert de l'Etat pour anglophoniser leurs enfants. Et elles ne s'en portent pas plus mal. L'avenir du pays est sans doute à une judicieuse anglophonisation/francophonisation des éléments culturels qui nous viennent soit de France soit d'Angleterre. Et si nos intérêts un jour nous commandaient de prendre ou d'apprendre de nouvelles façons de faire de l'Allemagne, de la Chine ou du Japon, refuserions-nous de le faire juste pour conserver notre identité de francophone ou d'anglophone? Il est temps que les Camerounais changent de logiciel, et bâtissent leur avenir d'Africains ouverts à la modernité dans un contexte mondialisé.
En effet, comme démontré dans notre récent ouvrage Time for Africa's Emergence ? With Focus on Cameroon (USA, 2016), à l'ère de la mondialisation, notre émergence prendra appui plus sur notre géographie que sur notre histoire. En d'autres termes, nous devons savoir osciller dans l'équilibre entre l'enracinement et l'ouverture, c'est-à-dire entre nos racines camerounaises et nos ailes de la modernité. Notons déjà que le fédéralisme comme forme de l'Etat du Cameroun conviendrait non seulement aux Anglophones, mais aussi aux autres régions du pays dont les élites multiplient depuis des années des memoranda adressés au pouvoir central. Ces réclamations ouvertement régionalistes sont symptomatiques de l'aspiration des Camerounais à une meilleure répartition des richesses nationales, à une meilleure gestion des affaires locales, et à une meilleure prise en compte des spécificités régionales. Quelle région du Cameroun ne souhaiterait pas faire partie d'un pays intégré, bien géré et gouverné avec justice, dans lequel les citoyens, en harmonie les uns avec les autres, développent leur potentiel humain par le travail, en respectant leurs devoirs et en jouissant de leurs droits?
Conclusion
Aujourd'hui l'urgence pour l'Etat au Cameroun est d'apaiser le climat sociopolitique et de corriger certains dysfonctionnements institutionnels en vue de préserver et de parfaire l'unité de notre pays. Le problème anglophone (et tous les autres griefs similaires) n'est en réalité que le thermomètre qui révèle une température politique élevée (c'est-à-dire l'urgence de réformer en profondeur nos institutions pour améliorer notre vivre-ensemble). A cet égard et à titre d'exemple, le système éducatif est un formidable outil d'homogénéisation des générations montantes dans le respect de nos diversités régionales naturelles, et non une pépinière où des politiciens à courte vue peuvent semer les graines des divisions et des haines futures. Par ailleurs, ce que demandent les Anglophones (plus de liberté, plus d'autonomie, une gouvernance de proximité, etc.) est aussi bon pour les autres régions du pays. Au bout du compte, le problème anglophone est certes la manifestation du malaise d'une communauté aspirant à un mieux-être au sein de la nation, mais il est aussi révélateur d'un réel besoin légitime qui monte partout dans le pays. De toute évidence, on ne peut pas gouverner 22 millions de Camerounais en 2016 avec les mêmes réflexes, méthodes et institutions qu'en 1972, lorsque le pays n'avait que 6 millions d'habitants.
Une lecture africaine du parcours de Fidel Castro à Cuba
Pour bien comprendre la figure historique de Fidel Castro Ruz, revenons brièvement sur l'histoire singulière de son pays. Avec ses 114 525 km² de superficie et ses 12 millions d'habitants en 2016, Cuba n'est pas un très grand pays. Depuis 1959, son histoire se confond avec celle de Fidel Castro, son leader bien connu pour ses convictions fortes, qui a su insuffler aux Cubains l'amour de la patrie, le mépris de la peur et la mystique du travail. Grâce à lui, ses compatriotes ont réussi à relever les défis de l'identité nationale cubaine au 20ème siècle. Contraint par la maladie, il a laissé le pouvoir à son frère Raul Castro, qui est depuis 2006 aux commandes de la révolution. Mais Fidel Castro est resté une légende à Cuba. Il fait désormais partie des grandes icônes qui ont accéléré le cours de l'Histoire comme Gandhi en Inde, Mandela en Afrique du Sud, Mao en Chine, De Gaulle en France, etc. Et plus que ces derniers, il a eu environ 50 ans pour marquer Cuba de son empreinte personnelle.
Cette île a été convoitée par plusieurs pays européens dès sa découverte en 1492. Si l'Espagne s'est finalement imposée, c'est parce qu'elle était la puissance mondiale de l'époque, et disposait des moyens de conquérir et de conserver une si riche et stratégique colonie. Mais elle dut la quitter en 1898, à cause de la détermination des Cubains à vivre libres. Malgré son indépendance proclamée en 1901, Cuba est resté un protectorat économique des Etats-Unis qui l'avaient aidé à chasser les Espagnols. Au cours de la période qui s'en suivit, les Cubains ont dû accepter la présence d'une base militaire américaine à Guantánamo, et surtout développer une résistance farouche à l'oppression. Cela va servir plus tard de terreau à la révolution.
I- La révolution arriva et triompha
C'est la dictature de Fulgencio Batista, au pouvoir de 1933 à 1944 et puis de 1952 à 1959, qui précipita l'arrivée de la révolution. En effet, son régime avait multiplié les brimades à l'égard des populations : népotisme et autoritarisme, prévarication et corruption, brutalités et atrocités policières, silence et indifférence face aux besoins vitaux des masses populaires (notamment en matière de santé, d'éducation, de logement et de justice). Cela déclencha la révolution dans les esprits, au moment où le dictateur se croyait toujours le seul maître à bord, obnubilé par l'appui des Américains qui étaient aux commandes de tous les leviers de l'économie du pays.
Au début de l'insurrection, Fidel Castro et les rebelles n'avaient pas de coloration idéologique. Le parti communiste officiel désapprouva leur action comme étant d'inspiration "bourgeoise et erronée". C'est après avoir battu militairement la dictature de Batista en 1959 que Fidel Castro adhéra officiellement au communisme, à la manière d'un leader politique qui se convertit à une religion donnée pour s'attirer le soutien des pays qui s'identifient à cette foi. Parce que Fidel Castro avait rétabli la souveraineté totale de son pays en nationalisant les propriétés et les entreprises américaines, les Etats-Unis appuyèrent l'opération militaire de la Baie des Cochons lancée en avril 1961 par des exilés cubains vivant aux Etats-Unis. Ce fut un cuisant échec pour ces antirévolutionnaires, grâce à la combativité héroïque des révolutionnaires et aux prouesses de l'aviation cubaine qui bombarda leur navire (le Houston) en pleine mer avant même son débarquement à Cuba.
II- La révolution cubaine avec Fidel Castro: un bilan contrasté
Comme toute uvre humaine, la révolution castriste a connu des hauts et des bas. Elle a suscité d'immenses espoirs mais aussi de grandes désillusions. Il est vrai que Cuba a subi des milliers d'agressions et des centaines de complots organisés à partir de l'étranger pour le déstabiliser, et que plusieurs milliers de cadres formés avant la révolution sont partis en exil. Mais cela ne saurait expliquer ni justifier tous les manquements imputables à ce régime politique lui-même.
a) Des échecs indéniables Les révolutionnaires cubains ont en effet commis plusieurs erreurs de pilotage, surtout dans la gestion économique du pays. Les discours fleuves du guide n'ont pas transformé le pays en un eldorado. Malgré les capitaux soviétiques et chinois servant de roue de secours, la révolution a souvent montré le pire qu'on retient toujours plus que le meilleur. On cite à cet effet la dérive autoritaire et la répression sanglante de ce régime fermé qui a transformé Cuba en un immense goulag (avec plus de 15 000 exécutions publiques qui ont poussé en exil plus de 15% de la population). On rappelle aussi la grande misère et le faible taux du PNB par habitant qui ont longtemps classé ce pays parmi les plus pauvres du monde. Ajoutons aussi qu'Alina Fernández (la propre fille de Fidel Castro) et cinq autres membres de sa famille se sont refugiés aux Etats-Unis, d'où ils ont mené une propagande acharnée contre Fidel Castro et la révolution cubaine. On peut imaginer le drame personnel d'un leader s'évertuant à convaincre le peuple des vertus de la révolution, alors que des membres de sa propre famille biologique en sont les ennemis les plus irréductibles. Plus grave, le régime a cultivé un abrutissant monolithisme de la pensée et une intolérance aveuglante n'admettant aucune critique. Cela a certainement conduit à de graves excès et dérapages. Mentionnons aussi la morbide soif d'affrontement avec les adversaires de la révolution, qui a mis le monde à deux doigts de la guerre nucléaire suite aux fusées soviétiques installées à Cuba en 1962. Citons enfin le radicalisme arrogant du régime qui n'a pas cru devoir modifier sa ligne idéologique lorsque s'effondraient l'URSS et ses alliés en Europe de l'Est. Cette intransigeance a retardé l'entrée de Cuba dans une mondialisation où les facteurs économiques prennent désormais le pas sur les considérations idéologiques. Mais cela dit, la révolution cubaine a aussi de grandes réussites à mettre à son actif.
b)Des succès incontestables Pour les Cubains ordinaires, le succès de la révolution se mesurait aux avantages comme la nourriture, les soins médicaux, l'enseignement et le logement qui étaient largement subventionnés par l'Etat. La situation socioéconomique des femmes, par exemple, s'est nettement améliorée: avant la révolution, elles étaient majoritairement serveuses et prostituées au sein de l'industrie touristique pilotée par les Américains; avec la révolution, elles sont devenues infirmières, institutrices, médecins, secrétaires, ouvrières spécialisées dans les unités industrielles de production, pendant que leurs jeunes enfants étaient gardés dans des crèches créées par l'Etat. Mais le plus grand succès de la révolution fut dans l'éducation devenue gratuite, adaptée et surtout plus technique et plus populaire. En dehors du taux de scolarisation enviable de 97,3 %, il faut relever la parfaite couverture sanitaire du pays, l'espérance de vie portée à 77,5 ans en 2005, la médaille d'or de la Santé Pour Tous décernée à Fidel Castro par l'OMS, les 20 000 médecins cubains envoyés servir dans le Tiers-Monde. Au plan diplomatique, les hommages appuyés de Kofi Annan le Secrétaire Général de l'ONU et de Danielle Mitterrand la première dame de France, tout comme les amitiés affichées et assumées de Myriam Makeba, Desmond Tutu et de Nelson Mandela, ne sont pas passés inaperçus. En 1975, ce fut le grand tournant internationaliste : les Cubains ont combattu le colonialisme en Angola, en Ethiopie et au Yémen du Sud, sans oublier leur appui aux rebelles au Salvador et au Nicaragua. Cela a rendu Cuba fréquentable par les pays pauvres du monde, et renforcé la perception de ces derniers que les Etats-Unis et de leurs alliés n'étaient que des impérialistes qui voulaient dominer le monde. La popularité exceptionnelle de Fidel Castro dans les pays du tiers-monde, et la visite historique du Pape Jean Paul II en 1998 ont consacré le succès planétaire de la révolution cubaine.
III-Quels messages pour l'Afrique d'aujourd'hui?
Vu d'Afrique, ce qui s'est passé dans l'esprit des Cubains lors des années de révolution est particulièrement intéressant: à la dure école de l'austérité révolutionnaire et de l'embargo américain, les Cubains ont appris à aimer leur pays, à travailler dur et à faire preuve de résilience dans leur engagement politique. Rappelons que l'impérialisme américain n'a fait que défendre ses intérêts à Cuba, n'hésitant pas à asphyxier ce pays à cause de l'audace révolutionnaire de son leader. Pour Cuba le salut est venu de la solidarité agissante de Moscou et de Pékin, dans le contexte particulier de la guerre froide. Il revient donc aux pays dominés de construire leur solidarité en mutualisant leurs atouts pour pouvoir résister à la rapacité des pays impérialistes. Plus particulièrement aux Africains, la révolution cubaine, qui peut être soit attrayante soit effrayante selon la posture idéologique qu'on adopte, adresse au moins trois importants messages:
1-Premier message : l'importance d'un leadership de qualité. Fidel Castro a été un modèle de dévouement à son peuple. Son obsession a été de faire de Cuba un pays prospère et indépendant, en utilisant la souveraineté du pays pour défendre les intérêts vitaux de la nation. C'est la plus grande mission que chaque peuple confie à ses dirigeants. Mais combien de leaders en Afrique s'en acquittent avec autant de loyauté et de désintéressement que Fidel Castro? On en a vu qui se sont ligués avec le capitalisme international pour ruiner leurs peuples, en contractant des prêts virés dans leurs comptes privés, obligeant ainsi leurs pays à rembourser de l'argent dont ils n'ont jamais profité. On en connaît d'autres qui fomentent des antagonismes ethniques ou inventent des arguties juridiques pour se maintenir éternellement au pouvoir, ou qui se proclament démocrates tout en se comportant comme de grands féodaux précoloniaux. On en voit même qui, après plus de 50 années d'indépendance, maintiennent leurs pays dans une totale dépendance monétaire, militaire et culturelle des puissances ex-coloniales, apparemment inconscients de la gravité de cette grave forfaiture historique. Pire encore, des leaders en Afrique ont vis-à-vis de leurs peuples une indifférence qui frise la moquerie face à leurs misères et souffrances indescriptibles. Fidel Castro, lui, est resté visionnaire, patriote, nationaliste et très proche des Cubains ordinaires, qu'il visitait dans les plantations et dans les usines, n'hésitant pas à leur donner l'occasion d'exprimer leurs opinions. Combien de dirigeants politiques africains peuvent se targuer d'avoir le respect et l'affection sincères de leurs compatriotes?
2-Deuxième message : émigrer n'est pas la solution. Une pathologique mentalité d'assistés tourne nos yeux, nos oreilles et même nos têtes d'ex-colonisés vers l'Occident (du moins culturellement quand ce n'est pas possible physiquement). Parmi les conséquences de cette absurde aliénation, l'invasion de l'Europe à travers l'émigration clandestine, malgré tous les drames humains hyper-médiatisés que nous connaissons. L'Histoire est même évoquée pour justifier le droit de l'Afrique à prendre sa part à la prospérité de l'Occident. Mais en réalité il s'agit d'un leurre : sans toucher aux réelles causes de notre retard économique, l'émigration (choisie ou clandestine) n'est qu'un remède palliatif et provisoire. Il est peut-être utile comme stratégie de harcèlement physique et moral de l'Occident, mais il ne devrait pas occulter l'essentiel, qui consiste à agir sur les vraies causes de cette migration : les guerres et l'insécurité, les dérives tribalistes de la mal-gouvernance, la faim et la maladie, la désespérance sociale liée au chômage, les sombres perspectives économiques, le manque de vision et de patriotisme, etc. Le phénomène de l'émigration clandestine, qui déplace le terrain et la nature de notre combat pour le développement, revient à aller quémander du poisson dans les pays étrangers, au lieu d'apprendre à pêcher dans nos propres eaux pourtant toutes aussi poissonneuses. En effet, nos pays ne sont pas pauvres, mais seulement victimes d'une gestion tatillonne, d'un tribalisme loufoque, de détournements impénitents des ressources, bref du manque de patriotisme de nos dirigeants. D'où le paradoxe de voir le monde se ruer vers l'Afrique aujourd'hui considérée comme l'avenir de l'humanité, alors que les Africains eux-mêmes ne rêvent que d'aller ailleurs. La mission historique des jeunes Africains d'aujourd'hui, c'est de se retrousser les manches et travailler à l'amélioration de la situation dans leurs pays, et non d'aller mourir comme des rats dans des embarcations de fortune dans la Méditerranée. Les Cubains nous ont prouvé, par l'exemple, qu'un pays peut se développer malgré l'hostilité de ses voisins, en s'armant de patriotisme et d'une énorme capacité de travail.
3- Troisième message : la prudence face à la religion et à l'argent. Les églises chrétiennes ont souvent précédé, accompagné ou suivi les conquêtes coloniales. Pis encore en Afrique, elles sont restées muettes face aux injustices et aux humiliations infligées aux colonisés qu'elles n'ont jamais formés à utiliser la force libératrice de l'Evangile pour changer leur situation sociopolitique. C'est pourquoi les marxistes disent que le christianisme berce les gens d'illusions sur l'au-delà, et anéantit en eux toute volonté d'action révolutionnaire. Mais la révolution cubaine n'a été ni antireligieuse ni anticléricale, mais simplement indifférente au fait religieux. Bien qu'ayant été élevé par les Jésuites, Fidel Castro n'est pas sentimentalement lié au catholicisme : il a expulsé des prêtres espagnols dès qu'il a eu la preuve qu'ils travaillaient contre sa révolution, mais il a aussi accepté leur retour ou leur remplacement quand l'incident a été jugé clos. Pour lui, la religion chrétienne véhicule des idéaux et des valeurs respectables, mais elle ne devrait ni s'enfermer dans un dogmatisme paralysant, ni aliéner les masses en leur enseignant l'acceptation passive de la misère et des injustices.
Concernant le goût du lucre, le rapport de la classe dirigeante avec l'argent est révélateur du degré de décrépitude morale du régime politique. En Afrique, les cas d'atteinte à la fortune publique par les gouvernants sont monnaie courante. Cet appétit financier excessif transforme la classe politique en une dangereuse ploutocratie insatiable qui accapare tout. Aidés par une corruption systémique et une justice aux ordres, ces gouvernants sont partout des prédateurs et des jouisseurs impénitents qui se délectent de tout ce que l'argent permet d'acquérir: femmes comme objets de plaisir, villas cossues, voitures rutilantes, vacances mirifiques et comptes bancaires impudiques à l'étranger. Pendant ce temps leurs pays stagnent ou régressent, car ces fortunés ne sont que des îlots d'opulence dans un océan de misère. La révolution cubaine, telle que l'incarne Fidel Castro et les autres dirigeants, nous enseigne la nécessité d'empêcher les gens véreux d'utiliser le manteau du pouvoir pour s'enrichir sans vergogne sur le dos du peuple.
Au bout du compte, l'expérience de Cuba sous Fidel Castro parle à tous les pays pauvres et dominés dans le monde. Ce leader s'est servi de l'idéologie pour défendre son pays de la voracité des impérialistes, profitant de la division du monde en deux blocs idéologiques antagonistes. Mais aujourd'hui les choses ont évolué, et la complexité des problèmes sociétaux invite au dépassement des illères doctrinales. L'essentiel finalement, c'est une espèce de realpolitik qui vise à satisfaire les besoins des populations par l'implémentation des meilleures politiques possibles. Ce réalisme ou pragmatisme, Fidel Castro l'a bien compris. Avec abnégation et obstination, il a joué sa partition dans l'histoire de Cuba, avec des succès évidents et des excès indéniables. Mais reconnaissons qu'en 2016, les Cubains ne peuvent ni avoir un accès libre à l'Internet, ni élire leurs dirigeants dans des élections libres et transparentes. Ceci n'est pas une exclusivité de Cuba certes, et c'est aux Cubains de profiter de la transition générationnelle annoncée pour 2018 pour faire toutes les réformes systémiques qui s'imposent. Le salut de Cuba réside sans doute dans un mélange judicieux des acquis positifs de la révolution castriste et des exigences de la démocratie et du respect des droits humains dans un contexte économique mondialisé. C'est certainement à cela que le Président américain Barack Obama faisait allusion le 22 mars 2016 dans son discours au peuple cubain prononcé à la Havane : "Je ne demande pas au peuple cubain de détruire quoi que ce soit, mais plutôt de construire quelque chose de nouveau". Quant à l'Afrique, elle est aujourd'hui confrontée au même type de défis colossaux que Cuba par rapport à son développement et à son émergence, et a par conséquent plusieurs raccourcis et faux clichés à désapprendre, tout comme des principes et des valeurs à apprendre de l'expérience cubaine avec Fidel Castro, mutatis mutandis.
Démocratie des tribus au Cameroun et succession de Paul Biya
I - QUE PENSER DE LA DEMOCRATIE DES TRIBUS ?
Pince-sans-rire, Mono Ndjana affirme en effet que si Titus Edzoa après sa sortie de prison remplaçait un jour Paul Biya au pouvoir, ce serait une faute grave aux conséquences incalculables. Pourquoi ? Depuis que les Peulhs en 1982 ont cédé le pouvoir aux Fangs-Bétis, les autres ethnies attendent impatiemment leur tour, et ne supporteraient pas qu'un frère de Paul Biya prolonge encore leur attente. Il va même plus loin dans ses prédictions : vu leur puissance financière, ces ethnies en attente vont recourir aux mercenaires étrangers dans cette lutte à mort pour le pouvoir.
Pour expliciter son point de vue, il estime que la démocratie n'est pas une pratique universelle et uniforme. Par rapport au choix des dirigeants, elle n'est individualiste et idéaliste que là où le sentiment national est déjà bien intériorisé par les diverses communautés du pays. Mais en Afrique, nos cafouillages démocratiques correspondent au stade actuel de notre évolution politique: nous sommes encore victimes de notre mentalité digestive et de notre nombrilisme clanique qui valorisent la motivation alimentaire plus que la citoyenneté nationale supra-ethnique. Par conséquent, nous nous comportons encore comme un peuple d'enfants ou d'affamés, qui n'ont jamais été éduqués à agir ou à penser autrement.
Après ce constat, on se serait attendu à ce que Mono Ndjana propose l'enracinement de la démocratie comme antidote de ce tribalisme rétrograde et infantilisant. Au contraire, il prescrit la démocratie "communautaire "", qui valorise l'équilibre ethno-régional et le consensus plus que la majorité des voix électorales. Pour lui, l'Afrique doit parvenir à la démocratie en suivant les mêmes étapes que l'Occident. En attendant, elle devrait se contenter des pratiques actuelles malgré leurs méfaits, dans une espèce d'étape pré-démocratique. Cette étonnante justification du tribalisme en politique étale très vite ses limites à l'observation. Ce fléau n'est ni tolérable ni acceptable parce qu'il est provisoire. Ses dégâts sont innombrables : même au sein de la tribu qu'on veut favoriser dans la pure logique tribaliste, les démons du sectarisme continuent de dresser les Camerounais les uns contre les autres. En effet, ceux qui y sont promus par le système le sont selon des critères jamais élucidés, en tout cas sans aucun rapport avec leur compétence technique ou managériale, leur militantisme politique, leur exemplarité comportementale, ou leur capacité à tirer leur région ou leur tribu vers le haut, comme le révèle l'Opération Epervier et comme l'a dénoncé Charles Ateba Eyene dans un livre qu'il a publié en 2008.
Pour Mono Ndjana, la prégnance du fait tribal nous empêche de faire passer notre pays de l'affrontement ethnique permanent à la conscience partagée d'avoir un même destin national. Mais pour lui, est-ce un reproche ou un éloge ? En fait ses propos s'adressent à plusieurs destinataires: à son parti politique qui ne l'a pas récompensé pour son militantisme malgré sa proximité tribale, il annonce la fin de son hégémonie, espérant voir certains rats quitter le navire ; aux extrémistes Fangs-Bétis tentés de se cramponner au pouvoir par réaction ou par instinct de conservation, il agite l'épouvantail du spectre de la guerre civile; à ceux qui piaffent d'impatience de confisquer à leur tour le pouvoir, ces paroles tendent à flatter leur égo. Au bout du compte, loin d'inviter les uns et les autres à dépasser le repli identitaire, ces propos le renforcent chez nous, au moment où dans le monde se constituent des cercles de solidarité de plus en plus vastes et ouverts.
II - DES PRESUPPOSES TROUBLANTS ET DESOLANTS
Pis encore, ces affirmations reposent sur trois présupposés intrigants, qui semblent aller de soi pour Mono Ndjana. D'abord, comme aucune tribu parvenue au pouvoir ne veut le partager avec les autres, chaque tribu doit nécessairement avoir son tour aux affaires. Ensuite, la gestion essentiellement tribale du pouvoir (par les Peulhs de 1958 à 1982 et par les Fangs-Bétis depuis 1982) est un précédent qui doit devenir la norme. Enfin, parce qu'ils sont viscéralement attachés à leurs tribus et ne maitrisent pas les rouages de la démocratie, les Camerounais devraient se contenter de la gestion politique tribale actuellement pratiquée. Que penser de ces présupposés ?
II-1 A chaque tribu son tour à la mangeoire ?
D'abord, si l'appartenance tribale doit être plus déterminante dans le jeu politique que la citoyenneté nationale, pourquoi ne formalisons-nous pas cela par souci de transparence? Au Nigeria par exemple, le consensus national est qu'à la tête de la fédération un président nordiste et musulman (assisté d'un vice-président sudiste et chrétien) succède à un président sudiste et chrétien (lui-même assisté d'un vice-président nordiste et musulman), ou vice versa. Sans avoir formellement procédé à de tels arrangements consensuels, les Camerounais sont en plein dans un marché de dupes. Ensuite, considérer le pouvoir politique comme un gâteau à consommer par les tribus à tour de rôle, c'est faire de notre pays un théâtre où chaque troupe (tribale) vient jouer un spectacle macabre qui consiste à manger, boire et, dans la foulée, détourner le maximum des ressources du pays le plus longtemps possible. Cela transforme du coup les membres des autres tribus en spectateurs envieux et impatients de pouvoir à leur tour faire la même chose à leur guise. Il s'agit d'une curieuse conception de la politique que Mono Ndjana ne dénonce pas mais légitime sans états d'âme. Cela appelle quelques interrogations:
- Comment pouvons-nous construire une nation sans une vision élevée capable d'inspirer et de guider son organisation présente et future? Comment pouvons-nous vouloir l'inclusion en promouvant l'exclusion, souhaiter l'intégration nationale en encourageant la confrontation tribale? Visiblement l'instauration d'une nation fraternelle n'est pas parmi nos objectifs à terme, sinon pourquoi entretenir tant de frictions ethniques qui font de notre pays une véritable poudrière?
- En l'absence d'un tel idéal à l'aune duquel leurs actions peuvent s'évaluer, nos dirigeants politiques peuvent-ils réellement travailler en pensant à l'avenir? Peuvent-ils par exemple penser à former leurs successeurs potentiels pour s'assurer la pérennité de leur uvre? Sont-ils conscients que les individus passent tandis que les nations demeurent ? Ne sont-ils pas finalement comme des rats à qui on demanderait de planter des kolatiers ? En effet, selon un adage de chez nous, on ne peut pas s'attendre à ce que le rat (qui vit à peine quelques mois) plante des kolatiers (qui ne produiront des fruits qu'après plusieurs décennies de lente maturation).
- Pendant combien de temps restera paisible et indépendant un tel pays? L'édification d'une nation, comme une uvre collective de longue haleine, bénéficie des apports successifs et cumulés de plusieurs générations de citoyens conscients de bâtir quelque chose qui les transcende. Avec tous nos antagonismes ethniquement cultivés, la moindre étincelle ne pourrait-elle pas mettre le feu aux poudres à tout moment, réduisant ainsi à néant tous nos efforts passés?
Plus sérieusement, disons que le pouvoir politique dans un pays ne devrait pas être une mangeoire. Aucun groupe ayant un agenda caché (d'inspiration tribale ou autre) ne devrait à aucun moment confisquer ou contrôler le pouvoir politique. C'est cela qui a abouti au génocide rwandais en 1994. Ce n'est pas parce que les Fangs-Bétis et les Peulhs ont géré le pouvoir au Cameroun comme une mangeoire que cette déviance regrettable doit devenir la norme. Il est salutaire que le pouvoir politique change de mains, mais pas pour qu'un groupe tribal autoproclamé "pays organisateur" laisse un autre groupe continuer la même musique. En l'absence d'un ordre de passage négocié et connu d'avance, comment éviter l'affrontement entre les tribus en attente depuis longtemps, celles qui veulent s'accrocher au pouvoir par cupidité, et celles qui souhaitent par égoïsme y revenir après un premier passage? Comment garantir le fair-play dans ce combat ethnique ou éviter l'abus d'une position ethnique dominante ? Comme on le voit, une vision ethno-centrée du pouvoir politique et de l'alternance est un archaïsme absolument clivant et paralysant qui ne peut conduire qu'aux tensions tribales et à l'incertitude politique, une situation qui effraie et éloigne les investisseurs.
L'alternance au pouvoir, si elle est démocratiquement effectuée et non ethniquement disputée, est positive pour des raisons plus patriotiques. Elle consacre l'arrivée aux affaires, non pas d'une autre ethnie, mais d'une nouvelle équipe de femmes et d'hommes politiques porteurs d'une nouvelle vision pour leur pays, qui ont obtenu du peuple un mandat limité dans le temps pour dérouler un programme précis. Compétents, patriotes et venant de toutes les régions du pays, ils travailleront en synergie dans l'intérêt supérieur de la nation, et non chacun pour ses proches. Par leur posture, ils rassurent les investisseurs nationaux et étrangers. Et Dieu seul sait ce qu'une telle équipe peut accomplir en un temps record si elle sait allier l'imagination créatrice à l'unité d'objectif et de style, une farouche détermination à laisser une empreinte durable dans les curs de leurs compatriotes à l'audace politique galvanisée par le patriotisme. A chaque alternance, après une autocritique sans complaisance, le pays devrait se livrer à une autocritique sans complaisance, et pouvoir donner une nouvelle feuille de route à la nouvelle équipe. Au Cameroun, ce sera l'occasion idoine de corriger les excès d'un présidentialisme trop fort qui a conduit à une ethnicisation extrême du pouvoir depuis 1958, avec tous les dégâts collatéraux que nous connaissons. Ce sera aussi le moment de voir si nous avons fait le bon choix de faire d'un seul homme le chef du parti au pouvoir, le chef de l'Etat qui nomme à toutes les hautes fonctions civiles et militaires sans aucun mécanisme de contrôle et de contrepoids, le président du conseil supérieur de la magistrature, le chef suprême des forces armées et de la diplomatie, bref la clef de voûte institutionnelle vers laquelle tout doit absolument remonter. Pas étonnante la légendaire inertie qu'un tel système politique produit. En réalité, il fonctionnait comme un corps humain dépourvu des mécanismes automatiques, dans lequel pour chaque petit mouvement du pied, de la main, des poumons ou des intestins, l'ordre devait être décrété par le cerveau, ce qui conduit naturellement au blocage. Voilà le genre de problèmes que l'alternance devrait résoudre dans un esprit totalement oblatif, loin des calculs tribalistes, limitatifs ou vindicatifs. D'ailleurs étant donné tous les dérapages enregistrés au cours de notre premier demi-siècle d'indépendance, le Cameroun gagnerait à s'assurer qu'aucune tribu, même pas celle du chef de l'Etat, ne soit dorénavant en mesure de contrôler tous les postes stratégiques dans le pays.
II-2 Existe-t-il une norme établie de dévolution du pouvoir au Cameroun?
Même si nous admettions avec Mono Ndjana qu'Ahidjo et Biya ne représentaient que leurs ethnies lors de la passation du pouvoir en 1982 au Cameroun, cela veut-il dire que le pouvoir chez nous restera ethniquement géré et transmis à perpétuité? Il revient aux Camerounais de comprendre qu'une pratique qui produit plus de dissensions que de cohésion dans un pays devrait être abandonnée, et qu'il faudrait cultiver des éléments plus fédérateurs à l'ère de la construction des Etats-Unis d'Afrique au sein de la mondialisation.
Comme une solide corde tissée avec plusieurs fils différents, la nation construit son identité et sa solidité en combinant avec intelligence ses diverses entités tribales. Cela se voit clairement en matière de culture. Loin d'être une source d'antagonismes, la diversité ethnique positivement vécue est culturellement enrichissante. Elle est l'humus qui féconde notre génie créateur dans plusieurs domaines: du football à la littérature, des arts plastiques aux arts culinaires, de la musique au cinéma, etc. La promotion de nos richesses ethnico-culturelles devrait d'ailleurs être au centre d'une politique de dynamisation culturelle au service de notre intégration nationale et de notre rayonnement international. Nos festivals culturels (le Ngouon, le Ngondo, le Mpo'o, etc.), le rituel des funérailles chez les Bamilékés, nos arts culinaires diversifiés, nos traditions orales véhiculées par nos langues locales, notre riche pharmacopée traditionnelle à base de plantes naturelles, nos pittoresques tenues traditionnelles d'apparat, etc. sont autant de valeurs culturelles positives à développer et à pérenniser.
Mais ce qui fait problème, c'est l'utilisation politicienne de l'appartenance tribale pour rallier les gens d'un clan à une cause qu'ils ignorent, ou tout simplement pour tout accaparer. Le danger pour la cohésion nationale, c'est utiliser impunément le pouvoir d'Etat de façon discriminatoire dans la gestion des citoyens, en accordant aux uns ce qui est ostensiblement refusé aux autres. Légitimer une telle pratique signifie que le droit de la force a remplacé la force du droit. Cette tendance est visible dans les actes de nomination aux hautes fonctions civiles et militaires dans nos pays africains. C'est cela qui s'appelait apartheid en Afrique du Sud avant 1994. Si le seul critère d'accès aux postes importants ou sensibles était la compétence, les tribus se battraient au même pied d'égalité pour avoir des candidats valables pour ces hautes fonctions. Cela réduirait au strict minimum le recours à la discrimination positive pour des besoins de convivialité ethnique. Ce serait tant mieux pour la saine émulation dans le pays, pour l'efficacité et la performance de nos systèmes. Mais lorsque nous pratiquons un favoritisme puéril qui fait fi de l'efficacité, infantilise les bénéficiaires et scandalise les autres, nous faisons de la réalité multiethnique un usage inintelligent, contreproductif et même dangereux. Cela devrait être éradiquée par des lois fortes qui incitent chacun à réussir par ses efforts personnels. C'est la voie obligée de la compétitivité par laquelle sont passés les pays qui sont aujourd'hui émergents.
II-3 La démocratie n'a-t-elle pas de modèle à notre taille?
Au cur de la démocratie se trouve l'égalité des citoyens partout sur le territoire national, un principe illustré par la formule "un homme, une voie" lors des élections. Sans avoir catégorisé les habitants de nos pays, comme le firent jadis les colons français pour qui les "indigènes" vivaient dans les colonies et les "citoyens" à la métropole, il est contradictoire d'accepter la république en rejetant comme inadaptés l'Etat de droit et la démocratie qui lui sont intrinsèques. Le tribalisme vient ainsi au secours des ennemis de la démocratie, car il refuse à certains l'égalité promise à tous par la république: par ce subterfuge, une tribu de quelques milliers de personnes peut tout contrôler dans un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Dans un tel contexte, les élections même transparentes deviennent une farce, puisque c'est la tribu qui au bout du compte pilote le pays. Ce ne sont donc pas les Camerounais qui sont trop attachés à leurs tribus et par conséquent réfractaires à la démocratie, mais ce sont les tribalistes qui rejettent la démocratie parce qu'elle s'accompagne du respect de l'égalité citoyenne. Et pis encore, de fil en aiguille, ils rejettent aussi la bonne gouvernance qui, à travers l'efficacité dans la transparence, promeut l'intérêt général en éliminant les dysfonctionnements politiques, les déséquilibres économiques et les crises éthiques au sein des Etats. La logique tribaliste nie donc à la démocratie sa prétention à l'universel, alors que les pays comme le Ghana, le Sénégal, l'Inde, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays en développement ont mis sur pied des systèmes démocratiques qui marchent bien.
Le pouvoir devrait aussi changer de mains, par le vote populaire à date constitutionnellement échue, non pas parce que les tribus sevrées de pouvoir menacent de faire intervenir des mercenaires étrangers, mais pour permettre le renouvellement des idées, des hommes et des structures grâce à l'arrivée d'une masse critique d'hommes nouveaux capables d'insuffler les changements souhaités. Les Camerounais sont à même d'identifier de bons programmes politiques sans tenir compte de l'origine tribal de leurs concepteurs, et de comprendre qu'une tribu ne devrait pas être stigmatisée dans un pays à cause des exactions de quelques individus appartenant à cette tribu. D'ailleurs, il n'y a en réalité que deux tribus dans nos pays d'Afrique : la tribu minoritaire des possédants arrogants, repus et dodus (on la retrouve dans toutes les régions du pays) et la tribu majoritaire des débrouillards démunis, chétifs et rétifs (encore plus présents partout que les premiers). Le pouvoir politique qui remplacera l'actuel, sans aucun esprit de revanche contre les Peulhs et les Fangs-Bétis, devra s'imposer le devoir historique de corriger les dérives qui ont plombé le Cameroun pendant des décennies : la corruption, le tribalisme exacerbé, l'inertie systémique, l'équilibre régional pour masquer le nivellement par le bas, le favoritisme qui ridiculise la compétence, la création des élites factices par le lien tribal et non par le travail ou le mérite, etc. Et sans nécessairement être au pouvoir, chaque ethnie, communauté ou région de notre pays y trouvera son compte.
En nous focalisant sur le contrôle ethnique du pouvoir politique, nous nous sommes éloignés de l'essentiel, faisant de la politique notre plus grand diviseur national. Nous avons mieux à faire que de compter éternellement nos tribus, pendant qu'ailleurs on s'entend sur l'essentiel, travaille efficacement et avance rapidement. Après tout, un pays ne se développe qu'en cultivant les valeurs cardinales telles que la mystique du travail bien fait, la qualité intrinsèque du leadership, la valorisation des compétences, un management tourné vers les résultats, le sens de l'éthique, etc. Inversement, ce qui condamne une région ou un pays à la misère, ce sont les défaillances systémiques ou structurelles comme la mauvaise gouvernance, la corruption et la prévarication, les conflits ethniques latents, la mauvaise gestion de l'environnement, la médiocratie, etc. Il est désolant de constater qu'au lieu d'encourager notre pays à s'arrimer à la modernité pour plus sûrement construire son émergence en 2035, certains de nos intellectuels déploient des tonnes d'ingéniosité à tropicaliser la démocratie en la vidant de ce qui ailleurs fait son essence et sa force. Cela nous fait penser à certains intellectuels qui en leur temps ont légitimé l'esclavage, la traite négrière, la colonisation et même le néocolonialisme.
III - L'URGENCE DE SORTIR DU PIEGE TRIBAL
Seul un insensé fait la même chose pendant longtemps sans jamais se demander s'il est en train d'avancer ou de reculer, d'échouer ou de réussir. Après plus de 50 ans d'indépendance, pourquoi la confrontation tribale continue-t-elle à rendre impossible la nécessaire fraternisation parmi les fils d'un même pays pourtant condamnés à progresser ensemble ou à périr ensemble ? Les Africains devraient développer un sens de la nation plus fort que l'appartenance à une tribu. Certes en chacun de nous cohabitent deux sensibilités tournées vers deux allégeances distinctes: d'un côté le citoyen du pays capable de s'élever au niveau des préoccupations nationales, et de l'autre la personne privée membre d'une famille ou d'une ethnie particulière. Ces deux allégeances sont parfaitement gérables et ne s'excluent pas mutuellement : le citoyen peut et devrait être capable de taire ses intérêts privés et tribaux dès lors qu'on parle de la gestion politique du pays, car cette dernière est une science obéissant à des règles modernes de bon fonctionnement. Personne ne nous demande de renier ou de détester nos tribus : nous pouvons les aimer sans nous y empêtrer, en sachant que nous ouvrir stratégiquement aux autres nous apporte de l'oxygène, tandis que nous replier sur nous-mêmes est absolument sclérogène.
En effet, la balkanisation est toujours débilitante pour tout le monde. Ici nous revient à la mémoire l'échec répétitif des grèves estudiantines à l'unique université camerounaise de Yaoundé dans les premières décennies de l'indépendance. Pourquoi ? Le pouvoir politique de l'époque savait habilement jouer sur les clivages tribaux pour parvenir à ses fins. Dès que commençait une grève au campus, chaque ministre rencontrait nuitamment en sa résidence les étudiants de son ethnie et les exhortait à se démarquer des étudiants venant des autres régions du pays, car sous le prétexte de la grève, ces derniers voulaient mettre le pays à feu et à sang; après avoir dit cela, le ministre corrompait quelques leaders estudiantins bien choisis, qui à leur tour devaient amener leurs camarades de la même tribu à se désolidariser du mouvement, et le tour était joué. Les étudiants ainsi ethniquement divisés et opposés commençaient à se suspecter les uns les autres, et le mouvement de grève implosait par fissuration. Cela confirmait une vérité aussi vieille que le monde : tout comme l'union fait la force, la fragmentation fait la faiblesse.
Certes chacun de nous est né quelque part, et dans la république personne ne devrait avoir à s'en excuser. Mais nous devrions apprendre à regarder au-delà de nos petits villages, car ils ne peuvent plus nous suffire aujourd'hui. Face à des défis collectifs, les solutions les plus efficaces sont également collectives. L'émergence du Cameroun prévue en 2035 ne se fera pas avec un pays en lambeaux où les ethnies s'entre-déchirent comme à l'époque précoloniale. Ce sera avec un Cameroun dont les populations, ayant transcendé le saucissonnage tribal, auront en partage une même vision de l'avenir à construire autour des valeurs partagées qui font recette en ce 21ème siècle.
CONCLUSION
Comme en accédant à l'indépendance les pays africains ont choisi de devenir des républiques, ils devraient logiquement en accepter les principes d'organisation. Parmi ceux-ci, il y a le respect des libertés, le pluralisme doublé de la concurrence pour éviter les monopoles et les situations dominantes, le choix démocratique des dirigeants à tous les niveaux et surtout, l'égalité absolue des citoyens en droits et en devoirs. Cela n'est possible que si les tribus s'abstiennent de violer sciemment le pacte républicain avec des attitudes, des actions et des revendications nombrilistes qui visent plus à éliminer un groupe ethnique rival qu'à faire avancer le pays en tant que maison commune. Nous devrions faire en sorte que les entités tribales ne soient plus un obstacle à la construction de la grande entité nationale. Tout comme le racisme longtemps pratiqué en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, le tribalisme devrait être vigoureusement combattu en Afrique parce qu'il constitue la négation même du principe démocratique de l'égalité de la citoyenneté dans un Etat de droit. Même si des intellectuels utilisent des arguties pour essayer de banaliser ou faire accepter le tribalisme, notre devoir moral le plus urgent aujourd'hui est d'avoir le courage d'éradiquer ce fléau qui chaque jour allume dans nos pays un nouvel incendie qu'il faut éteindre dans l'urgence.
Parcours et combat de Nelson Mandela : quelles leçons pour le Cameroun en quête d'émergence ?
I - Un héros adulé, mais peu imité en Afrique
Nonobstant son caractère hideux et monstrueux, l'apartheid a permis la projection de la sublime âme de Nelson Mandela à la face du monde. Sans être un saint ou un prophète, il a symbolisé le meilleur de l'Afrique dans les circonstances qui étaient les siennes. Avec lui et Barack Obama (le premier fils d'Afrique élu président des Etats-Unis en 2008), la barre est désormais très haute pour les Africains : personne n'osera plus douter de leurs capacités d'atteindre les plus hauts sommets du charisme et de l'humanisme, de la conscience et de la compétence, du cur et de la raison.
Cependant l'arbre ne devrait pas nous empêcher de voir la forêt.
Lorsqu'on fait l'éloge de Nelson Mandela ou de Barack Obama, plusieurs hommes politiques du continent font profil bas. Ils sont gênés aux entournures soit parce qu'ils s'adonnent à des pratiques aussi vexatoires et discriminatoires que celles qu'a combattues Nelson Mandela, soit parce qu'ils sont englués dans des systèmes opaques et maniaques (fraudes, sectes, népotisme, prévarications, etc.) incapables de faire surgir dans leurs pays des leaders inattendus comme Barack Obama. La seule différence étant qu'au lieu du racisme, c'est dans le tribalisme rétrograde et d'autres sectarismes inavouables qu'ils excellent, en laissant la corruption brouiller les contours de cet apartheid à peine déguisé.
II- De l'éveil à la conscience politique au recours à la lutte armée
Nelson Mandela a grandi dans un pays martyrisé par la ségrégation raciale érigée en un système répressif et violent. Deux catégories sociales s'y affrontaient en permanence : d'un côté la majorité noire privée de tous ses droits politiques et sociaux, et de l'autre la minorité blanche s'arrogeant tous les droits et privilèges. Dès l'année 1948, avec la victoire électorale du Parti National Afrikaner conduit par Jean François Malan, la discrimination raciale se systématise et se radicalise dans ce pays. Après avoir précisé le poids de chacune des quatre races présentes dans le pays (les Blancs, les Asiatiques, les Métis et les Noirs), le système créa pour les Noirs des zones exclusives d'habitation (les fameux Bantoustans qui représentent 13% de la superficie du pays et où s'entassent 80 % de la population), des cités-dortoirs à la périphérie des grandes villes et même des laissez-passer spéciaux. A la discrimination juridique et institutionnelle s'était ainsi superposée une rageante ségrégation territoriale et sociale.
Face à une telle immoralité systémique aux conséquences si désastreuses, avec d'autres leaders noirs, Nelson Mandela a choisi de se rebeller. Il confirmait ainsi le fait que seule la dissidence, si elle n'est pas combattue ou étouffée, peut conduire à des évolutions salutaires. Pour obtenir l'égalité raciale et la démocratie, Nelson Mandela était disposé à sacrifier sa liberté, sa vie familiale, sa carrière d'avocat, sa santé et même sa vie. L'ANC (le Congrès National Africain), fondé en 1912 pour mettre fin à cette politique, utilisa d'abord des méthodes non violentes comme les pétitions, la désobéissance civile, les marches de protestation et les appels au boycottage. Mais avec la violence d'Etat, une branche armée du mouvement - baptisée umkhonto we siswe ou la lance de la nation - fut créée en 1961et placée sous le commandement opérationnel de Nelson Mandela.
A ce niveau, les leçons à retenir sont nombreuses pour le Cameroun et l'Afrique.
En matière de revendication des droits politiques, la lutte armée n'est pas une option à écarter, les actions pacifiques pouvant s'avérer inefficaces. Mais les combattants de la liberté devraient bien s'organiser, s'armer d'une grande capacité de résilience et se convaincre que le chemin vers la victoire sera semé d'embûches. En effet, étant donné les intérêts en jeu et le rapport de forces, il serait bien naïf d'espérer que les puissances occidentales sacrifieront leurs intérêts économiques et stratégiques sur l'autel du bien-être des Africains. La posture de Nelson Mandela est donc une leçon de réalisme venant d'un leader qui, comme jadis le général de Gaulle en France, avait lié son destin personnel à celui son pays.
Concrètement, il a d'abord canalisé la colère de son peuple dans une structure de lutte plus efficiente que les actions isolées; puis à l'instar de Fidèle Castro, il n'a pas hésité à prendre les armes lorsque cela était devenu inéluctable; ensuite, à la manière du Mahatma Gandhi, pendant ses années de prison, il s'est laissé reformater par un profond mouvement de résistance spirituelle et de purification intérieure qui lui a donné un formidable ascendant moral sur ses interlocuteurs blancs; plus tard, un peu comme Martin Luther King, il a donné une voix et un visage aux revendications de son peuple; enfin après sa sortie de prison en 1990, à la manière d'Abraham Lincoln, il a eu la sagesse d'inspirer une nouvelle constitution pour ressouder une nation ébranlée dans ses fondements par l'apartheid. Pour toutes ses réalisations exceptionnelles - sans aucun doute facilitées par sa capacité de se comporter tour à tour comme de Gaulle, Martin Luther King, Fidèle Castro, Gandhi et Abraham Lincoln - Nelson Mandela est devenu une icône planétaire que les leaders africains devraient aujourd'hui être fiers d'imiter.
III - De la ténacité dans la lutte à la négociation avec l'ennemi
Le procès dit de Rivonia se termine le 12 juin 1964 avec la condamnation de Nelson Mandela et de 7 de ses 10 coaccusés aux travaux forcés à perpétuité. Nelson Mandela assurait lui-même sa défense lors de ce procès qu'il transforma en une tribune politique. Il indiqua d'abord que le but de son combat était l'amélioration des conditions de vie des millions d'enfants noirs qui passaient leurs journées à côtoyer la délinquance, sans aller à l'école et même sans voir leurs parents partis travailler en zone blanche pour une maigre pitance. Puis il dénonça le fait que 25 millions de Sud-Africains, à cause de la couleur de leur épiderme, vivaient dans une précarité intolérable du fait des lois injustes, immorales et donc inacceptables. Il insista sur le fait que les accusés, loin d'être des bandits de grand chemin ou des terroristes à la solde du communisme comme le prétendaient le régime raciste et ses alliés occidentaux, avaient tout simplement écouté leur conscience les invitant à lutter contre ce régime mortifère. Pour conclure, il affirma sur un ton grave et solennel : "J'ai lutté contre la domination blanche ; j'ai lutté contre la domination noire ; j'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les races vivent en harmonie et disposent des mêmes chances ; c'est un idéal que j'espère réaliser au cours de ma vie et pour lequel, s'il le faut, je suis prêt à mourir". Ici on a certainement cru entendre Fidèle Castro déclarant devant le tribunal de la Havane, à l'époque du dictateur Batista, lors de son procès pour subversion après son débarquement raté à Cuba en 1956 : "Il est normal que les hommes d'honneur soient tous morts ou en prison, dans un pays dont le président est un criminel et un voleur. Condamnez-moi si vous le voulez bien, l'Histoire m'acquittera".
Cette audace galvanisée par un patriotisme hors pair et par une foi inébranlable en la cause défendue, c'est ce qui manque le plus chez la plupart des politiciens africains, notamment chez ceux qui se disent de l'opposition. Loin de constituer une force de veille démocratique, de propositions alternatives ou de contrôle critique du pouvoir, les opposants chez nous passent leur temps à se neutraliser, à se combattre et même à faire des clins d'il au régime en place. Le mot politicien est devenu synonyme de personne sans hauteur ni pudeur, sans vision ni conviction, ondoyante et inconstante dans ses opinions, et prête à tous les grenouillages pour accéder à la mangeoire. A cause de leurs motivations bassement alimentaires, nos politiciens ont fait perdre à la politique sa capacité de transformation positive de nos systèmes d'organisation. On a même entendu des leaders d'opposition au Cameroun déclarer avec un air de jactance qu'ils souhaitaient entrer au plus tôt au gouvernement parce qu'ils ne voulaient pas rester "des opposants à vie".
Ces opposants de circonstance et sans substance savent-ils que Nelson Mandela est resté, pendant 27 années d'incarcération, fidèle à ses idées et à ses idéaux, refusant même d'être libéré par le régime raciste qui lui demandait en contrepartie de renoncer à ses convictions ? Par la suite, il a obtenu un élargissement plus conforme à sa cause le 11 février 1990. Et lorsqu'est venu le temps de la négociation, du compromis et du pardon, il n'a pas hésité à franchir ce pas, car "pour faire la paix avec un ennemi, on doit collaborer avec lui, et il doit devenir votre associé".
Ici encore, les leçons pour les Africains sont particulièrement édifiantes.
Si les droits politiques n'étaient octroyés au peuple que par la magnanimité d'un pouvoir lassé ou repenti de son oppression, cela ne constituerait qu'un geste de pitié ou de mansuétude. Heureusement que les droits politiques s'arrachent toujours au bout d'une intrépide lutte menée avec méthode et détermination. Mais il ne faudrait pas ici confondre opiniâtreté et aveuglement stérile : intransigeant sur le fond, il faut rester lucide et prêt à faire des compromis sur certains aspects non-essentiels, ne fût-ce que pour ménager une sortie honorable aux adversaires. En Afrique, rares sont les hommes politiques (du pouvoir ou de l'opposition) qui s'acquittent de leur mission avec hauteur et dignité, ou qui persévèrent jusqu'au bout dans la voie de l'intégrité morale. C'est pourquoi au-dessus du ciel africain, la figure de Nelson Mandela brillera longtemps par sa singularité et son exemplarité.
IV - Des tensions raciales à l'harmonie nationale par l'ubuntu
Sous le parapluie de l'apartheid, les stratèges afrikaners ont bâti une implacable suprématie blanche, fondée sur le déni des droits politiques à la majorité noire du pays. Mais la discrimination raciale allait beaucoup plus loin : derrière les apparences, c'était en fait une lutte sans merci entre l'opulence et l'indigence, la liberté et l'esclavage, l'équité et l'injustice, la générosité et l'indifférence. C'est ainsi que le système avait finalement enfermé toutes les races dans le ghetto de la déshumanisation qui conduit à la haine et à la peur des autres. Cela aurait pu constituer un handicap insurmontable même après la fin de l'apartheid, si les nouveaux dirigeants du pays n'étaient pas imprégnés de l'esprit d'ubuntu, cette culture d'humanisme bien connue en Afrique.
Pour Nelson Mandela en effet, la notion d'ubuntu est bâtie autour des valeurs comme "le respect, la serviabilité, le partage, le communautarisme, la générosité, la confiance et le désintéressement". Elles promeuvent le vivre-ensemble au plan local, national, continental et même mondial, et s'opposent à l'individualisme et à l'égoïsme qui sont perçus, notamment par la majorité noire en Afrique du Sud, comme des valeurs typiquement blanches. Elles incitent l'individu et le groupe à faire preuve de compassion, de tolérance, de pardon et du respect d'autrui. Il s'en suit qu'une partie de la société ne saurait vivre heureuse et en sécurité dans sa tour d'ivoire, pendant qu'une autre vit dans l'indignité et l'indigence.
Lorsqu'un acteur politique se laisse guider par l'esprit d'ubuntu, cela se voit à travers ses actes. Par exemple, c'est cet esprit qui a conduit Nelson Mandela à rejeter l'apartheid sans pourtant condamner les Blancs en tant qu'êtres humains, car il était convaincu que derrière la brutalité du racisme se cachait un fond d'humanité qui finirait tôt ou tard par rejeter ce système; c'est le même esprit qui l'a poussé à partager le pouvoir avec les Afrikaners, afin de parvenir non seulement à un changement des lois, mais au-delà, à un changement des curs.
C'est à ce même esprit qu'on doit la création de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) en Afrique du Sud entre 1996 et 1998. En invitant chacun à témoigner sur les horreurs vues, subies ou commises, cette catharsis nationale a permis de pacifier les esprits et surtout, de redonner aux victimes leur dignité perdue. Mieux encore, elle est devenue une référence et un modèle exportable : elle a été imitée dans plusieurs pays africains comme au Sierra Leone et au Ghana en 2002, en RDC en 2003, au Maroc en 2004, au Libéria en 2006, au Kenya en 2008, en Côte d'Ivoire en 2011 et au Mali en 2013. Elle a également été reprise dans les pays latino-américains comme l'Argentine, le Brésil, le Chile, l'Uruguay, le Salvador, le Guatemala et le Pérou. C'est une autre leçon de sagesse que nous a léguée le pays de Nelson Mandela. Sans elle, les Sud-Africains allaient tout droit vers un effroyable bain de sang. Grâce à elle, ils ont découvert qu'ils pouvaient obtenir plus par le dialogue et la négociation que par la vengeance et la violence.
Comme pays de grandes disparités humaines et naturelles où le sentiment national n'est pas encore solidement ancré dans les curs, le Cameroun a intérêt à cultiver l'esprit d'ubuntu, sans lequel aucun consensus ou compromis n'est possible dans ce pays. En effet, avec ses 22 millions d'habitants en 2014, le pays compte environ 250 langues autochtones avec autant de groupes ethniques. Parmi ces groupes, les plus importants sont les suivants : au Centre et au Sud, les Ewondo, les Fang, les Boulou ainsi que les Bassa et les Bakoko dans la vallée de la Sanaga; à l'Ouest, les semi-Bantous Bamiléké organisés en plusieurs royaumes autonomes, les Bamoun qui leur sont apparentés ainsi que les chefferies du Nord-ouest ; dans le Littoral et dans le Sud-ouest, les Sawa et les Bakweri, qui ont été les premiers à subir l'influence coloniale ; dans le Grand-Nord on trouve les Kirdis païens dans les Monts Mandara, les Foulbés musulmans autour des grandes villes comme Maroua, Garoua et Ngaoundéré, ainsi que les Kotoko et les Arabes-Choa près du Lac Tchad. Ajoutons à ce tableau humain bigarré l'extrême diversité religieuse (avec la forte présence de l'Islam, des diverses obédiences du Christianisme et des croyances traditionnelles), ainsi que les séquelles contrastées de la colonisation subie en plusieurs vagues (allemande jusqu'en 1918, puis française et anglaise jusqu'en 1960 et 1961). Le pays consacre aujourd'hui la coexistence d'un Cameroun anglophone à côté d'un Cameroun francophone, d'où la nécessité du bilinguisme officiel français-anglais pour cimenter cet ensemble fort complexe. A l'ouverture démocratique dans les années 90, plusieurs revendications identitaires centrifuges ont été théorisées ici et là : le problème Kirdi, le problème anglophone et surtout la question Bamiléké ont envahi le champ du débat sociopolitique, tandis les élites Sawa réclamaient une plus grande protection des minorités, suite à l'introduction dans la Constitution de 1996 de la notion fort controversée d'autochtones et d'allogènes. La question bamiléké a fait des vagues même au sein l'Eglise Catholique, avec une virulente lettre des prêtres de Douala adressée au Vatican le 16 mars 1987 suite à la nomination d'un évêque auxiliaire bamiléké à Douala, et surtout à l'occasion de la nomination d'un archevêque bamiléké à Yaoundé le 17 juillet 1999. Dans un tel contexte sociopolitique de méfiance faite de peurs et de susceptibilités, l'esprit d'ubuntu a un énorme travail à faire dans les curs et les esprits des Camerounais, car un pays divisé contre lui-même devient vulnérable et incapable de travailler sereinement pour son émergence. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, cet esprit devrait faire comprendre à tous qu'aucune ethnie n'est rien sans les autres, que l'inclusion est toujours plus sécurisante que l'exclusion, et que même les différences - supposées ou réelles - constituent une chance et une richesse pour le pays, comme cela s'est vu notamment aux Etats-Unis. En réalité, l'esprit d'ubuntu devrait aider le Cameroun à sortir des impasses politiques comme le problème anglophone, la question bamiléké, la marginalisation des Kirdis, la minorisation sociopolitique de la majorité féminine, la décentralisation comme base et stimulus du développement équilibré des régions, le verrouillage du système politique, le non-balisage de l'alternance politique, etc.
L'esprit d'ubuntu pourrait encore mieux s'apprécier à travers les crises causées par son absence. En effet, c'est la non-reconnaissance par les protagonistes d'un conflit de leur appartenance à une même entité particulière qui exacerbe souvent les tensions. Cela s'est vu en grandeur nature en Côte d'Ivoire en 2010.
Ce pays francophone ouest-africain, par sa stabilité politique et son rayonnement économique, a longtemps symbolisé une présence moins négative de la France en Afrique. Les premières décennies de l'indépendance en effet y ont été marquées par un remarquable essor économique basé sur la production du café et du cacao. Mais suite à l'effondrement des prix de ces produits à la fin des années 80, et après la mort de son premier président survenue le 7 décembre 1993 au bout de 33 années de pouvoir, ce pays n'a pas réussi une succession harmonieuse au sommet de l'Etat. Comme conséquence, un coup d'Etat qui s'est mué en rébellion a conduit à la partition du pays et à une impasse politico-militaire à partir de 2002. L'élection présidentielle de 2010, censée ramener la paix, a abouti à une grave crise postélectorale qui a causé trois mille morts. Dans ces circonstances explosives, les partisans de l'esprit d'ubuntu en Côte d'Ivoire auraient dû monter au créneau assez tôt pour fixer les limites à ne pas dépasser, et faire comprendre à tous les camps que "les héros sont ceux qui font la paix et qui construisent, et non ceux qui cassent et détruisent", comme l'avait si opportunément prêché Nelson Mandela lors d'une conférence à Soweto en juillet 2008. Aujourd'hui en 2014, cet esprit d'ubuntu devrait inspirer dans ce pays une authentique réconciliation nationale, c'est-à-dire celle qui n'impose pas aux vaincus la volonté des vainqueurs.
Bien avant la Côte d'Ivoire, l'absence de l'esprit d'ubuntu a eu des effets beaucoup plus dramatiques au Rwanda en 1994. Ce pays enclavé de la région des Grands Lacs, habité par les Hutus (85%) et les Tutsis (14%), a connu cette année-là l'un des plus graves génocides de l'Histoire. La colonisation (allemande puis belge) avait eu tendance à favoriser les Tutsis et à exacerber toutes sortes de clivages, question de diviser les communautés autochtones pour mieux les dominer. A l'indépendance en 1962, les Hutus ont été placés aux commandes, mais leur volonté manifeste de prendre leur revanche contraint les Tutsis à se refugier en Ouganda où ils créent le FPR (le Front Patriotique Rwandais). Le coup d'Etat de 1973 voit l'arrivée au pouvoir du général Juvénal Habyarimana, un Hutu pur et dur qui, face au harcèlement militaire du FPR, ouvre partiellement le pouvoir aux Tutsis à travers le Traité d'Arusha signé en 1993. Mais parallèlement se développe, avec le journal Kangura et la RTLM (la Radiotélévision des Mille Collines) financés par les dignitaires Hutus, une vigoureuse campagne médiatique anti-Tutsi, qui subrepticement prépare les esprits aux massacres à venir. Le 6 avril 1994, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase : l'avion du Président Habyarimana est abattu au-dessus de la capitale ; en quelques heures, tout bascule : les extrémistes Hutus s'emparent du pouvoir, accusent les Tutsis de l'assassinat du président, et sonnent le tocsin du génocide. Pendant les 100 jours qui vont suivre, l'abomination dans la réalité va dépasser l'imagination : les miliciens Hutus traquent et massacrent à l'arme blanche plus de 800 000 Tutsis et leurs sympathisants Hutus. Ailleurs en Afrique, on avait déjà vu des groupes ethniques au pouvoir marginaliser des régions entières (comme le Darfour au Soudan, la Casamance au Sénégal, le Kivu en RDC, certaines parties de la Somalie, etc.), mais c'est au Rwanda que le sommet de la barbarie fut atteint avec cette élimination physique, massive et systématique d'une tribu par une autre pour des raisons de rivalité politique. Heureusement que les choses ont positivement évolué ces dernières années dans ce pays, notamment avec le retour progressif des réfugiés, la nomination d'un président et d'un premier ministre intérimaires Hutus avant les élections législatives et présidentielles de 2003, la suppression de la mention Hutu ou Tutsi dans les documents personnels, de nombreuses réformes institutionnelles, etc.
Avec les cas ivoirien et rwandais, on peut mieux apprécier les effets bénéfiques de l'esprit d'ubuntu en Afrique du Sud. Le jour où tout le monde prendra conscience de son potentiel en tant que moteur et promoteur de la paix, la bataille pour la concorde entre les hommes ou entre les nations aura été presque gagnée.
V - De deux langues blanches à onze langues officielles
Au plan linguistique, l'apartheid a causé autant de dégâts qu'au plan politique. Deux langues étrangères (l'afrikaans et l'anglais) ont été longtemps imposées à tout le pays comme preuve patente de la suprématie blanche. L'afrikaans a été introduit par les colons hollandais dès 1652, tandis que l'anglais est arrivé après la conquête du Cap en 1795 par l'Angleterre. Par ailleurs, plus de 575 Noirs (dont plusieurs dizaines d'enfants) ont été tués en juin 1976 à Soweto lors des émeutes contre un décret rendant obligatoire l'afrikaans dans les écoles noires du pays, au même titre que l'anglais. Tout cela a servi de toile de fond au travail de la Codesa (Convention pour une Afrique du Sud démocratique) mise sur pied en 1991, dont la mission était d'élaborer une nouvelle constitution pour ce pays après l'apartheid. Le réaménagement linguistique du pays figurait parmi ses priorités, car ayant fait partie du problème, les langues devaient aussi faire partie de la solution.
La Codesa a rempli sa mission historique.
Aujourd'hui, le pays compte onze langues officielles dont les deux langues blanches et neuf des langues bantoues de la majorité noire. Chaque province promeut trois de ces onze langues, choisies en fonction de sa configuration démographique. Lorsqu'on fait la somme arithmétique des langues choisies, on constate la domination au plan national des langues blanches, certainement parce qu'elles ont été bien promues pendant les années d'apartheid : l'anglais est choisi par six provinces sur les neuf, l'afrikaans par huit provinces sur les neuf, et l'anglais avec l'afrikaans par cinq provinces sur les neuf. Les langues noires sont elles aussi territorialement réparties : le xhosa et le zoulou sont présents chacun dans trois provinces, le setswana dans deux provinces, le ndébélé, le siswati et le tshivenda dans une province chacun. Mais si on considère leur nombre des locuteurs en tant que langue première, les langues officielles sud-africaines se classent en 2001 de la manière suivante : le zoulou (10,7 millions), le xhosa (7,9 millions), l'afrikaans (6,0 millions), le sotho nord (4,2 millions), le tswana (3,7 millions), anglais (3,7 millions), le sotho sud (3,6 millions), le tsonga (2,0 millions), le swati (1,2 million), le venda (1 million), le ndebele (0,7 million).
Cette politique linguistique sud-africaine vise d'une part la promotion des deux langues blanches pour réconcilier les Blancs avec le reste du pays, tout en ouvrant le pays au reste du monde, et d'autre part de réhabiliter les cultures bantoues qui symbolisent la fierté et la dignité retrouvées de la majorité noire. Une telle approche inclusive et équilibrée est psychologiquement épanouissante pour tout le monde. D'ailleurs dans le système d'enseignement, elle se traduit par une cohérence remarquable ; au niveau du cycle primaire, l'écolier sud-africain est initié à la lecture, à l'écriture, à l'expression orale et à la connaissance de son environnement en sa langue maternelle ; vers la fin du cycle primaire interviennent les sciences, les mathématiques, l'histoire, la géographie et les premières notions de la deuxième langue (anglais ou afrikaans) ; au niveau du secondaire, l'anglais et l'afrikaans remplacent progressivement les langues bantoues comme langues d'enseignement ; enfin à l'université, les cours sont en anglais et en afrikaans, à l'exclusion des autres langues officielles provinciales.
Pour le Cameroun, cette politique linguistique sud-africaine devrait sonner comme un coup de semonce. En effet, alors que depuis 1994 le pays de Nelson Mandela réhabilite ses langues autochtones longtemps dépréciées et interdites par l'apartheid, le Cameroun depuis 1961 a condamné les siennes à la disparition pure et simple en choisissant de les ignorer superbement ; seuls l'anglais et le français sont ici promus de la maternelle à l'université et dans tout l'espace public, malgré les nouvelles dispositions en faveur de la promotion des langues du terroir dans la Constitution de 1996 et dans la Loi du 14 avril 1998 sur l'orientation scolaire. Ainsi après plus d'un demi-siècle d'indépendance, et malgré quelques initiatives privées prises ici et là, les langues autochtones camerounaises se trouvent en état de déréliction avancée. Elles sont ostensiblement délaissées par l'Etat, les élites, les jeunes et même les vieux. Elles sont perçues comme les langues de l'inculture, exactement comme c'était le cas à l'époque coloniale ! Pourtant selon le linguiste français Claude Hagège, "la langue, c'est une certaine manière de concevoir et de dire le monde". En effet, notre première langue conditionne notre premier rapport au monde : c'est par elle que se construisent la personnalité des individus et le sentiment de fierté et de dignité des peuples ; elle joue un rôle déterminant dans la maturation psychoaffective, culturelle et morale du jeune enfant dans son milieu naturel. Le Cameroun ne peut pas parvenir à l'émergence en négligeant un pilier psychoculturel d'une telle importance. Comme l'Afrique du Sud postapartheid, les pays africains devraient osciller entre leur passé et leur avenir dans l'harmonie et sans déchirements. D'où l'urgence des politiques culturelles et linguistiques inclusives, équilibrées et avant-gardistes, qui vont d'ailleurs accélérer leur marche vers l'émergence, en impactant profondément leur développement compris comme un construit collectif et transgénérationnel.
CONCLUSION
Nelson Mandela est une icône dont les leçons - induites de sa trajectoire et de ses victoires - constituent un précieux legs au Cameroun, à l'Afrique et à toute l'humanité. Que ce soit par son opposition radicale à l'oppression raciale qui a été dopée par sa conscience politique éclairée, par son humanisme adossé à l'esprit d'ubuntu qui lui a inspiré un sens élevé du dialogue et de la réconciliation, ou par les réformes majeures effectuées dans le domaine socioculturel pour la convivialité raciale, il a mené un combat, agité des idées, inventé des concepts et inspiré des changements qui ont finalement rendu possible ce qui relevait de l'utopie : son pays s'est débarrassé de la ségrégation raciale pour devenir une puissance économique et une société de fraternité qui, malgré les pesanteurs et les séquelles de ce douloureux passé, avance aujourd'hui à grands pas vers son apogée. Les dirigeants du Cameroun - pays qui projette d'atteindre le point d'émergence en 2035 - devraient dès à présent se laisser transformer par le puissant exemple de Nelson Mandela, de telle sorte qu'on puisse dire demain que ce dernier aura été le précurseur et le catalyseur de notre renaissance. Cela vaut pour tout autre pays du continent. En d'autres termes, la conclusion que nous devrions tirer de son parcours et des mutations survenues dans son pays est évidente par elle-même : quelles que soient la nature et la stature des défis à relever sur le chemin de notre émergence, tout reste à notre portée et a priori rien n'est impossible, pourvu que nous nous donnions à temps tous les moyens matériels, humains et spirituels indispensables.
Faiblesses et promesses du double scrutin du 30 septembre 2013 au Cameroun
I-ENCORE ET TOUJOURS DES INSUFFISANCES
Depuis le retour au multipartisme au début des années 90, plusieurs failles régulièrement dénoncées minent le processus électoral camerounais. Elles sont imputables à l'inadéquation des textes réglementaires, à l'incompétence ou même à la mauvaise foi de certains acteurs ou intervenants. Parmi ces faiblesses, les plus récurrentes sont les conditions inégalitaires de participation des candidats, un découpage biaisé des circonscriptions électorales (par exemple plus de sièges de députés dans les zones favorables au pouvoir et moins dans les zones favorables aux opposants), la partialité des organes d'arbitrage, l'achat des consciences, l'implication active des fonctionnaires de l'Etat dans le parti au pouvoir, les fraudes massives, les menaces et les intimidations des opposants, les votes multiples, la distribution sélective des cartes d'électeurs et même les inscriptions filtrées sur les listes électorales. Lors du double scrutin du 30 septembre 2013, malgré l'introduction de la biométrie, on a remarqué que certaines de ces tares avaient décidément la peau dure. Au total, des efforts ont été réalisés certes, mais il reste encore du chemin à parcourir, notamment concernant les quatre faiblesses structurelles ci-après, dont les effets sont les plus pernicieux sur le processus électoral :
a) Une faible participation populaire
D'abord un coup d'il dans d'autres pays africains : selon l'encyclopédie en ligne Wikipédia, le pourcentage d'électeurs inscrits au Rwanda par rapport à la population totale est d'environ 58,03% (6.5 millions d'électeurs sur 11,2 millions d'habitants aux législatives de 2013) ; en République Démocratique du Congo (RDC), il est d'environ 48,48 % (32 millions d'électeurs sur 66 millions d'habitants aux législatives de 2012) ; en Guinée-Conakry, il est de 46,36% (5.1 millions d'électeurs sur 11 millions d'habitants) ; au Mali pourtant en guerre civile, il a été de 45,33% (6,9 millions d'électeurs sur 15 millions d'habitants à la présidentielle 2013). En comparaison en 2013 au Cameroun, seulement 5,4 millions d'électeurs sont inscrits au fichier électoral biométrique sur 20 millions d'habitants. Et selon les chiffres officiels, seulement 4,2 millions de Camerounais ont effectivement voté au double scrutin du 30 septembre, soit un pourcentage de 21%. Les non-inscrits ont été donc plus nombreux que les inscrits. En principe les absents ont tort, mais on devrait s'interroger sur ce taux de non-inscription particulièrement élevé. En extrapolant, on peut même dire que les majorités d'aujourd'hui au parlement et dans les communes sont des majorités par défaut, étant donné que la majorité réelle est absente et silencieuse. Même si cette anomalie n'est pas attaquable au plan juridique ou légal, est-il moralement acceptable que seulement 21% des citoyens décident pour l'ensemble de la population ? Un tel niveau de désaffection populaire n'est ni acceptable ni justifiable, car les élections devraient être, ici comme ailleurs, un grand moment de participation civique au renouvellement à la fois des idées, des pratiques et du personnel politique à tous les niveaux, et non la préoccupation d'une minorité d'ailleurs non représentative.
b) La persistance du vote ethnique
Lorsqu'on ne vote qu'en fonction de l'origine ethnique du leader du parti et non selon la pertinence du programme proposé, cela dénote une grave immaturité politique : dans ces conditions et quoiqu'on dise, les élus se sentiront plus redevables à leurs bastions ethniques qu'au reste du pays, avec tout ce que cela comporte comme esprit sectaire ou allégeances inavouables. Au Cameroun, c'est à cause de cette façon de voir et de faire que l'UDC a d'énormes difficultés à s'imposer en dehors du Noun, tout comme l'UNDP en dehors du Grand Nord. Même si le RDPC et le SDF ont des prétentions nationales, leurs meilleurs scores sont toujours obtenus dans leurs'socles granitiques', c'est-à-dire le Centre, le Sud et l'Est pour le premier parti, et le Nord-Ouest pour le second. Le vote ethnique reste donc chez nous la lame de fond et non l'écume des vagues, c'est-à-dire la règle et non l'exception. Pour contourner ce phénomène dans un contexte multiethnique où le sentiment national reste faible, la loi aurait dû explicitement encourager les partis à faire des alliances selon les contingences ou les convergences, afin de promouvoir des solidarités interethniques. En Côte d'Ivoire par exemple, on connaît l'ampleur de la crise postélectorale à laquelle a conduit le vote essentiellement clanique de 2010 ; en Guinée-Conakry à l'élection présidentielle de 2012, les voix des Malinkés étaient acquises à Alpha Condé et celles des Peuls à Cellou Dalein Diallo : ce saucissonnage ethnique de l'électorat voulu par des politiciens du dimanche crispe le vivre-ensemble dans le pays avant et après les élections. L'exaltation de l'ethnie ne saurait constituer un programme politique viable et fiable. En attendant que soit trouvée une autre formule électorale qui tienne compte de leur mode de vie à la fois individuel et communautaire, les Africains devraient avoir la lucidité d'éviter un vote sentimental pouvant conduire à de dangereux débordements ou dérapages.
c) La pauvreté de l'offre programmatique
Dans un pays où presque tous les secteurs sont sinistrés, ne promettre aux électeurs que des écoles, des routes, des ponts, des hôpitaux ou des marchés, c'est louable mais politiquement insuffisant : traiter les symptômes visibles c'est bien, mais soigner radicalement la cause sous-jacente du mal, c'est encore mieux. Pour cela il suffit par exemple de bien décrypter notre système gouvernant actuel pour découvrir qu'il est à l'origine des dysfonctionnements comme la corruption, le tribalisme, l'opacité dans nos systèmes de gestion, le système éducatif qui va à vau-l'eau, les atteintes à la fortune publique, etc. Tout cela est tributaire de notre système gouvernant, qui est lui-même l'une des séquelles toujours vivaces de la Françafrique. Chez nous en effet, celle-ci n'a encouragé que la médiocrité et la vassalité, en étouffant toute volonté d'affranchissement véritable. Il suffit de se rappeler les conditions de notre accession à l'indépendance en 1960, ou la fin tragique de Thomas Sankara au Burkina Faso dans les années 80 pour s'en convaincre. Le Cameroun qui veut émerger en 2035 n'a plus besoin des politiciens folkloriques qui chantent ou dansent lors des meetings, ou qui distribuent à profusion de l'argent ou de la nourriture pour corrompre les électeurs démunis. Au contraire, il nous faut des femmes et des hommes patriotes, compétents et conscients des enjeux, arrivés aux affaires par vocation et non par calcul nombriliste ou machiavélique, pour qui la politique est un lieu de pouvoir pour servir la nation et non pour autre chose. Seuls ceux-là sont capables de proposer des programmes politiques novateurs et mobilisateurs, qui puissent donner à leurs concitoyens de nouvelles raisons de travailler avec ardeur pour placer leur pays dans l'orbite de l'émergence.
d) Des moyens financiers et humains dérisoires
La participation à une élection démocratique devrait obéir aux exigences du marketing moderne, cela va de soi. A travers des études et des enquêtes d'opinion, il faudrait disposer d'une solide connaissance du milieu sociopolitique, des attentes de l'électorat, des bonnes pratiques ayant réussi ailleurs ainsi que de la stratégie des concurrents. Il s'agit d'un minutieux travail d'analyse et de synthèse, permettant à tout candidat sérieux de concocter son programme politique sur la base d'une analyse objective de l'existant, de ses propres atouts et faiblesses, des menaces réelles et des opportunités à saisir, des obstacles et de possibles voies de contournement, sans oublier les éventuels grenouillages ou même les coups bas des autres acteurs. Ne pas procéder ainsi, c'est faire preuve de débilité politique. Loin d'être une génération spontanée, les victoires électorales se préparent avec un sens quasi-militaire de la stratégie, et en mobilisant d'énormes moyens financiers, humains et matériels pour pouvoir s'entourer de l'expertise nécessaire. Mais le 30 septembre 2013, on a vu certains candidats aller aux élections avec pour seules armes le nom et l'effigie du leader de leur parti, tandis que d'autres se contentaient de mettre en exergue leurs remontrances amères ou leurs jérémiades puériles contre leurs adversaires, comme si ces derniers étaient obligés de les accueillir dans la compétition électorale avec des sourires et des fleurs! A leur décharge cependant, notons leur inexpérience handicapante, et surtout la faiblesse des moyens dont ils disposaient. Cela pose en fait le problème du financement adéquat, transparent et légalement encadré des partis politiques en Afrique. Un bon niveau du jeu démocratique avec une bonne qualité des acteurs politiques, cela a bien évidemment un coût, et l'Etat devrait s'en préoccuper tout le temps, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections.
II-UN POTENTIEL D'AMELIORATION POUR L'AVENIR
Les élections du 30 septembre 2013 ont également montré quelques lueurs d'espoir pour l'avenir. Elles se sont généralement déroulées dans la tolérance avec moins d'animosité et plus de convivialité, et les résultats officiels ont été accueillis dans un calme inhabituel qu'il faut saluer ici. Cela prouve au moins que le processus démocratique camerounais n'est pas aussi désespérément verrouillé qu'on le dit souvent, et qu'il dispose d'une assez grande marge de progression encore exploitable. Parmi ces notes d'espoir, on peut mentionner :
a) L'introduction des cartes électorales biométriques
L'introduction de la biométrie a été sans conteste une grande avancée. Parmi les améliorations à mettre à son actif, citons la sécurisation accrue du nouveau fichier électoral, l'impossibilité des votes multiples et donc des charters électoraux, l'élimination des doublons ainsi que sa mise à jour facilitée. Cependant de nombreuses récriminations ont encore été entendues : falsification manuelle des procès-verbaux des résultats, inscription biométrique en amont mais vote manuel en aval, distribution des cartes biométriques par des intermédiaires non prévus par la loi, existence de fausses cartes, etc. Cela signifie que la biométrie n'a finalement été qu'un petit pas dans la bonne direction et que des verrous encore en place devraient absolument sauter avant que l'informatisation complète du processus puisse mettre tous les protagonistes en confiance. Les questions, juste rhétoriques il est vrai, qu'on pourrait se poser ici sont les suivantes : pourquoi le système choisit-il, face à la glaciation politique au Cameroun, de s'améliorer à dose homéopathique même là où la technologie permet de faire des pas de géant en un temps record ? Qui a donc intérêt à retarder les réformes décisives comme l'informatisation réelle et totale du processus électoral ou l'instauration du bulletin de vote unique ?
b) La pression de la société civile et des militants de base des partis
Cette pression a été remarquable au sujet de la biométrie, et sera plus forte dans l'avenir sur Elecam et sur le pouvoir, étant donné tous les espoirs légitimes soulevés par ce début de modernisation auquel les Camerounais ont manifestement pris goût. Autrement dit, cet autre jalon posé dans la construction démocratique du pays va certainement accentuer une soif légitime de perfectionnement du processus. En outre, on a noté des résistances inhabituelles des citoyens face à la volonté de contrôle des appareils : des militants de base se sont ouvertement opposés à la volonté des états-majors d'investir des candidats aux conseils ou aux exécutifs municipaux, sans tenir compte de l'avis de la base. A cet égard, la fronde d'Ateba Eyene du RDPC contre ce genre de pratiques dans sa région natale a surpris les adeptes de la sacro-sainte discipline du parti. Cela est pourtant salutaire en démocratie, et vient rappeler que la souveraineté devrait en tout temps revenir au peuple, et que le jeu démocratique tomberait vite dans la parodie s'il ne tenait pas compte du militantisme des uns et des compétences des autres dans l'attribution des fonctions politiques.
c) La plateforme commune de certains partis d'opposition
A l'occasion de ce double scrutin, quatre partis d'opposition (le CPP, l'AFP, l'UDC et l'UPC) ont mutualisé leurs forces : quand l'un d'eux se présentait dans une localité, les autres l'appuyaient systématiquement. Même si cela n'a pas suffi à ébranler le parti au pouvoir, pour une fois on a vu ces partis d'opposition collaborer étroitement. Les opposants, tout comme les partis de la majorité présidentielle, devraient s'habituer à travailler en synergie pour plus d'efficacité. Le peuple a besoin d'être rassuré que les opposants sont autre chose qu'un assemblage hétéroclite d'individus aigris, vindicatifs, haineux et amers ; les citoyens ont besoin de savoir que les opposants proposent une autre vision ou une gestion différente du pays, et pourraient efficacement collaborer demain au sein d'un gouvernement de coalition, par exemple. Mais malheureusement les opposants camerounais ont jusqu'ici brillé par leur incapacité à regarder dans la même direction, certainement à cause de leurs égos surdimensionnés ou des intrigues de leurs adversaires. Depuis 1990 en effet, on a assisté tour à tour à l'échec de la Coordination des Partis Politiques et Associations (CPPA), de l'Alliance pour la Réconciliation Nationale au Cameroun par la Conférence Nationale Souveraine (SRC-CNS) ainsi que de la Convergence des Forces Démocratiques et Progressistes (CFDP). Récemment encore, on a enregistré la dislocation du Pacte Républicain qui est devenu le Groupe des 7 ou des 5, d'où l'exaspération d'Achille Mbembé qui, en octobre 2011 sur RFI, avait qualifié l'opposition camerounaise d'"imbécile". La plateforme citée plus haut n'est donc qu'un frémissement qui devrait mieux se structurer pour les élections à venir. Rappelons que le socialiste François Mitterrand n'aurait jamais été élu président de France en mai 1981, s'il n'avait pas signé auparavant avec les Communistes le célèbre Programme Commun de la Gauche. Aujourd'hui, François Hollande ne gouverne-t-il pas en France avec les Ecologistes et les Verts ? Donc au-delà des partis politiques classiques qui restent des entités vivantes et identifiables, ce sont généralement des coalitions de partis qui gouvernent sur la base des consensus négociés. La classe politique camerounaise dans son ensemble devrait s'en inspirer.
d) La percée inattendue du Mouvement pour le Renouveau du Cameroun (MRC). Pour sa première participation à une élection, ce parti a pu obtenir des conseillers municipaux dans le Littoral, au Centre et à l'Ouest, et même un siège à l'Assemblée Nationale. C'est une performance remarquable, étant donné l'extrême émiettement de l'électorat de l'opposition au Cameroun. Ce succès n'est pas seulement lié à la personnalité du leader national de ce parti Maurice Kamto, dont les détracteurs ne manquent aucune occasion de rappeler qu'il a flirté avec le pouvoir avant de démissionner du gouvernement en novembre 2011. Mais ces derniers oublient qu'en politique tout comme dans un champ de bataille, ce n'est pas parce qu'une arme a appartenu un temps à l'ennemi qu'on doit refuser de l'utiliser - bien sûr après toutes les vérifications d'usage - contre ce même ennemi si elle vous tombe dans les mains. Autrement dit, si le changement au Cameroun devait nécessairement passer par un ancien ministre du régime, pourquoi devrait-on le récuser d'emblée ? Peut-être qu'avec le temps on comprendra mieux les tenants et les aboutissants de la performance du MRC à cette double élection. Mais d'ores et déjà, ce succès signifie qu'à défaut d'un ange providentiel introuvable, les Camerounais peuvent accepter et suivre un leader politique qui, malgré ses imperfections humaines, est capable d'un minimum d'audace ; il veut aussi dire que l'alternance par les urnes, qui est d'ailleurs la seule option républicaine envisageable, reste possible dans ce pays ; enfin, il prouve que l'apparente désespérance politique ambiante masque en réalité chez les Camerounais une grande soif d'hommes nouveaux qui se démarquent par leur allure, leur posture et leur droiture. Sans extrémisme ni populisme, en pariant sur l'avenir à travers la jeunesse et déterminé à faire la politique autrement, le MRC a visiblement caressé de nombreux Camerounais dans le sens du poil. Il reste à voir comment cet espoir soulevé sera capitalisé par ce parti, et surtout comment seront enrayées les manuvres de neutralisation et de déstabilisation qui seront éventuellement menées à l'encontre ce jeune parti, comme cela s'est vu en d'autres temps et dans d'autres partis politiques prometteurs au Cameroun.
Sans surprise, les élections du 30 septembre 2013 ont consacré et confirmé l'hégémonie du RDPC sur la scène politique camerounaise. Mais bien plus que cela, elles ont été riches en enseignements et en signaux significatifs que les spécialistes continueront pendant longtemps à décrypter. En tout état de cause, si les tares relevées sont corrigées avec une dose de bonne foi, et si les points positifs notés sont amplifiés et consolidés sans entraves et uniquement dans le sens du perfectionnement général du processus, nul doute qu'avec l'informatisation complète et totale des opérations électorales, les Camerounais auront eux aussi droit, dans un proche avenir, à des résultats électoraux fiables dans des délais raisonnables, comme cela se voit ailleurs en Afrique et dans le monde
Le bilinguisme officiel camerounais: un dangereux alibi ou une chance inouïe? Par Sa'ah François GUIMATSIA
[Après plus de 50 ans de cheminement, le bilinguisme officiel camerounais a fait du chemin certes, mais il aurait pu faire des bonds de géant, s'il avait bénéficié d'une promotion plus sincère, plus vigoureuse et plus imaginative. Aujourd'hui son impact réel reste mitigé au sein des populations. Avec la survenue de la mondialisation et la construction urgente des Etats-Unis d'Afrique, il faudrait repenser l'aménagement linguistique dans chaque pays africain en général et au Cameroun en particulier, avec à l'esprit une farouche volonté d'enracinement culturel, une conscience aiguë de n'être qu'un petit morceau de la grande Afrique de demain, et une détermination à prendre toute notre place dans un monde en cours de globalisation. Le multilinguisme, dans ce contexte devient de plus en plus une urgence. L'option bilingue camerounaise, qui est un pas dans la bonne direction, aura une avenir des plus radieux, si l'acteur principal qu'est Etat change son fusil d'épaule, et s'attaque de front à ses incohérences tels que l'oubli des langues autochtones et l'utilisation du bilinguisme pour masquer l'absence d'un véritable biculturalisme paritaire et équilibré.]
INTRODUCTION
En accédant à l'indépendance, beaucoup de pays africains ont choisi la langue de l'ancienne puissance coloniale, pour des raisons de pragmatisme politique. Le Cameroun n'était pas en reste. Il a choisi le bilinguisme français-anglais, par fidélité à son double héritage culturel colonial. Aujourd'hui cependant, lorsqu'on regarde une carte des langues officielles sur le continent, on constate que les choix linguistiques faits à l'indépendance ne sont pas restés figés. Il apparaît clairement qu'en Afrique aujourd'hui, l'adoption ou le maintien dans le temps d'une langue officielle ne dépend pas uniquement de l'histoire coloniale du pays concerné, mais aussi de sa situation géographique, de ses ambitions sous-régionales ou de ses orientations économiques. Dans la mouvance de la mondialisation, la promotion du multilinguisme dans plusieurs pays du monde apparaît en ce 21ème siècle comme une façon de s'adapter au nouveau contexte global.
A titre d'illustration, citons quelques exemples en Afrique.
La Guinée Equatoriale, ancienne colonie espagnole du Golfe de Guinée, a érigé le français comme sa deuxième langue officielle après l'espagnol, ce qui a énormément facilité son intégration économique dans la CEMAC et son adhésion à la Francophonie. Le Ghana, pays anglophone entouré de plusieurs pays francophones en Afrique de l'Ouest, est devenu membre observateur de la Francophonie et accorde désormais à la langue française une place très importante dans son système éducatif. Le Nigeria a procédé à la même analyse et fait la même chose que le Ghana, conscient du fait que son statut de puissance économique et démographique sous-régionale passe par la maîtrise de la langue française par ses citoyens candidats à une carrière internationale dans une Afrique de l'Ouest majoritairement francophone. Parallèlement, le Rwanda vient d'adopter avec enthousiasme l'anglais comme troisième langue officielle (en plus du français et du kenyarwanda), en lui donnant même une place prépondérante dans son système éducatif, suite à une brouille diplomatique avec la France. Le Mozambique - pays lusophone de l'Afrique de l'Est - est devenu membre du Commonwealth et a fait de l'anglais l'une de ses langues majeures, justement parce qu'il se trouve au cur d'une région où domine la langue de Shakespeare. De même le Gabon, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo et plusieurs autres pays francophones du continent, sans pourtant devenir officiellement bilingues, ont compris que l'anglais est une langue planétaire absolument incontournable. En somme, on peut affirmer qu'un puissant vent d'anglophilie est actuellement en train de souffler dans tous les pays non anglophones dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. L'option bilingue du Cameroun se trouve donc, 50 ans après, amplement confirmée et justifiée par l'Histoire. Le défi que le pays devrait relever maintenant, c'est de passer rapidement du bilinguisme virtuel des textes au bilinguisme réellement vécu et pratiqué par les citoyens, confirmant ainsi son statut de modèle linguistique pour le reste du continent.
Nous nous proposons dans cette contribution de faire en quatre temps un état des lieux du bilinguisme camerounais aujourd'hui. Après une rapide évocation de l'envers du décor pour nous pencher sur certaines insuffisances ou faiblesses de cette option linguistique camerounaise, nous essayerons, à travers une typologie des divers candidats au bilinguisme, d'en comprendre les enjeux actuels et futurs, puis nous décrypterons les nouvelles raisons qui rendent ce bilinguisme aujourd'hui encore plus impératif qu'hier, et enfin, par pragmatisme et sur la base de notre expérience de formateur bilingue, nous indiquerons comment un adulte pourrait s'y prendre concrètement pour vite maîtriser la langue étrangère de son choix.
I - LE BILINGUISME OFFICIEL, UN DANGEREUX ALIBI ?
Dans la Constitution de 1961, "le français et l'anglais sont les langues officielles de la République fédérale du Cameroun ". Celle de 1996 va plus loin en stipulant que "les langues officielles de la République du Cameroun sont le français et l'anglais, les deux langues étant d'égale valeur. L'Etat garantira la promotion du bilinguisme dans le pays et s'efforcera de promouvoir et de protéger les langues nationales". Mais par rapport à cette disposition constitutionnelle, sur le terrain, la politique du bilinguisme officiel, depuis 50 ans, connaît un succès mitigé. Non seulement la loi du nombre donne une prééminence certaine au français en consacrant une espèce de marginalisation de l'anglais, mais surtout le bilinguisme officiel sert d'alibi à trois défaillances imputables à l'Etat au Cameroun.
I - 1 La mort programmée des langues autochtones ?
En concentrant tous ses efforts sur la promotion du bilinguisme français-anglais, l'Etat a malheureusement oublié les langues autochtones. Aucun programme officiel de promotion pour ces langues n'a été mis sur pied. Des initiatives privées sont signalées ici ou là, mais grosso modo, ces langues demeurent ostensiblement les parents pauvres dans l'aménagement linguistique officiel du pays. Cela est symptomatique du sort réservé par les décideurs aux cultures et aux langues locales. Tout se passe comme si le Cameroun n'aurait besoin que des langues et des cultures étrangères pour son émergence promise pour l'année 2035. Pourtant tout le monde sait que la bataille culturelle est en fait la seule que l'Afrique peut et doit gagner. Une politique culturelle intégrale, à la fois africaniste et ouverte (à la fois verticale et horizontale), aurait dû amener les décideurs d'ici à promouvoir certaines langues locales pour des besoins d'identité culturelle et de fierté pour les Camerounais, étant entendu que ceux-ci ne devraient pas se présenter au rendez-vous "du donner et du recevoir" en quémandeurs complexés, mais en contributeurs éclairés à la culture universelle.
On connaît sur le continent des exemples de promotion stratégique des langues autochtones pour les raisons évoquées plus haut. Le cas du Nigeria est édifiant à cet égard : bien qu'étant un pays anglophone et membre du Commonwealth, depuis son accession à l'indépendance en 1960, ce pays a développé trois langues dites majeures qui y sont promues dans les médias et enseignées à l'école : le haussa dans le Nord, l'igbo dans le Sud-Est et le Yorouba dans le Sud-Ouest. Ces langues sont présentes à tous les niveaux du système éducatif, ce qui témoigne du respect des décideurs nigérians pour la culture locale. Le cas de l'Afrique du Sud est également souvent cité : au moment de la fin de l'Apartheid en 1994, ayant constaté les dégâts causés par cet odieux système sur tous les plans et notamment dans le domaine de la culture, ce pays a choisi de promouvoir onze langues officielles d'égale valeur, parmi lesquelles les deux langues coloniales (l'anglais et l'afrikaans) et neuf langues parlées par les communautés noires. Nelson Mandela et son équipe ont ainsi mis sur pied une politique linguistique originale visant à la fois la nécessaire réconciliation entre les diverses communautés du pays et une indispensable ouverture au monde. Malgré toutes les difficultés rencontrées dans la mise en application cette politique, l'objectif est clair et la volonté politique de l'Etat sud-africain est sans équivoque. C'est certainement le temps qui permettra de parfaire le dispositif juridique et de tendre de plus en plus vers l'objectif visé. Revenant au Cameroun, comment peut-on croire que nos décideurs n'aient pas compris, en 50 ans, qu'après avoir demandé et obtenu l'indépendance du pays, c'était de leur part une forfaiture impardonnable que de continuer à prendre, notamment en matière linguistique et culturelle, des décisions manifestement basées sur un mépris souverain des valeurs locales, juste comme au temps de la colonisation ? Le résultat est là aujourd'hui, à la fois désolant et désopilant : tout est culturellement sens dessus dessous, comme si le pays avait choisi de tourner le dos à tout patriotisme en matière culturelle. On peut même affirmer que l'extrême focalisation de l'attention des pouvoirs publics sur les deux langues officielles au détriment des langues du terroir a abouti à une schizophrénie linguistique, qui a visiblement installé l'homme camerounais dans une dangereuse extraversion de sa personnalité. Cela est d'autant plus inquiétant que les jeunes Camerounais d'aujourd'hui ignorent leurs langues autochtones, et se contentent du français ou de l'anglais. Cela ne peut conduire qu'à un déplorable déracinement culturel. Tout se passe comme si les pouvoirs publics camerounais avaient programmé la mort des langues autochtones dans un proche avenir, car si une langue n'est pas parlée par les jeunes générations dans une communauté, elle s'éteint et meurt de sa belle mort. Pourtant, le pays était bien parti pour bâtir un modèle culturel original basé sur un fond africain traditionnel auquel s'ajouteraient les meilleurs apports anglo-saxons et latins, comme le suppose sa double appartenance au Commonwealth et à la Francophonie. Un système bien camerounais qui, sans d'ailleurs se limiter aux emprunts culturels venant des deux anciennes puissances coloniales, resterait ouvert aux influences jugées positives venant des autres peuples du monde.
I - 2 La promotion du bilinguisme au Cameroun : juste le service minimum ?
Combien de Camerounais sont-ils réellement bilingues aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle de bilinguisme officiel ? Très peu en réalité. Au Cameroun en général, chaque citoyen se perçoit avant tout comme un anglophone ou comme un francophone. Le pays est bilingue certes, mais les citoyens ne le sont pas. On entend très souvent ce genre de critiques dans les milieux populaires anglophones. Si l'Etat était vraiment sérieux dans cette option bilingue, pourquoi cette timidité dans la promotion du bilinguisme sur le terrain ? Pourquoi certains textes officiels sont-ils encore publiés uniquement en français ? Pourquoi la majorité des officiels francophones ne s'expriment-ils pas en anglais en situation formelle ? Pourquoi, dans le système éducatif camerounais par exemple, l'Etat s'est-il limité à une juxtaposition dans le pays de deux sous-systèmes (anglophone et francophone) au niveau du primaire et du secondaire, pour ne "tolérer" le bilinguisme que dans l'enseignement supérieur, alors que l'institution de la parité linguistique dès 1961, de la maternelle au supérieur, aurait à ce jour moulé des millions de Camerounais dans le bilinguisme intégral ? Et si pour accéder à certains postes importants dans la vie sociopolitique du pays, un certain niveau de bilinguisme était exigé des postulants, cela indiquerait nettement la voie à suivre. En effet, le message d'une telle mesure de souveraineté serait sans équivoque : chaque citoyen saurait ce qu'ils gagne à être bilingue, ou alors, ce qu'il perd à rester monolingue. En somme, il y avait plus d'un moyen d'action à la disposition des pouvoirs publics pour booster sur le terrain une politique linguistique librement choisie. Au lieu de cela, pendant longtemps on a multiplié les atermoiements comme si la seule inscription du bilinguisme dans la Constitution suffisait à le rendre désirable. Pis encore, entre 1961 et les années 90, le pays s'est paradoxalement tenu à bonne distance de la Francophonie et du Commonwealth, pour cause de bilinguisme. Quel gâchis! Si l'Etat avait mis dans l'implémentation du bilinguisme tant vanté tous les moyens nécessaires, la proportion des Camerounais bilingues serait beaucoup plus significative aujourd'hui.
I-3 La marginalisation culturelle des anglophones ?
Certains intellectuels anglophones trouvent que derrière le paravent du bilinguisme, se cache en réalité le refus de l'Etat de voir les anglophones exercer une influence culturelle significative dans le pays. Les partisans de cette thèse se demandent pourquoi, dans l'oeuvre de construction de la jeune nation camerounaise, l'Etat refuse obstinément une application stricte et comptabilisable du biculturalisme, c'est-à-dire une association intelligente et systématique des éléments culturels anglais et français, ce qui aurait certainement fait la force et l'originalité du Cameroun réunifié. Selon Christian Cardinal Tumi par exemple, la réalité est d'ailleurs plus grave qu'on ne croit. Il affirme en effet que les anglophones, même lorsqu'ils sont nommés à des postes élevés dans l'administration pour des raisons d'intégration nationale, ils disposent en réalité de peu de marge de manuvre, et ne peuvent donc pas impacter (culturellement entre autres) sur le système. Il écrit à cet égard : "Les ennuis quotidiens du Premier Ministre anglophone sur certains dossiers, le manque de respect répété, chronique et ouvert dont il est l'objet de la part de certains membres du gouvernement, aggravent une situation déjà fort embarrassante". D'ailleurs, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1964, Bernard Fonlon, un autre intellectuel anglophone bien connu, déplorait ce même état de fait : "Après la Réunification, on conduit sa voiture maintenant à droite, le franc a remplacé la livre comment monnaie courante, l'année scolaire a été alignée sur celle des francophones, le système métrique a remplacé les mesures britanniques, mais en vain ai-je cherché une seule institution ramenée du Cameroun anglophone. L'influence culturelle des anglophones reste pratiquement nulle". En effet, la majorité doit pouvoir aménager une petite place pour la minorité, dans un esprit d'inclusion et de responsabilité partagée. Ce n'est pas parce que la communauté anglophone est minoritaire démographiquement, territorialement et économiquement qu'elle devrait être culturellement étouffée ou assimilée par la majorité francophone. Certaines attitudes ou faits objectifs confirment cette impression au quotidien, et cela aboutit inéluctablement à ce sentiment largement partagé par les anglophones d'être culturellement muselés, comprimés, marginalisés et finalement trompés au change, malgré tout le ramdam fait autour de la promotion officielle du bilinguisme. On dirait que le bilinguisme sert d'alibi pour ne pas tenir compte de l'héritage culturel anglo-saxon dans l'édification du pays.
Après ces restrictions formulées sous la forme d'une évocation des "dégâts collatéraux" de la politique du bilinguisme officiel du Cameroun, il convient à présent de considérer, tout aussi objectivement, les acquis positifs d'une politique linguistique considérée par l'immense majorité des Camerounais comme une chance inestimable tant pour les individus que pour le pays, car on en découvre chaque jour de nouvelles vertus, notamment à l'ère de la mondialisation. Un succès et un attrait qui justifient d'ailleurs l'engouement de plus en plus marqué des citoyens à devenir bilingues ces dernières années, ou à s'assurer que les jeunes générations le deviennent.
II - LE BILINGUISME DE PLUS EN PLUS PRISE
Le Programme de Formation Linguistique Bilingue (PFLB), à travers son réseau de centres linguistiques régionaux, a déjà formé depuis 1989 des milliers de citoyens bilingues, et d'autres centres linguistiques privés se créent chaque jour dans le pays, notamment à Douala et à Yaoundé. La formation bilingue est donc devenue au Cameroun un créneau porteur, notamment du côté francophone. Les candidats à cette formation, de plus en plus nombreux, se recrutent dans toutes les catégories sociales. Du côté anglophone cependant, l'engouement semble nettement moins marqué (une frilosité habituelle des groupes minoritaires), toutefois la nécessité d'être bilingue est globalement acceptée dans les deux communautés linguistiques du pays, peut-être pas toujours pour les mêmes raisons. Une petite enquête effectuée entre 2005 et 2010 auprès d'une centaine d'apprenants au Centre Linguistique de Douala nous a permis de dresser une typologie sommaire des candidats actuels au bilinguisme (francophones et anglophones), ainsi que de leurs véritables motivations profondes, afin de pouvoir noter, s'il y a lieu, des changements de paradigme à travers le temps. Sur qui s'exerce donc la pression du bilinguisme aujourd'hui ? Et pourquoi ? L'étude susmentionnée nous a permis de dégager six groupes bien identifiables de candidats :
Les étudiants et les chercheurs d'emploi. C'est le groupe sociologique le plus nombreux. Généralement âgés entre 20 et 25 ans, ils sont conscients des difficultés rencontrées par leurs aînés ou parents monolingues dans un passé, et ne souhaiteraient pas se retrouver pris dans le même piège sur le marché de l'emploi. On en trouve beaucoup qui ont même déjà raté une ou deux opportunités d'emploi, justement pour cause de déficit en matière de bilinguisme. Par conséquent, c'est avec un réel engouement qu'ils s'adonnent à un apprentissage plus fonctionnel et moins scolaire de leur deuxième langue officielle. Bien plus, comme ils sont généralement jeunes et sensibles aux oripeaux de l'émigration vers l'Occident, ils souhaitent pouvoir y séjourner soit pour poursuivre leurs études, soit à la recherche d'un emploi. Ces dernières années au Cameroun en effet, le désir d'émigration vers l'Europe ou vers les Etats-unis est resté très fort au sein de ce groupe qui, malgré la médiatisation extrême des misères et des déboires des sans-papiers en Occident, n'a toujours pas renoncé à son désir d'y aller tenter sa chance. Dans ces conditions et au vu des difficultés économiques du pays, devenir bilingue leur apparaît comme une planche de salut, car cela constitue pour eux la meilleure façon de se préparer à cette émigration synonyme de salut.
Les employés et les cadres des grandes entreprises. Le désir du bilinguisme est ici lié à leur volonté de conserver leurs emplois ou d'être promus à des postes de responsabilité au sein de leurs entreprises. En effet, ils sont souvent mutés dans d'autres localités dans le pays, et doivent pouvoir travailler partout, que ce soit en zone anglophone ou en zone francophone, avec un même degré de compétence linguistique. Ils prennent donc leur formation bilingue au sérieux, et s'y engagent avec détermination.
Les opérateurs économiques. Ceux-ci sont des patrons et sont encore plus déterminés que leurs employés ou cadres, étant donné la nature de leur activité essentiellement tournée vers l'étranger. Par e-mail ou par téléphone, ils ont des contacts d'affaires réguliers et suivis avec des partenaires installés aux quatre coins du monde, notamment dans les pays tels que Dubai, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les Etats-Unis ou l'Union Européenne. Qu'ils soient francophones ou anglophones, ils connaissent la valeur inestimable du multilinguisme dans ce genre d'activités. Ils sont conscients que, pour des raisons de stricte confidentialité, il vaut mieux se passer des services d'un interprète. Et comme il s'agit en général d'affaires à négocier avec précision et dans l'urgence, il leur faut absolument parler la langue de leurs partenaires étrangers, qui supposent d'ailleurs toujours que tous les Camerounais est parfaitement bilingues. Les patrons camerounais sont conscients qu'ils devraient éviter de s'exprimer en une langue imparfaite pouvant conduire à de graves malentendus dans la communication. Ce groupe d'apprenants a toujours des objectifs et des besoins linguistiques très précis, et fait montre d'une inébranlable volonté de maîtriser aussi rapidement que possible le vocabulaire en usage dans leur secteur d'activité.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat. La fonction publique étant nationale au Cameroun, les employés de l'Etat ressentent de plus en plus la pression d'être bilingues. A travers le jeu des affectations, des mutations et des promotions, tout fonctionnaire ou agent de l'Etat peut en effet être appelé à travailler n'importe où dans le pays. Bien plus, comme les agents de l'Etat sont au service du public camerounais composé d'anglophones et de francophones, ils devraient normalement être en mesure servir les usagers dans les deux langues, quelle que soit la localité où ils exercent. D'ailleurs si les représentants et porte-parole de l'Etat que sont les fonctionnaires ne parlaient pas eux-mêmes les deux langues officielles du pays, cela serait perçu comme un sérieux coup de massue asséné à la politique du bilinguisme officiel prôné par l'Etat.
Les leaders d'opinion, les personnalités publiques, les artistes et les élites. Ceux-ci ressentent eux aussi la nécessité absolue d'être bilingues dans le contexte camerounais, pour bénéficier d'une plus large audience. Leur statut spécial leur impose en effet de s'adresser à la totalité du public national ou international, notamment quand ils sont sollicités par les médias. Lorsque ceux qui ont des messages à transmettre au public s'expriment en français et en anglais, ils sont perçus par le public comme des rassembleurs, ce qui est très positif pour leur image au Cameroun.
Les chercheurs et les internautes. Au Cameroun comme partout ailleurs, l'Internet offre des possibilités inouïes aux chercheurs et aux internautes en général. Ces derniers connaissent la valeur inestimable du multilinguisme dans leur recherche d'informations conservées dans le système. Comme la toile est mondiale, bien entendu le multilinguisme y règne en maître absolu, avec comme toujours l'anglais faisant la course en tête par rapport aux autres langues. Les internautes multilingues ont donc un avantage indéniable sur leurs homologues monolingues par rapport à leur capacité à tirer le meilleur parti de ce merveilleux système de stockage d'informations.
En somme, le bilinguisme camerounais est en train d'atteindre sa vitesse de croisière au niveau du grand public. Il a cessé d'être la préoccupation d'une minorité d'intellectuels. Comme le montre bien la typologie présentée ci-dessus, il est considéré comme un avantage comparatif réel pour tout le monde. D'ailleurs ne dit-on pas que l'illettré de demain sera celui ou celle qui ne pourra pas changer de code linguistique au moment opportun ? Le phénomène ira certainement en s'amplifiant, d'autant plus que de nouvelles raisons, encore plus pressantes à l'ère de la globalisation des échanges, sont venues rendre encore plus impérieuse la nécessité pour tous les Camerounais d'être bilingues aujourd'hui. Quelles sont donc ces nouvelles raisons en faveur d'un bilinguisme encore plus renforcé?
III - POUR UNE CAUSE ANCIENNE, DE NOUVEAUX ARGUMENTS
On peut dire que les raisons en faveur du bilinguisme étaient nationales en 1961, et qu'aujourd'hui sont évoquées de nouvelles raisons plus continentales et globales. Le même produit s'avère consommable pour des raisons à la fois locales et globales, d'où la satisfaction de faire d'une pierre deux coups. Le résultat, c'est que les nouvelles raisons justificatives du bilinguisme anglais-français rendent cette option linguistique encore plus impérative.
En voici quelques-unes :
Les effets positifs des actions cumulées de l'Etat depuis 1961. En faisant du bilinguisme officiel la base de sa politique d'intégration nationale, le gouvernement a progressivement amené les populations de tous bords à accepter cette option linguistique. En dehors de certains extrémistes anglophones qui estiment que leurs enfants n'ont pas accès à certains établissements d'enseignement supérieur de prestige à cause de la barrière linguistique, aucune opposition politique sérieuse à cette option linguistique ne s'est exprimée. Elle est l'un des rares sujets de politique nationale où il existe un véritable consensus qui transcende les divisions partisanes au sein de la classe politique. Peu à peu le scepticisme que certains avaient au départ a fini par faire place à une adhésion presque enthousiaste, notamment avec les effets et les exigences de la mondialisation. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment les établissements scolaires privés ou publics du sous-système anglophone sont pris d'assaut à Douala et à Yaoundé par des enfants venant des familles francophones. Il y a donc, quoi qu'on puisse penser par ailleurs des insuffisances et des faiblesses du système, une réelle adhésion des familles francophones à l'anglais. Si à cela on ajoute la présence plus que symbolique du bilinguisme dans l'affichage publicitaire et dans les médias, on se rend compte que de réels progrès ont été réalisés depuis la Réunification. Certes s'il reste encore beaucoup à faire pour son enracinement, mais il est rassurant de constater que le contexte sociopolitique est devenu plus propice à son épanouissement, et il suffit de consolider ces acquis avec des attitudes et des actions appropriées. Après bien des atermoiements et avec une évolution significative des mentalités, on peut dire que les obstacles sont maintenant levés, et que de plus en plus de Camerounais vont s'ouvrir aux vertus du bilinguisme, avant de s'en approprier définitivement.
Le nouveau contexte africain d'aujourd'hui. Avec ses 54 pays indépendants, l'Afrique est l'une des régions les plus balkanisées du monde. Avec tant de pays souverains, une vingtaine de politiques économiques ainsi qu'autant de monnaies et de politiques étrangères, ce continent n'a aucune conscience de son unité et ne pèse pas d'un grand poids face aux autres régions du monde. Pour cela, son décollage économique risque d'attendre encore bien longtemps. Au plan linguistique, on constate que le français et l'anglais sont les langues officielles de près de 83 % de ces 54 pays africains. Comme le recommandent tous les travaux des chercheurs et tous intellectuels bien pensants, les Africains devraient absolument travailler à l'émergence, le plus tôt possible, des Etats-Unis d'Afrique, si ce continent souhaite peser d'un poids significatif et prendre toute sa place dans la mondialisation en cours des échanges. Cette nouvelle fédération ou confédération africaine à mettre sur pied sera multilingue bien entendu, avec l'anglais et le français statistiquement jouant les premiers rôles. Nous ne sommes pas du tout là en politique fiction. Les Camerounais devenus bilingues, dans ce nouveau contexte, seront comme un poisson dans l'eau. Alors, ils seront reconnaissants aux pères fondateurs d'avoir eu en 1961 la sagesse d'engager leur pays dans une option linguistique d'avenir, plus de 50 ans avant les autres pays du continent. Si les Camerounais de maintenant en sont conscients, cela dopera à coup sûr leur engagement individuel et national au bilinguisme, qui n'est en réalité que le premier pas vers le multilinguisme africain de demain, comme nous l'avons déjà démontré dans l'un de nos livres.
Les nouvelles perspectives offertes par la zone CEMAC. La CEMAC est une zone économique intégrée qui est en cours de construction en Afrique Centrale. La langue dominante de cet espace est le français, et le Cameroun en est la locomotive économique. Les anglophones camerounais ont là une raison supplémentaire de devenir bilingues, s'ils veulent prendre pied dans la CEMAC à armes égales avec d'autres acteurs économiques de la zone, sans se sentir linguistiquement défavorisés.
III - DEVENIR BILINGUE AUJOURD'HUI : COMMENT ?
Comment répondre à la pression du bilinguisme si on est déjà adulte ? Telle est notre dernière préoccupation dans cette étude. En d'autres termes, que pouvons-nous recommander aux adultes qui, face à tous ces nouveaux défis linguistiques à relever pour s'arrimer à une mondialisation qui nous envahit de toutes parts, s'engagent à devenir bilingues en apprenant une deuxième langue étrangère ? Nous savons que les échecs dans ce domaine sont nombreux, surtout chez l'adulte dont le cerveau a déjà perdu beaucoup de sa plasticité cognitive, c'est-à-dire de sa capacité d'assimilation de nouvelles connaissances. Grâce à notre expérience de formateur bilingue, nous reprenons ici notre recette déjà proposée aux adultes qui veulent maîtriser rapidement une deuxième langue. Il s'agit d'une série de six facteurs-clés que nous avons déjà eu l'occasion d'expérimenter à maintes reprises avec nos apprenants adultes. Judicieusement utilisées, ces six clés faciliteront à coup sûr l'apprentissage de la langue cible. Nous les présentons brièvement ici, regroupées sous l'acronyme MOTEUR, pour le plaisir des yeux.
Pour maîtriser assez rapidement une nouvelle langue, tout apprenant adulte devrait donc savoir mettre ensemble et faire fonctionner pour lui-même les pièces suivantes de notre moteur :
M comme MOTIVATION. Elle constitue le stimulus qui pousse tout être humain à agir ; c'est la raison d'être profonde de nos actions. Plus elle sera forte chez l'apprenant des langues, mieux sera son engagement personnel et plus facile sera son progrès. La décision de d'acquérir une nouvelle langue devrait être déclenchée par un bon stimulus individuel, comme par exemple le plaisir d'acquérir un nouvel outil de communication internationale, une grande détermination à connaître une langue socialement prestigieuse, l'aspiration légitime à accéder à un emploi mieux rémunéré, etc. Dans tout les cas, il ne faut jamais perdre de vue le fait que l'utilité, plus que toute autre considération, est la motivation la plus fondamentale de l'homme en général. Aucun apprenant ne maîtrisera une langue absolument inutile pour lui. La motivation, bien circonscrite et bien comprise par l'apprenant, va littéralement le doper en libérant tout son potentiel cognitif, et nul doute qu'il apprendra avec plus d'entrain et de plaisir.
O comme ORIENTATION. Il s'agit ici d'une orientation plutôt spirituelle. Nous sommes en effet une juxtaposition d'un corps et d'un esprit, et personne ne sait avec exactitude comment ces deux composantes apparemment opposées interagissent pour faire de nous ce que nous sommes. Pour plus d'équilibre de notre personnalité profonde, il semble tout à fait logique de chercher à satisfaire autant nos besoins spirituels que nos besoins matériels. Pour l'apprenant des langues, en ajoutant une dimension spirituelle à son projet, il va certainement mettre à contribution toutes ses ressources spirituelles, c'est-à-dire tout son "moi" moral. Par exemple, il pourrait se convaincre que par le truchement de la maîtrise de la langue cible, il ajoute sa petite pierre au dialogue des cultures ainsi qu'à la compréhension entre les individus, les communautés et même les peuples. Cela peut sembler éthéré mais c'est ainsi que sont mobilisées nos ressources spirituelles. Une telle vision de la langue cible donnera à celle-ci les attributs d'un précieux outil au service de la paix, de la concorde, de la tolérance et de l'ouverture aux autres. Pour l'apprenant adulte, une telle conception va sans aucun doute conférer à son projet d'apprentissage linguistique une dimension moins individualiste et plus social (au sens africain du terme), c'est-à-dire moins personnelle et plus relationnelle.
T comme TRAVAIL REGULIER. L'apprenant en langues doit en effet se préparer à transpirer : toujours 1% d'inspiration contre 99% de transpiration, comme a dit un sage. L'acquisition linguistique chez l'adulte est un processus laborieux et graduel, qui est à la fois cognitif et comportemental. En gros, il est organisé méthodiquement autour de la maîtrise des quatre compétences linguistiques de base que sont la lecture, l'écriture, l'écoute et la prise de parole. Il y a donc un nombre impressionnant d'éléments syntactiques à apprendre et à assimiler d'une part (compétence grammaticale), et d'autre part l'agencement correct de ces éléments pour construire une communication écrite ou verbale avec autrui (compétence communicationnelle). Ici donc, l'input s'évalue par rapport à l'output. Le travail pour l'apprenant en langue, c'est aussi l'entraînement systématique à l'emploi délibéré de la langue cible comme moyen de consolidation ou d'expérimentation des acquis, ce qui a l'avantage de donner à ses organes acoustiques et phonatoires - l'oreille et la bouche notamment - le temps de s'ajuster naturellement au nouveau code.
E comme ENCADREMENT DE QUALITE. Les formateurs linguistiques ont en effet un rôle primordial à jouer dans le processus d'apprentissage. Pour vite maîtriser la langue cible, l'apprenant doit absolument être suivi et encadré par des professionnels bien formés, qui savent utiliser la panoplie d'adjuvants modernes que propose l'ingénierie de la didactique des langues. Les encadreurs devraient être moralement et techniquement compétents. Au Cameroun plus particulièrement, ils devraient savoir qu'ils ont le privilège de contribuer à la démolition de la cloison linguistique entre les deux communautés de leur pays tout en préparant en même temps les nouveaux citoyens du monde. Par conséquent, ils devraient prendre leur rôle au sérieux. Auprès des apprenants, ils sauront jouer différents rôles à divers moments : ils seront tour à tour pour eux les modèles, les partenaires, les conseillers, les guides, les experts dans l'utilisation du matériel didactique, les stimulateurs, les inspirateurs et surtout, les facilitateurs éclairés et passionnés d'apprentissage.
U comme UNIVERSALISME Nous entendons par ce mot ici, la mise à contribution de toutes les données scientifiques en matière d'acquisition linguistique - les méthodes et les principes expérimentés ayant fait leurs preuves ailleurs dans le monde - tout en tournant le dos à la croyance à l'irrationnel qui a fait plus de mal que de bien en Afrique. Le retard de notre continent dans bien des domaines est certainement dû à notre tendance à nous soumettre au diktat du surnaturel et de l'irrationnel. L'apprenant des langues doit se convaincre que le succès véritable et durable appartient à tous ceux qui s'organisent intelligemment et travaillent méthodiquement. Il s'agit de savoir rationaliser ses efforts, en évitant des inhibitions farfelues ou contreproductives. Suivre les conseils et assimiler les enseignements donnés par des encadreurs compétents constituent, pour l'apprenant, la seule voie du succès.
R comme RESILIENCE C'est la capacité de rebondir après un choc, et de faire montre de ténacité, sans se laisser décourager par les difficultés. Avec l'apprenant des langues, des obstacles ne manquent pas. Ils peuvent être liés à des facteurs extralinguistiques, à son propre ego surdimensionné qui manque d'humilité pour apprendre, aux conditions insatisfaisantes d'apprentissage, à des encadreurs incompétents ou difficultueux, aux différences trop marquées entre la langue d'arrivée et la langue de départ, aux éléments linguistiques (tels que le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe) qui normalement se complexifient après les niveaux débutant et élémentaire, etc. Pour que l'enthousiasme de l'apprenant ne s'estompe pas à cause des facteurs démobilisateurs de ce genre, il lui faut s'armer d'une bonne dose de résilience.
Voilà brièvement présentés les six facteurs favorables que nous recommandons à tout apprenant adulte confronté au défi d'apprendre une nouvelle langue. On pourrait d'ailleurs les résumer de la manière suivante : en matière d'acquisition linguistique par l'adulte, les progrès sont fulgurants si l'apprenant s'astreint à des efforts méthodiques, réguliers, positivés par l'esprit et bien encadrés par des formateurs compétents.
CONCLUSION
A la fin de notre analyse, le bilinguisme officiel camerounais est sans conteste une chance inouïe pour le pays et pour les citoyens. Les autres pays africains nous envient d'avoir choisi comme langues officielles deux des langues les plus belles et les plus parlées dans le monde. Mais comme toute uvre humaine, cette option linguistique reste perfectible, notamment dans sa élaboration conceptuelle et dans son implémentation. Pour qu'il ne soit plus perçu par certains comme une ruse pour masquer le rejet du biculturalisme, il convient de le délester de toutes ses insuffisances et incohérences, sans oublier de corriger les dégâts collatéraux relevés sur le terrain, afin de doter notre pays d'une nouvelle architecture linguistique plus cohérente et plus visionnaire. L'objectif final étant de construire un multilinguisme stratégique (français, anglais, langues autochtones et autres langues) pliable et adaptable selon nos intérêts, et capable de transformer le Camerounais en un citoyen fier de son identité culturelle, et linguistiquement à l'aise en Afrique et dans le monde. D'où la nécessité, dans ce contexte de reconfiguration linguistique, d'un bilinguisme individuel de grande qualité, puisé à bonne source auprès des encadreurs de la bonne étoffe. Comme pour tout produit en forte demande, le bilinguisme peut lui aussi tomber entre les mains de mystificateurs et de charlatans véreux, à l'instar de ceux qui ont investi les domaines de la foi et de la médecine chez nous.
Notes :
REFERENCES
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
Christian Cardinal Tumi : Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf. Editions Veritas, Douala, page 35
Bernard Fonlon, Construire ou Détruire, Abbia, Yaoundé, 1964, page 37
Le PFLB est un organisme de promotion du bilinguisme placé sous la tutelle de la Présidence de la République. Il fait un travail remarquable dans neuf des dix régions du pays.
Il s'agit de Cinquante ans de bilinguisme au Cameroun. Quelles perspectives en Afrique ? Editions l'Harmattan, Paris, 2010
Dans Cinquante ans de bilinguisme au Cameroun. Quelles perspectives en Afrique ? Opp. Cité page 124