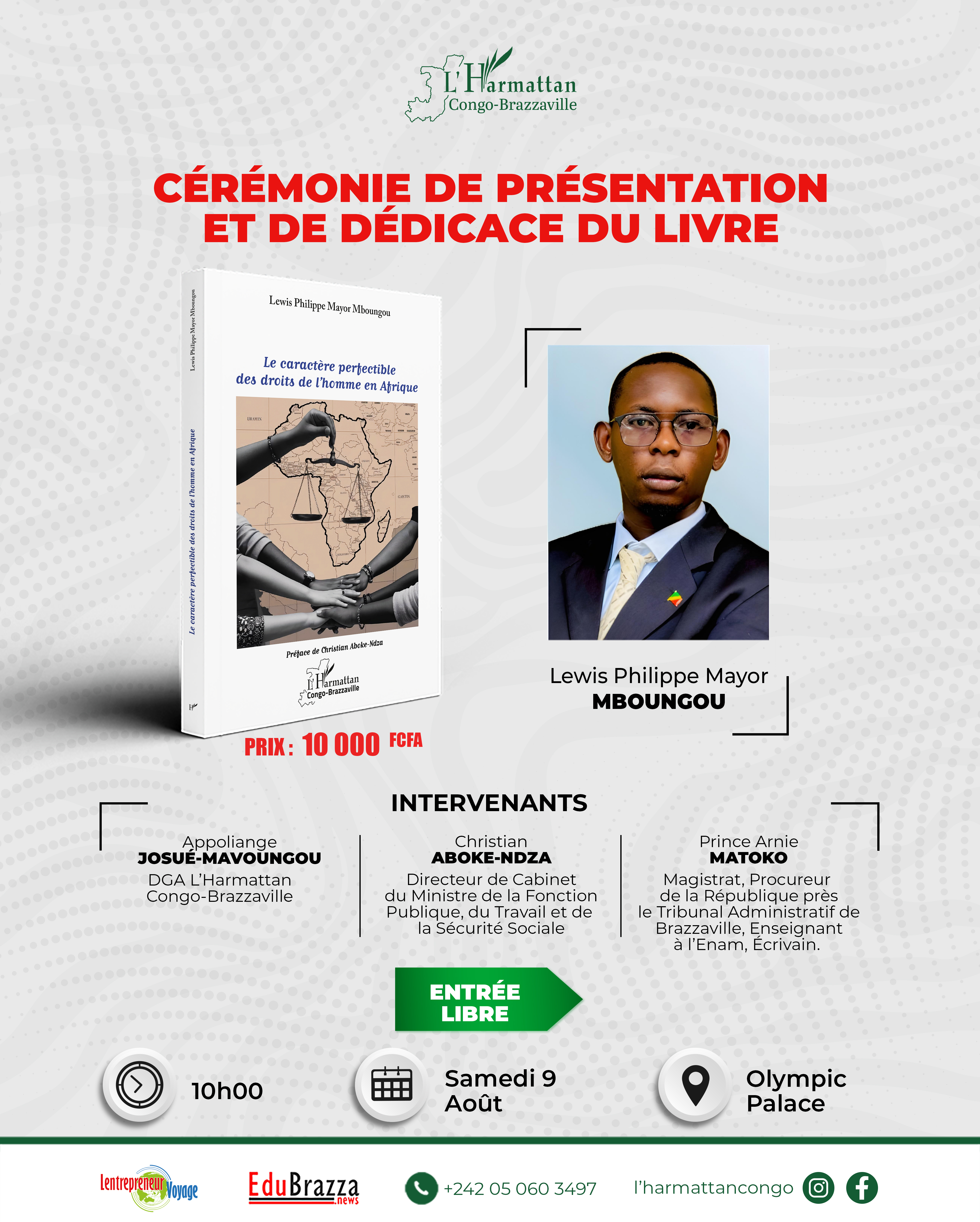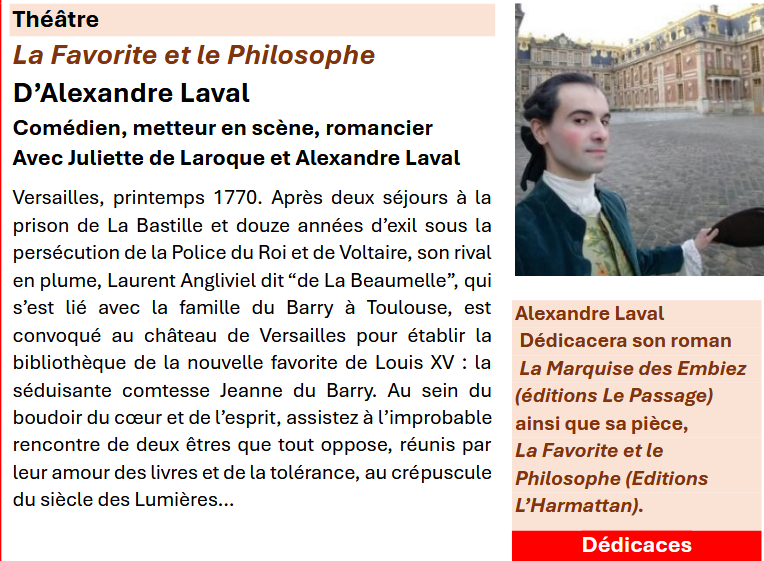Albert Le Dorze
ContacterAlbert Le Dorze
Descriptif auteur
Plongé dans la clinique psychiatrique depuis quelques décennies, nous constatons que nous n'avons pas de thèse à défendre, d'École à promouvoir. Mais faut-il pour autant se priver du texte ?
Des idées sans doute, des pensées peut-être ou de simples petites pierres qui s'agglutinent à un socle qui serait le plus Petit Dénominateur Commun du psychiatre '?
Vagabonder, musarder... Entre la fonction psychothérapique du psychiatre, les manoeuvres de la séduction, les chemins escarpés de la pédagogie, les risques de la dépendance et le Mal barbare à prévenir qui fait grimacer l'Art et la culture.
Il faudrait, pour certains, fondre la psyché dans la biologie, confondre aliénation sociale et mentale. Assertions lapidaires aussi spécieuses que réductrices qui contribuent toutes à la destruction de la psychiatrie.
Albert LE DORZE est médecin-psychiatre. Enseignant. Animateur de groupes Balint. Auteur d'articles de psychopathologie et de critiques culturelles.
Fonction(s) actuelle(s) : Psychiatre
Vous avez vu 11 livre(s) sur 11
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
A PROPOS DE <em><em>Quelque chose de Claude Huart</em></em> par Ghislaine Huon, Quimperlé, Editions de Kerguelen ; juillet 2021
Ce dernier évoque souvent Apollinaire. Fresnes-sur-Escaut, son lieu de naissance, n'est pas très éloigné de Stavelot, noyau dur pour Apollinaire. Impossible, en effet, d'échapper à son héritage géographique et culturel. Géographique, nordique : le Hainaut, les grosses têtes, Alcools. Culturel, Apollinaire serait-il lui-même sans Marie Laurencin ou Picasso ? Faudrait voir Huart du côté de Xavier Grall, de Glenmor, de Thersiquel et autres... Beaucoup pensent Claude Huart sudiste : explosion de couleurs oblige.
Chut ! Ne le disons pas trop fort : le véritable auteur des commentaires pointus, élégants, tendres, teintés d'humour, c'est Héloïse, le chat de Claude Huart. Je fais moi, mon métier de chatte, je dors, je rêve et lui, il s'absente dans les livres. Ça lui permet de dire que Je est un autre. Et Madame Huon l'a bien noté : il m'imite ! Il court après des bouts de bois, des cendriers, des assiettes, des cafetières, des pots de lait. Et en plus, il les barbouille, il colorie ! Il y met du bleu, du rouge, du vert et même du jaune, comme l'autre, celui-là qui habite à côté, coquin, Goguin je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. J'en ferais autant si seulement on s'occupait enfin de mes griffes !
Et il se promène ! tranquille. À Quimperlé, à Quimper, au Belon, à la buvette du Pouldu, dans les îles. Il aime la nature et les rivières, mais il ne nage pas aussi bien que moi, j'en suis sûre. De temps en temps ils se retire dans une grotte, il invente, il bidule, il fait de la magie, il grave parait-il. Mais je n'ai pas le droit de toucher à ce qu'il appelle la faïence. Brûlante, trop précieuse... C'est vrai qu'ils s'arrangent bien ces deux-là, Ghislaine Huon et Claude Huart. Mais maintenant, en tant que chat, ils me disent de me taire et de laisser la parole aux humains et à leurs quelconqueries.
C'est toujours vrai : le sensible, c'est bien mais l'intelligible c'est mieux. Pouvons-nous résister à la fascination du calcul ? Claude Huart oui ! Il aime le beau, le plaisir, l'ironie. Cézanne, impossible de ne pas l'évoquer, affirmait qu'il y avait deux manières d'échapper à la banalité de la narration, du raconter une histoire. La première c'est l'abstraction, la deuxième, la sensation que Francis Bacon appelait la Figure, qui concerne la viande accrochée à l'os, l'instinct, pas le sentiment, le sexe comme principal organe des sens. Francis Bacon : si je vais chez le boucher, je trouve surprenant de ne pas être à la place de l'animal. Vu par Ghislaine Huon, Claude Huart échappe à ce double écueil...
Leçon de bonheur, mais le bonheur, c'est comme l'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
A PROPOS DE <em><em>Comment on massacre la psychiatrie française</em></em> par Daniel Zagury,Editions de l'Observatoire, Paris ; 2021
Ce n'est pas un pamphlet, il y manque la satire. Pas de point d'interrogation. C'est un fait, une photographie.
D'abord la destruction de la comédie qui veut nous faire croire que, comme tout, la psychiatrie se consomme, que le cerveau s'augmente, se modifie, se découpe, se dissèque comme une chose banale. Il ne s'agirait que de modifier les comportements... Fi de l'esprit, cet objet insaisissable donc charlatanesque. La psychiatrie ne saurait être qu'une discipline médicale comme une autre. Les pros de la santé mentale ne sont que des ouvriers du bâtiment cérébral. Et ce cerveau fonctionne comme un ordinateur. Si ça cloche, c'est que le chef de chantier a mal calculé la taille de la glande pinéale. Ne pas s'étonner des possibles conséquences violentes. L'hôpital, fut-il psychiatrique, n'est qu'une entreprise, ne pas l'oublier ! Des données, des résultats !
Et ça permet de diminuer le nombre de glandeurs uniquement payés à serrer la paluche, en leur fournissant une bonne poignée de médocs, à ces gens finalement incapables de se gérer eux-mêmes que, du coup, on appelle malades... Efficacité. Confiance en une psy bureaucratisée, ordinatée. Peuvent pas se tromper ces gens-là. Auteurs de multiples protocoles, ouatés ou pas. Comment ça ? Vous avez contenu ce malade pendant trois jours et en plus il est en pyjama ? Mais c'est contraire au règlement et à la dignité humaine ! S'il est violent, c'est que vous n'avez pas été bon... Et si vous, les infirmiers, les psys, les soutiers, n'êtes pas heureux à votre travail, n'hésitez pas, faites appel à la brigade " qualité au travail ", ils sauront, eux ! Ils modifieront un tout petit peu le protocole et toc !
Un égale un, un psy en vaut un autre, ça permet de constituer des pools interchangeables. Une équipe ? Mais ça voudrait dire que deux personnes qui se rencontrent ça fait plus qu'une et une... Impossible. Et s'ils sont cent ça devient quoi ? Une masse, une foule, une institution, une communauté ? Faut classifier, réguler, classifier cela. Éviter à tout prix cette bêtise que d'aucuns nomment intelligence collective qui risquerait de ressusciter des mandarins, des agitateurs, des leaders qui passeraient leur temps à faire des réunions, à parloter, à tenir compte des vécus, des sentiments... Ils voudraient même être chefs que cela n'étonnerait pas !
Désormais le fou n'est pas le malade, c'est le potentiellement dangereux, celui à risques. Le savoir clinique, même intégrateur de toutes références, est quasi inutile, Henry Ey au rencart... À quoi bon l'expertise pénale psychiatrique qui ne fera que brouiller les pistes alors qu'on ne demande à cet expert que de prévoir et prévenir la violence ? Un sociobidulethérapeute administratif ce sera mieux... Et quelle idée de terminer ce livre par une lettre à Thierry, ce patient monstrueux, inclassable, " inhumain " que la psychiatrie française a, jusqu'ici, accueilli dans une unité de soins ? De soins, pas une unité sécuritaire ! Elle a même essayé de l'autonomiser... C'est dire ! C'est que ça coûte cher ces soins-là, pour rien !
Trop beau ce livre pour être entendu.
A PROPOS DE Enjeux actuels de la participation de la psychiatrie au contrôle social à travers la question de l'évaluation des dangerosités par Anne CRISTOFARI, Faculté de médecine de Marseille, le 16/10/2020
Le risque de psychiatrisation de la délinquance avec tous ses effets sur la fonction du psychiatre est tout à fait bien explicité. Mais les psychiatres y sont sans doute aussi pour quelque-chose. Peut-être aurait-il fallu davantage évoquer cela. En effet, au XVIIème siècle c'est une police médicale qui se chargeait des intérêts de l'hygiène publique devenue santé publique. Le premier président du premier comité de salubrité publique de la révolution française s'appelait d'ailleurs Guillotin. Et selon l'historien Jean-Pierre Goubert "à l'extrême fin du XIXème et au début du XXème, on remarquera une extraordinaire concomitance entre le désir de liberté individuelle et celui de santé publique". L'enseignement de l'hygiène est obligatoire dès 1883 dans les écoles primaires laïques. La croyance au progrès sans limite se justifiait de par la disparition des grandes maladies infectieuses d'où l'acceptation du dispensaire des vaccinations de la médecine à l'école, à l'usine, du certificat prénuptial, de la déclaration obligatoire de la tuberculose et de la syphilis, de l'isolement, de la mise en quarantaine, de l'internement.
L'éducation psy n'est pas qu'un vain mot, elle a peut-être démarré avec Anna Freud, s'est poursuivie dans le sillage de Françoise Dolto que se voulait médecin d'éducation et qui n'a pas hésité à régulièrement intervenir sur les ondes de France-Inter pour donner des conseils aux parents, aux éducateurs. Ce que Winnicott a fait également à la BBC. Roger Gentis disait que la psychiatrie doit être faite et défaite par tous. Jacques Hochmann, sur le modèle québécois, Pour une psychiatrie communautaire, souhaitait des psychothérapies d'immeubles.
Je ne peux résister à la tentation de citer un éditorial de L'Information psychiatrique de Horassius de mars 1996. Il estimait que la promotion de la santé mentale devait passer au traitement des maladies à leur prévention : "Et les choses changent : il existe des demandes d'intervention à visée préventive qui nous sont adressées en faveur des chômeurs, Rmistes et sans domicile fixe : cela préfigure et annonce la nature et l'importance de notre rôle (les psychiatres) dans une véritable politique de santé mentale."
Comment s'étonner que le socius demande à la psychiatrie la résolution de ses problèmes de vie commune ?
À propos de <em>La philosophie devenue folle[1] Le genre, l'animal, la mort</em> de J-F. Braunstein
D'abord le sexe et le genre. En premier, l'éducation, l'apprentissage, l'empreinte, l'emprise, les poupées et les pistolets. Ruissellement de la théorie du genre en France, le manuel de Sciences et vie de la terre en 2011 : "On ne naît pas homme ou femme, on le devient en fonction d'un choix personnel". Champ des possibles : homosexuel le matin, hétéro bête à midi, bisexuel la nuit. Le corps ne saurait contraindre désirs et plaisirs : liberté chirurgicale totale afin de modeler ce corps, de permettre une libre accession au transsexualisme, une libre amputomanie, si un bras vous devient insupportable. Si le genre est plus fluide, plus plastique que le sexe anatomique il devra en être de même pour le corps qui, Judith Butler l'a bien repéré, n'est que le résultat d'"une certaine conjonction historiquement contingente de pouvoirs et de discours[2]." Retour à la gnose. L'identité sexuelle est un concept vraiment réactionnaire, seule la construction des genres permet d'échapper à la prison des corps. Transchronologie : les vieux peuvent redevenir jeunes.
Une société moins coincée porterait d'ailleurs un autre regard sur les amours pédophiliques. Ce qui rendrait bien service à la si proche pédagogie sociale : il y a bien longtemps que l'on a renoncé à rééduquer les gauchers. Et s'il n'y a pas de violences, pourquoi refuser les douces caresses du grand-père adoré ? Et d'ailleurs, l'inceste, s'il y a un consentement mutuel ? Et ce vieux monde qui assigne, stigmatise avec des histoires de toilettes hommes, femmes ! Le genre ne permet que des water-closets neutres. Sous la douche, neutre aussi, contemplation des femmes à barbes, d'hommes sans pénis mais avec des seins, des prothèses à profusion... En 2015, victoire au concours chanson de l'Eurovision de Conchita Wurst "La victoire de Conchita Wurst, homme barbu travesti en femme, fut saluée dans toute l'Union européenne comme une victoire de la tolérance, du président autrichien à l'évêque de Vienne Christoph Schoenborn en passant par le Parlement européen. Conchita Wurst représentait l'identité européenne et serait la "Queen of Europe". La vice-présidente du Parlement européen, la députée verte et militante lesbienne Astrid Lunacek, s'émerveille : "Conchita Wurst porte un message politique d'une très grande importance [...] en lien avec les valeurs de l'Union européenne : l'égalité des droits, les droits fondamentaux, ou encore le droit de vivre pleinement sa vie sans crainte, que ce soir pour le groupe des LGBTI ou les autres minorités[3].""
Lecture du Journal Le Monde[4] du 5/10/2018, "Un canular met à mal un pan des sciences humaines américaines. Trois Américains ont réussi à faire publier des articles totalement farfelus dans des revues spécialisées notamment sur les "études du genre"".
Peter Boghossian et James Lindsay, en 2017, avaient piégé la revue Cogent Social Sciences en lui faisant publier une pseudo-étude tendant à montrer que le pénis ne devait pas être considéré comme l'organe masculin de la reproduction mais comme une construction sociale. Le pénis était la source d'une culture du viol, y compris du viol de la nature, et donc en partie responsable du réchauffement climatique Peter Boghossian et James Lindsay, ont décidé de pousser la farce un cran plus loin, rédigeant vingt études bidon en l'espace de dix mois et les soumettant à des revues plus réputées que Cogent Social Sciences. Les journaux ciblés publient essentiellement des travaux sur les questions du genre, de la sexualité, de l'identité ou de l'origine ethnique, un champ d'étude que Boghossian, Lindsay et Pluckrose estiment "corrompu", au sens où l'idéologie y aurait pris le pas sur la recherche de la vérité. Selon ce trio, ces disciplines sont gangrenées par une culture du "grief", c'est-à-dire une obsession à attribuer les discriminations dont souffrent certaines personnes (en raison de leur sexe, de la couleur de leur peau ou de leur orientation sexuelle) aux machinations d'un groupe dominant - les hommes blancs hétérosexuels, pour schématiser.
Les articles publiés flirtent souvent avec le grotesque. L'un d'eux met ainsi en scène une chercheuse inventée étudiant, dans les parcs canins, la culture du viol chez les chiens et se demandant s'il est possible de réduire les tendances aux agressions sexuelles des hommes en les dressant comme on dresse leurs compagnons à quatre pattes. L'étude a été publiée par Gender, Place & Culture et l'un de ses relecteurs a écrit à son sujet : "C'est un papier merveilleux, incroyablement novateur, riche en analyses et extrêmement bien écrit et organisé", etc. Autre exemple, une étude parue dans Sexuality & Culture, qui encourage les hommes hétérosexuels à s'introduire des godemichés dans l'anus pour faire baisser leur homophobie Un des reviewers s'est enthousiasmé pour ce "travail", assurant qu'il s'agissait d'"une contribution incroyablement riche et passionnante à l'étude de la sexualité et de la culture, et en particulier l'intersection entre masculinité et analité". Sic
Inimitable Le Monde. Car la conclusion vaut aussi son pesant d'or. Pierre Barthélémy : "Quand on ose ce genre de canular pour redonner une santé à la science, on risque aussi d'aider ceux qui la combattent." Hé oui ! La science a besoin d'autocensure ! Faut pas parler de certaines choses car cela pourrait conforter l'extrême-droite... Mais la science, quand-même, elle devrait avoir peur de son ombre ? Tu as eu tort Galilée d'affirmer que la terre était ronde ! Fallait pas désespérer les damnés de la terre qui croyaient qu'elle était plate... Une certaine tristesse peut nous saisir...
Deuxième fétiche : "Les animaux sont des humains comme les autres." C'est signé Stéphanie de Monaco.
Pas de barrière entre l'espèce humaine et les animaux. Cultures humaines et animales sont synonymes. Paola Cavalieri : on découvrira que l'espécisme, cet impérialisme de l'espèce, est à la base du racisme, cet impérialisme de la race. Braunstein s'attarde surtout sur la figure de Peter Singer, le philosophe, le Grand Timonier à la pointe de ce combat titanesque. Après la libération des esclaves, des colonisés, des femmes, des enfants, celle des animaux est à venir. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement la raison, le langage ou la liberté mais la sensibilité qui crée une communauté douloureuse des vivants. Les Grands Singes, si proches de nous (98.4% de gènes communs) sont des êtres qui pensent, conscients, capables de se projeter dans l'avenir, d'apprentissage du langage des signes des sourds-muets humains par exemple. Ce qui n'est pas le cas des handicapés mentaux et des séniles. Ils ont droit à des avocats, des experts-tuteurs, et certains le préconisent, au vote. Humanisme à dépasser. Questions épineuses : que faire pour que la vie soit bonne à la fois et aux tigres et aux antilopes ? Quel statut donner aux microbes et aux bactéries, poissons rouges, punaises, mouches, vipères, vers ? Et la carotte découpée ? Réponse : elle est vivante mais n'a pas de système nerveux. Mieux vaut d'ailleurs faire des expérimentations médicales sur les animaux humains au système nerveux délabré plutôt que sur un orang-outang vif et vigoureux. Il existe indiscutablement une hiérarchie chez les humains, ce dès la naissance.
La zoophilie doit échapper à tout opprobre, il s'agit d'activités sexuelles mutuellement satisfaisantes. Attention... un homme copulant avec un poulet risque d'être cruel envers celui-ci. Mais mieux vaut faire l'amour avec un animal que de le bouffer, orgasmes assurés. Donna Haraway, star de la modernité, ne peut que se louer des plaisirs liés aux baisers profonds de sa chienne, Melle Cayenne Pepper. D'une manière plus générale il convient d'abolir toutes frontières entre l'humain, l'animal et la machine. Des cyborgs partout. Foin des lois biologiques, immunologiques et autres babioles. Delphine Gardey : il faut "introduire le "trouble" dans les valeurs universelles de la République des sciences, en s'amusant à défaire les fictions modernes que sont le sujet, la nature, la science et la culture[5]". Le tableau de chasse est satisfaisant.
Troisième mythe : l'enthousiasme pour l'euthanasie que tout le monde, sauf Hans Jonas et Houellebecq, soutient. Croisade pour le Bien, pour une mort digne. Processus désacralisé. Braunstein retrouve, après l'égalisation de l'humain et de l'animal le même Peter Singer en spécialiste de bioéthique. Postulat : seules certaines vies valent la peine d'être vécues. L'euthanasie pour les non-personnes, sans qualité de vie, dépourvues d'un système nerveux en état de marche, qui ne dépendent que de la bienveillance des vraies personnes, peut se concevoir. C'est un acte d'humanité, de miséricorde, une délivrance pour tous. C'est un comité d'experts qui prend la décision de l'effectuation de l'action finale. L'infanticide de nouveau-nés lourdement handicapés ne saurait être un crime, il s'agit d'un simple avortement post-natal. La déclaration de naissance pourrait être repoussée à trois jours, temps raisonnable pour un vrai diagnostic de conformité. On tue bien les escargots. Tous les enfants, dans le fond, sont remplaçables. L'utilitarisme, pas la vieille morale, toujours teintée par la perversion chrétienne ! L'extraordinaire explosion du marché des greffes d'organe impose une définition nouvelle, opératoire, de la mort. L'idéal c'est que le prélèvement d'organes se fasse sur des morts pas vraiment morts : définition qui ne prend en considération que le silence du cortex. Collection de cadavres vivants nationalisés en attente, possible.
L'auteur convoque George Orwell et la décence ordinaire et rapproche ces idées de celles, nazies, ayant entraîné l'Aktion T4 qui visait à la disparition des humains "anormaux", dégénérés, physiquement ou psychiquement. L'idéologie rapportée par Braunstein est opératoire, utilitariste, au service d'une qualité de vie individuelle. Ce qui est fort différent de la position du président américain Reegan, louée par Braunstein : "Chaque législateur, chaque docteur et chaque citoyen doit reconnaître que la vraie question est de savoir s'il faut affirmer et protéger la sainteté de toute vie humaine, ou adopter une éthique sociale où certaines vies humaines sont considérées comme ayant de la valeur et d'autres non. En tant que nation, nous devons choisir entre une éthique de la sainteté de la vie, et une éthique de la qualité de la vie[6]." Tout est dit, on n'y coupe pas : au-delà d'une mécanisation, numérisation de la vie, la transcendance religieuse ; nous sommes tous filles et fils de Dieu. L'éthique sociale du nazisme est autre, c'est un eugénisme d'Etat qui repose sur le racialisme, le darwinisme social, l'antisémitisme. La Loi, l'Etat et les institutions appliquent le programme de mort.
En 2008, dans La politisation de l'ordre sexuel, nous écrivions : "La guerre entre le religioso-naturel qui affirme le caractère sacré de la vie et la démarche progressiste laïque de l'individualisme démocratique rationnel adossée à la science qui promeut la qualité d'une vie, librement choisie, se poursuit aujourd'hui et se poursuivra. Ainsi pour la loi allemande, en 2006, l'avortement est un crime dépénalisé et remboursé ! On peut maintenir l'ambiguïté entre morale et droit en attribuant, comme le fait la loi française de 1994, à l'embryon humain la notion de "personne potentielle", censée interdire les expérimentations sur l'embryon mais autoriser l'avortement. Et quid de l'eugénisme défendu dans une certaine forme par Pierre-André Taguieff[7] ? La génétique serait, selon certains, nécessairement, l'histoire du nazisme en témoignerait, une science de mort, raciste, qui aurait mené à l'eugénisme exterminateur. Toute préoccupation eugénique, visant à l'amélioration du patrimoine génétique humain serait condamnable. "Le soupçon qui dérive de l'amalgame nazificateur fonde le terrorisme intellectuel qu'exprime l'imposition de l'alternative stricte : il faudrait nécessairement choisir entre un humanisme de la méfiance et du soupçon, criminalisant l'eugénique en discréditant le savoir biologique, et le parti du crime contre l'humanité Humanisme ou science de la mort. Il s'ensuit que la position humaniste est radicalement désimpliquée de l'ordre du savoir scientifique On affirme ou l'on suggère que la science moderne et en particulier la science du vivant, est le pire des savoirs, porteur de la barbarie maximale[8]." [...] Il paraît pourtant normal, selon Taguieff, d'éviter de donner naissance à des enfants anormaux, de supprimer ces sujets anormaux virtuels que sont les ftus atteints d'anomalies "actuellement hors d'atteinte des ressources thérapeutiques." Et ceci pourrait permettre d'avancer divers modes de légitimation de l'avortement eugénique illustrant un souci de prévention fondé sur divers types d'intérêt : l'intérêt de l'enfant à ne pas naître, l'intérêt des parents (éviter de mettre au monde un enfant fardeau) et enfin l'intérêt de la société globale. Mais, véritable cliché épinglé par Taguieff, le risque existerait que "le diagnostic prénatal conduise dans un terme proche à des avortements de pure convenance, à un eugénisme actif, motivé par exemple par le sexe de l'enfant à naître[9]." Les craintes d'une "pratique eugénique", d'une perversion du conseil génétique, à propos du diagnostic préimplantatoire DPI (recherche d'une anomalie génétique avant la grossesse sur un embryon obtenu in vitro réimplanté ensuite dans un utérus maternel), l'idée du surgissement d'un "homo généticus" synonyme d'enfant parfait sont régulièrement exposées dans différents articles par Jacques Testart. Ces positions sont frontalement récusées par Israel Nisand[10]. Nisand estime que si par exemple, demain, un nouveau gène de l'autisme était découvert, il y a fort à parier que les parents éprouvés par la naissance d'un enfant malade demanderaient au DPI de leur éviter une IVG. "Qui mieux que les parents peut prendre ce type de décision ? " "Ce ne sont pas les médecins qui estiment qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce sont les parents qui, seuls, ont cette légitimité. La société aurait bien tort de vouloir se substituer à eux pour des décisions d'une telle gravité qu'ils seront seuls à assumer ultérieurement." Pour Taguieff la désacralisation du génome ne fait pas scandale tant qu'elle ne se prolonge pas sur le mode d'une intervention biomédicale susceptible de le modifier. Au sens strict, l'eugénisme est une forme d'interventionnisme d'Etat, coercitive, qui, pour réaliser ses objectifs, doit supprimer le libre choix individuel en matière de procréation. Une définition plus douce de l'eugénisme moderne pourrait se résumer en une modification du patrimoine génétique humain en vue de son amélioration. La question posée est celle de l'autotransformation volontaire de l'humain par les technosciences[11]."
Le livre de Braunstein paraît exprimer en miroir inversé les positions extrêmes des philosophes qu'il combat. Il regrette l'engagement "quasi-queer" des médecins pour toutes les techniques possibles qu'ils proposent : changement de sexe, amputomanie, greffes d'organes à tout prix ouvrant la porte à tous les marchés. Ce qu'André Breton appelait la réclame, aujourd'hui la publicité médiatisée. Ils oublient facilement morale et serment d'Hippocrate : "D'abord, ne pas nuire." Mais il reconnaît les réticences de certains pédiatres quant à certaines conséquences de la théorie du genre. "Ces enfants sont conduits par des parents submergés par la vague transgenre médiatique chez un militant pro-transgenre, ils entrent alors dans un parcours de changement de sexe dont ils auront le plus grand mal à s'extraire. S'engager dans un tel parcours est, selon des pédiatres plus prudents, éminemment absurde et dangereux[12]."
Michaël Fssel arpente, lui, en ce qui concerne les médecins, d'autres voies. Son compte-rendu du livre de Götz Aly Les anormaux[13] intitulé Les ambivalences du progressisme[14] estime qu'au-delà du catholicisme de l'auteur son livre n'est pas seulement une étude historique du national-socialisme mais qu'il illustre au contraire une tendance lourde de la modernité : "hygiénisme militant, promotion du "progrès" même par la violence, rationalité instrumentale, efficacité bureaucratique." "Points communs entre convictions progressistes et pratiques totalitaires" ? On aurait tort, selon Fssel, d'évacuer le trouble suscité par ce livre. Recours nécessaire au religieux, à la spiritualité ? La facilité avec laquelle une certaine idéologie progressiste s'est accommodée de la radicalité nazie est un fait d'histoire. En temps de guerre, l'insistance pleine de sollicitude sur les vies indignes d'être vécues épouse tout naturellement la stigmatisation des bouches inutiles. Se méfier, donc, de l'exaltation d'une vie saine et même de la vie bonne. Fssel : le désir des psychiatres allemands, au service de l'Aktion T4, aurait rencontré l'idéologie hitlérienne sur un point précis : l'idée que tout problème appelle sa solution, le problem solving. Ne pouvant admettre l'idée que certains malades étaient incurables, qu'ils défiaient leur pouvoir thérapeutique, ils ont considéré que le système de mise à mort s'est constitué pour ne plus voir ni entendre des êtres qui contredisent les pouvoirs de la science médicale. Tenue en échec, la rage de guérir s'est transformée en volonté d'anéantir.
Il est à craindre ou à s'en féliciter que les décisions prises face au concret des situations nous éloigne de la sainteté peut-être difficile à faire équivaloir avec la vie bonne et de l'absence totale de limites défiant toute loi sociale, ce contre quoi le livre de Braunstein nous met en garde.
Notes :
[1]Braunstein Jean-François. La philosophie devenue folle. Le genre, l'animal, la mort. Paris : Grasset, 2018.
[2]Braunstein Jean-François. Ibid. p. 81.
[3]Braunstein Jean-François. Ibid. p. 139.
[4]Barthélémy Pierre. "Un canular met à mal un pan des sciences humaines américaines". Le Monde, 5 octobre 2018 ; p. 7.
[5]Braunstein Jean-François. Ibid. p. 253.
[6]Braunstein Jean-François. Ibid. p. 305.
[7]Taguieff P-A. "L'eugénisme." Esprit. Novembre 1989 ; p 99-115.
[8]Taguieff P-A. Ibid. p 104.
[9]Taguieff P-A. Ibid. p 107.
[10]Nisand I. "Le choix légitime des parents." Le Monde. 20 octobre 2006.
[11]Le Dorze Albert. La politisation de l'ordre sexuel. Paris : L'harmattan ; 2008, p. 91-94.
[12]Braunstein Jean-François. Ibid. p. 124-125.
[13]Götz Aly. Les anormaux. Paris : Flammarion ; 2014.
[14]Fssel Michaël. "Les ambivalences du progressisme." Libération. 18 octobre 2014 ; p 30.
À propos de <em>La mécanique des passions</em> [1] d'Alain Ehrenberg ou la Nouvelle Psychiatrie ?
Il ne peut exister de césure entre le biologique et le social. La valeur essentielle, c'est la propriété de soi, la possibilité de réaliser toutes ses chances. Tout sujet, handicapé ou pas - il faut parler d'handicapable - est capable d'être augmenté du fait des propriétés dynamiques liées à la plasticité cérébrale, à la sélection synaptique. Il possède un potentiel caché, fait preuve de créativité, origine de nouvelles valeurs. Son self présente de nouvelles formes de vie, des styles spécifiques. La compétence, la cognition sociales sont essentielles : l'individu se doit d'être reconnu dans sa dignité. Il faut écrire une science naturelle du comportement autonome.
Philosophie qui se revendique pratique, empirique, utilitaire, humienne. Le comportement humain procède par tâtonnements mais on le veut aussi mécanique, automatique, régulier, prédictible, quantifiable. Par l'appren-tissage le sujet devient capable. Disparition de la psychopathologie, seuls des dysfonctionnements neurophysiologiques existent. Les symptômes ont valeur d'expériences vitales. Domaines du coach, du pair, du partenaire dans l'établissement de projets visant au dépassement mais le spécialiste de la maladie mentale ne peut que se dissoudre. Il nous faut identifier les détériorations d'un système neural spécifique à un individu et "prescrire des programmes d'entraînement cognitifs personnalisés afin d'augmenter la cognition, d'améliorer le fonctionnement dans la communauté et d'optimiser le bien-être[3]." Peut-être comme une hypnose au long cours[4] ? Les entraînements de remédiation cognitive - la narrativité est notoirement insuffisante - réussissent à modifier l'activité du cortex préfrontal. La contingence devient nécessité, l'existence fondue dans l'essence, la mythologie réduite à l'état de ferraille. Le sujet, schizophrène ou autre, est un sujet pratique confronté à des problèmes à résoudre. La négativité devient un atout. Clairvoyance d'Antoine Garapon : "La domination intellectuelle ne passe plus par de nouveaux concepts, mais par un nouveau statut du concept qui n'a de valeur que s'il est opératoire[5]." Opérations, calcul, digitalisation.
Et c'est le patient qui décide, à tel moment, s'il a besoin d'un pair, d'un médicament, d'un soutien communautaire comme celui des entendeurs de voix, de telle expérience sexuelle, de tel apprentissage. Il faut viser l'autocontrôle, l'autorégulation émotionnelle. Le sujet est expert de lui-même. "Aux USA, les groupes, programmes, organisations dirigés par des personnes avec une sérieuse maladie mentale sont deux fois plus nombreux que les organisations de santé mentale dirigées par un professionnel[6]." Les libertariens pourraient signer ce manifeste : c'est à la société de s'organiser afin de permettre la libre expression des différences. Les pratiques neuroscientifiques concernent l'individu ordinaire et elles veulent faire claquer au vent les voiles de l'individualisme démocratique, refusant avec violence tout écrémage culturel, élitiste. Comme le disait Roger Gentis[7] en 1973, la psychiatrie doit être faite et défaite par tous. Elles valorisent les initiatives individuelles et aiguillonnent l'esthétisation de la vie de tout un chacun. L'héroïsme de la modernité est pour tous.
Proximité évidente entre la neuropsychologie et l'anthropologie numérique. D. Dennet et S. Dehaëne : nous pouvons répondre à toutes les questions pertinentes en étudiant l'activité cérébrale sans recourir à des expériences subjectives. La plasticité cérébrale permet une action-réponse à la question qui court-circuite, pour la bonne cause, l'intentionnalité et la volonté du sujet.
Intentionnalité qu'Ehrenberg a toutefois quelques difficultés à abandonner : le symptôme doit bien toujours avoir quelque valeur intentionnelle. Pouvons-nous ainsi faire passer la psychanalyse par-dessus le moulin ? Pour lui, le même fait peut, à la fois, s'analyser du côté sensori-moteur et du côté de l'intelligible, d'une dynamique psychique. Cerveau individuel, psyché, attentes sociales, cultures ne peuvent se distinguer. Siri Hustvedt, écrivaine qui tremble et se décrit[8], déclare : je ne peux savoir où la maladie finit et où le je commence. Et comme l'antique péché religieux, le malheur ne peut que traduire une insuffisance d'intelligence cognitive ou émotionnelle, une faute à confesser puis à dépasser. Le sujet humain doit rebondir, il est flexible. Ce malheur doit apporter le "bénéfice" d'une différence. La diversité n'attend pas un secours solidaire qui s'apparenterait à ce que Baudelaire nommait la prostitution fraternitaire. La happycratie d'Eva Illouz, l'homo-festivus de Philippe Muray s'affichent comme étendards d'une modernité obligatoirement positive.
La croyance en la neuroscience doit cesser car la mécanique newtonnienne n'a pas besoin de croyance. Reste à savoir si la nature humaine, si elle existe, obéit à ce qu'on lui présente comme désespérément rationnel. Michel Tournier : il n'y a rien de plus émouvant dans une vie d'homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué. Levinas : la rencontre se distingue de la connaissance, elle fonde l'existence. Paul Valéry. "La science est due à des accidents heureux, à des hommes déraisonnables, à des désirs absurdes, à des questions saugrenues, à des amateurs de difficultés, à des loisirs et à des vices, au hasard[9]." Le tenant d'une théorie unique, totale, monoculaire ne peut-il apparaître, au mieux, que comme un idiot utile ?
Notes :
[1] Ehrenberg Alain. La mécanique des passions. Cerveau, comportement, société. Paris : Odile Jacob ; 2018.
[2] Edelman G. Cité par Ehrenberg Alain. Ibid. p. 125.
[3] Ehrenberg Alain. Ibid. p. 240.
[4] Roustang F. Elle ne le lâche plus. Paris : Minuit, 1980.
[5] Garapon Antoine. "Une gauche "ringardisée" par la mondialisation ?" Esprit, septembre 2016 ; n°427, p. 37.
[6] Ehrenberg Alain. Ibid. p. 246.
[7] Gentis Roger. La psychiatrie doit être faite et défaite par tous. Paris : Maspero ; 1973.
[8] Hustvedt Siri. La femme qui tremble. Une histoire de mes nerfs. Paris : Actes Sud ; 2010.
[9] Valéry Paul, Cahiers : Gallimard, La Pléiade ; Tome II, 1974, p. 938-939.
Le dernier opuscule de Charles Madézo : <em>Rose Ressac</em>.
Métissage entre la littérature et les mathématiques ? L'Oulipo, certes, mais ici c'est à Mallarmé que vous pourriez penser. Mais encore ! A qui, à quoi ? Il s'agirait de faire rendre gorge à la sensation, à l'affect, à l'émotion, à des trucs dits féminins afin de les rendre traductibles, sinon en formules algébriques, du moins en figures rhétoriques qui les fixent, tel un papillon épinglé, sur le papier : on peut comprendre désormais.
La semaine passée, vous avez donc relu, et d'un coup, un mot, un nom vous frappe la cervelle : Luis de Gongóra y Argote, le cultisme ! Il y a sûrement un Italien qui ferait l'affaire ou un Grec, en tout cas c'est du Sud qu'il s'agit. L'auteur nous y invite, qui convoque Garcia Lorca, grand admirateur de Gongóra. Mais que dire du cultisme ? Louis Gaudran, spécialiste de la question : "Double aspiration : ascétique d'abord avec la recherche d'une langue extrêmement concentrée, s'exprimant par demi-mots et suggestions rapides, poussant au plus haut point le caractère ésotérique de toute véritable poésie ; aristocratique d'autre part, par l'immense érudition qu'elle met en uvre [...] ses néologismes audacieux, ses inversions forcées, ses métaphores hyperboliques (d'où le risque de pédantisme), son effort constant vers l'extrême subtilité (d'où le risque d'affectation)." Charles Madézo se tient sur cette ligne de crête, sur le fil du rasoir.
Ceci n'est possible que dans une période où la culture se veut détachée de son environnement. Le langage, seul compte le langage ! Charles Madézo cultive la nostalgie de ce temps où nous avions le droit d'être dépouillé, ou purement décoratif, ou bizarre. Peut-être que nous aspirions au droit d'être sans sentiment, sans idée, sans idéologie ? Lire Madézo et méditer.
Notes :
(1) Madézo C. Rose Ressac, Questembert : Stéphane Batigne ; 2017.
(2) Gaudran L. "Gongóra y Argote." Le nouveau dictionnaire des auteurs. Sous la direction de Laffont et Bompiani. Paris : Robert Laffont ; 1994, Tome II, p 1274.
Psyché et cultures
Une seule civilisation numérique avec abolition des cultures ? "Le cosmopolitisme postnational s'organise autour d'un grand rêve, celui de l'abolition immédiate et définitive de toutes les frontières entre les groupes humains et, plus avant encore dans l'utopie, de celui de l'élimination totale et irréversible de toutes les barrières entre les humains(58)." Le risque, clair, est d'aboutir à une uniformisation universelle et comme l'a suggéré Lévi-Strauss, d'un appauvrissement culturel irréversible. "Vouloir évaluer des contributions culturelles lourdes d'une histoire millénaire, et de tout le poids des pensées, des souffrances, des désirs et du labeur des hommes, qui les ont amenées à l'existence, en les rapportant exclusivement à l'étalon d'une civilisation mondiale qui est encore une forme creuse, serait les appauvrir singulièrement, les vider de leur substance et n'en conserver qu'un corps décharné(59)." Croire en un métissage culturel mondial ne serait que folie criminelle. Il ne peut y avoir de civilisation mondiale au sens absolu "puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversité, et consiste même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité(60)." Coalition et non pas fusion cosmopolite.
Notes :
(1)Le Dorze A. Cultures, métissages et paranoïa. Paris : L'Harmattan ; 2014.
(2)Lalande A. "Civilisation", Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris : PUF ; 1980, p 141.
(3)Toumson R. Mythologie du métissage. Paris : PUF ; 1998.
(4)Toumson R. Ibid. p 179.
(5)Toumson R. Ibid. p 179.
(6)Pomian K. "Patrimoine et identité nationale." Le Débat. Paris : Gallimard, mars-avril 2010 ; n°159, p 46.
(7)Laplanche J., Pontalis J-B. Vocabulaire de Psychanalyse. Paris : PUF ; 1973, p 187.
(8)Kaès R. Différence culturelle et souffrances de l'identité. Paris : Dunod ; 2012, p 46.
(9)Kaès R. Ibid. p 15.
(10)Olender M. "La race comme mythe" Le Débat. Paris : Gallimard, novembre-décembre 2010 ; n°162, p. 167.
(11)Olender M. "La race comme mythe". p. 169.
(12)Dumont L. Homo hiérarchicus, essai sur le système des castes. Paris : Gallimard ; 1966.
(13)Lévi-Strauss C. Race et Histoire. Paris : Denoël, Folio Essais ; édition 2011, p 50.
(14)Lévi-Strauss C. Ibid. p 43-44.
(15)Lévi-Strauss C. Ibid. p 23-24.
(16)Taylor C. "De l'anthropologie philosophique à la politique de reconnaissance." Le Débat. Paris : Gallimard, mars-avril 1996 ; n°89, p 214.
(17)Taylor C. Ibid. p 211.
(18)Taylor C. Ibid. p 213.
(19)Taylor C. Ibid. p 218.
(20)Ozouf M. Composition française. Paris : Gallimard ; 2009.
(21)Sartre J-P. Orphée noir Paris : PUF, 1ère édition 1948, 8ème édition Quadrige ; 2011, p XVIII.
(22)Jullien F. "Paris-Pékin." Le Débat. Paris : Gallimard, janvier-février 2009 ; n° 153, p 159-160.
(23)Jullien F. De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures. Paris : Fayard ; 2008, p 168.
(24)Taguieff P-A. "Diversité et métissage : un mariage forcé." Le Débat. Paris : Gallimard, mars-avril 2010 ; n°159, p 41.
(25)Fourest C. "Le racisme existe, pas les races." Le Monde. 17 octobre 2012.
(26)Mbembe A. Sortir de la Grande Nuit. Paris : La Découverte ; 2010, p 153.
(27)Mbembe A. Ibid. p 153-154.
(28)Mbembe A. Ibid. p 154.
(29)Zimra G. Le tourment de l'origine. Le malaise identitaire. Paris : Berg International ; 2011, p 130.
(30)Zimra G. Ibid. p 132.
(31)Hess A. Les analystes parlent. Paris : Belfond ; 1985, p 100 et 106.
(32)Suréna G. "La psychanalyse et son étranger." Revue Française de psychanalyse. Ibid. p 751-760.
(33)Lacan J. "Le maître châtré." L'envers de la Psychanalyse. Le Séminaire livre XVII. Paris : Le Seuil ; 1991, p 104.
(34)Porot A. Cité par Fanon F. "Guerre coloniale et troubles mentaux." uvres. Ibid. p 665.
(35)Fanon F. Ibid. p 666.
(36)Cherki A. Frantz Fanon. Paris : Seuil ; 2000, p 103.
(37)Cherki A. Ibid. p 108.
(38)Zeldine G. "Un témoignage sur Fanon." L'évolution psychiatrique : 1981 ; vol. 46, n°1, p 133-153.
(39)Zeldine G. Ibid. p 140.
(40)Zeldine G. Ibid. p 140.
(41)Zeldine G. Ibid. p 149.
(42)Zeldine G. Ibid. p 153.
(43)Miller J-A. "Le théâtre secret de la pulsion". Le Point. 22 mars 2012 ; p 46.
(44)Pontalis J-B. Le laboratoire central. Paris : Editions de l'Olivier ; 2012, p 28.
(45)Kress-Rosen N. "Paranoïa." Dictionnaire de psychiatrie et de psychologie clinique, sous la direction de J. Postel. Paris : Larousse ; 1993, p 395.
(46)Searles H. L'effort pour rendre l'autre fou. Paris : Gallimard ; 1977.
(47)Kress-Rosen N. Ibid. p 395.
(48)Ey H. Leçons du mercredi sur les Délires chroniques et les Psychoses paranoïaques. Perpignan : CREHEY ; 2010.
(49)Fukuyama F. "La fin de l'histoire ?" Commentaire. Paris : Julliard, automne 1989 ; n°47, p 459.
(50)Muray P. Ibid. p 160.
(51)Martel F. Mainstream. Paris : Flammarion ; 2010, p 11.
(52)Martel F. Mainstream. Ibid. p 421.
(53)Monod J-C. "De nouvelles règles pour la direction de l'esprit à inventer." Le Magazine littéraire, avril 2013 ; p 15.
(54)Monod J-C. Ibid. p 15.
(55)Monod J-C. Ibid. p 15.
(56)Proust J. "Vers un homme nouveau ?" Le Débat. Paris : Gallimard, novembre-décembre 2009 ; n°157, p 124-143.
(57)Clark A. Natural-born Cyborg Minds, Technologies and the Future of Human Intelligence. Oxford University Press, 2003. Cité par Proust J. Ibid. p 140.
(58)Taguieff P-A. Ibid. p 43
(59)Lévi-Strauss C. Race et Histoire. Paris : Denoël, Folio Essais ; édition 2011, p 76.
(60)Lévi-Strauss C. Race et Histoire. Paris : Denoël, Folio Essais ; édition 2011, p 77.
À propos de : <em>Caché dans la maison des fous</em>(1) de Didier Daeninckx
Didier Daeninckx procède de même dans son livre Caché dans la maison des fous, consacré à Saint-Alban. Il évoque peu les traitements des fous, mais beaucoup plus la communauté de Saint-Alban, cimentée par certaines idées - engagement personnel et collectif -. Les fous sont des humains comme les autres, et les Juifs aussi. Combat contre l'idéologie qui décide qu'il existe des sous-hommes, des rats et punaises humains. Cachés, entre autres, au milieu des fous : Denise Glaser la Juive, Eugène Grindel dit Paul Eluard, Nusch son épouse, le Pr. Bardack cancérologue. Mais pourquoi ce "caché" masculin singulier dans le titre ? Pourquoi pas "cachée" ou "cachés" ?
Lâchez un poète dans l'enceinte de Saint-Alban et il boira des paroles cabossées et sera fasciné par le surréel des actions et productions des internés. Tous enfants de Lautréamont. Eluard le fugitif crée les éditions interdites de la Bibliothèque française. Et Daeninckx nous décrit le voyage, baroque, en gazogène-ambulance organisé par Bonnafé, de Saint-Alban à Saint-Flour, à la barbe de Vichy, au domicile d'un éditeur clandestin, avec Eluard comme pseudo malade et Denise comme pseudo-infirmière Il faut suivre Eluard, attentif au travail "psychotique" d'Auguste Forestier qui compose à partir de déchets - bois, ficelle, métal, os de boucherie -, des sculptures, des statues qu'il offre à tout vent et qui seront bientôt reconnues comme des uvres premières de l'art brut, théorisé par Dubuffet et Max Ernst, adossé à l'ouvrage princeps de Prinzhorn, Expressions de la folie.
Bonnafé confie à Denise le soin d'organiser la bibliothèque, ce qui la rapproche d'Eluard. Il lui confie aussi des enfants, internés, traumatisés, à qui, vite, elle redonne le goût de vivre : la psychiatrie doit être faite et défaite par tous, disait Roger Gentis. Pour Eluard, les folies discursives des patients ne sont que l'expression de désirs humains universels, comme le rêve. Daeninckx ne peut que parsemer son livre de poèmes d'Eluard, témoins de la cristallisation rendue nécessaire par ce lieu.
Mais un collectif qui ne serait qu'une collection de signifiants pour d'autres signifiants, ça ne saurait bien fonctionner si, à la tête, ne se retrouvaient de fortes personnalités. Tosquelles, Bonnafé en imposaient. Tosq, catalan, né à Reus comme Gaudi, médecin, psychiatre, qui a suivi une analyse avec un Juif hongrois, membre du Parti Ouvrier d'Unité Marxiste (le POUM), anti-stalinien - alors que Bonnafé était membre du PCF - ayant failli être fusillé par les stals, condamné à mort par Franco. Donc, comme tout "rouge" espagnol, considéré comme un violeur de nonnes. D'abord interné, après la défaite des Républicains, dans un camp près de Cahors, il met en place un service de psychiatrie. Il faut dire que, pendant la guerre civile, il en avait fait autant en embauchant des curés et des prostituées, grands connaisseurs, selon lui, de la nature humaine, faisant mentir l'adage ironique de Dostoïevski : "Plus j'aime l'humanité, moins j'aime les hommes." Il oblige d'ailleurs les catholiques, fonctionnaires de l'Eglise, à devenir de vrais catholiques ! Il récidive avec les religieuses de Saint-Alban : "Une partie de notre rôle consiste à convertir les individus en ce qu'ils sont réellement, que ce ne soit pas simplement la façade, que ça corresponde à leur être, à leur moi idéal ! C'est ce qui leur arrive à nos surs de Saint-Alban Elles sont reprises dans les mailles de leur vraie vie." Et pour cela y aurait-il besoin de la psychanalyse ? "Moi, la psychanalyse, je l'appelle la déconniatrie. Mais, pendant que le patient déconne, qu'est-ce que je fais ? [ ] Je déconne à mon tour. [ ] Un psychiatre, pour être un bon psychiatre, doit être un étranger." Ou faire semblant. Mais il faut que l'autre fasse un effort d'interprétation. Et roublard avec ça : Eluard, en panne de tabac, alors que celui-ci est rationné : "On peut trouver du tabac ?" Tosquelles : "Oui, mais il faut savoir jouer aux cartes." Nécessité de s'installer, dans le bistrot du buraliste, à quatre, cartes en main. Mais les règles du jeu sont variables et des plus fantaisistes. Si bien que le buraliste, pétainiste, qui a perdu un bras au Chemin des Dames, qui tente de comprendre le jeu, écuré, se réfugie dans la cuisine pour se taper un coup de gnôle pendant que sa femme, bravant l'autorité du maréchal et de son mari, en profite pour refiler quelques paquets de tabac. Mais il n'hésite pas à se faire obéir : il déplace sèchement une patiente qui avait volé draps et nourriture des enfants. Et pour ceux-ci : "On a isolé ceux qui pouvaient s'en sortir [ ] et je leur ai affecté les infirmières les plus maternelles, les plus aimantes." A l'époque, il y avait encore du naturel dans la différence des sexes.
Bonnafé, lui, est communiste, pétri de culture et de cinéma, matériaux indispensables pour devenir un bon psychiatre. C'est lui qui dévoile à Denise Glaser que le mystérieux visiteur qu'est Eluard est l'auteur de Liberté. Bonnafé, cet amoureux de Toulouse et de ses cinoches : René Clair, Vidor, Buñuel et surtout Potemkine... Voyages à Paris, rencontres avec André Breton, Péret, apéros avec Ernst, Man Ray, Tanguy. Participation à des manifestations interdites : amendes et jazz aux terrasses de cafés afin de les payer. Médecin directeur, il n'a aucune confiance dans l'administration. Car le problème majeur, c'est celui de l'alimentation, du ravitaillement : il ne faut pas mourir de faim. Onze cents personnes à nourrir chaque jour. Les neuf dixièmes des vaches, cochons, chevaux ont été réquisitionnés par l'armée allemande. Dans les autres asiles, c'est un tiers des malades qui meurt. Bonnafé : "Et vous savez ce qui inquiète le directeur de Montdevergues les Roses, près d'Avignon ? La perte de rentabilité économique à cause de l'aggravation de la mortalité ! Moins de malades, c'est moins de prix de journée versés et le spectre d'un plan de réduction du personnel qui se profile ! Il s'est bien démerdé : le préfet va lui faire envoyer un contingent de trois cents aliénés de l'hôpital de Pierrefeu, dans le Var, qu'il pourra faire crever de faim à leur tour."
A Saint-Alban, cent vingt-quatre malades sont mobilisés pour la culture des légumes et s'occuper de la volaille. Marché noir de proximité : les malades ne travaillent pas seulement pour être occupés, ils peuvent échanger ce qu'ils fabriquent avec les paysans - malgré trente lettres de dénonciation par jour à la gendarmerie - contre du lait, des ufs, du beurre, des saucisses quand il y en a. Ils cueillent des champignons, le pharmacien de Saint-Alban leur a appris à distinguer les comestibles. D'ailleurs, Bonnafé, expert, recommande de remplacer la culture de la pomme de terre par celle du chou, plus adaptée au climat. Mais expert aussi en tuberculose, il signe de nombreux faux certificats car on craint la contagion et la ration alimentaire des suspects est alors augmentée ! Le maire de Saint-Alban aussi signe des faux papiers établissant, par exemple, qu'untel, victime du travail obligatoire en Allemagne, est veuf et devra s'occuper seul de ses trois enfants : un accord entre Pétain et le Reich acceptait le retour dans ces conditions du prisonnier dans ses foyers. Devise de Bonnafé : la loi s'établit en marchant et en rencontrant les autres.
Très austère tout cela ? Ça n'empêche pourtant pas les jeux de séduction, les regards. Eluard à Denise : "Vous avez des yeux à rêver. Ils vous accompagnent dans la journée ?" Subversion des corps, Daeninckx : "C'est à ce moment que son regard [celui de Denise] rencontra celui de Nusch. Elle y lut une sorte d'invitation à venir la rejoindre alors que la jeune femme était nue, allongée sur un édredon, la hanche calée par un oreiller. Denise ne réalisa qu'une fraction de seconde plus tard [ ] qu'un autre corps se mêlait au sien." Nusch, femme libre, artiste de haute volée, qui se partagea plus tard entre Eluard et Picasso.
Jonathan Littell raconte dans Les Bienveillantes que, dans les camps de concentration, des corps cadavériques n'hésitaient pas à faire l'amour à travers les grillages. Punition : la mort. Fin de la poésie. D'ailleurs, pourquoi Forestier, si apprécié pour son art brut, était-il interné ? Il a provoqué le déraillement d'un train. Il voulait simplement voir l'acier des roues écraser des cailloux.
Inutile de remercier Daeninckx d'avoir, et avec quel talent ! ressuscité ce monde qui aurait totalement et définitivement disparu. Ce récit n'évoquerait que des choses aussi bizarres que celles rencontrées dans un phalanstère.
Notes :
(1) Daeninckx D. Caché dans la maison des fous. Paris : Editions Bruno Doucey ; 2015.
Houellebecq avec Comte : de la soumission mars 2015
Kantisme et psychologies prolongent la métaphysique car ils argumentent plutôt que d'observer. "Aie le courage de te servir de ton entendement, voilà la devise des Lumières." Responsabilité individuelle, raison, rationalité, liberté de conscience sont les maîtres-mots du kantisme. Il s'agit de dispositions naturelles. Contrainte au Droit, en surplomb de la politique, afin de civiliser le Mal, les passions négatives, l'envie, la jalousie, l'insociable sociabilité de l'Homme. Nécessité d'un Contrat social entre des individus devenus citoyens, émancipés, arrachés aux obscurs enracinements. Réalisation pratique : la Révolution Française. Puissant mouvement créateur des années 1830. Mais, selon Houellebecq, cela est faux : "Il suffit de rappeler la popularité persistante des théories du "contrat social" basées sur la fiction d'individus libres préexistants à la collectivité et sur la notion de "droits de l'homme" indépendants de tout devoir, qui en découle." [3] Tabula rasa impossible. Du côté des psychologies, c'est encore pire. Comte reléguait la "psychologie" du côté de la physiologie animale mais depuis sa mort, le ridicule aurait été atteint par le développement de ces "théories tenant tout bonnement pour acquise l'existence du "sujet", irréparable noumène dont le phénomène serait sans doute quelque chose comme le "moi"."[4] Mégalomanie narcissique de la croyance en la toute-puissance du moi sujet. Spinoza : les hommes se croient libres car ils ignorent les causes qui les déterminent.
Mais ne pas se méprendre sur l'âge positif scientifique. Il ne s'agit pas de scientisme, il est certes souhaité d'écarter préjugés et superstitions mais nous nous devons de renoncer à la recherche des causes, d'une causalité premières ; nous prenons seulement acte des lois effectives existant entre les choses observées par l'utilisation de la Raison. La connaissance, l'ordre positifs prendront naturellement, nécessairement, chronologiquement la place des illusoires connaissances et ordre métaphysiques. Les savants, et non les hommes politiques, constituent le nouveau clergé et il convient de gouverner les hommes selon la rationalité scientifique : "Des lois sont produites, elles permettent de modéliser les phénomènes et de prédire le résultat des expériences ; les entités ne sont pas multipliées au-delà du nécessaire : quoi d'autre ?" [5] Rien effectivement. Règne du déterminisme. "Pas plus que Dieu, la matière ne trouve grâce aux yeux de la pensée positive"[6] constate Houellebecq. Il y a de la science. Et elle évolue. Inutile de vouloir se raccrocher aux branches comme des cartésiens déboussolés par la physique de Newton, la mécanique quantique et autre relativité. Cartésien déboussolé : Freud. "Une illustration surprenante éclaire les contradictions de Freud devant le progrès, c'est son renâclement devant l'indétermination en physique moderne et même devant la théorie de la relativité. Pour lui, elles sont en opposition avec la science ! Il écrit, à propos de ces chercheurs : "La théorie de la relativité et de la physique moderne semble être montée à la tête de tels nihilistes intellectuels." Freud en déduit que cette conception est, en quelque sorte, "une contrepartie de l'anarchisme politique, peut-être une de ses émanations"." [7] Menaces contre l'Ordre du Monde, risque de chaos.
Alors que le vrai positif affiche son calme devant toute connaissance scientifique. Nous ne pouvons que subir la loi générale des connaissances humaines. Il faut s'y soumettre et la soumission, disait Charles Maurras, dans son texte d'admiration envers Comte[8], c'est la base du perfectionnement. Maurras, tout à son souci de l'Ordre - l'unité, pour lui, c'est la royauté, le nationalisme intégral - constate "qu'il n'y a point de liberté de conscience en astronomie, en physique, en chimie, en physiologie même en ce sens que chacun trouverait absurde de ne pas croire, en confiance, aux principes établis dans ces sciences par des hommes compétents." Notons : confiance nécessaire. La devise comtienne, Ordre et Progrès, se décline plutôt chez Maurras en Ordre et Equilibre. Equilibre qui se retrouverait plus facilement dans la dite culture paysanne. Giono : Un monde est contenu dans le simple fait de regarder. Camus : il y a l'Histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle. Soumission dit Houellebecq.
Les besoins humains doivent être satisfaits par la science. Et selon notre auteur, le besoin sexuel n'a cessé de croître au vingtième siècle. Le besoin spirituel persiste néanmoins, que comblait antan l'unicité catholique dont nous aurions tous la nostalgie. Comte : l'homme est un animal social. Maurras : "Ce qui pense en nous, avant nous, c'est le langage humain, qui est non notre uvre personnelle mais l'uvre de l'humanité. C'est la raison humaine [...], c'est la civilisation humaine dans laquelle un support personnel, si grand qu'il soit jamais, n'est qu'une molécule plus ou moins énergique dans la goutte d'eau ajoutée par nos contemporains au courant de ce vaste fleuve." Et si l'on considère que le contrat social entre citoyens éclairés, comme la démocratie, n'est qu'une ineptie, comment éviter la guerre de chacun contre tous, comment fonder le monde social ? Une seule réponse possible : la religion. Houellebecq : "Comte avait bien compris que la religion, sans cesser de s'intégrer à un système du monde acceptable par la raison, avait pour mission de relier les hommes et de régler leurs actes." [9] Comte se doit donc d'inventer une nouvelle religion : la religion positive. Maurras, athée, résout le problème en le confiant au catholicisme institué, immuable, ultramontain. Mais, ajoute Houellebecq, la religion comtienne a échoué car, si on exclut l'impensable mais absolue croyance en la résurrection des morts, il ne fait guère de doute que l'homme, en guise d'immortalité comme le propose Comte, ne se contentera pas d'une inscription post-mortem sur le calendrier du Grand-être. Fétiche dit Houellebecq. Car il y aurait "un désir d'immortalité inscrit en l'homme." [10]
Si le positivisme avait triomphé, toutes polémiques apaisées, tous affrontements disparus, le Un régnant, qui peut néanmoins s'intéresser, questionne Houellebecq "à une religion qui ne garantit pas de la mort ?"[11] Une seule perspective : ce n'est que par la technologie que l'on peut espérer l'immortalité physique. Ce qui promet encore, malgré les trans et les post humanistes, bien du mal-être et de l'insatisfaction : il faudra encore inventer une religion.
Comte, en 1822, propose son Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société et en 1855, l'Appel aux conservateurs. Si Maurras se veut réactionnaire, Houellebecq, comme Comte, n'est qu'un doux conservateur. Pour Comte, le positivisme prônait l'Ordre pour base, le Progrès comme but et l'amour comme principe. Manifestement la question du principe n'est pas résolue.
Notes :
Notes
1 Houellebecq M. "Préliminaires au positivisme." Préface de la Théorie générale de la religion ou Théorie positive de l'unité humaine. Auguste Comte. Paris : Editions Mille et une nuits ; 2005.
2 Houellebecq M. p 6.
3 Houellebecq M. Ibid. p 8.
4 Houellebecq M. Ibid. p 8.
5 Houellebecq M. Ibid. p 7.
6 Houellebecq M. Ibid. p 7.
7 Pragier S., Pragier G. Repenser la psychanalyse avec la science. Paris : PUF ; 2007. p 235-236.
8 Maurras C. "Auguste Comte, 19 janvier 1798-5 septembre 1857." Minerva, 15 mai 1903 ; n°6.
9 Houellebecq M. Ibid. p 12.
10 Houellebecq M. Ibid. p 12.
11 Houellebecq M. Ibid. p 13.
A propos de, <em>Les nouveaux rouges-bruns : Le racisme qui vient.</em> Editions Ligne (2014). de Jean-Loup Amselle.
M. Olender[3] rappelle que la race s'est voulue pendant plus d'un siècle "une réalité scientifique", devenue une construction mentale visant à enfermer l'Autre dans le non-humain, dans une animalité nuisible, à éradiquer. Nous serions piégés dans une race, dès avant la naissance, de toute éternité, sans pouvoir en changer et qui nous impose, au fer rouge, des phénotypes physiques (sang, odeur, crâne), psychiques, intellectuels et moraux. Véritable carte d'identité raciale. Les horreurs du nazisme rendent difficile, ce jour, l'usage du mot race - L. S. Senghor[4] n'hésite pourtant pas à le faire lorsqu'il défend la négritude, lui attribuant même des caractéristiques biologiques, sanguines, particulières - il lui sera préféré, désormais, celui d'ethnie. L'identité ethnique résulte de la perception par un groupe de son unité et de ses particularités du fait d'une origine, d'un langage, d'une religion, de mythes communs. Par extension, on invoque une identique identité culturelle.
Selon les tenants du culturalisme, du courant "culture et personnalité" : Ruth Benedict (1887-1948), Margaret Mead (1901-1978), Abram Kardiner (1891-1981), "la culture permet d'expliquer complètement les comportements humains en dehors de toute détermination biologique. L'esprit humain est alors perçu comme une page vierge sur lequel la culture imprime sa marque. [...] Dans une telle perspective les cultures sont relativement closes."[5] L'autre n'est plus qualifié d'animal mais de radicalement différent.
Amselle constate aussi que le culte de l'identité collective accompagne, douce berceuse, l'idéalisation des sociétés exotiques qui, tels les chasseurs-cueilleurs, étaient censées privilégier le don gratuit. Communautés primitives qui s'opposent à l'odieux cosmopolitisme.
Essentialisme : les Noirs, la négritude, les Juifs, les Asiatiques, les prolétaires, les femmes, les Blancs, les souchiens, les Français de francité, d'essence citoyenne comme d'autres qui naissent blonds avec les yeux bleus. Toutes ces communautés combattraient afin de se faire "reconnaître" par les autres, afin de posséder le droit à une mémoire propre. Exaltation de la différence. Au maximum coexistence des cultures mais extrême méfiance envers le métissage, surtout le biologique, l'horreur absolue, source de dégénérescence. Inquiétante étrangeté d'un concept comme celui d'émancipation qui voudrait libérer l'individu de tout lien qui entrave, de tout état de dépendance, de toute domination, de tout préjugé. Arrière l'humanisme bêlant, le culte du moi, du narcissisme ! Vive la diversité essentialisée et ses droits sacrés !
Lévi-Strauss, cet anthropologue du passé, coupable de théoriser la diversité culturelle, de solidifier ces cultures qui sont "une façon particulière de résoudre les problèmes, de mettre en perspective des valeurs qui sont approximativement les mêmes pour tous les hommes car tous les hommes sans exception possèdent un langage, des techniques, un art, des connaissances de type scientifique, des croyances religieuses, une organisation sociale, économique et politique."[6] Utilisation pour cela de "mille démarches conscientes et inconscientes [qui font pénétrer en nous] un système complexe de référence consistant en jugements de valeur, motivations, centres d'intérêt, y compris la vue réflexive que l'éducation nous impose du devenir historique de notre civilisation par laquelle celle-ci deviendrait impensable ou apparaîtrait en contradiction avec les conduites réelles."[7] Pire, dans Race et Culture (1971), vingt ans plus tard, il assénait qu'il n'est nullement coupable de placer une manière de vivre et de penser au-dessus de toutes les autres. L'incommunicabilité relative entre les cultures n'a rien de révoltant, il faut être un peu sourd aux autres valeurs. Lévi-Strauss redoutait l'impérialisme de l'universel. Pour d'autres, il s'agit ni plus ni moins que d'un éloge de la xénophobie justifiant la méfiance envers le métissage et les diasporas, véritables chevaux de Troie à l'intérieur des communautés (les Juifs), d'autant plus dangereuses qu'elles sont silencieuses et dissimulées.
Responsables donc, selon Amselle, de la paranoïa ambiante qui nous entraîne dans la spirale de la peur de l'autre, différent, tous les théoriciens de l'appartenance, de la suprématie du Nous sur le Je.
Rappelons, à grands jets, ce qu'il en est de la paranoïa. Pour Freud, dans Pulsions et destin des pulsions, le Moi plaisir originaire désire s'introjecter tout ce qui est bon et rejeter hors de lui tout ce qu'il considère comme mauvais, l'étranger devient le haï. Puis il sera question de pulsion de mort, de destructivité primitive secondairement projetée sur les objets extérieurs à savoir l'environnement maternel, la culture, la civilisation. La pulsion de mort aspire à la paix des cimetières. Pour Winnicott, l'infans ne sort du nirvana confusionnel qu'au prix de la haine de la mère frustrante, haine de cette mère dont il découvre qu'elle s'intéresse à d'autres personnes que lui. Deuil inévitable qui permet l'accession à la vie sociale. La culture prolonge le jeu transitionnel mère-infans, sujet-collectif et devient l'espace où se déploie la haine. J-A. Miller[8] estime d'ailleurs que l'amour ne vise que les apparences mais que la haine vise l'être : elle peut suppléer au trou béant de la psychose. La haine ou la folie... Pour les neuro-biologistes (Vincent, Damasio) ce sont l'acte-émotion, l'affect qui sont premiers, la cognition seconde. Mais le processus pathologique de la paranoïa n'est pas seulement celui de la personnalité du paranoïaque mais aussi celui de l'ensemble des interactions et des relations sociales du patient. La paranoïa serait donc la maladie sociale par excellence. C'est un mode de réaction à des situations vitales. Il existe des paranoïas dites sensitives qui éclosent sur des personnalités s'estimant non reconnues à leur juste valeur, timides, humiliées, silencieuses, jugées paranoïaques après des actes agressifs. Le raciste, le néo-raciste culturel recherchent un Ordre du monde, des cadres de références qui leur fournissent une grille de compréhension binaire du monde bon/mauvais. La recherche identitaire personnelle se solidifie dans une idéalisation - les idéalistes passionnés - de la race, de l'ethnie, de la culture, d'un collectif, d'une communauté qui procure un sentiment d'appartenance sécurisant qui définit les limites du sacrilège et de ce qui mérite le sacrifice et autorise la projection du négatif, de la haine sur l'Autre, le différent. Le raciste ne peut admettre la similitude de tous les hommes.
Pour les psychanalystes, impossible d'éviter la haine, le nous et le je. La vie psychique ne saurait se résumer à des déterminismes culturels ou socio-économiques mais de même elle constate l'inanité de la croyance en un moi narcissique tout-puissant. Françoise Dolto : "Faire de la psychanalyse, c'est être au service de gens qui vivent dans le même temps que moi, dans la même ethnie que moi, pour les écouter et les mettre en mesure de parler tout ce qu'ils peuvent dire par rapport à leur souffrance." "La théorie est utile pour un temps, pour des gens qui sont dans le même temps, le même espace, la même ethnie."[9]
Lacan, dans L'envers de la psychanalyse, le 18 février 1970, "Le Maître châtré" : "Très tôt après la dernière guerre - j'étais né depuis longtemps - j'ai pris en analyse trois personnes du haut pays du Togo, qui y avaient passé leur enfance. Or, je n'ai pu, dans leur analyse, avoir trace des usages et croyances tribaux, qu'ils n'avaient pas oubliés, qu'ils connaissaient, mais du point de vue de l'ethnographie. Il faut dire que tout était fait pour les en séparer, étant donné ce qu'ils étaient, ces courageux petits médecins qui essayaient de se faufiler dans la hiérarchie médicale de la métropole - nous étions encore au temps colonial. Ce qu'ils en connaissaient, donc du niveau de l'ethnographie, était à peu près celui du journalisme mais leur inconscient fonctionnait selon les bonnes règles de l'Oedipe. C'était l'inconscient qu'on leur avait vendu en même temps que les lois de la colonisation, forme exotique, régressive, du discours du maître, face au capitalisme qu'on appelle impérialisme. Leur inconscient n'était pas celui de leurs souvenirs d'enfance - ça se touchait - mais leur enfance était rétroactivement vécue dans nos catégories familiales - écrivez le mot comme je vous l'ai appris."[10]
Pas seulement responsables mais coupables les essentialisateurs : Dieudonné et ses Juifs, d'autres avec les islamistes, mais l'un des plus dangereux c'est J. C. Michéa car il communautarise le prolétariat, le vrai peuple autour de valeurs communes - ceci ne se fait pas, de décence - qui ne seront jamais celles de bourgeoisie, petite ou grande, elle aussi essentialisée. Populisme contre les élites... Il mérite le qualificatif rouge-brun, prolo à l'extérieur, brun tendance facistoïde délavée à l'intérieur. Michéa réplique que l'insulte hitléro-trotskyste lui dit quelque chose...
Dans le même opprobre : les évolutionnistes, car au même titre que les racistes à la Gobineau, ils évoquent des stades, des échelles, donc des différences. A. Comte, Freud, Taylor hiérarchisent, - contre Lévi-Strauss -, les cultures. Tout comme les colonialistes, tout comme Marx avec ses sociétés "asiatiques" hors-histoire, tout comme Sartre et les sociétés "rabougries" car sans écriture. Godelier abandonne le marxisme et prêche le sacré. Balandier essentialise le négro-africain en l'opposant à l'islam. Et que dire des diableries comme LGBT (Lesbienne-Gay-Bisexuel-Trans), CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires), CRIF (Conseil Représentatif des Israélites de France) sinon qu'il s'agit d'entités qui fixent une identité à chacune et chacun. Et elles créent, retour du bâton, de nouveaux blocs comme celui de l'antisémitisme à la Soral. A la limite, pour certains, la société ne se constitue que de tribus rivales, de sectes, de bandes, de zoos humains, avec leurs codes spécifiques qui fournissent un domicile, une identité à vie. Il suffit qu'un individu ait une goutte de sang noir, quelle que soit la couleur de sa peau, pour se voir épinglé dans la catégorie "Noir". Un Noir ne peut que produire de la musique noire.
Le contexte post-colonial favorise les revendications identitaires. Lois mémorielles qui interdisent toute polémique, qui sacralisent et sanctuarisent certaines communautés et favorisent ainsi la compétition victimaire : deux poids, deux mesures. Parallèlement s'installe la nostalgie de la vie néo-rurale, du village, (J-P. Le Goff) du "nous étions bien entre nous." Adotevi dans Négritude et négrologues a déjà jeté Senghor et sa négritude aux poubelles de l'histoire, "éructations obscènes d'intellectuels noirs qui ont la trouille de voir bouger le Nègre."[11] Césaire affirmait pourtant : "Nègre je suis, nègre je resterai." Contre la mort identitaire, E. Glissant a proposé, ce qui ne doit pas déplaire à Amselle, la créolisation du monde, le Tout Monde. Pensée sans origine, de l'errance, de la trace, d'une mondialisation globalisée, de la diversité, d'un partage des ancêtres, des imaginaires. Tout-relation, toutes collisions qui concassent l'Ordre du monde. Tout devient imprévisible, discontinu, aléatoire. Mais impossible, dit A. Ménil[12], de concevoir cette créolisation dans la plantation où seuls existent le maître et l'esclave. Le métis n'est que le symptôme honteux de la servilité, les femmes se sont couchées. Pas de Relation possible. Pap Ndiaye[13] renverra les métis à un rôle trouble de traîtres à la cause des Noirs dont se servaient les maîtres afin de maintenir l'ordre. Difficile d'échapper à l'essentialisation de la race. Dicale : "Mon père étant noir, ma grand-mère l'est redevenue à son tour. Elle était noire à reculons de la direction qu'avait prise sa propre mère, sa grand-mère et d'autres de ses ascendants. [...] Il y avait des gens pour poursuivre à ma génération le vieux combat de la race."[14] Et Amselle ne pourra que regretter les conclusions de Dicale : "Les métis [...] témoins et incarnations de l'érosion des appartenances ataviques [...] ils gêneront toujours plus ceux qui rêvent d'identités faciles à lire et de peuples bien rangés [...] Alors on tuera les Métis."[15] L'Autre, toujours l'étranger, l'ennemi, les ethnies, peuples et cultures différents. Ce qui s'oppose frontalement aux théoriciens "marxistes" pour qui il ne saurait être question de penser en dehors de la grille socio-économique et d'une analyse de classes et aux libéraux pour qui la liberté individuelle prime.
Et les adeptes du Nous, plus ou moins identitaires, font masse : les romantiques allemands avec Herder, B. Constant, E. Quinet, l'école de Francfort, N. Elias, O. Paz, I. Kertesz, M. Ozouf, Mbembé, Pap Ndiaye, L. G. Tin, les auteurs de Eloge de la créolité, mais aussi A. de Benoist et O. Mannoni, analyste qui a osé écrire que ce n'est pas n'importe quel peuple qui se laisse coloniser.
Avec ceux pour qui l'appartenance nationale n'est pas un mot creux : E. Renan, R. Debray, P. Nora, M. Gauchet, C. Guilluy, M. Sorel-Sutter, G. Zimra. Avec ceux qui tentent de relier l'appartenance collective et la liberté individuelle : le métissage en mosaïque de l'Amérique du Sud selon Laplantine et Nouss[16] : Blanc se disant africain ou un autre, catholique le jour, adepte du vaudou le soir.
Inflation de rouges-bruns. Daryush Shayegan, philosophe iranien dans La conscience métisse : "Le multiculturalisme tend à devenir une sorte de politique identitaire où le concept de culture se confond immanquablement avec l'identité ethnique, ce qui risque d'essentialiser l'idée de culture en surdéterminant ses distinctions."[17]
Faut-il suivre J-L. Amselle pour qui toute société est métisse, produit d'identités multiples, renvoyant aux calendes grecques l'idée d'une pureté originaire ? Le rhizome de Deleuze et Guattari plutôt que le fixisme. Et au cur même des libertés individuelles règne le principe de laïcité qui protège la libre pensée du citoyen, le droit de changer les normes, le droit à l'indifférence et qui récuse l'enracinement identitaire, communautaire qui submergerait l'identité citoyenne et serait contraire au principe de l'égalité. Hors de question d'inscrire dans la Constitution le Droit à la diversité, les droits des minorités invisibles. La différence n'est pas d'essence, de nature.
Mais pour beaucoup, le métissage généralisé, l'état universel, homogène, toutes les contradictions abolies, ayant placardisé Le choc des cultures de S. Huntington, ne seraient, in fine, que le véhicule de courtoisie de l'impérialisme américain, du mainstream, du triomphe du narcissisme individuel. Mais quand même : NIMBY, Not In My Back Yard : personne dans mon jardin. Retour du refoulé : la haine préexiste à l'amour.
Notes :
[1] Amselle J-L. Ibid. p 9.
[2] Amselle J-L. Ibid. p 90.
[3] Olender M. "La race comme mythe" Le Débat. Paris : Gallimard, novembre-décembre 2010 ; n°162, p 162-175.
[4] Senghor L. S. Ce que je crois. Paris : Grasset ; 1988, p 99.
[5] Meyran R., Rasplus V. Les pièges de l'identité culturelle. Paris : Berg International ; 2014, p 39.
[6] Lévi-Strauss C. Race et Histoire. Paris : Denoël, Folio Essais ; 2011, p 50.
[7] Lévi-Strauss C. Ibid. p 43-44.
[8] Miller J-A. "Le théâtre secret de la pulsion." Le Point. 22 mars 2012 ; p 46.
[9] Hess A. Les analystes parlent. Paris : Belfond ; 1985, p 100 et 106.
[10] Lacan J. "Le maître châtré." L'envers de la Psychanalyse. Le Séminaire livre XVII. Paris : Le Seuil ; 1991, p 104.
[11] Adotevi S. Négritude et négrologues. Paris : Union Générale d'Editions ; 1972, p 262.
[12] Ménil A. Les voies de la créolisation. Essai sur Edouard Glissant. Lille : De l'Incidence ; 2011.
[13] Pap Ndiaye. La condition noire. Essai sur une minorité française. Paris : Calmann-Levy ; 2008.
[14] Dicale B. Maudits Métis. Editions Lattès ; 2011, p 276-277.
[15] Dicale B. Ibid. p 276-277.
[16] Laplantine F., Nouss A. Le Métissage. Paris : Téraèdre ; 1977.
[17] Shayegan D. La conscience métisse. Paris : Albin Michel ; 2012, p 37.
De l'incarnation, du poids du corps - CIPA nov 2014.
Pourtant, persiste en France un créationnisme laïc, sécularisé lamarckien, qui refuse le non-finalisme biologique. Big bang, un être aquatique sommaire qui se complexifie, un poisson qui sort de l'eau, devient reptile puis dinosaure, bientôt abattu par un météorite, mais le singe se lève, regarde le ciel, devient bipède, sensible, manie l'outil, joue collectif, s'interroge sur le sens des choses, en particulier la mort, bref, l'animal s'humaniserait. L'échelle des êtres se transformerait en ascenseur. Homme qui inventerait, sur la voie de la civilisation, le Droit et les philosophies de l'Histoire afin de pacifier la sauvagerie.
Les êtres humains sont des êtres vivants parmi d'autres vivants. L'homme n'est pas une exception, il ne peut se définir par une dimension ontologique singulière, il n'est pas un élu parmi les vivants. En 1938, Freud, dans L'Abrégé de psychanalyse : "Si nous admettons que l'être vivant est venu après le non-vivant et a surgi de lui, la pulsion de mort concorde bien avec la formule [...] selon laquelle une pulsion tend au retour à l'état antérieur." "Tout être vivant meurt nécessairement par des causes internes."(2) La pulsion de mort tend à désintégrer l'organisme cellulaire.
Peut-on nier la dépendance radicale du social et du culturel par rapport au biologique ? J-M. Schaeffer, l'excellent auteur de La fin de l'exception humaine : pour qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait de la vie. Pas de vie, pas de culture. Mais toute vie est vouée à la mort, la culture peut-elle survivre à la mort des individus ? Il faut donc que les individus se reproduisent. La culture ne peut être une émancipation à l'égard du vivant, elle en est une modernité, spécifique et irréductible.
Ernst Haeckel (1834-1919), évolutionniste, lamarckien, moniste, matérialiste, antireligieux, pacifiste énonce sa fameuse loi de récapitulation, dite loi biogénétique fondamentale : l'ontogénèse, le développement embryonnaire, récapitule la phylogénèse, l'histoire évolutive de l'espèce.
Freud conjoint les positions, aujourd'hui obsolètes, de Lamarck et de Haeckel qu'il n'abandonnera jamais. Pour lui, le corps ne saurait être soumis à la folie du hasard. Lettre de Freud à Abraham(3) du 11/11/1917 : "Il s'agirait d'attirer Lamarck sur notre propre terrain et de montrer que le "besoin" qui, selon lui, crée et transforme les organismes n'est rien d'autre que le pouvoir des idées inconscientes sur le corps, dont nous voyons les vestiges dans l'hystérie ; en bref de montrer "la toute-puissance des pensées". Cela nous fournirait, en fait, une explication psychanalytique de l'adaptation : ce serait la clé de voûte de la psychanalyse."
A la fin de sa vie, Freud, dans le post-scriptum de La question de l'analyse laïque, jugeait que l'étude des lois de l'évolution devait s'intégrer dans le cursus de formation des analystes.
Le passage de la chose au mot, la prise en compte ou non de l'affect marquent la difficulté à penser le corps biologique, résultat de l'évolution.
Il y a de la représentation refoulée mais il convient aussi, avec Freud, de se pencher sur le destin de l'état affectif associé à la représentation refoulée. Mais qu'est-ce qu'un état affectif du point de vue dynamique ? Quelque chose de très compliqué, affirme Freud. Cela comprend "certaines sensations comme les sensations directes de plaisir et de déplaisir qui impriment à l'état affectif ce qu'on appelle le ton fondamental."(4) Ce qu'on nomme aussi humeur ou endogénéité. Les représentants psychiques des excitations issues du corps ne peuvent se métaboliser en pensées que "par l'intervention d'une médiation. Cette médiation, c'est la représentation", et de choses et de mots. Il faut évoquer un mouvement diachronique car l'objet est d'abord investi avant d'être perçu et halluciné sous forme d'objet partiel intériorisé. La perception du pré-objet correspond peut-être à une image mnésique, mais celle-ci n'a un sens que par rapport aux affects de plaisir et de déplaisir liés à la satisfaction des besoins. La distinction entre perception et sensation prend toute son importance puisque la chose se présente d'abord par l'intermédiaire de l'affect, donc de la sensation et ne pourra jamais être totalement figurable ni totalement dite dans un discours adéquat.
G. Rosolato(5) conçoit ce qu'il nomme les signifiants de démarcation comme les traits qui composent toute représentation, mentale ou objective, distincte du langage verbal. "Leur action se manifeste effectivement dans l'enfance dès le départ, à l'origine, à partir d'un éprouvé venant du corps, d'un affect, d'une perception, d'une relation entre le corps et l'objet."(6) Le langage est une addition de ces signifiants de démarcation et des signifiants digitaux, numériques, linguistiques. Piera Aulagnier : peu importe que le temps, - pendant lequel le processus originaire est le seul à pouvoir transformer les signes de la vie somatique en signes de la vie psychique -, ait une durée de trois heures ou de plusieurs semaines, son activité n'en persistera pas moins tout au long de notre existence. Pour François Gantheret : "Il n'y a symbolisation que lors de la rencontre entre une série associative et un ancrage dans une disposition organique ; que lorsque l'élément de réel organique est pris en charge dans un système signifiant."(7)
En 1954, Eugène Ionesco fait jouer Amédée ou comment s'en débarrasser. Entre Madeleine et Amédée il y a un cadavre mais qui ne cesse de grandir, atteint de la maladie incurable des morts : la progression géométrique. Une certaine psychanalyse a voulu se purger de toute référence à l'ordre biologique, en faisant allégeance au structuralisme et à son fer de lance : la linguistique qui, elle-même, ne jure que par l'idéal mathématique, à savoir "un type de discours sans quiproquo ni malentendu, un discours cohérent et contraignant pour l'autre, capable par sa forme même d'interdire le refus de son contenu"(8) André Lichnerowicz. La représentation ainsi proposée de l'homme est celle d'ensembles connectés et organisés, indépendants du contenu, vides de signification. La question du sens ne sera pas posée. Jakobson et Lévi-Strauss n'ont eu de cesse que de vouloir intégrer la linguistique dans les sciences de la nature : idéaux linguistique, biologique, mathématiques sont identiques.
Le symbolique "désigne un système de représentation fondé sur le langage qui détermine le sujet à son insu." E. Roudinesco, M. Plon(9). Le sens et la signification s'éloigneraient de toute visée psychanalytique.
Lacan s'interroge : "Pourquoi sommes-nous amenés à penser la vie en termes de mécanisme ? En quoi sommes-nous effectivement, en tant qu'hommes, parents de la machine ?"(10) J-J. Kress : "Cette parenté avec la machine est alors rapportée par Lacan à l'ordre symbolique propre à la machine autant qu'à l'homme en tant qu'il produit les mathématiques."(11) La machine à calculer serait plus libre que l'animal. Le monde symbolique c'est le monde de la machine.
Dans sa Lettre de dissolution de janvier 1980, Lacan assène : la stabilité de la religion vient de ce que le sens est toujours religieux, d'où mon obstination dans ma voie de mathèmes. Alain Badiou, dans son propre séminaire, Lacan. L'antiphilosophie 3 (1994-1995) commente : "Il est vrai qu'il y a de la part de la philosophie une opération sur la mathématique qui tend à la fois de la livrer au sens - d'en faire advenir le sens - et de l'articuler au doublet de la conscience et de la réalité."(12) Or la mathématique, selon Badiou, est soustraite au sens, elle est l'os de la vérité.
Derrida, dans son livre L'animal que donc je suis(13), commente Heidegger qui recherche l'essence de l'humanité de l'homme et l'essence de l'animalité de l'animal. Pour cela, question philosophique qui lui donne le vertige, il faudrait, dit-il, que la clarté soit faite sur la nature vivante du vivant, à priori caractérisé par la "possibilité de mourir." Heidegger affirme que l'animal ne meurt pas, il crève, il est pauvre, il éprouve la privation du monde - mais, note-t-il, il ne faut pas en déduire une hiérarchie entre l'humain et l'animal -. L'animal vivrait certes mais le Dasein humain serait autre, un existant. Mais, à d'autres moments, embarrassé, il écrit que l'animal meurt aussi. L'interrogation de Derrida porte sur ce que le Dasein humain devrait à l'animal. Question écartée, in fine, par Heidegger. Réponse différente de Nietzsche : tout "est pris dans un mouvement qu'on appellera ici du vivant, de la vie et de ce point de vue, quelle que soit la différence entre les animaux, cela [il s'agit de la recherche d'une différence ontologique] reste un rapport "animal"."(14) Et Derrida conclut son livre : "Voilà ! Cela suppose une réinterprétation radicale du vivant, naturellement, mais non pas en termes d'"essence du vivant", d'"essence de l'animal". C'est la question... L'enjeu, naturellement, je ne le cache pas, est tellement radical qu'il y va de la "différence ontologique", de la "question de l'être", de toute l'armature du discours heideggérien."(15) Pas moins !
Lacan affirme l'existence non pas d'une coupure somato/psychique qui séparerait le psychisme du corps mais d'une coupure épistémo/somatique. Il définit l'inconscient comme une forme de savoir qui agit directement sur le corps de l'être parlant. Il en arrive à douter, selon Eric Laurent, de "la possibilité même de l'écriture de la topologie du sujet sur le support anatomique du vivant. C'est le vivant qui viendra se prendre dans une écriture d'un ordre supérieur où il se retrouve morcelé, brisé."(16) "C'est le monde des mots qui crée le monde des choses"(17) confirme Lacan.
Nous serions passés du corps vivant au corps parlant, dépassant la perplexité anxiogène de Derrida.
Zenoni, psychanalyste, enseignant à Bruxelles, membre de l'Ecole de la Cause Freudienne, a commis, en 1991, un livre fort intéressant pour notre sujet : Le corps de l'être parlant(18) avec en sous-titre : De l'évolutionnisme à la psychanalyse.
Je le cite : "L'être du corps qui se déduit de la clinique n'est pas constitué de l'interaction d'une nature, faite de sexualité, d'agressivité, d'instinct d'autoconservation, et d'une culture (murs, codes sociaux, idéaux), mais d'une autre "nature", pour ainsi dire : une autre sexualité, une autre agressivité, une autre activité pulsionnelle que celle de l'être animal. Le concept d'interaction est trop court pour une appréhension de la clinique psychanalytique du corps. Il néglige l'abolition préalable du biologique comme plan pertinent de la causalité."(19) L'homme ne saurait être que déraciné du sol animal, de la sélection naturelle. Le corps biologique disparaît. C'est un "corps qui est homogène au symbole" qui est né. Et le symbolique s'incarne dans la chair qui précède le cerveau. Pour parfaire sa démonstration, Zenoni se fait anthropopaléontologue. Il affirme, dès la page 14, que toute la paléontologie se construit actuellement en dehors des théories darwiniennes. A la page 19, il note la réalisation en une fois de la structure de l'espèce humaine actuelle, soit son commencement absolu, son absence d'origine. Jamais il n'est possible de rencontrer de pré-humain. Rien de commun entre le singe et l'homme, profession de foi que ne renieraient pas les créationnistes religieux. L'essentialisme de l'être humain est proclamé.
Darwin a infligé à l'esprit humain une redoutable blessure : le cerveau, ordonnateur du sens, évolue. D'un strict point de vue scientifique les théories du formalisme logique - Hilbert dans les années trente - pour qui l'existence des objets mathématiques est extérieure au cerveau humain, ne rendraient pas compte des problématiques néo-darwiniennes. Le langage est aussi confronté aux lois évolutionnistes. Le cerveau n'est pas une machine simpliste, fixée tel un ordinateur une fois pour toutes, mais une machine vivante d'une extrême complexité douée de plasticité. Et la culture participe de ce procès adaptatif, devenue outil transgénérationnel. Poincaré contre Hilbert estimait que le fondement de la cognitivité résidait "dans le corps, dans ses mouvements, dans la perception, dans le fonctionnement du cerveau en action". Lévi-Strauss nous invite à réintégrer "la culture dans la nature."(20) Cela est, dit-il, même vrai des vérités mathématiques. Les énoncés de la mathématique reflètent au moins le fonctionnement libre de l'esprit, c'est-à-dire l'activité des cellules du cortex cérébral, relativement affranchies de toute contrainte extérieure et obéissant seulement à leurs lois propres.
En 1925, Freud se penche sur Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes(21). La mécanique lacanienne se met en branle, comme chacun sait, autour du pénis-phallus, de l'avoir ou pas. Lacan : "Ce signifiant [le phallus] est choisi comme le plus saillant de ce qu'on peut attraper dans le réel de la copulation sexuelle."(22)... Ou encore : "On peut dire aussi qu'il est, par sa turgidité, l'image du flux vital en tant qu'il passe dans la génération."(23) Le Phallus lacanien colle au pénis réel comme le scotch aux doigts du capitaine Haddock. Mais il est nécessaire de le placer au centre d'un ordre symbolique mathématique. Cet impérialisme du pénis-phallus et de sa métaphore Nom-du-Père permet de faire passer de curieuses assertions car déclin du Nom-du-Père et humiliation du père - avec un petit p - iraient de pair. Pour Melman(24), la sortie des repères du père patriarcal débouche sur le règne peccamineux de l'objet de jouissance, de l'objet (a). Si le père est traité comme un "bonhomme", un "rigolo", "un pauvre type", un "comique"(25) nous passons de la "névrose de papa"(26) à la perversion généralisée, ultime défense contre la "psychose sociale"(27). Première phrase de Sabine Prokhoris(28) dans son ouvrage Le sexe prescrit : "La psychanalyse serait-elle la gardienne de "la loi symbolique" ?" se complète à la page 145 par le jugement suivant : la psychanalyse "n'a pas hésité à servir de bonne à tout faire aux plus tenaces conservatismes" car elle a introduit "au cur du lien analytique, dans la modalité même de l'écoute, comme pour structurer celle-ci, un modèle de la relation entre les sexes qui construit celle-ci en "différencedessexes"."
L'Ordre Symbolique hors-temps a pris la succession des normes naturelles, traditionnelles et des normes religieuses instituées, ce que redoutait Lévi-Strauss dès 1954. Pour Judith Butler(29), papesse du mouvement queer, une anthropologie structurale qui prétendrait imposer des lois invariantes mathématiques qui transcenderaient l'Histoire n'est qu'une imposture : "Les arrangements sociaux soutiennent et maintiennent la structure symbolique."(30) Foucault : il ne convient pas de sacraliser le désir.
A l'école du symbolique, s'oppose celle de l'anthropologie philosophique : le corps extérieur à lui-même.
Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des disciplines empiriques qui s'intéressent à l'homme (biologie, paléontologie, primatologie, zoologie, neurosciences, histoire, médiologie, génétique et même la psychanalyse) et de fonder une anthropologie véritable afin de restituer les conditions d'émergence de l'humain au sein de la nature. Postulat : l'homme est un être lacunaire, déficient à tous points de vue, sans vraie prédétermination biologique, désadapté, dépourvu de milieu spécifique(31), condamné, selon Blumenberg (1920-1996), en guise de compensation, aux institutions et à la technique. La néoténie offre une forme de caution scientifique à l'hypothèse de l'être lacunaire, du manque originel. Pour Blumenberg, la vulnérabilité est à la fois biologique et sociale. L'homme vivant s'est mis debout : il doit voir venir et agir à distance mais il risque aussi d'être vu : il doit donc se défendre, prévenir : "Défaisant la prise directe au profit du jet, le jet au profit de l'indication manuelle, l'indication manuelle au profit de la désignation verbale et ultimement conceptuelle, l'homme aux abois met finalement hors-circuit son corps, au profit d'un rapport distant et représentationnel du milieu. Il joue le concept contre la manipulation, la vue intellectuelle contre la vue sensible, l'absent contre le présent, l'anticipation et la remémoration contre l'hic et nunc de l'urgence pratique."(32) Conformité avec ce que Freud écrivait dans Malaise dans la civilisation. Les expériences de pensée ne sont que des réassurances autoconservatrices.
Sloterdijk, philosophe allemand, issu de l'extrême-gauche, affirme que lire Foucault le nietzschéen c'est se faire arracher le cur par un couperet aztèque pour qui a été élevé dans la foi hégélienne, la nécessité de l'impératif catégorique, dans le happy-endisme de la philosophie de l'histoire, dans la croyance au Progrès par l'éducation et la politique. Il nous faudrait congédier le concept d'Homme, au profit de celui de Vie, de communauté des vivants.
Nous sommes inscrits dans l'évolution. Et l'humanisation présuppose un désir d'échapper à la sélection naturelle, d'où la nécessaire fabrication d'une couveuse, d'un utérus artificiel qui sécurise les hommes condamnés à la lutte permanente contre les invasions et les lésions ; d'où la rhétorique, la métaphore liées à l'indigence constitutive de l'être humain. C'est au langage qu'incombe la fonction d'assimiler l'inconnu au commun, au domestique, de construire une maison habitable. Hans Blumenberg : "La métaphore est anthropologiquement vraie en ceci qu'elle est une pratique concrète et quasi artisanale du manque et de la prévention, un art toujours risqué de la parade symbolique. Elle est une technique de soin. Elle console."(33) Pour conjurer la terreur, les traumatismes, les hommes ont inventé, métaphoriquement, par transposition, par transfiguration, des mécanismes comme la religion, les systèmes d'opinion.
Mais aussi, l'homme élabore une artificialité technique qui lui permet d'échapper à la régression animale. L'outil et la machine répondent aux besoins de l'utérus artificiel. L'intelligence se sédimente dans les objets fabriqués. Selon notre auteur, l'inconscient réside dans la technique, traduction d'un matérialisme supérieur.
Pour Sloterdijk, nous aurions trop insisté sur l'anthropologie et pas assez sur l'anthropogenèse. Dans sa célèbre conférence d'Elmau du 17 juillet 1999, Règles pour le parc humain : Une lettre en réponse à la Lettre sur l'humanisme de Heidegger(34), il affirme qu'il faut réformer les qualités de l'espèce humaine en s'appuyant sur les biotechnologies dont il ne faudrait pas avoir peur.
Aujourd'hui nous assistons à la technologisation généralisée et du corps et de la société. Le rapport NBIC de Rocco et Bainbridge, publié aux USA en 2002, avait promis la transformation de notre corps (NBIC pour Nanotechnologies, Biotechnologies, sciences de l'Information, sciences Cognitives). L'extension artificielle du cerveau est nécessaire afin non seulement de le réparer mais d'augmenter ses capacités, de réguler ses affects, d'obtenir selon l'expression de Dagognet "un accroissement de l'être." La matière prend possession de l'esprit. Alain Supiot : "Dans l'univers cybernétique de la régulation et de la gouvernance, les êtres humains n'agissent pas : ils rétroagissent aux signaux qu'ils reçoivent des systèmes d'information dans lesquels ils sont insérés."(35)
Naissance du cyborg (cybernetic organism) et autres hybrides corps-machines : Golem, avatars, chimères. La frontière entre l'humain et la machine n'existe plus. Le corps réel est digitalisé, fluidifié. Le virtuel, selon Alain Milon(36), aboutit à construire un réel aussi réel que le vivant. Nouvelle architecture-anatomie du corps : bits, gènes, atomes, neurones. David Le Breton évoque un homo-silicium. L'impasse sur le Manifeste Cyborg de Donna Haraway (2007) est impossible. Pour elle(37), la politique de Foucault "intensification du corps, [...] nouvelles techniques pour maximaliser la vie"(38), "technologie du sexe"(39), "dispositif de sexualité comme distribution nouvelle des plaisirs, des discours, des vérités et des pouvoirs"(40) n'est qu'une pâle prémonition de la politique cyborg. Nature et culture deviennent des mixtes. L'animal ne se sépare plus de l'humain. "Les cyborgs annoncent des accouplements fâcheusement et délicieusement forts. La bestialité obtient dans ce cycle d'échange marital, un nouveau statut."(41) Ni Femme, ni dipe, ni Primitif, ni Zéro, ni Stade du miroir, il convient, au contraire, d'être multiples, en réseaux, corps morcelés ou pas, avec profusion d'identités. Ne pas hésiter à devenir des monstres chimériques non représentables, non formalisables.
Au-delà de l'extension technique du corps, puis de son hybridation à la machine, les mouvements de dépassement de l'humain, de sa transformation tiennent le haut du pavé. Huxley, en 1950, fait surgir le concept de transhumanisme qui impose comme perspective l'éradication de la maladie et de la mort alors que le posthumaniste attend la fin de l'espèce humaine fatiguée et la naissance de la Singularité qui succèdera à l'humanité disparue. L'homme a entamé son propre procès : l'histoire, la finitude du corps, la mort le condamne.
Pour conclure, quelques grossières réflexions :
- L'affect n'est-il qu'un pelé, un galeux, un empêcheur de calculer en rond, la construction d'une métapsychologie exigeant la purge de toute folie, de toute passion ?
- Peut-on faire sortir la psychanalyse de l'Histoire, ses vérités devenues universelles, intemporelles ? Ce, à l'opposé d'une élaboration idéologique toujours ouverte ?
- Gisela Pankow invoque, certes, des structures symboliques fondamentales liées aux mathématiques qui apparaissent au sein du langage mais elles contiennent aussi, dit-elle, l'expérience première du corps, récusant tout dualisme. Ces structures sont détruites dans la psychose, déformées dans la névrose. La psychose impose une philosophie de la chair, de la douleur, une philosophie dans le boudoir : point de sens, point d'idées martelait Sade. Baudelaire, lecteur de Sade : "Le crime dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel."(42) Kristeva, dans les Pouvoirs de l'horreur(43), juge que le désir et les plaisirs de la vie ne proposent qu'une dénégation perverse de l'abjection originaire.
- Enfin, il nous faudrait abandonner le strict déterminisme linéaire de Freud pour un déterminisme chaotique, une causalité aléatoire qui prenne le hasard en compte. C'est le programme affiché par Sylvie Faure-Pragier et Georges Pragier dans Repenser la psychanalyse avec la science.(44) Pour eux, le hasard s'insinue dans les systèmes déterministes qui deviennent alors imprédictibles(45) "Pourrions-nous suivre, aujourd'hui, les scientifiques dans leur tolérance de l'indéterminé et de l'aléatoire ?"(46) "Indécidable, l'émergence du nouveau sous l'influence de l'aléatoire est devenu une métaphore stimulante du changement dans le processus analytique."(47) Nous sommes sur terre par hasard. Baudelaire, encore : le moderne c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. Nul n'a le droit, disait-il, de mépriser le présent.
Notes :
Notes
1 Psychiatre, psychanalyste.
2 Freud S. Cité par Laplanche J. et Pontalis J-B. "Pulsions de mort." Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : PUF ; 1973, p 377.
3 Sulloway F. J. Freud, biologiste de l'esprit. Paris : Fayard ; 1981, p 261.
4 Freud S. "L'angoisse." Introduction à la psychanalyse. Paris : Payot ; 1985, p 373.
5 Rosolato G. "Comment s'isolent les signifiants de démarcation." Penser l'originaire. Topique. Paris : Dunod, 1992 ; n°49, p 65.
6 Rosolato G. "Nos rencontres." Piera Aulagnier. Topique. Paris : L'Esprit du Temps, 2001 ; n°74, p 115.
7 Gantheret F. "Remarques sur la place et le statut du corps en psychanalyse." Nouvelle Revue de Psychanalyse. Paris : Gallimard, printemps 1971 ; n°3, p 142.
8 Lichnerowicz A. "Mathématiques et espaces de vérité." Paris : Le genre humain ; n°7-8, p 55.
9 Roudinesco E. Plon M. Dictionnaire de la psychanalyse. Paris: Fayard ; 1997, p 1041.
10 Lacan J. "L'univers symbolique." Le Séminaire. Livre II. Paris : Le Seuil ; 1978, p 43.
11 Kress J-J. "La mémoire entre mortification et histoire vivante du sujet." Revue de Neuropsychiatrie de l'Ouest. Rennes : 4ème trimestre 1997 ; n° 124, p 9.
12 Badiou A. Lacan. L'antiphilosophie 3 (1994-1995). Paris : Fayard ; 2013, p 121.
13 Derrida J. L'animal que donc je suis. Paris : Galilée ; 2006.
14 Derrida J. Ibid. p 219.
15 Derrida J. Ibid. p 219.
16 Laurent E. "Quelle inscription pour le sujet ?" Lost in Cognition. Psychanalyse et sciences cognitives. Nantes : Editions Cécile Defaut ; 2008, p 42.
17 Lacan J. "... ou pire." Le Séminaire XIX. Paris : Le Seuil ; 3 février 1972.
18 Zenoni A. Le corps de l'être parlant. De l'évolutionnisme à la psychanalyse. Bruxelles : De Boeck Université ; 1991.
19 Zenoni A. Ibid. p 74.
20 Lévi-Strauss C. La pensée sauvage. Agora. Paris : Plon ; 1962, p 294.
21 Freud S. "Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes." La vie sexuelle. Paris : P.U.F ; 1969, p 123-132.
22 Lacan J. "La signification du phallus." Ecrits. Paris : Seuil ; 1966, p 692.
23 Lacan J. Ibid. p 692.
24 Melman C. L'homme sans gravité. Paris : Denoël ; 2002.
25 Melman C. Ibid. p 152.
26 Melman C. Ibid. p 134.
27 Melman C. Ibid. p 120.
28 Prokhoris S. Le sexe prescrit. Paris : Aubier ; 2000.
29 Butler J. Défaire le genre. Paris : Editions Amsterdam ; 2006.
30 Butler J. Ibid. p 142.
31 Bimbenet E., Sommer C. "Les métaphores de l'humain." Le Débat. Paris : Gallimard, mai-août 2014 ; n°180, p 90.
32 Blumenberg H. Cité par Bimbenet E., Sommer C. Ibid. p 92.
33 Bimbenet E., Sommer C. Ibid. p 97.
34 Sloterdijk P. Règles pour le parc humain : Une lettre en réponse à la Lettre sur l'humanisme de Heidegger. Paris : Mille et une nuits ; 2000.
35 Supiot A. Cité par Musso P. "Le technocorps, symbole de la société technique." Technocorps, sous la direction de B. Munier. Paris : Editions François Bourin ; 2013, p 128.
36 Milon A. La réalité virtuelle. Avec ou sans le corps. Paris : Autrement ; 2005.
37 Dorlin E., Rodriguez E. Penser avec Donna Haraway. Paris : PUF ; 2012.
38 Foucault M. "Le dispositif de la sexualité." La volonté de savoir. Paris : Gallimard ; 1976, p 162.
39 Foucault M. Ibid. p 163.
40 Foucault M. Ibid. p 162.
41 Haraway D. Connexion art, réseaux, média. Paris : Ecole nationale des Beaux-arts ; 2002.
42 Baudelaire C. Le peintre dans la vie moderne. 1863 : Mille et une nuits ; Edition de 2010.
43 Kristeva J. Pouvoirs de l'horreur. Paris : Le Seuil ; 1982.
44 Faure-Pragier S., Pragier G. Repenser la psychanalyse avec la science. Paris : PUF ; 2007.
45 Faure-Pragier S., Pragier G. Ibid. p 242.
46 Faure-Pragier S., Pragier G. Ibid. p 83.
47 Faure-Pragier S., Pragier G. Ibid. p 245.
Bibliographie
BADIOU A. Lacan L'antiphilosophie 3 (1994-1995). Paris : Fayard ; 2013, p 121. (12).
BAUDELAIRE C. Le peintre dans la vie moderne. 1863 : Mille et une nuits ; Edition de 2010. (42).
BIMBENET E., SOMMER C. "Les métaphores de l'humain." Le Débat. Paris : Gallimard, mai-août 2014 ; n°180, p 90. (31, 33).
BLUMENBERG H. Cité par BIMBENET E., SOMMER C. Ibid. p 92. (32).
BUTLER J. Défaire le genre. Paris : Editions Amsterdam ; 2006. (29, 30).
DERRIDA J. L'animal que donc je suis. Paris : Galilée ; 2006. (13, 14, 15).
DORLIN E., RODRIGUEZ E. Penser avec Donna Haraway. Paris : PUF ; 2012. (37).
FAURE-PRAGIER S., PRAGIER G. Repenser la psychanalyse avec la science. Paris : PUF ; 2007. (44, 45, 46, 47).
FOUCAULT M. "Le dispositif de la sexualité." La volonté de savoir. Paris : Gallimard ; 1976, p 162. (38, 39, 40).
FREUD S. Cité par LAPLANCHE J et PONTALIS J-B. "Pulsions de mort." Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : PUF ; 1973, p 377. (2).
FREUD S. "L'angoisse". Introduction à la psychanalyse. Paris : Payot ; 1985, p 373. (4).
FREUD S. "Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes." La vie sexuelle. Paris : P U F ; 1969, p 123-132. (21).
GANTHERET F. "Remarques sur la place et le statut du corps en psychanalyse." Nouvelle Revue de Psychanalyse. Paris : Gallimard, printemps 1971 ; n°3, p 142. (7).
HARAWAY D. Connexion art, réseaux, média. Paris : Ecole nationale des Beaux-arts ; 2002. (41).
KRESS J-J. "La mémoire entre mortification et histoire vivante du sujet." Revue de Neuropsychiatrie de l'Ouest. Rennes : 4ème trimestre 1997 ; n° 124, p 9. (11).
KRISTEVA J. Pouvoirs de l'horreur. Paris : Le Seuil ; 1982. (43).
LACAN J. "L'univers symbolique." Le Séminaire. Livre II. Paris : Le Seuil ; 1978, p 43. (10).
LACAN J. "...ou pire." Le Séminaire XIX. Paris : Le Seuil ; 3 février 1972. (17).
LACAN J. "La signification du phallus." Ecrits. Paris : Seuil ; 1966, p 692. (22, 23).
LAURENT E "Quelle inscription pour le sujet ?" Lost in Cognition Psychanalyse et sciences cognitives. Nantes : Editions Cécile Defaut ; 2008, p 42. (16).
LEVI-STRAUSS C. La pensée sauvage. Agora Paris : Plon ; 1962, p 294. (20).
LICHNEROWICZ A. "Mathématiques et espaces de vérité." Paris : Le genre humain ; n°7-8, p 55. (8).
MELMAN C. L'homme sans gravité. Paris : Denoël ; 2002. (24, 25, 26, 27).
MILON A. La réalité virtuelle Avec ou sans le corps. Paris : Autrement ; 2005. (36).
PROKHORIS S. Le sexe prescrit. Paris : Aubier ; 2000. (28).
ROSOLATO G. "Comment s'isolent les signifiants de démarcation." Penser l'originaire. Topique. Paris : Dunod, 1992 ; n°49, p 65. (5).
ROSOLATO G. "Nos rencontres." Piera Aulagnier Topique Paris : L'Esprit du Temps. 2001 ; n°74, p 115. (6).
ROUDINESCO E. PLON M. Dictionnaire de la psychanalyse. Paris: Fayard ; 1997; p 1041. (9).
SLOTERDIJK P. Règles pour le parc humain : Une lettre en réponse à la Lettre sur l'humanisme de Heidegger. Paris : Mille et une nuits ; 2000. (34).
SULLOWAY F J. Freud, biologiste de l'esprit. Paris : Fayard ; 1981, p 261. (3).
SUPIOT A. Cité par MUSSO P. "Le technocorps, symbole de la société technique". Technocorps, sous la direction de B Munier. Paris : Editions François Bourin ; 2013, p 128. (35).
ZENONI A. Le corps de l'être parlant. De l'évolutionnisme à la psychanalyse. Bruxelles : De Boeck Université ; 1991. (18, 19).
A propos de <em>Souvenirs d'un autre</em> de Jacques Le Dem, Préface de Pierre Bergounioux Editions de l'Olivier
Et pourtant, il s'agit de la vie de Jacques Le Dem, psychanalyste sans enfance. Il s'agit de quelques épisodes choisis où il rencontre la Grande Histoire, celle qui fauche avant l'heure, dans laquelle nous sommes englués à notre insu. "Assemblage quelque peu hétéroclite et condensé, des bouts de souvenirs, des bribes de lecture et des découvertes."[1] C'est ce qui reste des "étrangers internés" à l'intérieur de nous. Découvertes, ruines et traces, mises à nu de fantômes, de secrets - cryptes à l'intérieur du Moi (Abraham et Torok) -. Fétu de paille à la surface du torrent ou sujet actif ? Ne resterait qu'une mélancolie, une nostalgie sourde de l'océan, de l'océan breton, de la mer. Jean Reverzy, cet autre médecin lyonnais, lui aussi écrivain magnifique et profond, décrit en conclusion de son livre Le Passage, la mort de Palabaud, son double. "L'agitation des humains, leurs projets, leurs travaux, leur gaîté, leurs peines sont de la folie en face de la mer. Palabaud tourna le dos à l'absurde et n'y pensa qu'en se redisant, de loin en loin, les mots qu'il aimait et qu'il confrontait. "Les hommes... la mer...""[2]
Mission accomplie : notre vie a suffisamment étincelé au firmament social, si, devenus morts, notre dépouille a été dirigée vers un musée. Certes, pas le Panthéon mais un musée discret, dans un cimetière ombragé, à minima une urne ou une plaque funéraire, nom, dates de naissance et de disparition, sculptées à la surface. Le musée, c'est fait pour voir mais ce serait figé, consacré, en dehors du bruit et des fureurs. Il impose postures et rituels. "Le musée ainsi invite au recueillement et à la sagesse des pensées plutôt qu'à leur inconvenance."[3] Jacques Le Dem, après combat, juge que le musée est un sas social de décontamination. Il y a donc eu pollution, risque d'envahissement, menaces. Et ce sont mémoires, souvenirs, flous de la pensée qui lardent le ciment civilisé qui ne tolère, lui, que l'oubli des faits ou alors le déplacement, la sublimation, ou même la transformation en son contraire : la défaite devient victoire. Ne pas hésiter à souffler la poussière sous le tapis. Jean Moulin et d'autres résistants ont été torturés dans des caves lyonnaises. Désormais, c'est l'Ecole militaire de médecine qui occupe les lieux et des fresques exotiques recouvrent les murs maculés de sang séché, le directeur de l'Ecole occupe le bureau du gestapiste en chef. Mais prière de ne rien voir. J. Le Dem, étudiant, ne savait rien. Médecin, notre auteur retourne sur ces lieux : il faut toujours être sourd et aveugle. Les lieux ont été muséifiés, au sens strict. Certes, persiste une plaque avec la devise de l'Ecole Pro patria et humanitate mais "un mur de béton ferme l'entrée du petit escalier qui conduit aux caves. [...] L'accès ici n'est pas interdit, il est barré."[4] J. Le Dem à la jeune hôtesse du musée - chapeau de Jean Moulin, photos du Maréchal, Chant des Partisans - : ""Savez-vous où tout cela s'est réellement passé ? Où se trouvent les caves ?" Non, elle ne sait pas. Elle semble un peu méfiante, comme si la question était inconvenante."[5] Le musée est une machine à accommoder.
Mais les bibliothèques ne peuvent-elles pas, aussi, destin terrible, devenir des musées ? Convenables les archives de la mairie d'Audierne, terre natale de l'auteur, qui ne gardent aucune trace, rien de rien, de l'existence, été 1940, d'un camp de "prisonniers" allemands, autrichiens, esprits éclairés, antinazis, peut-être même juifs, identifiés dans un premier temps par la population locale à une cinquième colonne espionne, placés par la bonne IIIe République, sous la garde d'un vrai gradé français. Ambivalent, incertain, ce dernier, lors de l'envahissement du réduit breton par les vrais nazis, leur livrera ces vrais amis de la France. Destination : les camps de la mort. Après la guerre, à la place du camp, une conserverie de poissons et un lycée Jean Moulin. Enquête rapide près des voisins les plus âgés : il y a eu un camp ici, mais de réfugiés espagnols. "Un responsable à qui il est demandé pourquoi il n'est pas fait état du camp d'internement dans l'histoire du pays répond qu'il ne saurait en être question car ce n'est pas une belle histoire et qu'il ne convient pas d'en parler."[6] Il est nécessaire que tout soit présentable, ordonné, l'idéal c'est l'algorithme.
Jacques Le Dem ne se prive pas de coups de patte destinés aux fidèles du tout organisé : "Plozévet où, quelques années plus tard, une enquête célèbre d'Edgar Morin, qu'accompagnait une armée de sociologues parisiens, devait faire crouler de rire tout le pays bigouden et les habitants, heurtés d'avoir été pris pour des sauvages... Par dérision, les questionnaires des "chercheurs" seraient remplis dans le sens attendu."[7] Toujours les BNP ou PNB. BNP : Bretons Nés Ploucs. PNB : Ploucs Naturellement Bretons. Inconvenants : le baroque, le grotesque - Voltaire détestait pour cela le théâtre de Shakespeare. Ainsi ce colonel qui portait des talons hauts, qui, en pleine guerre d'Algérie, afin de soutenir le moral des troupes, chantait des chansons "d'un abominable style guimauve en s'accompagnant de la mandoline."[8]
Il y a du pulsionnel, de l'inconscient. Et c'est la mémoire qui transforme en une histoire narrative et normativée les éléments aléatoires, contingents que nous vivons. Ce qui permet de se coltiner le présent et d'imaginer l'avenir. Se souvenir, dit J-C. Ameisen[9], c'est reconnaître et reconnaître c'est répondre différemment la deuxième fois que la première ! Source du nouveau. La première fois, les yeux ouverts, on n'avait rien vu ; la deuxième, celle du souvenir, on respire l'air, l'ambiance de la première fois et nous reconstruisons, après coup, ce que l'on ne pouvait voir. Vérité toujours trahie, déguisement, voilement, devoir de mémoire ?
Le vivre ensemble impose convenances et oublis. Pour Nietzsche, pour qui il n'y a pas de fait mais seulement des interprétations, la mémoire ne serait que dettes, sentiments de faute, de culpabilité, source de ruminations religieuses, balivernes qui entravent la marche vers la Très Grande Santé. Vérité trahie ? plutôt un pacte de mémoire instable, pas glorieux, qui nous fait contourner, suspendre le passé. Souvenirs écrans. Ce qui n'empêche pas les cadavres de sortir, la nuit, des tombes et placards. Impossibilité de tout refouler, de se fabriquer un Moi rutilant, structuré, accordé aux idéaux d'une société elle-même proprette, débarrassée de toute souillure, de toute odeur malséante. Le Christ a-t-il un derrière se demande Sergueï, l'"Enfant aux loups", exemple choisi par J. Le Dem. Pourquoi la honte et le rouge au visage nous saisissent-ils alors que nous sommes seuls ou que nous craignons quelques flatulences en public ? Pourquoi ces bafouillements, ces mots insanes, cette langue qui fourche comme on dit chez nous ? Se retrouver dévoilé, nu, débandant : inconvenance. Freud "accepte de s'égarer dans les rues chaudes de Rome plutôt que de rester confiné davantage dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens en compagnie de Moïse et des Tables de la Loi."[10] Et Dahut, la fille du roi Gradlon est punie car saisie par la débauche.
Plusieurs points de suture possibles entre cet inconscient sauvage et le conscient : l'esthétisme, l'admiration. L'esthétisme qui fait supporter la vision de l'autopsie. Jeu de miroir, il s'agit de l'autopsie de Palabaud, double de Jean Reverzy qui, dans Le Passage, jugeait que le "geste de celui qui tenait le coutelas était beau de rectitude et de précision."[11] J. Le Dem : "La beauté plastique de la "leçon d'anatomie" transcende le réalisme violent de la scène. La compulsion à voir ne sera jamais satisfaite ?"[12] Admiration ! Jacques Le Dem aime la littérature. A la fois ça ouvre sur l'inconvenance et ça suture. Les Contes libertins de la Fontaine plutôt que les Fables ; L'Homme sans qualités de Robert Musil qui ne se rappelle pas les mots mais l'air dans lequel ils ont été prononcés ; Boris Vian, J-P. Abraham, Jean Moulin le très séducteur sous-préfet de Châteaulin qui lit Corbière, rencontre Saint-Pol-Roux et Max Jacob, cet enfant de Quimper, mystique, ami de Picasso, mort en déportation à Drancy ; le père de Marcel Proust, Adrien Proust, professeur en épidémiologie qui déplorait la pauvreté et le manque d'hygiène des marins bretons ; André Breton, persuadé que L'Amour fou peut mener au crime - sur la plage du Pouldu les cris de la personne assassinée se font entendre se mêlant au vent - ; Victor Segalen qui cultive le divers et aurait apprécié le titre de l'ouvrage Souvenirs d'un autre. Pour Jacques Le Dem, comme pour les psychanalystes, la rêverie est une nécessité personnelle, elle étaie le métier.
Deux auteurs éclairent violemment le non-convenu, la transgression : Franz Fanon, psychiatre, militant politique, aperçu en Algérie, qui apporte le correctif de l'expérience bon enfant du colonialisme vécu par Jacques Le Dem - risque toujours d'avoir les yeux ouverts sans rien voir - et Jean Reverzy, déjà cité, brillant médecin, écrivain tardif, obligé en 1940 de démissionner de ses fonctions d'interne pour attitude non conforme. Résistant, médecin-chef de maquis puis médecin de quartier et qui, comme Segalen, éprouvera le besoin de placer ses pas dans ceux de Gauguin en Polynésie. "Il a connu la tristesse des tropiques mais aussi la beauté incandescente des femmes et la splendeur du Pacifique."[13] La lecture de Le Passage et de la Place des Angoisses de Reverzy peut bouleverser, j'en témoigne, quelques destins.
Ne laissons pas de côté les ombres glorieuses des professionnels de la psy rencontrés, aimés, parfois détestés. Freud en premier bien sûr, Soma Morgenstern qui fit éclater l'histoire du camp d'Audierne, Pichon gendre de Janet, Hesnard, Lafargue, si ambigu dans sa relation avec le national-socialisme, Fanon, Lacan, Bion, Appeau, Missenard, Resnik, Rosenfeld.
Le dernier chapitre du livre est une vibrante déclaration d'amitié pour le Docteur Ramon, forte tête, aventurier courageux, téméraire, bègue, qui voulait à tout prix, y compris en fautant, quitter l'armée pour devenir pédiatre, qui, analysé, découvre que son père est un père adoptif et qu'il est lui, luthérien, le fils d'un prêtre "missionnaire", un papiste ! Jacques Le Dem, comme Ramon, ne dédaigne pas l'impertinence antibourgeoise, anticléricale, rabelaisienne. Hôtel-Dieu, "ni Ramon ni moi ne pouvions alors imaginer que, toujours dans ces lieux, devait mourir, en 1994, Moana Pozzi, une actrice du cinéma pornographique qui avait eu une liaison torride avec l'archevêque Emmanuel Milingo."[14] Torride est une appréciation de Jacques Le Dem qui poursuit : "Etrange alliance à l'Hôtel-Dieu, non plus du trône et de l'autel mais de l'autel, du sexe et de la mort."[15] Impertinence : la visite à l'hôpital était annoncée par la sonnerie d'une cloche qu'agitait la sur-mère qu'on appelait Ma Mère ou mieux Ma révérende Mère. En tête de la procession, le patron, avec à ses côtés une élève infirmière roulant un fauteuil pour que le maître puisse s'asseoir lors de ses démonstrations cliniques ! Reverzy n'a strictement rien inventé en décrivant Joberton de Belleville dans Le Passage.
Nous manquerions un point exquis du livre de J. Le Dem si, emportés par le contenu, nous laissions de côté le style d'écriture. J. Le Dem est un styliste, un authentique écrivain. Et, de ce point de vue, cette écriture ne peut être considérée comme une clôture, une fermeture des analyses qu'il pratique. C'est un au-delà, comme les textes de J-B. Pontalis. Souvenirs d'un autre. Cet autre, l'enfant, l'adolescent, l'analyste dessillé, l'inconvenant qui brise le convenant, c'est Jacques Le Dem face au lecteur.
Notes :
[1] Le Dem J. Souvenirs d'un autre. Paris : Éditions de l'Olivier ; 2014, p 31.
[2] Reverzy J. Le Passage. Paris : Flammarion ; 1977, p 168.
[3] Le Dem J. Ibid. p 50.
[4] Le Dem J. Ibid. p 49.
[5] Le Dem J. Ibid. p 49.
[6] Le Dem J. Ibid. p 28.
[7] Le Dem J. Ibid. p 59-60.
[8] Le Dem J. Ibid. p 60.
[9] Ameisen J-C. La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice. Paris : Le Seuil ; 1999, p 38.
[10] Le Dem J. Ibid. p 50.
[11] Reverzy J. Ibid. p 164.
[12] Le Dem J. Ibid. p 42.
[13] Le Dem J. Ibid. p 40.
[14] Le Dem J. Ibid. p 83.
[15] Le Dem J. Ibid. p 83.
A propos de<em> La Faculté</em> Pièce de Christophe Honoré / Mise en scène d'Eric Vigner
Le 28 juin 1969, les clients d'un bar homo, le Stonewall Inn, résistent à la charge de police qui voulait faire respecter l'interdiction faite aux hommes de s'habiller en femmes et vice-versa. La marche des fiertés (L.G.B.T.I., Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels, Intersexuels), la Gay Pride commémore cet évènement. Désormais les homosexuels s'autodénomment gays. Dans les années 80 surgit l'épidémie du SIDA. En 1996, Bourdieu, Derrida, Eribon plaident dans Le Nouvel Observateur pour "une reconnaissance légale du couple homosexuel." La même année le parlement européen demande que l'on en finisse avec les discriminations envers les homosexuels. En 1999, en France, lois sur le P.A.C.S. et celles associant homophobie et racisme. Au droit à l'indifférence succède désormais l'exigence de nouveaux droits citoyens. La revendication de l'égalité des sexualités efface le petit secret honteux d'autrefois, le placard. A part quelques psy cacochymes, personne n'ose plus poser une équivalence entre perversion et homosexualité. Mais les combats pour l'égalité des citoyens- quelles que soient leurs croyances, leurs pratiques sexuelles -, la tolérance, la compassion suffisent-ils dès lors que l'on constate que nous sommes confrontés à une véritable (r)évolution anthropologique ? Contraception, avortement, droit des femmes, droit des enfants et maintenant le mariage de deux personnes du même sexe, avec droit à l'adoption, à la procréation médicalement assistée ! A accepter comme un progrès des droits démocratiques et égalitaires.
Or, jusqu'ici régnait l'Ordre du Monde. Françoise Héritier : "Il m'apparaît que c'est l'observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute pensée, aussi bien traditionnelle que scientifique... il s'agit là du butoir ultime de la pensée sur lequel est fondée une opposition conceptuelle essentielle : celle qui oppose l'identique au différent."(2) Jusqu'ici le cadet homme était toujours supérieur à l'aînée féminine. Les parents précédaient les enfants et c'était les femmes qui donnaient naissance aux enfants. Jusqu'ici le mariage au-delà du droit, du juge, du curé, ou du pouvoir politique était comme l'affirme le professeur Malaurie "un engagement pour créer la vie, pour les enfants qui en naîtront, le fondement d'une famille. Si vous retirez de ce modèle son essence, la différence des sexes et la constitution de la famille, il n'y a plus de modèle, le mariage est mort."(3) Françoise Héritier constate qu'il n'y a pas de sociétés connues qui reconnaissent l'existence d'unions homosexuelles de même valeur que les unions hétérosexuelles. Et c'est tout cet édifice institutionnel millénaire, éternel que le mouvement homosexuel ébranlerait ! Les sociétés seraient hétérocentrées et l'évidence des normes doit céder la place à une interrogation sur le processus qui aboutit à ces normes. Sylviane Agacinski : "Si l'ordre humain, social, et symbolique, donne aux individus une filiation double, mâle et femelle, ce n'est pas en raison des sentiments qui peuvent lier les parents entre eux, des désirs qui les animent, des plaisirs qu'ils se donnent, c'est en raison de la condition sexuée de l'existence humaine et de l'hétérogénéité de toute génération dont la culture a jusqu'ici voulu garder le modèle."(4)
Et il y aurait à discuter du statut conceptuel de l'homosexuel : Michel Foucault avait constaté que le pouvoir s'imposait moins par la répression sexuelle que par la classification et donc la hiérarchisation des pratiques sexuelles suivant des critères hétéronormés, ci-dessus exposés. Ce sont les gays qui doivent se réapproprier la "gaytitude". Il ne s'agit plus de rendre la société plus accueillante aux homosexuels mais d'utiliser leur position marginale, à la lisière, singulière, pour subvertir le discours dominant, faire passer l'hétérosexualité de sa position universelle à une position que l'on doit interroger au même titre que les autres, et à l'inverse faire passer l'homosexualité à une position de sujet parlant aussi légitime que les autres. Foucault voulait utiliser les assignations auxquelles on fixait les homosexuels pour imaginer, faire vivre de nouvelles socialités, de nouveaux plaisirs - laissons de côté la tunique de Nessus du sadomasochisme -. Le gay ne doit donc pas s'assimiler, il doit promouvoir un nouveau style d'existence. Valeurs homosexuelles propres, portes ouvertes à la communauté de ceux qui partagent les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes idoles. Tel est le "nouveau" auquel doit se confronter l'hétérosexuel "normal". Tocqueville constatait qu'aux U.S.A. "le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être des esclaves, et que l'inégalité se grave dans les murs à mesure qu'elle s'efface dans les lois."(5) Même conclusion pour Louis Dumont étudiant les castes en Inde : nécessité universelle de différenciation hiérarchique sociale : "Supprimez les modes anciens de distinction, et vous avez l'idéologie raciste."(6) Or l'homophobie serait un racisme. Formulation anthropologique de Norbert Elias (7) : l'ordre des choses se fissure quand un groupe socialement inférieur exige l'égalité sociale, légale, humaine ; le ressentiment surgit alors dans le groupe qui se considère comme naturellement supérieur : le statut social supérieur est constitutif du sentiment que l'individu a de sa propre valeur et de sa fierté personnelle.
Tout cela dit, comment s'étonner de la violence des réactions des hétérosexuels, des pères, des familles, angoissés devant leur Ordre du Monde déclinant ? Ne pas s'étonner que les éducateurs se soient sentis les premiers concernés... Savoir que Rimbaud était homosexuel est-il nécessaire à la bonne compréhension de la poésie ?
Mais il est vrai qu'un écrivain, un artiste ne maîtrise jamais la réception de son uvre. La mise en scène d'une tragédie grecque, et La Faculté peut se concevoir ainsi, pourra, par certains, oublieux de la poésie de la langue dramatique proposée, être vécue, à l'insu des auteurs, comme une provocation. Pourtant, cette Faculté nous paraît répondre à la mission d'éveil et aux exigences esthétiques que nous sommes, tous, en droit d'attendre d'un authentique Centre Dramatique.
Notes :
(1) Le Dorze A. La politisation de l'ordre sexuel. L'Harmattan, 2008.
(2)Héritier F. Masculin-féminin, la pensée de la différence. Paris : Odile Jacob ; 1996, p 19-20.
(3)Malaurie P. "Mariages homosexuels et homoparentalité" Commentaire Paris : Plon, hiver 2006-2007 ; n°116, p 993-999.
(4)Agacinski S. Le Monde. 22 juin 2007, p 20.
(5)Tocqueville A. De la démocratie en Amérique. Paris : Gallimard, folio histoire ; Edition de 1986, Tome I, p 503.
(6)Dumont L. Homohiérarchicus, essai sur le système des castes. Paris : Gallimard ; 1966, p 320.
(7)Elias N., cité par Zawadzki. Racisme, Dictionnaire de la violence. Paris : PUF ; Quadrige ; 2011, p 1083.
L'Addiction ou la mort avant l'heure Neurodon - le 15/11/2012
Le mot addiction s'origine dans le bas latin signifiant abandonné à. En bas latin juridique : obligation d'un débiteur, non solvable autrement, à rembourser sa dette par son travail. Donc contrainte par le corps. Définition du servage. Mais peu à peu il en vient à désigner les passions dévorantes et leurs conséquences comportementales souvent moralement répréhensibles. Passions non contrôlables qui nous font sortir de notre Moi social, qui peuvent nous ruiner.
Le concept général d'addiction est théorisé par le psychiatre Aviel Goodman en 1990 qui définit l'addiction comme un processus par lequel un comportement, qui peut fonctionner à la fois pour produire un plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est utilisé sous un mode caractérisé par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement (impuissance) et la persistance de ce comportement en dépit de conséquences négatives significatives (défaut de gestion). Addiction : il s'agit de produire du plaisir, - plus on a de plaisir, plus on en veut, -de soulager la douleur mais on échoue à contrôler ce comportement qui devient négatif, qui persiste en dépit de tout.
Dans le DSM IV qui est un mode, discutable mais internationalement utilisé, de classification des maladies mentales, le concept d'addiction n'existe pas. Il ne reconnaît que celui de dépendance. La dépendance implique que l'on dépende d'un tout : nous ne sommes pas autonomes, nous ne maîtrisons pas les choses. Il se dit dans le langage quotidien : ça dépend des circonstances, évidemment si cela ne dépendait que de moi... Nous subissons l'autorité, l'administration, l'emprise, la coupe, le joug, l'influence d'un tiers. Le terme dépendance, selon Rey, se conjugue avec asservissement, assujettissement, chaîne, esclavage, obédience, obéissance, servitude, soumission, subordination, suggestion, vassalité. Ça n'a pas bonne presse la dépendance ! Ça fait veule, pleutre, calamiteux, irresponsable, infantile, indigne, honteux.
Définition princeps de l'addiction selon le Dictionnaire culturel en langue française d'Alain Rey :
- situation de dépendance entraînant une conduite compulsive (c'est plus fort que moi) de nature pathologique et l'aliénation de la liberté de choix. Par extension, comportement compulsif dû à un besoin, à une habitude non contrôlée,
- mais aussi l'état d'une personne infirme, malade, qui ne peut accomplir, sans aide, les tâches normales de la vie quotidienne.
Selon J-J. Rousseau il y a deux sortes de dépendance :
- celle des choses qui est de la nature,
- celle des hommes qui est de la société.
Vieille histoire que d'opposer nature et culture... Qui dit nature dit le vital, le donné, le déjà là, le ce à quoi on ne peut pas échapper, l'endogène, le génétique, le besoin, le biologique, l'animalité, le rappel aux lois darwiniennes de l'évolution qui ne font que conjuguer hasard et nécessité. Pour beaucoup l'homme est une exception dans le monde des vivants. Certes on veut bien concéder qu'il est un animal mais il serait aussi autre chose, il serait unique. Or avec J.-M. Schaeffer(1), l'auteur de La fin de l'exception humaine : il faut affirmer que les clivages nature-culture, corps-âme, animalité-spiritualité, besoin-désir n'existent pas : la culture, l'âme, l'esprit, le désir font parties intégrantes de la nature, du corps, de notre animalité. Qui dit société des hommes dit culture, liberté, Eros, désir, création, jeu avec la nature que l'on manipule, que l'on maîtrise pour notre plaisir. Au contraire de ce que nous avons dit de l'addiction et de la dépendance : échec du contrôle du comportement et persistance du comportement négatif.
Freud a utilisé un autre concept, celui de pulsion qui s'enracine dans le biologique, le destin des pulsions dessinant la culture. Le besoin est, nous l'avons dit, du côté de la nature mais il est aussi concerné par des exigences de la vie sociale. Il existe des exigences sociales tellement prégnantes (tu ne tueras point, tu ne coucheras pas avec ta mère...) qu'elles en deviennent naturelles : on n'y échappe pas, de la même manière qu'on n'échappe pas à ce qui est inscrit dans notre cerveau avant notre naissance.
C'est ainsi qu'un besoin comme la faim entraîne la nécessité de se nourrir, la sublimation culturelle de cet acte devient gastronomie et sa perversion addictive le couple infernal anorexie/boulimie. La soif s'apaise par le boire, sa sublimation donne l'nologie et sa perversion addictive l'alcoolisme. Le besoin sexuel sublimé devient l'art érotique, au risque de la frénésie sexuelle et du SIDA, voire de l'addiction aux violences sexuelles. Le terme d'addiction sexuelle, de dépendance sexuelle a d'ailleurs été introduit dans les années 1970 par un membre des alcooliques anonymes. Il y a des ratés dans la réponse sociale, culturelle aux besoins. Nous pouvons fumer mais certains deviendront toxico du tabac. Nous pourrons, pour un court laps de temps, utiliser une benzodiazépine afin de lutter contre l'insomnie mais certains, devenus pharmacodépendants, écumeront cabinets médicaux et pharmacies pour s'en faire délivrer. Il est possible de jouer, c'est ainsi que nous affichons nos désirs, mais d'autres deviennent addicts à certains jeux pratiqués de manière répétitive : casino, tiercé, pronostics, jeux en ligne ou même simples grattages, avides de la décharge d'adrénaline provoquée par ces pratiques. Il est loisible d'utiliser Internet mais certains y passent leurs jours et leurs nuits au détriment de toute autre activité, avec bien sûr une mention spéciale pour la pornographie virtuelle. Nous pouvons nous faire plaisir en achetant quelques objets mais certains ne se sentent bien qu'en achetant compulsivement, y compris et surtout le non-nécessaire. Certains travaillent huit heures par jour mais d'autres sont des alcooliques du travail. Nous pouvons faire du sport pour nous entretenir, mais d'aucuns éprouvent la nécessité impérieuse de se "tuer" physiquement, tous les jours. En ne parlons pas des accros au risque, les toxicos du vertige, du défi : du parapente au saut en parachute ou saut dans le vide. Et il faut sans doute évoquer des personnalités addictives chez qui la recherche de la satisfaction ne saurait se passer d'un objet extérieur, d'une action compulsive : on passe d'une addiction à une autre. Absence de contrôle et nécessaire répétition. Il faut insister sur les bases neurobiologiques de ces comportements addictifs à symptomatologie sociale, culturelle.
Médicalement la dépendance est un état pathologique dans lequel l'organisme ne peut fonctionner physiologiquement sans la consommation d'une certaine substance ; il faut dépenser beaucoup d'énergie pour parvenir à l'abstinence et beaucoup d'efforts pour s'en procurer. Cette dépendance se traduit par l'accoutumance : nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet, la répétition de la consommation malgré les inconvénients et par un syndrome de sevrage en cas d'arrêt du produit toxique.
- Dépendance physique qui peut impliquer, en cas de manque, des troubles physiques graves. D'où l'accoutumance, les rechutes.
- Dépendance psychologique, soit un désir persistant de consommer, ce qui peut entraîner des troubles psychosomatiques comme des douleurs, mais sans vrai syndrome de sevrage physique. C'est le cas des addictions, des dépendances sans produit comme le jeu, le travail...
La dépendance est le résultat de la rencontre d'un produit, d'un comportement et d'une personnalité. Le manque est un état temporaire où le sujet ressent un vide sidéral qui ne peut être comblé que par le produit ou le comportement addictogène. On parle de craving (désir insatiable) lorsqu'après une période d'abstinence il faut compulsivement reproduire, répéter le comportement addictogène.
Freud parle de compulsion de répétition, synonyme pour lui de pulsion de mort. La compulsion c'est l'impossibilité de ne pas accomplir un acte. La compulsion de répétition est un processus incoercible, irrépressible, "démoniaque" dit Freud, d'origine inconsciente, par lequel le sujet se place activement dans des situations pénibles. Ce qui définit le masochisme, présent dans toutes les addictions, les formes de dépendance. La pulsion de mort - Thanatos - existe chez tous, depuis la naissance. La vie n'est qu'une intrication, un mélange de pulsions de vie - Eros - culturelles et de pulsions de mort, endogènes, de nature biologique qui tendent à la résolution complète des tensions, à leur assouvissement, à la paix comateuse, la paix des cimetières, à la non nécessité de penser, à l'inertie - principe de Nirvana - "Surtout que le velours noir de la bienfaisante amnésie ne s'ouvre pas" susurre J.-P. Dufreigne, l'auteur de Boire(2).Cette pulsion mortifère, ce travail insidieux de la mort, cette négativité dans l'humain, est une autodestruction qui secondairement peut se diriger contre le monde extérieur, la civilisation, la culture sous forme de pulsion d'agression de l'autre, de haine. On peut en déduire qu'il existe des comportements d'agression afin d'éviter l'autodestruction et des comportements autodestructifs afin d'éviter l'agression. C'est ce qu'on appelle alors la désintrication des pulsions. Spéculations direz-vous ! Purs aprioris, idéologies ! Mais des biologistes actuels, aussi renommés que J.-C. Ameisen, l'auteur de La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, définit la vie comme la répression de la mort avant l'heure. Pulsion de mort d'abord. On ne peut parler d'addiction si le négatif de l'humain, le mortifère ne rôdent pas.
Pour Freud, le bonheur résulte d'une satisfaction soudaine, brutale de besoins ayant atteint une haute tension. La joie, affirme-t-il, de satisfaire un instinct sauvage, la décharge orgastique est plus intense que celle d'assouvir un instinct dompté. Instinct, besoin, nous sommes dans le domaine de la biologie, du naturel. Or la civilisation, pour nous protéger contre la nature dangereuse, contre nos instincts potentiellement dangereux, et pour réglementer les relations des hommes entre eux, nous demande de sacrifier nos pulsions instinctuelles agressives. Ce surmoi collectif de la communauté civilisée n'a que faire du bonheur individuel : "L'homme civilisé fait l'échange d'une part de bonheur possible contre une part de sécurité."(3) Autrement dit, plus nous construisons une vie sécurisée, - principe de précaution, risque zéro -, alors que d'autre part la pression sociale nous demande de devenir de plus en plus performants, que le niveau de stress s'élève, plus il est difficile de satisfaire des instincts demeurés sauvages ; les addictions sont-elles symptômes du malaise dans notre civilisation ?
Freud ajoute, toujours optimiste, qu'il est moins difficile de faire l'expérience du malheur que celle du bonheur. Il convient d'éviter la souffrance plutôt que de rechercher la jouissance. Plusieurs voies possibles :
- Tenter de tuer les instincts en acquérant la sagesse en adoptant principes bouddhistes, méditation et yoga au minimum.
- Se sublimer dans l'art, le culte du beau ou dans le travail intellectuel, scientifique. Ce qui est loin d'être possible pour tous.
- Le retrait du monde, l'appel du désert au risque de l'ennui.
- Ou encore l'amour, censé nous consoler de notre vallée de larmes. Nous pouvons être passionnément addicté à une personne qui doit totalement répondre à nos attentes. Ce qui ne peut qu'entraîner déception, fureur et agressivité. La lune de miel se transforme en lune de fiel. Lacan : l'amour c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
- Ou la névrose, le suicide.
Mais malgré tout cela, l'indépendance par rapport au corps, au monde extérieur reste relative.
- Persiste la possible adhésion-dissolution dans le groupe, la secte, la tribu, la religion, transcendantale ou laïcisée. Ce qui définit les sociétés que Louis Dumont appelle les sociétés holistes, communautaires où le tout l'emporte sur le un, sur l'individu, qui, en soi, n'existe que comme membre du tout dont il est dépendant. Les sujets y sont liés par des croyances communes. Il existe un manuel de savoir vivre qui répond aux interrogations des membres de la communauté. Le malheur est attribué à un Autre, extérieur à la communauté. L'appartenance devient synonyme d'illusion, de ce que certains nomment servitude volontaire mais il faut noter que l'appartenance à une communauté qui partage les mêmes idéaux, les mêmes idées, les mêmes idoles, est une voie empruntée, souvent avec succès, par les personnes voulant échapper à leur addiction (groupes d'anciens buveurs, les sex-addicts anonymes, etc.). Car l'appartenance communautaire leur permet de surmonter la honte, la culpabilité ressenties, l'impression d'être, d'avoir été un vilain petit canard.
- Dernière stratégie repérée par Freud : le recours aux toxiques. Il n'y a pas de sociétés sans "briseurs de soucis". S. De Beauvoir dans La cérémonie des adieux, s'interroge : pourquoi Sartre, malade, souffrant d'artérite, s'entête-t-il néanmoins à boire et à fumer ? Revenu de Rome, Sartre zézaie car il a consommé dans le wagon-restaurant deux demi-bouteilles de vin : "Je me suis demandée pourquoi, dès qu'il le pouvait, il abusait ainsi de l'alcool. "C'est agréable" me disait-il."(4) C'est ainsi que Fernando Pessoa(5), cet immense poète du XXe s., voulait lutter, par l'alcool, contre "l'obscénité" qu'il ressentait en lui-même, qui le torturait, le soumettait à "une terrible muscularité" car il était, disait-il, "définitivement fatigué et assoiffé." Jouant avec lui-même il adressait à sa fiancée une photo qui le représentait au comptoir d'un estaminet avec ce commentaire : Fernando Pessoa surpris en flagrant délitre. Les hommes, de tous temps, ont été fascinés par les états de conscience qui leur permettent d'échapper à eux-mêmes, de ressentir, de percevoir au-delà des normes habituelles. Les drogues, le jeûne, certaines techniques corporelles permettent le dialogue avec les dieux, l'accession à un autre monde, une extase réservée aux initiés. Au risque du bad trip. Les artistes sont friands, de Michaux à Kerouac, de Bukovski à Jim Morrison, de ces expériences qui étendent leurs champs de travail. Et il est tentant, surtout à l'adolescence, de s'identifier à ces modèles transgressifs.
Si nous consommons des toxiques, adoptons des comportements à risque, nous jouons, comme Pessoa, dangereusement, avec la mort, attirés par le nirvana éternel, mais, au fond, persuadés magiquement que nous dominons et notre corps et le monde extérieur. Mélange de pulsion de mort et de pulsion de vie. Conduites qu'Aimé Charles-Nicolas et Marc Valleur(6) qualifient de conduites ordaliques. A l'opposé d'une vie longue et sans histoire, il faut chercher le plaisir sans frein - culte de Dionysos - y compris et surtout lorsqu'il y a risque. Les situations extrêmes sont souhaitées et recherchées.
Une politique de santé publique, basée sur les statistiques, met l'accent sur les dommages subis (maladies, handicaps, décès), la prévention, le moindre mal (distribution gratuite de seringues, produits de substitution, salles d'injection...) et les modifications à obtenir des conduites à risque (la route, le tabac). A savoir la sécurité. Mais il y aura toujours individuellement des irréductibles, des récidivistes. Les comportements ordaliques sont semblables au jugement de Dieu du Moyen-âge (jugement par les épreuves du feu, de l'eau). En principe il s'agit d'une épreuve dont l'issue n'est pas prévisible. Mais la soumission au destin n'est que partielle : la personne est persuadée, comme nous l'avons dit, qu'elle maîtrise l'épreuve, que la prise du risque est calculée. Comme le suppose la pratique de la "défonce", du "binge drinking" de la biture expresse, de la consommation frénétique, de la cuite alcoolique, avec éventuellement recours à d'autres toxiques, la plus rapide, la plus méga possible. Ceci concerne surtout les adolescents de 12 à 16 ans. Il s'agit d'ivresses intentionnelles, organisées : "sessions picoles" du jeudi ou samedi soir, qui se doivent d'être visibles, dans la rue versus exhibitionniste : se mettre minable, vomir en public, montrer ses seins, ses fesses ou comportements sexuels plus explicites. Le sujet doit transgresser. Il s'agit de repousser les limites, de montrer que l'on est capable de consommer autant qu'un autre, rituel d'affirmation virile pour les garçons. Addiction sinon à l'alcool, du moins au risque : on peut prendre goût à la sensation d'ivresse. Des rites superstitieux donnent l'illusion du contrôle. L'addiction vidéo permet de tuer, de torturer, de mourir : rien n'est irréversible dans la vie virtuelle, dans le monde des avatars qui peut faire de nous un héros.
Il existe, dans ces conduites addictives, une stimulation de la dopamine qui procure un frisson hors du commun, une décharge d'adrénaline. Les comportements addictifs "ont pour caractéristique (affirme Bernard Brusset, psychanalyste) de comporter une dimension biologique, métabolique et neuro-chimique inductrice de sensations corporelles et psychiques singulières"(7) qui appelle la référence à la pulsion de mort. Ce qui devrait inviter, face à ces problématiques, les analystes, à beaucoup d'humilité. Retenons que la recherche de sensations est inscrite dans la biologie. En effet, des biologistes comme A. Damasio ou J.-D. Vincent s'accordent pour affirmer la primauté du ressenti, du pathos. Il existe un tissage permanent entre les sensations et la pensée, organes des sens et intellect, langage. Ce dernier ne prend sens, dans le développement de l'enfant que par rapport aux affects de plaisirs et de déplaisirs liés à la satisfaction des besoins les plus primaires, les plus archaïques. L'investissement affectif précède les structures langagières, sociales. Pour Damasio, la raison de sang froid, le pur cognitif si coupés des émotions, ne peuvent suffire à faire des choix. Le cerveau émotionnel - le lobe frontal - est indispensable au fonctionnement normal de la rationalité, de la pensée. Ce qui est en question, c'est le sentiment que nous avons de notre identité, de notre infracassable noyau de nuit, suivant l'expression d'André Breton, le lieu de notre intime subjectivité, de l'incandescence extatique au risque de la douleur, - Malraux affirmait que chaque homme ressemblait à sa douleur. - Lorsque les affects disparaissent ou s'emballent la relation aux autres se distord, notre noyau de nuit se fracasse.
Et c'est inéluctablement par la mère ou plutôt par l'environnement maternel-familial que passent, que sont métabolisés ces affects à l'origine de folies passionnelles, de ce qu'on appelle en psychiatrie l'humeur. L'un des auteurs les plus éclairants, à mon avis, sur ce sujet, c'est Winnicott. Avec son concept d'espace transitionnel. L'humain, dit Freud, est un animal néotène incapable de survivre seul, et ce pendant un certain temps sans l'étayage d'un environnement maternel dont il est dépendant. Conséquence : tout objet qui remplace la vie utérine, synonyme de vie nirvanesque, sans problème aucun, a une valeur énormément augmentée. Cet objet est celui de l'addiction. Le suicide c'est le fantasme du retour à cette vie utérine, océanique. Mais aussi le néotène, c'est à dire nous, constate D.-R. Dufour, l'auteur de Lettres sur la nature humaine à l'usage des survivants, "a vocation à l'assujettissement à un sujet dominant. Il veut du maître."(8) Ce qui est à la base de la dépendance, de la servitude volontaire masochiste, expression de la pulsion de mort, de l'amour que nous portons au Grand Inquisiteur, au tyran, au chef, au gourou, à l'hypnotiseur. Sécurité d'abord ! La sécurité, le sentiment le plus archaïque, le plus primitif de l'humain jugeait Freud... Mais notons aussi que le masochisme révèle les attraits érotiques des jeux de pouvoir. Scandaleux constat pour la bienpensance : la soumission n'est pas toujours involontaire ! Léo Bersani : "L'exercice du pouvoir est source de jouissance ; il peut être tout aussi jouissif pour la victime que pour l'oppresseur."(9) L'addiction à un maître serait-elle inéluctable ?
L'aire transitionnelle à partir selon François Perrier, l'auteur de L'alcool au singulier. L'eau-de-feu et la libido "de ce qui est d'abord amour de la mère et ordre du regard porté sur l'enfant,"(10) n'appartient ni au bébé ni à la mère mais aux deux. C'est un espace dans lequel on ne peut pas dire : "Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi." C'est un espace de socialisation, de sublimation, de jeu, qui est à l'articulation d'un désir purement individuel, celui de l'enfant qui dit "je veux", et du désir de la mère, plus ou moins renforcé ou contredit par celui du père, de la société, de la tradition, et qui dit : "ceci est possible, ceci n'est pas possible, je te frustre pour telle raison." A partir de désirs strictement individuels, un enfant qui veut tout et n'importe quoi doit devenir un être collectivisable, social. Nous avons affaire à un processus dynamique. Comme le dit Winnicott, un nourrisson en tant que tel, ça n'existe pas, il n'existe que par son environnement maternel. Winnicott ajoute : l'objet qui existe dans l'espace transitionnel, l'as-tu créé, l'as-tu trouvé ? Eh bien cette question ne devrait pas être posée : l'objet est à la fois créé et trouvé. Il est créé car il appartient en propre à la subjectivité de l'enfant mais il est aussi trouvé car il était déjà déposé par la mère. Et c'est cet environnement qui progressivement doit désillusionner l'enfant convaincu d'avoir créé le monde. D'où la haine de l'enfant envers cet environnement. Sublimation nécessaire des pulsions sexuelles, des pulsions destructrices, propres de l'enfant en valeurs sociales, partageables collectivement.
Ceci s'échelonne sur toute la vie car ce qui prolonge l'espace transitionnel avec sa dimension de jeu, c'est notre environnement culturel (théâtre, littérature, créations, rêveries, mais aussi tricot, jeu de boules, pêche à la ligne et fête au village...). Un environnement maternel suffisamment bon, selon l'expression de Winnicott, procurera à l'enfant un sentiment suffisant de sécurité, de confiance en soi, une assise narcissique, gardienne de la vie, d'une grande stabilité.
Si ce processus transitionnel de séparation ne s'effectue pas correctement, nous sommes confrontés à deux possibilités. La subjectivité absolue de l'enfant l'emporte, cet enfant restera "sauvage" exprimant librement des pulsions perverses polymorphes, persuadé qu'il est le maître du monde puisque ce monde à découvrir, qui aurait dû lui être présenté par la mère, est dénié : il ne peut rien introjecter ; ou bien le désir de la mère, en tant que représentante de la tradition sociale, écrase le désir de l'enfant qui n'a droit à aucune subjectivité, c'est l'incorporation obligatoire, il n'y a pas d'espace pour le jeu. Un dysfonctionnement dans la dynamique de cet espace est un facteur prédisposant aux addictions. Toute addiction est une manifestation narcissique, masturbatoire dit Freud pour qui la masturbation est le comportement addictif primitif, dont les multiples équivalences traduisent l'échec dans la construction de la relation à l'autre.
Mais il ne s'agit pas de diaboliser les mères qui, à tout coup, seraient jugées non suffisamment bonnes. Le cerveau du nourrisson n'est pas vierge : l'agressivité, la pulsion de mort, la biologie préexistent. L'environnement maternel est à l'articulation de la nature et de la culture. La fonction paternelle, toute entière du coté de la culture, se doit de participer à ce travail de détachement, d'élaboration. Et ce qui est demandé aux mères par la civilisation serait de plus en plus difficile, voire insurmontable mais incontournable pour intégrer la Loi et au-delà pour échapper à la mort avant l'heure.
Notes :
1)Schaeffer J.-M. La fin de l'exception humaine. Paris : Gallimard ; 2007.
2)Dufreigne J-P. Boire. Paris : Grasset ; 1996, p 185.
3)Freud S. Malaise dans la civilisation. PUF ; 1971 ; p 69.
4)De Beauvoir S. La cérémonie des adieux. Paris : Gallimard ; 1981, p 50.
5)Pessoa F. Pessoa en personne : Lettres et documents choisis par José Blanco. Paris : Editions de la différence ; 1986.
6)Charles-Nicolas A., Valleur M., "Les conduites ordaliques" in Olievenstein. C. La vie du toxicomane. Paris : PUF ; 1982.
7)Brusset B. "Dépendance addictive et dépendance affective" Addiction et dépendance. Revue Française de Psychanalyse. Paris : PUF, mai 2004 ; Tome LXVIII, p 412-419.
8)Dufour D.-R. Lettres sur la nature humaine à l'usage des survivants. Paris : Calmann-Levy ; 1999. p 60.
9)Bersani L. Homos. Repenser l'identité. Paris : Odile Jacob ; 1998, p 110.
10)Perrier F. La chaussée d'Antin. Paris: U.G.E.; 1978, Tome II, p 204.
Le médecin trompé ou comment ce qu'il sait dépend de ce qu'il est.
Les choses sont relativement claires lorsque le médecin juge qu'il existe d'évidentes tentatives de manipulation de la part des patients. Ceci afin d'obtenir un avantage sonnant et trébuchant : arrêts de travail, certificats divers, accident du travail ou pas, nécessité de telle prescription médicamenteuse ou pas, cure thermale ou pas, etc. Le médecin peut estimer que le patient ment, triche, exagère, dissimule, sous-estime, mais bien formé, adossé à son savoir, à son code déontologique, à son éthique il saura faire face et évaluer ce type de situations. Mais tout est-il si simple ?
- "Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu avait faits." Il dit à la femme :
- "Alors, Dieu a dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?" La femme répondit au serpent :
- "Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort." Le serpent répliqua à la femme :
- "Pas du tout ! vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal." (1)
L'arbre de la connaissance permet d'affirmer : ceci est bien, ceci est mal, valeurs du tout sociétal, de la communauté, de la culture qui nous irrigue. Et le Serpent est le grand Séducteur, le grand manipulateur qui nous détourne de l'innocence paradisiaque, celui qui réussit à nous faire croire que la transgression, le péché, permettent un supplément de plaisir. Le séducteur est celui qui influence habilement l'individu ou un groupe pour le faire penser et agir comme il le souhaite en vue d'en retirer des avantages. Il n'utilise pas le raisonnement, la démonstration scientifique mais ses manuvres d'emprise, de persuasion, instrumentalisent, convoquent l'émotion, l'affectif, la sensibilité, la passion, toutes catégories le plus souvent qualifiées de féminines mais qui colorient aussi des expressions comme prestige, charisme. Donc, l'amour : la tendresse, la compassion, l'empathie, la joie mais aussi la haine et ses compagnes : la hargne, l'agressivité, la violence, la mauvaise humeur, au mieux l'indifférence.
Le Serpent, ce grand Communicateur saura nous convaincre, que nous avons besoin pour vivre mieux, pour jouir de la vie, de libérer nos affects coincés, nos conflits refoulés, nos pulsions sexuelles, fussent-elles teintées, mais cela en est encore meilleur, de zestes de malignité. Mystère humain : un sujet risque, lors d'une rencontre avec un autre, séducteur ou manipulateur, de découvrir par le truchement de cet autre une jouissance nouvelle à lui-même inconnue. Le séduit, le manipulé, c'est le médecin qui succombe au charme du patient-Serpent. C'est ce que la Bible appelle sans doute la Chute.
*
**
I
Ce patient-serpent réussit à provoquer une identification à sa propre personnalité, à son histoire, à sa sexualité, à ses fantasmes, à ses présupposés idéologiques. Nous devenons cet autre, nous abolissons les différences, nous nous retranchons sur ce qu'il y a de commun entre lui et nous, nous devenons complices : le patient communiste ne saurait être soigné que par un médecin communiste, les patientes hystériques par des médecins apollons, les ultra féministes par un médecin femme, les patients musulmans par un médecin musulman, l'accroc au football par un médecin président du club local de football, le patient de gauche par un médecin de gauche, etc. Ce patient réussit, en convoquant, à l'insu du médecin, un ou plusieurs points qui leur seraient communs, à créer ce que Freud appelle une foule à deux, semblable à un couple d'amoureux, qui obéit à la logique affective décrite plus haut et non à la Raison. Ce couple partage un idéal, une croyance commune. Régis Debray : "L'agir-ensemble repose par nature sur un croire et jamais sur un savoir partagé, c'est malheureux mais c'est ainsi." (2) René Kaës emboîte idées, idéal et idole. Résultat garanti : le professionnalisme du médecin s'efface derrière ce qu'il affiche comme étendards identitaires de sa personnalité sociale et de ce qui se devine comme éléments de son noyau dur intime. C'est la personnalité entière du médecin, sociale, familiale, conjugale, professionnelle, catholique, bouffeur de curés, cycliste, Fauchon ou Leader Price, amateur de cigares, talons aiguilles ou pas, bibliophile, échangiste, amateur d'opéra, cuisinier(e), cinéphile, baba-cool... etc. qui nourrira le cannibalisme d'un patient scénariste et metteur en scène du jeu médical.
Evoquons aussi ces patient(e)s qui veulent convaincre le soignant que rien ne vaut le vécu, la libération énergétique sensuelle, sexuelle. Ils ne se savent pas adeptes de Wilhelm Reich pour qui seul l'orgasme comptait. Mystique du corps contre la maniaquerie de la réflexion. La nature humaine est bonne, seuls l'environnement, la culture rendent l'homme malade. Rousseauisme tout proche. Patients qui écartent, parfois violemment, toute grille de lecture scientifique de leurs symptômes. Analyses biologiques ou radios inutiles ! Sexualité triomphante, sport intensif, régime avec légumes et fruits frais, omégas 3, ni tabac ni alcool. Militants d'une certaine écologie renforcés par la découverte sur Internet d'autres adeptes qui pensent comme eux. Il est vrai que pour Bruno Latour le principe de précaution est un principe de vigilance éminemment scientifique mais "à condition de définir la Science par l'enquête collective et non par la Raison avec un grand R." (3) A la limite, ces patients souhaiteraient se passer du médecin si celui-ci n'était incontournable du fait, et seulement de ce fait, de sa fonction sociale : distribution d'arrêts de travail, certificats divers. La fonction thérapeutique du médecin est volontiers ignorée, voire méprisée. Proximité des patients, férus d'Internet, qui exigent du praticien tel médicament, telle prescription. Droit à l'ordonnance, consumérisme médical. Le médecin impuissant en est réduit à une fonction d'officier de santé chargé d'administrer des formulaires administratifs.
Tous les dérèglements sont explicables par le traumatisme qui atteint l'écosystème dont l'homme fait partie. Il doit exister nécessairement une causalité extérieure. La référence répétée à la réalité sociale, économique, supprime le fantasme, l'imaginaire et réduit la vie psychique à une néo-traumatologie : harcèlement, abus en tous genres, surtout infantiles dont il faut absolument se souvenir y compris en les construisant.
II
Ferenczi définit ainsi la suggestion : "Introduction volontaire de sensations, sentiments, pensées et décisions dans l'univers mental d'un autre, et cela de telle manière que la personne influencée ne puisse corriger ou modifier de sa propre initiative les pensées et les sentiments suggérés." (4) Stratégies de haut vol. La personne séduite n'y voit que du feu, fascinée qu'elle est par les promesses du séducteur. Elle est inconsciente, victime de son inconscient. Chertok se montre plus incisif : "La suggestion ou l'influence suggestive est un processus corporel-affectif, une entité psycho-socio-biologique indissociable agissant à un niveau inconscient très archaïque, bien en-deçà du transfert, médiatisant l'influence d'un individu sur un autre, et capable de produire des changements psychologiques et physiologiques manifestes." (5) F. Roustang (6) distingue ainsi deux types de transfert. Un transfert immédiat, source de télépathie, de transmission de pensées vécues comme corps étrangers dans la tête de l'analyste, du médecin ou du patient, qui provoque, comme Freud l'avait constaté, la démesure, l'excès, la déformation et fait surgir, dès lors, du primitif, de l'archaïque, de l'infantile, de l'érotique et un transfert médiat où l'analyste-médecin est, idéalement, un Autre, un tenant-lieu. Le médiat, les références scientifiques doivent dissoudre l'immédiat, l'infra-verbal, les inquiétantes étrangetés que Freud attribue à la fréquentation de notre double, formation des temps psychiques primitifs. Les médecins qui manipulent le corps seront immédiatement soumis à ces corps étrangers qui lui occuperont la tête par télépathie, par transmission de pensée, à ces sensations qui appartiennent au double du patient et que l'on aura bien du mal à dissoudre dans une relation professionnelle type. Ce processus, à la base de l'intuition, se passe dans les deux sens : le patient aussi doit subir le double archaïque de son médecin.
Ces constats nous interrogent sur la relation mère-enfant, sur un sujet passivé par les soins maternels qui se doit, il y réussit plus ou moins, de retourner cette passivité en activité. Freud : la mère "ne se contente pas de nourrir, elle soigne l'enfant et éveille ainsi en lui maintes autres sensations physiques agréables ou désagréables. Grâce aux soins qu'elle lui prodigue, elle devient sa première séductrice." (7) Et il faudra, pour vivre, répudier, dans les deux sexes, cette "action passivante" (8), comme le dit André Green, de la mère. Mais certain(e)s patient(e)s savent, sauront y faire afin de transformer le médecin en mère nourricière chez qui ils obtiendront un gain de plaisir dans la passivité. Patients dont la pathologie est parfois peu évidente mais qui adorent le sourire, les fragrances, les mains, le toucher, ce dans toutes les régions du corps, de leur médecin. Ce ne sont pas des patients nourrissons mais ils adorent jouer à "la régression". Bion, explorant cette question, affirme que le bébé-patient en proie à un excès d'angoisse, projette ses émotions, ses affects qui le menacent à l'intérieur du sein, du corps de la mère qui utilise son propre appareil à penser les pensées et réussit à transformer ces affects et les restitue, domestiqués, à l'enfant, du coup capable de penser et de symboliser par lui-même. Le patient demande, de la même manière, à son médecin-mère archaïque de traiter ces excès au travers de la grille de symptômes physiques ou psychiques, réels ou imaginaires. Jean Begoin : le but de la séduction est de projeter la souffrance en même temps que le désir.
L'espace de la consultation est un espace de jeu (Winnicott) transitionnel entre le médecin et le malade qui n'est ni celui du médecin, ni celui du patient. Il est à la fois celui du médecin et celui du patient, celui de la mère qui devine les besoins du nourrisson (le transfert immédiat) et celui du nourrisson. Espace de transition où perdure la croyance du patient en la toute-puissance magique du médecin mais qui convoque toutes les facettes de l'illusion, de l'imaginaire, de l'intuition. C'est un espace ludique. Parler de la pluie et du beau temps, échanger les potins du quartier, s'engueuler gentiment, participe de ces jeux mais qui doivent aboutir, ne l'oublions pas, après une phase d'agressivité de l'infans envers sa mère qui se doit de répondre sans représailles, à l'indépendance et de la mère et de l'enfant. C'est le schéma d'une consultation réussie. Mais bien souvent le médecin maternel aux prises avec des patient(e)s à la recherche d'une dépendance sécurisante, risque d'abandonner sa neutralité scientifique, de ne plus réussir à penser, plaqué au sol du concret, du sensuel. Ces mêmes patient(e)s confortent le médecin dans l'illusion de sa toute-puissance, ils (elles) peuvent même passer un peu de baume sur ses blessures existentielles. Ils (elles) utilisent l'aliénation de ces médecins qui ne peuvent agir qu'en maternisant. Origine possible d'une vocation médicale.
Certaines mères ne peuvent concevoir leur enfant que si celui-ci les prolonge. Du coup, ces enfants ne peuvent aspirer à l'autonomie. Les mères ne sauraient dire non. Débordées, envahies elles sont tyrannisées par leurs enfants à qui elles trouvent toujours des excuses. Certains médecins-mères, hommes ou femmes, sont aussi incapables de dire non et excuseront toujours les actions de leurs patients qui sauront comment avoir toujours raison.
III
Mais il y a aussi du Père et du sexuel. Dans le temps et à ce jour de temps en temps il y avait, il y a du Père fouettard, du Père de la horde primitive freudienne qui n'hésite pas à punir sévèrement, y compris par la castration, les ceusses, les fils régicides qui veulent lui piquer et sa place et ses femmes. Car il jouit de toutes les femmes et les autres se doivent, s'ils souhaitent eux aussi se faire une place au soleil, de l'affronter, au minimum d'imaginer ses obsèques. Ici, pas de sentiments, pas de droits, que des devoirs, la sueur du travail, la compétition, la lutte, l'ambition, la Raison. Le Progrès est à ce prix. Les histoires privées d'amour, de cur, l'art, la poésie ne recueillent que sarcasmes. Mais les filles, déjà castrées, de nature dit-on, ont nettement moins de raisons de redouter la colère du Père. Elles restent donc attachées très longtemps à leur mère avant de découvrir que celle-ci ne peut pas leur apporter ce que les garçons auraient en plus. Du coup, la lune de miel se transforme en lune de fiel. Le ressentiment de la fille envers la mère est devenu un puits sans fond, il est inextinguible. Et la petite fille, dès lors, n'aura de cesse de vouloir obtenir un enfant de ce Père, selon l'équation pénis-phallus égale enfant. Au titre, pourrait-on dire, de compensation.
Le désir envers l'homme ne serait que le désir du porteur de l'appendice-pénis. Les sentiments, l'amour fille-père et, du coup femme-homme, ne seraient-ils que secondaires ? Le surmoi interdicteur de la petite fille serait-il rabougri, laissant triompher la chair, l'affect, la séduction, voire la logique de la soupe ? Les femmes en sont-elles réduites à ne pouvoir que séduire le père, le médecin, afin d'obtenir ce qu'elle est censée vouloir ? Le narcissisme l'emporterait-il sur le dit véritable amour ?
Mais à ce jour, nous assistons, nous participons plutôt au processus culturel de découronnement du Père.
Conséquences lourdes
- La patiente séduit le médecin-homme avec un grand naturel, condamnée qu'elle serait à la chair. Si passage aux actes sexuels la condamnation morale et déontologique sera immédiate. Mais nous le savons tous, de tels faits ne peuvent exister ! Attention tout de même... Car comme le disait Lucien Israël : avec les hystériques on ne s'ennuie pas.
- Relation patient/médecin-femme : il peut arriver que le patient tente de séduire la femme-médecin, mais ce risque serait d'emblée éliminé : la barrière de l'inceste s'impose. "Moi, consulter cette femme ? Elle est aussi jeunette que ma fille, un toucher rectal, ça va pas non ?" Quoique pour certains, avec un zeste de perversité... Réminiscences troubles de certains actes maternels inhabituels...
- Entre la patiente et le médecin-femme, prévalence d'une relation maternisante ambivalente qui oscille entre l'amour d'une mère-médecin parfaite et la haine d'une mère-médecin incomplète : "Vous devriez être disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Autrefois, le médecin de famille, les religieuses dans les hôpitaux, c'était autre chose... Toujours disponibles eux, jamais enceintes, elles..." "Ah ! Vous avez inscrit votre enfant à telle école ?" Probablement que c'est dans ce cadre qu'il existe les réactions thérapeutiques les plus négatives. Stratégies de la part de la patiente de mise en échec total du médecin-mère. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. "Mon médecin est très mauvais. Mais j'y vais quand même. Je ne suis jamais ses prescriptions. Quand je suis vraiment malade, je vais voir quelqu'un d'autre."
- La relation patient/médecin-homme, est marquée par les imagos père/fils. Le patient rebelle menace, au pire, de tout casser y compris la gueule du médecin. Il exige, il tonitrue, critique les prescriptions, dissimule le fait qu'il ne prend plus ses médicaments, ou qu'il n'en prend que la moitié. "Car c'est du poison." Il mégote sur la moindre augmentation d'honoraires : le médecin vénal profite de manière éhontée de la misère humaine. Bien entendu il persiffle chez les voisins, au boulot, au bistrot. Mais ce n'est pas incompatible avec une apparente attitude de soumission, voire avec une onctuosité, une componction toute ecclésiale. Le médecin peut subir les assauts directs ou indirects d'un patient bourreau, despote non éclairé, qui, afin de disqualifier son médecin, voire de l'humilier, peut facilement affirmer, péremptoire : "Vous me refusez ceci, vous dites cela, c'est parce que vous soignez aussi ma femme, mon voisin, mon chef et qu'ils vous ont parlé de moi. Je vous ai d'ailleurs vu, l'autre jour, au bistrot, à dix heures du matin. Pas joli. Et à la plage naturiste ce n'était pas votre femme qui était avec vous..." Mais à l'inverse il faut rajouter que certains patients, comme certains fils qui n'affrontent jamais le Père, obéissants, masochistes moraux, tendent la joue droite après avoir été frappés sur la joue gauche. Ils soulagent leur sentiment inconscient de culpabilité de par une fidélité indéfectible à un médecin-maître dont on ne saurait discuter les ordres et pour qui le coup de pied au derrière est une thérapeutique universelle. Ce patient-victime sera toujours amoureux d'un censeur content de l'être.
*
**
Dans tous les cas, séduction communautaire, appel maternel, ou au Père intraitable, la neutralité scientifique et bienveillante du médecin est mise à mal. Le Serpent, décidément, a plus d'un tour dans son sac qui saura toujours, au-delà du médecin diplômé, reconnu par la communauté sociale, interroger celui-ci sur ce que Pavese appelait "Le métier de vivre", et l'obliger, comme le disait Saint-John Perse, à se maintenir la face contre le vent.
Signature :
A. Le Dorze
Notes :
(1) "La Chute." La Genèse. La Bible de Jerusalem. Paris : Editions du Cerf ; 1973, p 26.
(2) Debray R. "Pense-bête." Médium. Avril-mai-juin 2011; n°27, p 221.
(3) Latour B. "Apprendre à vivre sur la planète Pandora." Le Monde. 14 janvier 2010 ; p 10.
(4) Ferenczi S. "Suggestion et psychanalyse." Psychanalyse I. Paris : Payot ; trad. 1975, p 233.
(5) Chertok L. Résurgence de l'hypnose. Paris : Desclée de Brouwer ; 1984, p 34.
(6) Roustang F. Elle ne le lâche plus. Paris : Editions de Minuit ; 1980, p 91.
(7) Freud S. "Un exemple de travail psychanalytique." Abrégé de psychanalyse. Paris : PUF ; 1975, p 59.
(8) Green A. "Passions et destin des passions." "La passion." Nouvelle Revue de Psychanalyse. Paris : Gallimard, 1980 ; n°21, p 36.
<em>LA PSYCHIATRIE EST-ELLE ENCORE UN HUMANISME ?</em> DE R. PALEM, L'HARMATTAN ; 2010.
Palem ! cet encyclopédiste passionné, ce membre créateur du SNPP - AFPEP(2) avec Gérard Blès et d'autres, ce questionneur, cet amateur de curiosités que l'âge ne saurait atteindre, ce bretteur, défenseur acharné de valeurs "humanistes" que d'aucuns qualifient de "radsocs". Ce pourfendeur de la pensée 68 coupable, à ses yeux, de réduire l'Homme, comme le regrettait aussi Sartre, à un objet entièrement explicable par le dehors ou par un inconscient qui lui serait aussi étranger, − ce qui ferait passer la conscience, la liberté, par dessus le moulin, − ce contempteur, donc, de Hegel, Heidegger, Foucault, Althusser et bien entendu de Lacan, ne saurait séparer l'Homme-conscience de son Etre. Car c'est la conscience qui, pour Henri Ey, et Palem, son légataire, garantit la libre pensée et leste la vie des hommes de ce poids de responsabilités dues à l'exercice de leurs droits démocratiques. "La structure de l'être conscient par excellence c'est le langage" affirme Ey.
Du bon côté de la barrière, les existentialistes, chrétiens ou non : Jaspers, E. Mounier, Ricur pour qui une structure sans sujet était une nécropole, Sartre, Camus, Merleau-Ponty et du mauvais, les structuralistes, les purs matérialistes, − un grand absent d'ailleurs chez Palem : Lévi-Strauss, pourtant à mon avis le plus représentatif, le plus concret de ces penseurs qui voulaient émietter l'Homme et n'en faire que le produit d'un algorithme −.
Combattre tout déterminisme réducteur, tel est le devoir de tout psychiatre humaniste ! Que l'inconscient soit historique chez Hegel, défini par l'assujettissement économique chez Marx et Althusser, par des jeux de pouvoir chez Foucault, ou de langage chez Lacan, qu'il soit plus difficile à cadrer chez Deleuze et Guattari qui flirtent souvent, par leurs concepts de flux, de reflux, de devenir, avec le vitalisme, il n'en demeure pas moins qu'il faut, en soi, le refuser. Affirmer que la subjectivité se définit pour un sujet lambda comme un signifiant pour un autre signifiant relève, pour Palem, au mieux, de la supercherie. Lacan : "Le sujet ne sait pas ce qu'il dit et pour les meilleures raisons, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est." Penser Céline : "Tout système politique est une entreprise de narcissisme hypocrite qui consiste à rejeter l'ignominie personnelle de ses adhérents sur les autres", − conseil qu'il aurait dû méditer, lui, l'antisémite −.
En tout cas, il ne saurait être question de dissoudre, comme un cadavre dans l'acide, la maladie mentale dans une anthropologie cannibale où la folie et même le crime ne seraient que l'expression de dysharmonies structurales dont il suffirait de modifier l'ordonnancement pour qu'il en soit autrement. L'hôpital psychiatrique assume une fonction soignante et le psychiatre est un authentique médecin, disciple d'Hippocrate ! Henri Ey, à propos des aliénés : "En tout état de cause, affligés par un des plus grands maux de l'humanité, ils n'en demeurent pas moins des êtres qui veulent vivre et nous avons, selon le précepte majeur de notre honneur professionnel, l'impérieux devoir de sauvegarder leur existence, fût-ce jusqu'à l'absurde."(3) Ce ne sont pas, contrairement au jugement du conventionnel Couthon, des animaux. Ce ne sont pas non plus des délinquants et la surdétermination sociale ne suffit pas à leur identification.
Les grands ancêtres humanistes sont convoqués, comme Pinel, tout à sa légende de briseur de chaînes des aliénés : "Pinel impose les "droits de l'homme" libre contre le despotisme carcéral, réintroduit la "dignité humaine" jusque dans "les loges infectes et malsaines de Bicêtre"(4)." L'humanisme des Lumières a conçu l'idée d'un sujet de la folie, malade amoindri mais chez qui persiste toujours une once de Raison, − idée qui rejoint celle du clivage de Freud entre un Moi psychotique et une autre partie "saine" du Moi, − mais non pas rendu fou par le hasard de signifiants lancés, tels des coups de dé, sur le tapis de la vie. Le psychothérapeute, le psychiatre se doivent d'être actifs : ils soignent et avec ce qu'ils savent et avec ce qu'ils sont. En tout cas, ne jamais reculer devant un outil thérapeutique qui pourrait s'avérer efficace.
Mais l'idée humaniste ne saurait non plus tolérer la réduction de l'Homme à un amas, à des réseaux de neurones plus ou moins perturbés. Ne pas confondre biologie du comportement et phénoménologie de comportements déjà considérés comme quasi pathologiques. Palem ne peut se satisfaire de l'équation homme neuronal - homme mental prônée par Jacques Monod, François Jacob ou Jean-Pierre Changeux. Il ne se résout pas à écarter le spirituel, toujours proche, il est vrai, du sacré. D'évidence il ne peut suivre, non-plus, les neurocognitivistes qui, comme Dennett ou L. Naccache, considèrent que les processus mentaux sont des processus de traitement de l'information au même titre que les mathématiques ou les statistiques.
Signature :
Albert Le Dorze
Soit ! Mais comment ne pas tenir compte de la théorie de l'évolution qui fait de l'animal un homme potentiel ? Les droits de l'Homme sont les Droits des animaux et les Droits de la vie. Question que Robert Palem n'ignore pas mais impossible pour lui de ne pas être comme le clerc vigilant de l'humain face à notre monde, synonyme de chaos génétique ""immense orgie collective" de gènes échangés et recombinés, − dont certains dits orphelins sont de pures créations −, et d'un homme qui n'est qu'une chimère, une mosaïque en perpétuelle recomposition" comme l'affirme Didier Raoult(5), notre spécialiste des maladies infectieuses, grand prix 2010 de l'INSERM, cette maison du Diable, comme chacun le sait.
Point commun avec R. Palem : Devoir et grandeur de la politique.
Notes :
(1)Le Dorze A. Humanisme et psy : la rupture ? L'Harmattan ; 2010.
(2)Syndicat National des Psychiatres Privés - Association Française des Psychiatres d'Exercice Privé.
(3)Palem R. p 38.
(4)Palem R. p 41.
(5)Raoult D. Chasseur de microbes. Le Monde : 20 novembre 2010 ; p 18.
<em>Les Dessous du Divan</em>. Claude Forzy
L'exercice de la médecine ne serait donc pas une simple activité technique, il exigerait une signature qui persisterait au-delà de la mort. Exercice singulier, écriture singulière. Traces, marques. Pour les enfants, les petits enfants, les arrière-petits enfants des patients, pour l'humain, offrande d'un grimoire qui témoignera que tel médecin a tenté, sa vie durant, confronté à la douleur du monde, aux éclats de la vie, d'approcher ce qu'André Breton, lui-même brûlé par la médecine, appelait le noyau infracassable de nuit, commun à tous les mortels. Jean Reverzy, médecin, auteur du célèbre Passage, affirmait que la mort des médecins n'était pas tout à fait comme la mort des autres personnes. Sans-doute parce que nous-mêmes et nombre de nos patients nous nous pensons et ils nous pensent immortels.
Etait-ce le cas pour le cher paranoïaque dont les tribulations nous sont contées par Claude Forzy dans son dernier livre Les Dessous du Divan, Confidences "tout à trac" (1). En retrait de son activité de psychiatre, Forzy, toutefois non décédé, a éprouvé le besoin de quitter la fange théorico-psychanalytico-culturalo-politico-prise de tête pour taquiner son esprit de sérieux et nous livrer cette petite merveille de légèreté, de grâce, d'humour et surtout d'ironie.
Quel plaisir de lecture ! Mais il y a erreur sur la collection, ce livre c'est de la littérature. Et de la meilleure, dans la veine ouverte par Swift, E. Waugh, labourée par T. Sharpe. Et nous n'hésitons pas à y rattacher le Finnois A. Paasilinna, l'auteur hilarant et grinçant de Petits suicides entre amis. Ne craignons rien, La ferme des animaux d'Orwell n'est pas très loin ! Plus proche, Le colonel des zouaves (2) d'O. Cadiot qui, contre l'emphase de l'intime, propose un cours d'art domestique porté au pinacle par un sieur Robinson. Avec le Robinson obsessionnel de Cadiot et le paranoïaque de Forzy, nous en apprenons davantage que l'enseignement fourni par un quelconque manuel logomachique.
Mais l'identification de l'auteur à son sujet littéraire ne saurait être totale ; le psychiatre surnommé l'uf − Forzy s'affuble d'un drôle de surnom − doit imaginer le langage du patient, ses tournures de phrases, ses tics, ses comportements, ses délires au besoin et les restituer dans un festival de clins d'il, de lapsus, de mots d'esprit, de répétitions imposées, de connivences frôlées, de désirs feulés, de vitalités exprimés.
Signature :
Albert Le Dorze
Puisses-tu, cher Claude, être lu par beaucoup.
Notes :
1 Forzy C. Les Dessous du Divan. Paris : L'Harmattan ; 2011.
2 Cadiot O. Le colonel des zouaves. Paris : POL ; 1997.
Pourquoi prenons-nous, au début de chaque année, de "bonnes" résolutions que nous ne tenons jamais ? Emission Ty Télé, le 27/01/2010.
A Babylone, plusieurs siècles avant J-C, il convenait de restituer les objets agricoles empruntés. Les juifs s'imposaient, au nouvel an, dix jours de pénitence afin de pardonner et de se faire pardonner les fautes commises dans l'année.
Pour Freud, il existe chez chacun une marmite pulsionnelle, l'inconscient, le ça dans laquelle bouillonnent affects - positifs et négatifs -, passion, agressivité et motions perverses évoluant chacune pour soi, réclamant l'immédiate satisfaction, sans égard pour la bienséance, le monde extérieur, brutalement égoïstes : meurtrières, incestueuses, sadiques, voyeuristes, fétichistes et autres, inhumainement répétitives, sans foi ni loi. En opposition existe un Moi, notre partie noble, morale, siège de la conscience, responsable, qui prend en compte les intérêts sociaux du sujet, se veut ordonné, aimable et aimant, sublime, tenant à distance la pulsion refoulée, ne voulant rien savoir du cheval sauvage inconscient qui lui fournit son énergie. Le refoulement pulsionnel est pourtant mité, incomplet. Il existe en effet des enclaves d'inconscient dans le Moi : les symptômes névrotiques, certains troubles du caractère, du comportement sont marqués par les caractères propres de cet inconscient. Le Moi ne peut que se défendre contre ces intrus qui nous empêchent d'être socialement idéaux car il se veut l'instance de la bonne, de la meilleure image sociale possible, à la source d'un bon narcissisme, d'une bonne estime de soi. De plus ce Moi se veut en paix avec les prescriptions traditionnelles de sa communauté : il n'a rien à se reprocher. Les vux de bonne année, les bonnes résolutions porteront sur ces enclaves inconscientes, présentes dans le Moi, ces empêcheuses de monstrations sociales parfaites, ces diablesses accointées avec la perversion : ne plus fumer, ne pas trop manger, ne pas s'enivrer, respecter son père et sa mère, ne pas désirer la femme de son frère, bref, obéir aux commandements sociaux.
Ceci explique que les vux soient rarement tenus (statistiquement 70% ne tiennent que quelques semaines) car le Moi, qui se veut maître chez lui, est emporté par le volcan, toujours mal éteint, de l'inconscient. L'équilibre entre le ça et le Moi est toujours d'une instabilité voulue stable. L'ambivalence règne : améliorons notre situation (comportements) mais à condition que rien ne change Trop dangereux, pas de psychothérapie dite dynamique qui risquerait de faire chanceler notre Moi branlant. Non, plutôt la méthode Coué, la pratique des vux s'y adosse.
Emile Coué, pharmacien et psychologue (1857-1926) fut le promoteur d'une psychothérapie référée à l'hypnose, à l'influence, à la suggestion. Celle-ci, contemporaine des premières élaborations freudiennes, connaît un immense succès. Il n'existe guère que l'article de Karl Abraham La formule thérapeutique de Coué, commentaires psychanalytiques(1) de 1926 qui éclaire et conteste cette forme d'aide, ancêtre de la pensée positive et du développement personnel. Le sujet hypnotisé est sous l'influence de l'hypnotiseur, il obéit à ses ordres, à ses suggestions. Les membres d'une foule s'identifient au chef, l'hypnotisé à l'hypnotiseur, le croyant au prêtre, l'élève au professeur. Mais tout ceci présuppose, dit Freud, un amour érotique entre ces protagonistes. C'est la libido qui fait lien social, qui, désexualisée, sublimée, devient identification, intériorisation de l'Autre, aimé, dont nous sommes désormais séparés. Les personnages primordiaux, les parents, sont les modèles identificatoires de base.
La méthode Coué consiste à répéter trois fois par jour, matin, midi et soir, vingt fois la formule : "Tous les jours, sous tous les rapports, je vais de mieux en mieux", ce à l'aide d'une cordelette-chapelet. C'est la voix parentale qui exhorte et exige une bonne santé et au-delà c'est la voix des ancêtres, de la communauté et de ses dieux respectés qui alimente le jugement surmoïque. La méthode Coué se veut une auto-hypnose consciente, une autosuggestion qui permet l'extension de la maîtrise de soi sur soi. Les idées s'incrustent dans l'esprit et deviennent réalité. Positions identiques à celles des psychologues des foules comme Le Bon et Tarde qui estiment que celles-ci sont peu sensibles à l'argumentation mais davantage aux images - la représentation primaire des motions de l'inconscient, donc puissamment affectives − que le meneur répète à l'infini et dont il exagère le potentiel émotionnel. Affaiblissement de la critique et augmentation de la foi se constatent banalement dans l'hypnose, la méthode Coué, dans le fonctionnement des masses. L'identification au Docteur Coué et à ceux qui vous veulent du bien est le garant du mieux-être. Au maximum elle écarte le malheur et au minimum elle apporte soulagement et consolation. La répétitivité, la ritualisation de la formule Coué font croire, comme chez l'obsessionnel, à la toute-puissance des idées qui doivent être positives. De plus, ces prières doivent effacer, comme le sacrement de la confession, les fautes passées, nos manquements aux codes sociaux Ce processus magico-religieux, dont il faut reconnaître la simplicité, connut un succès mondial.
Mais, comme le disait Karl Abraham, ces succès ne peuvent être durables : les enclaves inconscientes reprennent rapidement leur place, le Moi n'est vraiment pas maître chez lui ; l'inconscient impose le symptôme, répétitif et vainqueur. Les bonnes résolutions ne suffisent pas.
A la décharge de Coué, remarquons qu'il ne pratique pas un éloge de la volonté mais plutôt une pédagogie de l'imagination. Non pas Pic de la Mirandole : nés capables de devenir tout ce que nous voulons être, mais plutôt que le vouloir guérir, l'imagination d'un homme nouveau aspirant à de nouvelles contrées. Dans le fond, il s'agit de modifier, fût-ce légèrement, les rapports entre conscient et inconscient, entre superstructure et infrastructure. Nous, grands thérapeutes, de devons-nous pas, souvent, nous contenter de ces faibles mouvements ? Mais il est vrai que nous sommes censés en démonter les mécanismes. Nouvelle ruse de la croyance, de la foi en la toute-puissance des idées ? Chamanisme et psychanalyse, vieille histoire qui ne nous empêchera pas de souhaiter nos bons vux à qui le souhaite.
Notes :
(1) Abraham K. "La formule thérapeutique de Coué, commentaires psychanalytiques." uvres complètes. Paris : Payot ; 1989, Tome II, 1915-1925, p 290-296.
Pourquoi des groupes Balint ? Il n'y a pas de science de la praxis
"Comment se fait-il que la médecine ait laissé échapper cette véritable chance qui lui était offerte dans les années soixante ?" J-J. Kress.
Désormais la loi rend obligatoire l'évaluation des pratiques professionnelles, psychiatriques comprises. Un Clic sur le site de l'AMMPPU*(1) nous apprend qu'une activité de "formation personnelle doit permettre à l'apprenant de préciser ses objectifs, de situer ses résultats par rapport à eux, de tenir compte pour les apprécier, de son environnement professionnel, du cadre réglementaire et des conditions éthiques de son exercice, de cerner les problèmes restant à résoudre et les moyens de les résoudre (acquisition de connaissances ou de savoir-faire, organisation,...) et d'évaluer les progrès réalisés dans une spirale de formation." Dans cet esprit il convient, avec bonheur, selon l'auteur*(2), de conjoindre les obligations d'évaluation et de formation professionnelle. Il est rajouté : "La démarche fondamentale est bien la prise de conscience de la nécessité de s'intégrer dans une démarche qualité." Les actions de formation permettent, par la comparaison des expériences et la confrontation à des références validées de rentrer dans une démarche d'amélioration de la pratique, de la compétence professionnelle. Elles sont à la base de la formation médicale continue. Question : qui valide quoi ? Et pourquoi ?
*
* *
I Balint constata que les études médicales sont essentiellement orientées sur l'acquisition de connaissances scientifiques. Elles n'assurent que partiellement un enseignement des aptitudes pratiques et encore moins des aptitudes relationnelles. Le médecin a rarement l'occasion d'exprimer les difficultés rencontrées dans la relation avec le patient. Pourtant au même titre que les éléments sémiologiques les facteurs relationnels interviennent dans les décisions. Ils sont peu enseignés car cette approche ne se prête pas à une pédagogie magistrale.
Le langage mathématique permet-il à lui seul de comprendre, d'appréhender, d'agir sur ce que propose le monde, la clinique psychiatrique? Canguilheim estimait que la méthode anatomo-clinique, du point de vue épistémologique vaut la pensée mathématique car étaient déjà pris en considération les pouvoirs signifiants du perçu, l'organisation de l'objectivité à partir des valeurs du signe, la structure linguistique du donné. Les DSM III, IV, et autres qui se veulent descriptifs, athéoriques traduisent finalement le triomphe du chiffre et de l'algorithme garantie du caractère scientifique de la nouvelle démarche clinique d'où tests d'évaluation, modèles animaux, standardisation des observations, interviews structurées, systèmes experts dont le but avoué est la formalisation informatique qui permettrait un espéranto, un langage commun universel. Au prix bien entendu d'une mécanicisation de l'approche clinique. Le versant artistique du praticien se doit d'être pourchassé au nom de l'efficacité. Normalement ce versant tombera plus tard de lui-même en quenouille.*(3) Entrée en force des sciences fondamentales devenues autonomes et des techniques qui y sont liées. Les neurosciences, la démarche hypothético-déductive, le cognitivisme font passer la clinique psychiatrique "artistique" pour une ringardise. Le chercheur est plus important que le soignant, plutôt l'INSERM que l'internat des hôpitaux.
Aboutissement logique, l'Evidence Based Medicine. Qu'il est loisible de traduire par "Médecine fondée sur un haut niveau de preuves.", l'objectif étant de "cerner l'incertitude" résiduelle, inhérente à toute recherche clinique. "L'EBM n'admet qu'une finalité : améliorer le devenir sanitaire des malades grâce au transfert plus rapide des résultats de la recherche dans les pratiques". Le professeur Bourgeois se demande si l'application de ce modèle ne constituerait pas ce qu'il appelle "un choc culturel salutaire pour la Psychiatrie qui s'enlisait dans une subjectivité dangereuse, dans des interprétations souvent fumeuses qui venaient mal rendre compte de l'inefficacité thérapeutique. Il y a une évolution logique de la résurgence de l'approche objectivante". Autre citation : "Les anciens auront sans doute la nostalgie de la magie de la rencontre, de l'image du médecin omniscient et tout-puissant, des vertus curatrices des phénomènes transférentiels, des contacts humains, de la suggestion et même des placebos assez de nostalgie, voici un nouveau challenge, amusant comme l'informatique et, pour de nombreux aspects, des études bien intéressantes. Tout d'abord de nouveaux concepts devenus incontournables pour lire les travaux de recherche clinique : RRR, RAR, NST, ARB, AAB, etc." *(4)
Ce qui par association d'idées évoque les questions d'internat des années 1970, questions de médecine d'une dizaine de pages sur tel sujet, le diabète par exemple, dont les deux dernières pages énuméraient les mesures thérapeutiques à prendre, dont la dernière ligne de la dernière page assénait invariablement : on n'oubliera pas les implications psychologiques de l'affection. L'an dernier dans un groupe Balint un jeune médecin, première présence, s'étonnait des réactions agressives à son égard d'une famille endeuillée par le décès d'un père de famille âgé de 40 ans secondaire, comme on dit, à une longue et douloureuse maladie. "J'ai pourtant suivi exactement les prescriptions et les doses du topo". Etonnements multiples Il existait pour ce médecin une page d'un vademecum utilitaire intitulée : "Conduite à tenir face à un mourant adulte".
Dans ce cadre c'est le savoir accumulé, des théories qui sont transmis. Somme de savoirs communs à acquérir, toujours à évaluer. Ce qui permet de claires distinctions hiérarchiques. Cette logique du progrès n'éprouverait que commisération pour les histoires privées de cur, de sexe, pour la poésie, l'art, la décoration, toutes choses qualifiées de féminines qui évoquaient autrefois de noires superstitions à combattre.
Ce serait un ensemble d'idées, de représentations - passage du réel impossible, inintelligible à une réalité formalisable - qui, prolongé par la raison instrumentale, la technique et l'industrie donnerait du sens, de la signification à notre existence. Cette vision du monde, possible après mortification, correspond, du point de vue pédagogique, aux séminaires et aux groupes de pairs.
Le séminaire permet d'acquérir savoir et compétence, d'échanger avec des experts, de prendre conscience des exigences de la Santé Publique, de réaliser des audits validants.
Dans un groupe de pairs chacun est expert et enrichit les autres de son expérience en exposant sa pratique quotidienne. Un audit chargé de mesurer la différence entre une pratique singulière et des normes édictées idéales est aussi possible. Le consensus est à rechercher. Ceci s'avère soluble dans une psychiatrie évaluative, fondée sur un haut niveau de preuves.
Sans le recours à notre environnement maternel qui supplée notre prématurité, la pulsion sexuelle tendrait à l'auto-destruction. L'investissement, la sensation, les affects plaisir-déplaisir précèdent le signe langagier. Un nourrisson ça n'existe pas dit Winnicott, il n'existe qu'un couple nourrisson-environnement maternel qui contiendra, métabolisera les excès énergétiques de l'infans-animal humain et les lui restituera sous une forme compatible avec la vie psychique, une définition possible de l'éducation. D'où l'importance du jeu, d'expériences entre les pulsions propres du sujet et la réalité extérieure. C'est le domaine de l'art, de la culture du groupe-réseau protecteur qui prolongent le pare-excitations. Notre capacité à inventer, à traverser les apparences, notre curiosité intellectuelle, notre imagination, notre vie fantasmatique, humour, humeur, dépendent de ce jeu entre la tradition et notre originalité, singularité pulsionnelles. Ce n'est que progressivement que l'infans devient indépendant de la mère par le recours à la haine à l'égard de cette mère frustrante.
Le risque désormais, tout magistère disparu, c'est de remplacer la culture collective surmoïque par des "je" assoiffés de reconnaissance qui se veulent autonomes, sans dette à l'égard de toute autorité, du monde, à fortiori de toute transcendance, tout livre désacralisé, "ma parole vaut celle de n'importe qui", entièrement dans le présent qui affichent leurs opinions, leurs identités culturelles comme des vérités non critiquables faisant mentir E. Levinas pour qui il y a plus de vie dans les livres vermoulus que dans la vie elle-même. Seuls le vécu, l'émotion exhibés seraient susceptibles d'entraîner la conviction de ces E-T communicateurs. Chaque psy s'autoriserait de lui-même au nom d'une inter-réactivité généralisée, d' une relativisation triomphale : pourquoi pas, pourquoi pas moi ?
*
* *
II Pour Hanna Arendt penser, la plus libre et la plus pure des activités humaines, n'est pas raisonner. Il lui a été beaucoup reproché d'avoir décrit Eichmann comme un Allemand ordinaire ni faible d'esprit, ni endoctriné, ni cynique. Personne moyenne, banale mais incapable de prononcer une phrase qui ne fût un cliché, incapable de distinguer le bien du mal. Il avait pour lui sa bonne conscience d'Allemand ayant obéi aux ordres de ses supérieurs et du système : "On m'a demandé de le faire, je l'ai fait." Sa pensée était incapable de se saisir de l'existence d'autrui. Aucune mauvaise conscience, aucune responsabilité. Il raisonnait. Pourtant la reconnaissance de l'autre comme autre, différent, fait de nous un "obligé du monde." Pour Hanna Arendt le théoricien totalitaire est celui qui veut faire coïncider l'hasardeuse réalité avec les dictats des programmes intellectuels. Elle terminait son article par cette interrogation angoissée : peut-être fallait-il se faire à l'idée que la Shoah marquait les prémisses d'une automatisation généralisée ? Satisfaire les besoins illimités du corps, répondre aux petites commodités de la vie, ces occupations laissent-elles encore aujourd'hui une place pour la pensée ?
A la démarche-qualité requise il faut opposer L'Homme sans qualités (1931-1933) de Robert Musil chassé de Berlin et de Vienne par le nazisme : à tout instant, le monde pourrait être transformé dans toutes les directions... c'est pourquoi il serait original d'essayer de se comporter non pas comme un homme défini dans un monde défini, mais, dès le commencement, comme un homme né pour le changement dans un monde créé pour changer. Il faut combattre les "hommes à qualités" qui veulent remplacer leur moi par des chimères de totalité, ce qui déchaîne la barbarie. L'ironie et l'essayisme d'expériences multiples sont les armes de l'intelligence selon notre auteur. Pour Malraux l'intelligence c'est la destruction de la comédie, plus le jugement, plus l'esprit hypothétique. C'est aussi de savoir qu'une carafe est une carafe. "La profondeur n'est peut-être rien d'autre que cet immense avenir de réflexions et de perplexité enveloppé dans quelques mots d'une simple phrase." Jankélévitch.
Ceci rejoint la critique nominaliste de la science selon laquelle les idées abstraites et générales, les concepts ne sont que des noms, des conventions, des commodités empiriques qui ne permettent pas de saisir la nature des phénomènes, du réel. Elles n'ont pas de valeur objective. Le concept de chien n'aboie pas disait Spinoza et la folie n'est pas un simple concept. "Les savants ne savent que les mots. Je ne vois jamais des savants des choses le meilleur livre est le monde." remarquait le prince de Ligne. La clinique qui privilégie le fait le phénomène qui apparaissent à la conscience, perçus tant dans l'ordre physique que psychique, prend le parti des choses en soi. Le Monde, la chair, les pulsions sont des données à recevoir, qui sollicitent les organes des sens, originent des sensations susceptibles de procurer à un existant, dont les qualités de passivité sont suffisantes, les joies de l'altérité, de rencontres gratuites avec l'Autre, avec la différence. Le sensuel, l'incarnation donnent le sens de l'existence, et in fine, s'avèrent les meilleurs gages de la liberté. Entre le sujet et l'objet il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'intentionnalité. L'intersubjectivité, le moi, inscrits dans une temporalité fondent une subjectivité transcendantale différente de celle espérée par les catégories de l'idéalisme cartésien.
Pour Emmanuel Levinas autrui n'est pas objet de compréhension d'abord et interlocuteur ensuite. Les deux relations se confondent : la compréhension d'autrui, l'intuition participante, est inséparable de son invocation, moment premier. "L'homme est le seul être que je ne peux rencontrer sans lui exprimer cette rencontre même. La rencontre se distingue de la connaissance précisément par là."*(5) La pensée est inséparable de l'expression, celle qui vise un objet diffère du lien avec une personne. Le visage, dit Levinas, c'est l'infime résistance de l'étant en notre pouvoir. La vision du visage est audition et parole.
*
* *
III A la suite de ses études en médecine, il était aussi chimiste, Michael Balint, 1896-1970, se rend à Berlin avec son épouse Alice où ils entreprennent une analyse avec Hans Sachs et rencontrent Mélanie Klein et Alexander. De retour à Budapest Balint fera aussi une autre analyse avec Ferenczi et deviendra didacticien en 1926. De 1933 à 1938 il assume le poste de directeur de l'institut de psychanalyse et de la clinique de psychothérapie à Budapest. C'est l'arrivée des troupes nazies qui le force à quitter la Hongrie. Il s'établit avec sa famille à Londres où il vivra jusqu'à sa mort. A la Tavistock Clinic de Londres il fréquentera Bion. Comme Winnicott il sera président de la société britannique de psychanalyse longtemps perturbée par le conflit entre les partisans de Mélanie Klein et ceux d'Anna Freud. Il écrira entre autres : Le défaut fondamental, Techniques psychothérapiques en médecine, Les voies de la régression et surtout Le médecin, son malade et la maladie. La traduction de ce livre par Valabrega est contemporaine de l'introduction en France de la pratique des groupes Balint par E. et G. Raimbault, Michel Sapir, J.-A. Gendrot et d'autres
Les groupes Balint représentent une possibilité de formation qui permet d'intégrer la dimension relationnelle dans le processus de soin. Le premier groupe Balint, appelé "la vieille garde" réunissait douze médecins une fois par semaine durant deux heures pendant plusieurs années, autour de Balint, proposant un séminaire de discussions de groupe sur les problèmes liés à l'exercice de la pratique médicale. Il s'agissait de s'inspirer de la méthode psychanalytique de la libre association. La parole spontanée est donc préférée. Il faut permettre au praticien d'analyser les implications affectives et émotionnelles dans le travail avec les patients et de rechercher les moyens d'y faire face. Car si le médecin a des effets thérapeutiques positifs, d'une certaine manière le médecin serait le meilleur médicament, il présente aussi des effets secondaires indésirables.
La réponse du médecin se devrait d'épouser les particularités, la singularité du patient. Les symptômes, la maladie ne sont plus considérés comme se situant seulement dans le malade mais dans la relation malade-médecin. Le traitement peut être adéquat à la conférence de consensus mais se révéler inadapté par rapport à la plainte du patient. Le prototype de la réponse "vous n'avez rien" bien que techniquement juste peut être interprétée par le patient comme un déni de son problème. Des questions apparemment incongrues se posent : quelle relation le malade entretient-il avec sa maladie ? L'idéologie soignante du médecin joue-t-elle un rôle ? Suivre un patient favorise-t-il la dépendance ou même la chronicisation ? Certains symptômes sont à respecter qui permettent au patient le maintien d'un certain équilibre de vie.
La relation thérapeutique nécessite une ouverture à soi-même, au monde et dans cette relation le médecin n'est pas interchangeable. En aucun cas il ne peut s'agir d'un officier de santé susceptible d'asséner des conduites à tenir, issues de conférences de consensus, respectant des références médicales officielles, ce qui permettrait l'accréditation de consultations totalement transparentes. Le prêt-à-penser évaluatif soutient les visées consuméristes du patient ; le médecin se doit de satisfaire les besoins immédiats du patient-consommateur comme un garagiste soucieux de l'acheteur d'une voiture neuve, la tuning-gadgétisation signant un plus-de-qualification médicale.
La réunion régulière, deux fois par mois d'un groupe de sept-huit médecins, les mêmes, répond à la demande de construction d'un solide pare-excitations qui puisse contenir les angoisses de chaque participant, désormais partagées, liées à la relation professionnelle médecin-malade. Les émotions, sensations, pulsions, socles de la subjectivité, se doivent d'être accueillies et restituées, désormais psychiquement utilisables. L'humour, l'ironie mais aussi la colère, l'agressivité, la violence des mouvements haineux alimentent le jeu thérapeutique winnicottien, garanti par la libre association de paroles ; il ne saurait être question d'échanges désincarnés purement conceptuels : ne pas oublier le visage de Levinas. Cela rend possibles les deuils du médecin, sujet singulier, qui découvre son style dans la succession des réunions, mais dans l'obligation de se séparer rituellement du groupe Balint-environnement-maternel..
Et le leader alors ? La personne extérieure L'analyste de service Ce leader support de toutes les projections, de toutes les demandes de protection et de savoir doit s'interroger sur le désir du leader du groupe Balint, sur le tissu des transferts et du contre-transfert, sur ce que Balint appelait ses gratifications émotionnelles. Lacan souligne : "S'il y a quelques personnes qui ont dit sur le soi-disant contre-transfert quelque chose de sensé, ce sont uniquement des femmes. Vous me direz : - Michael Balint ? Seulement il a fait son article avec Alice."*(6) (27/02/1963) Lacan fouaille la question en s'interrogeant sur la fonction du désir dans l'amour, enjeu essentiel, pour autant que le désir ne concerne pas l'objet aimé. Le leader n'est sûrement pas un didacticien qui pourrait évaluer chaque médecin comme le ferait hideusement un analyste chevronné osant noter un jeune collègue débutant. Que resterait-t-il, dès lors, de l'inconscient ?
Ce leader se fond dans la continuité maternelle du pare-excitations mais il doit apparaître comme le garant, le tenant-lieu d'une pensée qui ne sera pas pur raisonnement, qui permettra la destruction des comédies qui entourent l'exposition d'un cas proposé par un membre du groupe, cas suivi pendant plusieurs mois, qui devra faire échouer les chimères de totalité en maintenant face contre le vent les possibles de l'essayisme. Nécessité de lutter contre l'automatisation mortifère que signe l'apparition d'une confortable culture communautaire. Il est si facile de faire l'économie de notre conflictualité psychique interne, de notre sexualité propre lorsque notre pare-excitations devient celui de la communauté. Fusion, confusion, prostitution fraternitaire disait Baudelaire. Sacrifice, pour le Grand Autre, de la jouissance sexuelle pour la jouissance Autre, extatique disait Lacan.
IV Une psychiatrie mortifiée tendant à la mathématisation en autorise l'évaluation, mais l'étude de la psyché ne peut se réduire à cela. Les groupes Balint se réfèrent à la psychanalyse. Leur but ? Sensibiliser le médecin à la dimension inconsciente de la relation soignante. Est-ce à dire que le clivage entre biologie et psychanalyse est la marque incontournable de la fonction et donc de la formation du psychiatre ? Se souvenir que pour Lacan l'homme est parent de la machine et que selon Freud la passion parasite la recherche intellectuelle analytique. Mais selon les neuro-biologistes modernes comme Antonio Damasio l'acte-émotion influe en permanence sur l'état physiologique et cognitif d'un corps en proie au langage entre l'être et le connaître. Là règne la singularité. C'est le pathos qui est premier. Jean-Didier Vincent : "Pour qu'il y est psyché il faut qu'il y ait l'autre." Il parle de flux de désirs, d' échange du sens, de passion et il veut réhabiliter "la chair, ses éprouvés." Et contrairement aux béhavioristes pour qui l'affect est la conséquence de l'acte : récompense ou punition, il affirme que cet affect précède l'acte, que nos comportements naviguent suivant nos fluctuations de l'humeur, de la relation à l'autre et au monde.*(7)
Il devrait être possible en conservant le cadre des groupes Balint de concevoir une formation pour psychiatres, avec le concours d'un leader extérieur, qui permette de conjoindre psychanalyse et biologie, ce qui pourrait s'avérer fécond et pour les théories de Balint, la psychanalyse et cette même biologie et apporterait une pierre à la définition du PPDC (plus petit dénominateur commun) du psychiatre.
En particulier le chantier primordial d'une compréhension, connaissance du sujet psychotique nous enrichirait. "Le sujet est ce que la psychose révèle dans l'humain en le mettant en question" M. Gauchet.
La participation valant évaluation à un groupe Balint évite la tentation de vouloir résoudre rationnellement le problème de l'inhumain dans l'humain, problème non réductible au social, à l'Histoire : il n'y a pas de Solution Finale. Le monde ne se réduit pas un affrontement de volontés. Ce sont les uvres de culture qui nous transmettent, si peu, les réflexions des ancêtres confrontés à la haine, à l'innocence violée, au péché originel. Les voix disparues imposent le silence, la méditation, non le vacarme, le trop plein d'Internet. Il n'y a pas de science de la praxis en politique, peut-on croire qu'elle existerait en psychiatrie ?
Les incertitudes, les repentirs dans la recherche de vérité qui transpirent dans les uvres de Pinel, d'Esquirol, de Kraepelin, de De Clérambault, de Jaspers, d' Henry Ey, de Lacan ou de Lopez Ibor ne valent-elles pas les certitudes des DSM-TR, RMO, SMR, TOC, TAG, TAA, CGI, SAS-SR, et autres ITT ?
Signature :
Albert Le Dorze
En conclusion et en guise de provocation avec G. Raimbault*(8) je citerai Balint et Lacan. Balint en 1947 : " Comme nous le savons tous, le maniement des pulsions agressives, de la haine a toujours été un problème non résolu et peut-être insoluble de l'humanité." "Les résultats que nous obtenons dans ce domaine - (la formation des analystes) - influenceront profondément non seulement l'avenir de notre profession mais aussi le destin de l'humanité". Douze ans plus tard, lors d'une table ronde réunissant psychanalystes et médecins, Lacan : "C'est toujours comme missionnaire du médecin que je me suis considéré : la fonction du médecin comme celle du prêtre ne se limite pas au temps qu'on y emploie".
Notes :
(1) Association Médicale Mosellane de Perfectionnement Post Universitaire.
(2) Steyer Norbert.
(3) Pichot Pierre. L'approche clinique en psychiatrie. Paris : Les empêcheurs de penser en rond ; 1992, vol.I,
p 7-29.
(4) Bourgeois Marc. EBM Journal, hors série. Editions Rand. L'année psychiatrique 1998 ; p. 1 et 2.
(5) Levinas E. "L'être". Les grandes questions de la philo. Paris : Maisonneuve et Larose ; 1998, p 83.
(6) Lacan J. "L'angoisse." Le Séminaire. Livre X. Paris : Le Seuil ; 2204, p180.
(7) Vincent J-D. Autour de l'uvre d'André Green. Paris : PUF ; 2005, p 364.
(8) Raimbault G. Entre Balint et Lacan. http://perso.wanadoo.fr/liliane.fainsilber/pages/ginette.htm/ p 4.
Il importe de vivre chaud et penser froid plutôt que vivre froid et penser chaud. L'écoute du psychiatre n'est pas celle du psychanalyste.
Il y a quelques années j'ai assisté à un colloque, un de plus, sur les rapports entre psychiatrie et psychanalyse. Les exposés des analystes concernaient naturellement la psychanalyse mais les exposés des psychiatres collaient au plus près de la psychanalyse, au minimum psychanalyse sans divan, celle-ci leur apparaissant certainement comme le modèle idéal de la psychiatrie. La singularité de la psychiatrie du coup disparaissait. J'ai cru comprendre lors de ce colloque qu'il existait une catégorie de psy honteux appelés, avec ironie et condescendance, par les analystes et les psychiatres présents, "chimiatres". Je ne suis pas certain que le mot biologie ait été employé une seule fois lors de ce congrès.
Aujourd'hui il existe une culture ecclésiastique de dénonciation rituelle de l'individualisme moderne ou post-moderne qui accompagne l'hydre d'un capitalisme toujours ultralibéral qui n'hésite pas à formater toutes et tous par l'utilisation impudique, la techno-science, de dressages chimiques et comporte-mentalistes. D'où des individus soumis, assujettis à la consommation de masse, incapables d'accéder à la métaphore et à la poésie, les moutons "sans gravité" de C. Melman(1), quasi décervelés qui acceptent du coup codes, références, protocoles qui règlent une existence privée de toute créativité. Il n'y aurait plus rien à écouter et d'évidence il faut améliorer cela.
En France, la caricature paraît légère si l'on associe nature et génétique à la droite, voire à l'extrême-droite, et la Culture à la gauche. Le problème de l'antibiologisme primaire pourtant se pose. Le déni des théories un tant soi peu biologisantes permet facilement de les qualifier de fantasmes. Se pencher sur la génétique, l'éthologie, l'eugénisme, évoquer Darwin et le principe de sélection naturelle, prononcer le nom de Jean-Pierre Changeux est aussi inconvenant que de s'exhiber, tout nu, un couteau entre les dents à Notre-Dame de Paris, lors de la grand messe pascale. Le qualificatif réductionniste dans une perspective gratuite, laïque et obligatoire devra immédiatement suivre le mot biologie. Il s'agirait ni plus ni moins d'une complicité avec Nietzsche le fasciste qui voulait remplacer l'éducation humaniste par l'élevage surhumaniste, humanisme, pour lui, synonyme d'asservissement, d'euthanasie des passions et des affects. Face à cette barbarie déchaînée il faut opposer bien entendu la culture, les cultures, les constructions sociales, l'anthropologie culturelle et sa déification du relativisme. IL n'y a pas de nature, tout est construction, organisation sociale et culturelle. Afin de réduire un symptôme il faut déconstruire scientifiquement, algorithme combinatoire, ce qui est emprisonné dans les structures langagières. Position psychanalytique d'écoute interprétative souhaitée.
I - Blessures infligées par la biologie, Darwin et la technique à l'écoute psychanalytique pure.
A/ Sloterdijk, philosophe allemand d'extrême gauche, affirme que lire Foucault le nietzschéen c'est se faire arracher le coeur par un couperet Aztèque pour qui a été élevé dans la foi hégélienne, dans le principe d'espérance, dans le confort de la pensée téléologique et la nécessité de l'impératif catégorique, dans le happy endisme de la philosophie de l'histoire, dans le messianisme, dans la croyance au Progrès par l'éducation et la politique. Nous aurions, selon lui, intérêt à congédier le Concept d'Homme au profit de ceux, nietzschéens et foucaldiens, de Vie, de Communauté des Vivants. La psychose, l'homosexualité, le handicap, la négativité illustrent exemplairement cette Vie. Et il convient d'étudier les conditions de possibilité et de réalité de cette vie. Notre vie commune est possible grâce à des systèmes qui permettent notre inscription dans une évolution qui servent à l'orientation dans le monde, au respect des règles qui constituent la religion de la communauté, à l'autoprogrammation culturelle. Selon Sloterdijk nous aurions trop insisté sur l'anthropologie et vraiment pas assez sur l'anthropogenèse.
Darwin a infligé à l'esprit humain une redoutable blessure : le cerveau, ordonnateur du sens, évolue. Or d'un strict point de vue scientifique les théories du formalisme logique - Hilbert dans les années trente - pour qui l'existence des objets mathématiques est extérieure au cerveau humain, ne rendraient pas compte des problématiques néo-darwiniennes. Le langage est aussi confronté à ces lois évolutionnistes. Le cerveau n'est pas une machine simpliste, fixée tel un ordinateur une fois pour toutes, organe des sens - information - mémoire-traduction-action mais une machine vivante d'une extrême complexité, douée de plasticité. Et la culture participe de ce procès adaptatif, devenue outil transgénérationnel. Poincaré, contre Hilbert, estimait que le fondement de la cognitivité résidait "dans le corps, dans ses mouvements, dans la perception, dans le fonctionnement du cerveau en action". Et "il nous faut retrouver le corps agissant"(2), théorie de l'évolution oblige. La pensée selon Alain Prochiantz n'est "qu'un rapport adaptatif entre un individu vivant et son milieu."(3) C'est un jeu des possibles, ce n'est pas une substance déposée dans le cerveau.
L'hominisation présuppose un désir d'échapper à la sélection naturelle et donc de fabriquer techniquement ce que ce Sloterdijk appelle une couveuse, un utérus artificiel qui sécurise les hommes. Ne pas oublier que pour Freud le besoin de sécurité est le plus archaïque car l'homme naît immature, néoténique. Freud recourt explicitement à un argument biologique : la valeur de l'objet qui seul peut protéger contre les dangers du monde extérieur, l'état de détresse, et remplacer la vie intra-utérine perdue en est énormément augmentée. Ainsi donc "le facteur biologique est à l'origine des premières situations de danger et crée le besoin d'être aimé qui n'abandonnera plus l'être humain."(4) Dany-Robert Dufour écrit : " Mon inachèvement de néotène m'autorise une extrême plasticité. Ma débilité me confère la très grande opportunité des êtres faibles."(5) Et il rajoute : "Le néotène a vocation à l'assujettissement à un sujet dominant."(6)
Nos vies sont condamnées à un effort permanent qui vise à dresser des boucliers contre les invasions et les lésions. Pour conjurer la terreur, les traumatismes, les ruptures de l'environnement les hommes ont inventé métaphoriquement, par transposition, des mécanismes comme les religions. L'imagerie de l'habitat premier qui console donne naissance à la nostalgie du paradis perdu, d'un âge d'or oublié. Les systèmes d'opinion des individus font partie de ce pare-excitations, d'où la formule de Nietzsche : la vérité est le genre de mensonge sans lequel l'être humain est incapable d'exister. Le langage permet cette transposition, qui fait du monde "une maison habitable". Mais l'être humain n'existe ni comme divin ni comme animal mais comme monstre. Pour Sloterdijk l'Homme est l'Homme en tant qu'il parle et qu'il élabore des techniques qui permettent de le des-animaliser, qui en font le gardien du Monde. L'homme s'instruit, se forme, se domestique, se défait de telle manière qu'il en devient étranger à lui-même. Il connaît et invente des techniques qui le dénaturent. La psychiatrie est une technique de la couveuse.
B/ Dans le cadre de l'idéologie éducationniste, l'hominisation antibiolo-gique, antinaturelle impose, si l'on veut éviter les enfants-loups, les sauvageons, une éducation, un élevage, une domestication, un dressage social qui ne dit pas toujours son nom. Rien ne serait donné à l'homme à la naissance. Tout est à acquérir, à fabriquer, la nature humaine serait totalement malléable, perfectible, plastique. Il faut absolument améliorer l'homme, le faire sortir des choses naturelles, le guérir de son égoïsme tout aussi naturel, le construire, le finir. Il n'y aurait que cet historicisme condamné par Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Pas de donné, de subi dans la condition humaine. Ce qui compte ce n'est plus l'homme mais l'Homme en marche, l'Homme en totalité, l'Humanité. Nous sommes confrontés à ce que Rocloux(7) appelle l'impératif mélioriste, pédagogie qui ressemble fortement à une mystique du conditionnement. N'est-ce pas François Roustang qui repérait le risque pour la psychanalyse de devenir une hypnose au long cours ? La guérison psychanalytique selon Levi-Strauss se réduit à la réorganisation de l'univers du patient proportionnelle à son adhésion à la mythologie psychanalytique qui participe à un système langagier, symbolique donné d'où elle tire son efficacité. Ne jamais reculer devant les performances demandées à l'élève qui doit faire coïncider son "connais-toi toi-même" avec les valeurs collectives. L'éducation, l'instruction ne doivent pas hésiter devant les punitions, la coercition et même la prison. Les termes de dressage, de soins, d'apprivoisement, de sélection existent déjà dans le Politique de Platon et il était prévu pour le Sophiste un camp de rééducation. Rocloux(8) remarque d'ailleurs que le radicalisme culturel peut devenir, de par la nécessaire assignation des sujets aux normes de la communauté, aussi contraignant que la raciologie pseudobiologique qui se prétend naturelle. L'humanisme classique imposé n'a pas toujours été si paisible -conférer la colonisation-. En tout cas un certain usage de la Raison s'est avéré insuffisant qui n'a pu éviter la guerre, le goulag, l'industrialisation de la mort comme à Auschwitz ou les génocides cambodgiens ou rwandais.
Mais c'est afin d'être conforme à la serre, à l'utérus artificiel, que l'on accepte une autodomestication qui vise à notre dénaturation, à notre élevage, à notre dressage humaniste, quête à l'autoperfectionnement indéfini comme le dit P. A. Taguieff.
C/ Exergues qui concernent l'articulation de la théorie psychanalytique et de la biologie de l'évolution.
1) L'affect et sa représentation
Qu'est-ce qu'un état affectif du point de vue dynamique ? Quelque chose de très compliqué affirme Freud dans Introduction à la psychanalyse. Cela comprend "certaines sensations comme les sensations directes de plaisir et de déplaisir qui impriment à l'état affectif ce qu'on appelle le ton fondamental."(9)
Avec Alain Gibeault nous constatons que :
- La distinction entre sensation et perception prend ici toute son importance quand nous considérons la notion de représentation de chose, puisque la "chose" se présente d'abord par l'intermédiaire de l'affect donc de la sensation et ne pourra jamais être totalement figurable ni totalement dite dans un discours adéquat(10).
- L'objet est investi avant que d'être perçu. La perception du "préobjet" correspond peut-être à une image mnésique, mais celle-ci n'a un sens que par rapport aux affects de plaisir et de déplaisir liés à la satisfaction des besoins et ne correspond donc pas à une représentation de la chose(11)..
Nous établissons un rapport direct entre les sensations plaisir-déplaisir, le ton fondamental de Freud, et l'humeur, définie au sens psychiatrique classique, et nous constatons que la mise en jeu du signe, de l'objet interne est postérieure à celle de la chose affect. Pulsion de mort, endogénéité, ton fondamental s'équivalent et se réfèrent à la même attaque interne du sujet : l'angoisse est le prix à payer au caractère inconciliable de la pulsion et le sujet devra convertir cette excitation par l'élaboration psychique. Tâche strictement interminable, la vie durant.
Ceci rejoint la position d'A. Damasio(12) -et de Prochiantz et de Poincaré- qui nous a appris que l'acte-émotion influe en permanence sur l'état physiologique et cognitif d'un corps en proie au langage, entre l'être et le connaître et celle de Jean-Didier Vincent(13) qui affirme que l'affect précède l'acte, que nos comportements naviguent selon nos fluctuations de l'humeur, de la relation à l'autre et au monde. La biologie contredit ainsi nettement le comportementalisme. Axel Khan(14) superpose à l'héritage de l'évolution les représentations mentales acquises par un individu dans son interaction avec l'autre qui le rendent capable de s'interroger sur la pensée des autres, de prévoir leurs réactions et donc de se réapproprier ses déterminismes innés en particulier sexuels qu'il ne sert à rien, par contre, de nier.
2) La représentation, le signe
Dans la tradition empiriste, le concept de représentation renvoie au redoublement de la chose réelle perçue, devenue trace-image mnésique. Passage de la chose au signe. La linguistique structurale fait de ce signe, rapport du signifiant et du signifié, de l'image acoustique et du concept, une théorie du signe-absence. Le réel, désormais monde extérieur et corps, n'est qu'un axe de référence, comme le dit Benveniste(15), somme toute secondaire.
A partir de la chose-son, l'image acoustique est privilégiée au détriment de l'aspect moteur du langage : la représentation de mot-image acoustique par la liaison avec la représentation de chose-image visuelle devient élément du nouveau jeu linguistique signifiant/signifié. Mais selon Julia Kristeva, en relisant le texte de Freud sur les aphasies, puis l'"appendice C" de la Métapsychologie "nous trouvons non pas le modèle saussurien (signifiant/signifié) mais freudien du signe, nous constatons d'abord que les perceptions et différentes affections coenesthésiques (auditives, tactiles, visuelles, etc.) s'intègrent dans la matrice de ce signe Freudien."(16) "Hommes de langue, hommes de mort"(17) commente Michel Serres qui ajoute : "Le triomphe du verbe écrit produisit une catastrophe perceptive."(18) Roland Barthes(19) estime que le concept est une réduction du divers, du devenir qu'est le sensible, arrogant somme toute. La vision du visage est audition et parole dit Lévinas.(20) O. Paz : l'il pense, la pensée voit, le regard touche.
3) Comme le dit Gauchet(21), la persistance de l'énigme de l'hypnose pose problème. Certes la psychanalyse l'a interprétée mais les phénomènes du coup de foudre, le charisme, l'influence, l'extase chamanique l'emprise du chef sur les masses demeurent toujours aussi insaisissables. Comment expliquer la possibilité pour l'humain de cet assujettissement non conscient à un pouvoir qui est aussi, par identification, une appropriation de l'autre ? La dimension hypnotique du transfert est incontestablement à réinterroger en permanence.
4) Ce sont les mêmes auteurs qui sacralisent le signe saussurien, qui affirment la totale autonomie du représentant-représentation : le désir devient une grammaire de l'inconscient qui occulte la pulsion, le sexuel devient passion du signifiant, le corps souillure, déchet. C'est pourtant Freud qui affirme que "la biologie joue vraiment le rôle du roc" "à travers les couches psychologiques."(22) Ne pas oublier que selon François Jacob(23) l'étude du génome humain ne sera pas politiquement correcte, ce ne sont pas, ajoute-t-il, les idées de la science qui déterminent les passions mais les passions qui utilisent la science. Pour Pierre Fédida(24) le psychologique est purement métaphysique, les phénomènes essentiels sont biochimiques. Nous serions donc au minimum à la recherche de l'inscription biologique de la métaphore. Et Marcel Gauchet constate que la biologie ouvre à la pensée un immense chantier. Derrida jugeait que la psychanalyse était encore dominée par "des institutions, des concepts des pratiques archaïques"(25), par une certaine logique, une certaine métaphysique de la souveraineté comme la toute-puissance du sujet individuel ou étatique. Le déni d'un concept comme celui de mutation hasardeuse n'expose-t-il pas au feu de cette critique ? Levi-Strauss nous invite depuis longtemps à "réintégrer la culture dans la nature."(26) Caducité de l'opposition nature/culture. L'esprit, dit-il, n'est qu'une chose. Il faut désacraliser aussi bien le langage que la biologie. L'écoute du psychiatre impose un athéisme radical.
D/ Dans un premier temps c'est donc la communion autour de grands textes humanistes et littéraires qui a permis l'autodomestication. Puis il y a eu une période post-littéraire, post-humaniste : la technique s'efforce de libérer le corps, partie prenante du monde extérieur. Ce qui du coup intellectualise la relation au monde mais vise toujours à nous libérer des lois biologiques de l'évolution. Position aussi anti-naturelle que le méliorisme éducationniste. C'est la Révolution Française qui marque l'emprise de la science et favorise les ingénieurs au détriment des lettrés. Bailly est astronome, Condorcet mathématicien, Laplace astronome, mathématicien et physicien. Lazare Carnot crée l'Ecole Nationale d'Aérostation, Monge, géomètre, crée l'Ecole Polytechnique en 1794. Désormais ce qui compte du point de vue éducation ce n'est plus que l'enfant soit bien dressé mais qu'il soit compétent. Et c'est cette compétence technique scientifique qui assure l'ascension sociale. L'éducation laisse la place à l'enseignement.
Il convient donc de scruter, de penser l'origine technicienne de ce monde que Montaigne qualifiait déjà de "branloire pérenne." L'auto-domestication, l'auto-éducation transitent en effet par une transformation de plus en plus radicale de ce monde. Il faut parler d'autodomestication car contrairement à l'eugénisme des années 30 ce n'est plus l'État qui décide mais l'individu. La voie est ouverte afin que les avancées de la génétique et de la recherche biomédicale, demande de la couveuse sécuritaire, permettent ce qui veut apparaître comme un simple contrôle biologique du comportement. Sloterdijk, dans sa désormais célèbre conférence d'Elmau, du 17 juillet 1999, "Règles pour le parc humain. Réponse à la lettre sur l'humanisme" (27) affirme qu'il faut réformer les qualités de l'espèce humaine en s'appuyant sur les biotechnologies, donc les chimiothérapies, dont il ne faut pas avoir peur et qui annoncent la fin de l'humanisme classique, obsolète, de la gauche progressiste représentée par Habermas, prisonnière de la recherche obligée du consensus et d'une philosophie de l'Histoire. L'homme nouveau surgira plutôt de nouvelles formes de domestication de l'être. L'immunité divine, céleste, intime, est morte, elle est remplacée par une immunité technique, terrestre, politique. Il s'agit là du noyau dur de la modernisation.
In fine l'homme devient essentiellement un produit technique qui n'apprend ce qu'il est que par l'analyse de ses propres objets. L'artificialité, par la chimie, la génomique, se codifie sur les bases de l'autonomie individuelle. Cette artificialité technique permettrait d'échapper à la régression animale. Pour notre auteur avec l'outil et la machine qui répondent aux besoins de l'utérus artificiel, et l'écoute psychiatrique doit en tenir compte, nous avons affaire à une intelligence sédimentée dans les objets fabriqués qui rend caduque l'opposition entre nature et culture. Il faudrait désormais parler d'une conscience des machines, traduction d'un matérialisme supérieur. La dernière expression de l'antibiologisme qui se défait est le soupir de la belle âme.
L'usager récusera l'éducation autoritaire au profit de ses propres désirs, marqueurs des seules valeurs acceptables. Et il ne voit pas pourquoi la science et la technique ne seraient pas au service de ce qui lui paraît utile en vue de son bonheur, l'antibiologisme accompagne souvent l'anti-individualisme, ne pas oublier que la définition biologique du soi, selon l'expression de Jean Dausset, est donnée par le complexe immunologique majeur d'histo-compatibilité.(28) Et l'usager n'accepte pas non plus que les institutions refusent, récusent, en particulier au point de vue sexuel, ce qui lui semble bon pour les communautés qu'il se choisit librement. Le sujet individuel veut échapper au destin et écrire le récit de sa propre vie. Peut lui chaut que l'impulsion s'origine dans un inconscient quelconque, ce qui lui importe c'est d'être soi-même, non divisé, sans entrave, festif, voué au droit de consommer toutes choses. Et il ne voit pas pourquoi, par la technique, il lui serait interdit de faire coïncider l'imaginaire et le réel. Le corps est exigé totalement disponible, privatisé. Internet est la réalité avec son échelle digitale et son immédiateté planétaire.
Mais chez Nietzsche il existe un autre niveau de vérité dont l'effet est totalement indifférent aux intérêts vitaux des êtres humains ou pire qui peut leur être opposé. Vérités qui transcendent la vie et qui peuvent même être nuisibles à la Vie. Selon M. Foucault il faut distinguer la vérité et l'histoire de la volonté de la vérité. Ce que l'on pourrait comparer à des maladies auto-immunes ou à la pulsion de mort freudienne. Il s'agit de vérités inhumaines, au-delà du bien et du mal. Nietzsche : "Que le savoir avance ! Que la vie périsse !" "Nous avons l'art pour ne pas crever par la vérité." Car il peut exister en effet un conflit fondamental entre le pensable et le vivable. "Comment nous consolerons-nous, nous qui sommes les assassins de tous les assassins ?" La vie est incapable de se supporter telle qu'elle est, elle invente des représentations plus agréables, des transfigurations. "Il faut penser, dit Sloterdijk, "l'écologie cachée de la douleur du monde."
Nous serons toujours soumis à des pensées sans maître qui devanceront radicalement notre expérience subjective, l'intériorité que nous aurons construite. Ces constructions métaphysiques dans lesquelles les hommes se sont installés ne sont que des machineries mentales. On peut se réchauffer dans la vie et supporter le froid dans la pensée. Les humanistes ont froid dans la vie et cherchent à se réchauffer dans la pensée, ils s'appliquent à édifier des nouvelles cathédrales de la communication par des illusions néoréalistes, néotranscendantalistes. Ils se réchauffent d'autant mieux dans la pensée qu'ils précipitent en enfer ce qui, comme la biologie, perturbe la ronde des anges et des saints.
II - Le psychiatre peut refuser les a-priori discutables d'une certaine écoute psychanalytique.
Etre psychiatre permet peut-être d'éviter - ce serait un paradoxe puisque pour Foucault la psychiatrie est surtout une stratégie de défense sociale, d'hygiène publique - le questionnement moderne, queer, posé à l'écoute psychanalytique sur ce qu' il en est des spécialistes de la "fonction psy" qui placent les marques de savoir, comme les feus médecins asilaires, en position d'agents thérapeutiques ; le sommet étant atteint selon Jean Allouch(29) par les analystes qui se veulent spécialistes de l'écoute. J'ai reçu très récemment une invitation pour un séminaire de formation des psychanalystes 2008 réservé, le mot était souligné, aux praticiens qui sont déjà, également souligné, à l'écoute des patients. On se demande bien ce que font les autres, les apprentis. Il doit y avoir un C.A.P de l'écoute ! Plus discrètement J-R. Freymann(30) conclut son livre Introduction à l écoute : "C'est celui qui a la virtualité d'entendre" [l'analyste, sans aucun doute, un spécialiste] "qui introduit chez celui qui parle la capacité parfois de s'écouter. A bon entendeur, salut !" ; phrase censée illustrer Lacan : "Qu'on dise reste oubli derrière ce qui se dit par ce qui s'entend." Mais chez Lacan il n'y a là aucune tendance à la personnification.
Mais pas de discussion possible autour de l'Inceste, de la Castration, de la Différence des Sexes, de la Fonction Paternelle, de l'Ordre Symbolique. Car il s'agit de signifiants, la mystique du signifiant, qui "semblent désigner un ensemble de règles inconditionnées sur lesquelles reposerait la vie même de la société, et plus profondément encore, l'accès des sujets humains à la culture et au langage. Les règles qu'imposerait cet "ordre" [ symbolique ] ne sauraient être modifiées par ce qui se passe dans la société, puisque, précisément, elles sont les conditions mêmes de la culture et donc de toute vie sociale. Elles constituent un fondement à la fois antérieur et transcendant, qui n'est pas susceptible d'être transformé par l'action humaine."(31) Ce sont donc les experts en "fonction psy", les professionnels de l'interprétation, qui légifèrent et disent le Droit pour éventuellement s'opposer à de nouveaux droits conquis par des minorités sociales. De l'écoute psychanalytique à la surdité sociale.
La première phrase de Sabine Prokhoris dans son ouvrage Le sexe prescrit qui date de l'an 2000 "La psychanalyse serait-elle la gardienne de "la loi symbolique" ?" se complète à la page 145 par le jugement suivant : la psychanalyse "n'a pas hésité, à servir de bonne à tout faire aux plus tenaces conservatismes" car elle a introduit "au cur du lien analytique, dans la modalité même de l'écoute, comme pour structurer celle-ci, un modèle de la relation entre les sexes qui construit celle-ci en "differencedessexes."" Pourtant le Phallus conceptuel du Nom-du-Père colle au pénis bien réel du père comme le scotch aux doigts du capitaine Haddock. "Ce signifiant [le phallus] est choisi comme le plus saillant de ce qu'on peut attraper dans le réel de la copulation sexuelle." "On peut dire aussi qu'il est par sa turgidité l'image du flux vital en tant qu'il passe dans la génération."(32) En 1947, Lacan, dans son article "La psychiatrie anglaise et la guerre"(33), était confronté - je cite - à des "sujets mal réveillés de la chaleur des jupes de la mère et de l'épouse." Je trouvais, dit-il "à l'échelle collective l'effet de dégradation du type viril que j'avais rapporté à la décadence sociale de l'imago paternelle dans une publication sur la famille en 1938." En juin 1957, un des chapitres du Séminaire IV s'intitulera: "Les culottes de la mère et la carence du père." En 1966, dans les Ecrits, il poursuivait : "C'est bien ce qui démontre que l'attribution de la protection au père ne peut être que l'effet d'un pur signifiant, d'une reconnaissance, non pas du père mais de ce que la religion nous a appris à invoquer comme le Nom-du-père."(34) Mais pourquoi diable, Dieu ne serait-il pas une lesbienne noire ? En janvier 1958, dans Le Séminaire V les homosexuels sont absolument guérissables : "Savoir si, vraiment le père [avec un petit p] en a ou n'en a pas, et c'est très exactement cela qui est demandé par l'homosexuel à son partenaire."(35) Explication : "C'est la mère qui se trouve avoir fait la loi au père à un moment décisif."(36) Pour Melman(37) la sortie des repères du père patriarcal traumatisant débouche sur le règne généralisé, peccamineux, de l'objet de jouissance, l'objet (a), une nouvelle économie psychique ; si le père est traité comme un "bonhomme", un "rigolo", "un pauvre type", voire comme "un comique"(38) nous passons de la "névrose de papa"(39) à la perversion généralisée, ultime défense contre "la psychose sociale."(40) Déclin religieux du Nom-du-père et humiliation du père -avec un petit p- vont de paire. L'écoute peut même être drôlatique avec Pierre Legendre qui a comparé la revendication du droit à l'homoparentalité à la mise à sac de la Cité par les hitlériens(41) et qui réclame une alliance entre psychanalystes et juristes qui permettrait enfin de construire un ordre juridique et symbolique proprement humain(42). A savoir le sien. Illustration du phallogocentrisme et du familialisme dénoncés par Derrida.
L'inconscient exige-t-il vraiment une Loi du Père s'exerçant sur une mère, naturellement aimante, dans le cadre d'une famille bénite hétérosexuelle ? La fonction psy autorise-t-elle à prévoir les pires malheurs en cas de mariage homosexuel, d'homoparentalité, de transmission du nom de la mère à l'enfant, de l'autorisation des mères porteuses, du surgissement des biotechnologies et pourquoi pas de l'autorisation de la messe en latin ? Le psychanalyste expert peut même prévoir en cas de carence ou de déclin du Nom-du-père des effets catastrophiques sur deux ou trois générations ! Le complexe d'Oedipe n'est-il pas plutôt le mécanisme d'assimilation des règles qui construit le désir hétérosexuel et définit les droits conférés au garçon et ceux dont la fille doit s'accommoder ? Judith Butler estime que l'utilisation du concept de phallus par Lacan équivaut à une énonciation performative d'où ce phallus tiendrait ses propriétés. Ne convient-il pas de s'interroger sur l'articulation du genre sexuel, visible, construction, assignation sociales et la sexualité qui ne saurait se résumer à ce qu'imposerait la cage de fer de la différence, dite naturelle, des sexes ? Pour Jacques-Alain Miller le concept foucaldien d'un corps hors sexe dont les plaisirs seraient multiples mais qui récuserait leur unification sous le grand manteau de la Castration n'est qu'une utopie qui s'appuie sur une "section de perversion"(43). Difficile de décoller -toujours le scotch- ce qu'il en est d'une définition scientifique de la perversion d'une référence à des normes sociales. Mais peut-on politiquement considérer l'homosexualité comme une perversion en 2007 ? C'est le même Jacques-Alain Miller qui déclare en 2003 : "Nom-du-père et signification phallique sont mises à rude épreuve et font preuve de leur insuffisance."(44)
L'Ordre Symbolique hors-temps a pris la succession des normes naturelles, traditionnelles, et des normes religieuses instituées. A l'opposé du tohu-bohu, de la mésentente, caractéristiques de la démocratie toujours à construire. Le rôle du psychanalyste comme de l'ethnologue consiste sans doute à étudier, analyser, peut-être expliquer ce qui est mais sûrement pas à décréter ce qui doit être. Michel Tort : "La même opération se réitère chaque fois qu'un pan de l'édifice dit symbolique (c'est-à-dire religieux) est défait par le mouvement social et politique (procréation, indissolubilité du mariage, hétérosexualité, violence sexuelle, etc.) : On demandera à l'expert en sciences sociales de garantir urbi et orbi l'universalité des représentations religieuses les plus contingentes mais les plus anciennes." (45)
III - Le psychiatre ne vise pas seulement à la connaissance de l'affect mais à la transformation du sujet.
Avec Foucault distinguons rhétorique et philosophie. La rhétorique c'est l'inventaire et l'analyse des moyens par lesquels on peut agir sur les autres par le discours, quant à la philosophie c'est l'ensemble des principes et des pratiques techniques qu'on peut avoir à sa disposition, mettre à la disposition des autres pour prendre soin comme il faut de soi-même ou des autres. Elle ne détermine pas seulement les conditions et les limites d'une connaissance de l'objet mais les conditions et les possibilités infinies de transformation du sujet. Depuis Descartes un sujet pourrait accéder à la vérité sans avoir à se transformer mais ici il est hors de question que le sujet devienne seulement objet d'un discours de vérité scientifique, il faut que cette vérité affecte le sujet. Les discours de l'esprit ne doivent pas seulement entraîner des convictions mais des actes. Le logos vrai n'est pas là pour nous permettre de nous cultiver ou de mieux nous connaître, il nous aide à agir correctement. Deleuze et Guattari remplacent le "qu'est-ce que ça veut dire ?" par le "qu'est-ce que ça produit ?"(46)
Pour Foucault, la parrhesia n'est pas la franchise du tout dire, le courage de la vérité, ce n'est pas la liberté de parole comme la libre association analytique mais la technique, nous retrouvons là Sloterdjik et la couveuse, qui permet au maître d'utiliser comme il faut dans les choses vraies qu'il connaît, ce qui est utile, ce qui est efficace pour le travail de transformation de son disciple. C'est une technique qu'on utilise dans le rapport entre le médecin et le malade, entre le maître et le disciple qui pose des questions qui déstabilisent le maître et qui vise à la transformation, la modification, l'amélioration du sujet. Il s'agit d'un type de discours dans lequel on dit à la fois ce qui est vrai et ce qu'il faut faire, un discours qui dévoile la vérité et prescrit. L'éthique étant la forme réfléchie que prend la liberté, la souveraineté de soi sur soi ne s'exerce pas comme un combat mais comme jouissance. Nous nous constituons en permanence comme le médecin ou le malade de nous-mêmes.
Chez Foucault il est question dans le cadre d'un "régime général et thérapeutique du corps et de l'esprit"(47) de nouvelles formes de subjectivité, de libertés concrètes, de transformations possibles, d'esthétique de l'existence, d'éthique du souci de soi, de pratiques sociales, d'occupations réfléchies et volontaires, d'art de vivre qui aboutissent à une stylisation de la liberté qui serait fort différente des cultes narcissiques du New-Age. Il s'agit d'une "intensification du corps, d'une problématisation de la santé et de ses conditions de fonctionnement" "de nouvelles techniques pour maximaliser la vie."(48) "d'une technologie du sexe"(49) "d'un dispositif de sexualité comme distribution nouvelle des plaisirs, des discours, des vérités et des pouvoirs."(50) C'est ainsi que Paul Veyne écrit : "Le moi, se prenant lui-même comme oeuvre à accomplir, pourrait soutenir une morale que ni la tradition ni la raison n'épaulent plus ; artiste de lui-même, il jouirait de cette autonomie dont la modernité ne peut plus se passer..."(51) Foucault écarte les disciplines psychologiques, produits du pouvoir, des sociétés disciplinaires, il repousse le concept d'intériorité psychique individuelle qui ne serait que l'effet des techniques discursives de domination, d'assujettissement. L'autotransformation de l'humain doit rendre possibles de nouvelles formes de subjectivation en suscitant de nouveaux rapports entre les individus et en multipliant les plaisirs. Le problème n'est pas de découvrir en soi la vérité psychanalytique de son sexe mais d'user de sa sexualité, de pratiquer, d'expérimenter. Il faut cultiver l'extensibilité du soi-plaisir, l'extensibilité du sujet humain comme le dit Léo Bersani(52).
Si la névrose a introduit le conflit comme point constitutif de la personnalité la psychose, comme nous le fait remarquer Gauchet(53), nous interroge sur d'autres arrêtes vives : les contradictions, les antagonismes, les antinomies, le déni, au travail dans toute expérience humaine, entre paranoïa et autisme, seulement paroxystiques dans cette psychose. Le signe d'une intelligence de premier ordre est d'être capable de se fixer sur deux idées contradictoires, sans pour autant perdre sa capacité de fonctionner, notait S. Fitzgerald dans la fêlure. Impossible désormais d'envisager l'humain sans y intégrer sa dimension de folie dont la psychose n'exprime que la limite, la pathologie. Le sujet est ce que la psychose révèle dans l'humain en le mettant en question assène M. Gauchet(54). Le souci de soi conjoint une esthétique de l'existence. L'écoute du psychiatre devrait ainsi permettre la naissance de sujets éthiques, assurant ainsi, selon le souhait de P. Chamoiseau, "la déroute des inerties psychiques." (55)
Notes :
1 Melman C. L'Homme sans gravité. Entretiens avec J-P. Lebrun. Paris : Denoël ; 2002.
2 Bertoz A. In : Le Monde des Débats. Avril 2000 ; p 24.
3 Prochiantz A. Lettre de la schizophrénie. n°19, juin 2000 ; p 17.
4 Freud S. Inhibition, symptôme et angoisse. Paris : PUF ; 1971, p 82-83.
5 Dufour Dany-Robert. Lettres sur la nature humaine à l'usage des survivants. Paris : Calmann-Levy ; 1999, p 60.
6 Dufour Dany-Robert. Ibid. p 105.
7 Rocloux Joël. "La nature humaine à l'épreuve : "Elevage" ou "dressage"." Recherches. Revue du Mauss. La Découverte, 2001 ; n°17, p 51.
8 Rocloux Joël. Ibid. p 48.
9 Freud S. "L'angoisse." In : Introduction à la psychanalyse. Paris : Petite Bibliothèque Payot ; 1985, p 373.
10 Gibeault A. "Pulsion et langage." In : "Excitation représentation de mots et de choses." II. Les Cahiers du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie. Paris : Association de santé mentale du 13ème Arrondissement de Paris, 1983 ; n°7, p 142.
11 Gibeault A. Ibid. p 142.
12 Damasio A. Le Monde. Le 22 septembre 2000 ; p 30.
13 Vincent J-D. Autour de l'uvre d'André Green. Paris : PUF ; 2005, p 364.
14 Kahn Axel. "Et l'homme et la femme dans tout ça ?" Le Monde des Livres. Le 15 septembre 2006 ; p 2.
15 Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris : Gallimard ; 1966.
16 Kristeva J. "Condenser et construire : à propos de l'interprétation dans une cure de border-line." In : Psychologie Médicale. Paris, SPEI, 1982 ; tome XIV, n°9, p 1 369.
17 Serres M. Les cinq sens. Paris : Grasset ; 1985, p 107.
18 Serres M. Ibid. p 277.
19 Barthes R. Le neutre. Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris : Seuil ; 2002, p 200.
20 Lévinas E. "L'Etre." Les grandes questions de la philosophie. Paris : Maisonneuve et Larose ; 1998, p 81.
21 Gauchet M. "Essai de psychologie contemporaine." Le Débat. Paris : Gallimard, mars-avril 1998 ; 99, p 164-181. Et mai-août 1998 ; 100, p 189-206.
22 Freud S. "Analyse terminée et analyse interminable." Revue française de psychanalyse. Paris : Puf, 1975 ; 3, p 402.
23 Jacob F. "Eloge du darwinisme." Le Magazine Littéraire. Paris : mars 1999 ; n°374, p 23.
24 Fedida P. Le Monde des débats. Paris : septembre 1999 ; n°6, p 25.
25 Derrida J. "Pulsion de mort, cruauté et psychanalyse." Le Monde. 11 juillet 2000 ; p 11.
26 Levi-Strauss. La pensée sauvage. Paris : Plon ; 1962, p 294.
27 Sloterdijk P. Règles Pour le Parc Humain. Editions Mille et une nuits. La petite collection ; 2000.
28 Dausset Jean. Prospective et santé. Etoile promotion, 1980 ; n°16, p 9.
29 Allouch J. La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Paris : EPEL ; 2007.
30 Freymann J-R. Introduction à l'écoute. Strasbourg : Eres, Arcanes ; 2002, p 182.
31 Eribon Didier. Hérésie. Paris : Fayard, 2003 ; p 210.
32 Lacan J. "La signification du phallus." Ecrits. Paris : Editions du Seuil ; 1966, p 629.
33 Lacan J. Autres écrits. Paris : Editions du Seuil ; 2001, p 112.
34 Lacan J. Ecrits. "Du traitement possible de la psychose." Paris : Le Seuil ; 1966, p 556.
35 Lacan J. "Les formations de l'inconscient." Le Séminaire V. Paris : Le Seuil ; 1998, p 210.
36 Lacan J. Ibid p 208.
37 Melman C. L'homme sans gravité. Paris : Denoël ; 2002.
38 Melman C. Ibid. p 152.
39 Melman C. Ibid. p 134.
40 Melman C. Ibid. p 120.
41 Legendre P. Le Monde de l'éducation ; décembre 1997.
42 Legendre P. L'Inestimable objet de la transmission. Paris : Fayard ;1985, p 360.
43 Miller J-A. "Michel Foucault et la psychanalyse." Michel Foucault, Philosophe. Paris : Le Seuil ; 1989, p 82.
44 Miller J-A. "Lacan et la politique." Cités 16. 2003 ; p 120.
45 Tort Michel. Fin du dogme paternel. Paris : Aubier ; 2005, p 135
46 Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. Paris : Minuit "Critique" ; 1980.
47 Halperin David. Saint-Foucault. Paris : EPEL, 2000, p 84.
48 Foucault Michel. "Le dispositif de sexualité". La volonté de savoir. Paris : Gallimard ; 1976, p 162.
49 Foucault Michel. Ibid. p 163.
50 Foucault Michel. Ibid p 162.
51 Veyne P. Coté par Halperin. Ibid p 86.
52 Bersani L. Homos. Paris : Editions Odile Jacob ; 1998, p 18.
53 Gauchet M. Ibid.
54 Gauchet M. Ibid.
55 Chamoiseau P. Ecrire en pays dominé. Paris : Gallimard ; 1997.
Note de lecture <em>La route</em>de Cormac McCarthy ; 2006, Editions de l'Olivier, traduction française 2008.
Et quelques survivants. Un homme et son enfant, surgis de nulle part, ayant, comme des cons, manifestement oublié de devenir post-humains. L'enfant était tout ce qu'il y avait entre lui et la mort(1). Aller au sud, vers la mer. Surtout réussir, la nuit, le jour, à allumer le feu afin de ne pas mourir de froid. Crever de faim. Sur la route. Bouffer, manger n'importe quoi, ce que l'on trouve dans les décharges carbonisées, les détritus, les caves qui ont résisté à l'Apocalypse. Ne faire confiance à personne. Tuer pour subsister. Car les post-humains sont des barbares qui redécouvrent les joies de la torture gratuite, de l'esclavage, d'une vie jeu de cirque. Les maîtres devenus animaux supérieurs, surhommes qui dominent et martyrisent des créatures marchant et titubant, des coquilles sans foi. La fragilité de tout enfin révélée. D'anciennes et troublantes questions se dissolvant dans le néant et dans la nuit. L'ultime expression d'une chose emporte avec elle la catégorie. Eteint la lumière et disparaît(2).
Cauchemar récurrent d'Auschwitz : ici il n'y a pas de pourquoi. Chez McCarthy, le pourquoi a explosé. La mort, triomphe de la mort, road movie en enfer. Tout sentiment, cette chose archaïquement humaine, ça encombre désormais. Ça persiste pourtant entre l'homme et le petit :
- D'accord ?
- D'accord.
L'homme se meurt mais qui trouvera le petit garçon ? McCarthy maintient : La bonté trouvera le petit garçon(3). Car elle existerait encore dans ce monde en putréfaction cette putain de bonté ! Encore quelques gentils Une femme, un homme, une petite fille, un petit garçon. Persisterait donc une famille gentille. Ultime refuge ? Non, pas le dernier car il y a Dieu. Mais pour McCarthy c'est la même chose. A la dernière page du livre, sept lignes, la femme, la mère : Elle lui parlait quelquefois de Dieu. Il essayait de parler à Dieu mais le mieux c'était de parler à son père et il lui parlait vraiment et il n'oubliait pas. La femme disait que c'était bien. Elle disait que le souffle de Dieu était encore le souffle de son père bien qu'il passe d'une créature humaine à une autre au fil des temps éternels(4). Dieu après la fin du monde.
Stupéfaction de Freud confronté au nazisme : le progrès a passé alliance avec la barbarie. Et selon Kristeva(5) seuls la religion et le fascisme, mais non les sublimations freudiennes culturelles et scientifiques, pourraient traiter les surplus de haine et d'abjection originaires. Au-delà du principe de plaisir. Dieu est mort, le ciel est vide, le monde désenchanté. Il nous faudrait croire en Eichmann comme prototype de la nature humaine ? Irréductibilité du sacré ? Terreur devant le Mal, la toxicomanie comme seul recours ?
Lire Husserl, H. Arendt, P. Ricur. Découvrir Levinas. Polémiquer avec R. Girard. L'homme n'est-il qu'un humanoïde ? Quelles raisons de vivre soutiennent ce qui banalement s'appelle un homme rationnel ?
Notes :
1.P 31.
2.P 30.
3.P 240.
4.P 244.
5.Kristeva J. Pouvoir de l'horreur. Paris : Le Seuil ; 1980, p 181.