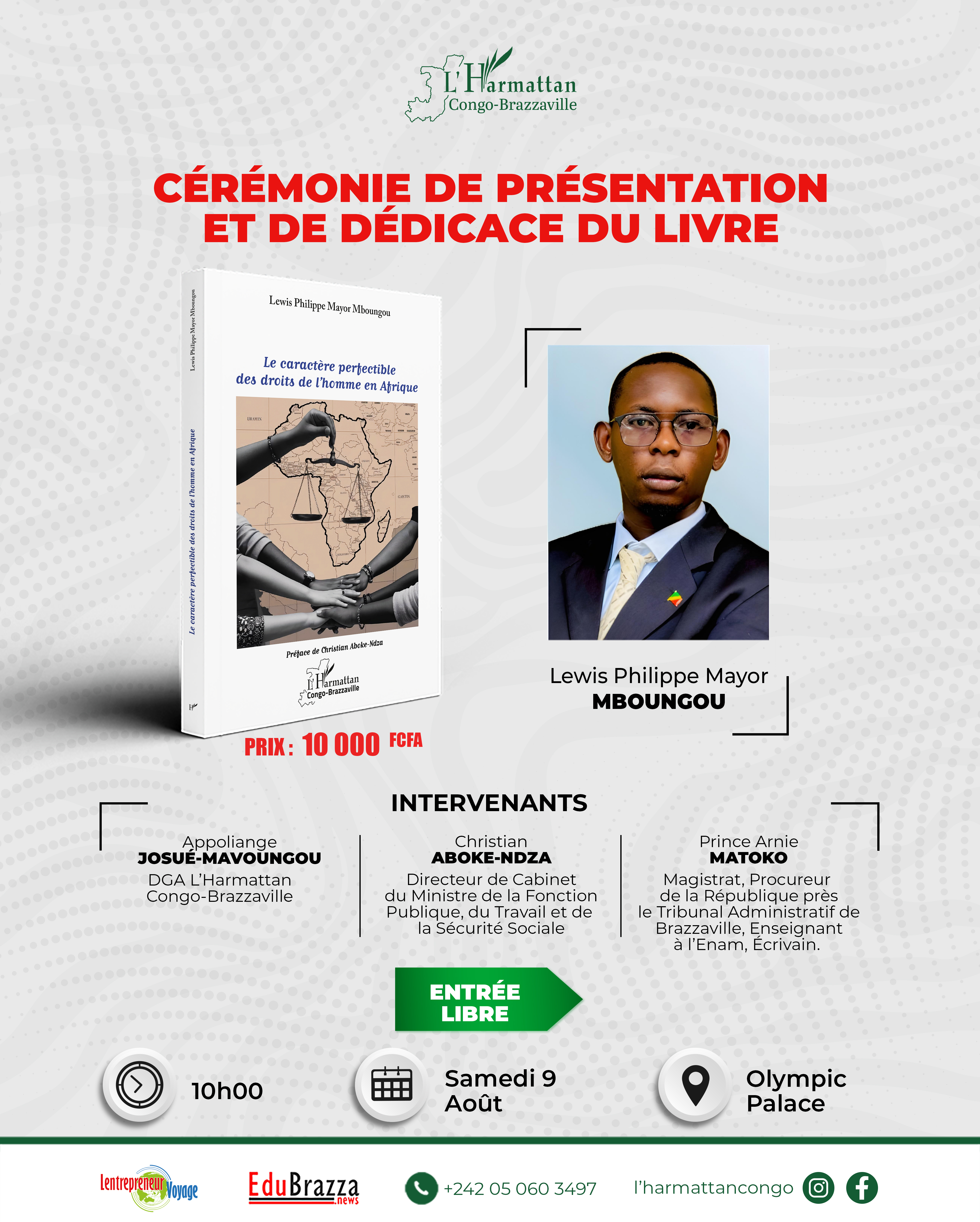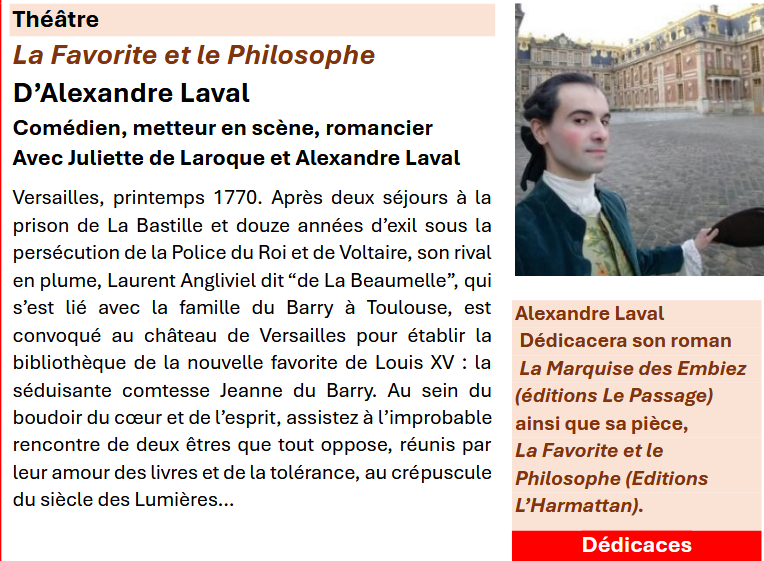Bernard Lutun
ContacterBernard Lutun
Descriptif auteur
Bernard Lutun a suivi des études scientifiques qui l'ont conduit jusqu'à l'Ecole polytechnique, puis à faire carrière dans le corps des ingénieurs de l'armement. Dès son premier poste, de 1979 à 1982, dans un arsenal des armements terrestres, il est amené à réfléchir sur la manière dont cet établissement apparemment industriel est conduit. Il entreprend de nouvelles études en 1986 et en histoire, parce qu'il a compris qu'il ne pourrait mener à bien ses investigations par la méthode sociologique, pourtant supérieure en l'espèce, mais que le milieu n'aurait pas tolérée.
Au lieu d'étudier les arsenaux de son temps et de proposer une réforme simple et trouvée depuis longtemps, mais dont l'application avait toujours été empêchée, il a été conduit à remonter jusqu'au XVIIe siècle, afin de mieux asseoir les conclusions qu'il a tirées de ses années de recherche dans les archives de la Marine et de ses lectures d'ouvrages imprimés.
Le mémoire de maîtrise est consacré à un établissement métallurgique de la Marine au XIXe siècle, dont l'existence a été contestée. L'étude est technique, administrative et politique. Une partie de ce qui relève de la politique est reprise dans une étude plus vaste qui se rapporte à la comptabilité publique en deniers et en matières dont cet établissement devait se servir comme les autres, en lieu et place d'une comptabilité industrielle comme il en existait déjà dans l'industrie.
Le mémoire de DEA a été publié par l'Harmattan en 2005 : c'est l'histoire d'une épuration administrative étudiée de près.
Le mémoire de thèse en deux volumes présente l'organisation générale des deux services de la Marine jusqu'en 1789 et les projets de réforme qui ont été imaginés ou mis en oeuvre afin de relever un service militaire que certains considéraient comme nuisible à l'Etat et irréformable, les officiers militaires étant très difficiles à domestiquer. Un volume de textes commentés sur le service sédentaire (les arsenaux), fait pour illustrer plus simplement, la thèse est disponible séparément chez l'auteur.
Aux livres s'ajoutent 39 articles publiés, et l'édition des mémoires d'un ingénieur du Génie maritime, Jean Tupinier (1779-1850).
Structure professionnelle : 168 C, rue de Lille, 59100 Roubaix
Titre(s), Diplôme(s) : Ingénieur X, ENSTA ; docteur en histoire
Vous avez vu 11 livre(s) sur 2
AUTRES PARUTIONS
2. Essai sur les progrès des blindages (1871-1890), dactylographié, 60 p. ; déposé en octobre 1991. Extrait du précédent. 15 €.
3. La marine de Colbert. Études d'organisation, 288 pages, Paris, Economica, 2003. 37 €.
4. 1814-1817 ou L’épuration dans la Marine, 398 pages, Paris, l’Harmattan, 2005. 32 €.
5. Une autre Marine (1756-1789). Réforme d’une institution, dactylographié, 2 vol., 1 005 p., thèse de doctorat de l’E.H.E.S.S. soutenue en juin 2005 et relue ; déposé en juin 2010. Autoédition. 100 €.
6. Marine militaire et comptabilité : une incompatibilité ? Contribution à l’histoire des finances de l’État français, 339 pages ; déposé en juillet 2007, 2e éd., octobre 2010. Autoédition. 35 €.
7. Les arsenaux de la Marine par les textes (1631-1791), dactylographié, 560 pages, octobre 2010. Autoédition. 45 €.
8. Dictionnaire historique de la comptabilité publique, dir. Marie-Laure Legay, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. Ouvrage en collaboration, période 1500-1850, France et autres États d’Europe. 26 €.
9. Liste générale des élèves et des ingénieurs du corps des ingénieurs-constructeurs de la Marine puis des ingénieurs du génie maritime (1765-1967), suivie de la liste du corps des ingénieurs de l'artillerie navale (1909-1940), 234 p., auto-édition, 2013, 60 €. Avec mise à jour des dates de décès.
10. La Délégation générale pour l'armement (D.G.A.) : politique industrielle et autres problèmes, l'Harmattan, 2019.
11. Des pierres dans la mer ou service inutile, 1er vol. (2019),2e vol. en préparation, autoédition,
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Du grade, du rang et des fonctions des officiers de la Marine sous l'Ancien Régime
(1) Thèse de l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Louis Bergeron. Nous pouvons fournir des exemplaires de la thèse, qui comporte un très important appareil de notes et de références auquel nous renvoyons pour l'essentiel. Elle est longue de 1 000 pages en deux volumes (800 pages de texte et de notes), et nous ne l'avons pas laissé reproduire sur papier par l'A.N.R.T., parce que nous l'avons tant soit peu retouchée en 2010, au moment du dépôt légal, en même temps que nous fournissions une nouvelle bibliographie dépassant l'objet de la thèse.
(2) Les officiers de l'infanterie et des troupes à cheval connaissaient le funeste système de la réforme après chaque guerre, quitte à être rappelés à la guerre suivante, non les officiers de la marine, qui suivaient le régime des deux armes savantes, Artillerie et Génie, même pendant de longues périodes d'oisiveté. Nous ignorons la raison de cette différence, mais les anciens Français n'étaient pas forts en géométrie. Choiseul l'ignorait aussi et il aurait voulu supprimer le système de la réforme dans l'Armée. Ce changement n'a pas eu lieu, alors que ce ministre a fait du bon travail de ce côté-ci du militaire. Nous croyons avoir démontré que le militaire de la Marine l'a berné, comme il a berné Sartine quelques années plus tard, et que Louis XV a peut-être bon dos (voir infra). L'autorité licenciait des régiments entiers, et ce système n'était bon ni pour le service ni pour les officiers pauvres ni pour les finances publiques qui devaient servir des pensions de réforme. Les ordonnances de 1788 devaient y mettre un terme définitif et, dans leur nouvelle composition, les deux armes principales de l'Armée auraient employé 10 000 officiers seulement et tous permanents. Le comte de Guibert (1743-1790) a dénombré sur les registres-matricules 35 000 officiers ou anciens officiers touchant un traitement quelconque, y compris les officiers en activité de service Cela montre qu'il y avait bien du ménage à faire dans l'Armée, où le génie et l'intelligence du Français s'exerçaient autrement mieux que dans la Marine, indépendamment de la question des côtes protectrices de l'Angleterre, de la noblesse, de la population de la France et de l'instinct belliqueux de son peuple, seule la guerre, a écrit Tocqueville, pouvant encore rapprocher la paysannerie de la noblesse, devenues étrangères l'une à l'autre pour le reste.
(3) Les trois ordonnances sont recopiées dans A.N. fonds Marine, A2-21 et A2-22. Les sources issues de ce fonds sont désignées par AN suivi de la cote. Nous précisons la notion d'équivalence in fine.
(4) Lettre du Conseil de marine à l'intendant de Rochefort du 30 septembre 1718, AN, A2-24, p. 184.
(5) L'exposé du "chevalier" de 1782 publié sous le même titre Essai sur la marine est, à bien des égards, une amplification du plan de Petit de 1762, et nous le lui attribuons définitivement (nous avions écrit peut-être dans la thèse). L'auteur se présente comme un lieutenant de vaisseau qui aurait rompu avec son corps et obtenu sa retraite. Le lieu d'impression mentionné est Amsterdam, comme souvent dans les livres publiés sans autorisation. Ce qu'on peut écrire au ministre, sur ordre ou de propre mouvement, on n'a pas le droit de le publier. Le ton n'a pas changé ; le problème reste le même. Nous avons consulté l'exemplaire de la Bnf Lf69-17.
(6) De l'esprit des lois, livre III, ch. 7 et livre IV, ch. 2.
(7) Nous l'avons présenté dans la Revue historique, n° 591, juillet-septembre 1994, p. 3-29.
(8) Mémoire au Roi de février 1791, Marine, fonds des colonies, F3-158.
(9) Ce comportement rappelle celui de la plupart des commandants à la mer à la bataille des Cardinaux (20 novembre 1759) et de plusieurs à la bataille des Saintes (9 et 12 avril 1782) et d'Aboukir (1er août 1798). Dans cette dernière bataille, l'attitude de deux des généraux surtout, Decrès et Gauteaume, est douteuse : ils sont protégés par Bonaparte, mais celui-ci n'a-t-il pas lui-même déserté en Égypte ? La lâcheté a été le trait saillant dans plusieurs batailles navales, et pourtant les coupables n'ont pas été punis ; à la lâcheté s'ajoutait l'insubordination endémique depuis le ministère de Colbert, qui s'en lamentait. Celle-ci n'a disparu qu'après la défaite de Trafalgar, comme par enchantement. Mais la domination universelle de l'Angleterre s'établissait ainsi pour plus d'un siècle.
(10) Il est évoqué dans son autobiographie publiée sous le titre : Mémoires d'un marin granvillais, Georges-René Pléville Le Pelley (1726-1805), éd. Chartrain, Le Pelley-Fonteny et Gosset, Saint-Lô, Cahiers culturels de la Manche, 2000.
(11) La pension de retraite, qui était une grâce accordée aux services exceptionnels ou aux blessures sous Louis XIV, devient peu à peu un droit, comme le prouve le règlement de 1788 et son barème, que nous avons reproduits dans notre étude 1814-1817 ou l'Épuration dans la Marine, Paris, l'Harmattan, 2005.
(12) Choiseul raconte dans le mémoire non daté (AN, G124) qu'il a demandé à Louis XV un travail plus long que d'habitude pour lui exposer son projet pour la Marine un an avant le rapport des ordonnances de 1765 : "J'allais lui lire les moyens que je lui proposais pour corriger ou du moins diminuer [les vices de la Marine], lorsque le Roi m'interrompit avec bonté et pitié, en me disant : "Comment, vous vous êtes donné la peine de travailler autant sur la Marine ?" Il prit alors dans ses mains le mémoire assez volumineux dont je commençais la lecture. Je lui répondis que je croyais de mon devoir, de mon honnêteté et de la persuasion où j'étais de l'utilité de la Marine, de m'occuper sérieusement d'une administration qui m'était confiée ; que je croyais même que, politiquement, la Marine était si intéressante à son royaume que, si j'avais à choisir, je quitterais sans balancer tous les autres départements pour celui-là. "Ne faites pas cela", me dit le Roi, gardant toujours mon mémoire. "Des ministres qui vous ont précédé ont eu comme vous des projets, je les ai laissé faire, ils n'y entendaient rien ; mais à vous, je vous dirai un secret pour que vous ne vous tuiez pas inutilement, et ce secret est qu'il ne peut y avoir de marine en France." Permettez-moi, lui dis-je, Sire, de vous représenter que je ne vois pas d'impossibilité et que je vois une nécessité. "Il ne peut y avoir de Marine en France", répartit le Roi et, en me rendant le mémoire, il ajouta : "Il faut suivre ce qui est, sans innovation, et ne faites pas la folie de vous mettre en tête de faire une chose à laquelle vous ne parviendrez pas"."
Le ministre se dit convaincu que ce serait effectivement une folie de procurer une marine à un roi qui pense ainsi et se rappelle le tour qu'il lui a joué lors de la réforme de la Guerre. Aussi retire-t-il son mémoire et se borne-t-il à travailler de son mieux au matériel de la Marine, en attendant l'occasion de remettre "un département que le Roi estimait si peu". Cette occasion se présente peu après, dit-il, et cette indication donne à penser qu'à partir de ce moment, il commence à se désintéresser des affaires de la Marine, ce qui a fait croire à tort que l'ordonnance générale de 1765 et ses satellites, dont on devine le fond, étaient dus à son cousin et successeur le duc de Praslin (1712-1785). Choiseul a-t-il dit la vérité ?
(13) Aristote comprend dans la classe commerçante "ceux qui se livrent aux opérations de vente et d'achat, au commerce de gros et de détail" (Politique, IV, 4, 10). C'est la place des artisans dans la cité qui est problématique pour certains : sont-ils ou non des esclaves publics ? (II, 7, 22-23). Le peuple est divers : cultivateurs, gens de métier, commerçants, gens de mer (répartis dans la marine de guerre, la marine de commerce, le transport maritime et la pêche côtière). Ce sont des gens libres ou citoyens. Il y a en plus le prolétariat ouvrier et ceux qui tiennent leur origine libre d'un seul parent citoyen (IV, 4, 10). Les nobles et les hommes libres ont des conditions voisines ; "ceux dont la lignée est plus noble sont, plus que les roturiers, de vrais citoyens, et la noblesse d'origine, en tout pays, est à l'honneur ; une autre raison aussi, c'est qu'il est naturel que les descendants d'ancêtres meilleurs soient meilleurs car la noblesse est vertu d'une lignée." (III, 13, 2-3). Platon reconnaît que la cité a besoin de commerçants (La République, livre II), mais il veut que l'on punisse le citoyen qui ferait le commerce (Lois, livre II). En forçant le trait, on peut dire que le maître est conservateur, alors que le disciple est progressiste. Une république ainsi conçue est aristocratique. Ces maximes continuent de faire beaucoup de tort à la France.
(14) Les preuves décisives sont dans le rapport au Roi des ordonnances de 1765 (AN, C1-279), le mémoire justificatif au Roi de la fin de 1765 publié par Calmettes dans les Mémoires du duc de Choiseul, 1719-1785, Paris, Plon, 1904, p. 381-414 et dans le mémoire non daté et surchargé par l'ancien ministre AN, G124, sans la préface). René Estienne a recopié la version initiale (avec la préface) de ce dernier dans son mémoire de l'école des Chartes, mais sans l'étudier. Les AN venaient de l'acquérir. Le mémoire de d'Estaing de 1763 (AN, G175), publié dans le numéro de mai 1910 de la Revue maritime et celui de Bigot de Morogues à Sartine, alors qu'il était chargé de rédiger le projet militaire rejeté en 1764 (AN, G122), les complètent. Les autres mémoires conservés et les deux séries d'ordonnances imprimées (celles de 1764, la principale étant restée en projet et rangée par erreur dans la bibliothèque de Vincennes où nous l'avons trouvée, et celles de 1765) fournissent le résultat avec une précision qu'on aimerait pouvoir montrer dans d'autres affaires.
(15) L'ordonnance des Classes du 31 octobre 1784 dispose que les capitaines affectés à ce service sont des officiers "retirés" un terme qui n'était appliqué qu'à des généraux, à partir de 1756, sans que nous sachions pourquoi au juste, mais Gabriel de Bory n'a jamais pardonné à Choiseul de l'avoir compris dans cette catégorie et mis en fait à l'écart à 43 ans, après son rappel brutal de Saint-Domingue et qu'ils touchent des appointements et non des pensions de retraite. Il y a un point à éclaircir car l'annuaire de la Marine pour 1789 mentionne plusieurs officiers du service des Classes des trois grades d'officier particulier qui sont dits capitaines de vaisseau, etc., et non anciens capitaines comme les autres. Pourraient-ils revenir au service ? Plusieurs y sont revenus à l'organisation du 1er janvier 1792, qui consacre la démolition de l'uvre de Sartine et de Castries du côté militaire. L'ordonnance ne mentionne pas non plus l'interdiction du cumul, et l'on peut supposer qu'un officier militaire retiré qui quitte les Classes quitte le service tout court et touche une pension ou seulement sa pension, alors que les commissaires de la Marine affectés aux Classes sont des officiers civils en activité de service.
(16) Au début de 1785, il reste 180 capitaines, et la liste d'activité ne doit plus comprendre que 80 noms ; on la complète peu à peu par des lieutenants qui ont montré leur valeur, leurs connaissances maritimes et leur bon esprit. Soixante capitaines demandent leur retraite, quarante restent dans l'espoir d'être inscrits sur la liste d'activité. Vingt-deux capitaines ont été promus chefs d'escadre le 20 août 1784, et trente-trois sont placés dans le service (sédentaire) des Classes, qui est partiellement militarisé.
Les rangs des lieutenants ont été éclaircis eux aussi, et le grade d'enseigne supprimé : Castries veut six ans de navigation réelle pour être fait lieutenant quand on est midship, comme en Angleterre. Une étude nominative serait facile à faire, quoique longue : les archives sont plus consistantes, et Castries a importé dans la Marine le dossier individuel institué dans l'Armée en vue des inspections annuelles. La purge de 1762 est plus difficile à étudier, mais, dans les deux cas, on améliorerait grandement les fiches nominatives en carton confectionnées aux Archives nationales. Les résultats des études sur l'organisation de 1669 et sur l'évolution du corps sous Louis XIV sont contradictoires ou au moins confus. L'identité de certains officiers est douteuse, l'état de leurs services, établi à l'époque ou reconstitué de nos jours, manque de précision. Et puis, il n'y a pas que des militaires dans la Marine : il y a aussi des officiers civils, et leur étude ne manque pas d'intérêt.
(17) Des officiers ont été exclus de la Marine pendant la guerre d'Amérique pour faute grave, et Suffren a usé et peut-être abusé de l'autorité déléguée par le ministre pour démonter les capitaines désobéissants et les envoyer à Versailles. De Grasse n'avait pas la même autorité naturelle, pourtant il aurait pu lui aussi démonter des capitaines fautifs : il a été gêné de dire à Castries qu'il n'a pas osé le faire en général, parce qu'ils avaient bien fait le jour d'avant. A la bataille des Saintes (9 et 12 avril 1782), un tiers du grand corps est en ligne, et le petit corps a beaucoup grossi.
(18) L'assimilation des grades est ainsi libellée dans l'ordonnance du 1er janvier 1786 relative aux ingénieurs, art. 2 et 3, Marine A1-140 : "Les ingénieurs directeurs auront rang de capitaine de vaisseau et prendront rang entre eux et avec les directeurs du port et de l'artillerie, après les capitaines de vaisseau ; les ingénieurs sous-directeurs auront rang de majors de vaisseau et prendront rang entre eux et avec les sous-directeurs du port et de l'artillerie après les majors de vaisseau. Au contraire, ils roulent avec les colonels (ou les lieutenants-colonels) suivant la date de leurs brevets et commissions, c'est-à-dire selon leur rang d'ancienneté dans leurs corps respectifs. Dans le premier cas, le rang s'entend comme rang de préséance ; dans le second, le rang d'ancienneté dans le grade entre en ligne de compte, mais toujours dans le cadre de l'équivalence des grades, parce qu'il est improbable qu'un colonel plus ancien commande un ingénieur-constructeur en chef. C'est de cette manière qu'il faut entendre l'assimilation dont nous parlons : elle est faite pour faciliter le service à terre, sans comprendre le service à la mer, qui est exclu. Gautier et Groignard conservent leur grade, mais le texte sous-entend qu'il n'y aura pas d'autres promotions de ce genre ; les officiers de marine ne font pas le service d'ingénieur.
Les ingénieurs ordinaires et les sous-ingénieurs restent des officiers civils, mais ils sont susceptibles d'embarquer pour perfectionner leur pratique et exécuter les travaux prescrits par leurs commandants.
(19) Règlement du 27 avril 1800 sur l'organisation de la Marine, section IV, art. XX, et arrêté du 26 juillet 1800 portant règlement sur l'organisation et le service général de la Marine, section III et section XX, art. LIX. Ces règlements sont insérés dans le Recueil des lois relatives à la Marine et aux Colonies, tome X.
*********
De l'anoblissement par les talents au Royaume-Uni.
*********
Il n'est pas hors de propos de dire quelques mots du système de l'anoblissement par les talents en Grande-Bretagne. L'essence du régime politique anglais reste à la fois monarchique et républicain. Nous l'avons lu plus d'une fois fois dans des rapports ou mémoires au ministre rédigés par des officiers qui enviaient ce régime et souhaitaient son adoption en France. Cette note-ci a eu pour idée première le souvenir de l'anoblissement séparé des époux Thatcher, celui du mari ayant attiré l'attention des critiques, parce qu'il comporte l'hérédité, qu'ils croyaient abolie, alors qu'elle est seulement en sommeil. Nous pensons du reste qu'une telle mesure serait anticonstitutionnelle.
Plusieurs ordres de chevalerie comportant la noblesse dans leurs grades ou classes les plus élevés, les gouvernements s'en sont servis pour récompenser des sujets qui ont bien servi leur pays, et non de la manière ordinaire ou à l'ancienneté. L'ordre de l'Empire britannique est celui qui est le plus souvent employé pour récompenser des artistes. Il comprend cinq classes, dont la première est dite Knight ou Dame Grand Cross (effectif limité à 100 à tout moment) et la seconde, Knight ou Dame Commander (845), et il est ouvert aux femmes depuis sa création en 1917. On trouve dans les listes (séparées) de récipiendaires, Alfred Hitchcock, fils d'épiciers (1980), Elizabeth Taylor (2000), Mary Quant (2015) ou Emma Thomson (2018), qui ont accédé ainsi à la nobility. Les anoblissements sont autorisés par le souverain et lui seul, et les actes revêtus de sa signature.
Les anciennes formes de l'anoblissement, y compris à titre héréditaire, n'ont pas disparu. La pairie (peeress, composée de peers et de baronesses) et l'état de baronet ou de baronetess (1 200 titulaires vivants, dont 240 sont également pairs du Royaume), sont les honneurs héréditaires subsistants. On croyait que cette noblesse s'éteindrait naturellement par l'absence de nominations nouvelles, que les travaillistes avaient obtenue en 1964 en échange d'une noblesse viagère, mais le ménage Thatcher a troublé cet ordre nouveau. Les services éminents de la femme, Margaret (1925-2013) née Roberts, fille d'un autre épicier et d'une couturière, méritaient une récompense éminente. Son mari Denis (1915-2003), homme d'affaires divorcé, n'en avait pas assez, mais le premier ministre a obtenu en partant et apparemment pour lui, le titre de 1st baronet of Scotnet (1991), un titre héréditaire et le premier décerné depuis 1965. Maggie avait peut-être le projet de rétablir l'hérédité dans les faits, mais il est difficile de ne reprocher que des maximes gothiques à un homme politique qui a emprunté certaines idées à la gauche, telles l'opposition à la peine de mort ou le droit à l'avortement. Ses conceptions étaient d'origines diverses, et elle a été bien servie par les circonstances. Au décès de son cher Denis, leur fils Mark (1953) est devenu 2nd baronet (sa sur jumelle est aussi noble que lui, mais sans titre) et ses descendants mâles par primogéniture seront également baronets.
Mrs Thatcher continue de siéger à la Chambre des communes, lorsqu'elle obtient en 1992 un honneur pour ses services, mais sans passer par la voie normale : elle est créée pair du Royaume sous le titre de baroness of Kesteven, mais pair à vie. C'est elle que l'on a voulu honorer dès le début, mais il fallu procéder ainsi, parce que, si les femmes peuvent être anoblies, elles ne transmettent toujours pas la noblesse : celle-ci est bien une convention sociale, comme le soulignait le maréchal de Castries. Remarquons encore qu'elle n'a pas porté son titre, préférant qu'on continue de l'appeler madame, même à la Chambre des lords. Colbert, créé marquis de Seignelay, n'a pas davantage porté son titre, c'est son fils qui s'est fait appeler ainsi. Ce système d'honneurs a donné de très bons résultats dans l'ensemble jusqu'à présent, et la majorité des Britanniques y tient : pourquoi en changeraient-ils ?
Deux innovations de procédés dans la marine à voiles : les plans de vaisseaux et le calcul de leur stabilité
La version complète de cet article, avec les planches, se trouve sur le site de l'AADCNS, au nom de l'auteur.
Notes :
1 Joël Sakarovitch, Épures d'architecture, de la coupe des pierres à la géométrie descriptive, XVIe-XIXe siècles, Bâle, Birkhaüser, 1998, p. 27 et 29, pour ce paragraphe. Voir aussi : Le dessin d'architecture dans les sociétés antiques, actes de colloque, Université de Strasbourg, 1985.
2 Les dix livres d'architecture de Vitruve, corrigés et traduits nouvellement en français avec des notes et des figures [par Claude Perrault], Paris, Coignard, 1673, réimp. Paris, Bibliothèque de l'image, 1995.
3 Perrault suppose que le texte latin de référence est corrompu (par suite des copies successives antérieures). Ce texte est reconnu comme obscur.
4 Joël Sakarovitch, op. cit., p. 36 et 50, pour ce développement.
5 Ibid., p. 43, 45 et 51.
6 Les chantiers des cathédrales, Paris, Picard, 1953 (2e éd. en 1973).
7 Joël Sakarovitch, op. cit., p. 51 et 57, pour ce développement. Alberti affirme que "[Donatello et Brunelleschi] notèrent ceci sur un parchemin quadrillé, avec des annotations chiffrées que seul Filippo pouvait comprendre". Il ne reste aucun dessin ni recueil de notes de l'architecte. L'hagiographe Vasari (1511-1574) écrit que l'architecte avait produit de nombreux modèles pour lui et pour le public, mais qu'il n'avait guère montré ses plans et calculs. Le plan en deux vues de Cologne, bien antérieur, existe encore, et il est doté d'une échelle sinon d'une cotation.
8 Sur la vue en plan, les murs coupés sont hachurés. Sur la vue en élévation ou en coupe, les murs coupés sont représentés en blanc, alors que les pans de mur en vue sont hachurés. Ce sont déjà les conventions actuelles.
9 Le traité de Serlio (1475-1554), publié environ trente ans plus tôt, ne l'est pas.
10 La coupole n'est pas hémisphérique mais ogivale, ayant environ 30 m de hauteur pour 42 m de diamètre, parce que l'ogive exerce moins de poussée que le plein cintre : ici le tambour est mince et on ne peut placer de contreforts. Le poids de la lanterne doit être équilibré par la composante verticale de la poussée des nervures. La double voûte allège la construction par un autre moyen qu'au Panthéon. Elle est bâtie sur un réseau de nervures en pierre verticales (8 principales et 16 secondaires) reliées par huit cercles concentriques horizontaux sur lesquels s'appuient les deux voûtes superposées. La maçonnerie des voûtes en briques disposées en chevrons diminue aussi la poussée. La voûte intérieure a 2,25 m d'épaisseur à la base, 0,75 m à la lanterne. L'échafaudage est fixé au tambour de la coupole et non au sol, il est mobile ; il n'y a pas de cintre. La coupole a été terminée en 1436, la lanterne en 1471. La cathédrale de Florence mesure 153 m de long et 42 m de large. Le record de portée des coupoles maçonnées reste détenu par l'architecte du Panthéon : 43,3 m. Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, tard. de l'éd. de 1568, éd. Chastel, Paris, Berger-Levrault, 1983 ; Peter Murray, L'architecture de la Renaissance, trad., Paris, Electa-Weber, 1973, p. 9-30 ; Giovanni Fanelli, Brunelleschi, trad., Florence, Becocci, 1977 ; Encyclopædia Universalis, Le grand atlas de l'architecture mondiale, Paris, 1985 ; Jean-François Devémy, Sur les traces de Filippo Brunelleschi, l'invention de la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence, Suresnes, Les éditions du net, 2013.
11 Frederick Lane, Navires et constructions à Venise pendant la Renaissance, trad., Paris, S.E.V.P.E.N., 1965, pour ce paragraphe.
12 Jean Boudriot et Hubert Berti, La frégate, étude historique (1650-1850), 1992, p. 32 et ordonnance du 15 avril 1689 pour les armées navales et arsenaux de marine, livre XIII, t. 2.
13 Patrick Villiers, Marine royale, corsaires et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, Dunkerque, 1991, p. 44-45 et 109.
14 Jean Boudriot, "La conception des vaisseaux royaux sous l'Ancien Régime", dans Neptunia, n° 169, décembre 1987, p. 9 à 24, pour ce développement.
15 Reproduit dans le Code des armées navales, recueil annexé au 3e volume de l'Histoire générale de la marine publiée en trois volumes, de 1744 à 1758, p. 27-29.
16 Lettre de Colbert à Pierre Arnoul du 18 septembre 1678, dans Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, I.N., t. III, 1re partie, suite, p. 125-126.
17 Brian Lavery, éd., Deane's Doctrine of Naval Architecture, 1670, Londres, Conway Maritime Press, 1981, pour ce paragraphe.
18 Patrice Decencière, "Influences hollandaises et anglaises sur la construction navale française autour de 1670", Neptunia, n° 258, juin 2010, p. 5-15.
19 Il est conservé au Musée de la marine à Paris et a été exposé récemment.
20 L'ordonnance du 16 septembre 1683 à laquelle nous faisons allusion a été recopiée dans le Ms 421 du S.H.D., Vincennes, 1er vol. des règlements, p. 9-10. La prescription est reprise dans l'ordonnance du 15 avril 1689, l. XIII, t. 1, art. 6, le modèle devant être en bois.
21 Le plan du Jason, de 50 canons, porte l'approbation et la signature du Conseil de marine à la date du 24 mars 1723 (ce plan est reproduit dans l'ouvrage de Jean Boudriot et Hubert Berti, op. cit., p. 24-25).
Une lettre du Conseil de marine du 3 janvier 1720 accompagne un modèle de présentation des plans de vaisseau ; elle répète que les plans approuvés doivent être conservés par le conseil de construction et qu'il est interdit d'y rien changer dans l'exécution (A.N. Marine, A2-24, p. 393-394).
22 Le contenu de cette sous-partie est extrait de ma thèse soutenue en 2005, chapitres 2 et 5, qui envisage la Marine, et surtout le service sédentaire, plutôt comme une institution que comme des chantiers et ateliers ayant une production à assurer. Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution.
23 Ordonnance du 15 avril 1689, l. XII, t. 9, art. 1, 7 et 8.
24 Jean Boudriot, article de Neptunia cité.
25 Ordonnance du 15 avril 1689, l. XIII, t. 3, art. 1.
26 Bruno de Dinechin, Duhamel du Monceau. Un savant exemplaire au siècle des Lumières, Paris, C.M.E., 1999, p. 123-124, pour la fin du paragraphe.
27 Jean-Jacques Brioist, "L'ingénierie cartésienne de Renau d'Elissagaraÿ", Documents pour l'histoire des techniques, n° 16, 2e semestre 2008, p. 169-186.
28 Larrie Ferreiro, "Paul Hoste, premier théoricien de la tactique et de l'architecture navale", Neptunia, n° 262, juin 2011, p. 6-13.
29 Pierre Bouguer, Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements, Paris, Jombert, 1746, préface.
30 Bruno de Dinechin, op. cit., p. 10-12, 19, 72-73 (sa commission de 1739), 131, 177, 345-354, 400, pour ce développement.
31 Ibid., p. 125-126.
32 État des services de M. Duhamel, de l'Académie royale des sciences, inspecteur de la Marine, rédigé par lui-même le 7 février 1765, A.N. Marine, C7-93.
33 Pierre Bouguer, op.cit., pour ce développement.
34 Henri-L. Duhamel du Monceau, Éléments de l'architecture navale ou traité pratique de la construction des vaisseaux, 2e éd., Paris, Jombert, 1758, introduction et ch. 2 et 3, pour ce développement.
35 Article Construction, art du constructeur de vaisseaux, Encyclopédie méthodique marine, 4 vol., 1783-1789.
36 Bernard Lutun, Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution, ch. 12 ou, avec des développements supplémentaires, "Une école pour les constructeurs des vaisseaux du roi de France (1740-1765)", Revue maritime, n° 435, 3e trimestre 1994, p. 106 à 134.
37 Lettre du ministre Maurepas à l'intendant de Toulon du 11 avril 1734, G 47, p. 451-452.
38 Premier mémoire du commis Truguet au ministre, du 26 mai 1761, S.H.D. Terre, A1-3599, pièce 57.
39 Mémoire [du commissaire général de Langerie à la Cour] concernant les rangs des vaisseaux et leurs principales dimensions, recopié dans S.H.D. Marine, Ms 421, p. 343-400. L'extrait paraît tiré d'un mémoire de la Cour, auquel Langerie répond en reproduisant de longs passages.
40 Patrick Villiers, op. cit., p. 699 et 700 et lettre de Fleurieu à Sartine du 17 avril 1780, C7-106. Dans cette lettre, Fleurieu expose que Borda souhaite voir confier les plans du Northumberland à Sané selon ses dernières propositions.
41 Patrick Villiers, op. cit., p. 699.
42 Ibid., p. 703 et 706.
43 Mémoire adressé au Roi par M. de La Luzerne sur les administrations dont il a été chargé, A.N. Colonies, F3-158, p. 496. Si La Luzerne ne cite pas le nom de l'ingénieur dans son mémoire, c'est intentionnellement. Nous avons remarqué qu'il donnait très peu de noms de personnes et toujours de manière élogieuse ; ce sont des modestes, leur utilité doit être illustrée par le ministre, les autres n'ayant pas besoin de lui pour se mettre en valeur. Il ne cache pas son admiration pour Borda.
44 Castries avait autorisé le capitaine de vaisseau de Kersaint (1742-1793) à présenter un projet après expérimentation à la mer, sur le 74 canons le Léopard.
45 Résultats obtenus par le dépouillement des matricules C2-105 et C2-106, d'annuaires imprimés et de divers papiers à caractère personnel (les dossiers personnels ou individuels ont été introduits dans la Marine pendant le ministère du maréchal de Castries, de 1780 à 1787).
46 Observations sur les écoles établies à Paris pour l'instruction des élèves-ingénieurs-constructeurs par l'article IX de l'ordonnance de 1765 qui concerne ce corps, G 89, f° 131 à 136, pour ce développement.
47 C7-48, dossiers au nom de Brun de Sainte-Catherine père et fils.
48 Rapports de Duhamel du Monceau au ministre du 29 août et du 6 octobre 1781, C7-48.
49 Registre-matricule CC2-1015 et Encyclopédie méthodique marine, art. École : "ils ont même aujourd'hui un maître de dessin" ; lettre de Borda au ministre du 7 juillet 1784, C7-254, dossier au nom de Pomet.
50 Lettre de Borda au ministre du 27 août 1783 et rapport de Blouin du 3 octobre, pour ce développement, CC7, D. individuel de Vial du Clairbois.
51 Règlement du 1er avril 1786, art. 7, lettre de Borda au ministre du 5 juillet 1787 et autres renseignements, C7-254, dossier au nom de Pomet, pour ce paragraphe.
52 CC7, dossier individuel de Degay, pour ce paragraphe.
53 Bernard Lutun, "La survie d'une institution de l'Ancien Régime ou L'invention de l'École polytechnique (1789-1801)", Revue historique, n° 586, avril-juin 1993, p. 383-420, pour ce paragraphe et le suivant.
Le destin des groupes textiles Boussac et Agache-Willot : un épisode de la désindustrialisation de la France.
La loi du 13 juillet 1967 (J.O. du 14 juillet 1967, p. 7059 à 7070), complétée par l'ordonnance du 23 septembre (J.O., p. 9634-9637) et le décret du 31 décembre de la même année (liste des tribunaux compétents), s'applique aux affaires dont il est question dans le corps de notre article jusqu'en 1986. Nous l'étudierons donc plus particulièrement, avant d'évoquer sommairement le régime de 1984-1985 et celui de 2005, qui se caractérisent plus par des inflexions plus que par de grands changements.
Cette loi "sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes" contient encore un terme lourd de sens quoique affaibli par l'adjectif qualificatif dans son titre, qui indique une distinction et une restriction d'emploi. C'est la première loi qui distingue réellement le sort de l'entreprise de celui du débiteur. La faillite, c'était en droit et c'est encore dans l'opinion courante, celle du commerçant en difficulté, commençant par la cessation de ses paiements selon l'ordonnance de commerce de 1673 et le Code de commerce de 1807 dans sa version de 1838 (236). Déjà distinguée de la banqueroute par Colbert, la faillite comprend depuis 1889 une forme atténuée, moins infamante pour le commerçant malheureux et de bonne foi : la liquidation judiciaire, qui comporte ensuite le règlement puis le redressement judiciaire et qui permet au moins de conserver l'honneur du commerçant qui paie tout ou partie de ses dettes. Depuis 1935, la faillite s'étend aux dirigeants des sociétés commerciales et, en 1967, à ceux des autres personnes morales de droit privé.
On en est venu à l'idée de la poursuite de l'activité d'une entreprise dont le chef risque d'être sanctionné et à ne plus la liquider dans tous les cas où il l'est effectivement. L'aspect économique prime désormais la sanction. Le droit des entreprises en difficulté, dérogatoire au droit commun, tend en effet à assurer des arbitrages difficiles ou même contradictoires (237). Ils ne doivent pas stigmatiser le débiteur au point de le dissuader de solliciter une procédure collective avant la dernière extrémité. Ils ne doivent pas non plus constituer un effet d'aubaine dont certains débiteurs feraient un simple mode de gestion. Ils doivent ménager les intérêts des créanciers, qui restent les moteurs de l'économie. Les sacrifier en toute circonstance, c'est priver d'autres entreprises de financements dont elles ont besoin ; les privilégier exagérément, c'est risquer de multiplier les suppressions d'emploi. Enfin, il n'est ni sain ni réaliste de maintenir artificiellement en vie des entreprises vouées à la disparition.
Le dispositif de 1967 prévoit quatre procédures différentes selon la situation de l'entreprise : 1° la suspension des poursuites, applicable aux entreprises connaissant des difficultés sans être en faillite (rebaptisée "cessation des paiements"), ajoutée par l'ordonnance ; 2° le règlement judici aire, applicable aux entreprises en faillite mais susceptibles de retrouver une situation économique plus saine à la suite du vote d'un concordat avec les créanciers ; 3° la liquidation judiciaire, qui vise à faire cesser l'activité et à réaliser les biens de l'entreprise ; 4° la procédure de faillite personnelle, qui atteint le chef d'entreprise coupable de mauvaise gestion. La faillite est une sanction, non un délit, qui ne frappe plus que des personnes physiques, dont font partie les dirigeants de personnes morales.
Une entreprise est en cessation de paiements, lorsqu'elle ne peut plus faire face durablement à son passif exigible, c'est-à-dire aux dettes échues et exigées, avec l'actif disponible immédiatement ou sous quelques jours (précisé dans la loi du 25 janvier 1985, art. 3). Ce n'est ni l'insolvabilité ni la gêne momentanée ou accidentelle de trésorerie. Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, commerçante ou non, dit débiteur, qui cesse ses paiements, doit en faire la déclaration au tribunal compétent dans les quinze jours (loi de 1967, art. 1) : c'est, en termes plus familiers, le "dépôt de bilan". Un créancier procède par assignation. Le tribunal peut se saisir d'office après avoir entendu ou appelé le débiteur (art. 2).
Le tribunal constate la cessation des paiements et prononce le jugement de "règlement judiciaire du patrimoine du débiteur" ou de liquidation de ses biens. Il fixe la date de cessation des paiements, qui peut être modifiée sous certaines conditions, sans dépasser celle de l'arrêté des créances ni remonter au-delà de dix-huit mois avant le jugement (art. 6, 29 et 30). Si la date n'est pas précisée, c'est celle du jugement. Le tribunal prononce le règlement judiciaire, s'il lui apparaît que le débiteur peut proposer un concordat sérieux et, dans le cas contraire, la liquidation des biens (art. 7). Il peut convertir le jugement, si le débiteur n'a plus la possibilité de proposer de concordat acceptable.
À la suite de chaque jugement, un juge-commissaire, membre du tribunal, est "spécialement chargé de surveiller et d'accélérer sous l'autorité du tribunal les opérations et la gestion du jugement" (art. 8). La loi de 1967 ne parle pas des administrateurs judiciaires, alors qu'ils existent depuis 1959, mais seulement des syndics, terme ancien qui a disparu de la loi en 1985. Autrefois les créanciers se constituaient en syndicat et élisaient l'un d'eux, appelé syndic, pour défendre à titre bénévole leurs intérêts. Cette mission revenait en fait aux principaux créanciers, des banquiers ou usuriers, qui cherchaient parfois à tirer un profit personnel ou à contraindre le débiteur de présenter des propositions de règlement des dettes (le concordat) plus favorables à certains qu'à d'autres. Devant la technicité de la tâche et le manque de candidats, les syndics sont devenus des professionnels, avocats ou experts-comptables nommés par le tribunal et rémunérés au tarif. En 1959 (décret du 29 mai modifiant l'un des deux décrets du 20 mai 1955), la profession de syndic-administrateur judiciaire est née et elle a été exercée à titre accessoire ou principal selon les tribunaux. Elle n'est pas un titre d'office, mais soumise à un statut défini dans le décret. L'admission est subordonnée à une formation et à un stage, et l'exercice à l'inscription au tableau. À vrai dire, ce décret distingue maladroitement les "syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire", chargés des administrations et des règlements judiciaires, des "administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés", et non les syndics des administrateurs.
L'une des deux lois du 25 janvier 1985, qui remplace le décret du 20 mai 1955, distingue les administrateurs judiciaires des mandataires liquidateurs, devenus ensuite mandataires judiciaires. Cette dernière appellation est encore malheureuse : elle recouvre le nom d'une profession et l'une de ses missions (redressement ou sauvegarde), l'autre étant la liquidation. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires forment la catégorie des mandataires de justice (238). Le mandataire judiciaire (au sens de la mission) est essentiellement chargé de vérifier les créances, d'établir les documents permettant le règlement des salaires et de représenter les créanciers. Sa mission s'achève lorsque les créances sont vérifiées. Si la liquidation fait suite à une sauvegarde ou à un redressement, c'est lui qui devient le liquidateur. L'appellation de syndic de faillite est donc devenue incorrecte en droit français. Les mandataires de justice ont été fort critiqués. Les activités complémentaires permises (conseil, enseignement, expertise judiciaire notamment) sont désormais réduites. En 2011, il y avait 140 administrateurs judiciaires inscrits en France, 408 mandataires judiciaires, 8 355 experts près les cours d'appel et 55 000 avocats.
Sous l'empire de la loi de 1967, un à trois syndics sont chargés des opérations d'administration et de disposition sous la surveillance du juge (art. 9, et art. 16 à 23 pour ce qui concerne les mesures conservatoires). Ceux qui ont été nommés auprès du groupe Boussac puis de B.S.F. ont joué un rôle économique important et actif, se substituant aux administrateurs de droit ou leur servant d'assistants obligés (art. 14). Ils ont l'avantage de ne pas procéder judiciairement et ressemblent davantage aux véritables administrateurs qu'ils ont pu être par ailleurs. Ils doivent compte au procureur de la République du déroulement de la procédure (art. 10). Le juge peut nommer un ou deux contrôleurs parmi les créanciers, qui vérifient l'état de la comptabilité et la situation du débiteur et l'assistent lui-même dans sa mission de surveillance des opérations du ou des syndics ; ces fonctions sont personnelles et gratuites (art. 11 et 12).
Le jugement constitue les créanciers en une masse, personne morale représentée par le syndic, qui seul agit en son nom et peut l'engager (art. 13). Aucun créancier dont la créance a son origine avant le jugement ou qui deviendrait exigible après le jugement ne peut prétendre détenir une créance sur la masse. Tel est le principal avantage de la procédure de règlement judiciaire : les dettes antérieures à la cessation des paiements sont gelées. Le juge-commissaire peut autoriser la poursuite de l'activité, pour trois mois au plus, l'autorisation étant renouvelée par le tribunal (art. 24). Le syndic communique les résultats de l'exploitation à la fin de chaque période. Les administrateurs de droit peuvent être associés à la continuation d'une entreprise en règlement judiciaire (art. 26). Le tribunal peut aussi autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance du fonds selon la loi du 20 mars 1956, et le résilier lorsque le preneur diminue les garanties qu'il avait données (art. 27 et 28).
Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire doit déposer un projet de concordat en vue de l'assemblée des créanciers (art. 67 et 68). Les créanciers privilégiés, par une sûreté réelle ou un privilège, sont avertis qu'ils ont à déclarer dans les trois mois leur intention éventuelle d'accorder des délais ou remises, par une déclaration qui les engage ; le syndic n'est pas tenu de leur communiquer à ce moment les offres du débiteur (art. 69). La convocation individuelle à l'assemblée des créanciers comprend un état du passif et de l'actif et la ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire (qui supporte les réductions, voire l'annulation, cf. art. 45), avec les offres du débiteur. Après la réunion des créanciers et le vote selon des majorités qualifiées (art. 70 et 71), le concordat voté est soumis au jugement du tribunal ; s'il l'accepte, notamment pour son caractère "sérieux", il l'homologue et donc le publie (art. 72). L'homologation le rend obligatoire pour tous les créanciers (art. 74). Le débiteur recouvre l'administration et la disposition de ses biens, à l'exception de ceux qu'il a abandonnés. En somme la société peut se relever grâce à l'allègement de sa dette. Elle peut rester dans les mêmes mains ou, comme la loi ne le dit pas, être cédée, le passif pouvant même l'être pour le franc symbolique, dettes selon concordat en sus.
Dans le cas de non-présentation d'un projet, de refus, de résolution ou d'annulation d'un concord at (art. 72 et 75 à 78), le jugement de règlement judiciaire est converti en liquidation des biens (art. 79). Le jugement de liquidation des biens emporte dessaisissement de l'administration et de la disposition des biens du débiteur (art. 15). Les créanciers sont constitués en état d'union ; le syndic procède aux opérations de vente des actifs en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances (art. 80). Les deniers nets des frais provenant des ventes par le syndic, en principe aux enchères publiques, sont versés à la Caisse des dépôts (art. 81). La société va disparaître, les repreneurs n'achètent que les actifs restants. Le montant de l'actif restant après les ventes, distraction faite des frais et dépens et des sommes versées aux créanciers privilégiés (sans précision), est distribué aux créanciers chirographaires dont les créances auront été vérifiées et admises, en proportion de celles-ci (art. 89 et 90).
Le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens est étendu aux associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social (art. 97) : c'est le cas de Jean-Claude Boussac, seul commandité du C.I.T.F., en 1978. Le tribunal peut faire supporter par les dirigeants d'une société ou par certains d'entre eux tout ou partie des dettes, lorsque l'actif de la personne morale ne suffit pas (art. 99). Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion toute l'activité et la diligence nécessaires (la charge de la preuve est inversée en 1985). C'est l'action en responsabilité dite en comblement de passif. S'ils ne s'acquittent pas de la dette mise à leur charge, le tribunal prononce le règlement ou la liquidation judiciaire à titre personnel à leur encontre (art. 100 et 101). Peuvent conduire à la même mesure l'abus de biens sociaux et la poursuite abusive d'une exploitation qui devait conduire la société à la faillite c'est, semble-t-il, le cas de Marcel Boussac (art. 101). L'effet de cette seconde action est bien plus redoutable, parce qu'au passif de la personne morale s'ajoute le passif personnel ; la date de cessation des paiements est la même.
Le commerçant ou les dirigeants d'une personne morale peuvent être condamnés à la faillite personnelle, qui n'est pas un délit, mais qui emporte diverses interdictions. Elle est prévue mais non automatique aux art. 106 à 108 : retenons ici la soustraction de la comptabilité ou son insuffisance ; l'usage de biens sociaux comme des biens propres ; les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ; l'incompétence manifeste ; la mise en liquidation de biens à titre personnel ou, s'il s'agit d'un règlement judiciaire, le refus de concordat ou sa résolution. Dans les deux derniers cas, la sanction de la faillite personnelle peut s'appliquer, si les intéressés n'acquittent pas leurs dettes (art. 109). La réhabilitation (art. 113 à 125), de plein droit ou non, vise les personnes physiques et les personnes morales. Elle est notamment prévue en cas de remboursement toutes les dettes ou remise entière par tous les créanciers ou encore leur consentement unanime à la réhabilitation. La banqueroute simple ou frauduleuse est un délit ; elle entraîne la faillite personnelle (art. 126).
Le rapport de l'ordonnance du 23 septembre 1967 au président de la République est reproduit en préambule. Nous le résumons ci-après (239). Les entreprises visées par "la suspension provisoire des poursuites et l'apurement du passif" sont celles dont la disparition causerait un trouble grave à l'économie nationale ou régionale. Deux conditions nécessaires sont mises : l'entreprise n'est pas en cessation de paiements et le tribunal juge qu'elle peut se redresser en trois ans au plus. Ces affaires sont confiées aux principaux tribunaux, ceux qui sont le mieux outillés, et leurs présidents y jouent en principe le rôle de juges-commissaires.
Il convient d'observer les signes avant-coureurs des difficultés et d'exploiter les sources de renseignements, d'étudier les réformes à faire et de chercher des concours. Dès que les difficultés ont pu être décelées et les remèdes envisagés, la procédure doit être mise en uvre rapidement, normalement par le débiteur. La première phase commence par un jugement d'ouverture qui suspend l'exercice de toutes les poursuites par les créanciers et interdit au débiteur tout acte de disposition étranger à l'exploitation normale et le paiement de créances nées avant le jugement. Celui-ci nomme un ou des "curateurs aux biens" chargés d'assister le débiteur ou même de le représenter. Le débiteur dispose de trois mois pour présenter un plan de redressement de sa situation. Il n'a pas le caractère d'un concordat, vu l'urgence ; c'est un acte unilatéral du débiteur ou de son représentant judiciaire. La première phase prend fin par le jugement qui statue sur le plan. Pour l'admettre, le tribunal peut exiger le remplacement des dirigeants ou fixer des délais de paiement. Le "commissaire à l'exécution du plan" la surveille et rend compte périodiquement au président du tribunal. Le plan d'apurement du passif, qui s'étend sur trois ans au plus, prolonge la suspension des poursuites. Le tribunal peut prononcer sa résolution, si le débiteur ne respecte pas les échéances. Afin de prévenir l'abus de la nouvelle procédure, un nouveau cas de règlement judiciaire ou de liquidation, assorti d'une sanction pénale, est prévu, en cas de non-exécution des obligations du plan ou d'irrégularités, ou encore d'actions interdites (art. 46 à 48 de l'ordonnance). Les voies de recours, qui entraînent des longueurs préjudiciables, ont dû être abrégées ou supprimées.
L'esprit de la loi de 1967 est celui d'une période de grande croissance économique pendant laquelle les faillites représentaient 9 à 10 000 dossiers par an (237). Celui des lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (qui modifie la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judici aire des entreprises elles ont été codifiées en 2000 avec leurs règlements reflète le changement de majorité politique et le retour de la crise : il y a alors près de 23 000 dossiers. On a reproché à la loi de 1967 de privilégier le désintéressement des créanciers par rapport au maintien de l'activité des entreprises, de conduire à la liquidation l'immense majorité d'entre elles après une procédure longue et complexe et avec un résultat financier médiocre, notamment en ce qui concerne les créanciers chirographaires. L'objectif principal de la législation nouvelle est la préservation de l'activité et donc de l'emploi par des mécanismes de prévention et de traitement préalables des difficultés des entreprises et, dans le cas où le remboursement des dettes est impossible, du maintien avant tout de l'activité et de l'emploi. La procédure de règlement judiciaire est modifiée sous le nom de redressement judiciaire. Une période d'observation obligatoire est prévue, mais une loi de 1994 en fait une étape facultative, lorsque l'état de l'entreprise la rend inutile. Ces objectifs n'ont pas été atteints et les critiques adressées à la législation de 1967 se sont renouvelées à l'usage. En 2003, près de 45 000 jugements d'ouverture ont été prononcés et ils se sont soldés, dans neuf cas sur dix, par une liquidation. Le maintien de l'entreprise, possible dans 6 à 8 % des cas, se fait aux dépens des emplois dans le cadre de la procédure de redressement. Si un plan de continuation de l'entreprise est adopté, il se termine par un échec dans près d'un cas sur deux dans un délai de deux à trois ans (240).
Une nouvelle réforme a donc été jugée nécessaire : c'est l'objet de la loi 845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises et de son décret d'application 1677 du 28 décembre, actuellement (2021) en vigueur. Elle privilégie la prévention et la négociation. En voici les nouveautés principales (241).
1. La procédure nouvelle dite de sauvegarde des entreprises, qui s'ajoute aux procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires) doit permettre le sauvetage d'une entreprise et des emplois dès l'apparition des premières difficultés sérieuses. Le chef d'entreprise en a l'initiative. Il garde la gestion de son affaire, l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal ayant pour seule mission l'assistance et la surveillance. Les poursuites des créanciers sont suspendues et le passif antérieur du débiteur gelé afin de permettre la réorganisation et, le cas échéant, une négociation entre l'entreprise et les créanciers réunis dans deux comités (les banques et les principaux fournisseurs). Si les propositions sont rejetées, la décision revient au tribunal, qui veille à l'intérêt de tous les créanciers. À l'issue d'une période d'observation de six mois renouvelable une fois, et s'il existe une chance sérieuse de sauvetage, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui définit les modalités de la poursuite de l'activité. La cession d'une ou de plusieurs activités peut être envisagée. Le mandataire judiciaire (au sens de la mission) est essentiellement chargé de vérifier les créances, d'établir les documents permettant le règlement des salaires et de représenter les créanciers. Sa mission s'achève lorsque les créances sont vérifiées. Si la liquidation fait suite à une sauvegarde ou à un redressement, c'est lui qui devient le liquidateur.
2. Le règlement amiable est remplacé par la conciliation, aussi confidentielle et d'un caractère plus contractuel. Le conciliateur nommé par le tribunal pour quatre ou cinq mois doit favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, afin de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. L'accord se traduit par une ordonnance exécutoire qui n'est pas publiée, sauf si le débiteur le demande. Le tribunal s'assure dans ce deuxième cas que la pérennité de l'entreprise est assurée et que les créanciers non signataires ne sont pas lésés.
3. La loi de 2005 étend le bénéfice de la conciliation et des procédures collectives aux personnes physiques exerçant une profession indépendante, y compris une profession libérale sous statut ou dont le titre est protégé.
4. Les dirige ants dont l'honnêteté n'est pas en cause mais qui commettent des fautes graves énumérées dans la loi doivent rembourser tout ou partie des dettes de la personne morale ; la durée maximale de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer est limitée à quinze ans. L'omission de la déclaration de cessation des paiements n'entraîne plus la faillite personnelle, mais seulement l'interdiction de gérer. Le débiteur placé dans cette situation peut être réhabilité "s'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler" une entreprise. Cette condition nouvelle s'apparente à une formation professionnelle.
La Marine et les conseils (1788-1824)
Abstract. The present article describes the introduction into a central administration until then composed solely of aides with no delegated authority, of : first, administrators who had broader oversight than the premiers commis [top aides] and to whom the Minister delegated authority for the so-called "detail" tasks ; and, second, a conseil supérieur [Superior Council], the prerogatives of which varied from project to project but included, most of the time, the preparation of bills which were to be submitted to the Prince a task which had long been entrusted to the Minister, who had been assisted in this by his staff or by ad hoc committees of officers.
Notes :
(1) Ordre dans lequel les bureaux de la Marine sont actuellement divisés et nouvel ordre dans lequel on proposerait de les former, [fin 1780], 306AP20, pièce n° 13(14), pour ce développement. C'est un propre non daté, mais apostillé "bon" par Louis XVI. Les documents d'archives invoqués dans cet article sont extraits des archives centrales de la Marine (conservées aux Archives nationales à Paris et au Service historique de la Défense, département Marine à Vincennes), et des Archives nationales, série AP. Le dernier chapitre de notre thèse de doctorat reproduit en partie cet article.
(2) Un mémoire contemporain, intitulé simplement Directeur général de la Marine et dont un exemplaire est de la main de Fleurieu, n'est pas plus net à cet égard. En revanche il annonce la partition du bureau des Officiers. L'auteur juge que le poste serait à confier à un officier général. C2-120.
(3) C2-45, f° 202.
(4) Idem.
(5) Lettre autographe de Claret de Fleurieu au ministre du 21 janvier [1781], C7-106.
(6) Idem.
(7) Lettre du ministre à Claret de Fleurieu du 27 février 1781, copie, C7-106.
(8) Lettre d'Hector au ministre du 15 janvier 1781, 296AP2. Hector est le fils d'un enseigne mort au service, il est originaire d'Anjou (C7-140).
(9) Cette convocation est mentionnée dans le dossier à son nom C7-184.
(10) Lettres d'Hector au ministre des 24 et 26 janvier et du 21 février 1781, 296AP2 ; Mémoires de la vie et de la carrière du comte d'Hector, 1806, p. 64 et 67, 296AP1.
(11) C7-140, dossier au nom d'Hector. Il émigre en Angleterre en février 1791, et son attitude pourrait avoir dicté celle de nombreux officiers du département de Brest, tant son autorité morale était grande.
(12) Latouche-Tréville (1745-1804), capitaine de vaisseau du 20 juin 1781, est directeur du port de Rochefort sous les ordres de son oncle Latouche-Tréville (1712-1788), qui a succédé à son père en tant que commandant du port, lorsque le ministre l'appelle à Versailles (C7-184). La date de nomination à la place de directeur adjoint des ports et arsenaux est le 27 février 1785 (C2-120).
(13) Observations sur l'état actuel de l'administration de la Marine à Versailles, à l'occasion du projet de donner à M. de Clugny une correspondance particulière de détails avec les ports. Pour M. le marquis de Castries seul, 18 février 1782, copie, pour ce développement. C2-120.
(14) Mémoire [au Roi] sur la division et la répartition du travail dans le département de la Marine, avril 1783, C2-120, pour ce développement. Il s'agit d'une mise au net accompagnée d'importantes modifications de forme de la main du ministre.
(15) D'après une note autographe du maréchal de Castries datant de 1786, C2-120.
(16) Lettre d'Hector au ministre du 17 janvier 1782, 296AP3.
(17) C7-93, C2-120 et Biographie universelle de Michaud, t. 12 (1814). D'après le Michaud, Dufresne, homme d'origine modeste, a d'abord travaillé chez des négociants de Bordeaux, puis en qualité de commis aux Affaires étrangères pendant le ministère de Choiseul. Des banquiers qui l'ont employé l'ont recommandé à Necker : voyant en lui plus qu'un comptable ordinaire, le directeur du Trésor fait de lui un premier commis. Il a pu le recommander au ministre de la Marine, qui est son ami.
(18) Notes diverses, C2-119. La note du 8 juillet 1785 mentionne le transfert à la direction générale des détails des officiers militaires et des ingénieurs-constructeurs ; celle du 12 mars 1786 contient le passage suivant : "Le bureau du contrôle des Classes ayant été divisé en deux parties, celle qui a passé sous M. Pouget a reçu la dénomination de bureau du commerce maritime et des pêches". Le départ de Pinet permet à Pouget de diriger le nouveau bureau, et cette charge vaut 6 000 l (en plus des 12 000 l de sa commission de commissaire général des Classes).
(19) Nous avons pu dresser un tableau nominatif du personnel de l'administration centrale vers le mois d'août 1787 à partir des renseignements trouvés dans C2-119 et 120, C2-59 et 306AP22, pièce n° 11.
(20) Réf. précédente.
(21) État de ce qui doit rester dans les bureaux du département, après avoir séparé ce qui est étranger, 1er avril 1788, signé La Luzerne, et État des établissements et des particuliers qui ont jusques ici été mal à propos inscrits dans celui des bureaux et qui doivent être payés sur le département de la Marine [ou des Colonies], idem, C2-119. Il manque les inspections.
(22) Note 20.
(23) La dépense paraît moins forte en 1787 qu'en 1785 et le budget de 1788 a dû être légèrement dépassé.
(24) Kersaint fait justement remarquer qu'aucun employé ne devrait être juge et partie dans de telles places : or, le reproche le plus grave qu'on ait fait à Latouche-Tréville est d'avoir "conservé des droits à des grâces dont il était devenu le dispensateur" ; son intégrité et son impartialité n'ont pas suffi à désarmer les critiques. Réflexions d'un homme de mer sur la constitution de la Marine, son administration et sa régie ministérielle, non signé ni daté (début de 1788, nombreuses corrections autographes), C2-120.
(25) Mémoire pour le Roi du 31 mars 1788, C2-119, pour ce développement. Les appointements de Dufresne paraissent diminués de moitié : est-ce la raison de son retour aux Finances ?
(26) Note pour le ministre du 10 février 1786, C2-119.
(27) Référence 25.
(28) Lettre de Latouche-Tréville à Hector du 14 décembre 1787, 296AP8. Latouche-Tréville est devenu franc-maçon en 1786. Du Crest de Saint-Aubin (1748-1824), son prédécesseur, a fui en Angleterre à la fin de 1787 pour échapper à l'arrestation. Il a dû remettre avant de partir et d'ordre du Roi sa démission. Hubert La Marle, Philippe-Égalité, "grand maître" de la Révolution, Paris, Nouvelles éditions latines, 1989, p. 90, 92, 93, 96, 102, 806 et 807.
(29) La distance avec le maréchal de Castries est moindre, mais ce ministre ne l'aurait pas choisi non plus, même s'il s'est inspiré de plusieurs de ses mémoires de réforme. Kersaint ne publie pas de brochure avant la fin de 1788 (Le bon sens) : sa vocation politique est née du dépit.
Madame de Blot note, à la date du 6 février 1785 (Journal des sept années du ministère du marquis devenu maréchal de Castries, commencé le 13 octobre 1780, Ms 182, f° 280 et 281) : Louis XVI dit de l'auteur du Traité d'administration des finances qu'il "abonde trop dans l'esprit du moment, il semble qu'il interpelle le peuple et qu'il veuille l'animer", et encore qu'il "ramène à l'indépendance et à l'esprit actuel". "Le Roi dit qu'il sait que le public parle beaucoup, il cite M. de Kersaint comme un frondeur de tout ce qui se fait et paraît souhaiter que le maréchal arrête ses déclamations." Calonne (1734-1802) accuse Kersaint de nuire à son crédit. Castries répond : "M. de Kersaint est un bon officier, mais ce n'est pas mon ami, et je ne saurais répondre de lui et encore moins de ce qu'il dit."
Le ministre avertit Kersaint et Dufresne de la part du Roi qu'ils doivent se montrer plus circonspects. Il s'est renseigné auprès du lieutenant général de police Le Noir (1732-1807), qui lui a signalé que Kersaint vivait avec une femme (ce n'est pas la sienne) qui avait mauvaise langue et était "très répandue dans la finance". Réponse autographe de Castries à Louis XVI, 306AP22, pièce n° 2(3).
Dans un mémoire destiné à La Luzerne déjà cité, Kersaint, peut-être avec l'aide de Fleurieu, écrit : "L'homme supérieur à qui nous le destinons [le mémoire] y découvrira bien ce que nous nous abstenons d'écrire et jugera si nous sommes capable en effet de tenir nos promesses, et, dans un moment où tout fermente, où la nation inquiète va recevoir un nouvel être, où les esprits préparés à de grands changements flottent entre la crainte et l'espoir, il nous pardonnera de céder à une impulsion secrète qui nous pousse vers lui sans le connaître pour lui découvrir de grandes vérités. Dominé par l'amour du bien et dévoué au service du Roi, ce motif, s'il nous a fait commettre une faute, en sera aussi l'excuse." Réflexions d'un homme de mer sur la constitution de la Marine, son administration et sa régie ministérielle, s.d. [début 1788], C2-120. Kersaint était en 1775 un émule du chevalier d'Arcq. Peut-être l'expérience de la guerre d'Amérique l'a-t-elle converti au libéralisme, à moins qu'il ne s'agisse d'une suite de son concubinage.
(30) Essai sur la Marine, où l'on propose une nouvelle constitution, par le chevalier de***, ancien officier de la Marine, Amsterdam, 1782, p. 56 (BnF Lf69-7).
(31) [Gabriel de Bory], Mémoires sur l'administration de la Marine et des Colonies, P. D. Pierres, 1789 (S.H.D. 54G1), pour ce paragraphe.
(32) Mémoires de M. Malouet, intendant de la Marine, sur l'administration de ce département, 1789, p. 165 à 172, pour ce paragraphe (S.H.D. 27H19).
(33) Ms 182, f° 50 (17 décembre 1780), 217 (16 décembre 1783), 240 (8 juillet 1784) et 375 (lettre de Castries du 23 juin 1787), pour ce paragraphe.
(34) Mémoires de M. le comte de Saint-Germain écrits par lui-même, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1779, pour ce développement. Il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais d'un ensemble de mémoires faits lorsqu'il était ministre ou avant sa nomination et qui servent à rendre compte du plan qu'il avait formé. Saint-Germain ajoute : "c'est une justification que je me dois et qui pourra ramener les opinions qui me sont devenues si contraires". Le "grand mémoire" est antérieur à son accession au ministère, il est reproduit p. 128 à 256.
(35) Règlement fait par le Roi portant établissement d'un conseil d'administration du département de la Guerre, sous le titre de Conseil de la Guerre, du 9 octobre 1787, préambule, pour ce développement. S.H.D. 3S3-12.
(36) Ibid., art. 1.
(37) Ibid., art. 14 et règlement du 23 octobre 1787, art. 17 et 18, pour ce développement.
(38) Règlement du 9 octobre 1787, art. 15 et 16 et règlement du 23 octobre 1787, art. 15, pour ce paragraphe.
(39) Règlement du 9 octobre 1787, art. 2 à 4, 19 et 20 et règlement du 23 octobre 1787, art. 22 et 24, pour ce paragraphe. Ne sont exclus du choix que les officiers généraux qui sont en résidence permanente dans les places et ceux qui sont employés aux colonies (règlement du 9 octobre 1787, art. 6).
(40) L'art. 37 du règlement du 19 mars 1788 s'énonce ainsi : "La discussion et la comptabilité des fonds du département de la Marine étant un des principaux objets confiés à la surveillance du conseil, il est autorisé à se faire fournir par le bureau des Fonds toutes les pièces, états et renseignements qu'il jugera nécessaires, soit pour se procurer des éclaircissements, soit pour faire observer les règles et formes auxquelles aura été soumise cette comptabilité."
(41) Règlement du 9 octobre 1787, art. 7 à 10, 12, 17 et 21, pour ce paragraphe.
(42) Règlement du 9 octobre 1787, art. 23 et règlement du 23 octobre 1787, art. 7, pour ce paragraphe.
(43) Règlement du 9 octobre 1787, art. 24 et règlement du 23 octobre 1787, art. 9, 11 et 29, pour ce paragraphe.
(44) Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales (1788), cité par André Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante, Paris, P.U.F., 1989, p. 80-81.
(45) Règlement du 9 octobre 1787, art. 25, 26 et 28, pour ce paragraphe.
(46) G149, pièces n° 67 à 69, pour ce développement.
(47) Règlement fait par le Roi portant établissement d'un conseil d'administration du département de la Marine, sous le titre de Conseil de la Marine, du 19 mars 1788, préambule. Le plan embrasse en fait tous les ministères en matière budgétaire et financière, et l'on a commencé par les deux départements les plus dépensiers.
(48) Ibid., art. 1.
(49) Ibid., art. 2 à 5, pour ce paragraphe.
(50) Les lettres de nomination ont été envoyées le 3 avril, y compris à Dufresne, ce qui donne à penser que La Luzerne ignorait encore qu'il devait quitter la Marine pour le Trésor (C2-119). On ne chôme pas car Borda annonce par sa lettre du 20 avril à Hector que la première séance est prévue le vendredi 25 (296AP8).
(51) Règlement du 19 mars 1788, art. 4, pour ce développement.
(52) Mémoires de la vie et de la carrière du comte d'Hector, 1806, p. 79-80 (296AP1).
(53) Mémoire sur les vaisseaux de garde , du 10 octobre 1786, 306AP24, pièce n° 1. Kersaint n'aime guère Hector, et c'est aussi un moyen d'éviter son omnipotence.
(54) Mémoires de M. Malouet, intendant de la Marine, sur l'administration de ce département, 1789, p. 86 à 89, pour ce développement.
(55) Ce conseil résulte de la fusion des deux conseils des Finances et du Commerce par le règlement du 5 juin 1787.
(56) Le règlement du 19 mars 1788 stipule, comme celui du Conseil de la Guerre, que tout ce qui sort du Conseil de la Marine est présenté au Comité intime de la Marine pour décision (art.27). Pourtant l'art. 29 indique que certains projets pourraient être simplement mis sous les yeux du Roi par le ministre, c'est-à-dire lui être présentés lors d'un travail.
(57) Règlement fait par le Roi pour la réunion de ses conseils, du 9 août 1789, pour ce développement. Toutes les nominations aux charges, emplois et bénéfices dans l'Église, la magistrature et les administrations de l'État sont dorénavant présentées à la décision du Roi dans son conseil, pour mettre plus d'accord et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections (art. 2). Tous les officiers du Roi sont concernés par cette mesure.
(58) Pierre-Victor Malouet, "Rapport fait à l'assemblée nationale ", 20 avril 1790, dans le Recueil des lois relatives à la Marine et aux Colonies, t. 1, p. 247 (S.H.D. usuels), pour ce développement. L'inspection dont il s'agit se rapporte probablement aux missions, et l'objection de Malouet a sa force : la composition du Conseil de la Guerre est ici aussi préférable.
(59) Recueil , t. 2, p. 214-215.
(60) Cité dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 28.
(61) Constitution du 13 décembre 1799, art. 72 et 73, pour ce paragraphe.
(62) Ibid., art. 52.
(63) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, éditions du C.N.R.S., 1974, p. 29 à 32, pour la fin du paragraphe.
(64) Constitution du 13 décembre 1799, art. 44 : "Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution."
(65) Arrêté des consuls du 26 décembre 1799 portant organisation du Conseil d'État, dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 33-34, pour ce développement.
(66) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 82.
(67) Ibid., p. 83.
(68) Ibid., p. 91.
(69) Ibid., p. 95 à 97, pour ce paragraphe.
(70) Martineau, ancien avocat aux Conseils devenu avocat au Tribunal de cassation, écrit à ce sujet en 1806 : "Le règlement de 1738, rédigé plus spécialement pour le Conseil privé, était adopté aux conseils des Dépêches, des Finances et du Commerce. Ainsi dans tous les conseils on procédait par demandes, par défenses, répliques, productions, incidents et requêtes ; en un mot, tout y sentait la procédure et la forme des tribunaux judiciaires. Ce tort, et c'en était un, tenait à l'habitude : on ne concevait pas alors d'autre genre d'instruction contradictoire. Mais ce tort doit cesser : en administration, tout doit être, dans la forme administrative, simple, précis et clair. Ce ne sont donc plus ces formules judiciaires et ruineuses qu'il convient d'admettre aux Conseils [sic] ; une demande peut être formée par un mémoire comme une assignation, et la défense proposée par un autre mémoire ; enfin les requêtes, les actes, les grosses doivent être écartés parce que, pour être utiles au fisc par la consommation ou l'abus du papier timbré, ils ne le sont pas plus à la justice qu'aux parties." Idées sur l'organisation du Conseil d'État, cité dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 133.
(71) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 201 à 204, pour ce paragraphe.
(72) Ibid., p. 208 à 211, pour ce paragraphe.
(73) Ordonnance du 29 juin 1814, titre II, art. 5, dans Le Conseil d'État , op. cit., p. 212 à 215.
(74) Mémoires du chancelier Pasquier, cité dans Le Conseil d'État , op. cit., p. 219 à 221, pour la fin du paragraphe.
(75) Ordonnance du 23 août 1815, préambule et art. 1, dans Le Conseil d'État , op. cit., p. 239-240.
(76) Le conseil d'État , op. cit., p. 240 à 245, pour ce développement.
(77) D'après l'ordonnance du 1er janvier 1816 (Bulletin des lois, 7e série, n° 56, p. 1 à 6), le tableau du service ordinaire de l'année comprend 30 conseillers et 31 maîtres des requêtes. Il y a de plus 22 conseillers d'État et 58 maîtres des requêtes en service extraordinaire et 21 conseillers d'État honoraires.
(78) Rapport au Roi du 18 mai 1814, AA1-13, pour la fin du paragraphe. Le rapport est soufflé par Jurien, directeur des Ports ; il faut espérer que l'inspecteur général Sané n'y est pour rien. Malouet, comme du Bouchage (1749-1821) après lui, n'a en tête que la restauration de la constitution maritime de Castries ; bonne pour le temps, elle est en partie périmée, et certaines parties encore bonnes ne peuvent être rétablies sans précaution. Malouet a pourtant été préfet maritime à Anvers sous l'Empire.
(79) Lettre au ministre de la Marine du 28 février 1822, accompagnée d'une copie du règlement du 19 mars 1788 et du mémoire dont il est question ci-après, A1-145.
(80) Mémoire anonyme d'un capitaine de vaisseau datant de 1818 environ, A1-145, pour ce développement.
(81) M. de Boisgénette [pseudonyme], Considérations sur la marine française en 1818 et sur les dépenses de ce département, 1818, VIII-150 p., p. 60 à 73.
La querelle de l'école navale du Havre (1773-1775)
Notes :
(1) Le nom de garde, qui prête à confusion, provient des gardes du cardinal (Richelieu), puis de ses successeurs dans la charge de grand maître de la navigation et du commerce de France jusqu'en 1669, qui étaient des soldats et non des marins, même en apprentissage, et formaient une garde d'honneur et de protection.
(2) Mémoire sur la nécessité de l'instruction des gardes du pavillon et de la Marine et sur l'établissement des études et des examens Pour Monseigneur seul (Mémoire fait pour rendre compte à M. de Boynes en 1771), non signé, Archives nationales, fonds de la Marine, G123, f° 85 à 89, pour ce développement. Les documents manuscrits que l'auteur de l'article invoque sont tirés de ce fonds.
(3) Au mémoire était joint un compte rendu détaillé de l'examen de 1771, et cette mention ainsi que la facture du mémoire indiquent qu'il provient du bureau des Officiers. Nous pensons que seul le compte rendu est de Bézout.
(4) Lettre du ministre au commandant de la Marine à Toulon du 22 janvier 1773, S.H.M. Toulon, 1A1-70, citée par M. Vergé-Franceschi, dans Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 268.
(5) Mémoire concernant les gardes du pavillon et de la Marine, octobre 1774, autographe de Joseph Pellerin fils, G123, f° 179 à 184.
(6) Instruction du 14 juin 1772, art. 161, 163 et 164.
(7) Ibid., art. 166.
(8) Mémoires de M.***, Ms 234 du Service historique de la Marine (S.H.M.), Introduction, f° 19 à 21.
(9) Mémoire anonyme et non daté, G86, f° 114 à 120, pour ce développement. L'évêque de Toulon est alors Alexandre de Lascaris de Vintimille (1721-1785).
(10) Un exemplaire autographe mais non daté de ce mémoire se trouve dans G123, f° 77-78. D'après les citations de M. Vergé-Franceschi, Les élèves de l'École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle, thèse de doctorat de 3e cycle, 1980, p. 89 et note 63, et Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 266, le mémoire daterait du 6 décembre 1771 et se trouverait également au S.H.M. Toulon, 1A1-66 ; mais comme celui que nous avons lu à Paris parle de brigades et non de régiments, il a dû être retouché en 1772 ou 1773.
(11) Réflexions sur l'établissement des élèves de la Marine. Idées sur les élèves. Projet de règlement pour les gardes du pavillon et de la Marine portant [affectation ?] de 20 élèves par chaque brigade, février 1773. Mise au net avec des corrections de la main de d'Estaing, G149, pièce n° 54, pour ce développement. Ce mémoire répond à une demande du ministre.
(12) Projet de rapport au Roi de création de l'École royale de marine à Lorient et à La Ciotat, août 1773, de la main de Blouin, avec des corrections d'une autre main, et Projet d'ordonnance de création de l'École royale de marine, non retenu, C8-18. Le mot de noblesse n'est pas employé.
(13) Rapport au Roi des ordonnances du 29 août 1773, avec l'approuvé, G123, f° 121 à 124.
(14) Mémoires de M.***, Ms 234, Introduction, f°19 à 21. Le projet rédigé par le commis doit lui-même résulter d'un compromis entre ses propres idées et celles dont le ministre ne se départirait pas. Il décrit ainsi les premières à Sartine : "Enfin mon avis fut d'établir deux écoles, l'une à Lorient pour le Ponant, l'autre à La Ciotat pour le Levant ; que les élèves ne devaient avoir ni solde, ni uniforme, ni rang entre eux ; qu'il fallait les regarder absolument comme des volontaires à l'essai ; qu'il convenait de les mettre dans l'école de théorie, à terre, absolument sous la discipline des maîtres, comme ils le seraient à la mer sous celle des officiers commandant les bâtiments qui serviraient d'école de pratique ; que quand ils auraient été ainsi instruits et examinés sur la théorie pendant trois ans, ils seraient uniquement exercés aux campagnes de long cours et faits enseignes après deux ou trois ans de navigation et un examen subi sur la manuvre et le pilotage, suivant la méthode observée pour les midshipmen anglais. Le ministre goûta d'abord ce plan et ensuite y substitua le sien J'avais indiqué l'homme le plus capable pour directeur de cette école, M. de Vialis [1730-1783] ; on en choisit un autre qui, quoique bon officier, n'avait pas ce genre de talent". Ibid., f° 28v. et 29r.
(15) Ordonnance du Roi portant établissement d'écoles royales de marine, du 29 août 1773, imprimé, C8-18, pour ce développement.
(16) École royale de marine, prospectus imprimé, C8-18 ou A1-111.
(17) Règlement du Roi concernant l'instruction des élèves de l'École royale de marine au Havre et sur la police intérieure et extérieure de ladite école, du 22 novembre 1773, manuscrit original signé et contresigné, C8-18, pour ce développement.
(18) Rapport au Roi sur l'École royale de marine du 22 février 1774, C8-18.
(19) Note des bureaux du 27 septembre 1774, G123, f° 125 à 129.
(20) M. Vergé-Franceschi, Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 303, 305 et 347-348.
(21) Ibid., p. 299 à 304.
(22) Ibid., p. 306.
(23) Ibid., p. 339.
(24) Ibid., p. 344 et 347, et rapport au Roi du 8 juillet 1774 intitulé Le Havre, B4-123.
(25) Plan de navigation pour la campagne projetée de la corvette l'Hirondelle, pour servir d'instruction à MM. les élèves de l'École royale de marine, brouillon, B4-123, f° 66 et 67, pour ce développement.
(26) Papillon autographe joint au Plan.
(27) Lettre portant renvoi du Plan à Potier, premier commis du bureau des Ports, le 27 avril 1774, B4 123, f° 68 : "L'intention de M. de Boynes est que dans les instructions de M. de Saint-Cézaire, monsieur Potier insère que dans le cas où la navigation de la Manche serait trop dangereuse par la nature des bâtiments, il doit sentir que l'espèce des individus qui y sont embarqués exige qu'on y pourvoie ou par des précautions convenables, ou en sortant de la Manche pour aller exercer cette jeunesse dans des parages plus tranquilles."
(28) M. Vergé-Franceschi, Les élèves de l'École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle, op. cit., p. 325.
(29) Mémoires de Castries-Vagnas, chartrier de Castries, 306AP1721, édités partiellement par Gilbert de Colbert-Turgis sous le titre de Souvenirs maritimes, 1997, p. 33 et 34.
(30) [Mathieu-François Pidansat de Mairobert], L'Espion anglais, ou Correspondance secrète entre milord All'Eye et milord All'Ear, éd. de 1784-1785, Londres, Williamson, t. VIII, 1784, p. 125-126.
(31) Gardes de la Marine, mémoire autographe de d'Arbaud de Jouques, s.d., G123, f° 79-80, pour ce développement.
(32) Castries-Vagnas dit la même chose dans ses mémoires, p. 30 de l'édition citée.
(33) Observations sur les gardes de la Marine et sur l'école des élèves de la Marine établie au Havre, s.d., s.n., G123, f° 172 à 178, pour ce paragraphe.
(34) Des élèves de la Marine, mémoire signé de Marguerie mais non daté, G123, f° 192 à 207, pour ce développement. Cette portion du mémoire est accompagnée du brouillon autographe d'un premier projet d'ordonnance.
(35) Projet d'ordonnance, 2e version Marguerie en 43 articles, G123, f° 163 à 171, pour ce développement.
(36) L'existence des protecteurs paraît inséparable du gouvernement monarchique, selon cet auteur qui ajoute : "En général un gouvernement sage doit chercher à parvenir à ses fins par des moyens doux, et le monarchique surtout doit regarder comme nulle la ressource des moyens violents par la raison que, plus ils le sont, moins on se porte à en faire usage", G123, f° 196v.
(37) Note des bureaux, sans titre, datée du 27 septembre 1774, G123, f° 125 à 129, pour ce développement.
(38) [Plan d'éducation pour les gardes de la Marine], s.d., s.n., G123, f° 60 à 71 ; f° 70. L'internat institué en 1764 a donc subsisté sous le ministère de Boynes.
(39) Réflexions sur l'établissement de l'École royale de marine au Havre, s.d., s.n., G123, f° 130 à 133 pour ce développement. Sartine dispose d'une certaine expérience en matière d'écoles. Il avait puissamment aidé le peintre Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) à fonder et à maintenir l'École royale gratuite de dessin ouverte à Paris en 1766.
(40) De 1771 à 1780, l'abbé Bossut (1730-1814) a examiné 651 candidats à l'école du Génie de Mézières ; 113 ont été reçus, soit 1 sur 6 : Anne Blanchard, Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI, Montpellier, 1979, p. 202.
(41) La perfection dans la théorie "est une idée abusive, une vraie chimère dans laquelle nous donnons depuis quelque temps". L'Arithmétique et la Géométrie de Bézout, les principes simples de la mécanique et un traité de navigation élagué du superflu suffisent à la masse des officiers. La Marine n'a guère besoin de géomètres sublimes, mais du "coup d'il qui embrasse tout, cette vivacité du moment qui exécute avec vitesse, détermine devant l'ennemi les plus grandes actions et, dans les dangers de la navigation, les meilleures manuvres". Observations sur les gardes de la Marine et sur l'école des élèves de la Marine établie au Havre, G123, f° 172 à 178, passim.
(42) [Plan d'éducation pour les gardes de la Marine], G123, f° 62v.-63r.
(43) Des élèves de la Marine, passim [réf. 33], et Projet d'ordonnance, 2e version, G123, pour ce développement.
(44) Projet d'ordonnance (4e version), signé d'Arbaud de Jouques, d'Isle-Beauchaine, Marguerie et d'Orvilliers (qui l'a visé), G123, f° 154 à 162. Tous quatre sont membres de l'Académie de marine.
(45) Gardes de la Marine, avec projet d'ordonnance (3e version en 46 articles), G123, f° 140 à 148, pour ce développement.
(46) Il peut s'agir du mémoire du Toulonnais exposé au début de l'article : un homme qui n'est pas du corps de la Marine ne saurait posséder les notions les plus élémentaires sur cet objet
(47) Il s'agit du document sans titre conservé dans G123, f° 90 à 93 ; la main est la même que celle du rapport du 27 septembre 1774 précité.
(48) Observations particulières sur le projet de nouvelle ordonnance concernant les gardes de la Marine et du pavillon, G123, f° 134 à 137, pour ce développement ; la main est encore la même.
(49) Réflexions sur l'instruction des gardes de la Marine, G123, f° 185 à 188, pour ce développement. Elles sont permises "par les comparaisons qu'une expérience de dix années [l'] a mis dans le cas de faire sur les divers moyens d'introduire dans cette partie du service les connaissances qu'on peut y désirer". L'anonymat des auteurs des mémoires que le ministre fait circuler permet de ne pas biaiser les jugements des censeurs.
(50) Mémoire concernant les gardes du pavillon et de la Marine, octobre 1774, autographe de Joseph Pellerin fils, G123, f° 179 à 184, pour ce développement. Joseph Pellerin père (1684-1783) a été premier commis de la Marine jusqu'en 1745 ou 1761, et il a reçu en retraite le titre d'intendant des armées navales. Il est connu de nos jours pour sa collection de médailles, achetée par Louis XVI et conservée à la Bnf. Son fils Joseph lui a succédé à la Marine ; il avait été anobli en 1740.
(51) Lettre au ministre du 10 septembre 1774 et Examen de ce qu'il y a à faire pour mieux constituer la Marine, dans Mémoires de M.***, Ms 234, vol. 2, f° 1 et suivants.
(52) Compagnies des gardes du pavillon et de la Marine, projet de rapport au Roi du 26 février 1775, dans Mémoires de M.***, Ms 234, vol. 2, f° 24 à 28, pour ce développement.
(53) Ordonnance du Roi concernant les gardes du pavillon et de la Marine, du 2 mars 1775, pour ce développement.
(54) Mémoire instructif sur les demandes de places d'aspirants-gardes de la Marine, imprimé, A1-115, pièce n° 37. Le Mémoire instructif dit que l'aspirant doit être "né noble", expression qui, supposons-nous, équivaut à celle de gentilhomme.
(55) Les états dont il s'agit sont conservés dans C1-130 à 136. Il manque les états bimestriels de janvier et février 1783, novembre et décembre 1783, l'année 1784, janvier et février 1786 pour Brest ; pour Toulon, novembre et décembre 1783, l'année 1784, juillet et août 1785, janvier et février 1786 ; aucun état pour Rochefort après octobre 1783.
(56) D'après les états précités, 127 aspirants ont été incorporés en 1775, 17 en 1776, 131 en 1777, 191 en 1778, 148 en 1779, 147 en 1780, 106 en 1781, 119 en 1782 et 5 en 1783.
(57) La description que Chateaubriand donne de son éducation au commencement des Mémoires d'outre-tombe paraît assez représentative de celle des officiers de marine de son temps : négligée dans l'âge tendre, plus suivie ensuite grâce au collège. L'écrivain a été chaperonné à Brest par l'un de ses oncles, capitaine de vaisseau à la retraite. Le cousin dont il parle et qui est mort en mer très jeune avait été reçu aspirant, puis renvoyé de la Marine pour ses notes insuffisantes, avant de naviguer au commerce.
(58) Observations sommaires sur l'ordonnance du 2 mars 1775 concernant les écoles militaires de la Marine, C8-18, pour ce paragraphe.
(59) États mensuels de revue, C1-130 et 144, et rapport au ministre du 14 mars 1775, C2-1.
(60) Règlement du 2 mars 1775 pour la police et discipline des gardes du pavillon et de la Marine et des aspirants, manuscrit, A1-114.
L'université et les grandes écoles autrefois
(1) Cet article a paru dans la revue Techniques avancées des anciens de l'ENSTA en 2008.
(2) Ceux qui les professent, qui les utilisent dans leur profession
(3) Ouvrage publié en 1689 et réimprimé de même dans l'édition Rémy en 1989.
(4) Traite des lois, ch. 1, art. 3 ; Eccl. 3, 11 et 11, 5.
(5) Les officiers de justice, extrêmement nombreux sous l'Ancien Régime.
(6) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 1. La condition d'âge n'y est pas. Les ordonnances du Roi, sans adresse ni sceau, sont les lois qui ne passent pas par l'enregistrement par les parlements. Elles mêlent souvent des articles de loi véritables et de menus détails d'administration, qui devraient être mis dans des règlements d'application ou autonomes. On y vient juste avant la Révolution. Les lois enregistrées, lettres patentes, etc., sont rares dans la Marine. On peut citer la loi de 1681 sur la marine marchande ; celle de 1689 relative à la marine de guerre est une ordonnance sans adresse ni sceau.
(7) Circulaire aux intendants des ports du 14 février 1689, citée par Didier Neuville, État sommaire des archives de la marine antérieures à la Révolution, Paris, Librairie militaire L. Baudoin, 1898, p. 349.
(8) Lettre du Conseil de marine au marquis de La Galissonnière du 31 août 1718, A2-24, p. 182-183. Les cotes sont celles des archives centrales de la Marine aux Archives nationales.
(9) Lettre du ministre Rouillé à Villeblanche du 25 mai 1750, A1-86, pièce cotée 15.
(10) Lettre de Rouillé à d'Orvilliers du 22 septembre 1751, A1-86, pièce cotée 14.
(11) Lettre du ministre Maurepas au sieur Barbeau du 17 décembre 1741, A2-27, p. 469-470 ; la phrase est répétée dans la lettre au maréchal de Maillebois (1682-1762) du 23 mai 1745, A2-28, p. 156-157.
(12) Lettre de Maurepas à Nogent du 16 juin 1728, A2-26, p. 63-64.
(13) Lettre du ministre Pontchartrain à Bégon du 23 mars 1699, A2-21, p. 149.
(14) Lettre circulaire aux commandants des gardes de la Marine du 6 décembre 1728, A2-26, p. 121-122. L'âge minimal est toujours de 16 ans.
(15) Mémoires du marquis de Blénac des 19 février 1704 et 27 novembre 1706, C1-279.
(16) D'après le Projet pour entretenir toujours les trois compagnies de gardes de la Marine d'habits uniformes , 1702, C1-279 ; ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 14.
(17) Ordonnance du 22 mai 1717, A2-24, p. 53-54.
(18) Lettre de Morville à Chavagnac du 19 juin 1723, A2-25, p. 149-150.
(19) Ordonnance du 25 octobre 1728, A2-26, p. 111-112.
(20) Lettre de Maurepas au comte des Gouttes du 28 décembre 1738, A2-27, p. 298-299.
(21) Mémoire des changements qui pourraient être utiles aux gardes de la Marine, par Conflans, du 31 décembre 1746, C1-279.
(22) Gardes de la Marine, mémoire d'octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe.
(23) États abrégés de la Marine.
(24) Mémoire du marquis de Blénac précité.
(25) Ordonnance du 28 février 1703, A2-21, p. 341-342.
(26) Lettre de Pontchartrain à Bégon du 10 mars 1709, A2-22, p. 175-176.
(27) Lettres du 17 novembre 1727, A2-25, p. 625-626, et du 5 juillet 1728, A2-26, p. 72-73.
(28) Lettre du 14 juin 1732, A2-26, p. 404.
(29) Ordonnance du 15 janvier 1704, A2-21, p. 417-418.
(30) Lettre de Maurepas à Rouvroy du 12 septembre 1729, A2-26, p. 178-179.
(31) Lettre circulaire du ministre aux commandants de la Marine, intendants et commandants des compagnies de gardes du 9 mars 1733, A2-26, p. 472 à 475, pour ce développement.
(32) Lettre du Conseil de marine à l'intendant Robert du 25 octobre 1719, A2-24, p. 366.
(33) Lettre du Conseil de marine à Beauharnais du 26 octobre 1716, A2-23, p. 621-622 ; lettre de Maurepas à du Deffend du 3 février 1727, A2-25, p. 528-529.
(34) Lettre du Conseil de marine à Chavagnac du 22 janvier 1722, A2-25, p. 13 ; lettres de Maurepas à Robert du 30 décembre 1726, A2-25, p. 493, à Nogent du 27 janvier 1727, A2-25, p. 523, à La Rochalard du 11 août 1732, A2-26, p. 432.
(35) Lettre de Pontchartrain à Robert du 10 décembre 1714, A2-23, p. 369 ; lettre circulaire aux commandants des ports du 13 octobre 1727, A2-25, p. 625-626 ; mémoire de L'Isle-Calian de 1748, C1 279 (cf. infra).
(36) Lettre de Maurepas à Nogent du 19 janvier 1728, A2-26, p. 5-6.
(37) Rapport au Roi du 23 mai 1759 avec l'approuvé, C1-279. L'augmentation de brigadiers et de sous-brigadiers date de la décision du 6 mai 1756. La décision de 1759 porte augmentation de la compagnie des gardes du pavillon, rétablie à 80 gardes et gradés après la diminution opérée en 1727. En tout donc l'effectif réglé des gardes est de 450.
(38) Ordonnance du 18 novembre 1716, S.H.M. recueil d'imprimés 3S2 ; préambule.
(39) Ordonnance du 7 juillet 1732, S.H.M. 3S2 ; art. 7 à 10 et 28.
(40) Ordonnances de 1716 et 1732 précitées, art. 1, et 3 et 4 respectivement ; mémoire de Rodier sur les officiers militaires, octobre 1761, C1-3, f° 8 à 17. L'Amiral présente également les officiers au Roi.
(41) Ordonnances de 1716 et 1732, art. 2. Les 4 brigadiers gagnent 600 l par an, les 6 sous-brigadiers 500 l et les 70 gardes du pavillon, 360 l.
(42) Ibid., art. 5 et 6 respectivement.
(43) Lettre de Maurepas à d'Avaugour du 7 février 1735, A2-27, p. 87-88.
(44) Gardes de la Marine, mémoire d'octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe.
(45) Note de juillet 1684 relative aux gardes, C1-279.
(46) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 6, 7 et 9.
(47) Ibid., art. 8 et 12.
(48) Mémoire des changements qui pourraient être utiles aux gardes de la Marine, déjà cité, C1-279 ; rapport au Roi du 10 septembre 1753 avec l'approuvé, C1-279.
(49) Un emploi du temps est indiqué pour Rochefort dans C1-279 (le document est daté du 19 mai 1685).
(50) Ordonnance du 15 avril 1689, l. XIX, t. 1, art. 3 à 10 et 14 à 16, pour ce développement.
(51) Ce mémoire a été publié par le père François Oudot de Dainville (1909-1971), s. j., sous le titre "L'instruction des gardes de la Marine à Brest en 1692", dans la Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, 1956, t. IX, p. 323 à 338. Le mémoire, daté du 26 mars 1692, est conservé dans B3-72, f° 119 à 151.
(52) Lettre de Maurepas au chevalier de Piosin du 26 décembre 1729 (A2-26, p. 194-195) : "Il n'est pas d'usage dans les autres ports de faire tirer à la butte les gardes de la Marine et je n'estime pas qu'il convienne de rien innover à cet égard." Lettre en sens contraire à La Luzerne et à Mithon des 10 janvier et 5 février 1735, A2-27, p. 31-32.
(53) D'après le père de Dainville, dans sa Géographie des humanistes, 1940, p. 444, le Recueil du père Hoste est court et clair, l'auteur cherchant à éviter tout ce qui pourrait embarrasser le lecteur.
(54) Observations sur l'ordonnance de la Marine pour l'instruction et exercice des officiers et gardes de la Marine, par des Clouzeaux, 21 octobre 1699, C1 279, pour ce paragraphe.
(55) Mémoire sur les études de MM. les gardes de l'Étendard, s.d., C1-279, pour ce développement.
(56) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 18.
(57) Lettre de Maurepas aux commandants des compagnies des gardes de la Marine du 22 juin 1738, A2 27, p. 273-274.
(58) Mémoire des bureaux dit Gardes de la Marine, octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe ; cf. lettre de Maurepas au chevalier de Piosin du 19 juin 1740, A2-27, p. 381.
(59) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 19.
(60) Ibid., art. 20.
(61) Ibid., art. 21 à 24.
(62) Ibid., art. 28.
(63) Mémoire de 1692 précité, pour la fin du paragraphe.
(64) Ration et demie pour les gardes de la Marine selon l'ordonnance de 1689, et double ration pour les gardes du pavillon, selon celle de 1732.
(65) Lettre de Maurepas à Mithon du 25 août 1727, A2-25, p. 585-586.
(66) Lettres de Maurepas à d'Héricourt des 31 janvier et 7 mars 1729, A2-23, p. 153 et 161.
(67) Lettre circulaire de Maurepas aux commandants des compagnies de gardes de la Marine du 31 mars 1732, A2 26, p. 394-395.
(68) Lettre de Maurepas à Levasseur de Villeblanche du 20 août 1736, A2-27, p. 180-181.
(69) Lettre de Maurepas à Camilly du 7 janvier 1746, G47, p. 521.
(70) Mémoire dit Gardes de la Marine déjà cité, [octobre 1761], C1-279.
(71) Mémoire sur l'utilité d'un nouvel arrangement pour les gardes de la Marine, par L'Isle-Calian, 1748, C1-279, pour ce développement.
(72) Suite de mon mémoire sur un nouvel arrangement pour les gardes-marine, novembre 1748, C1 279, pour ce développement.
(73) Observations faites sur l'expérience de 46 ans de services dans le corps des officiers de la Marine que j'ai cru convenable au bien du service et à l'honneur du corps et relatives aux favorables intentions du ministre et à son juste discernement, G133, pièce cotée 10, pour ce développement. Le mémoire n'est ni daté ni signé, mais il a été attribué à Franssures de Villers, nommé garde de la Marine du 21 mai 1705, ce qui donnerait à penser que ce mémoire date de 1751. Comme il y est question d'une guerre en cours, il est un peu antérieur, ou alors l'attribution est mauvaise.
(74) Mémoire touchant le service des gardes du pavillon amiral et des gardes de la Marine, par Martini d'Orves, 29 janvier 1749, C1-279, pour ce paragraphe.
(75) Lettre de d'Orves à Pellerin fils du 4 mars 1751, C1-279.
Expédition du jugement de séparation d'Armand et de Claire de Kersaint, des 28 mars-7 mai 1792 (1)
Le divorce a précédé la séparation : le droit romain le prouve. La conception chrétienne du mariage et son rite se sont mis en place lentement. À partir de 900 environ, l'Église exige la célébration publique du mariage. Le IVe concile de Latran (1215) proclame qu'il est un sacrement, et le prêtre, dont la présence est obligatoire, demande la manifestation du consentement aux époux et le reçoit au nom de l'Église. Le mariage est une promesse pour la vie, il est donc indissoluble : cette thèse a été admise un siècle avant le sacrement et s'appuie sur l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. La séparation de corps permet de mettre fin à la vie commune, non de rompre le lien : c'est la solution trouvée afin de concilier l'intérêt de l'homme souffrant et le respect de la foi.
Le contentieux du mariage regarde d'abord le tribunal ecclésiastique établi dans chaque diocèse, l'officialité. La procédure de séparation est au point à la fin du Moyen Âge (2). Ce juge poursuit aussi les séparations de fait et le concubinage. Cependant, l'action sur les laïcs tend peu à peu à se limiter à l'administration des sacrements. De plus, les sentences d'excommunication peuvent être cassées par le juge civil grâce à l'appel comme d'abus. En matière civile, la compétence sur les clercs s'estompe, parce qu'ils ont tendance à s'adresser au juge civil. En matière criminelle, elle se réduit à la justice disciplinaire. La prison et les amendes se font rares.
D'autre part, la double nature contractuelle et sacramentelle du mariage est reconnue et permet l'intervention de l'État dans la législation et le recours à la coutume. C'est une source de conflits entre les deux ordres de juridiction, d'autant que les deux natures du mariage sont inséparables. Les juridictions s'assistent aussi et l'on observe des chicanes entre justices du même ordre. Une autre raison avancée pour expliquer le passage d'un nombre croissant d'affaires au juge civil réside dans l'interprétation trop rigoureuse du droit canonique par les juges d'église.
Une séparation doit être prononcée par un juge pour produire des effets de droit (3). À la demande de séparation "de corps et d'habitation", selon l'expression consacrée, est souvent jointe la demande de séparation de biens, ou alors l'une des parties poursuit l'autre en réparation d'un crime qui y a donné lieu. Autre motif pour s'adresser au juge civil.
Les requêtes émanent des femmes, parce qu'un homme avouerait sa faiblesse, lui qui est administrateur des biens de communauté et de ceux de sa femme. Du reste l'adultère est un des rares cas où l'homme a le droit de demander la séparation de corps. L'inconduite de la femme peut le conduire à la chasser de chez lui ou à demander son enfermement (par lettre de cachet). La séparation de corps était ordinairement prononcée pour négligence, inconduite, débauche ou mauvais traitements. Par la simple séparation de biens, la femme retrouve certains droits sur sa dot et sur ses propres, mais elle doit continuer à vivre sous le même toit que son mari. Claire de Kersaint n'a pas reproché officiellement à son mari d'être dépensier ou infidèle. Les époux, mariés en 1772, n'ont eu qu'une fille, la future duchesse de Duras (1777-1828), et ils étaient séparés de fait depuis longtemps.
La loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire déclare pour commencer que l'arbitrage est "le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens" (titre I, art.1). Elle entend par conséquent le rendre possible dans toutes les affaires d'intérêt privé (I, 2). La séparation de corps ou de biens en est une, mais elle n'est pas citée nommément parmi les compétences des nouveaux tribunaux de famille, qui pratiquent l'arbitrage. Celles-ci sont énoncées comme suit : "S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et surs, neveux et oncles, ou alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendues et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée." (X, 12). Le tribunal de famille se compose de quatre arbitres, dont deux désignés par chaque partie ; en cas de partage des avis, un surarbitre est choisi (X, 13). Ses membres sont à la fois juges et jurés.
Le juge de paix (un élu au moins par canton) reçoit de ce tribunal arbitral toujours différent les délibérations prises pour les tutelles, curatelles et émancipations, et envoie celles qui sont frappées d'appel ou non aux juges de district, également élus (III, 11), mais il n'intervient pas dans les séparations. Les sentences arbitrales ne sont susceptibles d'appel (ici en dernier ressort car il y a deux degrés d'appel en général) que si elles le mentionnent et qu'elles désignent le tribunal d'appel (I, 4 et 5 et X, 14). Elles sont rendues exécutoires par une ordonnance du tribunal de district (I, 6) (4).
Cette manière de régler un conflit conjugal au moyen de parents ou d'amis, choisis par les parties, est bien curieuse, et l'on sait qu'aujourd'hui, elles demandent souvent le huis clos au tribunal (5). Elle correspond à un état antérieur de la société, dans lequel la solidarité se maintenait dans un cercle de famille étendu, ou à un État faible, et non à une société dominée par l'individualisme. D'ailleurs on a constaté que les professionnels du droit s'y étaient introduits et qu'ils avaient fini par occuper une place prépondérante. C'est la procédure que les époux Kersaint ont dû suivre pour se séparer officiellement. Elle était appliquée aux enfants, et on la retrouve dans cette loi révolutionnaire (X, 15 et 16), mais la décision arbitrale est ici soumise à l'appréciation du président du tribunal de district, qui peut la modifier ou en refuser l'exécution (X, 17). Le tribunal de famille n'émet donc qu'une sorte d'avis pour les enfants, alors que ses décisions de séparation sont des jugements, quoique susceptibles d'appel (6).
Le législateur de 1792 (loi du 20 septembre sur le divorce (7)) affirme que le divorce "résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte" et de la disposition de la constitution du 14 septembre 1791 selon laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil. En conséquence, la séparation de corps est abolie, seuls les jugements définitifs continuant d'avoir force de loi. Ce n'est pas seulement une attaque de plus contre la religion, avant sa proscription complète, mais une manière d'affirmer que la liberté chrétienne et la liberté républicaine française sont inconciliables.
La nouvelle loi prévoit sept cas de divorce pour "motif déterminé", le consentement mutuel et enfin "la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère". La demande de divorce appartient à chaque époux. Chacune de ces trois catégories de demandes est régie par une procédure particulière. La première fait appel au tribunal de famille, sauf si la demande s'appuie sur un jugement de condamnation ou une constatation officielle d'absence. La dernière comprend trois réunions de parents ou d'amis convoquées en assemblées de famille (six personnes au moins) devant un officier municipal de la commune dans laquelle le mari est domicilié. Chaque partie choisit trois conciliateurs ; l'officier n'assiste pas aux explications et débats, mais il dresse les actes de non-conciliation. Le défendeur n'est pas obligé d'assister en personne aux réunions. Huit jours au moins et six mois au plus après la date du dernier acte de non-conciliation (il s'est passé cinq mois entre la première et la troisième réunion et un mois entre la convocation et la première réunion), les époux se présentent devant l'officier d'état civil chargé des mariages, les actes ayant été déposés au greffe de la commune ; il est tenu de prononcer le divorce "sans entrer en connaissance de cause". Le rôle des officiers municipaux semble donc se limiter à un contrôle de régularité ou à la police. Les parents peuvent se borner à constater la non-conciliation. Cette forme de divorce ressemble à une simple formalité assortie de délais pour faire réfléchir les époux. En cas de dépassement du délai de six mois (un an en tout), le demandeur doit recommencer la procédure. Les actes de divorce sont sujets à l'enregistrement et à la publicité des anciens jugements de séparation ; le divorce produit les mêmes effets vis-à-vis des créanciers des époux.
La communauté ou la société d'acquêts est résolue selon la loi ou la convention, comme si l'un des époux était décédé. Cependant, dans six des sept cas de divorce pour motif déterminé (mais pas dans les deux autres catégories), s'il est prononcé contre la femme, celle-ci perd ses droits et bénéfices dans la communauté ou société, ne gardant que ses propres. Les droits matrimoniaux emportant gain de survie, les dons et avantages et autres dons mutuels sont éteints et remplacés, pour l'époux qui aura obtenu le divorce pour un motif déterminé, par une pension viagère sur les biens de l'autre époux et réglée par le tribunal de famille. Ces arbitres déterminent d'autre part le montant de la pension alimentaire de l'époux divorcé dans le besoin, dans la mesure de ce besoin et des facultés de l'autre époux. Les deux pensions sont éteintes en cas de remariage. Les neuf derniers articles de la loi règlent le sort des enfants. Ils sont confiés à l'un ou à l'autre des parents divorcés, qui leur doivent tous deux l'entretien, en proportion de leurs facultés. Les décisions appartiennent à l'assemblée de famille, qui décide aussi des contestations relatives à l'éducation, au droit et aux intérêts des enfants ; elles sont exécutées par provision, en cas d'appel.
Les décrets des 17 et 23 avril 1794 légalisent en divorces les séparations prononcées avant la loi de 1792. Ils ajoutent aux causes de divorce la séparation de fait de six mois au moins. Les tribunaux de famille suscitent des réserves croissantes, et la loi du 28 février 1796, en abolissant l'arbitrage obligatoire, réduit leur importance. Le Code civil de 1804 maintient le divorce mais en limite l'application. Il réintroduit la séparation de corps en vue de donner une satisfaction aux catholiques. Dans tous les cas, l'action doit être portée devant le juge d'arrondissement. Il en est de même des différends relatifs aux successions. La compétence des tribunaux de famille, sous le nom de conseils de famille, se borne désormais aux tutelles. La loi du 8 mai 1816 supprime le divorce et convertit en demandes de séparation les affaires de divorce en cours. Celui-ci est rétabli en 1884. La Révolution n'avait pas réformé les rapports matrimoniaux ni l'incapacité de la femme mariée. De nos jours, la loi a fait une place au traitement amiable et à l'arbitrage de certains conflits.
L'acte notarié du 31 mai 1792 conservé dans la famille comprend cinq parties : 1° le dépôt du jugement de séparation et de l'augmentation de conclusions de Claire de Kersaint par Charles Ganilh, l'un des arbitres, en présence des deux procureurs des époux, qui déclarent qu'ils acceptent le jugement et ne feront pas appel ; 2° la décision arbitrale (7 mai), transcrite ci-après et l'ordonnance du président du tribunal du 1er arrondissement (18 mai) ; 3° l'augmentation de conclusions de Claire de Kersaint ; 4° et 5° les procurations des époux.
"Décision arbitrale.
L'an [mil] sept cent quatre-vingt-douze, quatrième de la liberté et le mercredi vingt-huit mars après-midi,
Nous Charles-Philibert-Marie-Gaston de Lévis-Mirepoix, maréchal de camp, demeurant à Paris, rue de Verneuil, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Thomas d'Aquin, et Anne-Louis-François de Paule Lefèvre d'Ormesson, bibliothécaire du Roi, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, paroisse Saint-Augustin, tous deux nommés arbitres par dame Claire-Louise-Françoise de Paule née d'Alesso d'Éragny, épouse de M. Armand-Simon-Guy de Coëtnempren de Kersaint, député à l'Assemblée nationale législative, suivant l'acte extrajudiciaire du vingt-cinq février dernier (8),
Et nous, Armand-Jacques de France d'Amstel, demeurant à Paris, place Vendôme, paroisse Saint-Roch, et Charles Ganilh, homme de loi, demeurant à Paris, rue du Boulay, paroisse Saint-Eustache, tous deux nommés arbitres par mon dit s. de Coëtnempren de Kersaint, suivant l'acte extrajudiciaire du 1er mars présent mois (9).
Pour composer un tribunal de famille à l'effet de statuer sur la demande formée par Mme Kersaint contre M. Kersaint son époux, à fin de séparation de corps et d'habitation, ladite demande portée en son exploit du jour d'hier, nous nous sommes réunis dans le cabinet de M. de France d'Amstel, l'un de nous, en sa demeure susdite où étant, nous avons pris lecture des deux actes extrajudiciaires ci-dessus datés contenant notre mission. Après l'avoir acceptée, nous nous sommes constitués en tribunal de famille et nous avons procédé ainsi qu'il suit.
Nous avons pris lecture :
[1°] de l'exploit donné par Mme Kersaint à mon dit s. Kersaint son époux ledit jour vingt-sept mars présent mois, tendant à ce qu'il soit dit et ordonné qu'elle sera et demeurera séparée de corps et d'habitation de mon dit s. de Kersaint son mari, qu'il lui sera permis de continuer d'habiter où bon lui semblera (10), qu'il sera fait défense au dit s. son mari de la hanter ni fréquenter sous telles peines qu'il appartiendra, qu'elle sera et demeurera pareillement séparée de biens d'avec ledit s. son mari, pour en jouir à part et divisément, ensemble de ceux qui peuvent lui être échus pendant son mariage et qui lui échoiront par la suite ; en conséquence, qu'il sera procédé à l'inventaire des biens de la communauté, pour ensuite être par elle pris tel parti qu'elle avisera, comme aussi à ce que ledit s. son mari soit condamné dès à présent à lui payer une somme de six mille livres de provision, tant pour pourvoir à ses dépenses particulières qu'à celles de la demoiselle sa fille,
ladite demande fondée sur l'opposition de caractère de M. Kersaint avec le sien, et sur le mépris que ledit s. Kersaint a constamment fait de sa personne, en vivant éloigné d'elle et en annonçant à qui a voulu l'entendre qu'il ne vivrait jamais avec elle ;
2° d'une liasse de lettres écrites par M. de Kersaint à la dame son épouse depuis l'année mil sept cent quatre-vingt-un jusqu'à présent, ladite correspondance produite par Mme Kersaint à l'appui de sa demande ;
3° d'un écrit qui nous a été adressé par M. Kersaint, dans lequel il expose que Mme son épouse ne veut une séparation de corps que pour arriver à une séparation de biens pour exercer ses droits pécuniaires suivant sa fantaisie, et soutient que sa conduite envers Mme son épouse, depuis leur union, ne peut pas donner lieu à une séparation de corps et offre à la dame son épouse de la recevoir dans sa maison et de vivre en bonne intelligence avec elle ;
4° d'un mémoire présenté par Mme Kersaint par lequel, en augmentant les conclusions par elle ci-devant prises contre ledit s. son mari, elle demande :
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à la communauté qui a existé entre elle et ledit s. son mari et de ce qu'elle consent qu'il soit statué définitivement sur la liquidation de ses reprises et que le jugement qui interviendra en cette partie soit souverain et en dernier ressort,
que sa dot, montant à la somme de cent quatre-vingt mille livres argent d'Amérique, ou cent vingt mille livres argent de France, suivant leur contrat de mariage du six juillet mil sept cent soixante-douze, lui soit restituée et que restitution lui soit pareillement faite des successions qui lui sont échues depuis leur mariage jusqu'à présent, et notamment la somme de onze mille quatre cents livres reçue par mon dit s. Kersaint de la succession du s. Paule d'Éragny, son frère, suivant les quittances,
et que, pour la remplir des susdites créances montant au total à la somme de cent trente et un mille quatre cents livres argent de France, elle soit envoyée en possession :1° de la créance de cent mille livres argent de France qui appartient à M. Kersaint par M. Carrère de Saint-Domingue ; 2° d'une somme de vingt-deux mille cinq cents livres argent d'Amérique, ou quinze mille livres argent de France, à prendre sur la créance que M. de Kersaint a sur M. Laporte de Sainte-Lucie ; aux offres par elle faites, en cas de remboursement desdites créances, d'en faire emploi en présence et du consentement de mon dit s. son époux, que M. de Kersaint soit en outre tenu de faire en France emploi d'une somme de seize mille quatre cents livres, argent de France, restante pour parfaire et compléter la restitution de sa dot ;
que M. de Kersaint soit pareillement condamné à lui payer une provision alimentaire de cinq cents livres par mois et ce sans restitution,
qu'elle soit exclusivement chargée de l'éducation de sa fille et que M. de Kersaint soit tenu de lui payer une somme de mille livres par année pour sa portion contributive dans l'éducation de la demoiselle de Kersaint, leur fille ;
que M. de Kersaint soit condamné aux dépens.
Nous avons entendu séparément Mme et M. de Kersaint dans différentes séances et, après avoir inutilement tenté de les rapprocher et nous être parfaitement convaincus, tant par leur correspondance que par leur discours et leurs confidences réciproques que toute réunion, tout rapprochement entre eux est impossible sans danger pour l'un et pour l'autre, tant à cause de l'opposition de leurs caractères que de l'incompatibilité de leur humeur, opposition manifestée par une séparation de fait qui dure depuis douze années ; considérant d'ailleurs que M. et Mme de Kersaint sont parvenus à cet âge où leur réunion n'intéresse plus la société, qu'elle ne peut pas même influer sur le sort de l'éducation de leur fille unique, déjà parvenue à sa quinzième année, et par conséquent ayant reçu toutes les impressions qui peuvent résulter pour elle de la séparation de ses père et mère, et que cette séparation ne peut qu'assurer à chacun des époux leur repos et leur tranquillité.
D'un avis unanime, disons et ordonnons que Mme de Kersaint demeurera séparée de corps et d'habitation d'avec M. de Kersaint son époux, en lui faisant défense de la fréquenter.
Disons et ordonnons pareillement que Mme de Kersaint demeurera séparée de biens d'avec mon dit s. son mari pour en jouir à part et séparément.
Lui donnons acte de sa déclaration qu'elle renonce purement et simplement à la communauté qui a existé entre elle et son mari (11) ; en conséquence ordonnons que ledit s. de Kersaint sera tenu de lui restituer :
1° la somme de cent quatre-vingt mille livres argent d'Amérique, ou cent vingt mille livres argent de France, montant de la dot de la dame de Kersaint suivant son contrat de mariage dudit jour six janvier mil sept cent soixante-douze ;
2° celle de onze mille quatre cents livres que mon dit s. de Kersaint a reçue de la succession de M. Paule d'Éragny, frère de la dame de Kersaint (12) ;
3° enfin toutes les autres sommes que ladite dame de Kersaint justifiera avoir été reçues par ledit sieur son mari sur les successions échues à ladite dame de Kersaint.
Et, pour remplir ladite dame de Kersaint du montant de ses reprises formant au total la somme de cent trente et un mille livres quatre cents argent de France, nous disons et ordonnons que la dame de Kersaint sera mise en possession :
1° de la créance de cent mille livres argent de France, ou de cent cinquante mille livres argent d'Amérique appartenant à M. de Kersaint sur la dame veuve Carrère de Saint-Domingue, suivant la vente par lui faite au s. Pierre Carrère de sa portion dans l'habitation et sucrerie située au quartier de la Rivière-du-Lézard, qui lui appartenait en société (13) avec M. Lecouteulx du Molay et de M. de Meulan, ladite vente en date du trois avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, reçue par les sieurs Baudon et Petit, notaires royaux de la ville de Saint-Pierre, île de La Martinique ;
2° de la somme de quinze mille livres argent de France, ou de vingt-deux mille cinq cents livres argent d'Amérique, à prendre sur la créance de quatre-vingt mille livres argent de France, ou de cent vingt mille livres argent d'Amérique, appartenant à mon dit s. de Kersaint sur les sieurs Serre et Laporte de Sainte-Lucie, suivant le contrat de vente à eux passé le quatre juin mil sept cent soixante-quatorze devant le sieur de Ruot de Lomet, notaire royal de l'île Sainte-Lucie résidant au quartier de Micoud, d'une habitation sise au quartier du vieux port, vulgairement appelé la Pointe-de-Sable, appartenant à M. de Kersaint, ainsi qu'il est dit et porté au dit contrat de vente.
À l'effet de quoi mon dit s. de Kersaint fera à la dame son épouse toutes cessions et transports desdites créances et lui remettra l'expédition du contrat (14) qui établit sa créance sur ladite veuve Carrère et une copie collationnée par devant notaire de celle qui établit sa créance sur les s. Laporte et Serre ; faute par lui de ce faire dans la huitaine de la notification du présent jugement, disons et ordonnons que le présent jugement signifié tant à ladite veuve Carrère qu'aux dits s. Serre et Laporte vaudra toute cession et transport, à la charge néanmoins que ledit transport ne pourra empêcher ni M. ni Mme Kersaint de disposer réciproquement de leur créance sur les s. Serre et Laporte de Sainte-Lucie.
Comme aussi disons et ordonnons qu'en cas de remboursement de la créance sur les s. Serre et Laporte de Sainte-Lucie, Madame Kersaint sera la première remboursée du montant de la délégation à elle ci-dessus faite, à la charge pour elle suivant ses offres d'en faire emploi en présence et du consentement de M. Kersaint ou lui dûment appelé.
Disons et ordonnons pareillement que M. Kersaint sera tenu de faire emploi en France au profit de la dame son épouse d'une somme de seize mille quatre cents livres restante pour parfaire et compléter la restitution des reprises de ladite dame Kersaint.
Disons et ordonnons que les intérêts des créances ci-dessus déléguées à Madame Kersaint et de la somme dont M. Kersaint est tenu de faire l'emploi courront au profit de Mme Kersaint à compter du premier mars dernier, jour de la demande en séparation (15).
Et en outre disons que Mme Kersaint sera et demeurera chargée de l'éducation de Mlle Kersaint et que M. Kersaint paiera à ladite demoiselle sa fille et sur ses quittances la somme de mille livres par année, par quartier de trois en trois mois, et ce pour fournir à son entretien et à son éducation, et que Mme Kersaint fournira à ladite demoiselle Kersaint le logement et la nourriture et veillera à l'emploi des mille livres qui seront payées par M. Kersaint à Mlle leur fille, comme aussi disons que, dans le cas où la demoiselle Kersaint, après son éducation finie, préférerait la société de son père à celle de la dame sa mère, Madame Kersaint lui paiera sur ses quittances la somme de mille livres, ce que M. Kersaint fournira à tous les autres besoins de la demoiselle sa fille.
Enfin disons et ordonnons que M. Kersaint paiera à Madame son épouse, par forme de provision alimentaire et pour qu'elle puisse attendre la rentrée de ses revenus, la somme de cinq cents livres par mois pendant l'espace de dix mois qui ont commencé à courir du vingt février dernier et sans aucune restitution.
Et attendu qu'il est de la nature d'un tribunal de famille que tout s'y fasse gratuitement, disons qu'il n'y a lieu à condamnation de dépens ni contre l'une ni contre l'autre des parties.
Et avons clos et terminé le présent jugement le sept mai de ladite année et avons signé. Ainsi signé : Defrance d'Amstel, d'Ormesson, Lévis-Mirepoix et Ganilh ; en marge est écrit ce qui suit : enregistré à Paris le seize mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu trois cent vingt-huit livres dix sols pour la condamnation relative à M. Kersaint, et trente-sept livres dix sols pour celle concernant Madame Kersaint, signé Rippert.
Ci-après les susdites clôture et signature, nous avons donné à M. et Mme Kersaint lecture et notification de notre jugement. Signé : de France d'Amstel, Lévis-Mirepoix, d'Ormesson et Ganilh.
Suit communiqué au commissaire du Roi fait le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, signé Carouge ; à côté est écrit ce qui suit : enregistré à Paris le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu vingt sols, signé Rippert.
Vu la décision arbitrale rendue au tribunal de famille le vingt-huit mars dernier, close le sept mai présent mois, dûment enregistrée ce jourd'hui par Rippert, entre la dame Kersaint, d'une part et le s. de Kersaint son mari, d'autre part, je n'empêche pour le Roi être ordonné que ladite décision arbitrale sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au parquet ce dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, signé Beaurain de Montillet.
Nous, Marin Carouge, juge, présidant le tribunal du premier arrondissement du département de Paris par l'absence de M. Millet, vu la décision arbitrale rendue en tribunal de famille le vingt-huit mars dernier, close le sept mai présent mois, dûment enregistrée, entre la dame Kersaint d'une part et le s. de Kersaint son mari d'autre part, ordonnons que ladite décision arbitrale sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au tribunal le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé Carouge. Au pied est écrit ce qui suit : enregistré à Paris ce dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu quarante sols, signé Rippert."
ANNEXE : La question du titre de noblesse en 1830.
Les mémoires de la duchesse de Maillé (1787-1851) ont été publiés sous des titres différents en deux parties, en 1984 et 1989. Son mari (1770-1837) a été premier gentilhomme de la chambre du comte d'Artois puis de Charles X. La duchesse est légitimiste dans la mesure où elle tient au principe dynastique ; elle critique vertement l'employeur de son mari et le montre non seulement dans ses mémoires, mais aussi par ses fréquentations. Elle a en effet tenu salon rue de Lille et parle de plusieurs autres dames de la haute société d'avant 1830 qui en faisaient autant, dont la duchesse de Duras. Elle ne peut voir le second usurpateur en peinture et lui préfère la république. Ses mémoires n'ont pas la franchise d'un journal, mais ils n'en sont pas moins d'un grand intérêt.
Madame de Maillé aborde ainsi la question des titres de noblesse. Il faut savoir que la Charte révisée de 1830 ne les protège plus et que la constitution de 1848 défend de les porter dans les actes officiels de la vie. La famille de Kersaint est d'ancienne noblesse, mais elle ne porte jusqu'en 1830 que le titre d'écuyer. Au XVIIIe siècle, l'usurpation de la noblesse par des roturiers et le port de titres dans la noblesse se répandent, sans que le pouvoir royal réagisse sérieusement contre une prérogative du monarque. Il peut s'agir parfois de titres de courtoisie, mais ces sujets paient-ils les impôts des roturiers ? Armand (1742-1793) (16) se pare donc du titre de comte, ses frères cadets de ceux de baron et de chevalier. Sous l'empire, le "chevalier" Guy-Pierre (1747-1822) est baronifié mais reprend le titre de comte après 1814. Son fils, alors préfet de l'Orne, refuse de servir Louis-Philippe en ne signant pas le serment d'allégeance exigé des fonctionnaires. Il avait son ordonnance de nomination de comte, il avait commencé les démarches au Sceau pour obtenir ses lettres patentes et payé semble-t-il le tiers des droits. Le refus d'allégeance est la raison qui nous paraît la plus probable de son abandon (2e partie des mémoires, 1989, p. 278-279). Nous l'avions déjà lue chez d'autres auteurs, mais cette fois madame de Maillé a emporté notre conviction.
"[Louis-Napoléon Bonaparte] donne à chacun ses titres, en dépit du décret du gouvernement provisoire ; en cela je trouve qu'il a tort, puisque la constitution a sanctionné ce décret et que ce qu'il dit a toujours un caractère officiel, mais si en soi-même ce n'est pas rationnel, on ne peut nier que cela n'ait du succès dans la société où l'on aime les titres tels que les révolutions, le temps et les lois de 1830 les avaient faits. Ils étaient d'un accès si facile pour tous que ce n'était vraiment pas la peine de les supprimer ; mais enfin, ils le sont par la constitution que l'on a votée. [...]. Par les lois de 1830, prenait des titres qui voulait, on les prenait à peu près avec la même facilité, ou bien on les achetait et c'était un bon revenu établi sur la vanité. [...] À la longue, cette facilité même aurait fait tomber les titres en désuétude et la Révolution se serait faite par les murs, ce qui vaut mieux que celle qui se fait par les lois. Surtout en France, il en résulte qu'elle ne se fait point et que l'on n'a jamais tant appelé chacun par son titre. On ne les prend plus dans les actes, voilà tout.
"Les familles nouvelles, comme de raison, y tiennent bien plus que les anciennes. Qu'importe à celles-ci un titre qui ajoute bien peu d'éclat à leurs noms illustrés par l'histoire ou leur antiquité. Cette mesure prise dans un but de nivellement consacre au contraire une hiérar chie dont les grandes familles ne se plaindront pas. Cette abolition des titres blesse donc le véritable instinct de la France qui est l'égalité ; ceci a l'air d'un contresens mais peut très bien s'expliquer. Les Français ne sont pas démocrates, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que l'on aille chercher systématiquement les derniers d'entre eux pour les mettre à leur tête, mais ils veulent qu'ils puissent y arriver. Ce qu'ils ne peuvent souffrir, ce sont les droits, ce sont les préférences exclusives, les avantages qui ne sont pas à la portée de tous. Ainsi, le monde peut arriver à posséder un titre, mais on ne peut pas se donner l'ancienneté ni les souvenirs. [...] C'est [ce sentiment] qui a puissamment aidé à la Révolution de 89 et qui lui a rallié une grande partie de la noblesse en haine de cette situation de grand seigneur créée par Louis XIV, et qui établissait une supériorité telle à quelques-uns de ses membres."
On tenait le même discours au XVIIIe siècle
Notes :
(1) Jugement déposé chez Me Chaudot, notaire à Paris. Jean-Baptiste Chaudot (1751-1794) a été guillotiné. La pétition de sa section à la Convention, en vue de sa réhabilitation, porte ceci : "Chaudot, quoique déchargé des faits portés en son acte d'accusation, a été condamné par la conscience du jury comme auteur d'une conspiration. Ainsi Chaudot a été la première victime des conspirations qui n'ont existé que dans la conscience des jurés conspirateurs." B.N.F., Lb40 1782. L'acte de séparation est reproduit d'après une expédition conservée dans la famille. Les minutes de Chaudot, étude LXI du Minutier central, ne comprennent pas d'expédition du contrat de mariage. Ce texte a paru dans Le Lien, revue du Centre généalogique du Finistère, en 2018.
(2) Raphaëlle Lapôtre, Le mariage devant le juge. Droit matrimonial et pratique dans le Beauvaisis (XVIIe -XVIIIe siècles), École des chartes, positions de thèses, 2013, pour ce développement.
(3) Brigitte Maillard, Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, Rennes, P.U.R., 2003, p. 69-77, pour ce développement.
(4) Le président du tribunal de district (ici le 1er arrondissement de Paris) a bien reçu le jugement des époux Kersaint et ne s'est pas contenté d'apposer sa signature sur l'ordonnance du 18 mai 1792 : il l'a rendue d'après les conclusions du parquet, comme s'il était question de tutelle. Aurait-il eu le droit de réformer le jugement ? La loi de 1790, célèbre pour un autre de ses articles, n'en dit rien.
(5) On pourra lire Jacques Commaille, "Les tribunaux de famille sous la Révolution [ ]", dans Robert Badinter, dir., Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice dans la Révolution française, Paris, Fayard, 1989, p. 205-223, en faisant attention que cet auteur ramène le traitement des conflits familiaux aux lettres de cachet sans dire un mot des procédures réellement employées.
(6) Idem. Il faudrait étudier suffisamment d'espèces pour savoir si un président de tribunal de district a pu s'opposer à un arbitrage ou en modifier le dispositif.
(7) Cette loi est souvent confondue avec celle du même jour qui règle le mode de constatation de l'état civil. Cette dernière se substitue, sauf erreur, à la déclaration du 9 avril 1736 en 52 articles "concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtures, noviciat et professions, et des extraits qui doivent en être délivrés". Cette loi-ci renouvelle et précise le titre XX de l'ordonnance civile d'avril 1667. On remarque que des registres étaient prévus dans les églises paroissiales, dans certaines succursales, dans les chapitres, communautés séculières ou régulières et dans les hôpitaux.
(8) Le duc de Lévis-Mirepoix (1753-1794) et ce membre de la famille parlementaire des d'Ormesson, Louis (1753-1794) ont été guillotinés. Le premier nommé avait épousé en 1777 Alexandrine-Marie-Julie-Félicité de Montboissier-Beaufort-Canillac (1764-1807), qui est une cousine issue de germaines de Claire d'Alesso, en ce que la grand-mère maternelle de Claire, Marie-Catherine Pocquet de Puilhéry (1687-1742) et l'arrière-grand-mère de Félicité, Louise-Victoire Pocquet de Puilhéry (1701-1765) sont deux surs. Le second ne semble pas faire partie de la famille de Claire.
(9) Armand-Jacques de France, né en 1737, est un autre fils de Denis de France (1700-1752) et le cousin germain d'Armand de Kersaint par les Le Couteulx. Il a dirigé la succursale de la maison familiale à Amsterdam, d'où peut-être cette addition de fantaisie à son nom. Son père a été témoin au contrat de mariage d'Armande Eustache de 1742, le fils aîné à l'acte de tutelle de 1760. Charles Ganilh (1758-1838), ancien avocat, a été arrêté sous la Terreur et il a échappé à la mort grâce à la chute de Robespierre. Il a été membre du Tribunat, puis député du Cantal de 1815 à 1823. Il a publié des ouvrages de politique et d'économie. Il y a donc deux hommes de loi et deux parents des parties sur quatre arbitres.
(10) Les procurations datant de mai 1792 indiquent que Claire réside alors rue de Bourbon (paroisse Saint-Sulpice) et Armand boulevard des Italiens. Il habitait depuis 1784 dans un immeuble neuf construit à l'arrière du théâtre.
(11) L'importance réelle de cette concession dépend de l'importance des acquêts et de la situation financière du mari, qui ne semble pas bonne et c'est, dans ce cas, une mesure de prudence.
(12) Un des deux demi-frères, mort dans l'enfance, de Claire, qui avait deux surs.
(13) Depuis 1776 : l'on voit par là qu'Armand a pu acquérir une part dans l'habitation de La Martinique sans attendre le remboursement du prix de celle de Sainte-Lucie vendue deux ans plus tôt. Comment y est-il parvenu ?
(14) Les arbitres n'ont donc pas vu ce contrat en expédition ni en copie collationnée, à la différence de l'autre, pour lequel manque la formalité de la copie collationnée.
(15) Les arrérages, au taux habituel de 5 %, sont donc acquis au mari. Ils courent depuis 1774 et 1784.
(16) Armand de Kersaint, député girondin à la Convention et non régicide, a été guillotiné le 5 décembre 1793. Il s'était converti peu à peu aux idées nouvelles dans les années 1780, comme on le constate par les mémoires qu'il a envoyés à la Cour. Pour décrire correctement cette conversion, il faudrait disposer de papiers personnels. Ceux qui ont été saisis et reposent aux A.D. des Yvelines sont loin de suffire et montrent l'officier converti. Après 1782, il ne navigue pratiquement plus et habite à Paris. Il fait partie de la société de ses cousins Le Couteulx, et approche donc les milieux de la finance et de la banque. Nous n'avons pas pu mener à bien notre projet de biographie, parce que ces papiers étaient indispensables et que la branche aînée a refusé de nous les laisser lire ou qu'elle ne les possédait plus. Nous avons eu tort de ne pas commencer par la biographie du cadet, Guy-Pierre, suggérée par ses descendants ; elle ne manquait pas d'intérêt, l'officier ayant servi comme capitaine de commerce à Hambourg puis, après sa réadmission au service, participé à la création du port d'Anvers et à l'amélioration de la navigation sur les grands fleuves. Et nous ne manquions pas de documents : qui trop embrasse mal étreint
Des officiers et des pilotes des deux marines (1629-1789) (1).
(1) Cet article, sauf mention contraire, se compose d'extraits de La Marine de Colbert. Études d'organisation, Paris, Economica, 2003 et de notre thèse de doctorat intitulée Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution, déposée en 2010 à la Bnf et disponible chez l'auteur. Toutes les références servant d'éléments de preuves s'y trouvent. L'article, avec ses illustrations, a paru dans Le Lien, revue du Centre généalogique du Finistère, en 2020.
(2) Les ducs de Bretagne, quoique vassaux de la couronne de France, exerçaient dans leurs États tous les droits régaliens, dont celui d'amirauté. Après la réunion à cette couronne, la charge d'amiral, au lieu d'être réunie à celle d'amiral de France, est d'abord donnée à l'amiral de Guyenne. Par la suite, la plupart des amiraux de France ont aussi été amiraux de Bretagne, mais par des provisions séparées. Cependant les gouverneurs ont prétendu dès le début à tout ou à partie des droits d'amirauté. La contestation perdure sous Richelieu, qui a réuni les quatre amirautés entre ses mains sous un autre nom. L'édit de 1641 qui porte création de sièges d'amirauté en Bretagne reste lettre morte jusqu'en 1691. L'édit de novembre 1669 qui rétablit la charge d'amiral (limitée à la justice et à une partie de l'administration de la marine marchande) excepte la Bretagne, et une version spéciale de l'ordonnance de la marine (marchande) d'août 1681, parue en novembre 1684, attribue au gouverneur les droits d'amirauté. Pour terminer les querelles d'attributions, le comte de Toulouse (1678-1737), amiral de France depuis 1683, est nommé gouverneur de Bretagne en 1695. Son fils le duc de Penthièvre (1725-1793) lui succède dans ces deux charges jusqu'à la suppression de la charge d'amiral de France en 1791. Les ressorts des amirautés de la province respectent les limites des diocèses.
(3) Pour fixer les idées, voici la situation en 1760 et 1761. Le nombre effectif d'officiers-mariniers classés doit être d'environ 11 000, dont de nombreux prisonniers de guerre en Angleterre. La Marine entretient 228 officiers-mariniers du service de mer dans les six spécialités, dont 62 pilotes. Elle entretient 114 maîtres d'ouvrages des professions ouvrières dans les ports, plus 36 constructeurs et 11 ingénieurs des bâtiments civils. Les chirurgiens entretenus sont au nombre de 179 pour la mer et les hôpitaux maritimes, les médecins 11 pour les hôpitaux, les aumôniers des ports 13 seulement, les autres étant détachés par les supérieurs des séminaires et payés pour la campagne. Il y a enfin 20 maîtres des sciences et des arts pour l'instruction des gardes de la Marine.
Les états abrégés de la Marine donnent, pour 1696, les effectifs suivants : 11 283 officiers-mariniers non entretenus des six spécialités des bords en 1696 : manuvre, 3 483 ; pilotage, 1 448 ; canonnage, 3 462 ; charpentage, 1 897 ; calfatage, 730 ; voilerie, 263. Au 1er mai 1788, après la réforme des Classes de 1784 : 14 419 officiers-mariniers, 48 011 matelots, 8 656 novices, 7 883 mousses (total partiel 78 969 contre 70 282 en 1696) ; 8 640 capitaines, maîtres (et pilotes côtiers) et lamaneurs. Les ouvriers classés sont alors au nombre de 13 000 environ.
(4) Ordonnance de la marine d'août 1681, livre II, t. 1, art. 4. L'Amirauté délivre un acte qui permet aux pilotes reçus de commander, les deux années de navigation étant authentifiées par le siège d'après les certificats des services émis par l'administration des Classes.
(5) On a sursis à cette obligation de 1716 à 1724, mais elle a été remise en vigueur par un règlement de 1725, ainsi que nous l'avons dit.
(6) Ordonnance du 15 avril 1689, livre VIII, t. 1, art. 31.
(7) La même année il est décidé que les lettres de maîtrise permettront aussi de servir en qualité de pilote de mer.
(8) Ordonnance de la marine d'août 1681, livre II, t. 4, art. 3 et 8. Le pilote conserve dans la marine marchande une importance qu'il n'a plus ou ne doit plus avoir dans la marine de guerre : il "commandera à la route", et le capitaine n'a pas le droit de le faire passer par des endroits dangereux et de faire des routes contre son gré ; en cas de contrariété d'avis, ils se règlent sur celui des "principaux" de l'équipage, comme au moyen âge.
(9) Ordonnance du 12 janvier 1734. L'ordonnance de 1689 (livre VIII, t. 5, art. 3) compte les "pilotes" parmi les exemptés. L'exemption est encore signalée dans le Mémoire sur les Classes de 1750 déjà cité.
(10) L'ordre a été créé en 1693 pour récompenser le mérite militaire des officiers.
(11) Mascarille dit au contraire dans les Précieuses ridicules, scène 9 : "Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris".
(12) Nous empruntons aussi à Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, Paris, 4 volumes, chez l'auteur, édition de 1988, tome II, chap. 11, article du maître-pilote et tome IV, p. 32-33, 44-49 et 306-344.
(13) "Pointer" la carte, c'est mettre sur une carte réduite le point d'intersection de la latitude et de la longitude pour savoir où l'on se trouve et connaître la route à suivre pour se rendre à sa destination. On pointe la carte tous les jours à midi et à chaque changement de route.
(14) Cette faculté n'est pas mentionnée dans l'ordonnance, qui ne parle pas de table de loch mais de loch. Elle est signalée par Jean Boudriot, qui décrit la situation de 1780, à l'époque où les officiers de marine, surtout les jeunes, ont fait de grands progrès.
Le loch est un flotteur qui est lesté afin de s'enfoncer d'abord dans l'eau perpendiculairement à l'avancement du navire ; relié à une ligne déroulante, il permet de déterminer la vitesse relative d'un navire sur l'eau en surface par rapport à la masse d'eau dans laquelle il se déplace. Cette mesure est indispensable à la navigation à l'estime. Si le courant est connu et mesurable, la vitesse vraie par rapport au fond se déduit de la vitesse relative par une somme vectorielle. La distance parcourue est mesurée sur la ligne, qui est divisée en parties égales par des nuds. Lorsque le sablier de 30 secondes finit, on arrête la ligne et la division de la longueur de ligne filée par le temps donne la vitesse relative approchée du navire, que l'on corrige en estimant le sillage. Plus la mer est calme, meilleure est la mesure.
(15) Règlement du 6 octobre 1674 pour la police générale des arsenaux de marine, titre VI, art. 6. Lorsque les montres marines sont au point, elles s'ajoutent aux instruments des bords : réglées sur le méridien du lieu de départ, elles conservent l'heure de ce lieu, ce qui permet de calculer la longitude en mer. Parmi les instruments usuels figurent des sabliers pour marquer les quarts à la mer. Le règlement de 1674 a été fondu dans l'ordonnance du 15 avril 1689 promulguée après la mort de Colbert.
(16) Là comme ailleurs, on trouve une correspondance avec l'époque actuelle : la formation des ingénieurs par les grandes écoles se double depuis quelques années d'une formation dite par apprentissage à cause du contrat, mais en réalité par alternance, avec des compétences acquises de façon non académique, contrairement à l'enseignement déductif que les savants ont fini par imposer sous Louis XV dans le Génie, l'Artillerie, les Ponts et Chaussées et quelques autres services publics plus discrets. Les ingénieurs soumis au régime de l'alternance sont plus de 5 000, sur un total annuel d'environ 40 000 ingénieurs diplômés.
(17) Ordonnance du Roi concernant la Marine, du 25 mars 1765, art. 511 à 519.
(18) Il est toujours question de gentilshommes dans les ordonnances, jamais de nobles, alors que le terme a une définition juridique précise : quatre générations nobles en ligne masculine au moins. Ici la noblesse et même la vie noble suffisent, c'est-à-dire un comportement et une occupation compatibles avec la noblesse. Les professions ouvertes sans déroger sont plus nombreuses que ne l'admettent les historiens en général. Mais bien des gentilshommes qui envoient un fils dans la Marine le font par nécessité, autrement dit à cause de leur pauvreté relative, qui les prive du genre de vie noble qu'on leur suppose toujours, ou qui fait même vivre leur famille dans la gêne. Ceux qui n'ont que les quatre degrés doivent tenir au recrutement établi dans les compagnies de gardes, mais les connaissances demandées coûtent de plus en plus cher en scolarités ou en leçons particulières.
(19) La mesure a pour effet de déconsidérer le premier grade d'officier-marinier aux yeux des marins, alors qu'ils y attachent depuis toujours un grand prix, écrit La Luzerne. Pourtant d'autres maîtres accèdent à ce grade pour en exercer les fonctions, tel François Arnaud, maître-canonnier employé à la fonderie de Ruelle, promu sous-lieutenant de vaisseau et devenu en 1787 contrôleur technique de la fonderie, détaché de la direction de l'artillerie de Rochefort, pour remplir l'emploi créé par l'ordonnance du 26 novembre 1786. A.N. Fonds Marine, C7-8.
(20) Un autre décret du 25 octobre 1795 comprend les timoniers parmi les officiers-mariniers ; il y a donc désormais, dans la maistrance de pilotage, les pilotes côtiers, les pilotes lamaneurs et les timoniers.
Le service sédentaire de la Marine, l'industrie et les coûts de revient (1849-1914): un aperçu.<em><em></em></em>
Bernard LUTUN
Notes :
(1) Bernard Lutun, Marine militaire et comptabilité : une incompatibilité ? Contribution à l'histoire des finances de l'État français, chez l'auteur, 2010, p. 89-91.
(2) Ils prenaient des travaux donnés sur adjudication : cette solution a été adoptée juste avant la Révolution par le maréchal de Castries (1727-1800), prédécesseur de La Luzerne, afin d'augmenter la productivité des arsenaux portuaires avec un personnel inamovible. Elle ne résiste pas à la tourmente. Le grand mémoire de La Luzerne est analysé au chapitre 23 de notre mémoire de thèse.
(3) Bernard Lutun, op. cit., p. 93-129.
(4) D'après Paul Bethmont (1833-1889), député de Rochefort, l'examen concernait la comptabilité des matières et objets en magasin, la comptabilité du matériel en service à terre et à bord des bâtiments (y compris ceux en construction) et la comptabilité des travaux.
(5) Procès-verbal des séances des 21, 23 et 25 juin 1873, S.H.D. Vincennes, Marine 8S70. Guyard souligne que la Cour des comptes suit sur pièces et à Paris les unités simples du 1er janvier au 31 décembre et constate de la même manière que les quantités qui figurent à tel endroit de tel inventaire au 31 décembre sont celles qui résultent des écritures de l'année. Si les inventaires sont exprimés par unités simples, les mouvements le sont par unités collectives, ce qui oblige à de multiples recherches dans ces dernières unités.
(6) Pages 5 à 31, pour ce développement. Joinville avait donné à cette revue une étude retentissante sur la marine à vapeur en 1844.
(7) Auguste Gougeard, Les arsenaux de la Marine, 1882, t. II, p. 261-262.
(8) Bernard Lutun, op. cit., p. 138-148.
(9) Peut-être sous l'influence du commissaire Henri Garreau (1823-1893), informateur officieux de Lamy qui poursuit le combat d'arrière-garde d'une partie du Commissariat, tendant au retour du magasin général à la situation d'avant 1828 : "M. Lamy fit observer qu'il réclamait le système de la séparation du service administratif du service technique, non au point de vue de la défiance et du contrôle, mais pour appliquer le principe de la division du travail. Il ne veut enlever aux ingénieurs qu'un travail de tenue de livres." (rapport du 25 mars 1882, p. 47). Curieusement Gougeard est lui aussi partisan du magasin général unique confié au commissariat : c'est une autre vue de l'esprit, et qui part du principe opposé, puisqu'il veut éliminer le Commissariat des travaux. S'il est d'avis que le Commissariat alimente ce magasin d'après les demandes des deux grands services dont il voit la nécessité, c'est le directeur des travaux qui seul ordonnancera sur le magasin pour les besoins de l'usine, et le major général de la flotte qui fera de même pour les besoins de la flotte, d'après le règlement d'armement (Les arsenaux de la Marine, 1882, t. I, p. 114, 117 et 118).
(10) Les dépositions des directeurs des constructions navales de Toulon et de Brest citées dans le rapport de 1882 vont tout à fait dans ce sens.
(11) Commission mixte de la Marine. Rapport sur la situation des travaux de la Commission. 1re partie, organisation des ports considérés d'une manière générale ; 2e partie, affectation des ports, établissements hors des ports ; [3e partie, rapport sur la comptabilité, document séparé], 25 mars 1882, signé Dislère, Thomasset, et Fabre, S.H.D. Vincennes, Marine BB8-982 ou 10 O 8.
(12) Auguste Gougeard, Les arsenaux de la Marine, 1882, t. 2, passim, cité par Bernard Lutun, op. cit., p. 148-156.
(13) Il s'agit de la réparation et de l'entretien des bâtiments de servitude pour la direction des constructions navales, du service général des ports et rades pour la direction des mouvements du port, et de l'entretien et de la réparation des armes en service pour la direction de l'artillerie.
(14) Une simple usine portuaire n'a ni chenaux à baliser, ni fonds de rade à entretenir, ni torpilles à poser, ni magasins et casernes flottantes à réparer, et peu ou pas de remorqueurs. Dans les ports de commerce les dépenses de construction et d'entretien du port reviennent au ministère des Travaux publics.
(15) Ces modifications à la réglementation sont décrites dans notre travail précité, chapitre 4, § 4.2., p. 183-218.
(16) Instruction du 16 septembre 1903 concernant la production du tableau des frais généraux de la Marine, Bulletin officiel de la Marine, 2e semestre 1903, p. 323 à 335.
(17) En 1897, le total des comptes de travaux de tous les services est de 146,2 millions, dont 40 de confections pour le magasin, 32,9 de travaux de constructions neuves dans les ports et établissements de la Marine, 13,3 de travaux de réparation navale, 35,3 de constructions neuves par l'industrie et d'achats pour constructions neuves dans les arsenaux, et enfin 24,7 millions pour autres travaux. Les crédits affectés aux constructions neuves et achats de bâtiments n'ont fait qu'augmenter depuis 1888, passant de 26 à 76 millions en 1897, ou 61 millions en moyenne, dont 35 pour les arsenaux et 26 pour les achats de bâtiments à l'industrie. La valeur des travaux de constructions neuves s'établit à 503 millions de 1871 à 1887 (17 années : 29,6 millions par an) et à 606 millions de 1888 à 1897 (10 années : 60,6 millions par an). Extrait du rapport du Comité sur les comptes de travaux de l'année 1897, 3e partie, p. 69 à 87, S.H.D. Vincennes, Marine 6DD1 357.
Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution: avant-propos et plan de la thèse
Par rapport au mémoire de thèse, le livre comprend des corrections sans réelle importance, un avant-propos augmenté des paragraphes relatifs à l'amiral Castex, que j'avais oublié, un travail séparé et comparatif sur les officiers et l'organisation de l'Armée et une bibliographie très fortement augmentée. En revanche je n'ai pas touché à la conclusion, organisée comme le corps de la thèse, c'est-à-dire principalement de manière chronologique et secondairement de manière thématique, suivant les parties du service de la Marine. Cette conclusion a été spécialement conçue pour le jury, qui ne connaissait pas suffisamment la matière et n'a pas dû lire en entier un travail aussi long : c'était un résumé de mes découvertes assorti de considérations plus modernes, qui faisaient écho au propos liminaire. Le président du jury n'a vu que la forme et m'a reproché d'avoir présenté deux fois la matière de manière chronologique. J'ai fait sentir dans l'avant-propos que je ne voulais pas abuser de la patience du lecteur de bonne volonté: je laisse donc la conclusion comme elle était.
Le lecteur intéressé par mes travaux inédits pourrra se les procurer auprès de librairies ou de sociétés qui approvisionnent les bibliothèques universitaires. S'il n'y parvient pas, il peut me passer commande directement : j'envoie les documents à réception du paiement, port compris.
AVANT-PROPOS
Le présent travail est le résultat de l'élargissement d'une question que nous nous sommes posée lors de la composition de notre mémoire de maîtrise (1). Il s'agissait alors d'étudier un petit établissement industriel de l'État dont l'existence avait été remise en question en 1878, non par l'effet d'une réforme administrative, mais sous l'action d'un petit nombre de parlementaires qui cherchaient à connaître, en vue de l'améliorer, le rendement économique des arsenaux portuaires et des usines de la Marine hors des ports. La répartition des commandes entre ces établissements et l'industrie nationale a naturellement été évoquée par la commission mixte réunie pour étudier les questions soulevées, et les éléments recueillis lors de notre première recher-che permettaient d'envisager une étude des relations de la Marine et de l'industrie pendant la période précédant immédiatement cette époque (1814-1870), période pendant laquelle la grande industrie est née en France. L'acteur collectif principal, du côté de l'administration, est déjà un corps d'ingénieurs, en dépit de certaines apparences. Nous avons cherché à savoir quand et comment ce corps s'était constitué et quelle était sa place en 1814 dans l'organisation générale de la Marine. La seconde partie de cette question a été traitée dans le mémoire de diplôme d'études approfondies, et elle nous a conduit à décrire une épuration administrative, sans oublier d'esquisser l'organisation de la Marine, dont l'évolution serait à suivre jusqu'en 1870 (2). La mise en forme des matériaux recueillis pour répondre à la première partie de la question constitue le noyau du présent ouvrage.
1. Le problème resté en suspens a été posé par un ancien capitaine de vaisseau devenu conseiller d'État, un ancien ministre de la Marine du grand gouverne-ment Gambetta et surtout un homme courageux, Auguste Gougeard (1827-1886), dans le livre mémorable qu'il a publié après l'échec prévisible de cette commission mixte de 1878 dont il faisait partie : ce sont les Arsenaux de la Marine (3). L'auteur, qui s'est livré à des recherches historiques (4), évoque l'ancienne querelle qui a déchiré la Marine en opposant le corps militaire ou Épée au corps de l'administration ou corps de la Plume. Il décrit les conséquences nuisibles à l'intérêt public d'un principe qualifié de contradiction en matière administrative ou de dualisme administratif et qui consiste à diviser l'action administrative entre des corps qui ne sont pas subordonnés les uns aux autres, mais qui doivent travailler de concert pour accomplir la part d'action qui leur est confiée de manière indivise. Il laisse entendre que la querelle des corps n'est pas étrangère à l'adoption d'un principe funeste qui subsiste dans la Marine à l'époque où il écrit.
Exposer les opinions du commandant Gougeard à ce sujet, c'est comprendre notre démarche, lorsque la recherche initiale s'est étendue à la totalité ou presque des réformes du service administratif ou service civil ou sédentaire entreprises à partir de 1761. En effet, nous les avons d'abord supposées vraies, nous nous en sommes servi pour comprendre, nous avons trouvé chez plusieurs auteurs de l'époque (rarement chez les ministres, Colbert mis à part), des vues précises, exactes et concordantes en matière d'administration qui ont suffi à éclairer la réglementation qui devait être présentée et à confirmer les positions initiales.
Gougeard sait qu'une administration défectueuse n'a pas seulement pour effet de multiplier les dépenses (5). Seuls des procédés simples et efficaces permettent aux pouvoirs publics d'apprécier l'étendue des sacrifices à consentir et de les faire accepter par le pays. C'est ainsi que l'auteur publie, pour la première fois en France, un calcul de frais généraux par établissements et directions dont les résultats sont vraiment édifiants.
L'organisation de 1689 répond selon l'auteur aux exigences qu'il a posées. L'usine, dotée de tous ses organes, s'administre elle-même, pourvoyant à ses besoins en personnel et en matières, sous les ordres de l'intendant, à la fois administrateur et homme technique. Le groupe flotte et troupes de la Marine, selon la terminologie de 1882, est placé sous les ordres d'un chef indépendant, le commandant de la Marine. Le contrôle est prévu sous les trois formes qu'il doit revêtir : technique, administratif et financier. Du temps où les bâtiments n'avaient que deux positions, l'armement et le désarmement complet, on pouvait comprendre que la flotte et l'usine aient été con-fondues, c'est-à-dire qu'elles aient utilisé les moyens d'un même service, l'arsenal. En 1882 la séparation s'impose, les moyens à donner au groupe flotte devant limiter au nécessaire les points de contact avec l'arsenal, sans pour autant en créer un petit à côté du grand. En effet, les deux parties du port travaillent de façon différente : l'arsenal doit éviter les à-coups et donc suivre un plan de production établi d'avance, alors que la flotte doit agir avec rapidité et en utilisant sa liberté d'action.
L'ordonnance de 1776, qui renverse l'ordre précédent, repose sur deux prin-cipes erronés : 1° l'instrument de guerre est fabriqué par celui qui s'en sert (l'Épée) ; 2° les comptes, qui sont la conséquence nécessaire de cette fabrication, sont dressés et produits par un corps spécial (la Plume). Si la première erreur a été corrigée dès 1786 pour les constructions navales (mais non pour l'artillerie navale, jusqu'en 1909), la seconde "a pris, en se transformant dans l'ordonnance de 1844, un caractère tout particulier de gravité".
Marins et militaires spécifient le besoin militaire et sont juges du résultat obtenu par les hommes techniques ; ceux-ci rédigent les projets correspondants et créent ensuite "sous leur propre direction, responsabilité et gestion" l'instrument de combat. Les directeurs, qui sont les chefs de ces hommes techniques, sont donc, qu'on le veuille ou non, des administrateurs. Il faut "les pourvoir de tous les instruments nécessaires pour administrer et, en même temps, leur imposer, avec la responsabilité technique, la responsabilité administrative qui en est la conséquence. Cette absence de définition et d'établissement de la responsabilité est le vice le plus sérieux de l'ordonnance de 1844. D'après cette loi, les directeurs ne sont pas des administrateurs, le bureau des travaux [du commissariat] ne l'est pas non plus. Il s'ensuit que personne ne l'est, et la conclu-sion logique, c'est que personne n'est responsable. Administration et responsabilité sont en effet deux idées semblables ; l'une est le corollaire obligé de l'autre. Dans l'ordon-nance du 14 juin 1844, le mot même n'est pas prononcé et il ne pouvait l'être : c'est la critique la plus sévère que nous voulons en faire."
Par la force des choses, les services techniques ont eu peu à peu le droit de rendre leurs comptes. Pourtant rien n'a été changé aux procédés anciens, auxquels les nouveaux ont été juxtaposés, "si bien qu'aujourd'hui nous nous trouvons en présence de deux corps différents rendant compte ou, pour mieux dire, paraissant rendre compte d'un même fait [ ]. Ce sont ces procédés administratifs, dont la raison d'être est tout historique, que l'on a décorés après coup du nom de contradiction en matière admi-nistrative. Tant il est vrai que les sophismes les plus évidents, les appellations les moins justifiées ne manquent jamais pour défendre ce que l'on désire conserver."
En 1882, le commissariat administre sans contradiction une petite partie du service des ports et, outre l'ordonnancement, exerce dans les autres parties des fonctions équivoques car, "si elles relèvent de l'ordre administratif, elles font double emploi avec les directions ; si ce sont des fonctions de contrôle, elles se superposent à celles de l'inspection des services administratifs [nom alors donné au contrôle]." De plus le contrôle local, qui devrait être indépendant, exerce son autorité sous la direction de l'administration. Gougeard remarque que la Marine reste un ministère décentralisé. Les ministres ont pu jouer de la contradiction pour essayer de connaître la vérité, mais c'est un pauvre moyen comparé à la centralisation administrative.
Enfin Gougeard remarque que, dans le service des hôpitaux, que nous n'étu-dions pas ici, étant donné qu'il suit la même évolution que le service des constructions, le personnel médical n'a jamais été subordonné aux commissaires. Jamais le com-missaire de l'hôpital n'a eu de pouvoir disciplinaire sur lui, ni le droit de juger sa valeur professionnelle, ni de faire de proposition d'avancement. Ce pouvoir appartenait au médecin-chef, puis en deuxième ressort à l'intendant, dont le commissaire de l'hôpital relevait également. Il n'empêche que le dualisme règne toujours dans les hôpitaux maritimes et que Gougeard voudrait au contraire "remettre entièrement au corps médical la police et la direction des établissements hospitaliers, avec la disposition entière de tout le personnel qui y est attaché". Le commissariat ne serait plus qu'un fournisseur (pour la réparation et l'entretien des bâtiments, le chauffage et l'éclairage, la nourriture, l'habillement et le couchage des malades). Ainsi le corps médical serait maître de l'hôpital sans descendre jusqu'aux détails de l'administration. L'on sait que cette question n'a rien perdu de son actualité dans les hôpitaux publics d'aujourd'hui.
L'exposé indique les deux niveaux de dualisme que nos lectures nous ont permis ensuite de distinguer : celui qui règne dans l'arsenal sous l'intendant depuis Colbert et celui, plus gênant encore, qui se surajoute en 1776 dans ce service sous le ministre, et qui étend considérablement le dualisme existant depuis Colbert entre le commandant et l'intendant dans le service militaire à la mer et ses prolongements à terre, dans les armements notamment. Nous ne les avons pas perdus de vue dans l'étude que nous avons faite du service des arsenaux et du service des Classes ou des équipages, qu'il s'agisse du statut des personnels, de leurs fonctions ou des relations de travail que chaque corps ou groupe (la Plume et les ingénieurs principalement) entretient avec les autres corps et groupes du port de guerre, et surtout avec l'Épée.
2. L'étude du corps des ingénieurs-constructeurs nous avait amené à ex-ploiter le fonds ancien des archives centrales de la Marine conservé aux Archives nationales et au Service historique de la Marine (S.H.D.) à Vincennes. L'état de ce fonds et l'orientation prise nous ont conduit à rechercher des projets de réforme sans en sortir, sauf si des papiers des bureaux ou des ministres ont été rangés ailleurs, et sans recourir, sauf en cas de nécessité, aux sous-séries dites de la correspondance. Une liste de textes de loi assez complète des ordonnances et règlements sans adresse ni sceau, pour l'essentiel a pu être établie, pour la période allant de 1631 à 1791, et elle constitue l'épine dorsale de notre travail. Les travaux préparatoires et les mémoires adressés par les officiers sont plus ou moins nombreux et consistants selon les époques ; ils viennent éclairer les textes de loi dont nous faisons état.
La collection la plus intéressante, de surcroît prête à l'emploi, se trouve dans le chartrier de Castries (306AP) : les trois cents pièces emportées (ce sont en général des copies) par le maréchal de Castries (1727-1800) et relatives à son activité de réforma-teur ont permis de rédiger une première version de l'étude des réformes qu'il a fait accepter par Louis XVI. Ces réformes se rapportent principalement à la partie militaire du service, qui forme ainsi la seconde extension de notre travail. Celui-ci se divise désormais en service militaire (à la mer et à terre), service administratif ou sédentaire dans lequel on doit distinguer le service mitoyen des Classes ou des équipages du service des arsenaux. Les autres collections de documents, celles que nous avons formées nous-même, sont moins belles les papiers conservés ont été dispersés et quelquefois démembrés dans toutes les séries , mais elles nous ont paru suffisantes pour étudier les trois réformes qui ont précédé celle de Castries et les mouvements qui commencent à agiter la Marine pendant la guerre de Sept ans.
Nous devons préciser que l'étude que nous avons faite du service militaire se limite à la teneur des règlements de service ou des mémoires de réforme qui s'y rapportent, bien que ladite teneur dépasse parfois l'objet normal d'un règlement admi-nistratif. Le prolongement naturel de ce travail, ce sont les Idées militaires de la Marine au XVIIIe siècle du lieutenant de vaisseau Castex (1878-1968). L'un et l'autre livres devraient s'éclairer mutuellement, et pourtant ils ont peu de points communs : les escadres d'évolution, imaginées afin d'entraîner les officiers aux manuvres d'escadre à défaut d'armements réguliers suffisants, et la défense des colonies par la mer et contre les armées navales adverses. Pour le reste, il manque une étude intermédiaire que Castex aurait dû faire lui-même pour éviter de donner à ses conclusions un tour méta-physique que n'ont pas celles de l'amiral Mahan (1840-1914) : cette différence donne en effet aux écrits de l'auteur américain une évidente supériorité pour ce qui concerne l'histoire. L'on pourrait penser que nos origines respectives expliquent des points de vue paraissant plus opposés que complémentaires. Voyons plus précisément ce dont il s'agit.
Dès le début de son essai de 1912, le stratège avertit son lecteur : "Les idées professées par l'ensemble des membres d'une société militaire, armée ou marine, nous ont toujours semblé plus intéressantes à considérer que son organisation elle-même ou que ses ressources matérielles, et cela à toutes les époques de l'histoire [ ] comme une marine n'est pas créée pour offrir des occasions de noircir du papier ou pour donner de l'occupation à des ouvriers, comme elle a le combat pour suprême but, l'idée militaire, apanage des combattants, doit inspirer en dernière analyse la pensée adminis-trative ou industrielle. Elle en doit être l'ultime moteur et le ressort caché. Les idées militaires sont les fondations invisibles d'un édifice apparent." Castex est bien un officier d'Épée.
Il juge que la faiblesse des idées militaires a privé en 1783 les marins fran-çais de la plus belle illustration qui soit. Il reproche à Castries d'avoir transposé à la Marine les conceptions générales de l'utilisation des forces terrestres, tout en reconnais-sant que les vices des plans d'opérations de la guerre d'Amérique doivent beaucoup plus au chevalier de Fleurieu (1738-1810), un ancien lieutenant de vaisseau, qu'au ministre de la Marine lui-même. Il doute que le maréchal soit arrivé au ministère avec des idées militaires, ainsi que l'aurait écrit l'intendant Malouet (1740-1814). Castex entend par idées militaires des idées en matière de tactique et plus généralement une attitude au combat visant à faire entrer dans la tête des officiers de marine que leur arme est essentiellement offensive et tournée contre la marine de l'ennemi, contraire-ment à ce qu'ils croient et à ce qu'on leur a fait ou laissé croire. Il aborde les articles de l'ordonnance générale de 1765 qui se rapportent à la question il sait que des officiers de marine en vue les ont rédigés en remarquant que l'esprit est nettement défensif : il "semble dispenser de réfléchir, de combiner, de chercher à imposer sa volonté à l'adversaire. On sait à l'avance comment on doit se former. Quoi qu'il advienne, on se réfugiera dans cette figure géométrique, certain d'avoir tout fait pour obtenir la victoire ou du moins pour ne pas être battu." Il voit aussi, d'après les instructions de campagne données aux commandants des escadres d'évolution, que le point de vue proprement militaire est secondaire, l'entraînement maritime passant avant, y compris les évolutions "géométriques".
Le terme d'idées militaires que Castex a pris dans les mémoires de Malouet ne correspond pas à la pensée de cet officier de Plume. Castries sait avant d'entrer au ministère que les officiers de marine n'ont de militaire que le nom, et il reprend en sous-uvre l'édifice maritime que nous étudions afin de les convertir ; il y serait parvenu avec le temps, le temps que tous les officiers de marine prennent le bon pli et perdent les habitudes d'une marine "bourgeoise", ainsi qu'on les a caractérisées, ce qui est un comble pour un corps noble qui affecte de mépriser le commerce. C'est pour cette raison, probablement, qu'il a préféré le portefeuille de la Marine à celui de la Guerre. Si le maréchal de Castries a encouragé ses généraux à attaquer, il n'a pas cherché à dé-truire la suprématie de la doctrine défensive dans la marine française, et il a dû croire que ce serait l'uvre de ses successeurs, et d'abord de Suffren à qui il avait pensé plus spécialement. Castex a donc commis un contresens, et cela parce qu'il s'adresse davantage aux officiers de marine de 1912 qu'à ceux de Louis XVI, ainsi que le montre le passage suivant : "Il est en effet extrêmement difficile de traîner vers l'offensive une organisation conçue en vue de la protection. Si l'on essaie en particulier de bâtir pour la flotte française actuelle un projet d'opérations agressif contre n'importe qui, et cela à titre d'exercice personnel, on demeure stupéfait du nombre de bateaux qu'il faut, surtout en ce qui concerne les unités de flottille (contre-torpilleurs et grands sous-marins), sortir de leurs trous, arracher à la défensive pour les jeter contre la flotte ennemie. La perte de rendement due à l'immobilisation protectrice (?) est fabuleuse. Quand on cherche à tourner cette machine dans le sens de l'offensive, tout est à créer, jusqu'à de nouveaux groupements tactiques et à de nouveaux liens de commandement."
Castex, qui est un officier de marine, rapporte tous les déboires de la France en matière militaire à l'usage contre nature qu'elle a fait de sa marine. Cette position lui permet de taire ce qu'il n'a pu manquer de constater par ses lectures d'archives : des désobéissances individuelles et collectives dans les rangs des officiers des bâtiments armés, la désunion dans leur corps et plusieurs actes contraires à l'honneur qui n'ont pas été étrangers au sort des armes. Dans l'opinion publique, celle des milieux maritimes du moins, l'on perçoit pendant la guerre de Sept ans un air de désapprobation et une mé-fiance qui peut aller jusqu'au désir de doubler la Marine par une autre force armée sur mer, voire même de remplacer la première par une marine affermée. Au lieu de cette unique cause, nous en trouvons donc au moins trois autres : l'infériorité matérielle et surtout numérique en général (et non dans chaque engagement), la mauvaise organisa-tion au sens où nous l'entendons, ainsi que Malouet, dans notre travail et le mauvais état d'esprit des officiers dans leur ensemble, lequel est le résultat de l'organisation autant que du recrutement.
Ici encore nos lectures d'archives viennent confirmer l'opinion générale du commandant Gougeard. Cet ancien capitaine de vaisseau est conscient des progrès accomplis par son corps en matière de discipline et de subordination. "Sur la discipline, sur le respect dû à leurs chefs et à eux-mêmes, [les officiers de marine] professent des opinions d'un ordre incomparablement plus élevé. Ces compétitions de chaque jour, ces interminables discussions allant même parfois jusqu'au refus d'obéir, et qui jettent, quand on les étudie de près, comme un voile de tristesse sur ces époques en apparence si brillantes, leur sont devenues étrangères. Si, à l'égal de leurs aînés, le sentiment de leurs devoirs à l'égard de la patrie les anime, ils ont à un degré bien autrement élevé la notion de leurs obligations envers leurs inférieurs [ ] si, en un mot, les succès ne répondirent pas entièrement aux espérances, c'est que cette obéissance complète, rapide et con-fiante, qui seule pouvait les assurer, manquait à tous les degrés de la hiérarchie [ ]. Tels étaient les officiers à l'époque de la guerre d'Amérique. Tels ils étaient encore au début de la Révolution française, très jaloux de leurs privilèges et pourtant, inconsé-quence plus commune qu'on ne le suppose, supportant difficilement le joug de l'autorité au maintien de laquelle leur conservation était intimement liée" (6). Gougeard attribue naturellement l'esprit du corps à son recrutement privilégié, mais aussi à la mauvaise éducation des gardes dans la Marine. Nous aborderons ces questions sans nous reporter à des études de cas, c'est-à-dire aux meilleurs travaux publiés sur les batailles, parce que nous pensons qu'il faudrait d'abord réétudier celles-ci à la lueur du service militaire tel que nous le présentons.
3. L'examen des documents qui se rapportent aux réformes exige de connaî-tre les noms de leurs auteurs. Quelquefois la lettre d'envoi est restée jointe à un ex-emplaire du mémoire calligraphié ; en général seul ce dernier a été conservé, ou alors les deux documents sont conservés à part. La règle veut que les mémoires soient ano-nymes car ils sont lus et résumés ou commentés au profit du ministre par les bureaux ou par des hommes de différents grades ou états ayant sa confiance, qu'ils travaillent isolément ou qu'ils soient membres de comités. C'est la traduction d'un principe de l'ancien gouvernement : tous les sujets du Roi ont le devoir de le conseiller, et ses officiers le remplissent par l'envoi de mémoires sur des objets de leur service, lorsqu'il leur en est demandé ou de leur propre mouvement. La liberté de ton surprend le lecteur habitué à la prose administrative actuelle. Dans plusieurs cas, et notamment dans la préparation de l'ordonnance générale qui devait être rendue en 1764 et des ordonnances de 1689 et 1776, des comités ont été formés pour rédiger la loi d'après les indications du ministre et d'après les mémoires : ainsi s'est instaurée une discussion contradictoire sinon publique de la loi de la Marine. D'autres mémoires proviennent de particuliers proches à un titre ou à un autre de la Marine, et nous avons tenu compte de leur voix, même si elle ne représente pas l'opinion publique en général, quoiqu'elle puisse être la voix des milieux maritimes.
Dans cette masse de documents, les plus importants sont donc ceux des commis et des quelques officiers, des militaires surtout, qui approchaient de près les ministres et ont été directement associés à leur uvre de réforme. Plusieurs écritures caractéristiques nous ont donné l'idée de rechercher l'auteur sous la plume chaque fois que l'écrit n'a pas été calligraphié ou que la version calligraphiée porte des corrections autographes, et nous sommes arrivé à de bons résultats pour cette catégorie d'écrivains. Il convient encore de distinguer le commis ou officier qui écrit d'après ses propres idées de celui qui compose d'après celles du ministre, lorsqu'il a reçu l'ordre de les déve-lopper ; il arrive que toutes ces idées se combinent dans un même mémoire.
Les premières ordonnances de réforme datent de la fin de 1761 ; cela ne veut pas dire que, dans l'intervalle, l'ordonnance de 1689 soit restée immuable, et nous étudions dans la première partie du travail, à la suite de chacune des trois grandes parties du service (service militaire, service des Classes, service des arsenaux) et de leurs subdivisions, les principales modifications qui ont été apportées à cette ordonnan-ce. Les changements perceptibles sont de peu d'ampleur, comparés à ceux que Choiseul envisage dès 1761 et qui ne cessent plus jusqu'à la Révolution, ce qui prouve que cette année marque bien le début de l'ère des réformes décidées. Mais de quand date le mouvement de fond que traduit le changement d'état d'esprit dans la Marine, lequel rend possible la réforme ou au contraire soulève les officiers contre elle ? Ce change-ment-ci se lit dans les mémoires que nous avons lus : le parti pris avoué, l'aigreur et l'exagération dans les propos, surtout chez les militaires, paraissent remonter à 1756. Il y a des mémoires antérieurs sur les mêmes sujets, mais sur un autre ton, et il en reste peu, semble-t-il, alors qu'ils sont ensuite assez nombreux jusqu'à la Révolution et que leur ton trahit en général l'appartenance à tel ou tel corps.
Nous avons cherché les événements et les considérations d'ordre intérieur qui ont mis la Marine en mouvement. Les provocations à l'égard des écrivains embarqués de la part de plusieurs commandants à la mer, en 1754 et 1755, forment le détonateur ; le désaveu initial d'un pouvoir pourtant faible conduit des militaires à publier les Considérations sur la constitution de la marine militaire de France en 1756, une publication illicite qui contredit le principe du devoir de conseil rappelé ci-dessus. Par son contenu, implicite ou explicite, ce libelle fait pendant à la Noblesse militaire du chevalier d'Arcq (1721-1795), paru la même année. Cette publication est le premier événement ; les défaites navales de 1758 et 1759 et leurs suites forment le second. Quant aux considérations évoquées de manière partiale dans la brochure et dans presque tous les mémoires étudiés, elles se rapportent généralement à l'ordonnance de 1689.
La réforme dans la Marine s'est bien faite par rapport à l'ordonnance du 15 avril 1689 "pour les armées navales et arsenaux de marine". Pour autant les faiseurs de projets qui parlent de l'esprit de cette loi le connaissent-ils ? Font-ils même un effort pour le comprendre ? La lettre est déjà difficile à bien saisir. L'un des premiers commis dont le témoignage est le plus important, Jean-Baptiste Blouin (1733-1785), prétend même que l'ordonnance de 1689 altère, dans un sens favorable aux militaires, les dispo-sitions prises du vivant de Colbert (1619-1683) ou l'esprit qui l'a guidé. Une étude complémentaire devenait donc nécessaire, et nous l'avons menée avec des sources imprimées, principalement le Code des armées navales publié en 1758 et les volumes de la correspondance de Colbert publiée par Pierre Clément (1809-1870) et ses collabora-teurs qui se rapportent à la Marine. La conclusion est nette : Blouin s'est trompé, notre étude principale doit bien commencer en 1689, après le rappel des principes de Colbert (7).
Parmi ces principes, il en est un qui est passé à peu près inaperçu jusqu'à nos jours : Colbert a pensé à donner au service militaire la forme militaire, en associant en permanence des officiers et des marins à un vaisseau, comme c'était le cas dans les Galères, ou au moins des officiers et des marins, par le cantonnement. Il n'y est pas parvenu, et la Marine est restée organisée comme celle d'un armateur jusqu'à la fin de l'époque de la voile. Dans les années 1750, le roi de Danemark adopte cette idée, et le premier mémoire français que nous ayons lu et qui parle de l'organisation de la marine de ce pays date de 1758. D'autres officiers sont conquis : ils voient dans cette formation permanente des officiers de marine français le moyen d'extirper pour toujours l'esprit d'indiscipline et d'insubordination qui les caractérise depuis Colbert et qui est la cause principale de leur infériorité permanente et de plus d'une défaite navale. Les ministres réformateurs vont écarter cette formule au profit du régiment ou de la brigade d'artillerie, pour des raisons d'économie et pour d'autres raisons qui tiennent aux préjugés de la Marine, parce que l'engagement militaire des matelots paraît encore au plus grand nombre comme une opération contre nature. L'étude du service militaire s'éclaire ainsi et devient plus facile, sinon moins longue que celle du service sédentaire. La réforme de la marine de Danemark serait à étudier, mais ce travail nous a paru superflu ici, de même que l'étude du port de Karlskrona en Suède pour le service sédentaire. L'approfondissement de notre sujet le rendrait nécessaire.
4. Le plan du livre se déduit simplement de ce qui précède. Dans la première partie ou titre nous étudions le régime de l'ordonnance de 1689 dans les grandes divisions du service et leurs subdivisions jusqu'en 1757, les chapitres introductifs servant à rappeler les principes de Richelieu et ceux de Colbert. Dans la seconde partie nous évoquons l'effervescence qui se manifeste à partir de 1756 dans les ports et dans une partie de l'opinion publique par l'examen d'un certain nombre de mémoires, puis des projets du ministre Berryer (1703-1762) qui a précédé Choiseul (1719-1785) et des premières mesures que ce dernier a prises lorsqu'il est arrivé au ministère. Les trois autres parties traitent des quatre vagues de réformes mises en uvre successivement par Choiseul, Bourgeois de Boynes (1718-1783), Sartine (1729-1801), Castries et La Luzerne (1737-1799). L'ordre chronologique s'impose parce que les ministres sont alors les véritables législateurs et que la réforme passe le plus souvent par la loi, même si le parti que nous avons pris en matière de sources peut nous avoir conduit à exagérer l'importance réelle de la loi dans l'uvre des ministres. Dans chacun des exposés l'on retrouve les modifications des parties et sous-parties du service étudiées précédemment.
L'exposé est long et il paraîtra parfois répétitif. Si nous le comparons à celui que M. Daniel Baugh a consacré à l'administration de la marine britannique de 1739 à 1748, nous voyons que nous avions trente-quatre années à étudier au lieu de dix, et que notre travail est trois fois plus long que le sien (8). D'un autre côté l'auteur américain suppose connues certaines notions d'administration et même la teneur de plusieurs anciennes lois ou regulations. Nous ne pouvions pas nous le permettre et nous avons dû adopter pour cette raison également le plan chronologique, avec évocation des mêmes matières dans chaque partie ou époque. Ce plan seul permettait de les présenter claire-ment, après un examen rendu long et difficile par l'état de l'historiographie et par leur complexité même. Nous avons profité de la première partie pour présenter plusieurs notions principales au fur et à mesure de leur apparition. Le sens qui leur est donné pouvant changer ou s'altérer avec le temps, il importe de noter ces variations dans une étude consacrée à des réformes, qu'il s'agisse d'adopter une forme nouvelle ou de revenir à une ancienne forme jugée supérieure ou plus pure. Dans certains cas, l'altéra-tion est calculée par les acteurs en fonction du but qu'ils visent, mais nous verrons aussi tel officier général demander ingénument le retour à l'esprit de l'ordonnance de 1689 tout en louant un mémoire de réforme qui est tout contraire à ses principes. Enfin nous avons manipulé au moins 7 000 articles de loi et plusieurs centaines de lettres et de mémoires. Nous ne sommes pas sûr d'avoir toujours compris le sens véritable de tel article ou de tel passage : c'est pourquoi nous citons en général les lois article par article et les parties principales des mémoires analysés, même longuement, plutôt que de para-phraser ces derniers.
L'intérêt des auteurs qui s'occupent de marine s'est récemment déplacé vers le matériel, au moins en France, et il a fait progresser la connaissance historique. L'abus d'arguments tirés de l'état matériel des flottes fausse cependant l'interprétation des campagnes et même de la politique navale ou stratégique des États (9). Aussi avons-nous adopté l'ancien point de vue, parce que, sans donner à la loi plus d'importance qu'elle n'en a dans le relèvement d'un service public, nous pensons avec le colonel Ardant du Picq (1821-1870) que, dans une armée quelconque, l'élément moral est la condition première du succès, tant que l'homme reste l'instrument premier du combat, et que l'organisation qui assure le mieux le bon esprit, la solidité, la confiance des troupes, est la plus propre à décider de son issue (10).
TABLE DES MATIÈRES
[Premier volume] AVANT-PROPOS 9
TABLE DES MATIÈRES 19
TITRE I : LA MARINE DE COLBERT 25
Chapitre premier : L'ancienne Marine 29
Chapitre 2 : Les principes de Colbert 37
2.1. Le corps militaire de la Marine 38
2.2. Les classes de la Marine 46
2.3. Les arsenaux de la Marine 49
Chapitre 3 : Le régime de l'ordonnance de 1689. a. Les corps militaires de la Marine 59
3.1. Le corps des officiers de marine 59
3.2. Les gardes de la Marine 71
3.3. Les compagnies franches de la Marine 80
3.4. L'artillerie de la Marine 87
Chapitre 4 : Le régime de l'ordonnance de 1689. b. Les classes de la Marine 97
4.1. L'enrôlement des gens de mer 97
4.1.1. Le recrutement des matelots par les mousses 98
4.1.2. Les novices 101
4.1.3. Les pilotins, les écrivains et les volontaires 103
4.1.4. Les ouvriers 105
4.1.5. Les exemptés : capitaines marchands, maîtres, patrons et pilotes 107
4.1.6. L'étendue géographique des Classes 111
4.1.7. Le service par classes 113
4.1.8. La tenue des registres 115
4.1.9. La surveillance des gens de mer non levés pour le service du Roi 117
4.1.10. Les privilèges des gens de mer 120
4.1.11. La radiation de l'ordre des Classes 121
4.1.12. Les invalides de la Marine 121
4.2. Les levées d'hommes et leur emploi au service du Roi 124
4.2.1. Les levées dans les départements 124
4.2.2. La distribution des gens de mer sur les bords 128
4.2.3. La paie et l'avancement 132
4.2.4. Le régime des prises 135
4.2.5. Les punitions militaires 136
4.3. Les officiers des Classes 138
4.4. Le système des Classes peut-il fonctionner ? 142
Chapitre 5 : Le régime de l'ordonnance de 1689. c. L'administration de la Marine
dans les ports 149
5.1. Le statut des personnels 149
5.1.1. Les officiers de plume 149
5.1.2. Les maîtres entretenus 160
5.1.3. Les ouvriers des arsenaux 170
5.1.4. Les officiers de port 173
5.2. L'organisation des travaux dans le port 175
5.2.1. Les approvisionnements 175
5.2.2. Les chantiers et ateliers 183
5.2.3. La conservation, les armements et désarmements des vaisseaux 190
5.2.4. Le contrôle 196
5.3. Les bureaux et les finances de la Marine 199
Conclusion du titre premier 205
TITRE II : DES IDÉES DE RÉFORME (1756-1762) 221
Chapitre 6 : Un vent de fronde dans les ports 225
6.1. Le mémoire de Lenormant de Mézy 225
6.2. Les Considérations sur la constitution de la marine militaire de France
de 1756, ou de la destruction de la Plume 239
6.3. L'Essai d'administration de la Marine d'avril 1758, ou plan Narbonne 247
6.4. Les idées d'un officier de port (1762) 252
Chapitre 7 : Les voix de l'opinion publique 261
7.1. La noblesse commerçante et la noblesse militaire 261
7.2. La Plume et l'Épée en question 277
7.3. Repeupler les Classes 291
7.4. Des expédients de finance 294
Chapitre 8 : Projets et premières réalisations des ministres (1761-1762) 301
8.1. Le plan Truguet-Berryer de 1761 301
8.2. La suppression de l'infanterie de la Marine 311
8.3. La transformation de l'artillerie de la Marine 318
8.4. Premières mesures relatives à la Plume et à l'Épée 322
8.5. La reconstitution de la marine matérielle 330
TITRE III : L'ÉCHEC DU GRAND DESSEIN DE CHOISEUL (1763-1769) 333
Chapitre 9 : Les quatre points cardinaux de la réforme 337
9.1. Le retour à Colbert ou le plan Blouin 337
9.2. Un programme révolutionnaire : le plan d'Estaing de 1763 341
9.3. Une autre imitation de l'Angleterre ou le plan Rodier 350
9.4. Le plan de l'Épée 356
Chapitre 10 : L'ordonnance militaire de 1763-1764 369
10.1. Le premier plan du duc de Choiseul (été 1763) 372
10.2. Les projets d'ordonnances de 1764 379
10.2.1. Le service sédentaire en 1689 et en 1764 380
10.2.2. Le service militaire en 1689, 1764 et 1765 391
10.3. Le mémoire de Chanteloup 399
Chapitre 11 : Statu quo pour l'Épée 405
11.1. Les gardes de la Marine 405
11.2. Le corps de la Marine 412
11.3. L'artillerie de la Marine 417
Chapitre 12 : Naissance d'un nouveau pouvoir : le corps des ingénieurs-
constructeurs de la Marine 425
12.1. Des constructeurs à la recherche d'un titre 425
12.2. De l'esprit de famille à l'esprit de corps 429
12.3. Grandeur et limites de la promotion sociale 434
Chapitre 13 : Un sursis pour la Plume 437
13.1. L'ordonnance générale du 25 mars 1765 437
13.2. Les habits neufs de l'administration de la Marine 443
[Deuxième volume] TITRE IV : LES RÉFORMES BOYNES ET SARTINE
OU LE BUT MANQUÉ (1772-1776) 459
Chapitre 14 : Un corps d'officiers enrégimentés 461
Chapitre 15 : Une école navale au Havre 481
Chapitre 16 : Un retour en arrière ? 491
Chapitre 17 : L'impossible retour à l'organisation d'avant 1761 505
Chapitre 18 : Le chant des sirènes 519
Chapitre 19 : Une marine sédentaire d'allure militaire ou l'organisation de 1776 537
TITRE V : LA RÉFORME CASTRIES (1782-1788) 573
Chapitre 20 : De l'ordre dans les Classes 577
20.1. Une nouvelle refonte du système de Colbert 579
20.2. Le service à bord 603
20.3. La discipline et la retraite du marin 608
Chapitre 21 : Une arme pour l'artillerie de la Marine 615
Chapitre 22 : La régénération du corps de la Marine 633
22.1. L'épreuve de la guerre d'Amérique 633
22.2. Le recrutement des officiers de marine ou la poursuite de la querelle
des anciens et des modernes 646
22.3. Les projets de Hollande 659
22.4. Un autre plan de division de la marine militaire 670
22.5. La nouvelle formation du corps de la Marine 683
22.6. Les élèves de la Marine 690
Chapitre 23 : Du côté des arsenaux 711
23.1. Les progrès des ingénieurs-constructeurs 712
23.1.1. La standardisation de la flotte 712
23.1.2. La réforme de l'école de Paris 718
23.1.3. Les progrès du corps 729
23.2. Le désordre des arsenaux 733
23.2.1. De la supériorité de l'Angleterre 733
23.2.2. Les arsenaux et les intérêts particuliers 745
23.3. Le procès de l'ordonnance de 1776 760
Chapitre 24 : Des bureaux et des conseils 775
CONCLUSION 795
TABLEAUX ANNEXES ET ARTICLE ANNEXE 819
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 903
TABLE DES MATIÈRES 1001
Notes :
1. Une forge nationale pour quoi faire ? Les forges de La Chaussade à Guérigny (Nièvre), 1840-1885, 2 vol., 955 p. et 26 pl. h. t., mémoire de maîtrise de l'université Paris IV, 1990.
2. 1814-1817 ou L'épuration dans la Marine, 359 p. et 2 dépliants, mémoire de D.E.A. de l'université Paris IV, 1991. Une version révisée de ce travail a paru en 2005.
3. Les arsenaux de la Marine. Organisation administrative. Organisation économique, industrielle, militaire, 2 vol., 1882.
4. On reconnaît par son ouvrage précédent, La Marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu'à nos jours. Richelieu et Colbert d'après les documents inédits, 1877, qu'il a consulté notamment le Code des armées navales de 1758, qui rassemble par ordre de matières les principaux textes législatifs ou réglementaires rendus du temps de Colbert et comprend une réédition de l'ordonnance du 15 avril 1689.
5. Les arsenaux de la Marine, tome 1, Organisation administrative, p. 3, 4, 6, 12, 13, 17 à 19, 27, 28, 56, 57, 70, 74, 88 et 126-128, pour ce développement.
6. Auguste Gougeard, La marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu'à nos jours. Richelieu et Colbert d'après les documents inédits, Berger-Levrault, 1877, p. 109, 117-118, 119 et 120, pour ce développement.
7. Cette étude particulière a paru sous le titre La Marine de Colbert. Études d'organisation, Economica, 2003.
8. Daniel Baugh, British Naval Administration in the Age of Walpole, Princeton University Press, 1965. Cet auteur a obtenu en 1977 la publication par la Navy Records Society de Londres d'un volume de pièces intitulé Naval Administration, 1715-1750. Nous avons de même préparé un volume de documents relatifs au service administratif de la Marine dans les ports, sous le titre "Les arsenaux de la Marine par les textes (1631-1791)".
9. On en trouve un exemple parmi d'autres dans les actes des 7es journées franco-britanniques d'histoire de la marine, Les marines française et britannique face aux Etats-Unis (1776-1865), Vincennes, S.H.M., 1999, et spécialement dans les huit communications relatives à la guerre d'Amérique. L'auteur de l'exposé introductif rapporte en passant un propos de l'ambassadeur de Vienne à Madrid, "une belle flotte, mais que valent les hommes ?" (p. 12), mais il se garde de donner le moindre élément de réponse. C'est à l'un des auteurs anglophones qu'il revient de rappeler ce qu'était l'honneur d'un officier, et il sera question plus d'une fois dans le présent travail de la manière dont les officiers de marine français concevaient cet honneur dans les deux royaumes. Notons qu'ici encore Gougeard a vu juste et distingué l'honneur qui porte quelquefois à désobéir de l'esprit de désobéissance. "Viewing the past through nineteenth-century spectacles, we are apt to imagin that an officer's honour obliged him to do his duty. This is a serious misunderstanding. Honour was a strictly personal matter, which obliged an officer to serve only two people: himself and the King, in that order. It had very little to do with abstract obligations to the Navy or the country. The essence of honour was reputation: a man of honour expected, and was expected, to establish his honour by his courage in battle. This meant that a man of honour also expected to be given the chance to distinguish himself, expected to receive a command adequate to his rank and reputation, suggested by forces sufficient to win." (p. 126).
10. Choiseul déclare aux intendants des ports que "le bon ordre et le zèle dépendront toujours plus du zèle et des talents des sujets de l'administration que de nouveaux règlements" (lettre circulaire du 13 juillet 1764). Un ancien conseiller de De Gaulle devenu conseiller d'État, Jacques Narbonne [1918], écrit de son côté : "Je n'ai jamais pu croire que les structures administratives fussent des facteurs prédominants. Je ne crois pas à la vertu des lois et décrets lorsqu'il s'agit de redresser une situation. C'est une manie bien française je n'ai pas vérifié si elle était internationale de croire qu'un problème est résolu dès que l'on a rédigé et fait adopter un texte. Les textes sont souvent moins l'expression de la volonté et de l'efficacité gouvernementale qu'un alibi et un signe d'impuissance." (De Gaulle et l'éducation. Une rencontre manquée, 1993).
Destin des arsenaux français
Signature :
Bernard LUTUN.
Notes :
1. Les projets de réforme de ce précurseur sont exposés dans notre ouvrage intitulé Marine et compta-bilité : une incompatibilité ? Contribution à l'histoire des finances de l'État français, autoédition, 2007 et 2010.
2. Jusque dans les dernières années du XIXe siècle, les fonderies de bronze et les manufactures d'armes de la direction de l'Artillerie sont encore exploitées "à l'entreprise", c'est-à-dire ici en régie indirecte. L'entrepreneur est rémunéré selon la production qu'il a livrée ; il dispose des bâtiments et outillages de l'État, il recrute et rémunère son personnel, le ministère de la Guerre détachant ses contrôleurs techni-ques. Ce mode subsiste à l'étranger : la société Chrysler a ainsi assemblé les chars M1 dans les usines du gouvernement fédéral américain.
3. Le S.E.I.T.A. est devenu un établissement public en 1959 et une société nationale en 1980. Il est maintenant aux mains d'intérêts étrangers, mais le tabac reste un produit fiscal comme au XVIIIe siècle, tout en devenant un problème avoué de santé publique.
4. Suivant la pente générale à l'époque suivante, le gouvernement institue en 1926 les régies municipales dans le domaine industriel et commercial (décret-loi du 28 décembre 1926), puis les É.P.I.C. locaux (décret du 20 mai 1955).
5. Il y a eu, après la Libération, une certaine confusion dans la notion d'É.P.I.C. : deux nouveaux établissements de cette catégorie, E.D.F. et G.D.F., ont succédé aux compagnies concessionnaires des collectivités locales, alors que la concession et l'établissement public s'excluaient mutuellement. Ces deux établissements publics sont devenus récemment des sociétés, alors que la S.N.C.F. a abandonné son statut de société pour celui d'É.P.I.C., qui paraît mieux lui convenir.
On a dénombré 66 É.P.I.C. de l'État en 1987 ; à côté de ceux que tout le monde connaît, l'on remarque neuf ports autonomes et cinq théâtres.
6. La "nationalisation" était devenue inévitable devant le refus par l'État des hausses de tarifs deman-dées, c'est-à-dire de l'équilibre économique des concessions, ce à quoi s'est ajoutée la loi des 40 heures.
7. André Demichel, Le contrôle de l'État sur les organismes privés. Essai d'une théorie générale, 2 vol., Paris, L.G.D.J., 1960, titre III, p. 303 à 404, pour ce développement.
8. Voir la note qui termine le document n° 61.
9. L'opération de 1901-1905 se présente différemment. Les biens de l'Église ont été confisqués en 1789 sur la suggestion de Talleyrand, contre l'entretien du clergé (et donc du culte catholique) et l'acquittement des obligations des fondateurs, sans que le parti anticlérical ou antichrétien ne demande encore la suppression des congrégations (ni du culte catholique). Cette dernière a lieu en 1791, au moment où l'Église séculière est transformée en un corps de fonctionnaires et séparée de Rome. La plupart des édifices du culte et de leurs dépendances (y compris des chapelles conventuelles) sont alors affectés à l'Église séculière schismatique (puis à des cultes païens), et ceux des congrégations forment le gros des ventes publiques ; les volontés des donateurs, de quelque donation (des temps gothiques !) qu'il s'agisse, sont délibérément ignorées. Le concordat de 1801 réunit une partie du clergé constitutionnel à Rome et au clergé séculier réfractaire, pour ce qui concerne le spirituel. Inféodée au gouvernement et son auxiliaire pour la police, l'Église restaurée reprend sur ordre la tradition gallicane pour passer ensuite à l'ultra-montanisme. Au début, elle n'a pas le droit d'acheter des immeubles et une bonne partie des dépenses d'entretien des édifices du culte retombe sur les communes et les départements.
L'offensive républicaine reprend dès 1880 contre les congrégations, qui se sont à nouveau multipliées parce que les gouvernements cléricaux n'y ont pas mis de frein le Concordat les ignore volon-tairement, l'intention de Bonaparte étant de les avoir dans sa main et de n'en tolérer ou autoriser que d'utiles à ses yeux . Deux décrets dus à Ferry (1832-1893) conduisent le régime à chasser 5 600 religieux sans mettre la main sur leurs biens ; la plupart d'entre eux, même des Jésuites, reviennent dans leurs maisons quelque temps plus tard. Les deux présidents du Conseil Waldeck-Rousseau (1846-1904) et Combes (1835-1921) et le rapporteur de la loi de séparation, Briand (1862-1932), remplissent le programme radical : une Église séculière séparée de l'État, gardant ses lieux de culte et ignorée en tant que telle, les congrégations non autorisées (simplement tolérées selon le décret de 1804) dissoutes (loi du 1er juillet 1901 sur les associations, qui est d'abord une arme de guerre contre les congrégations) et les congrégations autorisées (surtout les milliers de frères des Écoles chrétiennes, qui naguère encore enseignaient dans des écoles publiques) interdites d'enseignement (1904). C'est une guerre idéologique qui aurait pu tourner en guerre civile, si Combes avait été suivi jusqu'au bout, une guerre malvenue au moment de la dernière phase de préparation de la guerre extérieure. Les manifestations d'hostilité se sont limitées à des opérations d'inventaire de biens meubles : les catholiques ont ainsi confirmé qu'ils voulaient cette guerre-ci et non la guerre civile. Leur attitude est celle de 1792 ; elle n'avait changé qu'à la fin de l'Empire français, les Français dans leur ensemble, sauf l'Armée, ayant abandonné leur tyran avant la défaite de leur pays.
Les biens des congrégations supprimées de 1901 à 1904 ont été vendus à vil prix et dans des condi-tions scandaleuses : la honte est pour l'État. Les ventes n'ont pas produit de républicains comme celles de la Révolution. La loi de séparation du 9 décembre 1905 prévoyait la dévolution (propriété ou mise à disposition selon le cas) des édifices du culte à des associations cultuelles en remplacement des fabriques, mais Pie X a défendu aux catholiques français d'en former par crainte de schismes, si bien que la loi a dû être modifiée sur ce point en 1907 : les édifices bâtis depuis la Révolution et avant la loi de séparation sont donnés en propriété à l'État ou aux communes et affectés au culte catholique, si cette affectation est confirmée par l'État. Les catholiques les occupent en fait sans titre, n'étant reconnus par aucune organisation. Nombre de ces édifices, d'ailleurs, avaient été construits en partie au moins grâce à des fonds publics. Les associations diocésaines créées en 1924 ont permis aussi de régler la question des biens accumulés par ou pour l'Église depuis 1905. L'État français s'est approprié au passage de beaux édifices qu'il n'a pas affectés au culte, comme les palais épiscopaux et les séminaires. Par ce comportement, il considère que l'Église est coupable de menées antirépublicaines et la condamne en la dépouillant, et non comme un propriétaire qui doit, selon ses principes avoués, recevoir une indemnisation juste et préalable. Avec le recul du temps, l'on s'aperçoit que l'Église a gagné une certaine liberté avec la séparation et que, même sur le plan des biens immeubles, elle a bien fait de résister car il lui serait aujourd'hui impossible de les entretenir en totalité avec ses moyens financiers.
10. Les nationalisations de la Libération. De l'utopie au compromis, dir. Claire Andrieu, Lucette Le Van et Antoine Prost, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1987, p. 19 à 35, pour ce développement. D'autres passages de ce chapitre s'inspirent de cet ouvrage.
11. André de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif, t. 3, 2e éd., 2 vol., 1971 : 1er vol., Les grands services publics administratifs, p. 140 à 142 et 163 à 178 ; 2e vol., L'administration de l'éco-nomie, p. 593 à 679.
12. Ses idées politiques ayant changé après la guerre, il est devenu un "compagnon de route" du P.C.F. Pierre Cot a été membre du bureau directeur du Mouvement de la paix et, en 1953, lauréat du prix Staline pour la paix. En 1939, il avait qualifié le pacte germano-soviétique de "Munich aggravé et sans excuse". En 1956, il condamne l'intervention russe en Hongrie.
13. Nous avons eu recours aux deux thèses suivantes, dans leur version publiée : Emmanuel Chadeau, L'industrie aéronautique en France, 1900-1950. De Blériot à Dassault, Fayard, 1987, et Robert Franken-stein, Le prix du réarmement français (1935-1939), Université Paris I, 1982, ainsi qu'à l'article de Claude d'Abzac-Épezy, "La reconstruction dans l'industrie aéronautique : l'exemple français, 1944-1946", Revue H.E.S., 18e année, n° 2, 1999, p. 435 à 449. Le premier sujet suppose des connaissances suffisantes de la comptabilité et de la gestion des entreprises, le second des notions de comptabilité publique. La première étude devrait être refaite, des synthèses comptables (bilans, comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits, etc.) étant disponibles pour cette époque récente et susceptibles d'être analysées, à défaut des comptabilités elles-mêmes.
14. Les quatre groupes devaient être :
- la Société générale d'aéronautique, S.G.A. (Lorraine-Dietrich, Latham-S.I.C.C., Amiot-S.E.C.M., Nieuport, Hanriot et Motobloc, soit 9 usines et 2 filiales) ;
- Edgar Brandt (Brandt, Dewoitine-S.A.F., Lioré & Olivier : 3 usines) ;
- Potez et Bloch (2 ateliers de prototypes, 4 usines) ;
- Breguet (Breguet, Mauboussin, Morane-Saulnier et Wibault-Penhoët : 2 bureaux d'études, 2 usines).
15. Potez et Bloch profitent de la faillite et de la liquidation de la S.G.A. en 1934. Ils en rachètent des morceaux et forment une S.A.R.L. avec des sociétés en propre et des sociétés communes. L'ensemble, qui produit études, prototypes, séries, moteurs et pièces mécaniques, n'a pas plus d'unité industrielle que la S.G.A. C'est plutôt une entente sur les prix.
16. Le contrôle exercé par un service spécial dans chacun des trois ministères militaires a pour objet :
"1° d'exercer une surveillance générale sur la fabrication et la vente des matériels de guerre et de dénombrer les quantités en cours de fabrication, fabriquées ou mises en vente ;
2° de connaître les procédés employés, de suivre l'orientation des études et le développement des moyens de production ;
3° de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires spéciales à la matière ;
4° de déterminer le montant exact des bénéfices des entrepreneurs et de surveiller leurs dépenses de représentation et de publicité."
17. Voir à ce sujet la note placée à la fin du document n° 61, § 5.
18. L'État rachète seulement les meubles d'Alkan et ceux de l'activité canons d'avion d'Hispano Suiza.
19. Edgar Brandt (1880-1960) s'est fait connaître dans le monde de l'art comme un ferronnier de talent, puis dans le monde militaire pour son mortier de 81 qui a eu, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de succès. En 1938, il obtient l'autorisation de reprendre la fabrication des mortiers et ouvre dans ce but une usine à La Ferté Saint-Aubin, qui existe encore.
20. Après Breguet viennent, selon la surface couverte : Caudron, Morane-Saulnier, Amiot, Farman, S.G.M.A.T., Latécoère, Gourdou-Lesseure et Bordeaux Aéronautique.
21. La législation sur les bénéfices de guerre 8 lois de 1916 à 1939 est mise sous le boisseau. Voir à ce sujet la note qui termine le document n° 61.
22. Chiffres donnés par E. Chadeau, op.cit.
23. Soit 37 000 et 14 500 employés sur un total de 660 000 environ. Le personnel civil de l'État en 1945 dépasse légèrement le million d'agents. À elle seule, la S.N.C.F. emploie alors 500 000 agents.
24. Louis Renault et René de Peyrecave, les deux principaux dirigeants de l'entreprise, sont inculpés de commerce avec l'ennemi et écroués le 23 septembre 1944. La réquisition des usines est prononcée le 26 et le 27 ; Pierre Lefaucheux (1898-1955) est nommé administrateur provisoire. Certains y voient un acte révolutionnaire, d'autres une sanction, d'autres encore une mesure conservatoire avant la nationalisation, en réalité une confiscation post mortem et sans jugement, qui est prononcée par l'ordonnance du 16 janvier 1945. En arrivant à Fresnes, Renault souffre d'aphasie et de troubles urinaires : "ce sera trop tard", déclare-t-il à sa femme, "ils m'auront tué avant car c'est la nuit qu'ils viennent". La prison abrite des collaborateurs et des F.T.P. (dont Tillon était le chef). Il est battu dans la nuit du 3 au 4 octobre ; transféré le 7, il meurt dans le coma le 24 à la clinique de la rue Oudinot, après de violentes douleurs à la tête. Les désaccords entre médecins n'ont pas permis de le soigner ni de déterminer l'effet des coups portés en prison.
On a comparé, dans l'ordonnance de nationalisation, les livraisons insuffisantes à l'armée française avec l'importance de celles qui ont été faites à l'Allemagne. Les petits actionnaires (Louis Renault possédait l'essentiel du capital de la maison-mère) sont indemnisés d'après l'ordonnance du 18 juillet 1945 modifiant celle du 16 janvier. La confiscation des participations de Renault permet à l'État de devenir le principal actionnaire de toutes les entreprises satellites de la maison-mère et de leur imposer ses directives. Gilbert Hatry, Louis Renault, patron absolu, Paris, éd. Lafourcade, 1981, p. 401 à 426.
Marius Berliet (1866-1949) s'est mis dans le même cas que Renault, mais son sort a été différent. Condamné à deux ans de prison et à la confiscation de ses biens, il ne souffre de celle-ci que par ses enfants car il leur avait donné ses actions dans son entreprise, et deux d'entre eux ont eu de fortes sommes à payer. Pour nationaliser, ce que la S.F.I.O. demande en décembre 1949 encore, il fallait désormais indemniser, et c'était l'obstacle principal au moment où l'opération était encore possible. L'année 1949 marque le retour à la normale, après le retrait du dernier administrateur provisoire. Les nationalisations de la Libération, op. cit., p. 103 et 105.
25. Jacques Mousseau, Le siècle de Paul-Louis Weiller, 1893-1993, Paris, Stock, 1998.
26. Louis Verdier (1886-1982), ancien ingénieur du Génie maritime, collaborateur puis successeur de Weiller, et Roger Méquillet, P.-D.G. de la filiale Voisin et gendre de Paul Claudel, lui-même administra-teur de Gnome et Rhône, sont acquittés en 1949. Verdier a été interné à Fresnes comme Renault.
27. Les orateurs à la Chambre ne peuvent sans risque utiliser ce ton : voir dans le document n° 61 le passage du discours de Tillon relatif à Gnome et Rhône.
28. Tillon a été ministre de l'Air du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945, ministre de l'Armement du 21 novembre 1945 au 28 novembre 1946 et ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme du 22 janvier au 5 mai 1947, époque du retrait des ministres communistes.
29. L'étude du réacteur Atar a été confiée à l'ingénieur Hermann Östrich (1903-1973) de l'établissement B.M.W. de Berlin, à une équipe de collaborateurs de même provenance et d'agents français, notamment de l'entreprise Rateau. Le modèle 101A passe aux essais en 1948, mais ne donne pas satisfaction. Le réacteur Atar 101B fait son premier vol sur un Ouragan (Dassault) en décembre 1951. Les modèles 9B et 9C de série équipent le Mirage III (1958) et le 9K50 le Mirage F1 (1973). Le Messerschmidt Me262 de 1942 était équipé de deux réacteurs Junkers Jumo 004, les premiers sur un avion de série, mais leur durée de vie était très faible (25 heures). Les Russes ont imité ce réacteur grâce aux personnels qu'ils ont enlevés. La Grande-Bretagne disposait alors de trois réacteurs, au moins à l'état de prototypes : le Metro Vickers (1943), le Rolls Royce Nene (1944) et le De Havilland Ghost (1945).
L'imitation d'un modèle supérieur est parfois nécessaire, mais l'imitation en général peut être mauvaise conseillère et augmenter le retard de l'imitateur au lieu de le résorber : en voici un petit exemple. Le premier char d'assaut conçu par les Français après 1945 est le char lourd AMX50. Son châssis ressemble à celui du Panther, char moyen, et doit beaucoup à la collaboration d'ingénieurs et de techniciens allemands : son moteur est le Maybach 700 ch V12 à essence, sa boîte de vitesses la ZF AK7. Sa tourelle oscillante va devenir, après réduction de ses dimensions et du calibre du canon, celle de l'AMX13, le plus grand succès français d'après-guerre dans le domaine des blindés. Le char lourd n'est pas produit en série car la France d'alors achète des M47 américains "Patton" (1953). Ce dernier véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à trains épicycloïdaux, alors que les boîtes des chars précédents sont à arbres parallèles, comme celles des automobiles. Le char AMX50 devient, par métamorphoses successives et après l'échec du projet de char franco-allemand, le char moyen AMX30. L'Allemagne développe de son côté le Leopard I : la société ZF, renaissant de ses cendres, choisit d'imiter la boîte de vitesses du M47, alors que l'AMX30 est équipé d'un dérivé de la boîte du Panther (et d'un moteur Hispano Suiza). Les trains épicycloïdaux sont la bonne solution. Comme la transmission de l'AMX30 n'a jamais donné satisfaction et que l'établissement d'armement AMX-APX s'est fait remar-quer par son inertie, lorsque l'état-major de l'armée de Terre lui a demandé des améliorations avec insistance, celui-ci lui suscite une concurrence par le moyen du bureau d'études d'un ancien constructeur belge d'automobiles, la société Minerva. La version améliorée du char, dite AMX30-B2, comporte la boîte Minerva ENC200, mais sans les trains épicycloïdaux, qui ne sont utilisés que dans l'AMX Leclerc (ESM500). Le premier exemplaire de série de ce dernier char date de 1991, le premier AMX30B2 remontant de même à 1979 et le premier AMX30B à 1966 : la France a donc pris un quart de siècle de retard en ce qui concerne la technologie de la boîte de vitesses, et le G.I.A.T. a perdu une pièce maîtresse des véhicules blindés.
Osons enfin une considération à caractère moral. Quoique habitué depuis le règne de Louis XIII au pillage et au dépeçage de l'Allemagne et imprégné depuis longtemps aussi du nationalisme dont l'Alle-mand est l'objet principal puis obsessionnel, le Français semble avoir été mû en l'espèce par sa défaite de 1940, qu'il a attribuée à l'infériorité numérique ou qualitative de son matériel et non à son comportement. Les Russes n'ont pas eu de sentiment de ce genre vis-à-vis de l'Allemagne ; leur prince était son allié, et son allié naturel, depuis le traité d'alliance défensive conclu par l'entremise de Bismarck et que Guillaume II n'a pas cru devoir renouveler. La défaite russe de 1918 ne peut expliquer le pillage russe de 1945 et des années suivantes, vu que la "grande guerre patriotique" n'est pas une guerre de revanche mais une guerre de défense ; ce pillage s'étend si loin dans le domaine des équipements civils qu'il est aussi, d'après nous, la réaction d'un pays sous-développé, et du pays sous-développé par excellence qu'était la Russie sous le joug des soviets, ou la forme russe de l'infériorité. Elle a empêché la "R.D.A." de produire des moteurs à essence à quatre temps : n'est-ce pas encore un trait caractérisé de l'infériorité de ce vainqueur ?
30. Les nationalisations de la Libération, op. cit., p. 35 à 39. La théorie de la prise du pouvoir et du passage au socialisme selon Lénine (1870-1924) est exposée dans L'État et la Révolution, rédigé en 1917. L'auteur admet qu'il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'écrire à son sujet : l'ouvrage, publié en russe pendant l'année fatidique, est donc resté inachevé. Une traduction a paru en 1925 (éd. Librairie de l'Humanité), une autre au moins en 1970 (Pékin), une troisième en 1971 (autre traducteur, éd. Seghers). Cet ouvrage, dont le sous-titre est "La doctrine marxiste de l'État et les tâches du prolétariat dans la révolution", est inséré dans le tome 25 (1977) des uvres publiées par les Éditions du progrès et les Éditions sociales.
L'auteur, qui n'attendait pas la révolution pour 1917, mais pour un futur assez lointain, comme Young (1741-1820) lorsqu'il traversait la France en 1787, prône la violence qui doit briser l'État bourgeois et instaurer la dictature du prolétariat d'après le modèle de la Commune de Paris, en réalisant la fusion de la police, de l'armée et des fonctionnaires avec le peuple en armes. Il écrit après Engels (1820-1895) que l'État est avant tout formé de détachements d'hommes armés pourvus de moyens matériels comme les prisons. Il refuse de contribuer au renforcement du pouvoir de Kerenski (1881-1970) et insiste sur la nécessité de l'insurrection, qui doit être déclenchée avant le congrès des soviets, et cette intention révèle la confiance que ceux-ci lui inspirent réellement. Pourtant il affirme que cette dictature sera celle des soviets, il ne dit pas que le parti bolchevik sera le véritable et unique instrument de la conquête du pouvoir et que le parti-État sera tout puissant.
L'État bourgeois n'est pas un organe de conciliation des classes sociales, mais un organe d'oppression d'une classe par une autre classe. Lénine a déjà caractérisé l'impérialisme par la fusion du capitalisme industriel et du capitalisme financier, par la lutte pour le partage des colonies et par le passage du capitalisme monopoliste au capitalisme monopoliste d'État, processus que la guerre accentue et accélère. Les monopoles d'État et les monopoles privés s'interpénètrent de façon à créer une forme d'État qui n'aura d'autre successeur que la dictature du prolétariat. Le capitalisme monopoliste d'État a forgé les instruments qui assureront le bon fonctionnement du régime qui doit lui succéder : planification, centralisation, simplification de la gestion économique. Les grandes entreprises se transforment selon le modèle du capitalisme d'État, et Lénine prend la poste allemande en exemple. Il ne doit pas connaître les établissements industriels de l'État français ! Et il ose écrire que, sous le socialisme, la gestion étatique pourra être confiée tour à tour à des non-spécialistes, même à des cuisinières !
Dans la phase dite socialiste ou de dictature du prolétariat, "c'est l'expropriation des capitalistes, la transformation de tous les citoyens en travailleurs et employés d'un grand cartel unique, à savoir l'État tout entier, et la subordination absolue de tout le travail de tout ce cartel à un État vraiment démocratique, à l'État des soviets des députés ouvriers et soldats". En attendant l'avènement du communisme sur la base d'un "essor gigantesque des forces productives" qui doit permettre la fin de l'opposition entre travail manuel et travail intellectuel, "la société ne sera plus qu'un seul bureau et une seule usine avec égalité de travail et égalité de salaire". La phase du quasi-État, correspondant au régime transitoire du socialisme, s'achèvera par la disparition des classes et de l'État. En d'autres termes, pour permettre aux masses d'accéder au pouvoir politique, les émanciper, un État réduit à la résolution des problèmes de droit et qui reflète la persistance des classes, doit subsister jusqu'à l'instauration du paradis communiste.
Ces informations sont tirées de l'analyse de l'ouvrage faite dans le Dictionnaire des uvres politiques dirigé par François Châtelet, Olivier Duhamel et Évelyne Pisier, P.U.F., 1986.
31. Les deux thèses des communistes font penser à la thèse et à l'hypothèse de Louis Veuillot et de l'Église de son temps.
32. Bernard Chenot, Les entreprises nationalisées, Paris, P.U.F., 7e éd., 1983.
33. L'étude du changement de statut de la D.C.N. est abordée dans l'ouvrage de Jean-Daniel Lévi et Hugues Verdier, De l'arsenal à l'entreprise, Paris, Albin Michel, 2004. L'I.G.A. Jean-Marie Poimbuf (1944), un réformateur pressenti en 1999 pour être le directeur de cette administration, puis le premier P. D.G. de la société nationale, écrit alors au ministre : "Pour faire de D.C.N. une entreprise industrielle performante, compétitive, capable de rivaliser avec les autres entreprises européennes de son secteur, le chemin qui reste à parcourir est encore plus important. C'est une tâche considérable. Elle consiste, tout en maintenant le savoir-faire de l'entreprise, non seulement à poursuivre les réductions d'effectifs ainsi que les restructurations et réorganisations engagées, mais encore à faire évoluer les mentalités des personnels, et d'abord des cadres, vers un réel esprit d'entreprise. Ce travail est un véritable défi [ la] D.C.N. est engagée dans une démarche de grande ampleur qui demande une mobilisation de tous les acteurs concernés du ministère de la Défense. Pour la réussir, il faut donner confiance aux personnels de DCN et en premier lieu à ses cadres, en clarifiant les objectifs stratégiques industriels poursuivis et en leur montrant que le ministère de la Défense, soutenu par celui du Budget, se mobilise et s'organise pour aider D.C.N. Ce soutien, dont elle a absolument besoin, lui permettra de combler ses handicaps structurels et culturels pendant le temps qui lui est nécessaire pour devenir l'entreprise performante que l'on attend." Op. cit., p. 98-99.
Notices ordonnance, ordonnancement et ordonnateur préparées pour le Dictionnaire historique de la comptabilité publique (2010)
Notes :
1 "Compte que j'ai rendu au Roi de mon administration depuis 1757 jusqu'au 16 mars 1770", dans Mémoires du duc de Choiseul, éd. Guicciardi, 1987. (A.N. K 502, pièce n° 40). Choiseul affirme qu'il détient "les comptes des dépenses de chaque année arrêtés de la main du Roi".
2 "Ces extraits devant être enregistrés dans le livre du Roi tenu pour toutes les dépenses du Royaume, ils seront employés régulièrement de 6 en 6 mois, c'est-à-dire que [l'extrait] des six premiers mois de l'année doit être envoyé, sans faute, au mois de septembre et celui des six derniers mois au mois de mars, et, s'il restait quelques paiements à faire des dépenses des six premiers mois lorsqu'on enverra l'extrait, elles ne doivent pas y être envoyées, mais elles seront rappelées dans celui des six mois suivants, de sorte qu'il n'y ait d'employé dans chaque extrait que celles qui auront été effectivement payées ; mais il est nécessaire que l'extrait des six derniers mois contienne toutes les dépenses du reste de l'année qui doivent entrer dans le même exercice, aussi bien que les fonds remis, ne convenant pas de faire d'autres extraits par addition, et il faut aussi que le tout soit exactement conforme au journal du trésorier. Il est nécessaire que les intendants leur envoient un double extrait, pour rester au bureau des Fonds, l'original devant [être] remis à Son Éminence [le cardinal de Fleury]."
3 Compte que j'ai rendu au Roi de mon administration depuis 1757 jusqu'au 16 mars 1770, dans Mémoires du duc de Choiseul, éd. de 1987, p. 205-206 (A.N. K502, pièce n° 40).
4 La fortune tardive du mot mandat en français ne doit pas conduire le lecteur à confondre le sens qui en est donné ici et celui d'ordonnance de paiement* des ordonnateurs secondaires, le mot mandat ayant été imposé dans ce cas quelques années plus tard.
5 La gestion de fait est une exception à la règle : Christian Nucci a été poursuivi pour gestion de fait par la Cour des comptes, et il était ministre au moment des faits (arrêt du Conseil d'État du 6 janvier 1995).
6 Notamment la réquisition ayant conduit à octroyer à autrui un avantage injustifié ou l'absence d'exécution d'une décision de justice portant obligation de mandater les sommes mentionnées.
7 Infractions aux règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique, octroi d'un avantage injustifié à autrui au préjudice du Trésor ou des organismes intéressés, inexécution des décisions de justice. La faute grave de gestion ne vise, depuis 1995, que les "personnes chargées de responsabilité" dans les entreprises publiques de l'État, qui ne sont pas ordonnateurs.