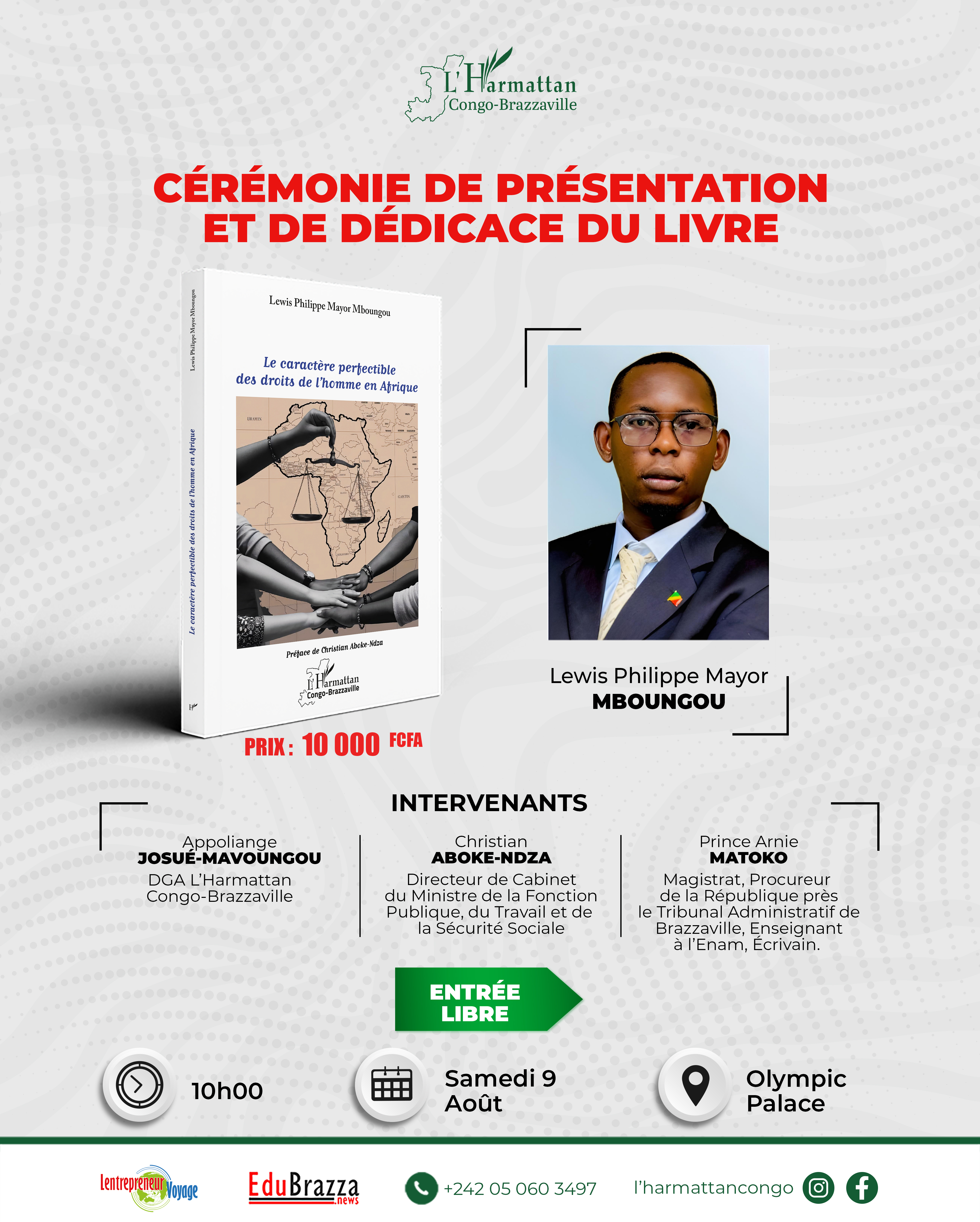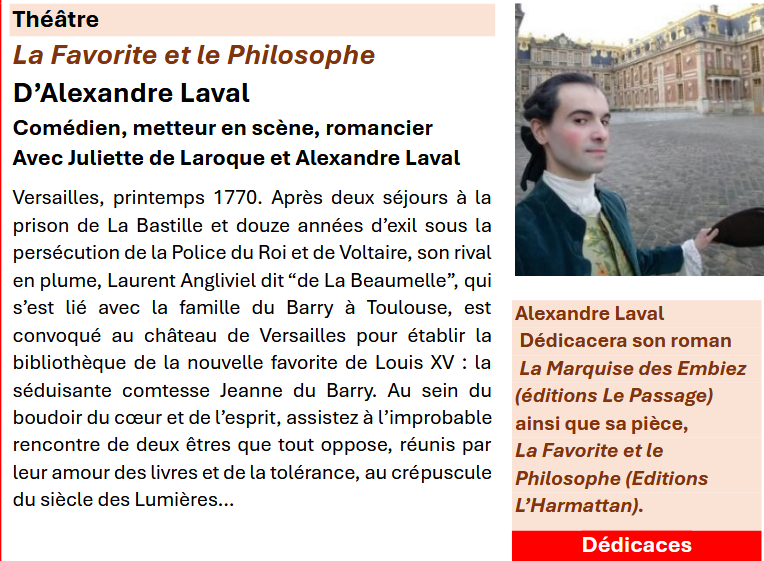Boubacar Ndiaye
ContacterBoubacar Ndiaye
Descriptif auteur
Boubacar NDIAYE est un poète et écrivain sénégalais qui explore dans ses écrits les frontières visibles et invisibles qui façonnent notre monde. Il est responsable achat et logistique de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises, à l'Agence de la Gambie.
Sa plume, à la fois intime et universelle, est un cri d’espoir, une invitation à se libérer des chaînes invisibles et à embrasser la lumière de l’avenir. Ses écrits témoignent de son engagement pour un monde où les divisions cèdent la place à l’unité et à la réconciliation.
Fonction(s) actuelle(s) : Responsable achat et Logistique CSE Gambie
Vous avez vu 11 livre(s) sur 1
AUTRES PARUTIONS
Conte - Le bracelet arc-en-ciel – Éditions Mame Touty, 2021 ;
Roman - Les ombres de la cité ou la révolution de Guédado – Éditions Yeewuna, 2023.
Recueil de poèmes - Viatiques du jeudi nuit pour raffermir le cœur des croyants – Lys Bleu Éditions, 2024.
Recueil de poèmes - Le couchant des indépendances – Éditions Yeewuna, 2025.
À paraître - Recueil de poèmes - Thiaroye 44: Les voix du Silence.
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Lettre à mes enfants dans un monde qui vacille.
Lettre à mes enfants dans un monde qui vacille.
Par Boubacar NDIAYE Mbindeef
Ce 19 mai 2025, terminé à 7:22
Bonjour les enfants,
Comment allez-vous ? J’espère que ma lettre vous trouvera en excellente santé. Votre maman et moi allons bien.
Ce matin, je me suis levé et j’ai tiré ma vieille machine à écrire Ermes. À mon époque, cette machine portable était notre ordinateur portable. J’espère que vous partagerez cette lettre avec vos amis, peut-être même sur les réseaux sociaux.
Je n’ai pas voulu prendre l’ordinateur. J’avais besoin de sentir mes doigts enfoncer les touches, d’entendre le claquement du métal contre le papier, de voir mes mots s’imprimer si fort qu’ils pourraient le perforer. Car les mots qui me traversent aujourd’hui sont puissants.
La Teranga, hier et aujourd’hui
Notre teranga a tellement fonctionné que nous sommes appelé le pays de la teranga. J’ai grandi dans cette hospitalité. Dans la maison de votre grand-père, nous avons vécu avec beaucoup d’étrangers. Ils partageaient nos chambres, et nous mangions à peine à notre faim. Il y avait tant de monde autour des bols que nos mains avaient du mal à atteindre la nourriture.
Quand j’ai commencé à travailler, j’ai rejoint la capitale. Ma première chambre, je l’ai partagée avec mes cousins. Ils portaient mes habits et mes chaussures. Et cela a continué. Une fois marié, dans la maison que j’ai louée, tous ceux qui venaient de ma région étaient les bienvenus. Tel père, tel fils. Cela a duré jusqu’à votre naissance, et même au-delà.
Je n’ai jamais refusé l’hospitalité. Tout fils d’Adam était le bienvenu chez moi. Et je n’étais pas une exception. Beaucoup faisaient même plus. C’est un devoir.
Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi avons-nous changé si vite ?
Le poison lent de la haine
Je vous ai toujours appris à respecter la différence, à valoriser l’autre. Mais aujourd’hui, je vois surgir dans les discours un racisme et une xénophobie décomplexés. Ils étaient là, discrets, mais la plaisanterie, le cousinage, savaient les contenir.
Aujourd’hui, on veut faire mal. Gratuitement. Ce n’est même plus un mépris, c’est une volonté de nuire. Et ce n’est pas encore la haine viscérale que connaissent certains ailleurs, mais nous y allons, si nous n’y prenons pas garde.
L’Afrique bouge en Afrique. Les Sénégalais s’installent au Mali, en Côte d’Ivoire, au Gabon. Des étrangers viennent aussi chez nous. Chacun trouve un secteur délaissé : coiffure, commerce, peinture... Et cela a enrichi notre économie, notre culture.
Alors pourquoi, aujourd’hui, ce rejet ? Pourquoi cette violence ?
Ce que nous avons perdu
Nous avons voulu le dialogue des cultures, la civilisation de l’universel. Mais ce mélange ne se fait pas vraiment entre Africains. Nous allons chercher ailleurs des valeurs creuses, et nous rejetons les nôtres.
Nos jeunes s’identifient à des figures déviantes : prison, drogue, violence. Ils ne savent plus où sont les repères. Ils suivent des populistes. Les autres se taisent.
Et dans ce monde désorienté, ceux qui viennent d’ailleurs, ou qui pensent différemment, sont catalogués, persécutés.
Une prière
Mes mots me fuient. Mes doigts se crispent. Ma tête tourne. Je m’arrête.
Est-ce que cela vaut la peine ?
Est-ce que vous partagerez cette lettre ? Est-ce qu’on la lira ?
Ils ont détourné la jeunesse du sérieux, pour ne laisser place qu’au burlesque et au virulent.
Alors, mes enfants, je n’ai qu’une recommandation : n’en faites pas partie.
Mbindeef
Et si Sonko s’était trompé de lutte
Et si Sonko s’était trompé de lutte ?
Le projet contre le système
Introduction
Le 24 mars 2024, le Sénégal vivait un moment historique : la victoire d’un président sans parti politique officiel, soutenu par un homme longtemps perçu comme l’ennemi numéro un du régime en place. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko incarnaient alors une promesse de rupture, un espoir pour les exclus, les trahis, les humiliés du système. Mais à peine seize mois après leur accession au pouvoir, un malaise s’installe, plus audible à travers les discours de Sonko que dans les silences du président. Ce malaise est profond. Il interroge non seulement la solidité de la coalition au pouvoir, mais surtout la nature même du combat engagé.
Et si Sonko s’était trompé de lutte ? Et si, en croyant pouvoir faire tomber le système, il n’avait fait que l’ébranler, sans jamais le déloger ?
I. Le discours d’un homme seul
Chronique d’un isolement annoncé
Depuis leur sortie de prison le 14 mars 2024, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont apparus comme un duo soudé, animé par une même ambition : rompre avec le système hérité de Macky Sall et reconstruire les institutions sur des bases éthiques, souverainistes et populaires. Mais très vite, les postures, les silences et surtout les mots ont trahi l’existence d’un décalage profond dans les pratiques et les visions.
Ce décalage, c’est Ousmane Sonko lui-même qui l’a mis en lumière.
En l’espace de quelques jours, au début du mois de juillet 2025, le Premier ministre a pris la parole deux fois de manière inhabituelle. La première fois c’est à la suite du rejet par la Cour suprême de la requête en rabat d’arrêt de Ousmane Sonko déposée à la suite de la décision rendue le 4 janvier 2024 par la Chambre pénale dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang. Il avait fait une déclaration en tant que Président du Pastef le 2 juillet 2025. Puis un discours prononcé lors d’une réunion politique de son parti Pastef le 10 juillet 2025. Deux interventions qui marquent un virage radical dans la communication du leader de Pastef.
Dans ce dernier discours, Sonko dénonce sans détour ce qu’il nomme les infiltrations du système au sein même de l’administration nouvelle. Il accuse des hauts fonctionnaires de continuer à servir les logiques de l’ancien régime, parle de “calculs politiques”, de “loyautés douteuses”, et s’en prend à certains compagnons qui auraient rejoint la coalition “pour faire tomber Macky”, mais non pour “refonder l’État”.
Il va plus loin : il critique des camarades de Pastef qu’il soupçonne de préparer 2029 dans son dos, en formant des “bureaux politiques de combat” et en se livrant à des manœuvres de positionnement.
La phrase la plus forte — “Je ne lorgne pas le fauteuil présidentiel. Je suis le belliqueux, Diomaye est le poli” — dit tout de la ligne de fracture : l’un veut combattre frontalement ; l’autre semble gérer, arrondir, temporiser.
À travers ces mots, c’est une solitude politique assumée que Sonko affirme. Il se présente comme celui qui reste fidèle à la ligne de rupture, quitte à déranger, quitte à apparaître excessif. Il se réclame de la cohérence, de la fermeté, du refus de compromis avec l’ancien régime, et affirme avoir pris “à témoin” le président sur leurs engagements initiaux.
Sa posture contraste fortement avec celle de Diomaye Faye, président discret, consensuel, soucieux de bâtir une coalition plus large, capable de rassurer les institutions et les bailleurs. Ce contraste, d’abord vu comme une complémentarité, devient, à la lumière des discours de Sonko, le signe d’un désaccord de fond.
Le silence de Diomaye face aux prises de parole de son Premier ministre est lui-même interprété. Quand Sonko critique la magistrature et dénonce les lenteurs dans les ruptures administratives, le président ne commente pas. Quand Sonko ne se rend pas à l’aéroport pour accueillir Diomaye à son retour de voyage, aucune explication officielle n’est donnée.
L’effet est immédiat : les observateurs parlent désormais de “cohabitation idéologique”, certains de “rupture consommée”. Dans les médias, les commentaires se multiplient. Des figures proches de la mouvance présidentielle, comme Habib Sy, Alioune Sall (ancien ministre), ou Cheikh Tidiane Dieye, appellent à l’unité ou à la retenue, tandis que d'autres au sein de Pastef prennent des positions plus tranchées, en faveur de l’un ou de l’autre.
En réalité, ce discours de juillet 2025 acte une chose : Ousmane Sonko se sent seul. Non pas seul dans le pouvoir, mais seul à défendre la ligne initiale, celle qui l’a conduit en prison, qui a mobilisé la jeunesse, et qui portait l’exigence de justice, de reddition des comptes et de rupture institutionnelle.
Sa solitude n’est pas qu’une posture. Elle est aussi le reflet d’un glissement progressif du pouvoir vers des formes de normalisation institutionnelle, voire de compromis. En dénonçant ce glissement, Sonko cherche peut-être à reprendre la main sur la narration politique, à rappeler que l’histoire n’est pas terminée — qu’elle ne fait, peut-être, que commencer.
En réalité, ce discours de juillet 2025 acte une chose : Ousmane Sonko se sent seul. Non pas seul dans le pouvoir, mais seul à défendre la ligne initiale, celle qui l’a conduit en prison, qui a mobilisé la jeunesse, et qui portait l’exigence de justice, de reddition des comptes et de rupture institutionnelle.
Sa solitude n’est pas qu’une posture. Elle est aussi le reflet d’un glissement progressif du pouvoir vers des formes de normalisation institutionnelle, voire de compromis.
Un des premiers signaux de cette tension est apparu dès le mois de mai 2024, avec la nomination de Samba Ndiaye à la tête du conseil d’administration de la SN-HLM. Une décision prise par le président Diomaye Faye, sans que Sonko — selon plusieurs sources proches de Pastef — n’en ait été informé ni consulté. Or, Samba Ndiaye est un ancien du Parti socialiste, considéré par certains militants de la rupture comme un homme du sérail, symbole des “recyclés” que Sonko dénoncera plus tard.
Cette nomination aurait profondément irrité le Premier ministre, qui y aurait vu une entorse à l’esprit de concertation promis dans le duo exécutif. Elle fut l’un des premiers signaux d’une différence de méthode et de priorités : là où Diomaye semble vouloir élargir la base de l’administration pour inclure des profils expérimentés, Sonko défend une ligne plus stricte, refusant toute concession aux logiques anciennes.
En dénonçant par la suite “le retour en force des figures de l’ancien régime” et la “clanisation” du parti, Sonko ne fait que prolonger un malaise ancien, que cette nomination avait déjà cristallisé.
II. Une révolution sans révolutionnaires ?
Le pouvoir, ce révélateur impitoyable
Ce que Sonko dénonce avec de plus en plus de vigueur, c’est la trahison du sens du combat, une dilution insidieuse des principes de la rupture dans les habitudes du pouvoir. Ce n’est pas une critique théorique, ni un simple malaise idéologique : c’est une colère sourde face à ce qu’il perçoit comme un abandon prématuré du peuple, et surtout de la jeunesse, qui a porté leur victoire sur ses épaules nues.
Car ce sont bien les jeunes qui ont affronté les gaz, les balles, les procès, la prison, les deuils. Ce sont eux qui ont brandi le drapeau de la rupture, au péril de leur avenir, de leur emploi, parfois de leur vie. Ils n’ont pas manifesté pour voir les mêmes visages revenir aux affaires, simplement maquillés aux couleurs de la nouveauté. Ils n’ont pas sacrifié trois ans de lutte pour que la politique redevienne un jeu d’équilibres entre clans et anciens alliés du système.
Aujourd’hui, ces jeunes sont déconcertés. Leur déception est palpable sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les quartiers périphériques. Ils ne comprennent pas pourquoi, après tant de promesses de justice et de reddition des comptes, aucune figure majeure de l’ancien régime n’a encore été inquiétée. Ni Amadou Ba, ni Abdoulaye Daouda Diallo, ni Aly Ngouille Ndiaye, ni même les gestionnaires de la Lonase, du FONSIS, de Petrosen, ou des sociétés d’autoroutes.
Où sont passées les audits annoncés ? Pourquoi l’IGE tarde-t-elle à publier les rapports ? Pourquoi les dossiers de l’OFNAC dorment-ils ? Pourquoi la CREI n’a-t-elle toujours pas été réactivée ?
Les militants de la première heure attendaient des signaux clairs. À la place, ils voient un appareil d’État qui ronronne, des ministres très diplomates, et un président qui reste muet.
Ce silence de Diomaye, Sonko ne l’accepte pas. Il le respecte, sans doute, mais ne le comprend plus. Dans son discours, il rappelle qu’il a été l’homme du terrain, le stratège, le mobilisateur, celui qui a mené toutes les campagnes. Il ne dit jamais que Diomaye lui doit la présidence — mais il laisse planer cette idée, en filigrane. Et il la juxtapose à un constat brutal : “Des gens préparent déjà 2029. On est en train de me faire un bébé dans le dos.”
La phrase claque comme une gifle. Derrière elle, il y a la peur d’une marginalisation, la sensation d’un contournement progressif, l’idée que le pouvoir est en train de se reconstituer sans lui.
Mais surtout, il y a cette frustration : le peuple attendait des actes, pas des manœuvres. Les priorités étaient claires : traquer l’impunité, remettre de l’ordre, montrer que le Sénégal changeait. Mais les jeunes voient aujourd’hui que les fauteuils ont changé de nom, mais pas toujours d’occupants ni de logique.
En convoquant l’exemple des États-Unis — où chaque président entre avec son administration, ses hommes, sa vision — Sonko ne plaide pas pour une épuration brutale. Il réclame une cohérence révolutionnaire.
Ce qu’il dénonce, c’est cette manière insidieuse de normaliser le système, de lui donner une seconde vie derrière le masque du changement.
Il ne veut pas seulement remplacer Macky Sall. Il veut rompre avec la manière d’exercer le pouvoir. Or il constate que le pouvoir, déjà, a pris ses aises.
III. Le système, toujours debout
La bête blessée, mais jamais morte
Ousmane Sonko l’a répété avec gravité dans ses dernières sorties : « Le système est toujours en place. » Cette phrase, bien plus qu’un constat d’échec, sonne comme un aveu amer — presque une autocritique implicite. Car après avoir gagné la bataille des urnes, après avoir fait tomber Macky Sall et son dauphin désigné, le Premier ministre réalise que le véritable adversaire n’était peut-être pas l’homme, mais l’architecture même du pouvoir.
Et cette architecture, elle, a très peu bougé.
Depuis avril 2024, des signaux faibles — mais désormais lisibles — montrent que l’ancien système se reconstruit dans l’ombre, parfois même avec la bénédiction passive des nouveaux dirigeants. Certains hauts fonctionnaires du régime de Macky ont été maintenus ou promus, au nom de la compétence ou de l’équilibre institutionnel. Des ministres nouvellement nommés, comme Cheikh Tidiane Gadio ou Serigne Gueye Diop, incarnent des profils technocratiques, prudents, peu enclins à heurter l’ordre établi.
Plus encore, de nombreux directeurs généraux de structures clés (SONES, APIX, AIBD, Petrosen) n’ont pas été remplacés dans les premières semaines, alors que la symbolique du changement appelait une rupture nette.
Même dans les gouvernorats et les préfectures, les anciens relais du MackySallisme tiennent encore les rênes, sous la doctrine d’une “transition douce” voulue par la présidence.
Mais pour Sonko, cette prudence est un renoncement stratégique.
Dans son analyse, le système ne se résume pas à un groupe de personnes, mais à une culture politique et administrative basée sur l'impunité, les clientélismes, la centralisation autoritaire, le verrouillage de la justice et l’enrichissement par le haut.
Ce système, affirme-t-il, sait muter, s’adapter, se camoufler. Et c’est là son génie : il est comme une plante grimpante qui s’accroche aux murs, peu importe la maison.
Les exemples sont nombreux.
La gouvernance du foncier reste floue. Les réseaux dans le pétrole et le gaz ne sont pas démantelés. Les opérateurs économiques qui avaient la main sur les marchés publics sous Macky Sall sont toujours actifs, parfois en position de force.
Plus grave encore : certains acteurs de la magistrature soupçonnés d’avoir été instrumentalisés sous l’ancien régime sont toujours en poste, sans enquête, sans audit, sans remise en question.
Et tout cela s’opère dans une ambiance de silence glacial du sommet.
Sonko l’a dit sans ambages : « Le Président ne parle pas. On lui fait croire que c’est la stratégie. Moi, je pense que c’est un danger. »
En effet, en gardant le silence sur des dossiers aussi sensibles que la reddition des comptes, la réforme de la justice, ou la restructuration de l’administration, Diomaye laisse le champ libre aux réseaux souterrains de reprendre du souffle. Ce silence, voulu ou subi, fragilise le projet de rupture.
Et Sonko le sait : le système ne tombe jamais tout seul.
Il faut du courage, des actes forts, une cohésion d’équipe, et surtout une vigilance permanente. Or aujourd’hui, le Premier ministre semble être le seul à tenir la ligne de combat, pendant que d'autres gèrent, négocient, recomposent.
Et c’est là le drame : la révolution semble avoir accouché d’un gouvernement de transition. Une transition douce, lente, administrative — qui pourrait bien faire survivre ce que la rue avait cru enterrer.
IV. Le Protocole de Rebeuss : mythe ou réalité politique ?
La mémoire carcérale comme levier de légitimité
Depuis quelques semaines, un mot intrigue, dérange, agite les débats politiques au Sénégal : le “Protocole de Rebeuss”. C’est Ousmane Sonko lui-même qui l’a remis au cœur de l’actualité. Et à plusieurs reprises, il y a fait référence comme à une forme de contrat moral et politique, conclu entre lui et Diomaye dans les heures sombres de la prison, lorsque le régime de Macky Sall tentait d’étouffer leur voix et celle du peuple qui se dressait.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Le “Protocole de Rebeuss” n’est ni un texte officiel, ni un accord signé, ni un document que l’on pourrait publier. Il relève de l’accord politique informel — cette parole d’homme donnée en prison, dans un moment de péril partagé, où les masques tombent et où l’engagement prend une valeur sacrée.
Sonko, dans ses discours récents, évoque ce protocole pour rappeler à Diomaye les engagements qu’ils ont pris ensemble, face à Dieu, à la Nation, et à leurs propres militants. Il l’utilise comme un garde-fou moral, une ligne rouge à ne pas franchir. En somme, un rappel à l’ordre silencieux, mais lourd de menaces politiques.
À l’écouter, le président aurait commencé à s’éloigner de cet accord.
En gouvernant dans la retenue.
En gardant autour de lui des profils technocratiques ou issus des anciens appareils d’État.
En se rapprochant de personnalités qui, hier encore, servaient le régime de Macky Sall, comme certains anciens ministres, directeurs généraux, voire magistrats.
Le “protocole” devient alors un symbole de fidélité à l’idéal révolutionnaire, mais aussi une arme rhétorique. Car en le brandissant devant l’opinion publique, Sonko place Diomaye face à ses propres engagements. Il le rappelle à la promesse initiale : celle de ne pas seulement prendre le pouvoir, mais de changer la manière de l’exercer.
L’effet politique est redoutable. En agitant ce souvenir commun, Sonko se réapproprie le noyau dur du récit de la rupture. Il se pose comme le gardien du serment, le garant du pacte, celui qui reste fidèle à la parole donnée.
Et ce faisant, il isole Diomaye. Car si le président refuse de commenter ce “protocole”, s’il continue de gouverner dans le silence et l’équilibre, il laisse le champ libre à l’interprétation de Sonko. Or dans une démocratie jeune et politisée comme le Sénégal, les symboles comptent autant que les actes.
Le “Protocole de Rebeuss” n’est donc pas qu’un souvenir de cellule. C’est devenu un outil de régulation du pouvoir, une sorte de contrat invisible mais toujours brandi, et qui pourrait, à terme, servir de base à une rupture politique formelle si le fossé entre les deux hommes devenait irréconciliable.
Il n’est pas exagéré de dire qu’il y a dans cette affaire des relents du “Protocole de l’Élysée” de 2012, quand Macky Sall s’était vu reprocher par ses anciens compagnons de n’avoir pas respecté certains accords de coalition, une fois installé au pouvoir.
L’histoire, décidément, bégaie plus souvent qu’on ne croit.
V. Leadership, orgueil et sacrifice
Un Premier ministre dans un costume trop étroit ?
Au fil de ses prises de parole, Ousmane Sonko donne le sentiment d’un homme à l’étroit dans les habits du pouvoir qu’il porte pourtant avec fierté. Lui qui fut le chef de file de la résistance, le tribun des rues, l’architecte de la rupture, se retrouve aujourd’hui confiné dans un rôle de Premier ministre aux prérogatives réelles mais limitées.
Car en vérité, il n’a pas la main sur les leviers les plus sensibles de l’État.
Le ministère de l’Intérieur, cœur de la machine sécuritaire, échappe largement à son contrôle. Il concentre les renseignements généraux, les fichiers administratifs, la logistique électorale, les gouvernorats, les sous-préfectures. Les fameuses “notes de renseignement” (ou billets de situation), qui peuvent être décisives dans les nominations ou dans la surveillance des agitations politiques, ne passent pas par son bureau. Il l’a d’ailleurs sous-entendu dans un discours en déclarant, non sans ironie : “Je découvre certaines décisions dans les journaux.”
Plus inquiétant encore : la présidence, via les services spéciaux, peut demander une enquête sur n’importe quel ministre, y compris sur le Premier ministre lui-même. Ce pouvoir présidentiel, hérité de la Constitution de 2001, rend Sonko vulnérable. Il est juridiquement le chef du gouvernement, mais politiquement exposé à une mise en isolement administratif, dans un appareil d’État où le centre du pouvoir reste à la Présidence.
Même chose pour le ministère des Forces armées, domaine réservé du chef de l’État en tant que chef suprême des armées. Les orientations stratégiques, les mouvements de troupes, les rapports sécuritaires liés au jihadisme dans la sous-région ou aux tensions frontalières (notamment avec le Mali et la Gambie) échappent à l’autorité du Premier ministre. Les militaires ne lui doivent aucune allégeance directe.
Quant au ministère de la Justice, il est aujourd’hui incarné par un homme de confiance de Diomaye, et dont l’autonomie vis-à-vis de Sonko est totale. Ce ministère pilote l’Inspection générale des services judiciaires, l’OFNAC, la CREI (à l’arrêt), et surtout, supervise indirectement le Conseil supérieur de la magistrature — l’un des corps les plus critiqués par Sonko. Mais là encore, aucune réforme structurelle n’a été entreprise depuis l’arrivée au pouvoir. Les plaintes contre certains magistrats proches de l’ancien régime sont restées lettres mortes.
Ces réalités institutionnelles expliquent en partie le sentiment d’impuissance que laisse transparaître Sonko. Il le dit entre les lignes : “on ne peut pas être jugé par des gens que nous avons combattus, ou qui nous ont combattus.” Mais il ne peut ni nommer, ni démettre, ni réformer — sauf à passer par le Président.
Dès lors, son autorité réelle s’effrite. Et avec elle, sa patience.
Sonko a toujours eu une relation forte à la verticalité. Il croit en la discipline, en la clarté des rôles, en la fidélité politique. Mais le poste de Premier ministre dans le système sénégalais actuel n’est pas fait pour un homme comme lui : c’est un poste d’exécution, de coordination, parfois d’interface. Or Sonko est un homme de doctrine, de stratégie, de confrontation.
Et c’est peut-être là que se joue la dimension personnelle de cette crise silencieuse. Sonko a sacrifié sa carrière, sa liberté, sa santé, son confort, pour un idéal. Il a vu ses amis tomber, ses partisans mourir, son image être salie. Aujourd’hui, il voit autour de lui des ministres qu’il n’a pas choisis, des clans se former, des décisions se prendre sans lui.
Il l’a dit : “Je ne suis pas dans une logique de fauteuil. Mais je ne sacrifierai pas l’idéal pour un poste.”
Dans cette phrase, il y a toute l’ambiguïté du moment : Sonko ne veut pas être président, dit-il. Mais il ne peut pas non plus rester un simple Premier ministre sans pouvoir.
Le costume est trop étroit.
Le sacrifice est trop lourd.
Et l’orgueil du combattant blessé commence à gronder.
VI. Le peuple arbitre ?
Entre mémoire des sacrifices et impatience sociale
Il y a une chose que les élites politiques sous-estiment souvent : la maturité du peuple sénégalais.
Ce peuple qui a fait tomber un régime, non pas par les armes ni par les cris, mais par le bulletin de vote et le courage collectif. Ce peuple qui, pendant trois ans, a marché, résisté, enterré ses morts, défendu ses prisonniers politiques, boycotté certaines institutions, et affronté un appareil répressif sans faiblir.
Ce peuple, aujourd’hui, observe. Il jauge. Il attend.
Il n’est ni dupe ni naïf. Il sait que l’exercice du pouvoir implique des compromis. Il comprend que la gestion d’un État n’est pas la même chose que la lutte depuis l’opposition.
Mais ce qu’il ne comprend pas — ou plutôt, ce qu’il n’accepte pas — c’est que la rupture promise devienne si rapidement un jeu d’équilibres personnels et de clans.
Dans les rues de Dakar, de Thiès, de Ziguinchor ou de Saint-Louis, on entend une phrase récurrente :
“Ils ne sont même pas en place depuis 100 jours, et ils se battent déjà.”
Ce jugement peut sembler sévère, mais il révèle une vérité plus profonde : la déception gagne du terrain, même chez les plus ardents militants du changement.
Certains se sentent trahis. D’autres, simplement inquiets. La majorité, elle, est fatiguée.
Fatiguée des querelles de leadership. Fatiguée des signaux flous. Fatiguée des réformes qui tardent. Fatiguée de ne pas sentir concrètement que quelque chose a changé dans leur vie quotidienne.
Car pendant que Diomaye et Sonko règlent des comptes silencieux, le chômage des jeunes ne recule pas.
Les prix des denrées restent élevés. L’électricité est instable.
Les appels à l’investissement peinent à convaincre, dans un pays où la dualité au sommet jette une ombre d’incertitude.
Et il y a une autre chose que le peuple n’oublie pas : le sang versé.
Les jeunes tombés à Bignona, Kolda, Kaolack, Ouakam, Nioro.
Les mères en deuil.
Les centaines de détenus d’hier, et ceux encore dans les geôles aujourd’hui.
Tout cela ne peut pas se solder par une querelle de palais.
C’est pourquoi, dans les débats publics, dans les médias, dans les daaras, dans les rues, la question de la responsabilité morale est posée.
Qui a trahi l’idéal ?
Qui s’est embourgeoisé ?
Qui a oublié les martyrs ?
Qui se tait quand il faut parler ?
Le peuple, sans le dire, observe pour juger.
Et son jugement est politique. Pas dans le sens partisan, mais dans le sens profond de ce mot : il se rappelle pour choisir.
Car en 2026, puis en 2029, les Sénégalais voteront de nouveau.
Et cette fois-ci, ils ne voteront plus seulement pour une rupture : ils voteront pour la cohérence.
VII. Quand l’histoire bégaie : frères d’armes, frères ennemis
Des complicités historiques aux fractures politiques
L’histoire politique du Sénégal — et au-delà, celle de l’Afrique de l’Ouest — est riche en exemples de duos formés dans la lutte et brisés dans l’exercice du pouvoir. Ce que vit aujourd’hui le tandem Diomaye–Sonko n’est pas sans précédent. Et ces précédents ont souvent eu des conséquences profondes, voire tragiques, sur le destin de leurs pays.
Senghor et Mamadou Dia : la fracture fondatrice
Le cas le plus emblématique reste sans doute celui du Président Léopold Sédar Senghor et de son Premier ministre Mamadou Dia, au début des années 1960. Tous deux compagnons de route, intellectuels, bâtisseurs de la nation indépendante, ils formaient un duo idéologique : l’un poète, l’autre technocrate.
Mais très vite, la question du pouvoir réel surgit. Mamadou Dia, plus radical dans sa vision socialiste et dans ses réformes économiques, se heurta à un Senghor plus modéré, plus proche de l’élite traditionnelle. La fracture se creusa jusqu’au coup d’État institutionnel de 1962, où Mamadou Dia fut accusé de tentative de putsch et emprisonné pendant douze ans.
Ce précédent est lourd de sens : il montre que la méfiance entre Président et Premier ministre peut mener à la destruction du tandem fondateur. Et qu’un excès de verticalité — dans un système où le président concentre les pouvoirs — peut étouffer la voix de celui qui devait incarner le contrepoids.
Wade et Idrissa Seck : l’ambition en miroir
Autre épisode marquant : la relation entre Abdoulaye Wade et son ancien “fils spirituel” Idrissa Seck. Pendant plus de quinze ans, Seck fut la cheville ouvrière du PDS, stratège électoral, organisateur de terrain. En 2002, il devient Premier ministre. Mais très vite, son ambition agace Wade, qui le soupçonne de préparer sa succession en douce.
En 2004, Seck est limogé, puis emprisonné pour détournement de fonds publics dans l’affaire des chantiers de Thiès. Une affaire aux relents politiques, où la rivalité personnelle fut habillée de motifs judiciaires.
Le lien entre Diomaye et Sonko, s’il venait à se rompre brutalement, pourrait rappeler ce moment : la blessure de celui qui s’est senti trahi par un mentor devenu obstacle.
Ghazouani et Abdel Aziz : la trahison au sommet
Mais c’est sans doute en Mauritanie que le cas le plus comparable se trouve. Mohamed Ould Abdel Aziz, président entre 2009 et 2019, avait désigné comme successeur son ami et compagnon d’armes Mohamed Ould Ghazouani, général respecté, loyal, discret.
À la surprise générale, une fois élu, Ghazouani prend ses distances, écarte les proches de son prédécesseur, et amorce un lent démantèlement du réseau Aziz. Ce dernier s’y oppose publiquement, parle de trahison, critique la gestion du pays… avant de se retrouver lui-même poursuivi pour enrichissement illicite, puis emprisonné.
Le parallèle avec Sonko est troublant : le “faiseur de roi” qui se sent marginalisé, qui accuse ses anciens alliés d’avoir rompu le pacte, qui s’en remet au peuple pour trancher — et qui pourrait, si la rupture se durcissait, subir une mise à l’écart institutionnelle ou judiciaire.
Ces trois cas historiques montrent qu’au sein d’un duo fondateur, le déséquilibre des pouvoirs, les ambitions divergentes et le silence stratégique peuvent transformer une alliance politique en guerre froide personnelle.
Et dans tous ces cas, c’est la stabilité du pays qui finit par en pâtir.
C’est pourquoi le Sénégal, fort de son histoire, ne doit pas oublier une leçon simple : on ne gouverne pas contre l’esprit d’union qui a porté un projet au pouvoir.
Les peuples savent reconnaître les égarements du pouvoir, et ils n’hésitent pas à sanctionner ceux qui trahissent leurs espoirs.
Conclusion générale – Le prix de la rupture
L’alternance politique du 24 mars 2024 n’a pas seulement mis fin à douze années de règne d’un homme, elle a aussi éveillé un espoir brut, massif, presque mystique.
Le peuple sénégalais ne réclamait pas un simple changement de figures. Il exigeait une refondation morale et structurelle de l’État, une justice réhabilitée, une économie réorientée vers le bien commun, un pouvoir désencombré des clans et des logiques de prédation.
Mais à peine cent jours plus tard, les fissures apparaissent déjà dans l’édifice.
La dualité entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko est plus qu’un simple malentendu. C’est la résurgence d’une question politique essentielle : peut-on conquérir le pouvoir contre un système, sans être absorbé par ce même système une fois aux commandes ?
Et surtout : peut-on gouverner ensemble avec des visions désormais divergentes sur l’action, le rythme et les priorités ?
Le Sénégal, aujourd’hui, avance sur une ligne de crête fragile.
La légitimité populaire est encore forte. Le crédit accordé au nouveau régime n’est pas totalement entamé. Mais la patience s’effrite. La jeunesse attend. Le peuple observe. Et le monde regarde.
Il est encore temps. Temps de recoudre, de parler vrai, d’agir juste.
Mais ce temps ne durera pas éternellement. Car l’Histoire, elle, ne fait pas crédit.
Elle juge.
Et souvent, sans appel.
Postface I – Une adresse au pouvoir
Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent se souvenir d’une chose : ils sont liés par un serment de peuple, non par une alliance de circonstance.
Ce peuple qui les a portés au sommet n’a pas d’arrière-cour, pas de plan B. Il ne s’est pas battu pour qu’on répète les mêmes erreurs, avec d’autres costumes.
Si vous décevez ce peuple, il ne criera peut-être pas. Il ne descendra peut-être plus dans la rue.
Mais il vous verra.
Il vous jugera.
Et il vous laissera seuls.
Gouverner, ce n’est pas vaincre l’adversaire. C’est honorer la mémoire des sacrifices.
Et parfois, pour cela, il faut taire son orgueil, tendre la main, se rappeler d’où l’on vient.
Le Sénégal n’a pas besoin de héros solitaires. Il a besoin d’hommes debout, ensemble.
Postface II – Parole d’horizon
Il est toujours étrange d’assister à la lente désunion de ceux qu’on croyait frères d’âme.
On se dit qu’ils ont tout vécu ensemble : l’injustice, la prison, l’espoir, le vertige de la victoire.
On se dit qu’ils ne se trahiront pas.
Et puis, un mot de trop. Un silence de trop.
Et le lien se fissure.
Mais ce pays — ce pays tissé de patience et de mémoire — a déjà vu des amitiés sombrer dans les abîmes du pouvoir. Il a déjà entendu des promesses se faner à peine prononcées.
Et pourtant, il croit encore.
Car ce pays est fait de peuples anciens.
De regards fatigués mais lucides.
De voix qui disent peu, mais qui savent.
Alors si ceux du sommet vacillent, le peuple, lui, se souviendra.
Il ne laissera pas l’histoire s’écrire sans lui.