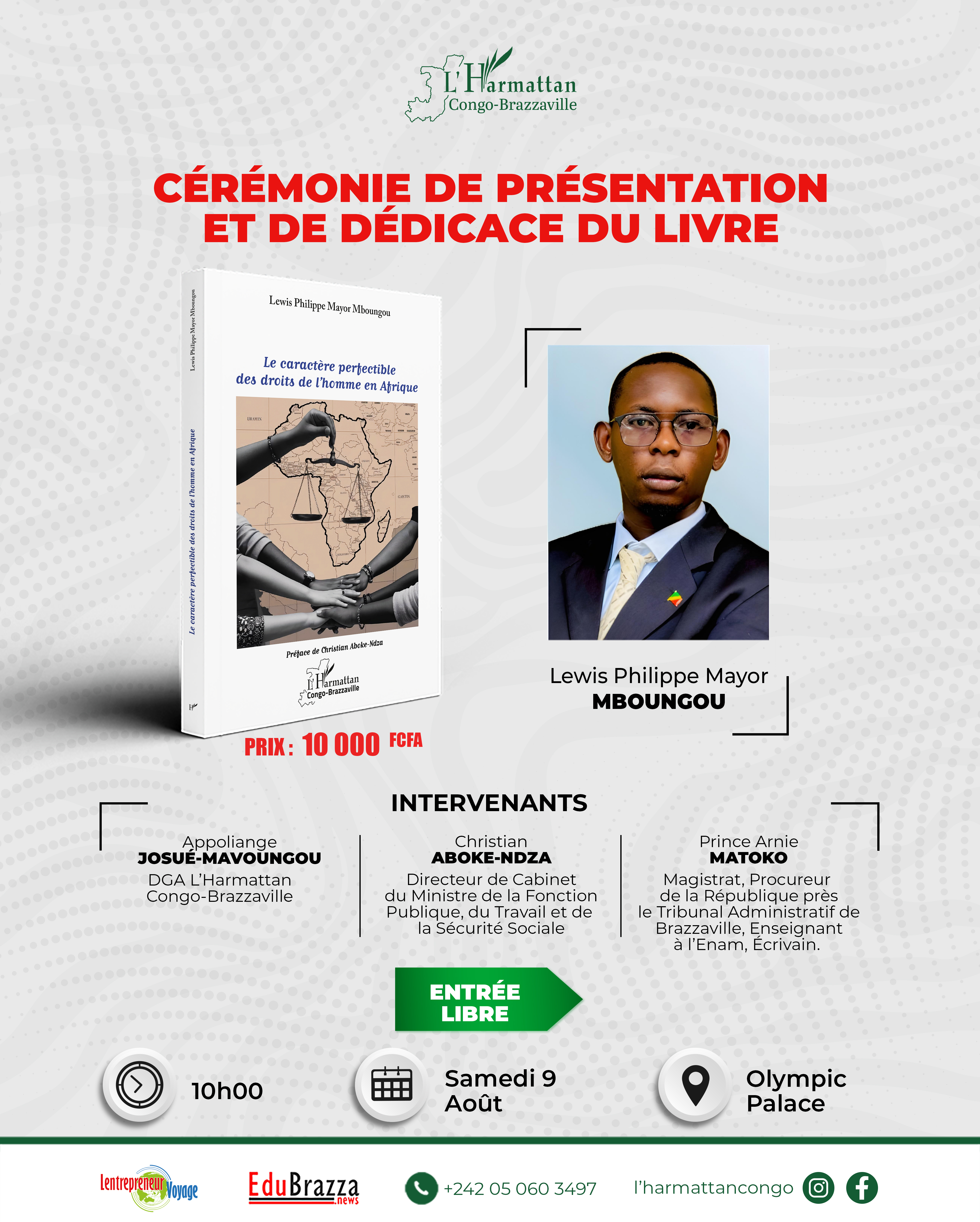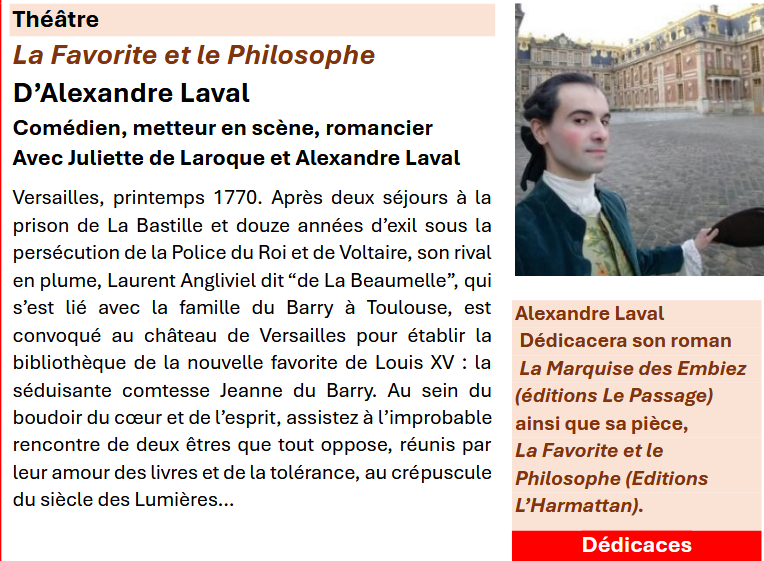François Labbé
ContacterFrançois Labbé
Descriptif auteur
Né á Dinan (22)
Etudes au lycée Lamoricière (Oran), Chateaubriand et Bréquigny (Rennes)
Faculté des lettres de Rennes (licence, Maîtrise, Doctorat)
Lecteur à l'université de Münster (RFA)
Professeur de lettres à Strasbourg puis Mulhouse et St Louis
Chargé de cours à la faculté des lettres de Mulhouse (préparation CAPES, cours 1ere année)
Responsable de l'action culturelle dans le Haut-Rhin
Proviseur du lycée franco-allemand de Fribourg (RFA)
Professeur à l'IUFM et à l'Université de Nouméa
Mise en place de l'école Saint-Exupéry avec Terre des Hommes à Cheyyur (Tamil Nadu, Indes)
Enseignant, marié, un fils. Partage sa vie entre son domicile du Pays de Bade et Carantec.
Titre(s), Diplôme(s) : Agrégé, Docteur ès lettres
Fonction(s) actuelle(s) : Ancien proviseur francais du Lycée franco-allemand de Fribourg
Vous avez vu 11 livre(s) sur 6
AUTRES PARUTIONS
Principaux articles de recherche littéraire
1. Copie d’un exemplaire des constitutions maçonniques d’Anderson avec dédicace latine de 1729 (Bibliothèque de Eutin (Allemagne), in : Annales Historiques de la Franc-maçonnerie, no 11, 1974, pp. 29 à 31.
2. « La loge de Münster et Blücher, 1802-1813 », in : Humanisme, no 116, 1977, pp. 9-11.
3. « Frédéric le Grand et la franc-maçonnerie », in: Annales Historiques de la Franc-Maçonnerie, no 18, avril 1977, pp. 12-21.
4. « A propos d’une étude sur la franc-maçonnerie autrichienne sous Joseph II », in : Humanisme, no 117, 1977.
5. « Kuenen et De La Tierce : question de biographie », in : Humanisme, no 124, 1978, pp. 19-23.
6. « Le message maçonnique en France au XVIIIe siècle », in : Humanisme, no 124, 1978, pp. 47-65.
7. « L'An 2440 : une lecture maçonnique », in : Lendemains, p.41-51, Berlin, 1978.
8. « À propos des Lettres Persanes », in Lendemains n° 15,1979.
9. « Femme, initiation et vérité romanesque dans Les égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon et Les confessions du comte*** » de Duclos, in : Lendemains, no 16, novembre 1979, pp. 113-120.
10. « Franc-maçonnerie, littérature et mouvement des idées au XVIIIe s. », in Recueil des Actes de l’Institut des Hautes Études et de Recherches Maçonniques, Paris, 1980.
11. « Louis-François de La Tierce (1699-1782), Franc-maçonnerie et Cosmopolitisme », in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 43, 1990, pp. 49-68.
12. « Littérature et franc-maçonnerie. « La vallée de la peur » de Conan Doyle », in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 23 et 24, 1980, pp. 21-26.
13. « Les bibliothèques de loges à Strasbourg », in : Humanisme, 1980.
14. « Une bibliothèque de loge à la fin du second empire. Loge des Frères Réunis à l’Orient de Strasbourg », in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 27-28, 1981, pp. 34-39.
15. « Pour une lecture initiatique de l’Immoraliste », in : Bulletin des amis d’André Gide, no 66, 1985, pp. 213-228.
16. « Germain-François Poullain de Saint-Foix », in : Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, tome 63, 1986, pp. 323-348.
17. « Lancelot, der Bote aus Frankreich », une revue française en Allemagne (1946-1951), in : Almende, 1986, pp. 85- 98.
18. « Bibliographie des recherches maçonniques en Allemagne 1 et 2 », in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 37 et 41, 1986.
19. « La nostalgie de Prométhée ou l'Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut et ses lecteurs », in Lendemains, p. 57-66, no 46, Berlin, 1987.
20. « La nostalgie de Prométhée ou l’histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut et ses lecteurs », un essai de lecture maçonnique »in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 40, 1988, p. 9-14.
21. « Itanoko, drame maçonnique », in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 40, 1988.
22. « Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière », in : Annuaire de la société d’histoire sundgovienne, 1988, pp. 23-35.
23. « Lamartelière romancier », in : Annuaire de la Société d’histoire Sundgauvienne, 1990, pp. 149-162.
24. « Louis-François de la Tierce (1699-1782) : Franc-maçonnerie et cosmopolitisme, in : Chroniques d’histoire maçonnique, no 43, 1990, pp. 49-68.
25. « Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière (1761-1830), l’introducteur de Schiller en France, l’annonciateur du mélodrame, l’auteur révolutionnaire », in : Studies on Voltaire and the eighteenth century, no 284, 1991, pp. 259-289.
26. « Compte-rendu de H.-J. Lüsebrink, R. Reichardt, Die Bastille, Zur Symbolgeschichte von Herrschaft und Freiheit, Frankfurt, 1990 – in : Francia, no 18/2, 1991, pp : 298-299.
27. « Le rêve irénique du marquis de la Tierce », in: Francia, Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, no 18/2, Sigmaringen, 1992, p. 47-69.
28. « Á Rebours et „l’œil d’un prince“: au-delà d’une esthétique de la provocation », in : Lendemains, numéro spécial Mallarmé, no 73, 1994, pp.46-53.
29. « Entre les modèles français et anglais, théâtre et franc-maçonnerie en Allemagne au XVIIIes. ; deux structures mimétiques et inductive d’une identité allemande », in: Cahiers d’Histoire des Littératures romanes, volume 3-4, p. 261-288, 1995.
30. « Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière (1761-1830). Un dramaturge entre deux cultures et deux époques », in : Recherches Germaniques, no 30, Strasbourg, 2000, pp.145-157.
31. « Progrès, vertu et harmonie sociale pour L.-F. de la Tierce », in : Chroniques d’histoire maçonniques, 48, 1997, p. 3-9.
32. « Anacharsis Cloots (1755-1794), le Prussien gallophile et le rêve d’une union franco-prussienne, clef de voûte de sa République universelle », in : Francia, Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, No 27/2, 2000, pp. 265-274.
33. « Un concurrent pour Rivarol: le baron philosophe Jean-Baptiste Cloots du Val-de-Grâce », in : Lendemains 101/102, 2001.
34. « Le Bauld de Nans et la passion de la maçonnerie », in : Renaissance traditionnelle, no 163-4, 2011.
35. Les écrivains et l'argent, collectif: "Un pauvre diable en mal de subsides": Le Bauld-de-Nans", Université de Lille, sous la direction d'Olivier Larizza, Orizons Paris, 2012
36. « Dufresne de Francheville » : Un philosophe à Berlin, Francia (2012).
37. Recension de La Dramaturgie de Hambourg (J.-M. Valentin), 2012, in : Francia, 2012.
38. Recension de Heinrich Heine, Lutetia, Correspondances sur la politique, l'art et la vie du peuple. Traduction, annotation et postface par Marie-Ange Maillet, Les Éditions du Cerf, 2011, in : Francia 2013
39. "Lamartelière et Shakespeare", in : Lendemains, 2012.
40. "Il y a 62 ans Il y a 220 ans... Il y a…Anacharsis Cloots – Garry Davis", Lendemains, 2013.
41. Correspondance des loges St Charles de Mannheim et Royale Yorck de l'amitié de Berlin, Partie 1, in: Renaissances Traditionnelles, 2012 (Partie 2 2013)
42. "L'énigmatique marquis De La Tierce: vers un essai de bio-bibliographie", Cahiers d'histoire et de Recherche maçonnique, Paris, 2012.
43. "Rimbaud au désert ou quand l'idéal est inaccessible"..., Academia, 2013.
44. « Comment Bürgeln a résisté aux convoitises des nazis », La Brique, 2015, p. 32-35.
45. « Les cahiers au feu d’un ancien proviseur du Lycée franco-allemand de Fribourg », in : La Brique, 2015, p. 23-27.
46. « La lettre d’un franc-maçon de Joseph Uriot », Franc-Maçonnerie Magazine hors-série no 3, 2016, p.52-59.
47. « La véritable histoire du chevalier de Beauchaine et de la maçonnerie du bois », Franc-Maçonnerie Magazine hors-série no 3, 2017, p.60-67.
48. « Cette Allemagne où la pauvreté se cache », La Brique, no 37, 2016, p. 32-34.
49. « Beaumarchais et le Sundgauvien Lamartelière (1761-1830) ou Schiller et le renouveau du théâtre français. », in : Annuaire de la société d’histoire du Sundgau, 2016, p. 167-178.
50. « Cupidon en loge, Joseph Uriot et sa Lettre. », in : Chroniques d’Histoire maçonnique, 79, 2016-2017, p. 43-56.
51. « En hommage au poète décédé il y a 20 ans : Eugène Guillevic, le roc et les choses. », in : Annuaire de la société d’histoire du Sundgau, 2017, p. 209-218.
52. « L’éloge de la folie, version trilingue, publiée par Jean-Jacques Thurneisen avec Jean-Charles Laveaux pour traducteur de la version française. », in : Francia, 44, 2017, p. 339-348.
53. « Des cousins germains si particuliers », À propos du livre de Pascal Hughes Was ist das ?
In : La Brique, 2019, p. 38-41.
En collaboration:
1. Les écrivains et l'argent, sous la direction d'Olivier Larizza, Orizons Université, 2012.
2. Qu'est-ce qui arrive à la spiritualité, sous la direction de Marc Halévy, Laurence massaro éditeur, Paris, 2020.
3. Littérature bretonne de langue francaise, sous la direction de Pascal Rannou ( Matière de Bretagne, Légende du roi Arthur, Auguste Brizeux, Èmile Souvestre, Jules Verne, Paul Féval, Julien Gracq), Yoran Embanner, 2020.
Ouvrages de recherche littéraire
1. Le mythe et la politique : un an après la mort du Général de Gaulle, maîtrise, Rennes, 1973.
2. Le message maçonnique au XVIIIe siècle, thèse, Rennes, 1975.
3. Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière, un dramaturge sous la Révolution ou l’élaboration d’une référence schillérienne en France, Peter Lang, Berne, 1990.
4. Anacharsis Cloots, le Prussien francophile, Paris, l’Harmattan, 1999.
5. Les constitutions d’Anderson (1742), texte traduit par Louis-François de La Tierce, ouvrage collectif, Romillat, Paris, 2002.
6. La gazette littéraire de Berlin, 1764-1792, Champion, Paris, 2004.
7. Le message maçonnique au XVIIIe siècle, contribution à l’histoire des idées, Dervy, Paris, 2006.
8. Édition critique de «Le Livre fait par force, Presses de l’université de Saint-Étienne, Lire le 18e siècle, 2008.
9. Berlin, le Paris de l’Allemagne, Orizons universités, Paris, 2011.
10. Encyclopédie de la Bretagne, éditions Dumane, Rennes-Paris, 2015/2016
Articles : Alain Bouchart/Arthur/Bécassine/Bretagne qui gagne/Celtomanie et celtophilie/ D’Abélard à Astérix : stéréotypes/La Borderie/La franc-maçonnerie en Bretagne/ Les Lumières en Bretagne/ Armand Rebillon/ Armorique littéraire/ Auguste Brizeux/ Barthélémy Pocquet/ Jacques Cambry/ Charles Pinot Duclos/ Dom Deschamps/ Écrivains du XIXe siècle en Bretagne/ Émile Souvestre/ François Duine/ Fréron/ Guillotin de Corson/ Julien Gracq/ Ludovic Jan/La Mettrie/ La Vallée/ Loaisel de Tréogate/ Littératire latine de Bretagne/ La Tour d’Auvergne/Gournay/ Voltaire et la Bretagne/Yan d’Argent/ Mythe et politique sous les Plantagenêt/ Pezron de Lesconvel/ Maupertuis/ Plélo/ Pommereul/ Poullain de Saint-Foix/ Société patriotique Bretonne/ Université et celtisme/ Écrivaines bretonnes/ Romans d’aventures/ Paul Féval/ Lamennais/ Auguste Pavie/ Prosper Proux…
11.Correspondances maconniques 1777-1783, Honoré Champion, 2015.
12. Un aventurier littéraire, Jean-Charles Laveaux alias De La Veaux ou Thibault de Laveaux (1749-1827), Honoré Champion, Paris, 2015.
13. Les débuts de la franc-maconnerie en Bretagne, Centre d'Histoire de Bretagne, 2016.
14. Un Voyage littéraire en Bretagne, Ed. Fanch Babel, 2 volumes, 2019.
15. Bertrand Du Guesclin, le dogue noir de Brocéliande, Fanch Babel, 2019.
16. Le Marquis de Langle, un Neveu de Rameau Breton, Éditions Complicités, 2020.
Traductions publiées
1. Le Conte, traduction de Das Märchen de Goethe, Orizons cardinales, Paris, 2008.
2. Vie et œuvre de Nicolas Barrera (Nicolas Barrera, Leben und Werk par Inken Drodz), Crantz, Stuttgart, 2010.
3. En allemand : KZ, Camp de concentration, dessins de Nicolas Barrera, Weil, 2020.
Essais
1. Une vie de prof. L’Harmattan, 2008.
2. En finir avec cette Institution scolaire, Mon Petit Éditeur, 2013.
Ouvrages de littérature
1. Poétic 7 , no 68 consacré à F. Labbé, Illustrations
de Christiane Herth, Rezé/Nantes, 1987.
2. La soue, La part Commune, Rennes, 2006. Réédition complète 2019 chez Fanch Babel.
3. Une vie de prof, (pseudonyme : Fanch Babel), L’Harmattan, Paris, 2008.
4. Litanies, MPE, Paris, 2011.
5. Le cahier rouge, Orizons littératures, Paris, 2011.
6. Sous la surface des choses, MPE, 2012.
7. L'imbécile heureux, L'Harmattan, 2013.
8. Des morts et des châteaux, Do Bentzinger, Strasbourg, 2014.
9. Le disparu de Trégastel, L'Harmattan, 2014.
10. Un château en Forêt Noire, L'Harmattan, 2015.
11. Le Jardin désespéride, Fanch Babel, 2019
Principales collaborations à des Revues littéraires
« Fait divers », nouvelle, in : L’encrier, no. 8, Strasbourg, 1986, pp.68-73.
« Derniers instants », nouvelle, in : L’encrier, no. 8, Strasbourg, 1986, pp. 83-88.
« Colombine », nouvelle, in : L’encrier, no 10, 1987, pp. 14-20.
« Une vie de chien », nouvelle, in : L’encrier, no 13, Strasbourg, 1987.
« C’est la vie », nouvelle, in : Almanach des Dernières Nouvelles d’Alsace, 1997, p. 18.
« Ici », in : Revue Alsacienne de Littérature, no 52, 1995, p. 45.
« Redécouverte : Lamartelière-Schwingdenhammer », in : Revue Alsacienne de Littérature, no 52, 1995, pp. 73-74.
« Maison illusion », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 59, 1997, pp. 48-53.
« Elle, la vie », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 66, 1999, pp. 24-27.
« D’autres vies », poème, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 67, 1999, p. 21.
« In memoriam Gilbert Schilling », in : Revue Alsacienne de Littérature, no 71, 2000, p. 81-82.
« Vieillir », poème, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 73, 2001, p.72.
« Mode d’emploi », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 76, 2001, pp. 71-73.
« Je ne parlerai plus », poème, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 80, 2002, pp. 59-60.
« Le regard de Beethoven », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 82, 2003.
« Litanies de l’enfance » nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 86, 2004, p.23-27.
« Orphée », poème, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 90, 2005.
« Quand j’étais petit » nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 98, 2007.
« Fleurs d’oranger », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 102, 2008.
« Ma journée », poème, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 103, 2008.
« Quand j’étais petit 2 », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 105, 2009.
« D’Oberkirch à Musset en passant par Saint-Thomas », nouvelle, in : Revue Alsacienne de Littérature, no 107 et 108, 2009.
Articles publiés sur les sites de l’Harmattan.com :
1. A propos de la grève et des retraites
2. Garry Davis et Anacharsis Cloots
3. Querelle du français à Berlin en 1780-90
4. Question totale, pensée unique
5. Racine et Shakespeare
6. Calédonie 1
7. Calédonie 2
etc.
Sur Cagou.com :
1. Grèves 1 et 2
2. Bush aux sports d’hiver
3. Les cahiers au feu
4. On ne retient de la Révolution que les grandes figures nationales
5. La myopie, une vertu nationale
6. Éric Cantonna a raté son pénalty
7. L’histoire ne se répète pas, dit-on.
Ouvrages non (encore!) publiés
Palindrome ou l’égoïste, roman
Élise, roman
Hier, roman
Traduction de textes de Kurt Tucholsky
Traduction de Erwin Sylvanus Kozeck et les enfants
La Mort, drame
Recueil poétique , Peines
l'institution scolaire
Comme un lacet se défait, roman
Biographie et oeuvre de Maupertuis
Une longue digestion, roman.
Divers
« François Labbé en Allemagne », interview in : Armor, le magazine de la Bretagne, janvier 2010, pp. 53-57
Divers compte-rendus
Animation de l’émission « Ça conte pour vous », produite par Louis Périn sur Radio-Fessenhein (1989-90) : nouvelles enregistrées.
Plusieurs « fanzines » dont L’Échappée-Belle au lycée de Saint-Louis (plusieurs articles) et Synchronie.
Pièce radiophonique : Diderot, l’Encyclopédie et l’ordinateur (avec les élèves de 1ere S du lycée de Saint-Louis).
Conférences (Bretagne, Franc-maçonnerie, Cloots, Lamartelière...)
Film sur les énergies renouvelable et le gaspillage avec Christiane Herth (Lycée de Saint-Louis et le club Vidéo)…
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
En finir avec cette institution scolaire Au diable l'École ? "Les cahiers au feu et le maître au milieu !" Préface de Fanch Babel Mon
Refuser l'école ! Une aberration, un scandale pour la
plupart de nos concitoyens, nourris de l'idée reçue que
cette école, républicaine, est l'indispensable, l'inaliénable
garant de notre démocratie. On confond à plaisir, jusqu'à
en faire des synonymes l'école et l'éducation. On
encense une institution nécessairement dépendante d'un
milieu, d'une époque, d'une idéologie en l'assimilant à
une aspiration profondément humaine. On mélange de
même école et instruction, l'homme instruit étant celui
qui possède le savoir que l'on est censé acquérir au terme
du cursus scolaire fourni par une institution forcément
"au service de…". Suivant les époques : ânonner un peu
de latin, pénétrer les arcanes de la lectio et de la
disputatio, trousser une prosopopée à la manière de…ou
pondre une dissertation en trois parties, connaître des
bribes de l'étroit Parnasse des Classiques dûment
estampillé par l'ordre national, disposer de quelques
repères historiques périodiquement revus, régulièrement
falsifiés, posséder les bases de l'arithmétique voire de la
géométrie ou jongler avec l'étude des fonctions et des
ensembles, s'ouvrir aux technologies nouvelles, être
capable de déchiffrer une notice, de "programmer", de
lire un journal, de découvrir la rouerie des publicitaires…
En revanche, "refuser l'école" fait immanquablement
penser à cette parole de Wolfgang Borchert : "
Imaginons : c'est la guerre et personne n'y va…". En
7
effet, la guerre, la défense de la patrie, la haine de
l' "ennemi" font aussi partie de ces idées reçues. Lors
des mobilisations, ils sont rares ceux qui refusent, les
insoumis, et d'autant plus rares que la sanction est fatale.
L'attitude est quasiment la même que face à l'école : il
faut bien y aller, sinon ce serait la catastrophe ! Et on ne
veut pas faire l'effort de comprendre que la catastrophe,
c'est justement d' "y aller" ! Récemment, une amie un
peu dépressive me disait : "la société, c'est comme le
vélo. Quand on est dessus, faut bien pédaler, sinon on
tombe !". Peut-être que le cul par terre, à regarder filer le
peloton, on ne serait pas plus mal, ai-je pensé ! Il est des
"chutes", des ruptures, des changements d'orientation
salutaires…
Les mêmes remarques pourraient d'ailleurs être faites à
propos de la police ou de la prison. Ces institutions sont
fondamentalement semblables à ce qu'elles étaient au
cours des siècles. On a pu émettre l'opinion que la prison
représentait un progrès en ce sens qu'aux origines, le
délinquant ou l'ennemi capturé était purement et
simplement tué, puis qu'on substitua à ce châtiment
l'esclavage ou le bagne et qu'enfin l'emprisonnement
donne la possibilité à plus ou moins longue échéance
d'une deuxième chance, mais il est des constantes qui
sont tout de même troublantes : jadis, on oubliait
l'indésirable dans un cul de basse fosse et aujourd'hui il
disparaît dans une cellule d'un quartier de haute sécurité !
S'il y a eu progrès - un temps, peut-être - ce progrès
s'est bien vite figé comme une sauce froide !
*
Il est primordial d'établir une stricte différence entre
l'"Éducation", qui est une légitime aspiration de chacun
et l'"École" qui est une institution supposée faire entrer
8
dans les faits cette aspiration revue et corrigée par le
milieu et l'époque. En effet, si la première est éternelle au
royaume des idées et des désirs, la seconde, elle, est
lourde, attachée à la terre, tellement complexe qu'elle ne
peut guère évoluer, chargée du poids des ans, des
traditions, des clichés et des fausses raisons, inféodée,
aliénée à tel ou tel système idéologique et économique,
bonne si la société qui la génère est - si tant est que cela
soit possible - bonne, négative pour l'Individu plus
généralement. Elle a le poids et la souplesse du béton
quand l'aspiration à l'éducation possède la légèreté de la
plume ou, pour s'appuyer sur une fable, la véritable
éducation est ce jonc souple et indestructible tourné vers
le ciel tandis que l'institution scolaire est davantage ce
chêne en apparence vénérable et impressionnant mais
enraciné dans un sol qui mériterait des amendements. On
sait ce qu'il arrive par temps de tempête !
Il y a de cela plus de trente ans, Margaret Mead voyait
trois modèles éducationnels possibles et son analyse
paraît toujours aussi juste :
- l'éducation post figurative
- l'éducation cofigurative
- l'éducation pré figurative
Dans le premier cas, il s'agit globalement de reproduire
ce qui existait avant. La jeunesse est appelée à refaire la
geste de ses pères. La position des Anciens, pour
reprendre une image littéraire. Une école
"endogamique" en quelque sorte devant assurer le
renouvellement des "cadres", mais un renouvellement
quasiment à l'identique de la société existante, avec -
concession démocratique - quelques ouvertures
apparentes, fausses fenêtres pour la symétrie,
9
Dans le second cas, on cherche à faire coïncider cette
éducation avec les réalités du moment. Une sorte de no
man's land éducatif, d'entre-deux essentiellement
utilitaire. L'école est toujours le pilier des sociétés, mais
au service exclusif des systèmes économiques,
technologiques et idéologiques, façonnant les esclaves
dont ils ont besoin. L'école fonctionnant selon les critères
que son environnement lui impose plus ou moins
ouvertement.
Enfin, il existe une dernière voie qui conduirait à préparer
l'enfant à un monde nouveau, qu'il aura lui-même à
définir. Cette école rêvant d'un vrai renouveau, qui
s'esquisse dès la Renaissance, se précise avec le Droit à
l'école pour tous réclamé par exemple par Pestalozzi et
la revendication d'une école formatrice de l'individu en
soi, la poursuite de lendemains qui chanteront, quand
l'homme sera réconcilié avec lui-même.
Il est évident que cette troisième forme - la seule digne
de l'Homme - est aussi la moins pratiquée, la plus
exigeante, la plus réprouvée en raison de ses dangers
apparents. Si l'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas où
l'on va. Cette dernière voie, susceptible de répondre au
vrai désir d'éducation, est malheureusement le parent
pauvre qu'on ressort de temps en temps du placard aux
idées pour calmer les inquiétudes en donnant un
badigeon altruiste aux deux autres voies qui, elles, se
conjuguent parfaitement.
*
Cet essai est écrit contre l'École telle qu'elle est par
rapport à ce qu'elle devrait être : un instrument de
transmission de savoirs et de compétences sélectionnés
par l'idéologie et/ou le système économique ambiant et
10
un instrument de préparation, d'anticipation aux
développements envisagés par ce système, alors que sa
vocation est d'être plus que jamais un contre-pouvoir au
service de l'homme dans un monde où il n'a jamais été
aussi réifié.
*
Il ne faudra pas, dans ces quelques pages, chercher les
solutions-miracles à une situation aussi complexe que la
place de l'institution scolaire dans la société moderne.
Les réflexions qui suivent sont seulement l'expression
des sentiments d'un enseignant qui pense qu'enseigner
pourrait vouloir dire autre chose que ce à quoi le réduit la
grande machine de l'Éducation Nationale. Il ne s'agit pas
d'une étude en bonne et due forme, mais de libres propos
reposant sur quarante années d'enseignement, une longue
expérience à travers le privé et le public, les écoles
primaires, les collèges, les lycées, les IUT, les
Universités, les IUFM…. On pourra en regretter les
approximations, voire probablement certaines
inexactitudes, l'absence de vision originale, l'étroitesse
des points de vue… Il n'en reste pas moins qu'on a là un
témoignage et que dans une démocratie tous les
témoignages devraient avoir leur importance.
Cet essai n'est donc- son titre et l'allusion à la chanson
bien connue sont un indice - en réalité pas dirigé contre
l'École dans son essence ni même totalement contre cette
école réifiante que nous connaissons et supportons tous,
dont la nécessité peut paraître une fatalité à la majorité
dans un monde où l'égalité des chances est loin d'être un
fait. Il n'est pas non plus écrit contre une École qui, pour
une part seulement, préparerait à acquérir des
compétences professionnelles et à intégrer ensuite le
11
monde du travail. Chacun sait que ventre affamé n'a
point d'oreilles et qu'avant de parler de démocratie, de
liberté, d'éducation, de culture, il faut donner aux
personnes la possibilité de vivre honnêtement et
correctement. Même dans une société imparfaite. On
verra ensuite (à condition de ne pas oublier ni de faire
passer une situation d'urgence pour une vénérable
tradition !)…
En revanche, il est dirigé contre les mensonges et la
sclérose d'une institution qui, dans nos pays prétendus
développés, ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas se
réformer et tourne en rond, car entre les formes qu'elle
avait au milieu du XIXe siècle voire plus tôt encore et
celles qu'elle emprunte aujourd'hui, il n'y a pas,
globalement, de grandes différences alors que les
exigences imposées à l'individu ont changé, que la
société des pays industriels s'est, en apparence au moins,
totalement transformée, que les aspirations individuelles
sont paradoxalement de plus en plus fortes alors que
l'aliénation (les idéologies, les modes, la langue de bois,
le consumérisme, la télécommunication…) des individus
n'a jamais été aussi terrible.
Il doit certes exister une école de l'urgence, comme il
existe des médecins aux pieds nus, mais il ne peut s'agir
en tout état de cause que d'un état passager, transitoire.
Vers 1850, lorsque la malnutrition, l'absence d'hygiène,
les accidents du travail, le chômage, des salaires de
misère, le travail des enfants décimaient les populations,
il était urgent de donner à ce prolétariat, qui était déjà un
précariat, l'instruction qui lui serait nécessaire pour
s'adapter à la nouvelle réalité sociale qui naissait, à
l'industrie et au capitalisme triomphants, pour avoir au
moins "la tête hors de l'eau" voire pour résister à ce
12
nouveau monde voulu par les nantis et les sectateurs
aveugles du progrès technologique. Il était obligatoire,
existentiel que ces hommes et ces femmes qui avaient
quitté leurs campagnes puissent prendre pied dans un
univers où il fallait bien savoir lire et écrire, compter
pour survivre, accéder plus facilement à un emploi seul
garantie du pain quotidien ou prétendre à l'aléatoire
qualité de citoyen. La situation était celle que l'on
rencontre toujours sur les trois quarts de la planète, qu'on
parle de tiers-monde ou de pays en voie de
développement : l'école comme moyen d'adaptation à
une réalité nouvelle avec pour retombée éventuelle un
savoir qui idéalement servirait à échapper à l'aliénation
que le diptyque travail/consommation propulse avec elle.
Mais cela ne veut pas dire que cette école se ferme
définitivement à des ambitions plus hautes. Si elle doit se
mettre un temps au service des nécessités premières, si
elle assure les démarrages, elle ne doit pas oublier que sa
mission est de former des hommes au sens noble de
l'expression, c'est-à-dire d'aider à la naissance d'un
individu libre de toutes chaînes, capable d'assumer
pleinement sa liberté au sein d'une humanité pacifiée et
pacifique.
Or, malheureusement, l'école d'aujourd'hui est restée
prisonnière du passé, elle se considère encore et, hélas !
De plus en plus comme la pourvoyeuse en hommes du
système économique ambiant, que l'on parle de
communisme, de capitalisme ou de libéralisme. Les seuls
changements, si l'on peut utiliser ce terme, consistent
dans un ajustement erratique aux réalités économiques
ambiantes!
Il est tout de même remarquable de voir que depuis le
XVIe siècle au moins (une recherche sérieuse montrerait
13
certainement qu'il faut aller bien au-delà), les plus grands
esprits partagent le même sentiment : l'éducation doit
servir avant tout l'individu, le révéler à lui-même, lui
indiquer les voies de sa propre réalisation. Ce n'est
qu'ensuite, lorsqu'il est entièrement libre, que cet
individu peut s'adonner raisonnablement à l'édification
d'une société harmonieuse, respectueuse de chacun et de
tous, des hommes comme de la nature. Et pourtant,
malgré ces déclarations d'intention, la réalité impose tout
autre chose.
En France, on étudie les principes éducatifs de Rabelais,
on les revoit sous la plume de Montaigne ou celle de
certains maîtres de Port-Royal, on étudie L'Émile… et
puis on oublie ces trop belles idées, pressés par l'urgence
des réalités.
Croit-on !
Walter Borgius, Célestin Freinet, Margaret Mead, Ivan
Illich s'inscrivent en fait dans la droite ligne de ces
grands ancêtres, mais on leur accorde peu d'importance
même si, çà et là, des expériences sont menées…
On lit avec plaisir les colères d'Alphonse Daudet contre
l'école, celles de Jules Vallès, de Nizan…, mais on n'en
tire aucune leçon.
Comment cela peut-il être possible ? Quelle perversion
fait qu'à l'école justement, on demande à l'élève de rire
de Thubal Holopherne et d'écouter avec attention et
respect les conseils de Montaigne sur l'éducation, alors
que dans l'école même on n'a que faire de ces exigences
et que les Ponocrates sont forcément rares ?
C'est d'abord cette hypocrisie que les pages qui suivent
tentent de documenter.
14
Les cahiers au feu? Non ! bien sûr, mais recentrer
l'institution scolaire, lui redonner une âme, le sens des
vraies valeurs qui transcendent les paradis éphémères,
clinquants de la consommation et prennent enfin en
compte l'individu à la fois dans son unicité et dans son
rapport aux autres, qui accordent aux hommes et à
l'environnement le respect auquel ils ont droit, c'est tout
le propos de ce livre.
Fanch Babel
15
Introduction
À tout esprit qui partage des idées libertaires et qui fait de
l'autonomie de l'individu, de son épanouissement
personnel le bien suprême, l'école apparaît comme une
relique de la société bourgeoise autoritaire qui s'est
définitivement établie dans les pays occidentaux au XIXe
siècle. Au même titre que toutes les institutions mises
alors en place sous le masque de la démocratie (qui ne
sont d'ailleurs le plus souvent que la démarque trafiquée,
voire "perfectionnée" de ce qu'elles étaient au stade
historique précédent) par cette société qui prend le relais
des régimes aristocratico monarchistes eux-mêmes
aboutissement des régimes féodaux, l'école frappe par
son aspect obsolète. Un esprit raisonnable et objectif
dirait qu'elle n'est pas la seule dans ce cas et que toutes
les autres institutions sont du "même tonneau" : la
prison, la police, l'armée, la justice… C'est justement ce
qui rend important une réflexion de fond vers cette
"vache sacrée" qu'est l'école, car refuser les raisons qui
servent à la justifier ne va beaucoup plus loin que la
critique d'une institution particulière : c'est la remise en
cause globale d'une société, d'une forme de vie, d'une
culture, d'un mode d'être au monde qui est en
perspective.
Cette école, qui, dans son excellence présumée, n'est
cependant qu'un discours, un tissu de mots, cette école,
16
objectivement, sert bien peu au développement de la
personnalité individuelle ou sociale de l'individu et,
quand on a l'impression qu'elle y parvient, c'est parce
que l'aliénation qui en résulte a été tellement bien
intériorisée que sa victime ne se rend plus compte qu'elle
est devenue une marionnette, un simple écho, la voix de
son maître. Les drames propres à l'école : la course aux
bonnes notes, l'angoisse des résultats, le sentiment de
l'échec ou l'obligation de faire mieux ou au moins aussi
bien que l'autre, aussi vite, avec autant de passion
apparente, l'ennui des heures perdues, ce corps
condamné à rester cloué sur une chaise, l'obligation
continuelle de faire semblant…, tout autant que les
éternelles querelles pédagogiques à propos des contenus
d'enseignement, des méthodes d'approche pour
apprendre sans coup férir son bonheur à l'élève, des
ambitions didactiques avec des démarches empruntées à
la tactique militaire parfois enrobées d'un excipient
ludique…, tous ces "drames" donc témoignent bien peu
de ce but supérieur même si on répète sans cesse vouloir
placer l'enfant au centre du système scolaire (ce qui ne
devrait être qu'une tautologie et non un "projet"),
rendre l'individu à lui-même, l'aider à se définir et à
développer ses qualités potentielles, intégrer et
comprendre le monde qui l'entoure, s'y insérer en restant
autonome.
En revanche, la nécessité de parvenir à une société
"déscolarisée" comme l'écrivait Illich, paraît s'imposer,
mais déscolarisée, en référence à une institution scolaire
symbole des autres institutions, une déscolarisation qui
serait alors une grande révolution culturelle. Parvenir à
une société des libertés et des individus libres pour enfin
mettre en accord les paroles d'une institution se
17
réclamant du bien de l'enfant et la réalité des faits dans
laquelle la hiérarchie est toute puissante où, "d'en
haut", on décide de ce qui est bon pour "l'élève", où
l'on remplace le développement de la curiosité naturelle
par un gavage de "paquets de savoir" prédéfinis,
normés, standardisés, aseptisés, par l'apprentissage de
comportements qui préfigurent ceux d'une société de la
compétition et de la consommation au lieu de soutenir le
désir et l'énergie du savoir, d'accompagner les
expériences sociales et individuelles.
Ce qui étonne, c'est qu'à de rares exceptions, l'École
n'est presque jamais remise fondamentalement en
question dans son existence même, dans ses fondements.
Les critiques lancées à son encontre sont le plus souvent
l'expression d'un ressentiment personnel contre des
déviations qui ne remettent pas en cause son essence. Le
tabou est total : l'école, comme la prison, la police ou
l'armée peuvent être critiquées sur tel ou tel point, mais
on ne peut toucher à leur principe. L'École fait partie du
paradis des vérités éternelles, ces dogmes imposés une
fois pour toutes et que les meilleurs esprits ont
intériorisés.
Alphonse Daudet ou Jules Renard, Flaubert ont réglé
leurs comptes avec elle sans toucher à ses fondements, à
la justification de son existence : ils dénoncent par
l'anecdote les mauvais maîtres, une discipline inadaptée,
une pédagogie inexistante, des locaux tristes, au pire une
entreprise de dépersonnalisation. Ils en font un
délassement littéraire.
Seuls peut-être, Jules Vallès au XIXe siècle et Paul Nizan
au XXe siècle exprimeront des critiques assez radicales
face à une institution qui trahit les attentes que l'on
pourrait placer en elle, mais la fameuse trilogie du
18
premier, après avoir été longtemps "mise en touche" est
désormais étiquetée ouvrage de littérature et les écrits du
second n'ont jamais été très populaires, rejetés dans
l'oubli par les oeuvres célèbres d'autres normaliens assez
fiers, eux, de leurs parcours scolaires et universitaires. La
société n'aime pas celui qui "crache dans la soupe" ou,
moins vulgairement : "malheur à celui par qui le
scandale arrive" ou risquerait d'arriver.
Il est cependant un fait accepté par tous : l'école, le
système scolaire n'est pas parfait. La conséquence
s'impose : il faut travailler à le rendre meilleur ! Les
ministres, les inspecteurs généraux, les inspecteurs
d'académie, les inspecteurs régionaux, les associations de
parents d'élèves, les coordinations de lycéens, les IUFM,
les pédagogues, les didacticiens, les auteurs, les éditeurs,
unissent apparemment leurs efforts pour réformer,
améliorer, transformer cette école presque aussi vieille
que l'histoire. Faisons leur confiance pour faire du neuf
avec du vieux !
En revanche, dire "non" à l'École apparaît comme un
scandale, voire le scandale, car cette institution est
généralement présentée comme le fer de lance des
démocraties et du progrès!
Bien sûr, on connaît quelques illuminés qui se sont
attaqués à cette imprenable redoute, les anarchistes
parfois, Paul Robin, Peter Kropotkine, Francisco Ferrer,
André Colomer ou Walther Borgius par exemple. On peut
les laisser crier tant qu'ils veulent, l'école telle qu'elle est
tellement entrée dans les moeurs que personne ne sera
tenté par ce chant des sirènes. Inutile de s'attacher au mât
ou de se boucher les oreilles avec des boulettes de cire,
plus de deux mille ans d'habitude, d'hébétude et le
19
consensus est quasiment total sur l'école. Les
psychologues parlent parfois d' "identification avec
l'agresseur" pour évoquer cette attitude qui fait que la
victime peut prendre fait et cause pour ce qui l'opprime,
refusant de voir plus loin que le bout de son voile ou de
sa salle de classe, une myopie, une cécité induite,
inaltérable, quasiment définitive.
Un certain nombre d' "évidences" appartiennent ainsi à
notre séjour carcéral librement - en apparence - accepté :
l'inégalité sociale, la liberté invariablement limitée, le
travail-qui-permet-à-l'homme-de-se-réaliser, la
méritocratie laïque, l'argent, la consommation (du
festival "off" d'Avignon aux trois paquets de nouilles
pour le prix d'un, du dernier best-seller de Houellebecq à
l'IPad de Apple), le PIB, la gauche et la droite, la
démocratie représentative, la crise-qui-exige-dessacrifices…
On peut en discuter, bien entendu, puisque
nous sommes en démocratie, mais la marge de manoeuvre
est étroite, les cadres semblent définitivement tracés.
En fait, la grande question qui se pose est de savoir si
l'homme doit être considéré comme sujet ou comme
objet, encore que cette formulation ne manque ni
d'ambiguïté ni de saveur puisque, en jouant sur les mots,
le "sujet" est bel et bien l'objet d'un pouvoir qui
s'impose à lui ! Pas d'échappatoire !
Si l'on s'en tient à la définition grammaticale de ces
termes, cela revient à dire : l'homme est-il considéré
comme un être autonome, capable de décider de ses
choix ou de ses désirs, créatif, actif, "existentialiste" à
l'intérieur d'une société, ou est-il un simple élément de
cette société, une brique qui doit s'insérer dans le mur de
la demeure sociale, essentiellement manipulable,
malléable, au-service-de… ? La société est-elle une
20
espèce de zoo ou de ménagerie dans laquelle on inflige
un traitement aux pensionnaires qui, tout en donnant
l'impression de conserver au plus près la nature, n'en
dévie pas moins de cette nature ? C'est la question
fondamentale qui se pose à l'École. Son devoir est-il de
proroger, de prolonger, voire d'éterniser un système dans
lequel l'individu n'est qu'un rouage ou bien doit-elle
chercher, en dehors de ces cadres, de nouvelles voies
permettant à l'individu de se réaliser ? L'école a-t-elle
pour vocation de presser des générations de jeunes dans
un moule préexistant et qui n'a guère évolué dans ses
grands traits, structurellement depuis des siècles ou bien
doit-elle chercher à faire éclater ces cadres pour ouvrir à
l'individu la terra incognita de la liberté ?
Croire en l'École est ainsi une sorte de profession de foi
voire d'acte de foi. Les esprits les plus frondeurs sont, à
son égard, étonnamment conformistes. On veut bien
réformer, modifier, adapter, mais fondamentalement elle
reste la même : un bâtiment à part, des classes, des
professionnels (fonctionnaires ou assimilés) de
l'éducation, un rapport, certes variable, mais un rapport
enseignants/enseignés qui perdure avec plus ou moins de
fortune, des programmes choisis par des adultes
respectueux des injonctions de l'État et des exigences du
monde de l'économie…, alors qu'il faudrait tout
repenser, faire table rase de ce qui existe puisqu'une
innovation véritable ne pourra sans doute se faire qu'en
dehors de ce cadre aliénant.
Il est évident que la déscolarisation de la société ne
pourra s'envisager tant que les fondements tabouisés de
la civilisation actuelle ne seront pas démasqués ou
dépassés : la foi en une société de la compétition, en une
21
productivité toujours accrue, en une consommation seule
source du bonheur, en une fuite en avant vers toujours
plus, en une sacralisation du travail ou plutôt de l'activité
rémunérée, en un veau d'or aux avatars nombreux, en
l'aveuglement des pays riches, qui ont basé leur mode de
vie exorbitant sur l'exploitation des pays pauvres et le
pillage des ressources. Décider de ne pas se résoudre à
abandonner l'individu à être un simple producteur /
consommateur, exploité / exploiteur, mais vouloir
s'engager dans le long processus de sa réévaluation, celle
de son essence et de ses acquis par opposition aux
dogmes et traditions, aux exigences d'un système aveugle
dont la finalité humaine a disparu et qui n'a plus pour but
que de produire plus pour vendre plus, toujours plus, un
système qui échappe en fait à tout contrôle et se
développe en toute autonomie sous le couvert illusoire
des États, qui, dans le fond, n'en peuvent mais… Cette
déscolarisation est en fait le symbole, le point d'ancrage
d'une désaliénation dans le sens de formes de vie et de
cultures libertaires et vraiment démocratiques dans
lesquelles l'accent serait mis sur le développement
harmonieux de chacun plutôt que sur la pérennisation
d'une école destinée à former des clones que l'on
persuade par divers tours de passe-passe qu'ils ont pu
développer leur vraie personnalité.
Cet essai n'ambitionne pas d'apporter des réponses aux
questions qu'il soulève. Il part de l'expérience de vie
d'un enseignant qui s'est toujours interrogé sur son rôle,
qui a cru longtemps pouvoir concourir à faire évoluer
l'institution scolaire de l'intérieur et qui croit savoir
aujourd'hui qu'il n'y a pas de demi-mesure, pas de
réformette possible en matière d'École, qu'il faut la
22
refonder entièrement. Les bons sentiments, les efforts
personnels ne suffisent pas et ne servent trop souvent que
d'alibis commodes.
Puissent ces quelques réflexions aider à prendre
conscience.
23
I. Les cahiers au feu et le maître dans le
milieu ?
24
25
Il paraît évident que l'enfant a besoin d'une éducation et cela
au moins pour deux raisons : il possède en lui des facultés
latentes, des virtualités qui ne demandent qu'à être développées
et il naît au sein d'une communauté, dans un monde dont
l'existence est réglée par un certain nombre de déterminations
qu'il devra connaître ne serait-ce que pour s'en affranchir, s'il
le souhaite plus tard. Seul, abandonné à lui-même, il
parviendrait peut-être à survivre, mais la nature nous montre
que tout être vivant passe obligatoirement par une phase
d'apprentissage au cours de laquelle l'exemple d'un individu
formé, adulte est essentiel dans la transmission des savoirs.
Cette vérité première soulève toutefois d'emblée des questions.
Si l'animal est amené à répéter ce que des générations
d'individus de son espèce ont appris, s'il n'y a pas de progrès
ou des progrès très lents dans l'apprentissage, progrès qui sont
plutôt des adaptations à de nouvelles données
environnementales par exemple, si les différences entre
individus sont relativement peu importantes, le cas est
totalement autre quand il s'agit de l'homme. Le petit enfant
possède une personnalité, une individualité, des capacités qui
en font un être unique même s'il doit intégrer un jour une
communauté dans laquelle il devra probablement rogner sur ses
particularités, mais "rogner" le moins possible ! Il ne faudrait
pas que l'éducation devienne simple conditionnement ni que
les éducateurs soient essentiellement les chiens de garde d'un
système, d'une idéologie ou d'une morale. Qui seront-ils donc,
ces éducateurs ? Au nom de quels principes agiront-ils ? De qui
dépendront-ils ? De quel droit useront-ils ? Cette éducation
doit-elle passer par l'école telle que nous la connaissons ?
Avant de tenter de répondre à ces questions, relisons le mythe
26
platonicien de la caverne.
Platon et sa caverne
Maintenant représente-toi comme il suit l'état de notre
nature du point de vue de l'instruction et l'ignorance.
Imagine des hommes dans une demeure souterraine, en
forme de caverne, disposant sur toute sa largeur d'une
entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont là depuis
leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte
qu'ils ne peuvent ni bouger ni regarder ailleurs que
devant eux la chaîne les empêchant de tourner la tête;
la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur,
au loin derrière eux; entre le feu et les prisonniers
passe une route élevée. Cette route est longée par un
petit mur, pareil à ces cloisons que les marionnettistes
disposent devant eux et au-dessus desquelles ils font
voir leurs merveilles.
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des
hommes portant des objets de toutes sortes, qui
dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et
d'animaux, en pierre, en bois et en toutes sortes de
matières. Tout naturellement parmi ces porteurs
certains parlent et d'autres se taisent.
Voilà bien, s'écria Glaucon, un étrange tableau et
d'étranges prisonniers.
Ils nous ressemblent; et d'abord, songe que, dans une
telle situation, ils n'ont jamais vu autre chose d'euxmêmes
et de leurs voisins que les ombres projetées par
27
le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face.
Et comment, observa Glaucon, puisqu'ils sont forcés de
rester la tête immobile durant toute leur vie !
Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de
même ?
Sans contredit.
Si donc ils pouvaient discuter, ne penses-tu pas qu'ils
prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils
verraient ?
Absolument.
Et si la paroi du fond de la prison renvoyait un écho
chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croiraientils
entendre autre chose que l'ombre qui passerait
devant eux ?
Non, par Zeus !
De tels hommes n'attribueront certainement de réalité
qu'aux ombres des objets fabriqués. Considère
maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les
libère de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur
ignorance. Qu'on délivre l'un de ces prisonniers, qu'on
le force à se redresser immédiatement, à tourner la tête,
à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en faisant
tous ces mouvements, il souffrira et l'éblouissement
l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure
il percevait les ombres. Que crois-tu donc qu'il
rétorquera si quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu
jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent,
28
plus près de la réalité et tourné vers des objets plus
réels, il voit plus juste ? Si, enfin, en lui montrant
chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de
questions, à dire ce que c'est ? Ne penses-tu pas qu'il
sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à
l'heure continueront à lui paraître plus vraies que les
objets qu'on lui montre maintenant ? Et si on le force à
regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils
pas blessés? N'en fuira-t-il pas la vue pour se
retourner vers les choses qu'il peut regarder, et ne
croira-t-il pas que ces dernières sont vraiment plus
distinctes que celles qu'on lui montre ?
Assurément !
Et si on l'arrache de sa caverne, qu'on le force à
gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le libère
pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil,
ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas
de ces violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la
lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat,
distinguer une seule des choses que maintenant nous
appelons vraies ?
Il ne le pourra pas, du moins dès l'abord.
Il aura, je pense, besoin d'habitude pour distinguer les
objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les
ombres qu'il percevra le plus facilement, puis les
images des hommes et des autres objets qui se reflètent
dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après
cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la
lune, contempler plus facilement pendant la nuit les
corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour le
29
soleil et sa lumière. À la fin je l'imagine, ce sera le
soleil - non ses vaines images réfléchies dans les eaux
ou en quelque autre endroit - mais le soleil lui-même à
sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il
est.
Nécessairement !
Après cela, il en viendra à conclure à propos du soleil,
que c'est lui qui fait les saisons et les années, lui qui
gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une
certaine manière est la cause de tout ce qu'il voyait
avec ses compagnons dans la caverne. Or donc, se
souvenant de sa première demeure, de la sagesse que
l'on y professe, et de ceux qui furent ses compagnons
de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du
changement et plaindra ces derniers ?
Si, certes.
Et s'ils se décernaient entre eux louanges et honneurs,
s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait
de l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se
rappelait le mieux celles qui avaient coutume de
paraître les premières ou les dernières, ou d'avancer
ensemble, et qui par-là était le plus habile à deviner
leur apparition, penses-tu que notre homme fût jaloux
de ces distinctions, et qu'il portât envie à ceux qui,
parmi les prisonniers, sont honorés et puissants? Ou
bien comme ce héros d'Homère, ne préféra-t-il pas
mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un
pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que
de revenir à ses anciennes illusions de vivre comme il
vivait ?
30
Je suis de ton avis, dit Glaucon, il préférera tout
souffrir plutôt que de vivre de cette façon- là.
Imagine encore que cet homme redescende dans la
caverne et aille reprendre son ancienne place : n'aurat-
il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant
brusquement du plein soleil? Et s'il lui faut entrer de
nouveau en compétition, pour juger ces ombres, avec
les prisonniers qui n'ont point quitté leurs chaînes,
dans le moment où sa vue est encore confuse et avant
que ses yeux ne se soient à nouveau habitués
(l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps
assez long), ne prêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et
les autres ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en
est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est
vraiment pas la peine d'essayer d'y monter? Et si
quelqu'un tente de les délier et de les conduire là-haut,
et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le
tueront-ils pas ?
Sans aucun doute.
Maintenant, mon cher Glaucon, il faut appliquer point
par point cette image à ce que nous avons dit au début,
comparer le monde que nous découvre la vue au séjour
de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire, à la
puissance du soleil. Quant à la montée dans la région
supérieure et à la contemplation de ses objets, si tu la
considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu
intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée,
puisque aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si
elle est vraie. En ce qui me concerne, voilà mon
opinion : dans le monde intelligible, l'idée du bien est
perçue la dernière et difficilement, mais on ne peut la
31
percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce
qu'il y a de droit et de beau en toutes choses; qu'elle a,
dans le monde visible, engendré la lumière et le
souverain de la lumière; que dans le monde intelligible,
c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité
et l'intelligence; et qu'il faut la voir pour se conduire
avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique.
Je partage ton opinion, autant que je le puis.
Eh bien ! Partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne
pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne
veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que
leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut.
Mais quoi, penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme
qui passe des contemplations divines aux misérables
choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à
fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et
n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres
environnantes, il est obligé d'entrer en dispute, devant
les tribunaux ou ailleurs, à propos des ombres de
justice ou des images qui projettent ces ombres, et de
combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui
n'ont jamais vu la justice elle-même...
À propos de ce mythe
Le mythe de la caverne est une allégorie destinée à
illustrer la situation des hommes par rapport à la vraie
lumière, c'est-à-dire par rapport à la Vérité.
Mais la fable de Platon est, comme disent les linguistes,
éminemment polysémique. C'est une caverne qui tient un
32
peu de l'auberge espagnole, chacun y apporte ce qu'il
veut, ce dont il sait avoir besoin ; chacun en fait son bien
et l'interprète à sa façon. En extrapolant les intentions du
philosophe grec, le plus couramment, on dit que cette
caverne représente l'univers social et culturel dans lequel
nous sommes plongés dès la naissance. Nos habitudes,
nos systèmes de pensée, nos relations sociales, notre
culture, toutes ces ombres en peuplent l'obscurité
abyssale et la caverne devient le lieu de toutes les
dictatures, de tous les sur-moi, visibles et invisibles.
C'est ce que tout élève de philo apprend et comprend
généralement.
L' "éclaireur", le philosophe, celui qui sait, se déclinera
alors, suivant les époques en une infinité de personnages
qui tous - du prêtre au dictateur - indiqueront aux foules
innocentes, médusées et angoissées la voie suprême, celle
qui mène à cette vraie lumière, celle qui permet
d'échapper aux ténèbres, à l'aliénation.
D'une aliénation l'autre, nous apprend d'ailleurs
l'Histoire !
Le bon père Prévost effaré de voir que les lecteurs de son
Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
(deux "écoliers" !) avaient négligé le message
moralisateur qu'il avait probablement voulu propager
(mais en était-il lui-même dupe ?) fit précéder les
rééditions de son histoire à succès d'une préface
explicative, dogmatique, didactique, accompagnée d'une
gravure soulignant l'évidence de la leçon. En effet, au
centre de celle-ci un vieillard barbu indique d'un doigt
impératif à un jeune homme effondré les nuées d'où
émerge, nimbée de rayons lumineux, une croix plantée
33
dans le coin supérieur droit de l'image tandis que, au
fond d'une caverne sombre, en bas et à gauche, se
morfond une jeune fille en pleurs. On ne pouvait être plus
explicite puisque l'image venait doubler la préface. Dans
un geste impliquant une lecture diagonale gauche-droit,
bas-haut de la gravure (avec toute la symbolique attachée
à ces directions), le barbu philosophe montre ainsi au
pécheur qu'il vient d'extirper de la caverne du stupre la
vraie lumière, celle née un jour sur les flancs du
Golgotha : abandonne, mon fils, les plaisirs incertains du
séjour chthonien pour la gloire éternelle des beautés
supérieures !
Les lecteurs pourtant ne s'en laissèrent pas compter et
continuèrent à donner le nom de l'héroïne sulfureuse à
leur cher roman, à le plébisciter, n'éprouvant au mieux
qu'une tiède pitié pour le malheureux chevalier revenu en
fin d'aventures sur ses erreurs de jeunesse. Je passe sur
les continuations que la foule des aficionados réclama,
car la mort de Manon ne pouvait satisfaire et il suffisait
d'un trait de plume pour lui redonner vie…
Un exemple anecdotique de ces mentors qui essayent de
vendre leur lumière aux aveugles des cavernes et ce qu'il
s'ensuit parfois, heureusement…
Du philosophe à l'enseignant
Un autre de ces mentors est l'enseignant, et le chemin qui
mène à la "vraie lumière" est pavé des bonnes
34
intentions de l'institution scolaire. D'ailleurs, la première
phrase de l'allégorie platonicienne est claire à ce sujet :
Maintenant représente-toi de la façon suivante l'état de
notre nature du point de vue de l'instruction et de
l'ignorance.
L'Instruction et
l'Ignorance.
La caverne dans l'obscurité et ses habitants condamnés à
croire à la réalité des vaines ombres projetées sur le mur
qui leur fait face, c'est l'humanité sans instruction et dans
cette ignorance qu'il faut combattre. Quand on a dit cela,
on n'est guère avancé, car tous ces mots manquent de
définitions précises.
Toutefois, ce mythe de la caverne ressemble assez à un
mythe d'origine qui serait alors celui de l'enseignant. Ce
dernier a pour métier de guider vers les lumières du
savoir, d'éduquer. Éduquer, ex ducare, conduire vers,
hors de… Mais hors de quoi ? Hors de l'ignorance (et
alors, qu'est-ce que l'ignorance ?) ? Hors de la caverne ?
Hors de soi ? Et conduire vers où ? Vers quoi ? Pour
quoi ? Pourquoi ?
Platon, bien entendu, répond à toutes ces questions :
l'homme vit dans un monde d'apparences sans grand
intérêt et il doit faire l'effort de s'élever vers les vérités
tangibles et éternelles. Il lui faut détacher son regard des
pâles imitations qui l'entourent pour tenter d'apercevoir
les vrais modèles et, au-delà de ces modèles, le créateur !
On comprend au passage pourquoi Platon était en odeur
de sainteté chez les chrétiens et qu'il n'a pas fallu
attendre la Contre-réforme catholique pour qu'un
néoplatonisme plus ou moins diffus imprègne la doctrine
35
chrétienne ! La vraie vie est ailleurs, l'eschatologie
chrétienne rejoint un platonisme à peine revisité.
L'École d'Athènes de Raphaël peut d'ailleurs passer pour
une sorte de figuration emblématique servant de pendant
illustré à ce mythe de la caverne. Entourés de tous les
mentors de l'Antiquité (et des temps modernes puisque le
peintre, dans sa représentation, n'aurait pas oublié
Copernic), Aristote montre d'un geste large la terre, le
séjour terrestre tandis que Platon lève le doigt vers les
cieux, le lieu des vérités éternelles, l'arrière-monde des
Idées, la transcendance du réel, et, tout autour, les grands
philosophes s'affairent à accroître le savoir humain.
Deux domaines, le ciel et la terre.
Le premier prône la raison et l'empirisme, le second en
appelle à des lumières sans doute plus essentielles et
moins immédiatement utiles. L'École rapproche, unit
Aristote et Platon, comme l'Église et ses Pères le firent,
Thomas et Augustin en particulier, au grand dam des
hérétiques de tout poil faisant pencher la balance vers
l'un ou l'autre des deux philosophes.
La fresque de Raphaël représente une école, l'école du
genre humain, une école rassemblant les meilleurs esprits
et affirmant qu'il ne faut rien privilégier, ni l'idéalisme ni
le rationalisme.
Le maître aujourd'hui y aurait-il sa place et quelle place ?
Toujours est-il que, lui aussi, se croit investi de la mission
de mener à la lumière. Mais quelle lumière ? Est-il
aristotélicien ? Est-il platonicien ? Est-il capable
d'effectuer la synthèse ? N'est-il pas tout simplement
l'instrument d'un système qui le dépasse ?
"Voulez-vous prendre une idée de l'éducation publique,
36
lisez la République de Platon. Ce n'est point un ouvrage
de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent des
livres que par leurs titres : c'est le plus beau traité
d'éducation jamais fait", écrivait J.-J. Rousseau dans son
Émile ou de l'éducation. Et il est vrai que le Platon
originel donne de belles idées de l'éducation, mais les
leçons d'Aristote sont tout aussi solides et lui au moins
ne fait pas du poète un interdit de séjour !
Éduquer, éduquer ? Vous
avez dit "éduquer"?
Restons-en aux mots. Educare, ex ducare, en latin,
erziehen, er-ziehen en allemand…, les exemples
pourraient être multipliés et se ramènent tous et partout à
la même expérience : éduquer, c'est conduire hors de soi,
tirer vers ailleurs.
C'est aussi forcément "arracher". Éduquer ne se fait pas
sans une certaine violence. Pas de formation sans
déformation ! Il y a quelques décennies, quand un
individu encore jeune semblait quitter le "bon chemin",
on l'enfermait dans une "maison de redressement" !
Chez les Padaungs, en Birmanie, lorsqu'une petite fille a
entre cinq et neuf ans, on lui passe sur le cou une
pommade et on pose le premier anneau d'un collier qui
fera d'elle au cours des années une femme-girafe, une
"Karen au long cou". Elle sera alors apte à se marier.
Son éducation de femme et son intégration dans le
groupe se payent d'une terrible déformation aux
conséquences effroyables. De tels exemples de
modifications physiques sont monnaie courante dans les
diverses civilisations et illustrent de façon choquante
37
d'autres formations/déformations moins sensibles, celles
qui sont la conséquence de l'éducation.
Ajoutons tout de même que l'éducation des femmesgirafes
heurte certes le sens commun et que cette
violence ainsi affichée, ne touchant que le sexe féminin,
est aussi inacceptable que l'excision mutilant quantité
d'adolescentes et marquant à jamais la vie des femmes
dans de nombreux pays. Cependant, si l'on reprend
l'exemple des Padaungs, on sait qu'il y a encore peu de
temps, il était quasiment impossible de rencontrer ces
femmes dont certaines, dès la puberté, portent déjà la
totalité des anneaux. Les régions que ces populations
habitent étaient réputées dangereuses et inaccessibles.
Cette coutume barbare se vivait donc en vase clos. Il y
avait, certes, mutilation mais en quelque sorte par erreur,
sans le vouloir, parce qu'une tradition vicieuse s'était
établie et transmise de génération en génération avec
l'oubli de ses causes probables (on a évoqué la nécessité
de protéger le cou des attaques d'animaux sauvages par
exemple…). Un rite donc en apparence nécessaire pour
affirmer l'appartenance au groupe voire sa cohésion dans
un milieu souvent hostile.
Depuis au moins l'Humanisme de la Renaissance et les
premières Lumières - Rabelais, Érasme, Pascal, Bayle,
Leibniz, Locke ou Fontenelle - nous savons en Europe
qu'autorité et tradition sont de bien mauvais maîtres. Les
Padaungs se moquent de nos références poussiéreuses,
mais on peut penser qu'un certain progrès des idées, une
réflexion sur les tenants et aboutissants, une prise de
conscience allant dans le sens des droits de l'homme fera
ou aurait fait avancer les choses. Mais voilà, alertés par
les chromos publiés par des revues prestigieuses sur
papier glacé, des touristes sont attirés par ces femmes
38
girafes comme jadis on se pressait dans les foires pour
regarder les monstres - Hugo et son Homme qui rit en
ont donné le roman terrible pour le XIXe siècle.
Alors, certains Birmans, plus évolués (?) ont enlevé des
femmes et des jeunes filles et les exposent désormais
dans leurs villages, accessibles, eux, aux voyageurs en
mal d'exotisme. Réduites à l'état de bêtes de zoo,
exposées dans des baraques, ces femmes souvent
prostituées font la fortune des souteneurs et la joie
malsaine de touristes avides d'expériences limites. On a
même "exporté" certaines de ces pauvres existences
sous prétexte de leur venir en aide dans des villages-zoos
en Thaïlande ! Ne nous récrions pas trop, nous, Français :
il y a moins de quatre-vingts ans, la France exposait ses
"sauvages" ses "Canaques" (le mot n'avait pas encore
le sens qu'il possède désormais) lors de la dernière
exposition coloniale (1931) ! Cannibale de Didier
Daenincks en a fourni une illustration bouleversante !
Si l'on tire la leçon de cette anecdote, on peut dire qu'une
éducation - vicieuse en soi mais considérée dans son
milieu comme indiscutable - est détournée à des fins
encore plus ignobles. La femme-girafe ne subit plus son
martyre pour appartenir de plein droit à une communauté,
mais pour devenir l'objet d'une curiosité malsaine, du
lucre et de perversions occidentales. Elle est
définitivement enlevée à soi, réifiée, rayée de l'humanité.
A l'origine, la déformation imposée à la femme-girafe
fait partie de ces rites qui maintiennent la cohésion du
groupe, cohésion essentielle en milieu hostile et ce
groupe est plus important que l'individu, qui seul ne
pourrait survivre. Sans justifier ces pratiques, on peut les
comprendre. Aujourd'hui, la situation est autre et le
39
maintien de cette tradition sans excuses : le groupe n'est
plus exposé aux mêmes dangers que jadis et
l'exploitation de ces femmes (tourisme, prostitution) est
une perversion, une hypocrisie inacceptable.
Cet exemple nous rappelle que l'enfant est
essentiellement malléable. Il a certes besoin de recevoir
une culture qui fera de lui un être complet et lui permettra
d'intégrer une communauté, de s'intégrer ensuite à une
civilisation, mais il possède aussi des qualités
personnelles qui ne doivent pas disparaître. Ce serait
peut-être même là le passage de la culture à la
civilisation.
En effet, la culture, qu'on peut définir comme l'identité
d'une communauté, est constituée par l'ensemble des
règles, conventions, croyances, traditions et réflexes qui
établissent une relation conviviale et utilitaire entre les
membres de cette communauté. C'est enfin le point de
départ des droits et des obligations. Elle n'est pas innée et
est également liée à l'autorité. Elle possède aussi un
aspect "cultuel".
La civilisation, pour sa part, peut être considérée comme
l'affinement de formes culturelles par l'apport des
sciences et des techniques, de toutes les conquêtes faites
dans un sens humano centriste. La civilisation se
rapporte au "cives" par opposition au "sauvage", à la
libération des contraintes naturelles et à la préservation
de la sphère personnelle, ce qui veut dire que l'individu
ne doit évidemment pas devenir l'otage d'un nouveau
maître, l'économie ou l'idéologie, passer des obligations
du clan à une autre forme de dépossession de soi. Il
devrait au contraire profiter personnellement de cette
évolution.
40
Tout cela passe évidemment par une éducation, par cet
"arrachement" auquel je faisais plus haut allusion. Le
film de François Truffaut, L'enfant sauvage, a mis en
images de façon magistrale, à partir du témoignage
émouvant du docteur Jean Itard combien, sans cette
éducation l'homme était inachevé et combien celle-ci
devait avoir lieu tôt, dès la naissance. Cependant, on ne le
dira jamais mieux que Rabelais, Montaigne ou
Rousseau : l'éducation doit se faire au bénéfice de
l'enfant et de l'homme qu'il deviendra.
C'est là tout le problème : que signifie "au bénéfice de
l'enfant puis de l'homme" ? Y a-t-il un développement
intrinsèque à garantir, une personnalité à enrichir ou bien
l'individu doit-il avant tout être intégré à la société qui
l'entoure, au système dans lequel il est né ? Dans le
premier cas, ne risque-t-on pas de privilégier une
hypothétique nature de l'individu et de négliger ce qui
paraît essentiel, la culture et la civilisation ? Dans l'autre,
le danger de réifier, de condamner l'homme à être la
fourmi de la fourmilière, la femme-girafe. Le choix est-il
seulement entre l'individualisme forcené et un
totalitarisme écrasant ? Certainement pas et c'est là le
principal problème que soulève une éducation bien
pensée. On pourrait imaginer une nouvelle École
d'Athènes façon XVIIIe siècle (Paris est d'ailleurs alors
souvent qualifiée de l'Athènes nouvelle) unissant Jean-
Jacques et Denis, le premier, un volume de ses Rêveries
serré contre sa poitrine, montrant son coeur du doigt et le
second, l'Encyclopédie à ses pieds et indiquant d'un
geste large la foule des hommes. Le nécessaire
individualisme de l'auteur des Confessions (mais aussi du
Contrat Social !) et la non moins nécessaire
41
"convivialité" chère au père de l'Encyclopédie (mais
aussi des lettres à Sophie Volland !). Karl Marx affirmait
ainsi - contrairement à ce que la praxis communiste a le
plus souvent montré - que le développement harmonieux
de chaque individu conditionnait le développement
harmonieux du groupe !
L'enfant a certes besoin d'acquérir une culture et
d'intégrer une civilisation, mais il n'est pas une tablette
de cire vierge. Biologiquement, psychologiquement, il
possède un certain nombre de déterminations, de
"talents", de "particularités", une "nature", qui
l'individualisent et qui ne doivent ni disparaître ni être
contraints.
Instruire et Éduquer
Instruire c'est transmettre des connaissances. C'est la première
définition qui vient à l'esprit.
Instruire peut être aussi le fait de remplir un formulaire vide ou de
préparer un procès. On reçoit encore des instructions - des ordres
- de son supérieur et l'évêque diligente son instruction pastorale
auprès de ses diocésains. Tous ces sens ont quelque chose en
commun : l'idée de "remplir", de "mettre en état de…", de
conduire un procès ou son existence, de combler un vide dans son
savoir, de rectifier un jugement… Mais le juge d'instruction n'est
pas un pédagogue et le prélat non plus ! Si l'on s'en tient à cette
définition de la transmission des connaissances, celle-ci peut vite
prendre l'allure d'un gavage autoritaire, d'une mise au pas, d'un
dressage. Il n'y a guère de temps encore, un individu mal éduqué
était quelqu'un qui n'avait aucune politesse, qui ne possédait par
les clefs du sésame social, qui ne savait pas se comporter et qui se
situait en marge. Il échappait ainsi à ce "dressage" de la majorité
qu'on appelait les bonnes manières. Une telle transmission
entachée d'autoritarisme et dont la finalité est l'intégration à une
communauté rappelle le fameux "hors de l'Église point de salut".
D'ailleurs on doit se demander si le savoir peut réellement se
transmettre au sens propre de ce verbe. Les lecteurs du Banquet se
souviennent de l'ironie de Platon à ce propos quand Agathon
42
demande à Socrate de venir s'asseoir auprès de lui afin que cette
proximité permette la communication de la science du philosophe,
par capillarité en quelque sorte. "Il serait à souhaiter, dira Socrate
en s'asseyant, que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d'un
homme qui en est plein dans un homme qui en est vide par l'effet
du contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du
morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide".
Ce n'est hélas ! ou heureusement ! jamais le cas et il n'existe pas
de transmission passive, mais plus exactement un accaparement,
une "prise en soi" par ce que l'autre propose.
Instruire, étymologiquement, c'est "équiper", c'est donc
permettre à un individu d'acquérir l' "équipement" qui le rendra
autonome, c'est-à-dire donner les moyens à quelqu'un de
construire ses connaissances en se construisant lui-même. Toujours
ce conseil de Montaigne au pédagogue : ne pas marcher devant
mais derrière. Ni gavage, ni réification.
Connaître, c'est arriver au stade de la co-naissance : ce qui est
hors-moi me pénètre et par innutrition devient présence en moi,
mais une présence fictive sous la forme d'un double mental
résultant de mes perceptions ou/et de mes réflexions. Connaître,
c'est faire naître en soi et avec soi la forme intelligible de ce qui
est hors moi. Ce que le maître a pensé ne sera pas, ne doit pas être
semblable à ce qui naîtra dans l'esprit de l'élève et la forme qui
naîtra dans l'esprit de chaque élève sera aussi différente. Dans tous
les cas différente mais ressemblante pour une part. Pas de clonage
en matière d'éducation mais une richesse de nuances, la richesse
de la diversité dans la ressemblance. Pour bien comprendre cela, il
faudrait établir une distinction entre le concept objectif, si tant est
qu'il existe (l'idée d'arbre, de soleil, de mer) et le concept
"personnel", le résultat de cette innutrition ou maturation plus
haut évoquée. Ces deux concepts se recouvrent en grande partie
mais les marges existent et c'est dans les marges que se situent les
différences, la diversité, les nuances et la richesse des points de
vue. L'apprenant respecté est un apprenant actif, pas une machine à
digérer ce qu'on lui impose et instruire vraiment ce n'est ni
transmettre "son" savoir en espérant le retrouver dans l'esprit de
l'autre ni modeler une intelligence dans une perspective préétablie.
Rien de bien nouveau dans ces truismes : les pédants de jadis
distinguaient la lectio (la parole du maître) de la disputatio (la
43
critique active de l'élève, l'accaparement qu'il faisait de cette
parole). Le vrai savoir n'existe que si l'on pense par soi-même,
sans autisme bien entendu et l'on a besoin du maître mais
d'un "maître" qui ne se conduise pas en potentat. Il n'est encore
que de relire Platon pour s'en convaincre : le dialogue est le moyen
privilégié de parvenir à ce vrai savoir, mais un dialogue entre deux
partenaires : le maître qui n'impose rien et que respecte l'élève et
cet élève, respecté par le maître, qui veut assimiler la parole de ce
dernier, la faire sienne. Sa maïeutique est avant tout l'art
d'accoucher les esprits des vérités qui sont au fond d'eux-mêmes !
Toute éducation qui s'y refuse est indigne et ne correspond qu'au
gavage dénoncé plus haut. À la place du respect règne le mépris ou
l'indifférence.
De même, on peut ajouter qu'il n'existe pas de savoir vrai sans un
effort personnel, effort pour comprendre ce qui est à connaître,
mais effort aussi pour aller plus loin en impliquant sa propre
intelligence et en renonçant au confort de la routine et des
préjugés ! Et cela est aussi vrai pour le maître que pour l'élève. Si
instruire c'est en quelque manière désaliéner les individus, non pas
en leur donnant une liberté clé en main, mais en leur offrant la
possibilité de la construire et de la remettre sans cesse en question,
il est clair qu'une des premières missions est de lutter contre ces
"préjugés qui tiennent chaud", contre les a priori, les jugements
hâtifs et confortables, l'autorité et la tradition, ce prêt-à-porter de
la pensée. Mais Fontenelle, bien après beaucoup d'autres, nous l'a
spirituellement seriné. C'était il y a plus de trois siècles et tous les
élèves de France sont depuis censés étudier la fable de la Dent
d'Or, sans en tirer, malheureusement le plus souvent, une leçon de
vie !
Éduquer est un verbe que l'on confond de plus en plus souvent
avec instruire. On débat d'ailleurs régulièrement du rôle des
professeurs : doivent-ils instruire ou éduquer ? Quelle est la
priorité s'ils se sentent responsables dans les deux domaines ?
Récemment, un enseignant retraité confiait aux auditeurs sur une
chaîne publique que, jusque dans les années 80, il s'était surtout
senti dispensateur de l'instruction, mais qu'ensuite il s'était de plus
en plus vu dans le rôle d'un éducateur… Les populations ont
changé, les temps aussi, concluait-il.
Éduquer vient d'educatio, un verbe qui désignait à l'origine
l'élevage animal. On retrouve l'idée de gavage et de dressage,
44
mais l'homme, contrairement à l'animal n'a pas un instinct qui le
ferait se satisfaire de l'engraissage qu'il subit et de l'apprentissage
qu'on lui impose. Il a une raison, puissance latente qui ne demande
qu'à être activée et qui ne peut se contenter du confort des réflexes
culturels inculqués, réflexes conditionnés qui ont le seul avantage
d'intégrer socialement l'individu, de l'intégrer au "troupeau"
national ou tribal ou religieux, mais dont le gros désavantage est de
lui faire en même temps perdre toute autonomie, tout libre arbitre.
La cité humaine confondue avec la termitière ! Il faut rendre vive
cette raison et quel moyen sinon l'éducation. C'est ce que Kant
préconisait après bien d'autres et en même temps que Pestalozzi
par exemple ! Kant considérait qu'après une période assez brève
de conditionnement nécessaire - ce qu'il appelait la discipline -
devant permettre à l'homme de se révéler dans l'être vivant qu'il
est, il fallait passer à un stade proposant à sa liberté les valeurs qui
rendront la vie humaine, digne. Éduquer ne serait rien moins que
de conduire sans arrachement, progressivement de la nature à la
liberté, de réussir la synthèse de "lui" et de "moi". Ceci bien sûr
sans chercher à remplacer les déterminations naturelles (égoïsme,
avidité, instinct de soi…) par des surdéterminations sociales ou
idéologiques, une sorte de sur-moi qui étoufferait dans l'oeuf ces
déterminations naturelles.
Éduquer donc ! La vie entière est éducation, c'est-à-dire
généralement éloignement d'une nature propre, mais
jugée insuffisante ou plutôt une suite de prises de
distance, d'accommodements, une accumulation
d'adaptations plus ou moins nécessaires, une résultante
aux composantes multiples...
Ces adaptations sont polymorphes et s'effectuent au gré
des rencontres et des événements, une série
ininterrompue de ricochets, de renvois, d'échos, chacun
influant d'ailleurs sur le suivant sans qu'il soit sans doute
jamais possible de repasser par "la case départ", de
revenir aux sources. Tout cela ressemblerait assez à la
45
façon dont se structure un cerveau. Une grande partie du
cortex cérébral est dédiée à la communication. Une
particularité du petit d'homme est qu'il va très vite
acquérir le langage. Parallèlement, son cerveau sera
modifié par ses expériences et par l'acquisition même de
ce langage qui, pour faire simple, lie un mot à une
perception, à un concept. Les gènes (naguère on aurait dit
"la nature" et il y a plus longtemps encore "la
Nature") ont pourvu le cerveau de structures qui vont
faciliter cet apprentissage, mais, en termes de neurones,
des connexions vont se faire, et d'autres se défaire.
En conséquence, une grande partie des neurones va
cesser toute activité voire mourir afin de laisser le champ
libre à ceux d'entre eux qui sont les plus efficaces.
L'expérience acquise joue alors un rôle essentiel dans le
remodelage du cerveau en opérant cette sélection des
circuits neuronaux les plus performants.
Le processus d'éducation est assez semblable : de
composante en composante, d'interdit en injonctions, de
suppressions en ajouts se crée un nouvel être qui n'est
plus ni tout à fait lui-même ni tout à fait un autre, plus
apte à s'intégrer dans le milieu où il vit. Il ne faudrait pas
que cette éducation le métamorphose, fasse disparaître les
potentialités qu'il avait en lui. Le cerveau évolue mais
conserve sa substance fondamentale ; l'individu éduqué
ne doit pas être purement et simplement coupé de luimême.
Tous les choix, les orientations, les formations imposés
dépendent du milieu, de l'époque, de la "civilisation"
pour reprendre les catégories de Taine ne vont pas sans
mauvaise foi ni regrets et ils laissent derrière eux un
sentiment d'incomplétude voire d'absence ou de manque,
si justement l'éducation n'accorde pas une place
46
essentielle à ce que l'auteur des Origines de la France
contemporaine appelait la "faculté maîtresse", le
tempérament !
Quelque chose m'échappe constamment dans ces
attitudes qui s'imposent et qui m'en imposent, qu'on
m'impose. Entre l'enfant jouant avec ses crayons de
couleurs et l'adulte en costume trois-pièces, il y a à
l'évidence solution de continuité, spécialisation, abandon
de l'ensemble des facultés potentielles pour une sélection
utile, mais utile à qui ? A l'individu ? A la société ? Au
système économique ambiant ? Qu'a-t-on fait de la
"faculté maîtresse" ?
Il arrive un moment où la question se pose devant
l'écheveau des parcours et des attitudes, des admirations
et des renoncements, des affirmations et des négations :
Qui suis-je donc ? A quoi bon tout cela ?
Une évidence : je suis fait.
Fait par les autres, les parents, les maîtres, tout ce qu'on
m'inculque directement ou indirectement.
Je suis fait. Un homme fait. Je suis "fait" avec toute
l'ambiguïté de l'expression ! "Je suis fait" signifie aussi
dans le langage courant "on m'a eu", "je me suis fait
flouer" !
Peut-être faudrait-il écrire tout simplement : "Je suis
refait" !
Tension insupportable.
Besoin d'authenticité.
Conscience que toutes les attitudes n'ont été que des
réponses circonstancielles et apparemment pragmatiques.
Or ces attitudes forment un ensemble hétéroclite de
47
facettes qui rarement harmonisent ensemble.
Sous l'écheveau des attitudes l'individu souffre et déteste
un jour le manteau d'Arlequin dont on l'affuble et qui
risque fort de ressembler à la tunique de Nessus.
Sartre donnait comme définition de l'existentialisme :
"Faire quelque chose de ce qu'on a fait de soi".
L'intention, le conseil est excellent et éminemment
réaliste, mais seulement possible s'il demeure en moi un
"je" majeur, une troisième instance, entre "moi" et
"eux", capable de faire la synthèse. Et ce serait sans
doute la finalité d'une éducation bien pensée que de faire
surgir cette troisième instance capable d'unir
harmonieusement le "vieux" fond et l'apport
culturel/civilisatoriel, les potentialités natives et les
contraintes du milieu et de l'époque où l'on naît,
l' "éternel", l'en-soi et le contingent ?
Une des tartes à la crème de l'enseignement des lettres
est depuis des années l'autobiographie. On lit et on relit
Philippe Lejeune et ses épigones, on commente, on
distingue le journal, la biographie, les mémoires. On
cherche les raisons, les justifications… On ne s'interroge
cependant pas assez sur les causes profondes de ce goût
(très habilement induit d'ailleurs : il faudrait aussi
démêler la part du "marketing") qui fait que l'homme
éprouve le besoin de se pencher sur son passé et ce
depuis une époque relativement récente, qui correspond
au moment même où prend naissance cette période de
l'histoire qu'on appelle les temps modernes. A
l'évidence, cet individu engoncé dans les contraintes
d'une société qui l'aliène de plus en plus cherche
48
seulement à reconstituer une personnalité qu'il croit
écrasée, disparue. Son Graal, aussi légendaire sans doute
que l'objet de la quête de Perceval, mais tout aussi
nécessaire pour remédier à la "gaste terre" des
quotidiennetés.
En quête des fragments d'un moi riche et ouvert, libre,
l'individu formaté, simplifié, réifié des sociétés
contemporaines, le diariste malheureux répond de temps
en temps à la nostalgie du paradis perdu.
Comme on peut le penser, ce paradis perdu d'une nature
glorieuse ne serait que rêve, que mythe et les temps
d'Astrée appartiennent à la poésie ou à la religion, mais
sa nostalgie indique au moins que la situation actuelle est
insatisfaisante et qu'on a - par pragmatisme, par une
conscience trop aiguë de l'importance de la réussite
sociale et des besoins matériels - dérivé vers une
conception étriquée de l'existence humaine.
La seule question véritable - et qui reprend toutes les
autres - est donc de savoir quelle éducation est digne de
l'Homme et quelle école il lui faut, quels maîtres.
Rechercher l'harmonie en soi et hors de soi.
Commençons par un paradoxe.
Partout l'école est présentée comme l'institution
démocratique par excellence. C'est l'école qui permet à
chacun, quelle que soit son origine, de profiter de
l'ascenseur social, de devenir un acteur (important) du
49
monde dans lequel il va évoluer. Tous ceux de ma
génération et leurs parents ont lu ces merveilleuses
histoires d'enfants très méritants mais pauvres et qui,
grâce à la Communale et à la clairvoyance de
l'instituteur, sont devenus généraux, hommes politiques
ou savants, faisant profiter de leur génie le pays, voire
l'humanité.
C'est par l'école que l'enfant échapperait au non savoir, à
l'ignorance crasse, à la "caverne", c'est par elle qu'il
apprendrait à utiliser ses facultés, c'est par elle qu'il se
socialiserait, acquerrait l'esprit critique et pourrait
prétendre jouir sinon d'une liberté totale, au moins d'une
autonomie qui s'en rapproche.
Scolariser les enfants est ainsi la première tâche à
laquelle doivent se livrer les gouvernements quand ils
sont démocratiques. Quand on se lance dans les
comparaisons entre les pays, dans les statistiques
permettant de juger du progrès des nations, à côté du
PIB, le taux de scolarisation est considéré comme un
indicateur de première importance. Dans les sociétés
dites avancées, c'est le nombre de bacheliers ou celui de
bac +3, 4 ou 5…
Ajoutons que l'école permettrait enfin l'accès à la culture
et que cette culture est supposée enrichir la vie puisque la
sensibilité aiguisée, l'intelligence accrue, le panel des
plaisirs possibles s'augmentera sensiblement, comme les
professeurs s'efforcent de le seriner et de le faire dire à
leurs élèves dans les copies de dissertation dont le sujet
tourne autour des sempiternels clichés nature et culture.
Un peu comme ces "nez" qui en parfumerie par un
travail constant parviennent à mémoriser plus de 200
fragrances alors que le commun des mortels s'en tient
plus ou moins à une douzaine, l'école élargirait les
50
horizons, développerait les potentialités, agrandirait le
registre des compétences et des jouissances. L'oeil ne
serait plus éteint par l'habitude du seul nécessaire,
émoussé par le quotidien étroit ; grâce à l'école et à la
culture distillée, il acquerrait une acuité vraiment
admirable. Voltaire et son Mondain ont laissé plus que
des traces !
L'homme cultivé devient ainsi créatif, et dans cet acte de
création, il est à l'image du dieu des religions !
La culture littéraire par exemple n'est sans doute pas
vitale. "Je hais les livres ; ils n'apprennent qu'à parler de
ce qu'on ne sait pas", écrivait Rousseau !
Chacun en convient. Robinson ("Heureux traité de
l'éducation naturelle", selon Jean-Jacques) sur son île a
d'autres chats à fouetter. Il se contente de la lecture
quotidienne de sa Bible, le livre qui le relie tout de même
à son ancienne vie, le livre de tous les temps et de tous
les lieux !
Cependant, dira le professeur de lettres (pardon !
aujourd'hui on parle en toute simplicité de professeur de
français), posséder une culture littéraire ouvre aux
bonheurs incestueux de l'intertextualité, aux délices
proustiennes des pastiches et mélanges, à la mise en
perspective de toutes ses lectures passées, aux frissons de
la rencontre avec un auteur, à la sublimation de sa propre
condition et à l'enrichissement (l'amendement) de ses
goûts et sensations…, bien qu'en réalité les morceaux
choisis de Lagarde et Michard et consorts, leurs
commentaires donnent de la littérature une vision bien
insipide.
Pareillement, le professeur de biologie rappellera que sa
science introduit aux secrets de la vie, démythifie,
simplifie, explique et fait s'effacer les peurs ancestrales,
51
disparaître les angoisses séculaires, s'évanouir les
croyances infondées, les superstitions affolantes…, ce qui
n'empêche pas les Créationnistes de reprendre du poil de
la bête !
L'histoire et la géographie agissent dans le même sens
d'un supplément d'existence ; savoirs "situationnels",
ils fixent notre assiette diachroniquement et
synchroniquement, permettant de comprendre le monde,
l'instant dans lequel on vit, d'avoir des perspectives,
d'ouvrir les horizons tout en se refusant à tout
dogmatisme, à tout esprit de système en relativisant tous
les savoirs, toutes les cultures, toutes les époques.
L'avenir est gros du passé et les commémorations dont on
parle tant nous rappellent les aléas de notre devenir …,
mais l'histoire qu'on racontait à l'ouest du mur de Berlin
et celle qu'on prêchait à l'Est ne se ressemblaient guère !
Les beaux-arts nous initient aux joies de l'esthétique ;
nous sommes convaincus que le beau, le to kalon sur
lequel ironisait le patriarche de Ferney, se décline de
toutes les façons possibles et que loin de s'en formaliser
ou de s'en étonner, il faut s'en réjouir : Qu'est-ce que le
beau pour un crapaud ? C'est évidemment sa crapaude !
Nous, les hommes, nous pouvons aller plus loin,
imaginer nos crapaudes !
Les mathématiques nous apprennent la rigueur,
l'abstraction, le raisonnement et annoncent le passage de
la théorie à la pratique sans lesquels il n'est pas de
progrès possible. La physique, la chimie…, mais il est
inutile de multiplier les exemples.
Soyons donc créatifs, inventifs, savants, laissons parler
cette part de notre être à laquelle la vie laisserait trop peu
la chance de s'exprimer s'il n'y avait l'École…
52
Le bien-fondé des enseignements est - en théorie -
indiscutable. Ceux qui leur dénient l'évidence d'un
surplus d'existence, d'un supplément d'âme, feraient
preuve de mauvaise foi, disent les inconditionnels de
l'École.
Pourtant, cette École, c'est aussi et surtout ce lieu où l'on
apprend ce qui est d'abord utile à une société, les
bénéfices pour l'individu paraissant plutôt faire partie des
retombées collatérales, en quelque sorte, un peu comme
dans un autre domaine la "Révolution verte" a été
propagée d'abord pour permettre aux industries de guerre
de se reconvertir dans l'agrochimie et de continuer à
engranger des bénéfices gigantesques ; les éventuelles
avancées sur le plan de l'amélioration des conditions de
vie des populations du Tiers-Monde n'étant que le leurre
lancé au public, des avancées de toute façon limitées dans
le temps et qui se sont payées par des dépendances totales
et catastrophiques pour l'avenir du monde.
L'enseignement en latin s'est d'abord fait parce que de
telles études soudaient une classe sociale et parce que le
latin était la langue de l'Église, le premier soutien des
gouvernements monarchiques et bourgeois. Une
association à bénéfices réciproques que dénonceront
certains humanistes puis les philosophes des Lumières
comme Diderot, l'abbé Raynal ou Anacharsis Cloots et
que fera éclater pour un temps trop bref la revendication
du doublement du Tiers-État lors des États Généraux, une
collusion que ne cesseront également de mettre en
lumière les penseurs socialistes ou communistes du siècle
suivant.
Lorsque la IIIe République décide - après quelques
atermoiements - de généraliser ce que la bourgeoisie des
53
fabricants et manufacturiers réclamait pour une large part
depuis longtemps, l'école obligatoire et gratuite, c'était
moins pour satisfaire aux désirs déjà anciens d'un
Condorcet, d'un Léonard Bourdon voire d'un Lakanal
que pour répondre à la demande d'une société dont les
structures économiques sont en pleine évolution.
Quand Jules Ferry créera les écoles d'arts et métiers, il ne
le fera pas parce qu'il désire ardemment que les enfants
des couches populaires obtiennent un niveau d'études
enrichissant leur existence, même pas pour leur permettre
d'accéder à tous les postes et dignités possibles et
imaginables, mais, selon ses propres paroles devant les
députés, pour fournir à l'industrie nouvelle les petits
chefs dont elle a besoin : "des sous-officiers pour
l'armée du travail"
Ainsi, le 3 mai 1883, le ministre de l'Instruction
publique vint à Vierzon poser la première pierre de
l'école primaire supérieure et professionnelle, un type
d'enseignement qu'il venait aussi de créer.
À cette occasion, il prononce un discours dont il n'est pas
inutile de citer certains passages, mais auparavant nous
rapporterons quelques paroles du.président de
l'Assemblée Nationale, Henri Brisson, ayant ouvert à
l'occasion de cette inauguration l'offensive des
"homélies" !
Après avoir rappelé tous les efforts consentis en faveur
d'une école primaire supérieure et professionnelle, qui
"serait admirablement placée à Vierzon", et rappelé
l'injustice qu'il y avait à laisser 150 000 à 200 000 jeunes
poursuivre leurs études "jusqu'à 20 ans, 22 ans, 24
ans", tandis que pour les autres, 4 à 5 millions, "la
tutelle nationale cessait à 12 ou 13 ans", il concluait en
citant l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de
54
l'esprit humain (10e époque), de Condorcet :
"On peut instruire la masse entière d'un peuple de tout
ce que chaque homme a besoin de savoir pour
l'économie domestique, pour l'administration de ses
affaires, pour le libre développement de son industrie et
de ses facultés ; pour connaître ses droits, les défendre et
les exercer ; pour être instruit de ses devoirs, pour
pouvoir les bien remplir ; pour juger ses actions et celles
des autres, d'après ses propres lumières, et n'être étranger
à aucun des sentiments élevés ou délicats qui honorent la
nature humaine… Dès lors, les habitants d'un même pays
n'étant plus distingués entre eux par l'usage d'une langue
plus grossière ou plus raffinée ; pouvant également se
gouverner par leurs propres lumières ; n'étant plus bornés
à la connaissance machinale des procédés d'un art et de
la routine d'une profession ; ne dépendant plus, ni pour
les moindres affaires, ni pour se procurer la moindre
instruction, d'hommes habiles qui les gouvernent par un
ascendant nécessaire, il doit en résulter une égalité réelle,
puisque la différence des lumières ou des talents ne peut
plus élever une barrière entre des hommes à qui leurs
sentiments, leurs idées, leur langage, permettent de
s'entendre ; dont les uns peuvent avoir le désir d'être
instruits par les autres, mais n'ont pas besoin d'être
conduits par eux ; peuvent vouloir confier aux plus
éclairés le soin de les gouverner, mais non être forcés de
le leur abandonner avec une aveugle confiance".
À ce préambule philosophique, humaniste, démocratique
ancré dans les principes de la Révolution de l'an II, la
cerise avant le gâteau, le ministre répondit avec plus de
pragmatisme et sans se soucier d'une cohérence
quelconque avec le discours de son collègue en
55
politique :
"Nous voulons essayer ici, de réaliser dans de vastes
proportions une idée que la première République a
poursuivie et caressée, qu'elle a formulée avec une
précision étonnante, et qui s'est retrouvée dans l'esprit
public toutes les fois que la démocratie a fait un pas en
avant, aussi bien après la révolution de 1830 qu'après la
révolution de 1848.
Cette pensée mère, cette préoccupation qui remonte déjà
à près d'un siècle dans notre pays, et qui voit aujourd'hui
la réalité s'ouvrir devant elle, l'idée qu'il faudrait pouvoir
graver sur le fronton de cet édifice, c'est que l'École
nationale, dans une démocratie de travailleurs comme la
nôtre, doit être essentiellement l'école du travail.
Oui, Messieurs, c'est à ce point de vue que nous avons
révolutionné l'école, nous avons commencé cette
transformation bienfaisante, et, si l'avenir nous est
donné, elle ne périclitera pas entre nos mains.
La visée suprême, le but final, la mission sociale de
l'école moderne, c'est l'éducation de cette démocratie
ouvrière qui n'est pas seulement la majorité du nombre,
mais dont les vertus laborieuses font la force du pays De
là le caractère professionnel de notre éducation primaire,
telle que les nouveaux programmes la constituent.
Je le dis bien haut, et je signale ce fait considérable aux
travailleurs qui m'écoutent, et auxquels on ne se lasse pas
de répéter que notre politique est, pour ce qui les
concerne, stérile ou indifférente, l'école primaire
d'aujourd'hui, celle que nous avons organisée d'après
l'idéal entrevu par la Révolution française, cette petite
école est, dès la première heure, professionnelle, c'est-àdire
qu'elle a pour but de préparer l'enfant à devenir,
56
comme l'immense majorité des citoyens français, un
travailleur.
Qu'est-ce que c'est, en effet, Messieurs, que ces
méthodes nouvelles que vous voyez appliquer dans
l'école ? Qu'est-ce que c'est que ces leçons de choses,
que ces musées scolaires dans lesquels l'industrie du
maître ou des élèves s'étudie à rassembler les différents
produits, soit du sol, soit les métiers locaux ? Qu'est-ce
que c'est que tout cela, sinon le commencement, la
première forme de l'enseignement professionnel, la
préparation élémentaire à la vie pratique, à la vie
laborieuse qui donne à chacun dans cette France le droit
de porter le front haut et de s'appeler citoyen ?
(…)
Ainsi se passent les années de l'école primaire, messieurs
; mais, quand l'enseignement primaire a parcouru ce
premier cercle un vide singulier et inquiétant s'ouvre
sous les pas de l'adolescent : plus d'école, plus rien entre
la douzième ou la treizième année et le commencement
de l'apprentissage.
C'est ce vide que nous voulons combler par l'école
professionnelle, et c'est un type d'école professionnelle
de cet ordre que nous voulons instituer ici ; je tiens à en
bien définir le caractère, à en limiter avec précision
l'étendue et la portée. Nous ne voulons pas créer à
Vierzon une école professionnelle qui double ou qui
copie les écoles d'arts et métiers de Chalons, d'Aix,
d'Angers. Non ; ces écoles ont un but déterminé : elles se
proposent de former des contremaîtres, des sous-officiers
pour l'armée du travail ; ici, nous voulons préparer des
soldats pour cette armée.
Ingénieurs, conducteurs de travaux, dessinateurs,
contremaîtres, ce sont les cadres du travail et de
57
l'industrie française. Ce n'est pas de cela que nous nous
préoccupons ici ; c'est de la grande masse ouvrière ellemême
; c'est le travailleur que nous voulons élever ; c'est
à lui que nous voulons donner une éducation pratique et
intellectuelle qui le rendra supérieur à sa tâche
journalière, et qui, loin de l'en dégoûter et de l'en
distraire, le rattachera à elle par un lien plus intime et
plus profond.
(…)
Ennoblir le travail manuel, messieurs, nous le voulons
aussi ; ce voeu, nous l'avons inscrit en grandes lettres
dans nos programmes. Le programme d'enseignement
moral et civique, arrêté par le conseil supérieur de
l'Instruction publique, porte un article ainsi conçu :
"Noblesse du travail manuel". Et pour que la noblesse du
travail manuel soit reconnue, non seulement de ceux qui
l'exercent, mais de la société tout entière, on a pris le
moyen le plus sûr, le seul pratique : on a placé le travail
manuel dans l'école même ! Croyez-le bien, lorsque le
rabot et la lime auront pris, à côté du compas, de la carte
géographique et du livre d'histoire, la même place, la
place d'honneur, et qu'ils seront l'objet d'un
enseignement raisonné et systématique, bien des préjugés
disparaîtront, bien des oppositions de castes
s'évanouiront, la paix sociale se préparera sur les bancs
de l'école primaire, et la concorde éclairera de son jour
radieux l'avenir de la société française.
Messieurs, l'enseignement professionnel qui sera donné
ici aura pour caractère distinctif de ne point constituer un
enseignement spécial pour une industrie quelconque : il
sera professionnel sans spécialité ; il distribuera les
principes généraux sur lesquels reposent toutes les
industries ; il associera, par exemple, les notions qui
58
président à l'industrie du fer à celles qui dirigent
l'industrie du bois. Pendant les trois ans que les jeunes
élèves de Vierzon passeront à l'école professionnelle,
entre la douzième et la seizième année, ils deviendront
sans peine - l'expérience en est faite, les programmes
arrêtés, le temps d'études fixé dès à présent -, ils
deviendront experts dans ces deux branches
fondamentales du travail manuel, le travail du fer et le
travail du bois. Et quelle sera la conséquence de cette
éducation professionnelle générale, qui ne lui donnera
pas encore un métier, mais qui le rendra capable
d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux celui
qu'il lui plaira de choisir ?
Cette conséquence est double : d'abord, il est évident que
la durée de l'apprentissage lui-même sera singulièrement
réduite, ce qui est un avantage considérable, et, en second
lieu, pendant ces trois ans d'études, l'enfant aura le temps
de faire ce qu'il ne peut pas aujourd'hui, de choisir
librement et en connaissance de cause la carrière qui lui
convient, de déterminer sa vocation. Enfin, il sera armé
contre ce danger de la spécialité mécanique, de la
division du travail à l'infini, qui est une des nécessités du
progrès industriel moderne, mais qu'il est de la sagesse
humaine, de la sagesse du gouvernement, des éducateurs
du peuple, de prévenir et d'atténuer dans ses mauvais
effets ; il pourra donc lutter contre une spécialité
tyrannique, il pourra, au besoin, changer de métier, et il
ne sera pas nécessairement attaché à l'industrie du fer,
puisqu'il sera aussi bien préparé à celle du bois.
Voilà, Messieurs, ce que je tenais à dire ici du caractère
distinctif et du but pratique de la nouvelle école. Je
n'hésite pas à déclarer que c'est une des oeuvres les plus
populaires et les plus démocratiques que l'on puisse
59
tenter en ce temps-ci - et j'ajoute que c'est une oeuvre
éminemment nationale. L'enseignement professionnel tel
que nous le voulons, nous parviendrons à l'organiser, car
nous sommes merveilleusement secondés par le
mouvement de l'esprit public. Il y a à ce sujet des chiffres
magnifiques que je veux vous signaler en passant :
l'enseignement professionnel s'est déjà associé à
l'enseignement primaire supérieur en plus d'un lieu, sur
une moindre échelle, avec un moindre luxe que dans
notre école de Vierzon ; on peut le tenir pour formé,
constitué et sérieusement établi dans 400 villages ou
chefs-lieux de cantons de France ; et depuis combien de
temps, Messieurs ? Depuis 1789. En 1789, il y avait 40
écoles primaires supérieures et professionnelles, en
France, nées un peu au hasard de la bonne volonté des
municipalités et de la spontanéité de l'esprit public ; et,
depuis 1789, sans intervenir autrement qu'en tendant la
main au bon vouloir naissant, il s'en est créé 400 sur
cette terre de France !
Messieurs, cet enseignement, qui a, comme vous le
voyez, de si profondes racines dans la nation elle-même,
répond à un double intérêt, un grand intérêt moral et
social, à un grand intérêt économique.
Messieurs, le savoir est pour l'ouvrier, sans doute, un
grand instrument de force, de puissance sur la matière,
mais c'est aussi un grand moyen d'apaisement et de
pacification : les passions anarchiques sont toutes filles
de l'ignorance. Apprendre à l'ouvrier, non seulement les
lois naturelles avec lesquelles il se joue dans l'exercice
de son métier, mais lui apprendre également la loi
sociale, lui faire voir clair dans ces phénomènes
économiques que les adversaires de la société actuelle,
qui est pourtant la plus démocratique et la plus libre des
60
sociétés, cherchent à travestir ou à obscurcir autour
d'elle, donner à l'ouvrier des notions justes sur les
problèmes sociaux, c'est en avancer beaucoup la
solution. Ce qui n'était dans d'autres temps qu'une
résignation religieuse ou sombre à des nécessités
incomprises, peut devenir, par les progrès du savoir et
l'habitude de la réflexion, une adhésion raisonnée et
volontaire à la loi naturelle des choses, adhésion qui se
rachète et se compense, en quelque sorte, par une
conception plus pratique des moyens à l'aide desquels on
peut espérer en atténuer les rigueurs.
J'ai dit enfin, Messieurs, qu'il y a dans cette affaire un
grand intérêt économique à considérer. Certes, la France
est une grande nation laborieuse : elle a remporté sur les
champs pacifiques de la libre concurrence européenne de
bien grandes victoires ! Mais tout annonce aux yeux
prévoyants qu'ici, sur d'autres champs de bataille, il
importe de ne pas s'endormir sur les victoires passées.
Nous avons, tout autour de nous, à nos portes comme audelà
de l'Atlantique, des concurrents extrêmement
redoutables dans l'ordre du travail. Ce qui nous arrive de
leurs produits, les rapports qui nous sont faits et, pardessus
tout, la concurrence que nous rencontrons sur les
marchés du dehors, nous donnent à cet égard des
avertissements qu'il ne faut pas dédaigner !
Oui, Messieurs, sur le champ de bataille industriel
comme sur l'autre, les nations peuvent tomber et périr :
sur ce champ de bataille comme sur l'autre, on peut être
surpris, on peut, par excès de confiance, par adoration de
soi-même ou par l'inertie des pouvoirs publics, perdre en
peu de temps une supériorité jusqu'alors incontestée ;
c'est à ce grand danger que doit parer l'enseignement
professionnel dans notre pays ; il n'est pas d'intérêt
61
national plus considérable, et je puis dire et répéter ici,
sans crainte d'être démenti par personne : à l'heure qu'il
est, Messieurs, relever l'atelier, c'est relever la patrie !"
Si l'on passe sur les trémolos très IIIe République, sur la
métaphore militaire, sur le fait que le ministre ne
s'adresse jamais apparemment aux (nombreuses) femmes
de l'assistance (Messieurs,…Messieurs,… !) à peu près
considérées comme les fleurs qui décorent la tribune, ce
discours pourrait être parfaitement contemporain et
concerner cette mondialisation dont on nous rebat les
oreilles.
Le ministre indique trois directions principales : d'abord,
il inscrit l'école dans une perspective générale
d'économie ("il est évident que la durée de
l'apprentissage lui-même sera singulièrement réduite"),
d'efficacité puisque l'ouvrier pourra ainsi être polyvalent
et mieux se plier à l'évolution de l'industrie ("à
l'industrie du fer, puisqu'il sera aussi bien préparé à celle
du bois") et de compétition économique internationale,
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique étant des
adversaires ("Nous avons, tout autour de nous, à nos
portes comme au-delà de l'Atlantique, des concurrents
extrêmement redoutables dans l'ordre du travail."), les
causes de la récente défaite militaire (excès de confiance,
adoration de soi-même, inertie, endormissement) devant
être éradiquées pour ne pas subir un sort semblable sur ce
terrain où les enjeux sont essentiels.
Puis, il définit l'école dans une perspective d'adéquation
des forces vives de la nation avec les réalités
économiques (et politiques) nouvelles, le tout noyé dans
un vocabulaire apparenté aux idéaux de 1789 et justifiant
ses affirmations : l'enfant est appelé à devenir avant tout
62
un serviteur, un travailleur ("Révolutionner l'école",
"l'école nationale, dans une démocratie de travailleurs
comme la nôtre, doit être essentiellement l'école du
travail", "une démocratie ouvrière", "elle a pour but
de préparer l'enfant à devenir, comme l'immense
majorité des citoyens français, un travailleur", "Qu'estce
que c'est que tout cela, sinon le commencement, la
première forme de l'enseignement professionnel, la
préparation élémentaire à la vie pratique, à la vie
laborieuse qui donne à chacun dans cette France le droit
de porter le front haut et de s'appeler citoyen ?",
"Former dès l'enfance l'homme et le citoyen, préparer
des ouvriers pour l'atelier, c'est notre tâche, et, si la
génération actuelle a le temps de la remplir, elle pourra se
coucher glorieuse dans sa tombe!")
Enfin, l'école répondrait à des impératifs de paix sociale.
L'oisiveté étant la mère de tous les maux, il ne convient
pas de laisser trop de temps libre aux classes ouvrières
qui pourraient devenir des classes dangereuses : "plus
d'école, plus rien entre la douzième ou la treizième année
et le commencement de l'apprentissage". Il ne faudrait
pas que le travailleur se laisse gagner par les appels des
"adversaires de la société actuelle (…), la plus
démocratique et la plus libre des sociétés". "C'est aussi
un grand moyen d'apaisement et de pacification : les
passions anarchiques sont toutes filles de l'ignorance."
Parallèlement, il convient de développer une morale :
"Le programme d'enseignement moral et civique, arrêté
par le conseil supérieur de l'Instruction publique, porte
un article ainsi conçu : "Noblesse du travail manuel" : "
Et pour que la noblesse du travail manuel soit reconnue,
non seulement de ceux qui l'exercent, mais (justification
suprême) de la société tout entière, on a pris le moyen le
63
plus sûr, le seul pratique : on a placé le travail manuel
dans l'école même !"
Retenons encore l'expression "fournir à l'industrie"
comme quelques dizaines d'années plus tard, il faudra
fournir de la chair à canon pour une cause qui dépasse
99% des malheureux engagés des deux côtés, mais qui
fera la fortune des Schneider, Krupp et autres capitaines
(ou chevaliers !) d'industrie ! On fait d'ailleurs appel au
même patriotisme ("ici, nous voulons préparer des
soldats pour cette armée") et le champ lexical de la
"bataille", d'une lutte quasi militaire et patriotique tisse
le texte d'un discours ponctué par La Marseillaise.
L'école primaire moderne sert donc en premier lieu à
"fournir" ou à faire du travailleur, et l'image finale de
l'ouvrier se couchant dans sa tombe avec la satisfaction
de la tâche accomplie est une trouvaille tout de même
extraordinaire qui annonce des lendemains sanglants !
Les choses n'ont guère changé de république en
république, de gouvernement de droite en gouvernement
de gauche. Ce qui hier paraissait utopie ne l'est plus par
d'habiles tours de passe-passe : on prédisait naguère 80%
d'une classe d'âge obtenant son baccalauréat. Cette année
2011, toutes sessions confondues, on a atteint les 95% !
Le ministre voulait "ennoblir le travail manuel" (une
obsession et un échec constant de toutes les
républiques !) et le couronnement de cet effort
démagogique aura été la "savonnette à vilains" que
représente le bac pro : Tu seras ouvrier, mal payé, mal
considéré, mais la République t'auras au moins donné tes
lettres de noblesse (!) : ton bac ! Ces annonces
apparemment généreuses, comme l'étaient celles des
64
ministres de la IIIe république, n'avaient rien, elles non
plus, à voir avec un altruisme foncier, mais bien avec une
demande exprimée par le monde de l'économie et de la
production, par des impératifs de sécurité publique. On a
toujours et on aura toujours besoin des sous-officiers de
l'industrie nouvelle et ces sous-off devront régimenter
l'armée des travailleurs toujours mieux formés à
accomplir les tâches qu'on attend d'eux, toujours plus
aptes à être plus finement aliénés !
Récemment, un député a cru bien faire en dénonçant
l'inutilité des épreuves de culture générale dans certains
concours de la fonction publique, ouvrant apparemment
ainsi une boîte de Pandore, car si, dans son esprit, il
s'agissait de ne plus enseigner que de l'utile, de
l'immédiatement utilisable et de ne vérifier que ces
connaissances-là, on ne peut, de toute façon s'empêcher
de s'interroger sur la "culture générale", telle qu'elle est
enseignée actuellement et qui ressemble davantage aux
questions du jeu des Mille Euros qu'à une culture
destinée à enrichir l'individu !
Au diable donc tout humanisme, toute philosophie.
Platon levait les yeux vers le ciel ; son univers était celui
des idées ; il montrait le chemin permettant de quitter la
caverne. Sans doute, avait-il tort, diront certains,
puisqu'il échangeait la contemplation des ombres célestes
contre la quête d'illusions tout comme les enfants
malhonnêtes de Babeuf, Cabet, Proudhon voire Marx ou
Bakounine croyant sincèrement qu'on allait un jour
quitter l'antre sombre dans laquelle se morfondaient les
peuples pour les douceurs des paradis communistes ou
anarchistes, faisant semblant de ne pas voir qu'on allait
65
échanger - pour une période transitoire au moins - un
type d'aliénation par un autre.
Zarathoustra en a fait l'amère expérience : même quand
dieu est mort, les hommes dans leur ensemble n'ont
aucune envie d'en tirer des conséquences. Le surhomme
nietzschéen est une espèce rare et surtout une espèce à
chaque fois menacée.
L'habitant de la caverne se contente, lui, de son sort, de
son confort précaire et il n'aime pas qu'on lui dise qu'il
se trompe. Il accepte parfois de changer de caverne, mais
c'est tout. Il reste prisonnier d'un univers carcéral, d'un
confort carcéral ! La caverne d'aujourd'hui est équipée
en ombres et images électroniques aussi fausses et
aliénantes que celles du passé. D'une cellule l'autre !
On tourne en rond ! Qui pourrait lui dire qu'il se
trompe ? Il faudrait encore un Zarathoustra, un Titan, or
Zarathoustra n'est que le héros d'une épopée
philosophique et les Titans sont prisonniers des pages de
la Théogonie d'Hésiode ! Prométhée est enchaîné à un
rocher quelque part dans le Caucase et Zarathoustra se
refuse en définitive lui-même à la pitié !
Le Maître aujourd'hui n'a rien ni d'un Titan, ni de
Zarathoustra. Il est (encore) un fonctionnaire, c'est-à-dire
qu'il contribue au fonctionnement d'un ensemble qui le
dépasse, il est un simple rouage du système économique
et social et ce système qui s'est établi dans la caverne se
moque pas mal des idées, des rêves de Platon comme des
adjurations de Zarathoustra ou des états d'âme de
l'individu en quête d'authenticité. Le maître en blouse
grise ou le jeune prof en jeans qui fait une demande pour
enseigner en ZEP ou dans un quartier difficile, sont
sincères et ils n'ont qu'un tort, croire en leur utilité
66
désintéressée, oublier qu'ils sont manipulés, utilisés,
réifiés dans leur rôle eux aussi. Dans mon enfance,
j'éprouvais un grand respect pour un missionnaire qui
revenait de temps en temps de la lointaine Afrique pour
rendre visite à sa vieille mère, une voisine. J'allais le
voir. Il me parlait de ses missions, évoquait son travail,
ses conversions. Il n'était pas rare qu'il eût la larme à
l'oeil tant le récit de ses efforts l'émouvait. J'étais touché
par tant de sincérité, par un tel don de soi, par son
émotion. Je l'admirais. Il était certainement honnête et
d'une vertu solide mon missionnaire à la grand barbe
blanche et à l'odeur de moisi, il était honnête comme un
instituteur, mais il n'empêche qu'il se trompait, comme
tous les hussards noirs de la République, il se trompait,
car - si on lui fait crédit d'une grande probité - croyant
dur comme fer qu'il sauvait les âmes de la lointaine
Afrique, il se refusait à réfléchir et à comprendre
combien il était instrumentalisé par l'idéologie coloniale!
On ne quitte ainsi pas la caverne. On l'aménage pour le
profit immédiat de quelques-uns sachant que toute
eschatologie est vaine. Toute pseudo évolution se fait
désormais intra-muros, mais rien ne change en fait. Les
ombres projetées sur le mur de la caverne paraissent de
plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, de plus
en plus denses. Une sarabande de formes, une danse
macabre, un mélange vertigineux qui donne l'illusion de
la nouveauté.
C'est hélas ! aux Maîtres d'aménager ce séjour puisque
l'imposture du chemin du haut s'est révélée, à eux de
faire passer de nouvelles illusions.
Aux Maîtres d'aménager, en effet, car eux-mêmes, sontils
capables de voir plus loin que ce pour quoi on les a
formés ?
67
Donc…
L'École est-elle émancipatrice, libératrice, formatrice au
sens noble que ce terme pourrait avoir ou n'est-elle qu'un
institut de formatage (on a inventé il y a 20 ans les IUFM
= Instituts Universitaires de Formatage des Maîtres ! On
ne pouvait trouver mieux !), une fabrique de clones, un
lieu de dépersonnalisation et d'uniformisation ? Et ce
Maître alors, est-il encore l'éveilleur qu'il a cru parfois
être ou qu'on a voulu voir en lui ? Est-il tout simplement
un de ces chiens de garde qu'un célèbre pamphlet
dénonçait dans les années trente, un manipulateur par
force, voire un maton par goût ?
Avant de répondre à ces graves questions, je vous invite à
un petit excursus dans le temps. Qu'a été l'école aux
époques passées ? Comment a-t-elle évolué ? Quelles en
ont été les objectifs constants et les nouveautés ?
Il n'est pas question ici de recommencer ce que d'autres
ont très bien fait en racontant l'histoire de l'enseignement
et je prierai mon lecteur de se référer à la bibliographie
en fin d'ouvrage si le rapide survol que je lui propose le
laisse un peu sur sa faim. Il ne sera pas non plus question
d'entrer dans le détail des enseignements et des
méthodes. Je me contenterai d'insister davantage sur
l'enseignement des lettres moins parce que cet
enseignement est supposé être potentiellement formateur
au sens noble du mot, mais surtout parce que mes
quarante années de prof de lettres ont forcément fait
pousser des oeillères dont il m'est impossible de faire
abstraction. Midas sur un autre plan sans doute.
68
69
II. L'École, une institution mise en place par les
puissants pour les puissants (les puissances en
place)
ou
Comment les tenants ou les représentants d'un système
décident de faire entrer dans les têtes des enfants des
principes utiles à leurs projets.
70
71
Il était une fois…
Avant ce bon Charlemagne, l'inventeur putatif et
mythique de l' "école", l'enseignement, lorsqu'il est
dispensé, est entièrement entre les mains du clergé qui
organise des écoles à vocation essentiellement
"professionnelles". Dès le VIIe s., voire plus tôt, cet
enseignement se décline de trois façons principales.
Les écoles monastiques qui n'existent que pour
l'accueil et la formation des futurs clercs,
Les écoles épiscopales ou cathédrales dans lesquelles
se trouvent en particulier manécanteries et petits
séminaires,
Les écoles presbytérales ou paroissiales qui ont pour
mission d'assurer la succession des prêtres.
Il est bien entendu qu'il n'existe pas d'organisation
générale et que chacun de ces trois types d'école
fonctionne à vue, de même qu'à l'intérieur de chaque
classe - si l'on peut dire - règne la diversité la plus
joyeuse.
Pourtant, un point commun : toutes ces institutions ont
une finalité qu'elles sont allées chercher en dehors de
préoccupations purement pédagogiques. L'école est là
pour permettre à de rares individus d'assurer un rôle
social, pour les intégrer à un système dont la clé de voûte
est l'Église et son omnipotence, pour qu'un jour ils soient
à même - à leur tour - de participer et de faire
fonctionner ce système. On n'apprend pas - quand on
apprend ! - pour accroître son savoir ou "s'épanouir",
72
on apprend pour s' "imbriquer" dans un monde qui
préexiste et qui doit se maintenir. On fait des moines, des
abbés et des curés parce que l'Église domine la société et
entend pérenniser sa puissance, parce que Dieu est la
figure masculine par excellence et que les cadres de cette
théocratie ne peuvent être que des hommes.
Les méthodes utilisées par les maîtres sont en rapport
avec la rigueur des existences : un principe, la sévérité,
particulièrement envers les adolescents, qui s'éveillent à
toutes ces concupiscences qu'il convient de réprimer ou
de voiler, car elles risquent d'aller contre l'ordre établi.
En revanche, les enfants subissent moins les foudres des
maîtres. On leur laisse plus volontiers la bride sur le cou
puisqu'ils sont si près de l'innocence angélique. Avec
mesure, cela s'entend !
On pratique le plus souvent une pédagogie par l'image
(prédication muette) car ce n'est pas d'hier qu'on sait
déjà l'impact de l'iconographie ; l'apprentissage du latin
(la langue de LA caste) est la principale activité dans le
secondaire et le supérieur (glossaires et copiage); les
élèves ne bénéficient d'aucune formation littéraire : on
insiste seulement sur la grammaire dont le caractère
apparemment indiscutable prévient toute échappée de
l'imaginaire. Quelques autres enseignements complètent
cette formation : les Écritures, un peu d'arithmétiques,
quelques rudiments de botanique et d'astronomie,
quelques savoirs manuels jugés nécessaires…Certes, de
rares intellectuels dans la lignée de Cassiodore de Sicile
au VI e s. poursuivent, rapporte-t-on, la tradition littéraire
de l'Antiquité davantage dirigée vers la réflexion et
l'échange, mais ils sont l'exception et les endroits où ils
enseignent réservés à une élite.
73
À partir de ce que certains historiens appellent la
Renaissance carolingienne (mais chaque période
historique, si l'on y réfléchit bien, voit plusieurs
"renaissances" : le terme est un peu galvaudé) on
constate une petite ouverture à ces études littéraires
négligées, sous l'influence d'Alcuin (735-804) dans de
nombreuses écoles épiscopales et monastiques, mais
encore une fois, ces évolutions ne se font qu'à doses
homéopathiques et ne profitent qu'à bien peu de
bénéficiaires. L'école tant vantée de Charlemagne,
l'École du Palais, n'est qu'une sorte d'Académie
ambulante fréquentée par de jeunes patriciens ayant passé
par le préceptorat ou l'école épiscopale. Rien à voir avec
la Communale !
Sept arts dits libéraux vont structurer l'enseignement
secondaire comme l'enseignement supérieur et se
divisent en deux valences :
- Le trivium, ou arts philologiques, correspond aux
lettres (grammaire, rhétorique et dialectique), un
enseignement qui préfigure ce qui se fera dans les
collèges de l'Ancien Régime avec l'importance
accordée aux lectio et disputatio.
- Le quadrivium (arts des nombres) qui regroupe ce
qu'on appellerait aujourd'hui les matières
scientifiques : arithmétique, géométrie, astronomie,
musique.
Dans les écoles épiscopales, on enseigne parfois le
trivium en insistant particulièrement sur la grammaire,
car on pense alors que les catégories grammaticales sont
le pendant des catégories logiques : le nom et l'adjectif
définissent la substance et l'attribut. Le maître lit (lectio)
et commente en latin ce qu'il a lu, s'appuyant le plus
74
souvent sur les inscriptions ou gloses en marge des livres,
gloses qui sont de son fait ou l'héritage d'un professeur
précédent.
Dans les villes, l'Église commence à créer des écoles
pour enfants pauvres, mais il faudra attendre le Concile
du Latran (1179-1215) pour qu'on donne dans presque
chaque cathédrale des cours à quelques nécessiteux. Là
encore, le peu d'enfants touchés par cet enseignement est
destiné à la sphère ecclésiale. L'Église se constitue le
vivier dont elle a besoin. L'enrichissement personnel,
l'acquisition d'une culture qui serait le bien propre de
l'individu est quasiment inimaginable.
Et l'Université fut
Un fait important cependant, c'est que vers la fin du XIIe
et le début du XIIIe siècle apparaissent les corporations
enseignantes. Le terme devient d'ailleurs officiel en
1262. Ces corporations commencent à échapper en partie
au contrôle de l'évêque, mais c'est pour tomber de
Charybde en Scylla : elles sont immédiatement la cible
des puissances laïques comme la monarchie française
dont les contours se dessinent au sein d'une féodalité
encore bien vivante, un État qui a de plus en plus besoin
de juristes, d'architectes, d'ingénieurs, de médecins,
moins d'intellectuels que de praticiens, dirions-nous pour
oser un anachronisme.
Un peu plus tôt, à Paris, plusieurs écoles monastiques (St
75
Germain, Ste Geneviève, St Victor et l'école épiscopale
de l'Ile St Louis) forment le berceau de l'université au
sein du Quartier Latin, avec des maîtres prestigieux
comme le malheureux et valeureux Abélard (1079-1142).
De nombreuses écoles particulières ouvrent aussi.
Les maîtres sont masculins, le plus souvent
ecclésiastiques mais, ce qui est nouveau, parfois laïcs.
Comme les élèves, ils doivent être cependant catholiques
et restent ainsi plus ou moins directement sous le contrôle
de l'Église.
En ces années qui voient une timide émancipation de
l'institution scolaire supérieure et universitaire, il n'existe
pas d'édifice particulier. Un tel pas est encore
inconcevable. On se regroupe en hospita (Collège des
Dix-Huit). Ces collèges se développent (bibliothèque,
salles particulières...) La maison de la Sorbonne (Robert
de Sorbon, 1257) est un collège qui héberge 16 étudiants
qui, petit à petit, reçoivent un enseignement dans le lieu
qui prendra le même nom.
En outre, les universités sont d'abord européennes avant
d'être nationales, ce qui se comprend puisque le concept
même d'état ou de nation en est à ses premiers
balbutiements. L'université de Paris est ainsi divisée en
quatre nations: France, Normandie, Picardie, Angleterre.
Le privilégié fait sa théologie à Bologne, sa médecine à
Montpellier ou Salente....
L'Université enfin est différenciée sur le plan des
enseignements : à Paris, elle compte ainsi quatre facultés
(arts, théologie, droit et médecine au milieu du XIIIe s.).
La faculté des arts constitue une sorte de propédeutique
et les trois autres ont une vocation professionnelle. Le
droit et la médecine sont davantage tournés vers le
76
monde, mais de nombreux médecins par exemple sont
liés à l'Église. L'université, comme l'école, conforte le
système en place, qu'il soit laïc ou ecclésial.
La faculté des arts délivre:
- la déterminance (14-16 ans) octroyée par les Nations
après une dispute publique qui devient le baccalauréat au
XVes.)
- la licence (au moins 21 ans et 6 ans d'études) est un
examen passé devant jury et comprend lui aussi une
dispute)
- la maîtrise ès arts qui sera plus tard le doctorat.
L'essentiel de l'enseignement est basé sur la logique et la
grammaire (le formalisme grammatical est un jeu
intellectuel qui ne dérange personne et surtout pas
l'Église) Pour le reste, on débat de thèmes religieux et
philosophiques comme déjà au XIIe siècle avec la
controverse des universaux animée par Abélard dont la
dialectique tentait de concilier foi et raison. On ne
pouvait être plus…conciliant. Pascal s'en souviendra.
L'intention était philosophiquement noble, mais le
glissement Foi/Église-Raison/État aisé et par là même
l'union des deux puissances pour le plus malheur de la
majorité !
En 1280, on compte cent vingt enseignants, à la faculté
des arts contre trente pour les autres.
Le nombre d'étudiants rapporté à la population globale
est infime. Au début du XVe s. Paris compte 3500
étudiants dont 10 à 15% d'étrangers.
La fin du Moyen Âge est marquée par la rigidité des
organisations et de l'enseignement scolastique, une
rigidité dont Rabelais a donné l'image comique pour
mieux mettre en valeur le renouvellement pédagogique
77
auquel il croit et qui a déjà commencé dans certains
collèges bien avant que Pantagruel et son fils ne voient le
jour. Une éducation primaire au sens où nous l'entendons
est inexistante.
Jusqu'à la Renaissance, l'enseignement - à l'école ou
dans les Universités - reste ainsi marqué par la présence
de l'Église, directement ou indirectement. Si on étudie
d'abord pour intégrer l'Église et pour la servir,
l'évolution politique et sociale entraîne cependant des
changements modérés. La formation d'un État centralisé,
une aristocratie plus avide de connaissances qui la
cimentent, la prise en compte de la bourgeoisie des villes
impliquent le développement de nouvelles compétences
et de nouveaux savoirs, mais, dans tous les cas, c'est
cette évolution qui crée l'instrument - à son service -, et
non pas l'inverse : l' "école" au sens large n'a
jusqu'alors jamais existé que pour entériner, formaliser
les résultats d'une gestation sociale et politique lente, une
réglementation après-coup, le soutien d'une situation
nouvelle.
L'Église et l'État s'appuient certes l'un sur l'autre (la
première fournit la plupart du temps les cadres au
second), mais l'école reste pour longtemps aux mains de
l'Église, une Église de plus en plus "gallicane" il est
vrai, c'est-à-dire ayant reconnu le primat de l'État, et,
lorsqu'une nouvelle Église tentera sa chance, le pouvoir,
qui y verra une menace, l'écrasera au bénéfice de sa
vieille alliée. Un roi, une foi, une loi. L'école sert une
noble cause : dieu, le roi, la religion. Ajoutons le
renouvellement des cadres et l'ordre intérieur,
78
immuable ! On tourne en rond. Toute échappée est
condamnée et l'affaire Galilée par exemple dépasse le cas
d'espèce, la mise en question de la cosmologie officielle :
il est d'abord celui qui s'attaque à l' "ordre" établi,
crime parmi les crimes ! On se contente d'interdire
(violemment !) ce qui gêne et de chercher dans le passé
les justifications du présent : Aristote puis Platon en
odeur de sainteté…
Comme larrons en foire, on s'entend bien sûr et pour des
siècles. Helvétius fera encore scandale en plein XVIIIe
siècle en dénonçant, après quelques autres, cette
association à bénéfices réciproques et lorsque
Robespierre s'opposera à la vague de déchristianisation
qui menace de se transformer en raz-de-marée, son
opposant Anacharsis Cloots lancera ce cri : "Gare le
Piège ! Hommes libres, on voudrait fixer vos yeux vers le
ciel, pour vous jouer quelque mauvais tour", une
constatation ou un avertissement valable pour tous les
temps et en tous les lieux du globe !
Essor de l'enseignement secondaire sous
l'Ancien Régime.
L'évolution des XVI e et XVIIe s. poursuit ce modèle
malgré les apparences et les voeux pieux des humanistes.
Le monde s'ouvre, l'image qu'on en a évolue et le vieux
cadre dans lequel a vécu le monde éclate et fait place à de
nouvelles vues. Cette évolution d'abord technique puis
intellectuelle, politique, les difficultés auxquelles est
confrontée l'Église romaine impliquent une rénovation
pédagogique.
L'honnête homme de la Renaissance a de nouveaux
79
besoins face au savoir : pour rompre avec des traditions
qui ont fait leur temps, le rapport au livre et au texte
(ancien) doit changer. Un formalisme littéraire remplace
le formalisme logique jusqu'alors en vigueur. On cherche
à mettre en valeur les aspects esthétiques ou moraux
d'une pensée plus que l'enchaînement des arguments.
Dans un monde qui voit se déliter la puissance de
l'Église et se renforcer le rôle des États, des
commerçants, des banquiers, de l'argent et des échanges
économiques et techniques, un nouveau code se dessine,
se moule dans l'ancien, celui de l'éthique et du bon goût
commun de quelques-uns. D'autre part, face à une Église
qui a confisqué, expurgé, commenté les textes de
l'Antiquité, l'humaniste désire remonter aux sources,
consulter les originaux. Le livre imprimé, enfin,
commence à se répandre.
Une nouvelle société chercherait à définir de nouvelles
bases culturelles correspondant davantage à un monde
qui se découvre d'autres centres d'intérêt et la nécessité
d'accorder un droit à l'éducation à davantage de
privilégiés, mais les anciennes habitudes, la routine ne
disparaissent pas du jour au lendemain. L' "école" va
alors être chargée de peaufiner, d'organiser ce qui est
déjà en gestation, mais si elle reste entre les mains de
l'Église, c'est d'une Église qui, confrontée à cette
évolution, poussée par les événements de la Réforme,
doit évoluer, en apparence au moins. C'est en tout cas
dans les pays catholiques le grand apport des Jésuites
dont le général siège à Rome. Ceci dit, le déroulement de
l'enseignement de ces derniers n'évoluera quasiment pas
pendant deux siècles. Si l'accent était particulièrement
mis sur la religion et la formation morale, une partie du
programme était marquée par l'humanisme. On étudiait
80
les auteurs de l'Antiquité dans le texte (expurgés, choisis)
et, pendant plusieurs années, les élèves pouvaient
s'imprégner d'une pensée et d'une philosophie nonchrétienne,
ce qui explique pour une part que des
sceptiques comme Voltaire ou Helvétius aient gardé un
excellent souvenir de leurs études. En outre, les jésuites
organisaient des discussions, des conférences publiques,
des représentations théâtrales qui développaient les
capacités des enfants qu'on leur confiait. Ils mettaient
tout en oeuvre pour inculquer les règles du discours et de
l'expression des idées. Enfin, des cours de métaphysique,
d'éthique et de logique étaient organisés à partir de
passages extraits principalement d'Aristote et de certains
philosophes scolastiques.
Cependant,
L'essor économique de la bourgeoisie au XVIIe et surtout
au XVIIIe s. impliquera naturellement un renouvellement
des valeurs éducatives: un enseignement secondaire
ouvert sur la vie et des programmes réalistes répondant
au développement économique et technologique tout en
prenant en compte une certaine mobilité sociale. Les
jésuites se verront reprocher de négliger les sciences, ce
"moteur du progrès", de pratiquer un enseignement
beaucoup trop théorique et peu apte à préparer les
individus à la vie. Une majorité des anciens élèves des
jésuites s'élèvent contre l'enseignement du latin
considéré comme désormais inutile à une société
moderne : la critique ira en s'accroissant et, au XVIIIe
siècle, Maubert de Gouvest consacre un ouvrage entier à
argumenter sur ce thème et il n'est ni le seul ni le
premier. L'Émile peut être lu sous un certain angle
comme un contre-modèle. Il paraît d'ailleurs l'année
suivant le départ des jésuites de France !
81
Les Oratoriens tiendront davantage compte de cet
environnement nouveau, ce qui expliquera leur succès
jusqu'à la Révolution : ils sauront mieux se positionner
par rapport à un monde en pleine transformation
intellectuelle, technique et économique.
L'idée se fait que l'enseignement secondaire aura pour
tâche de former cette bourgeoisie (grande et petite) qui
doit accompagner l'évolution économique.
Notons bien que pendant toute cette période, un
enseignement primaire de masse est encore impensable
quand la majorité de la population va exactement sur les
brisées de la génération précédente et ne fait que
reproduire le modèle existant. Le paysan prolongera la
routine dans laquelle vivent ses parents, même si
quelques progrès dans l'alphabétisation doivent être
signalés - surtout pour les garçons et de façon nullement
linéaire. Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), chanoine
de Reims (1666-1683), crée l'Institut des Frères des
Écoles chrétiennes, voués à l'éducation chrétienne des
"enfants des artisans et des pauvres"," mais il ne
touche que peu d'enfants et à sa mort, en 1719, l'Institut
compte 120 Frères établis en 22 villes, d'autres
congrégations toucheront aussi peu d'enfants et les
petites écoles végètent jusqu'à la Révolution et
fonctionnent de manières très diverses. En outre, le
paysan a besoin de ses enfants pour l'aider dans son
travail et il sait qu'un supplément d'éducation ne
mènerait qu'à des difficultés, quasiment jamais à une
amélioration du sort de ses enfants (les Mémoires de
Marmontel sont intéressantes à ce sujet). En outre, ceux
qui avaient appris à lire dans les campagnes n'utilisaient
le plus souvent leur savoir que pour lire ce qui était en
82
rapport étroit avec leur travail. La petite école n'avait que
cet usage, même si les exemples contraires d'enfants de
petite extraction parvenant à des études secondaires
tendent à nuancer cette constatation : une proportion
importante de la République des Lettres au XVIIIe siècle
est d'origine très modeste, mais, toute proportion gardée
(Le portrait du "Pauvre Diable" que nous a légué
Voltaire en témoigne), l'éducation reçue a
essentiellement valeur de "savonnette à vilain".
Les ordonnances de Louis XIV en 1695 et en 1698, de la
Régence en 1719 et de Louis XV en 1724 prescrivant la
fréquentation des écoles et le paiement du traitement du
maître (souvent évoquées) ne changent rien, car
beaucoup de communes n'ont pas les moyens de cette
politique et ces ordonnances venant après la Révocation
poursuivent en réalité la même politique : l'école comme
moyen de conversion ; elles n'ont que peu à voir avec des
visées éducatives dignes de ce nom.
Le pouvoir royal n'a pas de politique scolaire et les "petites
écoles" à la campagne, sont le fait" d'initiatives locales ou
privées : l'assemblée des habitants d'une paroisse, un bienfaiteur…
Dans les villes, les petites écoles sont parfois initiées par la
municipalité, mais le plus souvent par des communautés dévotes
ou des particuliers.
L'enseignement dans ces écoles primaires est laissé aux bons soins
de ses organisateurs et elles sont quasiment seulement fréquentées
par les garçons. Une grange, le logis du maître, le porche de
l'église tiennent lieu le plus souvent de salle de classe. Trois
enseignements essentiels sont dispensés : l'éducation religieuse,
l'instruction scolaire (lire et compter) et des préceptes de civilité.
Cet enseignement est gratuit pour les familles les plus pauvres,
mais rares sont les familles qui peuvent se permettre de renoncer
au travail des enfants en les scolarisant vraiment même seulement
quelques années. L'analphabétisme, recule au XVIIe-XVIIIe siècle,
mais il reste très important : en 1686-1690, 28 % des hommes
83
signent, contre 14 % des femmes ; peu avant la Révolution, on
passe à 47 % et 26 %. Le Nord et le Nord-est de la France sont
davantage alphabétisés que le Sud.
L'enseignement secondaire réservé à la frange privilégiée
de la population reste fondamentalement marqué par la
puissance de l'Église. Le recteur de l'Université de Paris,
Charles Rollin, l'auteur du Traité des études qui fit
souffrir des générations d'élèves, défendra certes
l'éducation humaniste, mais il ne la conçoit que liée à
une solide éducation religieuse. Sa conception est
essentiellement morale. Le but de l'éducation, dit-il, est
l'amélioration de l'homme, mais cette amélioration n'est
conçue qu'en fonction des exigences chrétiennes voire de
l'eschatologie. De bons maîtres n'accordent de l'intérêt
aux sciences que dans la mesure où elles mènent à ce but.
Un honnête homme est préférable à un homme instruit,
mais il est impossible de former un honnête homme sans
s'appuyer sur la religion et celle-ci doit demeurer le
début et la fin de l'enseignement.
Il est évident que cette question des rapports entre la
morale et la religion allait être la tasse de thé (ou de
chocolat) de tous les philosophes au cours du siècle et
plus tard.
*
Tous les élèves apprennent (ou apprenaient) que la partie
de bras de fer entamée en France dès la Renaissance entre
l'Église, les pouvoirs et les partisans d'une plus grande
liberté de pensée atteint un sommet à l'époque de la
fameuse querelle du Tartuffe et qu'un des conflits les plus
importants du XVIIIe siècle en France est celui qui se
déchaînera à propos de l'enseignement, l'Église désirant
84
conserver son monopole et les philosophes cherchant à
l'abolir, car le jeu en vaut la chandelle : tout le monde est
d'accord là-dessus !
Le renvoi des jésuites en 1762 marque l'acmé de cette
querelle. En apparence Aristote indiquant la terre
l'emporte sur Platon montrant le ciel. En apparence
seulement. L'Église (gallicane), force à la fois séculière
et spirituelle, représentante de l'ordre divin sur terre et
immensément possessionnée, monstre multicéphale a pu
supporter sans problème la disparition des jésuites ces
ultramontains souvent détestés ; elle voit dans
l'enseignement l'instrument par excellence lui assurant sa
prédominance dans ces deux domaines ; les philosophes
- pour la plupart - en veulent à cette puissance séculière
de l'Église qui met un frein au développement d'abord
économique puis intellectuel, car elle n'a pas intérêt à ce
que les choses changent vraiment. Le nombre de jours
chômés en raison de telle ou telle fête religieuse dépasse
quasiment le nombre de jours où le travail est permis ! La
production en souffre, pas les revenus du clergé ! À
l'image de Voltaire, les philosophes cependant ne veulent
pas, à de rares exceptions, la supprimer mais simplement
briser sa superbe, la renvoyer à des obligations qu'ils
jugent premières, le soin des âmes, l'eschatologie, le
contrôle de la morale des petites gens. Chacun sait dans
les salons que la canaille a besoin de religion et qu'une
société prospère et ordonnée se doit d'avoir une Église.
Relisons Voltaire ! Que celle-ci soit catholique ou
protestante, peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle
existe et apprenne à la populace à bien se tenir pour
mériter le paradis. La récompense viendra. Patience ! Au
grand jour du jugement dernier, les premiers seront les
derniers et les derniers les premiers ! On n'exclut certes
85
pas une évolution, mais ce sera pour dans très, très
longtemps. Peut-être qu'alors, aux calendes grecques, on
pourra rediscuter la place et l'importance de cette
Église…
Quelques dates
- Collège de France, 1530
- Édit de Villers Cotterêt, 1539
- Concile de Trente (1545-63) Chaque église devrait entretenir une
petite école dont le maître sera choisi par l'évêque.
- 1er collège jésuite à Paris 1551 (Collège de Clermont qui devient
Louis-Le-Grand en 1683).
- Édit de Nantes, 1598. Le roi nomme une commission pour
élaborer les statuts de l'Université de Paris : "à prier le roi trèschrétien,
à lui être soumis, et à obéir aux magistrats".
- Oratoriens à Dieppe en 1614
- Petites écoles de Port Royal 1637. Richelieu et la langue
française : Académie, dictionnaire de l'Académie.
- Sous Louis XIV : succès des Jésuites et répression des Oratoriens
(soupçonnés de jansénisme) et suppression des écoles protestantes,
des académies protestantes en 1685.
- Enseignement primaire gratuit proposé en de nombreuses villes
par les Frères de St Jean Baptiste de la Salle.
- Au XVIIIe s. tendance à séculariser l'enseignement secondaire et
fin des discriminations religieuses en 1787. L'intendant intervient
auprès des évêques dans la vie des petites écoles.
- Expulsion des Jésuites en 1762
- Rousseau publie L'Émile en 1762 : l'épisode du Vicaire Savoyard
déchaîne certes les passions, mais qu'un laïc, un Protestant se fasse
pédagogue paraît à l'Église être une provocation autrement
insoutenable alors que le combat entre théologiens et philosophes
n'a jamais été aussi dur. Ceci d'autant plus que contrôler
l'éducation, c'est bien sûr contrôler sinon les âmes au moins les
esprits !
- Écoles techniques et militaires.
- La Chalotais publie son Essai d'éducation nationale (1762),
Guyton de Morveau son Mémoire sur l'éducation publique (1764)
et Maubert de Gouvest sa critique Le temps perdu ou les Écoles
86
publiques (1765).
- Concours d'agrégation (1766)
- Idée d'un ministère de l'instruction publique avec Turgot qui
considère qu'on manque d'ingénieurs. Une réflexion qui est reprise
par de nombreux philosophes. La société civile commence à
réclamer une école qui soit au service de la société moderne. En
arrière-fond bien entendu, la certitude que progrès matériel et
progrès moral sont liés. Faire des ingénieurs, c'est accélérer le
progrès, ce progrès dont tous les hommes profiteront !
Enfin la Révolution se fit !
On ne trouve pas d'écho d'une problématique scolaire
dans les Cahiers de Doléance si ce n'est que le clergé
cherche à renforcer ses prérogatives en ce domaine. On
en est encore à des objections d'ordre moral contre
l'instruction populaire. On souhaite à la rigueur des
formations pratiques (sages-femmes, hydrographes,
militaires, des formations professionnelles…). La
Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen sera
d'ailleurs étrangement muette à ce sujet !
L'action en faveur de l'école sous la Révolution est
inséparable des leçons des philosophes d'une part (bien
commun, progrès, réalisme des apprentissages en vue de
ce bien commun) et de l'attitude face au clergé d'autre
part.
On peut distinguer plusieurs phases avec pour point de
départ l'abolition du monopole du clergé :
- surveillance par les pouvoirs civils en 1789 des
87
écoles existantes.
- 2 novembre 1789, les biens du clergé sont désormais
à la disposition de la nation et, en 1790, la
Constitution civile du Clergé est adoptée
- Avec la Constitution de 1791 apparaît une grande
nouveauté : "Il sera créé une instruction publique
commune à tous les citoyens", proclame-t-on. Mais
ce futur de l'indicatif reste bien hypothétique, la
France va entrer en guerre, la conscription de masse
va s'imposer. On pensera à l'éducation plus tard… si
on a le temps !
- Le 18 août 1792, les congrégations sont interdites et
avec cette interdiction, l'enseignement ou ce qu'il en
reste en cette période troublée est forcément
sécularisé. Notons que cette sécularisation ressemble
assez à la disparition des jésuites en 1762. Quelques
maîtres choisissent l'émigration, la plupart prennent
l'habit laïc : il faut bien vivre. Les contenus
d'enseignement et les méthodes n'évoluent
évidemment guère : on sait que l'habit ne fait pas le
moine !
- Le 8 mars 1793 les biens des congrégations sont mis
en vente.
- Pendant l'été 1793 on décide de supprimer les
académies, les écoles militaires, les universités car
symboles d'un passé aboli.
- Le 15 septembre 1793 un décret abolit les collèges de
l'Ancien Régime et établit 3 degrés d'éducation.
* Beaucoup d'idées… sans suites (1789-1794)
88
La question de l'éducation est certes posée dès la
Constituante comme sous la Législative mais celles-ci ne
proposent aucun texte de loi.
Il est évident que l'éducation représente un enjeu qui
apparaît à tous essentiel et la Constitution de l'an I
affirme qu' "il sera créé et organisé une instruction
publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard
des parties de l'enseignement indispensables pour tous
les hommes (…)" mais elle ne va pas plus loin et on
reste tout de même très peu précis sur ces "parties de
l'enseignement indispensables à tous les hommes" !
Notons qu'on parle désormais d'Instruction publique et
cette expression comme l'apprend l'étymologie signifie
qu'il s'agit d'équiper, de munir voire d'armer. Les
connotations militaires du substantif sont à peine voilées
("L'instruction de la jeune recrue"). L'adjectif, en
revanche, provoque d'indéniables échos démocratiques.
L'instruction publique permettrait à tous les citoyens
d'acquérir les connaissances indispensables pour intégrer
la société nouvelle, pour y tenir leur place. Mais quelle
place ?
La création d'un Comité d'Instruction Publique (octobre
1791) comme il existera un Comité de Salut Public, qui
se réunira régulièrement sous la Législative et la
Convention obéit aussi à un principe qui paraît évident.
La Révolution marque, dans l'esprit de ses propagateurs,
le début d'un renouveau, d'une régénération et l'École -
qui est en gros imaginée sur le modèle des établissements
de l'ancien régime - devrait paradoxalement y contribuer.
Le Comité est certes entièrement favorable à toute
mesure qui diminue le pouvoir de l'Église, avec pour
objectif une éducation citoyenne susceptible de rendre
89
inutile dans le futur toute religion, mais rien de concret
n'est proposé.
Si les assemblées restent dans le vague, les projets
d'éducation sont particulièrement nombreux : des
ecclésiastiques (Corbin, Delas, Paris, Villiers, Auger,
Daunou…), ou des laïcs comme J.-J. Mounier, J.-J.
Bachelier, Lacépède, Bourdon…, en rédigent et les
journaux s'en font l'écho. Pourtant, ces projets euxmêmes
vont davantage dans le sens d'une adaptation à
une époque conçue comme nouvelle qu'à un véritable
nouveau départ, une régénération dont les principes
resteraient à fixer.
Régénérer la Nation par l'Éducation soulève de toute
façon bien des problèmes, car si tout le monde pense
qu'il faut révolutionner la pensée, personne ne sait
comment. Certains esprits avancés comme Anacharsis
Cloots considèrent dès 1791 qu'une véritable renaissance
n'est possible qu'en l'ancrant dans le peuple parce que ce
peuple forme la partie la plus nombreuse de la société et
qu'il a été le moins contaminé par les habitudes de
l'Ancien Régime, si ce n'est par la religion. Ces hommes
pensent qu'il faudra patienter et que l'esprit ancien ne
sera définitivement extirpé que dans l'esprit des
générations futures. Que faire en attendant ? Comment
trouver les maîtres susceptibles d'assurer la transition ?
De par leurs études, leurs biographies, ils appartiennent à
ce passé abhorré et il n'est pas possible qu'ils échappent,
en dépit de leur bonne volonté et de leur foi
révolutionnaire, à ce qui les a formés. Pourtant, on a
besoin d'eux, dans cette phase de transition et, lorsque la
République sera proclamée, Anacharsis pensera que cela
90
ne sera possible qu'en créant un véritable service public
d'enseignement susceptible de former des hommes
nouveaux, un service public, écho des préoccupations
populaires, de "la partie saine de la Nation", ayant
défini un programme que les maîtres appliqueront.
Mais ces réflexions radicales de quelques-uns resteront
simple matière de discussion, sujets d'entretiens et de
polémiques au Comité d'éducation ou dans les couloirs
de l'Assemblée, car l'heure est à des préoccupations qui
paraissent plus urgentes avec cette coalisation des
puissances, l'agitation antirévolutionnaire qui trouble de
nombreuses campagnes et provinces, la chouannerie…
On s'en tiendra donc à des projets plus sages et plus
immédiatement réalisables.
Talleyrand (1754-1836) présente un projet à la
Constituante en septembre 1791. Sa ligne de pensée se
résume en quelques mots : apprendre à vivre heureux et
utile.
Ces deux derniers adjectifs sont importants, car, dans le
fond, ils paraissent représenter la finalité bien comprise
de toute éducation. Être utile parce que l'individu
appartient à une communauté, à une société et son action
s'inscrit dans un vaste contrat social dont il sera à la fois
une des chevilles ouvrières et un des bénéficiaires ; être
heureux parce que depuis les maîtres de l'Antiquité, on
ne peut l'être sans le Savoir : se connaître soi-même,
connaître son environnement et ses origines, penser par
soi-même, être libre…
En même temps ces deux termes peuvent paraître
tautologiques, car il est clair que dans une société
constituée et régénérée, l'individu ne peut être heureux
sans être utile. Dans l'esprit de Talleyrand et de nombre
91
de ses contemporains des Lumières bonheur et utilité
sont indissociables : il y a du bonheur à se rendre utile et
la certitude de son utilité est source de bonheur. Pourtant,
ces deux termes restent nimbés d'un flou sémantique
important car d'autres courants - la vague préromantique
s'enfle en cette période dramatique - rapportent
davantage la notion de bonheur à la subjectivité de l'être.
De toute façon, si l'utilité fait à première vue davantage
partie de la sphère sociale, personne ne nie qu'elle n'en
possède pas moins aussi une dimension spirituelle. En
effet, qui est utile? Celui qui produit des objets
manufacturés ? Celui qui travaille dans les champs ?
Celui qui écrit des poèmes ? Celui qui parle ou celui qui
se tait ? L'ouvrier, le paysan, le banquier ou l'artiste ?
Ce sera au législateur de préciser ce qu'il entend. Or, ce
projet reste très discret sur tous ces points, donnant
seulement la priorité à l'organisation d'un enseignement
public comme si le cadre, la forme devait conditionner
les contenus. Apprendre à vivre heureux et utile, paraît
donc être davantage une clause, un slogan qui résume les
aspirations des Lumières. Ceci dit, ce préambule énoncé,
Talleyrand passe aux choses sérieuses et esquisse les
contours de l'éducation telle qu'il l'entend.
*L'Éducation générale (écoles primaires) serait du ressort
du canton. Elle devrait être gratuite (au canton de payer !)
et fournir aux enfants les rudiments nécessaires pour
savoir lire, écrire et calculer. Quelques connaissances de
la géographie du département s'y ajouteraient et bien sûr
les enseignements parallèles de la religion et de la morale
civique et civile. L'accent est mis sur l'apprentissage du
français pour faire reculer "les patois" synonymes
d'ignorance, d'arriération et de particularisme. La
Révolution doit en effet supprimer tout ce qui risque de
92
fragmenter la société : on voit immédiatement les dangers
de la démarche !
*L'Éducation supérieure, quant à elle, devrait dépendre
du district. Elle servirait à préparer "utilement à tous les
états de la société". Cet enseignement sur sept ans serait
payant et considéré comme "nuisible et inutile au plus
grand nombre", destiné évidemment aux métiers certes
utiles mais n'exigeant que peu de connaissances !
*Des écoles départementales formeraient les
ecclésiastiques, les médecins, les hommes de loi, les
militaires. Les cadres de la société recevraient ainsi une
formation particulière.
Dans ces deux derniers types d'écoles, les éducateurs
seraient recrutés parmi les citoyens susceptibles de
transmettre un savoir : les prêtres, les juristes, les
médecins, les officiers etc., pas de pédagogues donc mais
des "professionnels".
*Enfin, un Institut National, sorte d'Académie de
l'enseignement, serait réservé aux "talents supérieurs".
On note immédiatement l'écart existant entre les bons
sentiments apparents du préambule et les moyens
envisagés. Si l'utilité du citoyen reste un critère évident,
être heureux semble signifier savoir rester à sa place : le
prêtre, le chevalier et le paysan en quelque sorte !
Pour ce qui est de l'organisation de l'administration de
l'Éducation, le projet prévoit une Commission de
l'Enseignement Public (avec des membres nommés par le
roi), une sorte de ministère de l'Éducation avant l'heure,
chargé de faire valoir les droits du politique.
93
On retrouve assez dans ce projet ce que Bernard Germain
Étienne de Laville-sur-Illon, comte de Lacépède avait
proposé dans ses Vues sur l'enseignement public (1790)
et qui avait eu un certain écho : un système distinguant
soigneusement les "productifs" et les "élites", un
enseignement n'ayant pour but que les activités
productives et l'enrichissement du pays. La gratuité du
primaire n'est pas vraiment décidée, mais envisagée
seulement.
La laïcité n'est pas une obligation et la religion demeure
matière d'enseignement. Les garçons sont surtout
concernés et l'on évoque simplement un "enseignement
domestique" pour les filles jusqu'à huit ans.
Les plans d'instruction publique de Mirabeau ou de
Daunou iront dans le même sens : une obligation scolaire
limitée au minimum lorsqu'elle est mentionnée, la
gratuité n'est pas non plus affirmée et l'éducation des
filles quasiment omise. D'ailleurs, Mirabeau, s'inspirant
de Rousseau, considère qu'hommes et femmes,
remplissant des fonctions différentes au sein de la
société, n'ont pas besoin du même enseignement.
L'administration est déléguée aux autorités locales et
dans tous les cas, on insiste sur une double formation :
- la première adaptée aux besoins sociaux, sachant que la
grande majorité du peuple est destinée à un travail ne
nécessitant que le peu de connaissances nécessaires pour
intégrer le "vaste atelier" social,
- la seconde civique et religieuse pour régénérer les
moeurs.
Il est intéressant de s'arrêter un instant sur la pensée de
94
Mirabeau, car il est l'auteur d'un double discours : celui
du philosophe et celui du pragmatique, ce qui n'est pas
sans saveur et préfigure (ou continue) la litanie des
déclarations démagogiques en matière d'éducation. Dans
un discours de 1791 (imprimé par Cabanis) De
l'instruction publique ou de l'organisation du corps
enseignant, Mirabeau (ou ses collaborateurs) définit ainsi
l'éducation "L'art de l'éducation n'est que celui de faire
prendre aux hommes les habitudes qui leur seront
nécessaires dans les circonstances auxquelles ils sont
appelés".
La formule est ambiguë, mais on comprend que suivant
la nature de la société l'éducation aura des caractères
différents et que surtout l' "homme" est plus objet que
sujet. Elle est conçue comme une force coercitive, un
moule qui, au nom de valeurs supérieures, permettra de
répondre aux impératifs d'utilité du moment et aussi de
confirmer les prédéterminations sociales. Les
circonstances et l'origine sont essentielles, pas l'enfant,
pas l'individu.
Il va ensuite paradoxalement opposer le passé révolu au
présent pour mieux définir l'avenir : "Tous les
législateurs anciens se sont servis de l'éducation publique
comme du moyen le plus propre à maintenir et à
propager leurs institutions. Quelques-uns d'entre eux ont
regardé la jeunesse comme le domaine de la patrie et
n'ont laissé aux pères et mères que la satisfaction d'avoir
produit des citoyens. C'est dans le premier âge qu'ils ont
voulu jeter les semences de la moisson sociale. Mais les
législateurs anciens cherchaient tous à donner à leurs
peuples une tournure particulière, et ne prétendaient
souvent à rien de moins qu'à les dénaturer, pour ainsi
dire, et à leur faire prendre des habitudes destructives de
95
toutes nos dispositions originelles."
Les premières remarques, qui font de l'éducation -
publique - l'arme privilégiée des États pour inféoder les
générations, sont suivies d'une vraie profession de foi
"libérale", un partisan déclaré du laisser-faire qui ne
surprend pas trop chez un homme de 1789. D'une part,
Mirabeau met en avant les "circonstances" auxquelles
les hommes sont "appelés" et d'autre part, il dénonce
ces états qui "dénaturent" leurs citoyens aux dépens de
"nos dispositions originelles". Le chaud et le froid ! Il
poursuit d'ailleurs avec une générosité étonnante ou
emporté par ses talents d'orateur : "Quant à vous,
messieurs, vous n'avez pas d'opinions favorites à
répandre ; vous n'avez aucune vue particulière à remplir ;
votre objet unique est de rendre à l'homme l'usage de
toutes ses facultés, de le faire jouir de tous ses droits, de
faire naître l'existence publique de toutes les existences
individuelles librement développées, et la volonté
générale de toutes les volontés privées. Il ne s'agit point
de faire contracter aux hommes certaines habitudes, mais
de leur laisser prendre toutes celles vers qui l'opinion
publique ou des goûts innocents les appelleront. Ainsi,
c'est peut-être un problème de savoir si les législateurs
français doivent s'occuper de l'éducation publique,
autrement que pour en protéger les progrès, et si la
constitution la plus favorable au développement du moi
humain, et les lois les plus propres à mettre chacun à sa
place, ne sont pas la seule éducation que le peuple doive
attendre d'eux."
La phrase centrale doit en particulier être relevée : "faire
naître l'existence publique de toutes les existences
individuelles librement développées, et la volonté
générale de toutes les volontés privées". Le disciple de
96
Rousseau ne peut manquer de rendre hommage à son
maître à penser. Il poursuit d'ailleurs en mettant en
question le rôle de l'État dans cette entreprise.
Selon Mirabeau, l'Assemblée nationale n'aurait en fait à
s'occuper de l'éducation que "pour l'enlever à des
pouvoirs ou à des corps qui peuvent en dépraver
l'influence", et pour la livrer ensuite à elle-même ; car,
dans une société bien ordonnée, "sans qu'on s'en mêle,
l'éducation sera bonne ; elle sera même d'autant
meilleure, qu'on aura plus laissé à faire à l'industrie des
maîtres et à l'émulation des élèves". Le voeu pieux d'un
philosophe libéral condamné à faire le grand écart entre
les principes d'utilité et de bonheur.
Cette finalité idéale dont rêve apparemment Mirabeau-
Janus est inscrite dans un futur lointain et le pragmatique
tribun revient sur son idée de départ : il faut tenir compte
des préjugés et des circonstances : "L'ignorance du
peuple est si profonde, l'habitude de regarder les
établissements pour l'instruction publique et gratuite
comme le plus grand bienfait des rois est si générale, et
les idées que j'énonce se trouvent si peu conformes à
l'opinion dominante, qu'en les supposant démontrées
dans la théorie, il serait sans doute dangereux, peut-être
même impossible, de les mettre en pratique sans de
grandes modifications."
Aussi Mirabeau effectue-t-il un rétablissement hardi :
l'intervention des pouvoirs publics dans l'éducation est
nécessaire pour que cette éducation se fasse d'après des
vues nationales : "Il convient que la volonté toutepuissante
de la nation forme partout des centres, soit par
les académies, soit par les écoles, d'où les lumières iront
se répandre au loin."
Après avoir refusé l'Éducation nationale au nom de la
97
liberté des individus, ce maître du double langage qu'est
Mirabeau prône tout de même une étape transitoire
illimitée, celle du rôle de l'État ! La synthèse entre les
aspirations du philosophe et le pragmatisme de l'homme
politique est osée, mais Mirabeau met en place un type de
discours qui se répétera jusqu'à nos jours : d'une part des
finalités généreuses et allant toutes dans le sens d'une
mise en exergue de l'individu et puis d'autre part
l'obstacle des réalités tout en faisant croire que l'utopie
humaniste, libertaire reste l'amer lointain vers lequel se
dirige le navire éducation forcé de louvoyer.
L'enfant au centre du système, déjà, dans les discours !
Le Comité d'instruction publique est nommé le 13
octobre 1792 et le 26 juin 1793, c'est Lakanal (1762-
1845) qui présente, au nom de ce Comité, le projet de
décret pour l'établissement de l'instruction nationale, qui
avait été préparé par Sieyès et Daunou. Il ne met plus à la
charge de la nation que les écoles primaires, auxquelles le
Comité enlève d'ailleurs ce nom — qui en effet n'aurait
plus eu de sens — pour les appeler "écoles nationales".
Ce projet fut repoussé par la Convention le 3 juillet, et,
sur la proposition de Robespierre, une Commission de six
membres fut alors chargée de préparer un nouveau projet
de décret sur l'éducation et l'instruction publique.
Lakanal fut élu membre de cette Commission des Six :
mais il n'y joua qu'un rôle de comparse. Les rapporteurs
de la Commission furent successivement Robespierre,
Romme et Léonard Bourdon.
Le 13 juillet 1793, Robespierre à son tour y allait de son
projet. Il rêvait de voir tous les garçons et les filles de 5 à
12 ans élevés en commun aux dépens de la République :
98
"mêmes vêtements, même nourriture, mêmes
professeurs, même instruction, mêmes soins".
Le travail manuel devait avoir une place importante et se
dérouler dans les maisons d'éducation nationale
surveillées par le conseil des pères. Des sanctions
devraient être prises contre les élèves qui n'atteindraient
pas la norme !
Les plus doués, après l'âge de 12 ans pourraient entrer
par concours au Lycée mais ce concours justement
marque les limites de la méritocratie à laquelle il songe :
la quasi-totalité des enfants auraient seulement le choix
entre des écoles secondaires ou l'apprentissage. L'enfant
devait ainsi être préparé à entrer au service de la
République menacée, les préoccupations premières de
Robespierre étant utilitaires, nationales et éventuellement
égalitaires.
Ce plan sera voté, mais son application reportée sur une
pétition de la Commune de Paris qui avait un contreprojet
basé sur l'acquisition de degrés moyens et
supérieurs d'instruction. Une simple querelle politique et
de préséance : les objectifs, quant à eux, étaient assez
semblables.
Le 5 septembre 1793, le régime dictatorial de "la
Terreur" est instauré.
Le calendrier républicain conçut par Romme et Fabre
d'Églantine est mis en place. Le 15 septembre, pour
départager la Commission des Six, la Convention décide
d'adjoindre trois autres membres dont Romme.
La Convention vote, en brumaire an II (octobre 1793),
divers décrets sur les écoles nationales justement
présentés par ce dernier au nom de la Commission
d'éducation nationale, constituant pour la première fois
99
une législation de l'instruction primaire qui, en
particulier, exclut les ecclésiastiques de l'enseignement.
Suite au discours de Chénier, qui n'est plus membre du
Comité d'instruction, la révision de ces décrets est
décidée. Romme, de nouveau choisi comme rapporteur
par le Comité d'instruction, fait lecture des révisions
effectuées par le Comité. Une commission nommée par
le Comité de salut public les rejette en bloc et présente un
nouveau projet : le plan Bouquier. Celui-ci est adopté le
29 frimaire an II (19 décembre 1793). Il proclame la
liberté d'enseignement. L'instruction serait gratuite et
obligatoire ; les instituteurs, fonctionnaires publics
salariés par la République à raison du nombre d'élèves.
Le programme de l'enseignement primaire se réduirait à
la lecture, à l'écriture, et aux premières règles de
l'arithmétique.
Gabriel Bouquier est né à Terrasson en 1739, dans une famille de
bonne bourgeoisie d'office, ami de Joseph Vernet et de Greuze,
puis de David, passionné de littérature et de poésie, de voyages et
d'archéologie, il était membre de l'Institut de Bologne et de
l'Académie des Arcades de Rome.
En mars 1789, il est un des principaux rédacteurs du cahier des
"plaintes, doléances et remontrances des habitants de Terrasson".
Députés de la Dordogne à la Convention, il fait partie de la
Montagne et vote la mort du roi. Il devient membre du Comité
d'instruction publique propose assez vite un nouveau "plan
d'instruction publique", dont l'impression est décidée. Il est
présenté à la Convention qui lui accorde la priorité sur d'autres
plans. Ce plan qui est probablement la synthèse de conversations
auxquelles Bouquier a participé se résume en ces quatre
dispositions principales : "L'enseignement est libre. — Il est fait
publiquement, sous la surveillance des autorités et des citoyens. —
Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'enseignement sont
salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui
fréquentent leurs écoles. — Ils sont tenus, pour le premier degré
d'instruction, de se conformer dans leur enseignement aux livres
100
élémentaires adoptés et publiés par la représentation nationale."
Bouquier succédera à Anacharsis Cloots à la présidence des
Jacobins pour une quinzaine.
Son jacobinisme le condamne ensuite au silence mais il n'est pas
proscrit après la Terreur commet la plupart des autres Montagnards
en vue. Sa candidature au Conseil des Cinq-Cents est un échec et il
se retire à Terrasson où il renoue avec un catholicisme
intransigeant.
La liberté de l'enseignement c'est d'abord pour ceux qui
la défendent, comme Chénier, le droit laissé au prêtre
d'exercer les fonctions d'instituteur. Prié de prendre la
porte, l'ecclésiastique rentre par les fenêtres ! Le projet
Romme en revanche, frappant d'ostracisme les ministres
des cultes, excluait par là même la religion de l'école. La
loi Bouquier établit une sorte d'équilibre précaire, elle
reste silencieuse sur ce point et rend tout possible. Les
questions idéologiques prennent le pas sur une réflexion
de fond concernant l'éducation des citoyens et l'avenir de
la République.
Certains députés songent pourtant aux instruments qui
institueraient une éducation nationale digne de ce nom.
Le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794), Grégoire, au nom
du Comité, présente un rapport sur un concours à ouvrir
pour la composition des livres élémentaires. Un jury est
formé en messidor, premier pas vers un contrôle des
contenus d'enseignement et de l'application de
programmes (encore à faire !) nationaux. L'examen des
divers manuscrits envoyés prend un temps considérable
et ne se termine qu'après la Convention ; ce sont alors les
Conseils législatifs institués par la Constitution de l'an III
qui ont à se prononcer. Sept ouvrages sont couronnés :
Les Éléments de grammaire française par Lhomond, la
Grammaire élémentaire et mécanique par Panckoucke,
101
des Éléments d'arithmétique avec des observations pour
les instituteurs, les Éléments d'histoire naturelle par
Millin, les Principes de la morale républicaine par La
Chabeaussière, le Portefeuille des enfants par Duchesne
et Le Blond et l'Art de la natation par Turquin et
Deligny.
Le 8 pluviôse (27 janvier 1794), Barère fait, au nom du
Comité de salut public, un rapport sur les idiomes
étrangers et l'enseignement de la langue française dont le
décret est adopté sans discussion. "Nous enseignerons le
français, dit-il, aux populations qui parlent le basbreton,
l'allemand, l'italien ou le basque, afin de les
mettre en état de comprendre les lois républicaines, et de
les rattacher à la cause de la Révolution". Le français
est la langue du progrès, il convient d'en faire bénéficier
- manu militari s'il le faut - toutes les minorités ! Le zèle
missionnaire n'est pas très éloigné et l'on reste dans la
droite ligne du Discours sur l'Universalité de la Langue
Française du "comte" Rivarol, premier prix ex-æquo
(et non sans difficulté !) de l'Académie de Berlin en
1784. Cependant, on remarquera que quand on veut faire
avant tout une nation, l'attention prêtée à l'individu, aux
particularismes baisse naturellement.
En bref, dans toute cette période, l'utile, oui ; le bonheur,
on n'y pense plus ou alors il découlerait simplement de
l'utile conçu comme l'adhésion totale aux principes
énoncés par le gouvernement révolutionnaire. Le citoyen
heureux est celui qui accomplit sa tâche, celui qui reste à
sa place, peut-on ajouter sans trop extrapoler. À la limite,
on pourrait dire que les théoriciens de l'État féodal ne
disaient pas autre chose : le noble payait l'impôt du sang
102
pour la défense commune, le roturier produisait les
richesses et les biens nécessaires à l'ensemble de la
communauté, l'ecclésiastique préparait l'au-delà pour
tous. Tout le monde était satisfait !
En outre, les législateurs des premières années de la
Révolution ne font qu'annoncer ce que les siècles
suivants mettront en pratique. L'éducation (l'instruction !
le terme se généralise) n'est pas là pour servir l'individu.
Au diable l'humanisme réactionnaire ! L'éducation doit
servir le pays et servir le pays se déclinera à chaque
génération un peu différemment au gré des évolutions
techniques et des théories économiques voilées par le
drapeau des vertus civiques et républicaines, par les
discours lénifiants ou héroïques, cache-misère permettant
de faire passer des vessies pour des lanternes à la
majorité. L'utilité se mesure au travail des campagnes,
puis de plus en plus au labeur en manufacture, puis en
usine, puis au sang répandu sur les champs de bataille,
puis…
Pourtant, certains esprits illuminés n'ont pas totalement
désarmé. Sous la Convention, Anacharsis Cloots, lui
aussi membre du Comité d'Instruction, se battra pour
faire exister sa République Universelle et des concepts
éducatifs qui vont dans le sens de cette ambition, celle de
la république universelle des individus, une république
respectueuse des différences et des cultures dont le défi
est de faire cohabiter les intérêts du genre humain, ceux
des diverses nations et ceux de chaque individu !
Condorcet (1741-1794), comme quelques autres encore
tiendra à l'idéologie de la transmission d'un savoir moins
directement conçu pour l'utilité du système que pour
l'émancipation de l'individu, ou plutôt parce qu'il est
103
persuadé qu'il faut changer le rapport habituel : c'est
cette émancipation des individus, leur harmonie qui
définira une vraie république, pas l'inverse ! Le vingt
avril 1792, il a présenté son Rapport et projet de décret
sur l'organisation générale de l'instruction publique.
Inutile d'entrer dans le détail d'une pensée très élaborée :
il suffit de retenir que ce projet est l'expression de la
philosophie de celui qui a écrit l'Esquisse d'un tableau
historique du progrès de l'espèce humaine. Condorcet
croit au perfectionnement constant et graduel de l'homme
et il est persuadé que l'école, si elle est ouverte à tous,
garçons et filles - et gratuitement -, est le meilleur
instrument de ce progrès. Développer les aptitudes
individuelles et perfectionner l'espèce humaine seraient
ses finalités. L'utile en étant l'évidente retombée.
Condorcet bouleverse les rapports si on le compare à
Talleyrand. L'homme, l'individu est la préoccupation
centrale, pas l'ouvrier, le producteur. Nullement utopiste,
il prône cette véritable libération parce qu'un de ses buts
est aussi d'accroître la rentabilité du travail, de rendre le
producteur plus souple face aux évolutions futures, de
pouvoir continuer sa formation tout au long de sa vie et
de faire de l'école le lieu où l'on apprend à apprendre… Il
pense enfin qu'il est essentiel de lutter contre les effets
délétères et sclérosants de la monotonie inévitable aux
générations condamnées aux mêmes tâches. Dans cette
perspective, il songe en outre à des activités culturelles, à
un enrichissement des loisirs…
Hélas ! Condorcet meurt, victime de la Terreur en 1794.
Son projet rejoint le paradis des beaux projets de tous les
temps remisés aux oubliettes ou réservés aux érudits
discoureurs : la Dîme de Vauban, le Cyrus de Ramsay, le
Projet de Paix perpétuelle de l'abbé Mably, l'Anti-
104
Machiavel, le Contrat Social, La République Universelle
d'Anacharsis,…tous trop parfaits, trop difficiles, trop
exigeants probablement pour devenir vérités humaines !
Ce plan de Condorcet sera repoussé, mais cependant
jamais oublié des esprits les plus sensibles. Le Peletier de
Saint Fargeau (1760-1793) s'en inspirera et tentera de
convaincre sans plus de succès, lui qui dans l'Acte
constitutionnel du 24 juin 1793 faisait écrire :
"La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès
de la raison publique et mettre l'instruction publique à la
portée de tous les citoyens".
S'inspirant également des idées de Condorcet, mais avec
une conception assez différente de l'Homme, Lavoisier
composa un petit traité intitulé Réflexions sur
l'instruction publique, "présentées à la Convention
nationale par le bureau de la consultation des Arts et
métiers", et imprimées par Dupont de Nemours vers
1793 :
"L'homme naît avec des sens et des facultés, écrivait-il
dans son préambule, mais il n'apporte avec lui en
naissant aucune idée : son cerveau est une table rase qui
n'a reçu aucune impression, mais qui est préparée pour
en recevoir."
Lavoisier proposait un enseignement laïc, orienté vers les
arts utiles et comportant quatre niveaux : écoles
primaires, secondaires, instituts nationaux, et lycées (les
équivalents des facultés) ; une société centrale des
sciences et des arts couronnerait le tout. Il revendiquait,
encore, l'importance du jeu comme vecteur éducatif, et
suggérait que l'éducation primaire suive la méthode
naturelle. Ce devoir de la société vis-à-vis de l'enfant
devait être gratuit. Il souhaitait, enfin, pour
l'enseignement secondaire une grande éducation
105
scientifique car "Une nation chez laquelle les sciences et
les arts languiraient dans un état de stagnation, serait
bientôt devancée par les nations ses rivales". Lavoisier
devait présenter ses Réflexions à la Convention, le 22
septembre 1793. Le vote, cinq jours auparavant, de la
"loi des suspects" provoquant la Terreur, remisa toute
idée d'instruction, même publique. Lavoisier n'avait plus
quelques mois à vivre.
*
La plupart des plans développés sous la Terreur essayent
de faire la synthèse entre une volonté explicite de
régénérer l'homme tout en préparant un citoyen au
service de la patrie par ses qualifications professionnelles
et défensives. Il y avait là une contradiction qu'on ne
pouvait résoudre qu'en considérant l'homme à la manière
de Lavoisier comme étant le produit exclusif d'une
culture, d'un apprentissage et en niant l'idée même de
qualités intrinsèques, toute chose qui allait contre le
mouvement des idées, la sensibilité qui, en dépit des
événements tragiques du temps, marquait les esprits
depuis plusieurs décades. Les problèmes idéologiques
soulevés étaient nombreux car, en peu de temps, il fallait
mettre à plat, sans toutefois tout désintégrer, un tissu
national nécessaire pour assurer la défense du pays dans
une situation particulièrement difficile. Comment alors
envisager la place de la religion, celle de la famille, celle
de l'individu ?
106
*Moins de théorie, plus de praxis (juillet 1794-novembre
1799).
L'épisode de la Terreur passé, la Révolution prend en
apparence un virage "pragmatique". En matière
d'éducation, on ressent le besoin de trancher, d'instituer.
On ajuste donc certains des projets présentés, on les
amende, on légifère en n'oubliant pas de garder le "ton"
patriotique des grands élans généreux d'un Condorcet par
exemple. Si la rupture n'est pas complète, on
"aménage" dans un sens plus directement pragmatique :
il est temps de remettre la France au travail…
Le décret du 17 novembre 1794 (27 brumaire 1794)
renoue avec certaines dispositions du plan Lakanal-
Daunou-Sieyès et chaque école se voit dotée de 2
sections, une pour chaque sexe. Les contenus
d'enseignement seront identiques, mais les filles auront
en plus des cours de travaux manuels (domestiques). Le
texte amendé sera adopté le 25 octobre 1795.
En outre, pour le premier degré (Loi Lakanal du 17
novembre 1794) : tous les jeunes citoyens doivent
apprendre à lire, écrire et compter. Il y aura une école par
canton ou par 1000 habitants. Les instituteurs seront
nommés par le peuple, agréés par un jury et rémunérés
par l'État.
Ces projets seront ramenés à des proportions plus
modestes le 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) par la loi
Daunou sur l'organisation de l'instruction publique, un
des derniers actes de la Convention : moins d'écoles
primaires au profit des écoles centrales, plus de gratuité.
Ces écoles centrales destinées à remplacer les anciens
collèges à raison d'une école par 300 000 habitants ou
107
une par département rural ont été créées par un décret du
25 février 1795 modifié ensuite par le titre II de la loi
Daunou. Elles fonctionneront dès 1796 mais pour une
période assez courte.
Cette loi revient sur l'obligation scolaire prévue par la loi
Bouquier du 29 frimaire an II. Elle instaure une
rétribution à la charge des familles des élèves, mais on
prévoit qu'un quart d'entre eux au maximum par
municipalité, considérés comme indigents, pourra être
exonéré. Les instituteurs se voient confier un local pour
la classe et le logement, mais sont payés par le produit de
l'écolage. La loi prévoit une école par canton au moins,
le canton étant à l'époque l'administration territoriale de
base. Les programmes du primaire se limitent à la
lecture, l'écriture, le calcul et la morale républicaine.
C'est le 22 août 1795 que Daunou et ses collaborateurs
du Comité d'éducation ont en effet rendu leur copie :
- 3 degrés sont prévus (les écoles primaire/les écoles
centrales/l'Institut National) auxquels doivent s'adjoindre
des écoles spéciales (anatomie, géométrie, mécanique...)
- On nomme un directeur de l'instruction publique, sorte
de ministre de l'Éducation avant l'heure, qui est,
précision intéressante, subordonné au ministre de
l'Intérieur !
- La liberté de l'enseignement est proclamée (mais l'on
sait ce que cela veut dire !).
En revanche, ne sont plus prévues ni la gratuité ni
l'obligation.
Cette loi Daunou est essentielle car elle résume en partie
le résultat des travaux du Comité d'instruction publique,
108
et reprend partiellement des dispositions législatives déjà
adoptées, mais sur certains points elle les complète ou les
contredit. Elle peut être considérée, par son plan et par
son contenu, comme la loi d'application du titre X,
consacré à l'instruction publique, de la Constitution de
l'an III, déjà adoptée le 1er vendémiaire an IV.
TITRE X - Instruction publique.
Article 296. - Il y a dans la République des écoles primaires où les
élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de
la morale. La République pourvoit aux frais de logement des
instituteurs préposés à ces écoles.
Article 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République, des
écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel,
qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
Article 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national
chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les
sciences.
Article 299. - Les divers établissements d'instruction publique
n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de
correspondance administrative.
Article 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements
particuliers d'éducation et d'instruction, et des sociétés libres pour
concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
Article 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la
fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la
patrie et aux lois.
109
La loi "Daunou"
L'article 1er prévoit de constituer une école centrale par
département, mais les articles 10 à 12 autorisent l'établissement
d'"écoles centrales secondaires" pour les villes qui ne sont pas
chef-lieu de département et qui disposent déjà d'un collège, à
condition que l'établissement soit financé par la commune.
L'enseignement y est divisé en trois sections (art. 2). Les élèves
sont admis dans la première à 12 ans, dans la deuxième à 14 et
dans la troisième à 16 (art. 3). À chacune de ces sections
correspond un enseignement dans un certain nombre de
disciplines. Pour la première, le dessin, l'histoire naturelle, les
langues anciennes et, dans certains cas et après autorisation, les
langues vivantes ; pour la seconde, les mathématiques, ainsi que la
physique et la chimie expérimentales ; pour la troisième la
grammaire, les belles-lettres, l'histoire et la législation.
Les professeurs seront choisis par un "jury d'instruction" (art. 5)
et sont révocables, mais le Directoire doit donner son accord pour
toute révocation (art. 6). Leur traitement fixe est celui d'un
administrateur de département (art. 7), mais ils perçoivent une part
de la rétribution scolaire payée par les familles à raison de 25
livres par an au maximum (art. 8).
L'article 4 oblige chaque école centrale à disposer d'une
bibliothèque ouverte au public, d'un jardin, d'un cabinet d'histoire
naturelle et d'un cabinet de sciences expérimentales (c'est-à-dire
d'un laboratoire).
Les écoles centrales se sont installées petit à petit. Dans de
nombreuses villes, les locaux de l'ancien collège ont été réutilisés
pour installer l'école. Pour constituer la bibliothèque, les
110
administrations ont regroupé les bibliothèques de district.
Dès juin 1797, on compte une centaine d'écoles centrales dont 68
sont en pleine activité.
À Paris, il est projeté d'établir cinq écoles centrales pour tenir
compte de l'importance de la population, mais trois seulement
verront le jour :
- l'école centrale de la rue Antoine, futur lycée Charlemagne ;
- l'école centrale du Panthéon, futur lycée Henri-IV ;
- l'école centrale des Quatre-Nations, qui occupe le palais du
même nom, aujourd'hui Institut de France.
Ces écoles centrales sont critiquées comme par l'enquête lancée en
1801 par le ministre de l'Intérieur Jean-Antoine Chaptal. On leur
reproche de ne pas tenir compte de l'enseignement primaire, de ne
pas proposer d'éducation morale et religieuse, d'offrir en revanche
une liberté jugée excessive aux élèves, qui sont censés progresser à
leur rythme et en effectuant des choix libres… Le choix des
méthodes est d'ailleurs laissé à l'appréciation des professeurs. Ce
libéralisme paraît outré à de nombreux observateurs et professeurs.
La réforme Daunou ne satisfait ni les partisans des acquis
révolutionnaires ni ceux du retour à l'ordre. Enfin, les écoles
centrales paraissent peut-être trop libertaires au goût du nouveau
régime. La loi Daunou reste en vigueur jusqu'à la loi du 11 floréal
an X (1er mai 1802) qui réorganisera encore une fois
l'enseignement : les écoles centrales les plus importantes seront
remplacées par des lycées d'État et les autres par des écoles
secondaires ou collèges, financés par les communes ou de manière
privée (par les familles).
Les bibliothèques des écoles centrales seront attribuées aux
communes par une décision du 28 janvier 1803 et formeront le
point de départ des bibliothèques municipales.
La Loi du 25 octobre 1795 marque une étape décisive sur
un autre plan car elle se soucie de la formation des
maîtres avec la création d'écoles normales à Paris et dans
les districts. Cependant, ces dernières n'ouvriront pas ou
seront jugées d'un niveau trop bas.
L'École Normale (dite "de l'an III" pour signifier que
son existence fut éphémère) qui avait été créée par la
111
Convention le 9 brumaire an III et avait ouvert ses cours,
un mois après l'École centrale des Travaux publics, en
pluviôse (janvier 1795) avait pour mission d'instruire des
instituteurs pour les futures écoles secondaires avec un
programme encyclopédique : sciences, histoire,
géographie, philosophie et grammaire. avaient été retenus
pour enseigner à l'École Normale. Les enseignants
étaient particulièrement brillants : Lagrange, Monge,
Berthollet, Laplace, Haüy, La Harpe, Bernardin de Saint-
Pierre etc. Très différente des autres "grandes écoles"
quant à ses objectifs et sa mission, l'École Normale
l'était aussi par son recrutement : des élèves de tout âge
(1400 environ), en général de plus de 25 ans, dont
certains étaient déjà dotés d'un fort bagage intellectuel.
Au printemps de 1795, à la fin d'un hiver rigoureux, les
émeutes et les soulèvements populaires de germinal et
prairial déclenchèrent une violente réaction antijacobine à
la Convention, ce qui précipita la fin des cours de l'École
Normale.
Pour compléter l'ensemble, au niveau de l'enseignement
supérieur doivent également être créées dix grandes
écoles, les "écoles spéciales" à visée supérieure et
professionnelle. Certaines resteront à l'état de projet,
comme l'École des antiquités ou l'École des sciences
politiques. En revanche on assiste à la création de l'École
centrale des travaux publics qui deviendra Polytechnique
(Fourcroy (1755-1809) a repris l'idée que des
représentants de la Montagne avaient en leur temps
lancée), de l'École Normale supérieure, de l'École de
Mars ou École militaire, du Conservatoire des Arts et
Métiers (à laquelle s'est attaché l'abbé Grégoire (1750-
1831), de l'École des langues orientales vivantes, de la
112
Bibliothèque Nationale, du Bureau des longitudes, de
l'École de santé, de l'Institut et des grandes écoles
techniques de la fin de l'Ancien Régime, qu'on rouvre
alors.
Le système mis en place fonctionne mal, la liberté de
l'enseignement permettant toutes les dérives. Il restera
cependant en vigueur jusqu'en 1802.
*
L'utopie d'une éducation démocratique permettant à
chacun de s'épanouir et de développer ses capacités n'est
plus du tout envisagée. Jusqu'alors on évoquait l'utile et
le bonheur ; désormais seul le premier terme paraît être
une finalité digne et le sens même de ce mot évolue :
l' "utile" n'est autre que ce que les débuts de
l'industrialisation et ses conséquences vont mettre en
place. Le pragmatisme des proclamations est patent.
Lakanal dira ainsi : "Il est bon, il est nécessaire que le
grand nombre de jeunes citoyens, sans aspirer à une
instruction plus étendue, se distribue, en quittant les
écoles primaires, dans les champs, dans les ateliers, dans
les magasins, sur vos navires, dans vos armées."
Rien de nouveau en fait. On retrouve la pensée d'un
Talleyrand sans les fioritures altruistes, qui ont fait leur
temps former des individus utiles à l'État et cet État n'est
ni une commune insurgée ni un pays en Révolution
cherchant à donner une nouvelle image de l'homme. La
France moderne vient d'accoucher et cherche à rattraper
les retards qu'elle a pu accumuler au cours des années de
bouleversements qu'elle a connus, pour devenir ou rester
une puissance, non seulement militaire mais aussi
économique. En gros, la récré est terminée, on se remet
113
au boulot, chacun à sa place, même si pour quelques
années encore, il flottera dans l'air des discours un peu de
cet idéalisme qui avait lancé les hommes à l'assaut des
bastilles, de quelque nature qu'elles soient. La
généralisation d'une éducation publique primaire fait son
chemin, mais moins en songeant aux individus qu'aux
défis annoncés par une révolution industrielle et
technologique déjà bien avancée en Angleterre par
exemple.
Le monopole napoléonien.
On connaît la fameuse déclaration des consuls au
lendemain du 18 brumaire : "La révolution est fixée aux
principes qui l'ont commencée ; elle est finie".
En matière d'éducation, ce fut particulièrement le cas.
Bonaparte, premier Consul, signe avec le pape le
Concordat le 16 juillet 1801 qui abolit la loi de 1795
séparant l'Église de l'État.
Chaptal, ministre de l'Intérieur, présente au Conseil
d'État un projet de loi sur l'instruction publique
ressemblant à l'ancien projet d'éducation nationale de
Lakanal (1793), mais qui n'est pas agréé.
Fourcroy, propose alors au Corps législatif, un nouveau
projet qui aboutira à la loi sur l'instruction publique du
11 floréal an X (1er mai 1802) qui vient transformer une
organisation scolaire qui satisfaisait peu :
114
- Des Écoles secondaires ou collèges sont créés,
- Les Lycées se substituent aux écoles centrales,
- On juge de l'état déplorable de l'enseignement primaire
et, toujours sans décréter ni obligation ni gratuité, on
cherche une échappatoire à ses difficultés (manque de
coordination, de programmes, de maîtres qualifiés, de
locaux adéquats…), on encourage alors les Frères des
Écoles Chrétiennes à prendre en charge ce type d'école !
Un retour en arrière ou le moyen d'effectuer une
transition bon marché. Les deux sans doute. Le signe
également que le primaire est sacrifié, ce qui veut dire
que la majorité des enfants est à nouveau confiée aux
bons soins des religieux, l'Église retrouvant une sorte de
légitimation.
On délègue aux communes les petites écoles prétextant
que les conseils municipaux sont les meilleurs juges des
intérêts locaux. Les instituteurs sont choisis par les
maires et les conseils municipaux. Leur traitement se
compose du logement fourni par les communes et d'une
rétribution payée par les parents, et déterminée par les
édiles. Les indigents sont exemptés de toute charge ; cette
exemption ne peut néanmoins excéder le cinquième des
enfants.
L'instruction des filles, que Lakanal avait constamment
mis au même rang que celle des garçons, est laissée de
côté.
Le 18 mai 1804, l'Empire est proclamé.
Devant le manque d'enseignants, on se tourne de plus en
plus, pour le primaire, vers les congrégations, décimées à
la Révolution. L'intérêt impérial est d'ailleurs davantage
115
tourné vers le couronnement du système scolaire :
l'enseignement supérieur et une université dignes des
temps nouveaux et surtout colonnes inébranlables du
régime.
Fourcroy, directeur général de l'Instruction publique, est
le maître d'oeuvre des différents textes législatifs et
réglementaires.
Le décret-loi qui fonde l'Université est adopté le 10 mai
1806.
Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un
corps chargé exclusivement de l'enseignement et de
l'éducation publique dans tout l'empire, et que les
membres du corps enseignant contracteraient des
obligations civiles, spéciales et temporaires.
Après son adoption Napoléon donne de nouvelles
instructions à Fourcroy pour son organisation.
Le décret impérial portant sur l'organisation de
l'Université est promulgué le 17 mars 1808 et précise son
profil (organisation administrative, statut du personnel,
fonctionnement pédagogique). Nous sommes loin des
idées généreuses des hommes de l'an II voire d'un
marquis de Condorcet : l'université est conçue comme
devant être un des rouages essentiels de l'empire.
Aucune école ne peut être créée hors de l'Université.
Mais en réalité, les écoles primaires ne sont pas vraiment
concernées, ne formant pas un corps d'État. Les Frères
des Écoles chrétiennes dont les statuts sont approuvés par
arrêté le 4 août 1810, resteront en dehors de ces
prescriptions, tout en étant soumis à contrôle.
L'Université est régie et gouvernée par un grand-maître.
Chaque académie est gouvernée par un recteur résidant
116
au chef-lieu des académies. Portalis, ministre des cultes,
se fait le porte- parole de tous les revanchards qui
réclament le retour de l'Église en matière d'éducation :
Les enfants sont livrés à l'oisiveté la plus dangereuse, au
vagabondage le plus alarmant. Ils sont sans idée de la
Divinité, sans notion du juste et de l'injuste. De là des
moeurs farouches et barbares; de là un peuple féroce ! Si
l'on compare ce qu'est l'instruction à ce qu'elle devrait
être, on ne peut s'empêcher de gémir sur le sort qui
menace les générations futures... Ainsi, toute la France
appelle la religion au secours de la morale et de la
société.
Napoléon écoute d'autant plus son ministre qu'il désire
faire aussi de la religion une alliée au service de son
pouvoir. Il écarte Fourcroy, l'ancien conventionnel, de la
grande maîtrise de l'Université au profit de l'onctueux
Louis de Fontanes très lié au clergé et aux milieux
catholiques. Celui-ci réorganise entièrement le système
scolaire français et crée les postes d'inspecteurs
généraux.
Décret du 17 mars 1808.
Organisation générale de l'Université.
Art. 1er- L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié
exclusivement à L'Université.
2 - Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction,
ne peut être formé hors de l'Université Impériale, et sans
l'autorisation de son chef.
3 - Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être
117
membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses
facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des
archevêques et évêques, chacun dans son diocèse…
4 - L'Université impériale sera composée d'autant d'académies
qu'il y a de cours d'appel.
5 - Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans
l'ordre suivant :
1° Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des
grades ;
2° Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique,
la logique, et les élémens (sic) des sciences mathématiques et
physiques ;
3o Les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments
des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des
sciences ;
4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers,
où l'enseignement se rapproche de celui des collèges ;
5° Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres
particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des
institutions ;
6° Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à
lire, à écrire, et les premières notions du calcul.
Notons bien : "autant d'académies qu'il y a de cours
d'appel" et l'accent mis sur les lycées (au second rang)
alors que les écoles primaires sont citées en dernier !
On compte 37 lycées en 1808.
Quelques rares élèves bénéficient de bourses (familles
indigentes), mais la majorité des lycéens appartient aux
couches sociales les moins défavorisées car, non
seulement les candidats au lycée doivent avoir 9 ans,
savoir lire et écrire, être recommandés, ils ont aussi une
rétribution à payer.
Le latin reste à la base de l'enseignement, mais un intérêt
118
marqué pour les mathématiques et les sciences
commence à se manifester.
Après 5-6 ans de lycée, l'élève peut s'orienter vers les
écoles spéciales
Fourcroy avait ainsi projeté de créer 10 écoles de Droit, 3
de médecine, 4 d'histoire naturelle, physique et chimie, 2
d'arts mécaniques, 1 de mathématiques, 1 d'histoire,
géographie, économie politique, 1 de dessin, 1 école
militaire spéciale (toutes ne verront pas le jour).
Malgré l'appel fait aux Frères des écoles chrétiennes, et
la présence d'institutions et de pensionnats privés le
monopole étatique est évident : préfets et sous-préfets
organisent et surveillent le primaire (choix des
inspecteurs généraux, des directeurs) ; les proviseurs de
lycée sont soumis au même contrôle :
- Impossibilité d'ouvrir un établissement scolaire sans
autorisation.
- Contrôle commun au public et au privé.
- La religion chrétienne reste prépondérante.
- Recteurs, inspecteurs d'académie, dépendent du
Grand Maître de l'université.
- Les Lycées dépendent de l'État ; les écoles
secondaires ou collèges des communes.
On est également plus sévère sur le recrutement des
enseignants Pour enseigner il faut posséder le
baccalauréat, la licence ou le doctorat conférés par la
Faculté. Le corps des agrégés, supprimé sous la
Révolution est rétabli en 1808 et devient le cadre d'élite
auquel on accède par concours.
Le primaire, quasiment rétrocédé à l'enseignement privé
confessionnel, intéresse peu : la majorité des élèves
119
n'aura pas accès au secondaire, un enseignement minimal
leur suffira, la religion pourvoyant au reste !
Cette création de l'Université impériale n'a cependant
réglé en rien la question de la concurrence entre
établissements publics et institutions privées qui, bien
que soumises à l'Université, avaient conservé une grande
part d'autonomie et Napoléon décide alors d'une enquête
auprès des préfets confiée à Savary, le ministre de la
police, pour prendre la mesure de la concurrence que font
aux lycées ces institutions privées, particulièrement les
écoles secondaires ecclésiastiques. Tout cela s'effectue
dans un climat de tension extrême avec le Saint-Siège
puisque Pie VII a été placé à Savone en résidence
surveillée, et que les catholiques doivent subir des
mesures coercitives. Savary demande aux préfets de
surveiller le choix des textes pour en déduire
l'attachement ou l'opposition du maître à l'État, de voir
comment l'histoire de la famille régnante est traitée…
L'Église n'apparaît plus, en dehors du primaire, comme
le soutien de l'État mais comme un adversaire possible,
qu'il faut préserver en le muselant.
À la suite de cette enquête, on décide, en 1810, de
renforcer l'importance des lycées en augmentant leur
nombre et les effectifs tout en limitant le nombre des
écoles secondaires confessionnelles. Le décret
d'application est signé le 15 novembre 1811. Il ne doit en
outre plus exister qu'un petit séminaire par département.
Pour revenir à l'enseignement primaire, après avoir laissé
se développer les congrégations religieuses enseignantes,
à l'image de la congrégation des Frères des Écoles
chrétiennes, l'État constate en 1811 que le nombre de
120
frères de cette dernière institution s'élève à 274, répartis
dans 42 maisons et il paraît urgent que leur contrôle soit
plus intensif. On encourage ainsi les instituteurs laïcs à
prendre leur autonomie par rapport au clergé, par
exemple en acceptant la charge de secrétaire de mairie
plutôt que celle de sacristain.
L'enseignement féminin conserve son autonomie et sa
fragilité sous l'Empire. Si ce n'est quand il encourage la
création des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
l'Empire s'en préoccupe peu. Pourtant, bien qu'en retrait
par rapport à celui des garçons, l'enseignement primaire
des filles se développe, grâce en particulier à l'essor des
congrégations féminines que l'État a encouragé. Cette
instruction a pour finalité de former de bonnes mères de
famille. Les jeunes filles n'ont cependant accès ni aux
lycées ni à l'enseignement supérieur ni à aucune des
écoles spéciales, réservés à l'élite des lycéens.
L'Université napoléonienne se soucie assez peu d'une
École qui apporterait à chacun les mêmes chances et qui
aurait pour premier but de concourir au développement
de l'individu. L'Empire a besoin de cadres, d'ouvriers, de
militaires et plus encore de "sujets" soumis, ce qui
explique son intérêt pour la rénovation du système
scolaire, mais aussi, après avoir cru en profiter et avoir
ainsi calmé les esprits religieux, son attitude vis-à-vis des
congrégations. L'empereur ne veut surtout pas voir se
reconstituer la puissance de l'Église, une sorte d'État
dans l'État, mais en même temps, il désire conserver un
allié soumis et contrôlé, qui prend en charge une grande
part du parent pauvre de l'enseignement : le primaire, en
veillant à une éducation morale et religieuse garante
121
d'obéissance.
.
Après l'Empire.
En matière d'enseignement primaire, on assiste au début
de l'enseignement mutuel dont on copie les
développements en Angleterre, à l'incitation des milieux
libéraux (enseignement mutuel de Bell et Lancaster dont
les traités sont adaptés dès la fin de l'Empire : Plan
d'éducation pour les enfants pauvres d'après les deux
méthodes combinées du Dr. Bell et de M. Lancaster, la
fameuse méthode Jacotot sous la Restauration). Le
monde de l'industrie anglo-saxon a découvert depuis
longtemps la valeur économique et sociale de
l'instruction populaire et certains esprits "ouverts" en
France pensent de même. Lazare Carnot prônera ainsi
l'éducation du peuple: "pour les intérêts de la
civilisation, pour ceux des bonnes moeurs et de l'ordre
public, pour ceux de la liberté, pour ceux enfin de
l'industrie agricole et manufacturière."
On ne pense plus du tout au bonheur de l'individu, mais
définitivement aux "intérêts de la civilisation", intérêts
supérieurs bien entendu et qui sont aisés à définir ! Le
bonheur pour la majorité sera dans une autre vie.
L'eschatologie expliquée au peuple justifie tout !
Ces préoccupations ont été clairement exprimées dans les
statuts de L'école mutuelle.
122
Son introduction en 1816 répondait à un triple objectif :
- économique, car la méthode n'exige que peu de
dépenses,
- social, car elle fournira la main-d'oeuvre qualifiée
nécessaire en ces premiers temps de l'ère industrielle,
- politique puisque les promoteurs de ce type
d'enseignement veulent comme sous l'Empire - assurer
la mainmise de l'État sur le système scolaire. La méthode
mutuelle est aussi une réplique à la méthode simultanée
mise en place par les Frères des écoles chrétiennes et elle
sera partiellement utilisée dans les salles d'asile qui
apparaîtront bientôt et sur lesquelles nous reviendrons.
Sur l'école mutuelle on se reportera à l'excellent livre d'Anne
Quérien, L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace ? Éd. Les
empêcheurs de penser en rond, qui en retrace l'histoire, une
histoire que l'école de la République ignore étrangement. L'école
mutuelle avait été créée pour les déshérités, le but étant de sortir
les enfants de la rue et de leur donner un savoir minimal conforme
à leur classe sociale : lire, écrire, compter, un objectif certes
discutable à nos yeux puisqu'il cloisonne apparemment les classes
sociales, mais il faut replacer ces tentatives dans leur contexte
historique. D'ailleurs, plusieurs intellectuels socialistes du XIXe
siècle - comme Proudhon - lui doivent leur essor ! En gros, le
nombre d'enfants par classe est important (économie de
personnel !), les élèves travaillent en groupes : ceux qui ont
compris expliquent aux autres. Tour à tour, chacun est élève et
"maître". Les différences de niveau ne sont plus un obstacle au
bon fonctionnement mais en deviennent le moteur. Cette école a
été rejetée pour deux raisons principales : les élèves apprenaient en
trois ans le curriculum prévu pour six et on prétendait qu'ils
n'apprenaient pas le respect du savoir ! On comprend que - en
dehors de considérations idéologiques - l'idée à la base de cette
méthode n'ait pas trouvé grâce auprès du corps enseignant, dont le
rôle, le savoir et la caste étaient menacés ! Si aujourd'hui, on parle
peu de cette méthode dans les IUFM, c'est pour les mêmes raisons
corporatistes et parce que le "maître" (la voix de son maître) est
123
encore le garant des droits du système, alors qu'il y a là une voie
intéressante pour "déscolariser l'école" si l'on ne se contente pas
d'y voir le moyen d'assigner chacun à sa place en fonction de ses
origines et/ou des besoins économiques.
Selon Anne Quérien, la méthode simultanée des Frères des écoles
présente pour sa part les caractéristiques suivantes, qui la
distinguent de la méthode mutuelle :
L'enseignant a un rôle d'autorité exclusif
Le maître indique ce qu'il faut lire, écrire, compter
Les tâches du maître ne sont pas cantonnées à l'organisation et à
la surveillance
Le maître corrige sur des cahiers de devoirs
Il n'y a pas d'autocorrection systématique et exclusive
La discipline est imposée et l'autorité non partagée
Une surveillance constante est recommandée, et favorisée par
l'architecture
L'enseignement est uniforme, les programmes sont normalisés
Les élèves ont même maître, même livre, même leçon, même
correction
Les élèves ont une place fixe, dans une classe déterminée par le
niveau scolaire
L'architecture et le fonctionnement sont normalisés
L'homogénéité des élèves (âge, aptitudes) est un facteur
d'efficacité
Le silence et l'immobilité sont requis avec insistance
Le nombre maximal d'enfants par enseignant est plutôt limité
Le niveau individuel ne coïncide pas nécessairement avec le
niveau du groupe
L'attention spontanée de l'élève est peu ou pas courante
L'apprentissage est fondé sur l'effort, l'enfant quitte la classe sans
regret
L'élève apprend l'obéissance pour travailler, non pour commander
La soumission à l'autorité du maître est un facteur d'efficacité.
En bref : l'esprit contestataire et militant, la solidarité
qu'encourage l'enseignement mutuel est systématiquement
supprimé. Le désir de travailler par obéissance subsiste presque
seul. Le collectif est mis sous surveillance, la coopération
quasiment impossible, les comportements uniformisés. On
comprend l'intérêt qu'y porte l'état bourgeois !
124
En 1820-1830 l'introduction progressive du machinisme
et l'industrialisation entraînent en effet la division et la
déqualification du travail traditionnel. Pour favoriser le
progrès industriel, il est alors nécessaire de former une
classe ouvrière susceptible de s'adapter aux évolutions de
cette industrie nouvelle. Les cours du soir fleurissent
alors. La formation professionnelle est cependant d'abord
moins technique qu'idéologique. La finalité réelle est de
contrôler et mettre au pas les travailleurs : enfants comme
adultes, une "mise au pas" qui avait été pendant des
siècles la mission de l'Église et que, face à cette alliée
désormais souvent indocile, on préférait "laïciser". Bien
entendu, tous ces jeunes gens, ces intellectuels comme le
poète breton Brizeux dont on admire alors le poème
Marie, qui donnent généreusement des cours du soir aux
ouvriers, le font par idéalisme et désir d'enrichir
l'homme, d'accélérer le progrès social, mais ils ne sont
pourtant que les instruments d'un système qui les dépasse
et a d'autres visées !
Un catholicisme social a toujours été une composante plus ou
moins importante de l'Église. Claude Fauchet, sous la Révolution,
en a été un des représentants. Après l'Empire, les milieux opposés
au libéralisme politique et économique et certains milieux
progressistes, attachés à la démocratie, lui redonnent un nouvel
élan. Les premiers considèrent que le "libéralisme économique"
est issu de la Révolution et que la situation de pauvreté dans
laquelle se trouvent les ouvriers est le résultat de l'abolition des
corporations. Leur premier réflexe est d'appliquer les principes de
la charité, qui peut alors prendre les formes du paternalisme, tout
en rêvant d'un monde où chacun aurait sa place, serait conscient de
ses devoirs envers l'autre dans une société harmonieuse et fixée
sous les auspices d'une solidarité revivifiée par la religion. Les
seconds tentent de développer un socialisme chrétien qui, s'il
125
s'oppose moins nettement au libéralisme économique, refuse
l'exploitation - telle qu'elle se pratique - des individus. Félicité de
Lamennais (1782-1854), Philippe Buchez (1796-1865), Henri
Lacordaire (1802-1861) puis Frédéric Ozanam (1813-1853) ou
Charles de Montalembert (1810-1870) en sont les représentants les
plus éminents.
Entre l'État qui encourage l'école mutuelle jusqu'en
1840 et le mouvement ouvrier naissant, il existe
d'ailleurs une convergence de vues sur le mutualisme
scolaire : le premier parce qu'il y voit le moyen
d'éduquer un grand nombre d'enfants à peu de frais dans
le sens des besoins du développement industriel, le
second parce qu'il est idéologiquement séduit par le
mutualisme social. Cependant, dans les deux cas, le
travail est considéré comme la valeur essentielle (le
mouvement révolutionnaire de 1848 se structurera autour
de la revendication du travail pour tous) ce qui se
comprend quand un important prolétariat urbain ou rural
n'a pour toute ressource que la force de ses bras, mais
cette réalité se mêle d'une mythification du travail, le
moyen de vivre devenant quasiment l'essence de
l'individu, sa justification sociale (quand il n'appartient
pas aux "nantis" !). Une aristocratie ouvrière formée
des plus qualifiés de ses membres, participe de cette
mythification que les patrons, l'Église et l'État
encouragent, une nouvelle aristocratie qui écrit, fréquente
les écrivains et les penseurs comme Agricol Perdiguier,
Avignonnais-la-Vertu, l'auteur des Mémoires d'un
compagnon et l'ami de George Sand, une minorité qui
donne l'impression que l'école permet à chacun d'avoir
au fond de sa musette son bâton de maréchal… comme
si devenir maréchal était la finalité de l'enseignement !
126
L'ensemble de ces mouvements se fait toutefois dans le
cadre d'une certaine peur de la bourgeoisie qui voit à la
fois dans l'école une nécessité pour l'industrie qui se
développe, un danger dans la mesure où l'accession à un
certain degré de culture menace son pré carré, sans parler
d'une dépense insupportable.
De 1815 à 1830, la révolution industrielle poursuit donc
ces tendances et induit une réflexion sur l'éducation qui,
d'une part, la "professionnalise" : il convient de
préparer les individus à leur rôle social de futurs
producteurs (on ne parle pas encore de consommateurs,
mais cela viendra vite) et de sélectionner ceux qui seront
les cadres de la nation. D'autre part, des médecins
intéressés à l'enfance déficiente comme les docteurs
Itard, Seguin se préoccupent aussi d'éducation dans une
perspective hygiéniste et rejoignent ceux qui clament,
pour toutes sortes de raisons (humanistes, sociales,
sécuritaires…) la nécessité de faire garder les enfants des
cohortes de parents enfermés douze heures dans les
usines.
Dans les pays allemands (particulièrement de confession
luthérienne) certains pasteurs et pédagogues prennent très tôt en
compte la petite enfance. En France, à la fin du XVIIIE SIÈCLE, sous
l'influence de Rousseau et de Pestalozzi, des initiatives privées
comme celle du pasteur Jean-Frédéric Oberlin qui ouvre dès 1771
une "école de tricots" dans les Vosges, accueillent les tout petits.
Mais ce type d'établissement (Oberlin implique des préoccupations
pédagogiques) est rare, la plupart ne sont au mieux que des
garderies ("salles d'accueil") qui se multiplieront avec la
révolution industrielle. Leurs promoteurs (souvent des
bourgeoises) désirent offrir un lieu de protection aux enfants dont
les parents travaillent pour les soustraire à la rue. Ce type de refuge
est appelé salle d'asile ou salle d'hospitalité à l'exemple de celle
fondée par Adélaïde Piscatory de Vaufreland, marquise de Pastoret
dès 1801, et les préoccupations sont d'abord sociales, hygiénistes,
127
charitables et morales. Le modèle des infant schools du Royaume-
Uni inspire de nombreuses âmes charitables sous la Restauration.
L'une d'elle, Émilie Oberkampf, se dépensera sans compter pour
les premières salles d'asile parisiennes et la formation des
éducatrices en amont, car on veut aller plus loin que le simple
gardiennage. En 1836, ces salles, qui se sont multipliées sous une
forme ou sous une autre (voir plus bas) sont rattachées au ministère
de l'Instruction publique La loi Falloux marque le premier pas vers
leur intégration dans le système scolaire. Elles reçoivent une
impulsion décisive grâce à Marie Pape-Carpantier et prennent le
nom d'écoles maternelles, d'abord le 28 avril 1848, puis le
deviennent officiellement en 1881 sous l'autorité de Pauline
Kergomard, première inspectrice générale du maternel. Celle-ci
s'oppose à la tendance majoritaire qui veut faire de ces écoles des
lieux d'instruction à part entière, voulant plutôt favoriser le
"développement naturel" de l'enfant, en faire de véritables lieux
d'éveil ce qui n'ira pas toujours dans le sens des ministres de la
République dont elle dépendra !
Les libéraux et socialistes prônent pour leur part une
éducation intégrale (Proudhon, Fourier, Saint-Simon ou
Marx), mais, à de rares essais près, ils en restent à la
théorie et ne font pas… école. Marqués par l'esprit des
Lumières, le principe de l'utilité sociale demeure chez
eux central et cette tendance occulte le principe d'un
développement personnalisé de l'individu.
Ainsi, Saint Simon (mort en 1825) accorde une grande
importance à l'éducation, mais pour lui, le savoir est une
conséquence directe du développement de la production.
Il imagine une société fondée sur les sciences, possédant
un système éducatif centralisé et obligatoire. Il distingue
l'éducation et l'instruction, accordant sa préférence à la
première : "c'est l'éducation proprement dite qui forme
les habitudes, qui développe les sentiments, qui épanouit
la capacité en prévoyance générale, c'est elle qui
apprend à chacun à faire application des principes et à
128
s'en servir comme de guides certains pour diriger sa
conduite."
Pour lui, prenant l'exemple de la Russie, il est évident
que des prolétaires français ne sachant ni lire ni écrire
mais ayant reçu l'éducation qu'il prône, seront davantage
capables de travailler utilement que des moujiks auxquels
leur propriétaire aura fait apprendre à lire et écrire. En
effet, ces prolétaires français "sont en état de bien
administrer une propriété ; ceux qui sont attachés à la
culture sont capables de diriger des travaux de ce genre ;
il en est de même pour ceux qui sont attachés à des
travaux d'arts et métiers : tandis que les Russes, à qui on
aura enseigné la lecture et l'écriture, n'auront reçu de
leurs parents qu'une éducation semblable à celle que
ceux-ci avaient reçue eux-mêmes, c'est-à-dire une
éducation très mauvaise ; et si vous essayez de confier
l'administration d'une propriété quelconque à ces
Russes sachant lire et écrire, vous verrez ces propriétés
dépérir dans leurs mains."
À son avis, l'éducation et l'instruction publique doivent
assurer la "propagation des connaissances". Le jeune
doit apprendre à lire, compter, écrire, dessiner, faire de la
musique et cette éducation ne doit plus dépendre de
l'Église. Saint Simon est enthousiasmé par la jeunesse
populaire qu'il idéalise et qui est "avide d'instruction
bien plus que les oisifs de nos salons." Il s'intéresse de
près à toute la jeunesse, qu'il divise entre trois groupes.
D'abord l'enfant, de 0 à 7 ans, puis l'adolescent de 7 à 14
ans, âge où les passions "s'enflamment dans l'individu,
en même temps qu'il acquiert la faculté de produire son
semblable" ; enfin, le jeune homme, de 14 à 21 ans qui
doit devenir immédiatement utile à la société, mais il
s'agit de la société dont il rêve !
129
*
Sur le plan du déroulement de la politique scolaire,
pendant cette période, on conserve globalement l'héritage
institutionnel napoléonien. Un évêque sera même Grand
Maître de l'Université (Frayssinous).
En bref, sous la Restauration, les partisans modérés de
Decazes soutiennent les projets de la Société pour les
progrès de l'instruction élémentaire (Journal
d'éducation).
On institue certes un brevet de capacité pour les
instituteurs, mais ils sont inspectés par les curés et des
subventions sont accordées aux écoles élémentaires
Avec les Ultras et Villèle (1820-1828) on redonne des
avantages aux congrégations et le mouvement du
primaire stagne.
Avec Martignac et les modérés (1828-1829) se poursuit
le développement de l'éducation mutuelle et surtout les
salles d'asile sous une nouvelle forme.
En effet, en 1826 Jean-Marie-Denys Cochin (1789-1841)
tout récent maire du XIIe arrondissement, est frappé par
la pauvreté et l'abandon de beaucoup d'enfants en bas
âge, délaissés par leurs parents par misère, paresse ou
parce qu'ils doivent travailler. Il reprend alors l'idée tant
de fois abandonnée des salles d'asile et réunit des petits
indigents dans deux pièces qu'il loue rue des Gobelins. Il
s'occupe lui-même de ces enfants, imagine et développe
une méthode appropriée à leur âge, et la transmet à ceux
dont il veut faire des maîtres. Son exemple devait vite
faire des émules. À la même époque, par exemple,
comme nous l'avons indiqué, en 1828, Émilie
Oberkampf, fait ouvrir une salle d'asile parisienne.
130
Encouragé par ses résultats et l'écho qu'il en recevait,
Cochin décide pour sa part de fonder un établissement
qui servirait de préparation à l'école primaire. Son
Manuel des salles d'asile (publié en 1833) couronné par
l'Académie française comme le meilleur livre publié
dans l'année est consacré à ce projet : "C'est pour
suppléer, écrit-il, aux soins, aux impressions, aux
enseignements que chaque enfant devrait recevoir de la
présence, de l'exemple et des paroles de sa mère, qu'il a
paru nécessaire d'ouvrir des salles d'hospitalité et
d'éducation en faveur du premier âge."
Il sollicite Mme Millet, l'épouse du peintre Frédéric
Millet, dont il a fait la connaissance et qui s'intéresse à
ses travaux pour se rendre en Angleterre où, elle passe
deux mois à visiter les écoles et à étudier l'organisation
des Infants schools. À son retour, elle ouvre un premier
asile rue des Martyrs qui annonce par certains aspects les
futures écoles maternelles. Parallèlement, Cochin ne
relâche pas ses efforts et peaufine son projet d'une "
maison complète d'éducation primaire" dont la salle
d'asile telle qu'il l'imagine sera à la fois le point de
départ et la structure de base, le fondement.
Cependant, ce plan proposé au préfet de la Seine, est
considéré comme impraticable, mais on ne manque pas
de saluer le rêve d'un homme de bien !
Ce refus ne le décourage pas et, en quelques mois, il met
en place un établissement susceptible d'accueillir plus
d'un millier d'élèves tout en offrant quatre logements
destinés aux maîtres. Une École normale, des salles
d'asile, dirigées par Mme Millet, complètent le dispositif.
Le succès est immédiat et conduira l'administration
municipale à le solliciter pour devenir propriétaire de
l'établissement et lui succéder (début 1831). Voyant dans
131
cette demande le fruit de ses efforts et les prémisses d'un
élargissement national, il donne son accord et n'accepte
qu'un dédommagement dérisoire. Dès le 22 mars 1831,
par ordonnance royale, son nom sera donné à
l'établissement. L'État relayait en quelque sorte la
reconnaissance publique.
En 1836, ces salles, qui se sont multipliées sous une
forme ou sous une autre, seront rattachées au ministère de
l'Instruction publique La loi Falloux marquera le premier
pas vers leur intégration dans le système scolaire. Elles
recevront une impulsion décisive grâce à Marie Pape-
Carpantier (qui sera révoquée en 1874 pour librepensée
!) et prennent le nom d'écoles maternelles,
d'abord le 28 avril 1848 et pour une courte période, puis,
officiellement et durablement, en 1881, sous l'autorité de
Pauline Kergomard, première inspectrice générale du
maternel.
Toute cette action s'inscrit globalement dans le cadre des
préoccupations charitables, caritatives de la société
bourgeoise du temps. Les préoccupations pédagogiques,
l'idée d'un développement harmonieux des individus ne
sont certes pas totalement absentes des préoccupations
des initiateurs, mais on souhaite en premier lieu juguler
la misère, permettre à des enfants autrement condamnés à
grossir les rangs d'un prolétariat misérable et en
définitive dangereux - moralement, économiquement,
politiquement - d'acquérir le minimum d'éducation qui
permettra d'en faire d'honnêtes travailleurs.
132
Libéraux et clergé réclament la liberté de
l'enseignement ; la République nous
appelle…
François Guizot (1787-1874) est ministre de l'Instruction
publique de 1832 à 1837. La loi qu'il fait passer, du 28
juin 1833 marque une étape importante : libre ouverture
d'écoles à ceux qui ont les titres, action concertée de
l'Église et de l'État pour une école moralisant et
consolidant le nouvel ordre économique et social tout en
favorisant l'essor économique.
- Chaque commune de plus de 500 habitants doit avoir
et entretenir une école primaire de garçons puis de
filles.
- Création d'écoles primaires supérieures dans les
chefs-lieux ou dans chaque ville de plus de 6000
habitants.
- Création d'Écoles normales
- Inspection primaire décrétée dès 1835. Les salles
d'asile (maternelles) sont officialisées en 1836. Des
cours d'adultes et des écoles pour filles non
obligatoires sont conseillés la même année.
- Le ministre lance un dispositif centralisé de direction
et d'administration de l'institution primaire. Son
collaborateur, Paul Lorain, parvient à réconcilier les
anticléricaux avec la méthode simultanée, ce qui
133
marque la fin de l'enseignement mutuel et des
potentialités libertaires qui pouvaient y être liées.
1848 voit une victoire à la Pyrrhus des Républicains : la
loi Guizot est modifiée dans le sens de la gratuité et de la
laïcité avec la liberté de l'Enseignement. La bourgeoisie
libérale effrayée par les événements et la montée des
idéaux révolutionnaires comme en témoigne par exemple
l'Association fraternelle des instituteurs socialistes, fait
voter la loi Falloux (1850), (liberté de l'enseignement
secondaire, fin des EPS, et la loi Parieu même année
contre les instituteurs propagandistes de la République).
Thiers, le futur contempteur de la Commune, écrit alors :
"Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup
plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte beaucoup
sur lui pour propager cette bonne philosophie qui
apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir".
Le travail ne doit pas être une partie de plaisir, la vie non
plus. L'école fera profit de ces hautes pensées, l'école
primaire particulièrement !
Profession de foi de l'Association fraternelle des instituteurs,
institutrices et professeurs socialistes - 1849 - Gustave
Lefrançais, Pauline Roland, Pérot
"En présence de Dieu et de l'Humanité, nous, démocrates
socialistes, nous associons dans le but de faire participer aux
bienfaits d'une éducation républicaine tous les enfants et tous les
adultes, hommes et femmes, qui pourront profiter de cette
éducation. [...]
Nous croyons de tout notre esprit, de tout notre coeur, de toutes nos
forces, en Dieu, principe de toute vie.
Nous croyons à l'Unité du genre humain, à la Solidarité, à la
Fraternité de tous les hommes entre eux.
Nous croyons que l'Humanité contient dans son sein, à titre de
membres égaux, tous les individus qui composent la famille
humaine.
134
Nous croyons à l'Égalité parfaire de l'homme et de la femme, à
l'Égalité parfaite de tous les êtres humains entre eux.
Nous croyons à la perfectibilité de l'homme et de l'Humanité, à
leur progrès incessant et indéfini.
Nous croyons qu'il n'y a de salut pour l'Humanité que dans une
Association volontaire, religieuse, parfaitement libre, fraternelle et
égalitaire de tous les hommes entre eux.
Nous croyons que toutes les nations sont soeurs et doivent se
considérer comme les membres divers d'une même famille.
Nous croyons à la souveraineté du Peuple ; la République est à nos
yeux la seule forme de gouvernement légitime. Elle doit réaliser
pleinement la Liberté, Égalité, Fraternité.
Nous croyons au droit, à la sainteté et à l'éternité de la Famille,
société particulière, qui doit subsister d'une façon harmonique au
sein de la grande société humaine à laquelle elle est liée.
Nous croyons qu'il ne doit plus y avoir ni riches, ni pauvres, ni
privilégiés, ni déshérités, ni supérieurs, ni inférieurs, ni enfin
d'autre hiérarchie que celle qui est nécessaire pour le jeu des
diverses fonctions que nous reconnaissons comme étant toutes
égales entre elles.
Nous croyons que tous les hommes étant égaux et frères, ils ont
tous un droit égal et imprescriptible au développement de leurs
facultés physiques, morales et intellectuelles.
Nous croyons que chaque homme se doit à tous et que tous se
doivent à chacun.
Nous croyons que chacun a droit au travail ; que chacun a le devoir
du travail dans la limite de ses forces et de ses aptitudes.
Enfin, nous croyons que la formule républicaine : Liberté, Égalité,
Fraternité, contient le mot et la règle de la vie, et nous nous
engageons à ne jamais rien faire, rien dire, rien professer que dans
le but de réaliser cette formule sacrée ; de la faire comprendre,
aimer, pratiquer par tous ; et nous jurons de baser sur elle tout
notre enseignement, comme toute notre vie ".
In : Souvenirs d'un révolutionnaire, par Gustave Lefrançais, Paris
Société encyclopédique française 1972.
135
Sous le Second empire on assiste à une certaine
libéralisation, mais le contrôle des professeurs est
institué, moins sur le plan professionnel que sur celui de
leur inféodation. Avec Victor Duruy (1863-1869), on
assiste à la création d'un enseignement secondaire
moderne qui prend effet en 1865 pour les garçons
(moderne parce qu'il élargit les programmes dans le sens
d'une ouverture au monde, aux sciences avec toutes les
ambiguïtés que cela signifie : "une instruction
appropriée aux besoins des industriels, des agriculteurs et
des négociants"), et en 1867 pour les filles.
Les sciences et l'enseignement primaire
En 1833, sous Guizot, une loi prévoit au niveau de l'école primaire
supérieure l'étude des premiers éléments des sciences physiques et
de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie.
En 1848, Hippolyte Carnot, décide de l'enseignement des notions
simples concernant les phénomènes de la nature tant dans
l'enseignement élémentaire que supérieur.
En 1850, la loi Falloux rend facultatif l'enseignement des sciences
physiques et de l'histoire naturelle et le ministre Fortoul ira jusqu'à
leur suppression complète pour le primaire: "Pas de sciences dans
une école primaire circonscrite au lire, écrire, compter."
On réintroduit une initiation aux sciences, en 1860, par le biais
d'une bibliothèque dans chaque école primaire où l'on trouvera des
ouvrages vantant les avantages du progrès technique. Sous la
forme de récits d'un abord aisé, on pratique une politique de
vulgarisation de certains savoirs : l'histoire d'une rivière, du ciel,
d'une technique… L'hygiène et la morale sont directement liées à
ces approches.
En 1867, Victor Duruy renforce l'instruction scolaire au-delà de
l'âge de 12 ans en doublant les connaissances de base
(orthographe, grammaire, arithmétique) par de nouveaux
enseignements facultatifs tels que la chimie, l'histoire naturelle et
la physique. Pour reprendre les termes de l'époque l'enseignement
136
scientifique primaire passe de "superflu (…) au rang de bénéfice
supplémentaire que l'Instruction publique offre aux enfants des
classes laborieuses".
Puis, la leçon de choses est institutionnalisée : elle doit faire
comprendre aux élèves les bienfaits de l'observation et de la
réflexion, des savoirs utiles à celui qui va bientôt entrer dans le
monde du travail.
En 1882, la loi Ferry rend l'enseignement scientifique obligatoire
pour offrir aux enfants de la République, "un viatique de
connaissances positives utiles, immédiatement investissables (sic)
dans leur vie quotidienne", c'est-à-dire dans leur vie de
travailleurs.
Si le primaire stagne globalement malgré ces quelques
modifications et un statut plus affirmé (le ministre, qui
est un enseignant, fait revaloriser la condition des
instituteurs et voter la loi d'avril 1867 : toute commune
de plus de 500 habitants doit avoir une école de filles, les
communes pauvres seront aidées par l'État pour subvenir
aux frais d'une école gratuite. Les bourses sont
réorganisées et la création d'une "caisse des écoles" est
destinée à aider les élèves dans le besoin), la concurrence
avec l'Allemagne concentre toutes les attentions sur les
études supérieures et l'on cherche à donner un véritable
élan à la création d'écoles réservées à l'élite des
étudiants. Cela devient une affaire d'état. Ainsi, le 31
juillet 1868, un décret fonde l'École pratique des hautes
études "afin de développer la recherche et de former des
savants".
*
Toutes ces réformes, qui peuvent paraître raisonnables et
aller dans la bonne direction, on en fait toujours le même
but : venir au-devant des bouleversements économiques
137
et techniques que connaît la France ! Duruy, comme ses
prédécesseurs depuis le Directoire, pense que le pays a
besoin d'une école susceptible de former les individus
dont l'économie, le système libéral ne pourront se passer.
Qu'il en résulte une augmentation générale de la
fréquentation des écoles et une accession d'un plus grand
nombre à une classe moyenne en train de se constituer
(lentement) sont des conséquences secondaires dont ce
ministre peut sans doute se réjouir, mais qui en réalité
n'ont pas plus d'importance qu'un accroissement des
savoirs de la majorité puisque la finalité reste toujours la
même : l'adéquation des populations avec le système
économique et les productions.
C'est dans le même sens que la loi de 1867 a encouragé
les cours d'adultes et l'enseignement primaire féminin.
Rien de gratuit ! L'école dans son ensemble s'adapte à un
monde qui change. Pas l'inverse.
*
Les grandes révoltes des années 1830 (notamment celle
des canuts en 1831), la révolution de 1848 ont effrayé les
bien-pensants et provoqué une accélération du contrôle
de l'école primaire par l'État car l'instruction nécessaire
est une arme à double tranchant : l'ouvrier qui sait lire et
écrire peut déchiffrer une notice, un règlement, signer...,
mais il peut aussi se procurer de mauvais journaux, des
ouvrages proscrits ! Il peut revendiquer !
En 1833, Guizot a créé une direction centralisée de
l'instruction primaire. Il s'agissait moins d'assurer la
cohérence du système que de le surveiller ! Dès que
l'agitation sociale pointe l'oreille ou prépare des
barricades, la bourgeoisie qu'elle soit libérale ou ultra, se
retrouve contre l'adversaire commun : la classe ouvrière.
138
Dans cette optique, en plus de la préparation du futur
ouvrier aux tâches qui seront les siennes, l'École doit être
la gardienne, de l'ordre public. Elle doit préparer l'enfant
à affronter le monde du travail en contrebalançant "
l'influence pernicieuse que trop souvent la fréquentation
des ateliers exerce sur l'enfance" (Préambule de la loi
du 11 janvier 1850 sur l'ouverture le soir des écoles
d'apprentis). L'École est conçue comme un modérateur
d'opinion, le creuset du conformisme social !
Les ouvriers et leurs amis, les esprits avancés, ne sont pas
dupes de cette "machination", mais ils continuent à
vouloir voir dans l'École le moteur des changements
possible, le seul instrument capable d'avoir une action
révolutionnaire en éclairant les individus, car un homme
instruit serait un homme capable de se défendre, de
défendre ses droits même si personne n'oublie que cette
école tant voulue appartient à l'État bourgeois, et de plus
en plus. Selon François Furet et Mona Ozouf
(L'Alphabétisation en France de Calvin à Ferry) la
demande scolaire n'est pas le propre d'une catégorie
sociale mais de l'ensemble de la population (habilement
manipulée). Pourtant, certains libéraux et de nombreux
intellectuels que nous dirions aujourd'hui de gauche
s'interrogent sur le sens de cette éducation : est-elle
vraiment le moyen de contrebalancer l'aliénation qui
menace le futur ouvrier ? Fait-elle en sorte que l'enfant
ne soit pas livré sans défense au patronat ou bien n'estelle
pas avant tout simplement moralisatrice en
inculquant de fait les valeurs de la bourgeoisie, une sorte
de préparation à cette aliénation ? Quant aux rares
enfants de milieux défavorisés qui "réussissent" ne
sont-ils pas alors simplement de nouveaux bourgeois,
139
l'école et les diplômes servant en quelque sorte de lettres
de bourgeoisie avant de devenir les alibis du système qui,
avec la République, se donnera pour essentiellement
démocratique ?
Il est alors difficile de répondre à ces questions, car on en
est à un stade de pauvreté de la classe ouvrière, de
paupérisme, qui - comme actuellement pour certains
pays en voie de développement - fait que l'école doit
d'abord servir à permettre de survivre, c'est-à-dire d'être
plus apte à trouver un emploi et toute discussion sur une
éducation qui mettrait en retrait la problématique du
travail et ne viserait qu'à l'enrichissement de l'individu
est encore un luxe. On ne fait pas la Révolution avec un
peuple qui a faim, disait Gandhi, quand Ghelderode
affirmait qu'on ne fait pas la révolution sans discours !
La problématique n'a pas évolué. L'auteur de cet essai a eu
l'occasion de se rendre en Inde (Tamil Nadu) pour aider à la mise
en place d'une école primaire patronnée par une ONG reconnue
pour son sérieux et ses réalisations. Pour le volontaire découvrant
cet immense pays, la première source de réflexion est constituée
par le fait que l'Inde possède un système scolaire d'État,
obligatoire et gratuit, les enfants recevant d'ailleurs un repas le
midi (ce qui le rend "attractif" pour les plus malheureux !).
Cependant, le poids des mentalités aidant, nombreux sont les
enfants (de castes défavorisées - même si celles-ci n'existent
officiellement plus, résidant dans des zones excentrées, dans des
états pauvres…) qui ne la fréquentent pas ou seulement pour y
recevoir la nourriture promise. Il est en outre vrai que ces écoles
publiques sont parfois (souvent ?) assez mal gérées : les classes
sont surchargées, certains enseignants, fonctionnaires titulaires,
délèguent parfois leurs pouvoirs à des "remplaçants" rétribués
par eux afin de s'adonner librement à des activités encore plus
rémunératrices, plus juteuses. Les niveaux sont forcément très
divers… Le but de cet enseignement est essentiellement de
140
permettre que tous les futurs adultes atteignent un ensemble de
connaissances seulement suffisant pour former les travailleurs
utiles au "tigre" indien. Les études supérieures sont certes
également développées, mais ouvertes à une minorité d'élèves
fréquentant le secteur public et à une majorité d'enfants inscrits
dans le secteur privé, qui s'est très vite développé : il existe un
véritable marché de l'éducation en Inde (comme dans tous les pays
en voie de développement) avec des écoles proposant en échange
de frais d'écolage modestes ou énormes un enseignement prétendu
de "qualité" (ce qui est malheureusement souvent faux, car les
escrocs sont nombreux) et des réseaux qui permettront à l'enfant
de réussir dans une société particulièrement dure. Quels parents ne
seraient pas prêts à tous les sacrifices pour qu'au moins un de leurs
enfants "réussisse" et fasse rejaillir ensuite cette réussite sur
l'ensemble de la famille ?
Mon école, initialement prévue pour scolariser les nécessiteux,
était donc par la force des choses une école de droit privé. Les frais
de scolarité très bas (une centaine d'euro par an) ne permettaient
l'accès qu'à des enfants de la toute petite bourgeoisie de cette
région très pauvre. Les parents, qui faisaient de réels efforts,
voyaient d'un mauvais oeil que des enfants de familles dénuées de
moyens, parrainés par des Européens, soient assis à côté de leurs
enfants pour lesquels ils payaient, eux, une rétribution ! L'école
était là dans l'esprit des parents pour que les enfants qui la
fréquentent aient plus tard "une bonne situation" et gagnent
beaucoup d'argent en se recommandant justement d'avoir effectué
leur scolarité puis leurs études en dehors du système national
gratuit, un avenir solide que les écoles d'état ne pourraient (à leur
avis) pas assurer !
On demandait en bref à une ONG de préparer la ségrégation
sociale de demain !
Dans les dernières années du second Empire, toutefois,
une évolution se marque : la conscience de classe
s'impose à la conscience "professionnelle".
141
On clame le besoin et la valeur d'une bonne éducation
générale, bénéfique à l'individu, au détriment du modèle
qui se développe le plus : l'école professionnelle, car il
est désormais clair que cette antichambre de l'atelier ou
de l'usine ne sert qu'à maintenir la division des classes et
l'immobilité sociale.
L'écrasement de la Commune marque pratiquement la fin
de ce débat. Et Jules Ferry fera de l'école comme
l'indique E. Plénel "un lieu clos soumis à l'autorité sans
partage de l'État" et comme toujours, le chemin de
l'enfer sera pavé de bonnes intentions ! Nous avons déjà
eu l'occasion de voir quelle était son attitude : il n'innove
en rien ni avec l'école primaire ni avec les écoles
professionnelles et l'espérance d'une promotion pour
ceux qui seront les "sous-officiers" de l'industrie
nouvelle.
Cependant, cette autorité sans partage ne se fera pas d'un
coup.
La République est certes proclamée après la défaite de
1871, mais c'est une république des grandes villes et
l'exercice du pouvoir lui échappe en fait. La population
rurale ou semi-rurale continue à voter pour les notables
associés comme toujours au clergé. Comment faire
d'ailleurs autrement puisqu'ils sont les seuls censés
posséder "l'instruction" ! Aussi, dès que les
Républicains parviennent à assurer le pouvoir exécutif en
1879, ils considèrent que la priorité des priorités est de
généraliser une instruction primaire qui, certes, depuis la
monarchie de juillet avait fait d'énormes progrès, mais
qui ne s'était en rien affranchie de la tutelle cléricale. Dès
1869, ils avaient réclamé "l'instruction primaire, laïque,
gratuite et obligatoire", seul moyen d'échapper à
142
l'emprise des prêtres. Dès 1880, le Conseil supérieur de
l'instruction publique est laïcisé : n'en sont plus membres
que des enseignants élus et n'appartenant pas au clergé.
La lettre d'obédience des enseignants congréganistes n'a
plus aucune valeur : pour enseigner, il faut désormais au
moins un "brevet de capacité". À partir du 9 août 1879,
chaque département doit se doter d'une école normale
primaire de filles et de garçons et, en juillet 1880, l'école
normale de Fontenay est créée pour former les
professeurs d'écoles normales. En 1881, l'enseignement
primaire est (enfin) rendu vraiment gratuit ; en mars
1882, l'obligation scolaire et la laïcité entrent dans les
faits (6 à 13 ans) et en 1886 la loi Gobelet décide de la
laïcisation des enseignants des établissements publics.
En compensation à cette charge contre le monopole de
fait que l'Église s'était reconstitué après le premier
Empire, le jeudi est "libre" pour que les parents qui le
souhaitent puissent envoyer leurs enfants au catéchisme.
Sur un autre plan, la défaite de 1871 impose
définitivement l'idée qu'il faut réformer l'Université sur
le modèle allemand (!) et accorder davantage
d'importance aux sciences. Parallèlement, les grandes
écoles se développent, car on souhaite former de plus en
plus d'ingénieurs, particulièrement dans les technologies
nouvelles.
La République a ainsi deux objectifs principaux : former
la masse de la population à un niveau qui lui permettra
d'échapper à l'influence du clergé et participer à l'effort
de modernisation ; créer de nouveaux notables,
républicains et techniciens capables d'assurer le lien
entre les masses salariées et le patronat, nouveaux
notables dont semble avoir besoin un pays qui vient
d'être vaincu et qui se remet mal de la défaite. En même
143
temps se dessine une élite administrative de hauts
fonctionnaires formés dans de grandes écoles payantes
dont l'École libre des sciences politiques, une
technocratie avant l'heure, alors que l'université
réformée "à l'allemande" n'a qu'un but : créer une élite
intellectuelle.
Élite donc d'une part pour ne pas dire nouvelle
aristocratie (qui englobe tout de même une bonne part de
l'ancienne !), ouvriers et employés d'autre part, et une
école primaire sous le régime d'une apparente
méritocratie permettant à quelques enfants du peuple de
devenir ces "sous-officiers de l'industrie nouvelle" ou
les hussards noirs de la République, voire parfois mais
rarement - alibi suprême de l'égalité républicaine, de
rejoindre l'élite.
Le mouvement ouvrier, récemment organisé, est à
nouveau partagé : faut-il tenter de "détruire" cette école
qui a toujours été l'instrument des puissants ou faut-il
jouer le jeu et en tirer le meilleur parti dans un monde qui
semble ne pas pouvoir échapper au "modernisme" ? En
réponse à l'école officielle qu'il accuse de conforter les
inégalités, il "bottera en touche" et favorisera les
passerelles souvent illusoires : les Bourses du travail
(fédérées en 1892) et les Universités populaires (1899),
soutenues au départ par la bourgeoisie libérale.
Cependant, l'illusion est de courte durée : les intellectuels
qui viennent y enseigner, souvent avec les meilleurs
sentiments du monde comme leurs prédécesseurs
idéalistes en 1830 et 1848, sont à mille lieues de leur
public et des problèmes qui les assaillent. Le discours
passe mal. Quant aux diplômes, ils sont inexistants. Les
Bourses du travail tentent la création d'écoles syndicales
en 1900 mais sans succès. La guerre de 1914-1918
144
marque leur fin définitive. Le monopole de l'État est
gravé dans le marbre.
Instrument de l'Église à ses origines, puis lieu de
rencontre entre ces deux alliés que sont l'État
monarchiste et l'Église, l'École devient l'objet de l'État
et de l'idéologie capitaliste qui le sous-tend ou le tient en
otage.
*
Au-delà du consensus sur les vertus émancipatrices de
l'instruction, la lutte entre l'Église et l'État pour le
contrôle de l'appareil scolaire a masqué un autre enjeu.
En effet, deux conceptions de l'éducation des enfants du
peuple ont été envisagées au cours du XIXème siècle
autour de la question de savoir s'il fallait ou non marquer
un lien entre école et production. Au terme du siècle, la
République semble refuser en apparence ce lien direct
pour les plus petits. Elle bâtit, pour assurer sa pérennité et
maîtriser le corps social, une école fermée sur elle-même.
Pour reprendre les termes de Plénel, "c'est parce que
l'école républicaine s'élève contre le travail des enfants,
ce délitement de la famille ouvrière, qu'elle réussit à
imposer l'État éducateur". En réalité, ayant diminué
pour une large part l'influence de l'Église, c'est aussi
pour s'y substituer et assurer une "préparation" parfaite
à une société laïque marquée par le positivisme : passé
par le crible de la morale, des mythes nationaux et de la
discipline scolaire, pourvu du minimum nécessaire à sa
future exploitation, la majorité des enfants des classes
défavorisées est intellectuellement apte à entrer dans le
monde du travail tel qu'on le conçoit désormais pour
elle ! Pour le coup, on comprend pourquoi les rares
145
tentatives pour inscrire l'éducation des enfants du peuple
dans le réel d'un autre type de production que celle à
laquelle ils seront destinés, qu'il s'agisse d'un Paul Robin
ou plus tard d'un Célestin Freinet, n'ont pu se réaliser
qu'en marge du système !
De son côté le mouvement ouvrier, dans sa majorité,
détourne ses espoirs en l'instruction nationale au profit
d'un outil qu'il veut plus efficace ou plus immédiat, car il
vise d'abord à la nécessaire amélioration matérielle des
conditions de vie de la classe ouvrière, pas à un
changement structurel, idéologique (inimaginable pour la
majorité) de société : le syndicat. Dans la même logique,
il confie au syndicalisme enseignant le soin de réformer
l'école officielle dans le sens des attentes d'un monde
misant sur le progrès technologique et la rivalité des
nations. On pourrait conclure avec Bernard Charlot que "
l'école primaire de la IIIème République naîtra à partir de
ce consensus qui concilie l'entreprise bourgeoise de
moralisation et la revendication ouvrière de dignité" si
l'on ne devait souligner que rien ne change
fondamentalement. L'Église avait longtemps fait de
l'école sa chasse gardée et un élément important de son
pouvoir ; la montée en puissance de l'État se fait certes à
son détriment, mais l'État, dans un consensus quasiment
absolu, en fait à son tour sa chose, la confisque à son
profit et au profit du système économique auquel il est
inféodé. L'Église, bien implantée dans le siècle,
puissance plus séculaire que spirituelle, cherchait à
conforter l'ordre social qui lui était favorable sous le
prétexte de préparer ainsi pour le mieux de tous
l'eschatologie qu'elle proposait ; l'État, république de
nom, mais pas de fait, est l'objet de quelques-uns, avec la
fallacieuse apparence d'une démocratie véritable et
146
l'École qu'il met en place est d'abord là pour conforter
un ordre social basé sur l'idéologie scientiste et la foi en
un progrès d'abord technique et matériel, les deux
colonnes sur lesquelles s'édifie le capitalisme.
L'enfant, au centre des préoccupations, ce sera pour plus
tard.
En bref, d'une eschatologie l'autre !
Dans tous les cas, l'École et l'instruction, l'éducation
qu'elle doit dispenser sont contrôlées par des puissances
qui les dépassent. Elle en est l'otage. Purement et
simplement instrumentalisée, elle est au mieux ornée
d'un discours lénifiant faisant croire à des finalités
idéales, l'excipient verbeux destiné à masquer
l'amertume des réalités. Par-delà toutes les proclamations
et déclarations d'intention généreuses, l'École telle
qu'elle a toujours été dans les faits n'a eu que deux visées
ou plutôt n'a été dévoyée que dans deux buts principaux :
assurer ce qui a été établi (composante conservatrice) et
préparer ce que les forces au pouvoir croient nécessaire
pour mieux assurer encore leur suprématie (composante
prédicative). La revanche de 1870, par exemple, s'appuie
sur un patriotisme particulièrement distillé dans les salles
de la communale alors que le conflit de 1914 aura
essentiellement des causes économiques et impérialistes.
Le patriotisme ne servira qu'à sublimer, à voiler
pudiquement, pour l'opinion publique, la lutte
économique et coloniale que se livrent particulièrement
la France et l'Allemagne. Des fortunes y ont intérêt et le
bond technologique attendu de la guerre fait espérer des
lendemains qui "moderniseront" les pays.
147
La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père, qu'est-ce qu'il fait le père ?
Il fait des affaires…
Plus tard, l'exemple du national-socialisme sera
particulièrement clair à cet effet, les systèmes totalitaires
ne faisant que rendre plus visible ce que le discours et les
apparences démocratiques dissimulent dans tous les
autres régimes.
On développera une éducation et un enseignement qui, en
histoire, par exemple mais aussi dans les matières
scientifiques et littéraires, sportives, tend à montrer
l'éternelle supériorité de l'Allemagne, un enseignement
qui prépare l'avenir de la théorie raciale de l'espace vital.
L'école en Union Soviétique aura des caractéristiques
semblables : former les robots du système.
L'enseignement du français : un exemple caractéristique d'une
culture de classe
L'université napoléonienne a fondé le lycée et celui-ci est le
sanctuaire dans lequel, pour la majorité, les enfants des classes non
populaires, donc non destinés à un travail de production, reçoivent
une éducation plus académique. On pourrait penser que cet
enseignement, par définition moins immédiatement utilitaire,
permettrait aux jeunes gens d'acquérir une vraie culture, de
développer leurs talents, d'enrichir leur personnalité, que l' "école"
à ce niveau serait plus respectueuse de la mission que lui ont
assignée tous les vrais pédagogues : l'épanouissement de chaque
enfant.
En fait, les programmes des lycées conduisent à la même aliénation
que ceux de l'école primaire, sur un autre plan. Si l'on prend pour
exemple ce qui est longtemps le fleuron de l'enseignement, les
148
lettres, avant que les mathématiques ne les détrônent (pour des
raisons aisées à comprendre), on note que leur apprentissage loin de
donner à chaque élève les moyens de se révéler, d'épanouir ses
capacités, ses potentialités créatives ne vise qu'à maintenir
l'intégrité d'une classe (en gros, celle des possédants) par le biais
d'une culture commune, tout en donnant l'impression d'un
enseignement marqué par un certain humanisme. Les auteurs sont
soigneusement choisis en fonction d'une morale favorable à
l'immobilisme social, les exercices également. L'enseignement des
lettres possède au moins trois fonctions jusque vers les années 1871-
1880 et ne se distingue que peu de ce qui se faisait sous l'Ancien
Régime :
- Établir une filiation entre l'élite des siècles passés et l'élite
contemporaine (la place des études classique, la place du
latin, un Parnasse soigneusement limité à quelques "grands
auteurs" du XVIIe siècle voire du XVIIIe siècle puis à des
contemporains "sûrs"…)
- Préparer ces élites à la maîtrise du discours et de l'écrit
(nécessaire aux "carrières"),
- Créer l'honnête homme moderne (raisonnablement
scientiste, lecteur d'une certaine presse, maître de sa plume,
raisonnablement religieux, patriote et gestionnaire de sa
fortune).
On a donc à faire à un enseignement de transition alors que la
révolution industrielle s'impose et que les ombres du passé sont
encore bien présentes, mais un enseignement destiné à conforter
diachroniquement et synchroniquement une classe sociale
privilégiée.
- La classe de 1ère est la Rhétorique. Ses finalités sont claires :
maîtriser l'art de la parole et du discours, art que devait jadis
posséder le juriste ou l'ecclésiastique et que devra acquérir le
futur député, le futur patron, la future notabilité. Ceci implique
un certain nombre d'exclusions: des genres, comme le roman ou
la poésie, des époques comme le moyen-âge, des écrivains
(certains auteurs de la Renaissance, du dix-huitième siècle, les
contemporains "libéraux"...)
- Si l'art d'écrire peut paraître privilégié, c'est parce que la forme
est particulièrement travaillée et que l'imitatio joue un grand
149
rôle. Le fond est moins valorisé. À la limite, peu importe ce qui
est dit (tant que cela reste "neutre") le comment seul intéresse :
les Considérations de Montesquieu sont traitées comme un livre
de littérature et Boileau demeure la référence principale.
Le manuel de français le plus utilisé jusqu'en 1870, le Noël et
Delaplace (Leçons françaises de littérature et de morale, 29 éditions
officielles entre 1804 et 1862), est intéressant à feuilleter à ce
propos:
"Tout dans ce recueil est le fruit du génie, du talent, de la vertu;
tout y respire le goût le plus exquis et la morale la plus pure", peuton
lire en guise de déclaration d'intention.
Les auteurs s'appuient sur Rollin et son Traité des études, qu'ils
citent, pour justifier leur entreprise : le "choix exquis" (jugement
porté par les auteurs sur leur travail ?) des morceaux choisis qui
composent leur livre : "Il ne s'agit pas pour lors de faire
comprendre aux jeunes gens la suite d'un raisonnement long et
obscur, ce qui est beaucoup au-dessus de leur âge, mais de les former
à la pureté du langage, et de leur donner de bons principes" !
Leur but est avant tout l'acquisition d'un langage élégant, de bon
goût, allant surtout de pair avec une morale solide.
Le chapitre introductif intitulé Règles de l'art d'écrire, est constitué
par un extrait du discours de Buffon lors de sa réception à
l'Académie Française.
Ce choix d'un homme du siècle précédent célèbre pour son style et
scientifique tout de même un peu dépassé, est très éclairant sur les
finalités qu'on se propose alors de l'enseignement du français, le
"goût" est essentiel :
"Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui passeront à la postérité
: la quantité de connaissances, la singularité des faits, la nouveauté
même des découvertes ne sont pas de sûrs garants de l'immortalité.
Si les ouvrages qui les contiennent ne roulent que sur de petits
objets, s'ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie, ils
périront, parce que les connaissances, les faits et les découvertes
s'enlèvent aisément, se transportent et gagnent même à être mis en
oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses sont hors de l'homme,
le style est l'homme même. Le style ne peut donc ni s'enlever, ni se
transporter ni s'altérer. S'il est élevé, noble, sublime, l'auteur sera
également admiré dans tous les temps, car il n'y a que la vérité qui
soit durable et même éternelle."
150
Les objectifs des programmes sont clairement résumés par Noël et
Delaplace :
"Chaque morceau de ce Recueil, en offrant un exercice de lecture
soignée, de mémoire, de déclamation, d'analyse (analyse des tropes,
des périodes, de la composition !), de développement oratoire, est en
même temps une leçon de vertu, d'humanité ou de justice, de
religion, de dévouement au prince et à la patrie, de désintéressement
ou d'amour du bien public."
La connaissance d'aspects choisis de l'Antiquité, les classiques
français, quelques philosophes soigneusement expurgés et des
auteurs modernes (choisis pour leurs "performances" scripturales,
pas pour leurs idées) illustrent cette volonté.
Le lycée est alors coupé de la vie et maintenu en dehors des études
pratiques. On ne souhaite que former l'homme de tous les temps ou
plutôt l'homme moderne façonné sur les exemples du passé.
Au cours du siècle, les grands de la littérature classique se
maintiendront avec des fortunes diverses ou en fonction d'oeuvres
nouvelles, pour se résumer, le fameux : Une Corneille perchée sur
une Racine de La Bruyère Boileau (!) de La Fontaine Molière. S'y
ajouteront avec parcimonie jusqu'en 1870 (V. Duruy travaillera dans
ce sens, mais insuffisamment) des ecclésiastiques, des professeurs,
des modèles de "bonne vie", des critiques. Rousseau, Voltaire, puis
Chateaubriand ou Balzac sont présents au fur et à mesure des
éditions, mais sous forme d'extraits particulièrement bien choisis et
rendant tendancieusement d'abord compte de leur valeur moralisante
ou stylistique. Ceci conduit, en dépit d'un semblant d'ouverture à
une atrophie du domaine de la littérature : elle n'est qu'instrument
de la rhétorique et de la morale. On assiste au triomphe de la
littérature didactique (sermonnaires, prédicateurs, moralistes,
religieux, puis auteurs "patriotes", mémoires d'enfants du peuple
ayant "réussi"...), extraits expurgés au nom du beau et du bien. Il
s'établit une anthologie de "morceaux" inoubliables comme
"Télémaque élève modèle", "Mentor professeur modèle" que tout
lycéen doit "posséder" pour la vie.
On utilise Rousseau pour illustrer tel titre de chapitre: "Les jeunes
gens corrompus de bonne heure sont inhumains et cruels, le jeune
homme sage jusqu'à vingt ans est le meilleur et le plus aimable des
hommes" ! Massillon pour développer l'idée que "La victoire la
plus glorieuse est celle que l'on remporte sur soi-même", Le Père
151
Guénard pour étudier les bornes que la religion doit mettre à l'esprit
philosophique, La Harpe pour convaincre que "La retraite est
essentielle au travail" ou Chateaubriand pour donner un exemple de
l'éloquence chrétienne…
Voltaire sera essentiellement un conteur, un maître du style, pétillant
et malicieux…
En bref, on cherche à former des jeunes gens de bien, d'honneur et
de religion, maîtrisant une langue de bon goût façonnée par les
modèles qu'on leur présente. Les têtes parlantes du siècle précédent,
la Voix de son maître des futurs débuts du phonographe !
Jusqu'à la réforme de Jules Ferry, ce nombre réduit d'auteurs laisse
la littérature française en seconde position (malgré les avancées dues
à V. Duruy). Il n'y a qu'à l'agrégation de lettres où un sujet de
littérature française est imposé (1850: "Pourquoi la tragédie
moderne et en particulier la tragédie française n'a-t-elle pas admis
l'emploi du choeur?")
Les lettres, qui sont alors pour le second degré, le fleuron de
l'enseignement, ne visent qu'à permettre à la classe dirigeante de se
"retrouver", de communier aux mêmes accents, de célébrer les
mêmes valeurs.
Les exercices écrits demandent alors de composer à la manière de...
(Monologue d'Hannibal devant les portes de Rome; Prosopopée
d'Ajax sur les ruines de Troie...) et ce n'est qu'après 1870 qu'ils
seront remplacés par l'explication de texte, mais une explication,
elle aussi très cadrée.
Les préoccupations politiques et idéologiques sont évidentes et
l'instrumentalisation de la littérature en témoigne. Le rappel constant
du lien entre le beau, bien dit, bien écrit et le bon, la morale
(préoccupation des vieilles perruques du XVIIe siècle), cache ou
occulte le vrai et devient l'alibi d'un conservatisme obsédé par
l'ordre. La littérature est donc à la fois prisonnière des objectifs
scolaires de l'enseignement secondaire et des objectifs idéologiques
du pouvoir. Longtemps avant Baudelaire, la littérature prouvera que
le beau dépasse largement le bien, l'État, lui, a une autre vision : il
prépare ses futures élites capables d'études secondaires et met tout
en oeuvre pour s'en assurer la fidélité.
L'idée même de littérature que comprennent les promoteurs de
l'école au XIXes., continue à véhiculer de toute façon cette vision
moralisatrice héritée du XVIIe siècle : elle exclut la littérature
152
d'imagination pour ne privilégier que la littérature (au moins jusque
1850) prenant racine dans l'humanisme d'un XVIe siècle édulcoré,
soigneusement émondé de ses prolongements philosophiques, qui
semble ne chercher qu'à améliorer l'homme en le guidant par la
morale.
Sur cette situation se greffe le débat entre 1830 et 1870 à propos des
rôles spécifiques de la culture scientifique et de la culture littéraire.
Quelle est la place du progrès technique et social face à l'invariable
grandeur morale de l'homme? Les tenants, de plus en plus
nombreux, sinon d'un changement de paramètre au moins d'une
évaluation nouvelle de l'apport (indiscutable depuis le Siècle des
Lumières) des sciences (ce qui n'est pas encore le modèle
mathématique qui triomphera à partir de l'entre-deux-guerres) se
battent pour faire triompher leurs idées : le monde moderne
(entendons, le système économique) sera scientifique ou ne sera pas
et le nouvel honnête homme doit être l'homme de science,
l'ingénieur, voire le technicien. Un bon exemple est fourni par le
débat parlementaire qui opposa Lamartine à Arago, le poète au
savant. Lamartine eut cette phrase : "Si le genre humain était
condamné à perdre entièrement un de ces deux ordres de vérité, ou
toutes les vérités mathématiques, ou toutes les vérités morales, je dis
qu'il ne devrait pas hésiter à sacrifier les vérités mathématiques, car
si toutes les vérités mathématiques se perdaient, le monde industriel
subirait sans doute un grand dommage, un immense détriment, mais
si l'homme perdait une seule de ces vérités morales dont les études
littéraires sont le véhicule, ce serait l'homme lui-même, ce serait
l'humanité entière qui périrait."
Cette pensée, dans sa substance, n'a certes pas vieilli. Arago, pour sa
part, réclamait un enseignement moderne, une éducation
"exclusivement professionnelle, scientifique, industrielle" et
Lamartine refusait cet adverbe "exclusivement" ; il pensait au
contraire qu'il fallait conserver les lettres, la formation humaine.
Cependant, il n'était pas non plus pour une éducation fermée au
monde, au progrès, à l'évolution des sociétés. Comme Rousseau en
quelque sorte, il désirait qu'on établisse un ordre dans la succession
des apprentissages : d'abord une "éducation morale, littéraire, (…)
commune", puis "cette éducation spéciale et industrielle", quand
l'individu est assez fort pour en prendre la vraie mesure.
Un certain nombre de décades encore, et la cohabitation souhaitée
153
par l'auteur de Graziella allait s'imposer ; plus tard, le rapport
s'inversera...
Mais si les critères (littérature ? Sciences ?) pourront changer, le
propos demeurera le même : hier comme aujourd'hui, l'École
demeurera prisonnière d'un discours ambigu : en paroles de plus en
plus "ouvert", tourné vers l'individu et en actes qui pérennisent sa
fonction aliénante. L'écart entre le discours et la réalité, entre
l'apparence et la vérité des faits sera de plus en plus évident.
L'École au sens large est le moule dans lequel il contraint les
générations : par l'école primaire, faire des producteurs capables et
respectueux de cet ordre ; par le lycée former des élites liées entre
elles par un sentiment de classe, d'appartenance à un groupe de
privilégiés destinés à prendre en main les destinées du pays.
Ajoutons que, lorsque les lettres devront céder le pas aux sciences,
on assistera simplement à une mise au pas définitive d'un
enseignement destiné à servir un système économique productiviste
qui désormais se montrera dans toute sa vérité voire sa brutalité
même si le discours officiel fera en sorte de démontrer que la
formation humaine par les mathématiques est par certains aspects
supérieure à la formation "littéraire" mais dans les deux cas en se
refusant à admettre que ce ne sont là que des conséquences d'une
valeur considérée comme supérieure : le marché, le système
économique, la permanence d'une hiérarchie sociale.
On ne connaîtra vraiment quelques auteurs français modernes
qu'après 1870 et parce que les nécessités d'un sursaut national
conjuguées avec la laïcité mènent à élargir le Panthéon littéraire. La
République a besoin de grands hommes, une idée que la Révolution
de l'an II avait déjà cherché à populariser. La littérature nationale
doit se mettre au service de la patrie, ce qui ne voudra pas dire que
les programmes s'ouvriront à tous les auteurs. Un Panthéon en
chassera un autre, rien de plus.
*
154
Au XIXème siècle, siècle des révolutions, s'est joué le sort
de l'école primaire et de l'institution scolaire.
À la fin de la période, juste avant le premier conflit
mondial, le triomphe de l'école obligatoire ne résulte pas
seulement d'un affrontement entre l'État et l'Église pour
le contrôle de l'éducation du peuple, elle est aussi le
produit d'une autre lutte menée autour du rapport entre
l'école et le travail. En effet, évacuant la question d'une
éducation permettant à l'individu d'être à la fois
totalement soi et membre à part entière de la société dans
laquelle il vit, voire de la communauté humaine dans son
ensemble, tout le siècle est traversé par la question de
savoir si la socialisation des enfants du peuple doit passer
par l'école ou par le travail. Il faut s'entendre sur ce
terme de socialisation, polysémique s'il en est, mais qui
ne signifie alors principalement que l'intégration à une
société du travail et de la production en pleine évolution.
Tantôt l'éducation par l'école est perçue, par la
bourgeoisie au pouvoir, comme perverse (elle inoculerait
aux enfants des classes "dangereuses" le désir de
changer de classe sociale) et l'éducation par le travail est
alors considérée comme préférable pour les masses car
moralisatrice; tantôt la promiscuité des enfants du peuple
avec les ouvriers développerait de façon précoce leur
conscience de classe et serait donc corruptrice, voire
dangereuse.
On se met d'accord sur une synthèse frileuse ou
hypocrite permettant de ménager la chèvre et le chou, les
postulations généreuses et humanistes de quelques-uns
(mises en avant, étendard philosophique et
philanthropique, cache-misère pratique en apparence)
avec ce qui est présenté comme l'impératif de la
155
compétition internationale : l'école doit certes servir
l'individu en lui offrant quelques chances de
développement, elle doit aussi et principalement l'amener
à intégrer le rang qui lui est dû dans la société (de par ses
origines plus qu'en raison de capacités, qui pour la
plupart demeureront inexploitées mais aussi de par les
développements sociaux économiques en cours ou
prévus). Le discours officiel des dirigeants et des
notables est ambigu, altruiste seulement en apparence ; il
est hésitant en ce qui concerne les syndicats partagés
entre les nécessités d'assurer le pain à tout le monde, de
donner des cadres à la classe ouvrière et des aspirations
plus humanistes. Il reste profondément ancré dans les
réalités immédiates économiques, sans perspectives, sans
"téléologie", myope.
Les deux discours de J. Ferry et du président de
l'Assemblée à Vierzon évoqués plus haut sont à ce
propos de véritables paraboles : Janus républicain ne se
dissimule pas et la pratique du double idiome en matière
d'éducation se généralisera : une duplicité qu'on retrouve
partout et qui culmine dans les régimes autoritaires et
totalitaires.
L'école devient une propédeutique sociale.
On peut comprendre voire accepter que, pour la période
qui va, en gros, jusqu'au début des années 70, la pauvreté
criante d'une large fraction de la population française,
qui ne dispose pas du minimum nécessaire l'explique
certes et le justifie : il faut pallier au plus pressé, comme
probablement aujourd'hui dans les pays dits "en voie de
développement" : permettre à la quasi-totalité des
populations d'acquérir ce minimum "culturel"
156
considéré comme vital puisqu'il semble offrir à chacun
de meilleures chances d'obtenir une activité assurant
l'existence matérielle. Ce faisant, cependant, au lieu de
rompre avec un système qui sème l'illusion, on ne fait
que repousser l'échéance inévitable. Dans cette course
poursuite infinie, le "système" possède les meilleures
cartes : il pourra toujours placer plus loin la carotte
insaisissable. Certes les premiers besoins seront satisfaits
mais au prix d'autres contraintes, d'autres maux. La
quantité de "bonheur" varie peu. Hier, les esprits
avancés désiraient que tous les enfants sachent au moins
lire et compter ; aujourd'hui d'autres esprits avancés
revendiquent l'accès au bac pour tous, voire des études
supérieures. La démarche est la même et le résultat assez
comparable : la création d'un véritable prolétariat, car si
le prolétaire selon sa définition est celui qui ne possède
que la force de ses bras, si le prolétaire du XIXe siècle
ressemble assez au tableau qu'en ont fait les romanciers
naturalistes, qu'il dispose aujourd'hui d'une voiture et
d'un réfrigérateur, d'une télé XXL et d'un I Pod ou I Pad
ne change pas grand-chose à sa situation morale.
Il est toujours sur le dernier échelon d'une échelle de
coursive, dans l'eau jusqu'au cou et s'il a l'impression
que sa situation s'améliore, qu'il s'élève chaque
génération davantage, ce n'est qu'illusion : la mer monte
et le bâtiment auquel il s'accroche et sur lequel il désire
prendre pied monte avec la marée. Sa situation n'évolue
qu'en apparence.
Les responsables politiques, les ministres peuvent parler
de progrès, s'en gargariser : les choses n'ont en fait pas
tellement évolué. L'institution scolaire demeure
l'instrument essentiel des États, qui ne sont plus (mais
157
l'ont-ils jamais été ?) l'expression démocratique des
volontés populaires. L'appareil d'État s'est
progressivement réduit à une sorte de superstructure ou
plutôt d'interface entre l'ensemble des citoyens et ce
qu'on peut appeler le monde de l'économie et du travail.
Le chef de l'État, lui-même, se transformant simplement
en une sorte de super VPR à la recherche de marchés
nouveaux ! Le G20, Davos, … prétendent régir le
monde !
Que ce monde soit capitaliste, communiste, libéral ou ce
qu'on voudra ne change d'ailleurs structurellement rien.
L'institution scolaire n'est là que pour préparer aux
changements qu'on lui demande. À partir de 1850, il était
inconcevable que l'on intègre un monde du travail de plus
en plus compliqué sans un minimum de connaissances de
base comme le calcul et l'écriture, la lecture ; en l'an
2011, il est tout aussi inconcevable de ne pas disposer
d'un vivier de travailleurs capables d'effectuer des tâches
plus complexes qu'aux premiers temps de
l'industrialisation et susceptibles de changer d'emploi, de
pays au gré de l'évolution technologique et financière.
L'accès aux études, les quasis 100% de reçus au bac,
l'université ouverte à tous se paye d'arrières pensées qui
n'ont rien d'altruiste.
On pourrait encore arguer de cette seconde chaîne qui
s'est ajoutée aux liens qui paralysent l'individu: le
citoyen moderne ne doit pas seulement être d'une
manière ou d'une autre un producteur efficace et
polyvalent, il doit aussi se manifester comme
consommateur. Or une consommation solide, moderne et
efficace se prépare. Ça a été toute l'ambiguïté d'une
formule dévoyée comme : "Ouvrir l'école sur la vie",
dont les responsables politiques (mais aussi les
158
pédagogues et trop d'enseignants) ont fait un de leurs
slogans à partir des années 70, comme si une des finalités
de l'école n'aurait jamais dû être autre. La question étant
alors de savoir ce qu'on appelle la vie ! La duplicité de
cette formule, c'est que pour le système économicopolitique
il s'agit de la vie professionnelle et de la
fonction consommatrice, alors que pour les enseignants
et les pédagogues (il faut l'espérer !) c'est aussi autre
chose, un apport plus directement enrichissant pour
l'individu. Ainsi, les vacances paraissent-elles une
nécessité pour l'équilibre de l'enfant et leur répartition
judicieuse, leur rythme, leur durée doit être sérieusement
établie. Or, si jusqu'en 1914, les fameux trois mois de
vacances n'ont jamais été qu'une concession au travail
des champs, les enfants paraissant plus utiles à aider leurs
parents qu'à user leurs culottes sur les bancs de l'école,
aujourd'hui encore, le calendrier scolaire est établi en
fonction des lobbys touristiques : vacances d'hiver,
vacances d'été, étalement des vacances pour prolonger le
temps d'utilisation des pistes de ski (utilisées en outre par
une fraction de la population), pour soutenir la
fréquentation des plages, des centres de loisirs (les
vacances du prof n'ayant jamais été autre chose que ce
qu'on qualifie en terme administrativo-juridique de
"droit d'aubaine" : l'instituteur pendant longtemps n'a
été rétribué que sur 9 mois de travail avec un salaire
réparti sur les douze mois !)… Ainsi, les classes de neige
aideront (dimension noble à valoriser dans le discours) à
cimenter une classe, à découvrir le milieu, à initier à
plusieurs activités sportives et en même temps
(dimension plus discrète), elles donneront l'envie de
consommer de l'or blanc !…
Les vacances sont un exemple de cette emprise
159
continuelle d'agents extérieurs sur l'école : d'abord les
fêtes religieuses comme justification et puis désormais
les impératifs économiques. La discussion bouffonne
autour des rythmes scolaires serait un autre exemple avec
la semaine de quatre jours, celle de quatre et demi, celle
de cinq…
Ainsi, non seulement l'école voit son fonctionnement
dicté par des considérations qui n'ont rien à voir avec ce
qui devrait être sa mission première, mais elle collabore à
la formation du consommateur dont l'économie a besoin.
Soutien indéfectible du monde de l'édition (le livre
scolaire représente un marché énorme et les lectures
suivies servent de fonds de roulement aux éditeurs), c'est
aussi à l'école qu'on apprend le sens du mot loisir, et cela
d'une manière elle aussi fort ambiguë. En effet,
l'ouverture sur le monde, c'est aussi fréquenter les
spectacles, aller au théâtre, participer en rangs par deux
aux semaines du cinéma ou autres manifestations
nationales, c'est encore visiter les musées, les lieux
patrimoniaux, voir les Disneyland ou les parcs à vocation
scientifique… Combien de ces lieux ne survivent que
grâce à l'obole des écoliers ? Bien entendu, il est du
devoir de l'école d'initier les enfants, tous les enfants à
ces formes de la convivialité et de la culture moderne,
mais en même temps, ces classes entières entraînées dans
des voyages ou des visites insuffisamment préparées,
sans lendemain le plus souvent, obligatoires, sans
discussion critique postérieure ressemblent davantage à
un conditionnement allant dans le sens de la
consommation voulue par le système.
L'exemple de l'informatique est aussi patent à ce sujet :
bien entendu, il faut former les jeunes à l'utilisation de
ces désormais indispensables instruments, mais il ne
160
faudrait pas élever en mythe ce qui n'est que technologie
ni rendre l'enfant esclave de ce nouveau progrès au
détriment d'autres voies de la connaissance. Lorsque
l'école remplace le réel des expériences, des découvertes,
des observations par le virtuel et l'audiovisuel, elle a une
action qui va uniquement dans ce sens et éloigne l'enfant
de sa vérité profonde. Elle manipule au profit de
l'univers de la consommation et ce ne sont pas les
quelques manifestations montées en épingle par le
battage médiatique, comme les opérations Fête des
sciences, La main à la pâte…, (bonnes en soi mais
n'ayant que valeur d'alibi) qui changent grand-chose !
161
III. Un système qui se fissure, des
craquements sinistres, de l'eau dans
le gaz
162
163
Les volontés particulières, les beaux livres, les belles
phrases et les projets admirables ne suffisent pas. Ce qui
fait vraiment bouger le monde, c'est l'événement auquel
on ne s'est pas attendu, le séisme qui vient bouleverser ce
qui paraissait établi. Peut-être en approchons-nous enfin,
peut-être y sommes-nous ! En effet, de l'intérieur le
système scolaire tel qu'il est montre des signes
d'essoufflement. Parallèlement, l'association économicopolitique
n'a plus trop confiance dans une institution qui
répond à son avis désormais imparfaitement à ses
exigences. Cette association ne voit plus en elle l'alliée
de toujours. Pour faire face à la demande, les états ont
choisi les solutions les plus économiques, la formation
attendue en souffre et les élèves, sur de nombreux plans,
ne répondent plus aux attentes…
Le système en effet se mord la queue : si le monde
économique réclame une constante augmentation globale
des savoirs et des savoir-faire, des compétences de
chacun nécessaires à son évolution et à ses profits en
même temps qu'une obéissance absolue fallacieusement
compensée une consommation sans frein (du travail et
des jeux !), il ne peut s'empêcher de constater les
prémisses de ce qui arrivera inévitablement le jour où
l'intelligence des nations, l'intelligence de la société
civile sera assez forte pour contrebalancer voire pour
combattre toutes les aliénations. On commence d'ailleurs
à le voir : les jeunes générations sont moins sensibles aux
mirages qu'on leur propose : une trompeuse réussite
sociale payée par un stress insupportable, le règne absolu
du veau d'or, la fuite en avant vers un toujours plus
forcément insatisfaisant, la massification des goûts et des
choix… Un monde de frustrations dont les illusoires
164
garde-fous mis en place par le système s'estompent : la
religion, la morale républicaine, le respect de la
hiérarchie, de l'argument d'autorité, du savoir, du travail
voire de la propriété…
Les foules qui manifestent contre les abus bancaires, les
occupations d'usines, les initiatives locales, le
mouvement des Indignés voire les événements en
Égypte, Libye, Tunisie, Syrie en sont le signe avantcoureur
avec un élément remarquable : ces mouvements
se font avec des foules très mêlées, parfois peu marquées
par l'école, mais qui ont tout de même profité de savoirs
véhiculés par les médias. On pourra toujours alléguer que
les foules tunisiennes par exemple ou libyennes ont été
instrumentalisées par les Islamistes, il n'en reste pas
moins qu'elles ont refusé de continuer à croire aux
promesses creuses des dictateurs qui les méprisaient et
les gouvernements Islamistes qui découleront de ces
bouleversements devront en prendre bonne note !
À l'école, le prof est plus que jamais déconsidéré parce
qu'il représente l'agent d'un étouffant système de plus en
plus mal ressenti. Il est un des derniers matons qui, en
apparence, cherchent à imposer le vieil ordre voulu par
un système économique qui échappe à tout contrôle, à
toute justification, à toute réflexion. L'école elle-même,
telle qu'elle est, ne fait plus illusion et chacun sait que
l'élève est payé - dans sa majorité - en monnaie de singe.
Les diplômes sur lesquels s'appuie une méritocratie en
paroles ne valent plus grand-chose et il en faut toujours
davantage pour espérer profiter des avantages que
quelques-uns tentent de préserver. Demain, on sera
instituteur avec un bac plus sept !
Le malaise est grand et touche tous les membres de la
communauté enseignante : les usagers (les "usagés"
165
pourrait-on dire) d'abord, élèves, parents et professeurs,
mais aussi le monde politique et les donneurs d'ordre.
Du côté des élèves, désillusion, ras-le-bol
et contestation.
Pour les premiers, pour les élèves, on assiste à une
véritable révolution des comportements qui mène à une
résolution de la schizophrénie inhérente au système : le
brave élève qui accepte quasiment tout ce que l'on veut
de lui et qui dissimule sa vraie personnalité pour la vivre
éventuellement ailleurs que dans le cadre scolaire se fait
de plus en plus rare.
Jusqu'alors, l'élève était docile. Le prof respectait son
chef d'établissement et son inspecteur, le chef
d'établissement respectait le Recteur… Tout ce monde
appartenait encore en grande partie à la même famille.
Une société des connivences : on partageait peu ou prou
les mêmes "valeurs", les mêmes idées fondamentales,
ce qui était loin de vouloir dire qu'il n'y avait pas
diversité d'opinions, sinon, il n'y aurait jamais eu ces
soubresauts de l'histoire qui, d'une manière ou d'une
autre, un peu comme les modifications génétiques, font
évoluer les choses. Comme dans les meilleures familles,
les disputes, les querelles et les répudiations existent. Il y
a toujours quelque part un fils prodigue mais le retour de
ce fils prodigue est de toute façon prévu et source de tant
166
de joies feintes ! Il est d'ailleurs tout à fait pertinent de se
demander si ces soubresauts justement ne sont pas eux
aussi inscrits, programmé dans ce grand tout dont fait
partie le monde de l'école. Cela ne signifiait donc pas
que cet élève (ou le prof, ou le chef d'établissement, ou le
Recteur, ou…) n'eût aucune réflexion personnelle, qu'il
fût fait d'une pâte essentiellement malléable ! Il avait
pour sa part simplement enregistré les règles d'un
système qui réclame l'impersonnalité, la répétition, le
rabâchage, le masque. Son véritable moi se développait
comme en retrait, à un autre niveau : en classe, dans
l'amphithéâtre, il parlait la langue du prof, la langue
qu'on attendait de lui avec les quelques variantes plus ou
moins autorisées, mais il avait, lorsqu'il était seul, avec
ses amis, quand il était en confiance, son propre idiome,
son jardin secret. Derrière les apparences lisses et
standardisées qu'imposaient son enseignement, son
éducation, se développait une autre personnalité, riche,
rugueuse, insaisissable, désireuse d'originalité, mais
dissimulée. Sans aller jusqu'à dire que notre
enseignement favorisait (ou favorise encore car rien ne
change radicalement) les psychoses, voire une sorte de
schizophrénie particulière, il est clair qu'il poussait
(pousse) à la sournoiserie, aux faux-semblants, à une
certaine hypocrisie prudente et surtout, en profondeur, à
une distance prise avec ce qui était enseigné.
Tant que le modèle scolaire prolongeait, doublait,
accompagnait le modèle patriarcal en vigueur dans les
familles, les choses sont allées leur train de sénateur, leur
petit bonhomme de chemin, assez confortablement.
Petites filles modèles et garçonnets respectueux devant
un papa façon Robert Gérane et une maman Folcoche,
élèves attentifs et silencieux devant un Maître impérieux :
167
mais, "par derrière", on n'en pense et on n'en réagit pas
moins.
Le petit Français a appris à vivre à deux vitesses, à avoir
deux vies, deux langues, deux mimiques.
Une richesse dans un sens !
Mon expérience à la tête d'un établissement bilingue dépendant de
l'AEFE et accueillant deux populations d'élèves, allemands et
français, est à la source de cette réflexion. Les premiers
réagissaient en général beaucoup plus spontanément, beaucoup
plus directement que leurs condisciples français. Ils n'hésitaient
pas, en cours, à intervenir, à donner leur opinion, voire à critiquer
avec un aplomb et une sûreté surprenants chez de très jeunes gens.
Face à la direction et aux enseignants, ils se comportaient le plus
souvent sans complexes comme des partenaires (idées et
propositions pour l'organisation d'activités diverses, pour l'avenir
de l'établissement… ; interventions lors des conseils de classe,
demandes d'éclaircissement sur certaines décisions des conseils de
classe, sur les programmes, sur le bien-fondé de certains
apprentissages…) Face à l'ensemble des élèves, ils représentaient
leur lycée et combattait tout vandalisme, laisser-aller, dégradations
diverses… Ils étaient les défenseurs des droits des élèves mais
aussi les gardiens attentifs de ce qu'ils considéraient être leurs
devoirs. Par contre, leurs camarades français, dans leur majorité et
surtout les premières années, étaient remarquables par leur
mutisme : peu de participation orale en cours, peu de dialogue avec
les enseignants ou la direction. Ils gardaient les distances,
présentant toujours à l'observateur une façade lisse et
respectueuse, en apparence, des règles. Le lycée n'était pas tant
leur lycée que l'endroit où ils devaient séjourner pour effectuer
leurs études, un lieu où la volonté parentale les avait placés. Ils
fuyaient plutôt les contacts qu'ils ne les suscitaient.
Inviter un élève allemand à venir donner son opinion sur ce qui
allait bien ou mal dans l'établissement, c'était s'engager dans une
longue discussion face à un jeune à l'aise dans le fauteuil où il
s'était installé. Inviter un élève français au même exercice, c'était
avoir devant soi une jeune fille ou un jeune homme à l'évidence
sur ses gardes, la pointe des fesses sur le bord du siège, peu
loquace ou veillant à ne livrer que des paroles convenues et sans
168
conséquences, se précipitant vers la porte dès la fin de
l'entretien" !
Heureusement, dans cet établissement vivant très bien
l'autodiscipline (qui exige en fait une vraie discipline), le jeune
Français ne tardait pas à abandonner ses réflexes culturels à la
frontière et à adopter dans l'établissement une conduite qui ne le
distinguait guère, en fin de scolarité, de ses camarades allemands !
En revanche, depuis que les certitudes d'une certaine
tradition commencent à chanceler, depuis que tout fout le
camp comme on s'est amusé à le dire et à le répéter,
depuis que les nouvelles classes dangereuses ont accès
aux études, avec stupeur, ni les parents ni les maîtres ne
reconnaissent leurs chères têtes blondes et ces dernières
sont moins enclines que jamais à danser, disons, pour
faire image, une vie durant, le ballet Jekill/Hyde ! Les
problèmes commencent alors ! Révolution culturelle !
Bouleversements ! Rien de sûr désormais… La chienlit
du Général et les solutions à la Sarkozy, le karcher.
On a déjà connu ça lors de la Révolution, la Grande : à la
base un refus des "Pères" ! Anacharsis Cloots
écrivait bien avant les événements de 1789 :
Le respect craintif, la vénération profonde pour les
vieillards, tant recommandée par les moralistes, est la
source de mille maux en politique. L'Orient est engourdi
par l'ascendant de la vieillesse ; on a cherché la cause
de la stagnation des sciences et de la durée du
despotisme dans ces contrées immenses ; je la trouve
dans l'autorité des vieillards, pendant que le savant
Bailli la cherche en vain chez un peuple primitif, inconnu
à lui et à nous. Les républiques anciennes qui donnaient
le droit de vie et de mort sur leurs enfants devaient par
cela seul marcher vers la décadence : l'ignorance des
pères accumula les erreurs des enfants ; les préjugés se
169
multiplièrent avec les générations.
Et, en 1793, à quelques jours de sa propre et fatale
arrestation, il notait avec une satisfaction prématurée :
Les fils, malgré leurs pères, ont sauvé la patrie dans
notre mémorable Révolution. L'obéissance des enfants
eût bouleversé toutes nos villes à parlements et à sièges
royaux. Nous étions perdus, si la verte jeunesse avait
sanctionné les erreurs des faibles vieillards.(…) Notre
Révolution est l'oeuvre des jeunes gens. Il y a plus de nerf
et de civisme dans un écolier de 4e que dans les quatre ou
cinq académies du Louvre.
Il suffit de regarder l'âge des hommes de la Révolution
pour nous convaincre de la justesse de ses propos, nous
qui attribuons des brevets de jeunesse aux quinquas et
sexas qui nous gouvernent ! Le problème est que les
jeunes gens d'aujourd'hui sont les vieillards de demain !
Depuis pas mal de temps, donc, la fameuse connivence
culturelle qui cimentait l'échafaudage scolaire s'effrite de
plus en plus. Certains rejettent la faute sur les soixantehuitards
qui auraient sapé les fondements de l'ordre
traditionnel. Dans ce cas, hommage leur soit rendu, mais
regret que leur action ait été récupérée ou plutôt qu'ils
aient été les très innocents instruments d'une évolution
qui devait, par un surprenant retour des choses, se passer
au bénéfice d'un système peu enclin aux cadeaux et aux
explosions libertaires.
Aujourd'hui, ces cohortes de jeunes gens menées à la
baguette-carotte vers le baccalauréat, ces cohortes
dressées à devenir les braves rouages du système et les
non moins braves consommateurs des produits de leur
travail (moins évidemment les plus-values encaissées par
170
d'autres, l'érosion de leurs ressources par le jeu de la
spéculation et de la dévaluation, les réflexes
consommatoires induits et cultivés) semblent avoir
décidément pris à leur propre jeu les instances qui les
manipulent : les nouvelles générations refusent la
contradiction qu'elles ressentent désormais entre les
apparences données par le discours scolaire, ses
promesses et la réalité de la vie qui leur sera imposée.
Elles prétendent obtenir ce qu'on leur a fait miroiter.
Pour ces générations, ces bacs (bons marchés) dont on les
décore doivent avoir la même valeur que les
baccalauréats que passaient jadis les enfants de la
bourgeoisie. Elles veulent tellement croire au miracle des
études, à l'ascenseur social dont on leur a rebattu les
oreilles qu'elles souhaitent obtenir la récompense des
efforts qu'elles pensent avoir consenti sur les bancs de
l'école, du lycée et de l'université, les monnayer puisque
la seule valeur qu'on leur a inculquée est celle de l'argent
et de la consommation (en apparence) facile. Le jeune en
possession de son diplôme n'est plus prêt à accepter
n'importe quoi, à être traité comme les générations
passées qui n'avaient eu droit qu'à quelques années
d'école. Il se met à revendiquer directement
(manifestations, violence, abstention lors des votes, choix
de candidats extrémistes…) ou indirectement
(absentéisme, maladies, accomplissement à la limite de
l'acceptable des tâches imposées…). ll réclame en bref
les dividendes des placements qu'on l'a amené à
effectuer…, ou un autre monde.
En outre, si la démocratisation apparemment complète de
l'institution scolaire, l'accès généralisé au bac et aux
études supérieures se fait au premier chef en raison de la
171
demande en compétences de la société productive, la
réification induite des individus possède naturellement
son revers. Revers pour le système qui l'a mise au point,
bien entendu, revers pour le système qui a cru avoir
inféodé l'école pour l'éternité. Certes, pendant des
siècles, son fonctionnement a été assez parfait : parvenir
à une adéquation totale entre la "mission" de
l'institution scolaire et les exigences socio-économico
politiques, tout en se dédouanant en exhibant de plus en
plus le masque souriant d'une école qui serait au service
des individus et en laissant quelques soupapes de
sécurité : les discours des pédagogues, les tentatives
pédagogiques, les réformes scolaires, les statistiques
montrant la croissance du nombre de diplômés, la
publicité faite sur la réussite scolaire de tel ou tel "Petit
Chose"… Mais dialectique historique oblige comme
l'auraient jadis écrit les vieux marxistes, la mise en coupe
de la quasi-totalité des individus s'est payée du besoin de
leur accorder en même temps et globalement plus de
"culture", de réflexion, d'intelligence pour parvenir à
remplir des tâches de plus en plus complexes et il arrive
un moment où le système bascule : le plus de savoir
nécessaire à la pérennisation des structures de
domination, se retourne contre le dominateur puisque le
dominé est à même désormais de mieux comprendre
l'aspect négatif de sa situation et de réagir contre. La
monarchie absolue a joué la montée de la bourgeoisie -
agglomérat de personnages possédant la culture
nécessaire à la gestion de l'État absolutiste mais n'ayant
aucune existence politique - contre la menace que
constituait l'aristocratie, rival qu'il convenait de réduire
au silence, "d'encager à Versailles" en lui refusant tout
pouvoir réel. On connaît le résultat : sûre d'elle-même et
172
de ses capacités, la bourgeoisie a pu développer un esprit
de corps puis de classe, des valeurs propres et s'est
imposée à cette monarchie absolue qui croyait la tenir en
laisse.
L'élève, le jeune, en est au même point : il s'indigne, il
revendique, il refuse.
Notre époque voit aussi la fin des fausses modesties, de
l'acceptation d'un destin tout tracé. Les médias, les
modes, la culture moderne donnent l'impression à chacun
d'avoir les mêmes droits que l'autre. La langue ellemême
s'est "démocratisée", simplifiée : au diable les
registres de langue, tout le monde semble parler le même
idiome bon enfant. La faute n'existe plus. La forme est
secondaire, seul le message compte, comme l'ont seriné
les linguistes. Tout le monde (ou presque !) boit du
champagne et déguste du foie gras, tout le monde (ou
presque !) possède une voiture, tout le monde (ou
presque !) peut passer des vacances sur des plages
enchanteresses, tout le monde (ou presque !) profite des
mêmes libertés sexuelles (ou presque), des mêmes
drogues (ou presque), des mêmes pratiques sportives (ou
presque)… On ne se pose pas la question de savoir si le
champagne consommé à la Tour d'Argent est le même
que celui proposé en promotion par Lidl ou Max Plus, on
ne veut pas savoir que les trois tranches de foie gras de
canard vendues en pack plastique par telle grande surface
n'ont rien à voir avec le bloc de foie gras d'oie Rougie
proposé par Fauchon, on feint d'ignorer que la semaine
de vacances à Mallorca pour 199 euros tous frais compris
n'a qu'une lointaine ressemblance avec la semaine passée
dans la suite d'un ressort-hôtel de Tahiti ou de Floride où
une seule nuit revient à 1000 ou 2000 euros…
173
Je suis donc comme tout le monde et j'ai les mêmes
droits. Finies les hiérarchies, toutes les hiérarchies,
qu'elles soient fondées sur la naissance, la richesse, la
culture, le savoir et les diplômes. Chacun peut devenir
riche, célèbre, envié, désiré : nous n'allons tout de même
pas accepter qu'on nous relègue au niveau de nos pères !
Paradoxalement, dans ce monde massifié, "grégarisé",
la revendication de l'individualisme est devenue la
marque des temps. Chacun veut, exige son droit au
bonheur clamé, mis en images par les médias et le
système, son droit à la réussite matérielle promise, à
l'argent et cela le plus vite possible, immédiatement.
Il est vrai que, contrepoids à cette massificationmondialisation,
le discours du système (la politique,
l'économie, la publicité, les médias) tend à faire accroire
cette idée que chaque individu n'a jamais été aussi
"unique" qu'aujourd'hui !
Ce système, pour se prolonger, a été amené à emboucher
cette trompette de l'individualisme-roi, à flatter les
individus dans le sens de leur singularité supposée, à leur
faire croire qu'en s'habillant comme tout le monde, en
écoutant la musique produite par l'industrie du CD, en
regardant les films produits par l'industrie du cinéma, en
assistant aux concerts organisés par les industriels des
events qui font tourner leur écurie, en croyant aux mythes
vulgarisés par les médias, en acquérant les mêmes
diplômes…, on serait néanmoins unique et parfaitement
heureux. Tout cela accroît l'égoïsme naturel et entre en
contradiction avec la réification qui s'empare de chacun
et dont on prend conscience de temps en temps avec
horreur ! Plus dure est la chute : les pauvres sont encore
plus pauvres, les attentes sont sans lendemain, le
chômage, la crainte de l'avenir, la peur de l'écocide qui
174
menace un monde livré au toujours plus, s'emparent des
esprits et des corps. Le clinquant, les images cathodiques
ou digitales, le bling-bling ne satisfont plus : no future !
Alors, le choix est simple : soit l'apathie, la fuite vers
d'autres paradis, artificiels, le désir de mort ou la révolte,
l'indignation dont on parle tant depuis quelque temps. Ne
plus être joué devient le mot d'ordre, faire coïncider la
morale avec les faits, peut-être, comme le proclamait
encore Anacharsis Cloots la veille de gravir les marches
menant à la guillotine.
Cette révolte, ce refus d'entendre les beaux discours est
entré dans l'École, s'est immiscé dans les esprits. On
commence à ne plus croire en cette École qui n'a pas su
changer vraiment d'esprit et de forme. On ne croit plus
en ces profs qui apparaissent trop comme les derniers
mainteneurs d'un ordre qui se défait, les CRS d'une
institution en pleine déréliction. On ne croit plus en cet
avenir qu'on nous promet par l'intermédiaire de diplômes
dévalués. On a conscience de n'avoir qu'une vie. On veut
le bonheur et on se demande si ce bonheur est vraiment
inscrit dans les finalités matérielles offertes à la
consommation, dans l'électronique et ses mondes
virtuels, dans les objets et les loisirs de masse…
La société française se caractérise en outre dans sa
composition par l'ouverture qui s'est faite (non sans
difficulté) aux filles et fils de l'immigration. La part
importante de ces jeunes gens dans l'ensemble de la
population scolaire aide aussi à mieux comprendre la
méfiance dont est désormais entourée l'institution
scolaire.
Une nation renfermée sur elle-même peut célébrer à
175
l'infini ses propres mythes, ses a priori, ses stéréotypes.
Sans l'apport d'un sang nouveau, elle serait condamnée
au mieux à un immobilisme qui lui ferait, peut-être,
accepter comme allant de soi ce que les générations
précédentes lui ont transmis.
Le monde moderne d'abord, la mondialisation en marche
depuis plus longtemps qu'on ne le dit généralement ne
permettent plus cette isolation source d'un conservatisme
total. Or, les générations d'immigrés arrivés en France
depuis la fin de la guerre de 1914 et surtout depuis les
années soixante représentent ce sang nouveau susceptible
d'amender le monde dans lequel ils sont entrés de force.
Ces immigrés ont aussi été une concession accordée au
reste de la population qui a cru ainsi se retrouver dans la
position du maître face à ces nouveaux venus. Ils étaient
surtout le tribut à payer à une évolution qui oblige à aller
chercher ailleurs qu'en France les travailleurs non
qualifiés et bons marchés dont le système économique a
besoin. Ces nouveaux esclaves arrivent donc pour
constituer les bataillons de producteurs qui ne coûtent
quasiment rien, d'autant plus qu'on pense les renvoyer
quand ils ne seront plus nécessaires.
Mais là encore, on s'est trompé. La décolonisation, une
main-d'oeuvre moins manoeuvrable qu'on le prévoyait, les
réactions d'une partie de la société civile, des
organisations syndicales et humanitaires, de certains
partis ont fait que ces gens ont difficilement, au cours de
longues années, tout de même réussi à obtenir un certain
nombre de droits élémentaires et ceux qui ne devaient
être qu'une main-d'oeuvre d'appoint taillable et corvéable
à merci ont pu (encore imparfaitement) s'imposer dans la
société française à un tel point que leur absence serait
aujourd'hui impensable : la France est cette mosaïque
176
jamais complète de citoyens venus de tous les horizons et
qui font souche sur son territoire. Qui font souche, mais
qui n'oublient - pas plus que le Breton, le Corse ou
l'Alsacien - jamais leurs origines. Ces gens venus
d'ailleurs ont considéré les habitudes françaises avec le
regard de l'Usbek des Lettres persanes, le regard naïf de
celui pour qui les habitudes, les traditions, les vérités
établies n'ont rien de sacré. Le roi est nu à leurs yeux !
Cette jouvence d'une vision neuve a certainement
beaucoup apporté à la France et lui apportera encore, car
elle seule est capable de montrer ce que les habitudes font
qu'on ne remarque plus.
En particulier, les jeunes gens issus de ces familles et de
cultures n'ont pas été préparées à idolâtrer l'école laïque,
et n'ont que faire des images d'Épinal, de ces enseignants
qui seraient les héros de la République, de cette
consensualité sur des valeurs établies avant eux, donc
sans eux. Protégés par leurs propres a priori, ils
considèrent avec distance le puéril folklore scolaire et ne
s'y sentent pas trop à l'aise. L'École a continué à
fonctionner ces dernières décades parce qu'elle a
bénéficié de préjugés habilement distillés dans les esprits
par le système économico-politique ambiant : vieille
dame respectable, qu'on peut certes chercher à
"améliorer" par des réformettes inoffensives, mais
qu'on ne doit pas mettre en question dans ses
fondements. La tradition et l'autorité, le respect sont une
obligation pour une école laïque et républicaine qui n'est
là que pour le bien de tous… Cette règle non écrite est
obsolète désormais. Les jeunes issus de l'immigration
savent sans doute mieux articuler leur colère contre un
système qui les déçoit et contre son alliée, l'École, qui
continuent à faire d'eux, dans leur majorité, les perdants
177
ou les parents pauvres auxquels on consent quelques
mendicités en osant par exemple parler de discrimination
positive ! Leur colère, leur côté iconoclaste ne reste
d'ailleurs pas leur seul fait, l'incendie se propage et tous
les élèves désormais, de quelque origine qu'ils soient, ne
voient plus l'École avec les yeux de leurs parents.
Avec une population scolaire dans laquelle ils
représentent une forte proportion, il n'est plus possible de
tenir les mêmes discours ni d'avoir les mêmes réponses
aux problèmes soulevés qu'il y a ne serait-ce que vingt
ans. Certains de ces jeunes ont fait souffler - parfois avec
violence - un vent de revendication dans les
établissements scolaires et c'est en les écoutant que
l'école pourra changer, se métamorphoser, car ils
représentent des jeunes gens qui ont besoin de tout autre
chose que de l'École poussiéreuse qui essaye de les
presser dans son moule dépassé. Par leur regard venu
d'ailleurs, ils sont le levain nécessaire à des
transformations qui devront prendre forme.
Dans le fond, on ne peut être que satisfait de voir que ces
générations nouvelles ont été, par leur refus de l'école,
les premières à dire ses vérités à cette vieille dame
indigne !
Si l'apport des enfants de l'immigration a servi pour une
part à débloquer la société et à relancer le
questionnement sur les formes et les finalités de
l'institution scolaire, un autre facteur est essentiel :
l'accession à "sa majorité" de la moitié de la population
française : celle des jeunes filles et des femmes. On l'a vu
plus haut : jusqu'au premier conflit mondial, l'éducation
scolaire féminine est traitée en parent pauvre. Pour le
système, la femme n'intègre pas encore réellement (bien
178
que le nombre des travailleuses augmente fortement
jusqu'en 1914) le monde de l'économie et de la
production. Son action est généralement considérée
comme négligeable et il ne paraît pas opportun de se
mettre en frais pour celle qui n'est considérée au mieux
que comme l'aide, voire l'esclave de l'homme. Les
choses cependant commencent à évoluer dès avant le
premier conflit mondial : la voix des femmes, leur
revendication se fait entendre et la place qu'elles
prennent au cours de cette guerre est considérée par tous
les observateurs et historiens comme le pas décisif dans
l'acquisition de droits qui les amèneront très
progressivement à la parité juridique avec leurs
homologues masculins. Sans entrer dans le détail d'une
prise de conscience et d'une transformation de la
condition féminine (toujours incomplète : les mentalités
évoluent lentement) sur les plans psychologiques,
sociaux, juridiques et politiques, on peut noter que
l'école mettra tout de même environ un demi-siècle à
prendre la mesure des évolutions en cours. Jusqu'à une
date relativement récente, les sexes sont séparés et la
poursuite d'études demeure une des prérogatives
masculines : écoles de filles et de garçons, lycées de
jeunes filles et de jeunes gens, agrégation masculine et
féminine, impossibilité à un homme d'enseigner dans le
maternel… Désormais, au moins sur le plan théorique,
ces freins, ces réflexes, n'existent plus et l'institution
scolaire ne fait quasiment plus de différence entre les
sexes, même si les pesanteurs intellectuelles, parfois
ravivées, suivent avec un certain retard : l'enseignement
technique est toujours moins ouvert aux filles sauf dans
les filières destinées au tertiaire ; on se répète encore que
les jeunes filles seraient plus littéraires, les garçons plus
179
scientifiques…, tant de fariboles qui se survivent dans les
bureaux de la rue de Grenelle comme dans le secret des
conseils de classe.
Cette accession à sa majorité donc de la population
féminine, au moins autant que l'apport des enfants de
l'immigration, ne pouvait se faire sans que le modèle
scolaire machiste dans son essence ne soit remis en
question.
Du côté des enseignants : des hussards de
la République au prolétariat intellectuel…
Si du côté des élèves, l'impatience face à l'institution
scolaire se généralise, c'est au moins autant le cas chez
les enseignants. Nous sommes désormais loin de la
période glorieuse de l'instituteur et de l'institutrice en
blouse grise et de la mythologie dans laquelle on les a
drapés. La situation a bien changé. La position sociale
n'est plus la même qu'il y a seulement quelques années
encore et le travail est tout autre. L'enseignant est devenu
la bonne à tout faire en matière d'éducation. Mal préparé
à toutes les tâches qu'on lui demande, il est à la fois
chargé de garder les petits pour - officiellement -
socialiser les enfants, pallier les différences sociales en
assurant à tous les mêmes chances de départ, permettre
aux parents de vaquer à leurs occupations
professionnelles ou autres. Il doit éduquer, intéresser,
amuser. On attend aussi de lui qu'il transmette savoirs et
180
savoir-faire…
Il y a peu de temps encore, les choses étaient plus
simples. Je peux en témoigner !
Jadis et Naguère
Le jeune Renan disait être entré en Allemagne et avoir cru pénétrer
en un temple, le Temple du savoir et de la philosophie. Mon
émotion devait être à peu près la même que la sienne lorsque,
bachelier tout frais émoulu, échappant enfin au ronron des cours du
lycée, je fis mes premiers pas dans le hall de la Faculté des lettres
de Rennes. Mai soixante-huit venait de passer et l'Université avait
jeté au feu la toge ou le costume trois-pièces pour enfiler des
jeans : elle se voulait désormais au moins en surface foncièrement
irrespectueuse et libertaire. La vieille dame coincée s'était
transformée en une pétroleuse irrésistible.
Disait-on.
Les Premières années, les bleus comme moi, avaient en apparence
tous les droits, rien n'était plus imposé. Le carcan des siècles
passés avait laissé place à la bride sur le cou ! Alors que les "libreservice
" commençaient à se développer dans le pays, il était tout
naturel que ce monument de la tradition qu'était l'université évolue
aussi dans ce même sens d'une inimaginable et infinie liberté.
Nous avions le droit de choisir nos enseignements, de faire nos
emplettes en quelque sorte, le panier à la main, dans un
gigantesque marché des idées. Les murs de l'amphithéâtre où
avaient lieu les inscriptions étaient couverts d'immenses listes
bariolées qui proposaient aux futurs étudiants un nombre
incroyable de cours et de combinaisons de matières possibles. On
pouvait s'inscrire en lettres, mais en même temps en philo et en
psycho, en dramaturgie, en arts plastiques... Si l'envie vous en
prenait, vous pouviez ajouter à votre sélection d'autres
"valences" : de l'anthropologie, de la musicologie, de l'histoire
de l'art voire des mathématiques "modernes", du breton ou des
langues anciennes grâce à des cours pour grands débutants dont
certains étaient programmés le soir afin de permettre aux étudiants
travailleurs de profiter des mêmes chances que leurs camarades
181
plus favorisés par la fortune. Nous applaudissions à de telles
débauches de générosité, à de telles avancées sociales, ne
cherchant d'ailleurs pas à imaginer la fraîcheur du malheureux
étudiant-travailleur à la fin de sa journée !
La seule inscription en lettres vous amenait donc à vous décider
pour un certain nombre de cours ou d'unités de valeur (!) parmi
une offre aussi diverse que variée. Ainsi, chacun faisait-il ses choix
attiré par les intitulés les plus flamboyants, les plus étranges, les
plus baroques. Comme dans les halles de la place des lices, le
marché hebdomadaire de Rennes, on pesait et repesait les offres,
on les flairait, les tâtait, les plaçait précautionneusement au fond de
son porte-documents, on y renonçait ensuite parce que l'étal
suivant proposait quelque chose d'encore plus alléchant, de plus
surprenant, de plus inattendu, d'absolument inconnu mais si riche
en potentialités : la littérature comparée, la linguistique, la
sémiotique, le structuralisme, des auteurs du second rayon appelés
à un nouvel avenir, "Les petits Romantiques", "Le roman
policier", "Romans de gare et romans photos", "Le théâtre de
l'absurde", "Le nouveau roman", "L'OULIPO"… Les héros du
moment s'appelaient Goldman, Lefebvre, Barthes, Richard,
Jakobson, Foucault, Deleuze, Derrida, Lévi-Strauss, Saussure,
Piaget, Chomsky, Greimas, Kristeva, Georges Bataille, Gilbert
Lely… Ils rejoignaient leurs grands aînés dont on avait entendu
vaguement parler en classe : Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Freud,
Marx et son copain Engel…
Je restai en équilibre sur un pied devant une grande affiche qui
faisait ainsi la retape :
"La clef du structuralisme analysé dans ce cours est le primat de
l'opération, avec tout ce qu'il comporte en épistémologie
mathématique ou physique, en psychologie de l'intelligence et
dans les relations sociales entre la praxis et la théorie. C'est en les
coupant de leurs sources que nous tenterons d'aboutir à faire des
structures des essences formelles lorsqu'elles ne demeurent pas
verbales : c'est en les y replongeant que l'on rétablira leur
solidarité indissociable avec le constructivisme génétique ou
historique et avec les activités du sujet. Le cours aura lieu le mardi
de 13 heures à 15 heures. En raison des TP, le nombre de
participants sera limité à 30."
Tout cela me paraissait tout de même fort compliqué et, reprenant
ma déambulation, je passais au stand suivant où un grand maigre
182
barbu promettait une nouvelle lecture parallèle de Rimbaud et de
Corbière à partir des écrits de Wilhelm Reich… Il avait l'air sympa
ce type. Les Amours Jaunes me tentaient (un titre pareil flattait ma
curiosité et puis ce Corbière-là était breton comme moi) ; on disait
en outre que Reich allait bien plus loin que Freud, mais, réflexion
faite, le Dormeur-du-Val qui n'était pas-sérieux-quand-on-a-seizeans
entrevu au lycée ne m'attirait plus trop… On avait passé des
heures d'ennui et de récitations ânonnées avec un prof qui, en
guise d'explication, ne savait que se gargariser du "génie
précoce" de Rimbaud, ironiser sur notre propre nullité et nous
conseiller avec condescendance d' "en prendre de la graine".
En définitive, j'avais choisi de faire un peu de philo, un rien de
psycho et d'ajouter une pincée d'histoire de l'art au plat de
résistance constitué par la littérature, ne me décidant, par curiosité
ou par conformisme moderniste, que pour une initiation à la
linguistique. La grammaire - qu'elle soit structurale ou générative
- ne m'intéressait pas. Je n'en avais plus fait depuis la quatrième et
tout le monde s'accordait pour affirmer qu'avec toutes ses règles
arbitraires, elle était parfaitement ringarde et inutile. Un instrument
de classe par excellence auquel nous, les enfants de Mai et d'un
Marx jamais lu mais toujours revendiqué, n'allions tout de même
pas accorder nos faveurs. D'ailleurs les deux profs qui, seuls dans
leur coin, proposaient ce cours, avec leurs cheveux coupés en
brosse et leurs costumes étriqués façon IVe République, leur collier
de barbe à la Robert Hue avaient l'air particulièrement réacs, ce
qui était une preuve du bien-fondé de l'exclusion dont ils étaient
les victimes, une caution de notre mépris.
En littérature, je jetai mon dévolu sur les Petits Romantiques parce
que cet intitulé m'intriguait : Auguste Barbier, Claude Tillier,
Louis Ménard, Pétrus Borel, Célestin Nanteuil, Philothée
O`Neddy, Xavier Forneret, Aloysius Bertrand, Aloysius Block…,
tous ces jeunes gens pétris d'idées ardentes et généreuses, ces
génies maltraités et qu'il convenait de ressusciter, ces mal-aimés
honteusement oubliés de Lagarde et Michard. Je trouvais
scandaleux que ces malheureux aient dû attendre 1968 pour que les
gardiens de l'establishment, les chiens de garde de la bourgeoisie,
soient contraints de leur concéder une petite place dans le
Panthéon littéraire occupé par les gloires établies. Un impératif
moral catégorique guidait mes choix, un sentiment de justice me
183
poussait donc vers eux. Puis, je m'inscrivis à un cours sur L'Idiot
de la famille, parce que ce titre me plaisait et que j'allais enfin
faire du Sartre, Sartre que les profs du lycée évoquaient en pinçant
les lèvres ou en nous laissant entendre les paradis sulfureux de la
planète existentialiste. Je fus aussi tenté par un cours sur la
Pornographie au siècle des Lumières, à une étude du roman
prolétarien : Poulaille, Dabit, Constant Marva, sur lequel,
d'emblée, je choisis de faire un exposé bien que n'ayant ni lu une
seule ligne de cet auteur ni même jamais entendu parler de lui ! Sa
qualité de "mineur du Borinage" suffisait à le rendre attirant !
Mon voisin de table se rabattit - à partir des mêmes critères sans
doute - sur Rose Combe, garde-barrière auvergnate... Je décidai
aussi de prendre part à une série de conférence sur le Théâtre de
l'absurde. Bien que n'ayant jamais de ma vie mis les pieds dans
une salle de théâtre, je préférais négliger les Classiques parce
qu'ils ne pouvaient être que dégouttant d'une arrogance
insupportable. L'absurde me paraissait être plus près des réalités et
plus caustique, plus décapant, plus dans l'air du temps. Beckett,
Adamov ou Ionesco, cela changeait des Molière, Racine et
Corneille vaguement rencontrés au lycée et synonymes d'ennui.
Voilà. Ma première année s'est d'ailleurs bien terminée.
Les autres aussi. Je me suis passionné pour l'Imagologie, le roman
policier, le roman noir, le mélodrame, le roman initiatique au
XVIIIe siècle… J'ai glosé comme je pouvais sur le nouveau roman
alors que j'avais à peine feuilleté Balzac ou Zola. Je me suis pris
de passion pour Pédro Arrabal et Ariane Mnouchkine quand je
n'avais lu que Le Cid, Phèdre et Le médecin malgré lui en matière
de classiques. Je fis ma maîtrise sur Léo Malet et passai un
certificat sur La Maison du peuple de Louis Guilloux, mais
j'ignorai les ouvrages de Proust, Gide, ou Mauriac. J'ai fait
semblant d'adorer les surréalistes parce que cela se faisait, mais je
n'avais plus vu une ligne de Hugo depuis l'école primaire. J'ai
même eu 18 sur 20 à un exposé sur Les premiers échos de
l'inconscient chez Proust, dont j'avais au mieux feuilleté quelques
pages à la bibliothèque universitaire entre deux rendez-vous
amoureux, et réchauffé les poncifs traînant dans l'Histoire
littéraire des éditions sociales et un "Que Sais-je ?" rapidement
survolé !
184
J'ai passé mes concours avec succès puisque j'étais devenu maître
dans l'art de composer une dissertation selon les règles et que je
savais mettre en application cet aphorisme qui fleurissait sur les
murs de la Sorbonne : La culture, c'est comme la confiture : moins
on en a plus on l'étale. Et moi, j'étalais avec assez de doigté ce
que je m'étais mis à apprendre à marches forcées dans le Lagarde
et Michard exécré quelques années plus tôt, pour faire bonne figure
lors de ces concours : un peu de chacun, un saupoudrage
généralisé, les clichés les mieux établis... Rutebeuf, l'ancêtre de
Villon ; Rabelais, le géant, Agrippa ou le poète sous le harnais ;
Ronsard, l'Orphée du Vendômois ; Cyrano dans la lune ; le viril
Corneille, Racine si féminin ; Molière, le Martyr du théâtre ; La
Fontaine, notre Homère ; Montesquieu le Sage ; Diderot,
philosophe et pornographe ; le chat Voltaire ; le sensible
Rousseau ; Chateaubriand le rêveur ; Hugo le poète engagé ;
Lamartine et son lac ; Rimbaud le révolté ; Zola le naturaliste….
De quoi faire illusion, le digest d'un digest. Pauvre nourriture !
Je me suis donc retrouvé devant mes élèves, prêt à leur resservir ce
que j'avais appris pour qu'ils en prennent de la graine.
Pendant des années donc j'ai bravement fait mon travail
d'enseignant et de fonctionnaire respectueux, comblant mon
indigence intellectuelle par des préparations intensives et
rébarbatives faisant la part belle à la compilation. J'ai fonctionné
comme on le voulait. Petit engrenage au coeur de la grande
machine Éducation Nationale. Cependant, fonctionner avant et
après 68 n'avait pas tout à fait la même signification. Avant,
l'éducation nationale, c'était la grande muette ; après il fallait en
plus donner l'impression d'avoir l'esprit critique, d'être capable de
s'encanailler en entraînant les élèves hors des sentiers battus de
Lagarde, Michard, Castex tout en respectant cependant les
programmes. Alors, il convenait de reprendre - à dose
homéopathique - ce que l'on avait fait en fac : accueillir quelques
minores en ironisant sur les vieilles barbes, s'intéresser au romanfeuilleton,
aux journaux, aux revues, à la littérature de "kiosques
de gare", aux romans photos, à la pub… Il fallait introduire
prudemment de nouvelles techniques : les exposés à plusieurs pour
favoriser l'esprit de recherche et le travail de groupe, les panneaux
expositions, les discussions chaises en rond, le philips 6x6, les
incursions au CDI, les invitations d'auteurs, les projets culturels, le
théâtre, la vidéo… Il fallait en finir avec les manuels et faire
185
marcher la ronéo à alcool puis la photocopieuse car un-bon-proffait-
tout-du-début-à-la-fin : recherche de textes abordables par ses
élèves, préparation des activités, recherche de documents
iconographiques et cinématographiques, invention d'aides
pédagogiques, sans oublier le "ludique" car on n'apprend que par
le plaisir et le plaisir, c'est bien connu, ça se trouve dans le jeu !
C'était donc cette époque inénarrable où quatre malheureux élèves
serrés sur une estrade, une feuille en main, se poussaient du coude
pour se donner la parole, adressaient des petits signes aux copains
du fond de la salle, éclataient de fou rire ou, écrasés de timidité,
n'arrivaient pas à sortir une parole audible, ânonnaient ce qu'ils
avaient gribouillé sur leur pense-bête. Le prof faisait semblant
d'écouter, l'air inspiré, de prendre des notes. Il surveillait sa
montre. Huit minutes l'exposé, sinon, on ne s'en sort pas ! Allez,
aux suivants. On fera le bilan demain. Une note de groupe, un
corrigé distribué-à-lire-pour-la-semaine-prochaine-et-à-collerdans-
le-cahier et on passe à la suite. Dépêchez-vous s'il vous
plaît : on n'a pas que ça à faire !
C'était cette époque joyeuse où des profs de lettres (mais aussi de
mathématiques ou d'histoire) écrivaient avec leurs élèves des
livres policiers ou des recueils de poèmes, des contes illustrés et
des romans photos. Ils faisaient semblant de croire qu'ils ne
servaient que de guide et que le génie de leurs chères têtes blondes
était entièrement responsable du résultat final, tiré à trente
exemplaires, distribué aux parents ravis, à la bibliothèque du CDI
et à monsieur ou madame le proviseur qui y allait d'un petit
discours ému flattant l'imagination des jeunes, le dévouement de
l'enseignant et les lendemains heureux qui attendaient ces vingtcinq
jeunes gens si créatifs, si bien préparés à affronter les
difficultés de la vie.
C'était cette époque joyeuse où des profs montaient des pièces de
théâtre en transformant les jeunes en marionnettes, emplacements
marqués à la craie sur le plancher de la scène et costumes cousus
par une maman dévouée, avatars modernes des détestables Fêtes
de la Jeunesse de ma propre enfance...
C'était cette époque joyeuse où des profs organisaient des cafés
littéraires, des expositions en faisant comme si l'idée, la réalisation
venaient de l'enthousiasme juvénile des élèves. Les "jeunes" sont
formidables et moi je suis l'éveilleur celui qui permet ces
opérations hautement culturelles et susceptibles d'un grand
186
retentissement sur l'épanouissement de chacun… Le journaliste de
la rédaction locale passait parfois et la documentaliste recueillait
précieusement les découpures de journaux dans un press-book
qu'on ressortait aux grandes occasions.
Tours de passe-passe, illusions, illusionnisme, encensés par la
presse, les revues pédagogiques, les inspecteurs pédagogiques
régionaux, les missions culturelles académiques, les inspecteurs
d'Académie, les recteurs, le ministre, les concours, les sponsors
divers et variés : Crédits Mutuels, Caisses d'Épargne, BNP...
Nos jeunes sont formidables, notre système scolaire fait l'envie de
tous les pays du monde.
Nous sommes formidables.
Suis-je formidable ?
La parole de Madame ou de Monsieur l'Inspecteur Pédagogique
avait alors valeur d'oracle. Lorsque Son Autorité prenait la peine
de se déranger pour assister à un de mes cours et vérifier
l'orthodoxie de mon enseignement, c'était comme une apparition :
Sa Bonhomie soulignait l'excellence de mon travail, la valeur de
mon engagement, insistait sur mon avenir de professeur tout en
relevant, çà et là quelques petites incongruités, vénielles bien
entendu, qui n'entachaient pas la vision d'ensemble, mais
prouvaient que Son Autorité ne s'était pas déplacée pour rien. Avec
l'onction d'un prélat aux doigts boudinés, Sa Grandeur m'indiquait
alors d'une façon artiste, les quelques voies que je pourrais
emprunter pour améliorer encore ma pratique. Nous nous quittions
émus jusqu'aux larmes, lui ou elle devant ce brave fantassin de
l'éducation, devant ce Poilu qui en redemandait, et moi face à cette
Autorité si simple, si disponible, si républicaine, si satisfaite de
moi, si satisfaite d'elle-même. D'ailleurs, preuve indubitable de
cette collégialité, au moment de se serrer la main, Son Abnégation
daignait descendre de son nuage et prouver à l'inspecté qu'on le
considérait comme un collègue, comme un pair en s'intéressant
même à ses affaires intimes :
On m'a dit que vous effectuiez des recherches personnelles. Elles
avancent, ces recherches, cher collègue ?
Bien sûr, monsieur l'inspecteur, et…
C'est parfait mon cher. Continuez. Il n'y a rien de tel pour son
187
équilibre que de cultiver son jardin secret. Moi aussi je publie, pas
autant que je le voudrais, hélas ! mais notre métier est tellement
passionnant ! Au revoir et à bientôt. Dans deux ou trois ans peutêtre.
J'aimerais vous retrouver plus régulièrement, mais nous
sommes si peu nombreux !...
Napoléon pinçait bien l'oreille de ses grognards lors des revues.
Bien entendu, comme je mettais en pratique les conseils citoyens
qu'on me dispensait, ma carrière se déroulait au grand choix : je
franchissais les échelons rapidement et allègrement, le salaire
augmentait, les heures sup étaient majorées. Les inspecteurs
m'appelaient parfois - distinction insigne - pour préparer les sujets
de bacs, ceux de BTS et nous passions d'extraordinaires aprèsmidi
dans le Parnasse d'une inspection académique (car
l'inspecteur aimer à sonder la profondeur des provinces) à discuter
sur les textes et les sujets de dissertation que nous devions imposer.
Imaginez la salle Leclerc de Hautecloque, le portrait en pied du
chef de guerre, un drapeau tricolore recouvrant le coin supérieur
gauche du tableau, les hautes croisées entrouvertes sur un petit
parc vert sombre, les stucs au plafond, des corniches compliquées,
la moquette de haute lisse, des armoires ventrues cirées et
luisantes, quelques vieux livres dans une vitrine....
C'était l'occasion de longs débats où chacun des élus à ces
aréopages délicieux mettait son point d'honneur à lancer des
propositions irréalistes, mais au combien dignes de témoigner de
sa propre valeur intellectuelle, de son imagination, de son
originalité, de son modernisme érudit voire de son
anticonformisme… Une discussion de bas-bleus, une agréable
conversation de salon. Allions-nous proposer une phrase de
Wittgenstein ou un jeu de mots de Lacan pour ce bac ? Comment,
vous trouvez Lacan trop difficile pour nos élèves ? Mais l'humour
voyons, et la profondeur ! Nos jeunes s'y retrouveront plus vite
que vous ne croyez, cher collègue. Je puis vous assurer que… Moi,
dès la seconde, j'ai… D'ailleurs, l'interrompait un autre d'un geste
péremptoire, la subversion du sujet et la dialectique du désir
touchent particulièrement l'adolescent. À ce moment-là, ajoutait
narquoisement une sceptique, on pourrait s'interroger sur la
signification du phallus lors de l'érection du phare d'Ar Men !…
Na, na, na, mesdames et messieurs ! Pas de débat universitaire,
disait avec un bon sourire madame l'Inspectrice enchanté du
188
brainstorming que provoquait sa présence. Nous préparons les
sujets du bac ! Nous ne sommes pas en faculté, en licence, même si
vos propos se permettent quelques licences, voire licence ! Rires,
gloussements, rougissements, trémoussements de plaisir de la
basse-cour professorale… Vos intentions sont excellentes, mais
appuyons-nous davantage sur l'actualité, sur l'événementiel. J'ai
songé pour le bac G à un sujet dans le genre : Que pensez-vous des
nouvelles mères ? Nous utiliserions comme texte d'appui, un
article d'Evelyne Sullerot que j'ai apporté, là…
Tous sourires avalés, le collège des concepteurs de sujets se
penchait alors, mine sérieuse, soucieuse même sur le projet de
madame l'inspectrice. Il convenait de le trouver globalement bon
et intéressant, mais d'exprimer tout de même quelques réserves
assez solides pour montrer qu'on savait réfléchir, des réserves qui
ne devaient toutefois pas sembler décisives au point de vexer
madame l'IPR !
L'idée me paraît splendide, mais Évelyne Sullerot, je ne sais pas,
un peu trop catho sans doute… Mais mon cher, vous confondez
sans doute ! Sullerot catho ! Non ! Elle est socialiste, je vous
assure.
Et si on prenait un texte de la femme du ministre, ah ! comment
s'appelle-t-elle, la philosophe du féminisme ? Oui, la femme du
ministre de la justice… Vous voulez dire Élisabeth Badinter,
intervient une collègue charitable et condescendante ? Oui, c'est
cela, un texte de son histoire de l'amour maternel par exemple…
Ah ! Quelle belle biographie de Condorcet, elle nous a donné,
Élisabeth Badinter ! Condorcet, mais oui, l'auteur du fameux
projet d'éducation. Comment ? Vous ne situez pas ? Mais si…
Et pourquoi pas l'incipit d'Ainsi soit-elle alors, répliquait une
bonne élève entre deux âges ? Moi, je ne suis pas d'accord,
rétorquait un autre voulant se signaler à madame l'Inspectrice, car
il n'avait encore rien dit. Benoîte Groult, c'est tout de même un
peu léger pour le bac et Badinter, c'est toujours tellement
tarabiscoté. Sans son ministre de mari, son livre !... Je pense
comme madame l'inspectrice : Sullerot me convient mieux, et puis
nous avons le texte sous les yeux !...
Le temps passait et la proposition de madame l'inspectrice était
adoptée à l'unanimité. Quelle belle idée dans le fond ; quelle belle
journée avec son point d'orgue dans cet accord unanime sur le
texte choisi par Madame l'Inspectrice.
189
Et si nous allions prendre un café au coin de la rue du Rectorat,
proposait l'inspectrice ? En toute simplicité ! Il y a là-bas un petit
troquet pas mal du tout et nous l'avons bien gagné ce café. "Un
troquet" ! Madame l'inspectrice est délicieuse !
Les ordres de mission signés sur un coin de table pour obtenir le
remboursement des frais de déplacement, la garde rapprochée des
valeurs de la République, ses prétoriens respectueux emboîtaient le
pas à madame l'inspectrice et le petit groupe se dirigeaient alors
dans un joyeux brouhaha vers le caboulot fraternellement proposé.
On y évoquait les spectacles vus, les derniers livres lus. Chacun
attendait poliment son tour, se creusant la cervelle pour ne pas
paraître le nigaud de la bande.
Chacun payait sa tasse, bien entendu.
Ces années soixante-dix, c'était encore une époque
calme, tranquille. Les lycées ronronnaient. Une
association à bénéfices réciproques. Le Ministère avait su
intégrer quelques revendications soixante-huitardes et
nous avions l'impression - à condition de ne pas trop se
poser de questions - que tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Le nombre de bacheliers croissait,
l'objectif des 80% d'une classe d'âge au bac ne paraissait
plus utopique. Les mauvais esprits qui se plaignaient
d'une baisse des exigences ne disaient plus rien. Tout
semblait s'être normalisé. D'ailleurs, la généralisation
des jurys de bac ou de brevet, les ajustements
académiques et nationaux dans une perspective d'égalité
des chances, tout allait dans le sens d'une amélioration
des résultats.
Mais aujourd'hui, les jeunes professeurs sont de moins en
moins prêts à accepter le rôle qui a été celui de leurs
prédécesseurs : des vocations mal payées condamnées à
faire ce qu'on leur demande sans trop de réflexion. La
grande muette retrouve de la voix et l'enseignant n'est
190
plus d'accord pour exercer son métier comme une
vocation, avec une rigueur et une obéissance
ecclésiastique. Il exerce un travail comme un autre, il
exige qu'on honore ce travail comme il se doit et il refuse
de servir de bouc émissaire pour les problèmes de société
qui surgissent même s'il revendique de son appartenance
au service public.
De plus en plus conscient qu'on l'a relégué dans une
sorte de prolétariat intellectuel, il ne rêve pas d'un passé
prétendument glorieux, mais enrage d'avoir été tant de
temps le dindon de la farce et de l'être plus que jamais. À
quoi l'a-t-on réduit ? Un accessoire, un bras séculier, un
parlement croupion qui manifeste rituellement pour
défendre un statut de plus en plus précaire, pour lutter
contre des conditions de vie et de travail indignes.
Chaque enseignant fait ce qu'il peut à son niveau.
Certains s'effondrent et ils sont de plus en plus à ne plus
tenir devant les tâches multiples qu'on leur impose,
devant des responsabilités toujours plus nombreuses et
qu'ils croient de moins en moins être de leur ressort.
Récemment, on pouvait lire à la une des journaux que
quand 13% de la population exerçant une activité
professionnelle souffre de "burn out", 17% des
enseignants en sont les victimes ! Et ces chiffres ne sont
rien. Face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés
puisqu'ils sont tout de même les représentants en
première ligne d'un système, d'une école que quantité
d'élèves refusent, les stratégies sont nombreuses avant
d'en arriver à ce "burn out" dont on ose parler :
distribuer uniquement de bonnes notes, multiplier les
absences maladies, abuser de vidéos et de films pour
avoir un semblant de calme… À cela s'ajoute le fait que
le métier exercé est totalement découplé des études
191
effectuées : un étudiant qui s'est spécialisé dans le
Moyen Âge se retrouvera en lycée amené à enseigner
bien évidemment tout autre chose et celui qui aura bossé
à fond Pascal pour son concours de l'agrégation n'en dira
pas un mot dans sa salle de classe. On pourra objecter
que cela a toujours été le cas et que la formation
intellectuelle reçue devrait permettre de s'adapter
rapidement à d'autres thèmes, qu'elle sait susciter une
certaine plasticité de l'esprit et qu'un des axes du travail
de l'enseignant est de continuer à se former
intellectuellement au cours de sa vie. Une chose est tout
de même évidente, depuis la disparition quasi totale
d'une formation professionnelle entrevue quelques
années, le jeune enseignant se retrouve directement, sans
préparation, sans savoir comment s'y prendre, souvent
angoissé devant la classe. Un peu comme si un ingénieur,
qui aurait étudié la problématique de la fission nucléaire
au sein d'une équipe de chercheurs, devait, du jour au
lendemain, construire un pont et diriger le chantier ! Les
IUFM n'étaient pas la panacée, mais au moins ils avaient
cet avantage de présenter les statuts de la profession, d'en
éclairer quelques aspects, d'aborder un certain nombre de
situations possible, d'apprendre aux jeunes gens à
préparer un cours en fonction des programmes, à
planifier une année, à prendre cette habitude de travailler
collégialement en n'hésitant pas à résoudre en commun
les difficultés rencontrées, à réfléchir non seulement sur
les pratiques mais aussi sur leur bien-fondé et sur celui
des programmes, à avoir une vision critique des manuels,
à acquérir le sentiment qu'on ne se rend pas totalement
désarmé dans une classe même si les moyens mis à la
disposition de ces IUFM étaient dérisoires…
Ajoutons à cela l'ignominie de salaires seulement
192
acceptables en fin de carrière. Les jeunes professeurs, qui
perçoivent à peu de choses près le SMIC sont condamnés
à louer à plusieurs de petits appartements dans la région
parisienne par exemple ou dans les grandes villes pour
survivre. Certains sont contraints d'avoir recours à une
seconde activité pour s'en tirer lorsque le conjoint n'a pas
d'emploi. Heureusement, ils peuvent, la plupart du
temps, profiter de la cantine, ai-je entendu siffler
aigrement lors d'une rencontre de chefs d'établissement !
Et on parle de salaire au mérite pour remédier à
l'indécence du "traitement" des enseignants, avec en
perspective les recommandations de l'OCDE et des
porte-parole du système libéral : établir une concurrence,
une émulation, recommandations sur lesquelles je
reviendrai !
Tout est pourtant à revoir sérieusement à ce niveau
puisque chacun est d'accord pour affirmer que
l'éducation doit être une priorité !
Mais cette situation a ceci de bon que l'on est peut-être
allé trop loin et que les jeunes professeurs non seulement
sont de moins en moins prêts à continuer de se laisser
tondre comme des moutons mais qu'ils prennent aussi
conscience de l'inadaptation du système scolaire face à
des jeunes qui eux non plus n'acceptent plus tous les
diktats et toutes les fausses promesses dont on leur rebat
les oreilles. Ils constatent que le profil d'une classe
d'aujourd'hui est totalement différent sur les plans
socioculturels de ce qu'il était vingt ou trente ans
auparavant, d'autant plus que la place du lycée et des
études longues a changé du tout au tout, l'économie
réclamant davantage de diplômés, même si ces diplômes,
en dépit de dénominations quasiment immuables veulent
193
dire tout à fait autre chose. Ils savent que les techniques
de communication ont évolué, que le livre, l'écrit n'est
plus la forteresse culturelle par excellence. Ils n'ignorent
pas que la culture des jeunes se fait davantage hors
l'école que dans l'école et qu'on les oblige, eux, les
enseignants, à quantité d'activités pour lesquelles ils
n'ont pas été formés et qu'on ne leur laisse que la
possibilité d'enseigner en gros comme on enseignait il y
a quelques lustres…
Toujours est-il que le jeune prof, dès les années 80
d'ailleurs, a commencé à se poser des questions et à se
demander si ce qu'il avait totalement pris pour argent
comptant, ce rôle d'animateur et de gardien qu'on lui
demandait, ce rôle de distributeur de diplômes en grande
partie dévalués qu'on attendait de lui, n'était pas une
vaste fumisterie et que lui, pauvre innocent, n'était que
l'instrument d'un système inacceptable.
Alors, il a compris qu'il ne suffisait plus d'être moderne
pour changer le monde, de quelques photocopies tirées de
Libé pour faire un cours formateur, que demander à ses
élèves de composer des poèmes surréalistes pour
apprendre à écrire était une vue de l'esprit quand on ne
possède pas les bases de la langue, qu'imaginer une mise
en scène novatrice de telle pièce de théâtre classique en
transformant par exemple Le Cid en un western-écrit-enfrançais-
de-tous-les-jours n'améliorait ni la culture
littéraire ni les compétences rédactionnelles et
n'accroissait en rien l'autonomie de ces jeunes citoyens.
Il a compris devant le désastre qui s'annonçait que le
Bled et consorts, aussi honnis les uns que les autres,
n'avaient pas que de mauvais côtés et qu'avant de jongler
avec les notions, les savoirs et les savoir-faire, avant de
s'épuiser à un actionnisme brouillon, il convenait
194
d'assurer des bases solides sans lesquelles il n'est pas de
pensée sérieuse ni de liberté des individus.
Et il n'est plus d'accord avec ce système politicoéconomique
qui l'exploite comme jamais et qui lui
demande de faire de l' "abattage", de fournir les
diplômés, les fonctions, dont il a besoin au mépris de la
personnalité des élèves et du développement réel de ces
personnalités. Il commence à regimber, et pas seulement
pour défendre sa caste comme on le lui reproche souvent,
mais parce qu'il voit vers quel gouffre la réification des
individus risque de mener.
Il se rebiffe et le système n'a plus confiance en lui.
Il se rebiffe mais en même temps - on ne peut lui en
vouloir - il s'accroche à sa profession, à son statut, à
cette école qu'il veut croire améliorable alors que tout est
à transformer…
Du côté de la coalition politicoéconomique
:
le vertige et les nouvelles stratégies.
Le système lui-même, petit à petit, prend ses distances
d'avec une école qui lui apparaît comme de moins en
moins fiable.
195
Depuis 50 ans au moins, le ministère s'appuie sur des
statistiques qui doivent démontrer au public l'excellence
du système scolaire français, qui illustrent sa vocation
profondément démocratique et égalitaire : de plus en plus
de bacheliers, de plus en plus d'étudiants ensuite, des
diplômes en veux-tu ? en voilà ! Une évolution positive
au premier regard, allant tout à fait dans le sens des
aspirations profondes du peuple français, du pays des
Droits de l'homme, du pays de la fusée Ariane, des TGV,
de l'Airbus et des centrales nucléaires-qui-assurent-notreindépendance,
une évolution qui va aussi dans le sens de
ce que l'industrie, les services, la banque réclament! Le
ministère se targue encore de réformes, sans doute jugées
trop nombreuses par les parents, les observateurs, mais
qui mèneraient en fin de compte à une amélioration
globale des résultats, ces réformes devant en effet être
comprises comme autant d'efforts consentis pour le bien
exclusif des jeunes Français. Certes, reconnaît-on en
haut-lieu (reconnaître sa faute, son erreur est l'élégance
suprême en matière de communication et de démagogie),
la plupart d'entre elles n'ont pas abouti aux résultats
espérés, mais c'est l'intention qui compte, globalement…
Le système économique se réjouit en apparence comme
le ministre de l'accès de 90 ou 98% d'une classe d'âge au
baccalauréat. Il aurait tort de ne pas le faire puisqu'il ne
s'agit que de se mettre en adéquation avec les
recommandations de l'OCDE, l'agence de notation
pédagogique qui distribue satisfecit et blâmes comme
Moody's ou Standard and Co à l'égard de la Grèce, du
Portugal, de l'Italie ou de la France. Le mot d'ordre est
clair, l'économie mondiale a besoin de diplômés, de plus
en plus de diplômés. Au début des années 90, on lavait
les cerveaux en apprenant aux foules émerveillées que la
196
quasi-totalité des ouvriers de l'automobile japonaise
possédaient le bac et que c'était là la raison du succès des
marques nipponnes partout dans le monde ! Que le
ministère forme donc des diplômés et régule comme on
le lui demande les flux de futurs travailleurs. Qu'il garde
au parking scolaire le trop-plein qui gonflerait les chiffres
du chômage et oriente vers les métiers qui ont de l'avenir
les jeunes en faisant croire à tout le monde
qu'aujourd'hui tout est mieux qu'hier et que nos chères
têtes blondes bénéficient d'une meilleure et plus
complète éducation, qu'ils seront mieux armés à affronter
la vie et les défis d'un monde qui change si vite !
Continuons à présenter ces examens comme l'ascenseur
social par excellence même si toutes les études sérieuses
montrent que rien ne change dans une société figée dans
ses structures. Et cette société est d'autant plus figée que
l'ouverture de l'école sur le monde, ce maître mot tant
proclamé de la pédagogie des années 80-90 ne contribue
qu'à servir cet impératif d'adéquation entre ce qui est
appris et ce qui est exigé par l'industrie, la finance, les
marchés : former un exécutant et un consommateur
puisque les deux fonctions essentielles de l'homo sapiens
moderne sont désormais l'inscription dans le processus
de production au sens large du terme et la consommation,
aucune classe, aucun âge, aucun sexe, aucune confession
ne devant échapper à cette double dépersonnalisation des
individus.
Peu importe que la part qui reste à l'être en soi et à sa
réalisation soit devenue peau de chagrin, détail de
l'histoire.
En réalité, le néolibéralisme triomphant enrage qu'on
n'aille pas plus vite et autrement. Il aurait voulu qu'on
197
presse encore davantage et mieux les futurs producteursconsommateurs
dans le moule qu'il a rêvé pour eux. Par
souci d'efficacité, il a réussi à faire supprimer ou réduire
au strict minimum les enseignements jugés inutiles, il est
parvenu à faire accepter l'augmentation des effectifs des
classes et à ne plus recruter qu'un-enseignant-sur-deuxpartant-
à-la-retraite ! Mine de rien, il a imposé les débuts
d'une rationalisation, d'une gestion économicotechnocratique
à la rue de Grenelle. Mais il aurait voulu
plus et dissimule encore son impatience derrière le rideau
des belles paroles prononcées par les ministres, recteurs
et autres marionnettes politiques, ce discours altruiste en
apparence, uniquement préoccupé du bien de l'enfant, on
connaît la chanson !
L'école n'a rien d'un ascenseur social en dépit des statistiques
officielles qui cherchent à montrer une progression de la
fréquentation de l'université dans toutes les couches sociales. Ces
indicateurs n'ont aucun sens dans la mesure où les filières
universitaires sont libres d'accès, non sélectives et que la
démographie a explosé entre les années 1950 et 2005 ! Mon cours
de dissertation pour les premières années de lettres à l'Université
de M. était fréquenté en octobre par 87 étudiants. Ils n'étaient plus
qu'une quarantaine en novembre et seulement une bonne vingtaine
avait rendu les devoirs nécessaires et effectué les exercices prévus.
Peut-être étais-je responsable de cette désaffection, mais mes
collègues étaient aussi mal lotis ou aussi incapables. En réalité,
nombreux sont les étudiants qui ont seulement besoin d'une
couverture sociale et qui n'envisagent pas sérieusement d'étudier.
Nombreux sont aussi ceux qui, tout simplement, ne disposent pas
du bagage minimal qui leur permettrait de s'en sortir…
Une récente étude (octobre 2011) effectuée sur les bacheliers de
2008 montre que 31% sont entrés en licence à l'université mais
que 1 sur 2 ne continue pas en 2e année et les bacheliers
technologiques sont ceux qui abandonnent le plus. 32%
poursuivent en filière courte (BTS…) mais si 90% se retrouvent en
198
seconde année, les bacheliers professionnels réussissent le moins :
en Bretagne, par exemple, en 2011, on a constaté que 80%
échouent à l'Université en 1ère année, 50% abandonnent dans les
BTS ou IUT (qui n'en ont reçu que 38 sur les 7800 bacs pro !).
Enfin, si 8% des bacheliers sont entrés en classe prépa, un quart
abandonne en cours ou à la fin de la première année…
Dans le cas des grandes écoles (qui se sont multipliées !) les
effectifs démentent en effet l'enthousiasme démocratique des
statistiques ministérielles : X, l'ENA, l'ENS, HEC ne constatent
pas une augmentation de la part d'étudiants d'origine populaire par
rapport aux années 50, mais une diminution nette malgré les
décisions de s'ouvrir, comme à HEC, aux étudiants socialement
défavorisés par une politique (partielle) de recrutement faisant
passer dans les actes une discrimination positive mesurée.
Comme le rappelait un responsable de l'enseignement supérieur et
de la recherche : "Les trois quarts des bacheliers pro sont issus de
milieux défavorisés, alors que les trois quarts des bacheliers
généraux viennent de milieux favorisés".
Pourquoi cette impatience ? Parce que les donneurs
d'ordre semblent pris à leur propre piège ou pire encore,
ils se sont rendu compte que l'institution scolaire
traditionnelle qui avait été tant d'années leur alliée
silencieuse et indéfectible, cette institution était à bout de
souffle : la formation donnée ne correspondrait plus à ce
qu'ils attendent, les "niveaux" seraient catastrophiques,
et les jeunes gens arrivant sur le marché du travail
n'auraient plus tout à fait la même attitude que leurs
aînés : ils revendiquent, n'accordent plus la première
place dans leur vie à l'activité qu'ils exercent…
Les donneurs d'ordre doutent en outre de cette École
"conservatrice" : le statut de fonctionnaire des
professeurs qui en fait ces intouchables qu'ils aimeraient
voir disparaître, les hésitations à se débarrasser de
certains enseignements qui gênent, la montée en
puissance des élèves et des parents qui se mettent à élever
199
la voix, la difficulté qu'il y a à imposer qu'un
établissement scolaire doit se gérer comme une PME…
Cette École leur apparaît de moins en moins contrôlable
et ils craignent que leurs exigences ne soient plus
respectées, que les compétences demandées ne soient pas
obtenues… Ils ne voient plus dans l'École l'alliée
silencieuse de toujours. Leur critique de l'institution
scolaire va de pair avec celle des États : on écouterait
trop la rue, on serait trop sensible à la société civile et à
ses nouvelles exigences…
"Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse" ! À
force de réclamer davantage de diplômés, de charger
l'École de quantités de tâches, tout en acceptant, en
exigeant, une école "amincie", la moins coûteuse
possible, on devait s'attendre à l'apparition de certaines
difficultés : niveaux, ambiance générale, réactions des
acteurs...
Les donneurs d'ordre, qui ont plus d'un tour dans leurs
poches, ont vite effectué un rétablissement : ils insistent
sur ces difficultés, probablement pour faire le ménage,
passer au fameux "plan B" : se débarrasser d'une alliée
inefficace et favoriser en bon libéralisme l'apparition
d'un nouveau type d'institution scolaire fonctionnant,
elle, suivant les règles du marché.
L'argumentation sur laquelle ils s'appuient n'est pas sans
solidité et aisée à faire partager par tous ceux qui peuvent
le vérifier, parents, employeurs, voire enseignants : même
dans ses fonctions les plus "basiques", celle de
l'acquisition de la langue et des rudiments du calcul,
l'école n'est plus qu'un échec patent.
Si on arrive à quasiment 90% de reçus au baccalauréat,
on dissimule le fait que des dizaines de milliers d'élèves
200
quittent l'institution scolaire sans diplôme ni formation !
Quant à ceux qui réussissent, ce ne sont ni les concours
généraux, ni les grandes écoles, ni les médailles Fields
qui peuvent faire illusion (effets d'annonce encore) ! Le
bac et le succès aux examens universitaires ne mesurent
rien de significatif quant aux performances réellement
formatives (diront les uns), quant aux "compétences"
(diront les autres), du système éducatif.
Tiens, à propos, vous avez participé à un jury de bac ? Je parie que
non ! Eh bien, voilà !
Après péréquation nationale et académique, voire départementale,
dans un souci d'égalité, des profs correcteurs sont convoqués. On
va expédier mettons 100 candidats notés entre 8 et 9,9 à l'issue des
épreuves du bac (ça peut être entre 7,… et 9,9, voire…). Au
maximum, deux ou trois heures de jury sont prévues. Après,
signature des ordres de mission pour le remboursement des frais de
déplacement éventuels. Important ça, les frais et les indemnités de
jury. Un peu d'argent de poche. Pour les vacances. Un plateau de
fruits de mer sur la côte peut-être, ou une après-midi au centre de
thalassothérapie. Aux frais de la princesse !
Un universitaire (qui n'a plus jamais mis les pieds dans un
établissement du second degré depuis son propre bac) préside
l'absence de débats. Un professeur par matière est présent.
Volontaire désigné d'office, comme l'écrivait spirituellement
l'Almanach Vermot.
Le président, après une courte allocution prouvant qu'il vient bien
de Sirius et, faisant sourire (poliment) la piétaille qu'il a face à lui,
passe les dossiers à la chaîne : "Tel candidat a obtenu 8,1 de
moyenne ; il a eu 2 en philosophie et avait un 6 aux épreuves
anticipées de français. Si le professeur de philosophie et le
professeur de français sont d'accord, on peut proposer de majorer
les notes dans ces deux matières afin qu'il arrive à 10 de moyenne
générale, condition sine qua non de l'attribution du bac.
J'ajouterais que son carnet scolaire ne me semble pas trop
mauvais, précise le président après avoir jeté un coup d'oeil sur le
dit carnet."
Les deux professeurs incriminés pensent qu'il reste encore 90
201
dossiers, qu'on voudrait bien partir avant 17 heures. Ils n'ont rien
contre. Comment pourrait-il d'ailleurs en aller autrement ? On
majore donc. Candidat reçu ! Les statistiques prévisionnelles et les
résultats vont bientôt coïncider…
C'est comme cela qu'on établissait les statistiques économiques
dans la défunte Union Soviétique ; on est resté très politburo dans
notre France du XXIe siècle !
Lorsque l'élève recevra sa collante, il s'émerveillera d'avoir eu un
10 en philo alors que son prof, cette carne, ne l'a jamais gratifié
d'une note supérieure à 5. Dans le fond, il le savait, il n'est pas si
nul et les profs jugent vraiment à la tête du client. Ce salopard de
pseudo- philosophe, y pouvait pas m' blairer ! Ce 10, c'est une
sacrée baffe qu'il reçoit : il faut que je le voie pour le lui dire et lui
mettre les poin(g)(t)s sur les i !
Rien n'est parfait, hélas !
Les savoirs considérés par l'institution elle-même comme
fondamentaux sont très imparfaitement maîtrisés par une
majorité croissante d'élèves sortant de ce système dotés
de diplômes (et ces manques sont particulièrement
déplorables sur le plan humain puisque le jeune adulte ne
reçoit pas de l'école ce qui pourrait en faire un être
complet et autonome, l'éternel alibi de l'école
républicaine).
Les scientifiques s'inquiètent de la "somme
impressionnante de signaux alarmants" corroborant les
visions les plus pessimistes. À l'université, la maîtrise de
la langue est insuffisante chez de nombreux étudiants, ce
qui non seulement pose des problèmes aux responsables
des enseignements en sciences humaines, mais de telles
carences soulèvent aussi des difficultés pour
l'apprentissage des mathématiques et des sciences tant il
est impossible de raisonner sans cette bonne maîtrise de
la langue ! J'ai moi-même pu constater que de futurs
professeurs de lettres préparant le CAPES rendent des
202
dissertations très insuffisantes sur le plan de
l'orthographe d'usage, de l'orthographe grammaticale et
de la syntaxe, sans évoquer la pauvreté du style et du
lexique employé. Il est vrai qu'on ne demande plus aux
correcteurs de ces concours d'accorder la même
importance à la perfection formelle que naguère, quand,
par exemple, une ou deux défaillances orthographiques
suffisaient à éliminer un candidat à l'agrégation ! Jadis,
cinq fautes en dictée privaient l'élève de son certificat
d'études, ce qui était exagéré, alors qu'aujourd'hui on
n'ose plus compter les fautes du bachelier (ou alors on
décide d'appliquer la fermeté (!) et de retirer au
maximum un ou deux points si le devoir est cousu
d'incorrections, ce qui permettra de dire que les jurys ont
été sévères et qu'on renoue avec les grandes traditions
d'excellence) ; naguère encore, on ne pouvait devenir
agrégé avec une expression écrite même légèrement
défectueuse, alors que désormais la "forme" ne compte
plus guère ! Sans faire une vache sacrée de l'orthographe
ou de la syntaxe (il est bien des règles qui pourraient être
réformées, simplifiées, mais réformer et simplifier, c'est
se contraindre à de nouvelles règles, ce n'est pas faire
n'importe quoi !), il faut bien reconnaître qu'une langue
pour sa précision, pour sa richesse a besoin des nuances
qu'elles introduisent et que les négliger, comme négliger
le vocabulaire, c'est condamner l'apprenant à une
expression frustre, à une pauvreté pour dire soi et le
monde…
Ces faits sont avérés. Pour faire ce que les donneurs
d'ordre voulaient, c'est-à-dire donner la priorité aux
nouvelles formations, à ce qui sera utile pour le futur
producteur-consommateur, on a diminué le nombre
d'heures consacrées au français dans le primaire et les
203
collèges dans des proportions importantes depuis trente
ans alors que d'un point de vue purement humain,
spécifiquement éducatif, il aurait été sage de procéder
autrement... La lecture à voix haute, les dictées,
l'apprentissage de poésies, celui systématique du
vocabulaire et des règles grammaticales sont de plus en
plus rares ou ne représentent qu'une part infime du temps
scolaire. Dès le départ, l'enseignement primaire ne
remplit plus sa fonction : la lecture, le calcul,
l'observation, l'écriture n'y sont plus acquis
véritablement par une proportion croissante d'enfants.
Ceux-ci ne sont plus censés acquérir la maîtrise de
l'idiome en apprenant de leurs maîtres des savoirs
grammaticaux et lexicaux déjà constitués, d'abord
simples puis au cours des années plus complexes, un
apprentissage renforcé par des exercices d'application
soigneusement dosés puis des travaux d'écriture, de
réemploi, personnels, mais en les découvrant eux-mêmes,
par l'observation des extraits de textes qui, d'ailleurs,
dans leur "saucissonnage" sont souvent d'une telle
banalité voire d'une telle pauvreté qu'ils ne peuvent que
donner le dégoût de la littérature quand le jeune apprenti
lecteur découvre que l'auteur de ces trois ou quatre lignes
rébarbatives s'appelle Chateaubriand, Balzac, Gide ou
Camus.
On est revenu, certes, sur les méthodes dites globales de
lecture, mais les méthodes "semi-globales" qui les ont
remplacées restent insuffisantes et induisent parfois de
mauvais réflexes. Les parents qui le peuvent - et
l'importance des origines sociales n'est plus à souligner
en dépit de tous les discours égalitaristes - se chargent
donc de cet apprentissage et les vieilles méthodes
syllabiques, l'ancienne méthode Boscher, Léo et Léa sont
204
à nouveau demandées !
J'ai pu constater qu'un des obstacles à la dictée
traditionnelle était l'impossibilité d'une fraction
importante des élèves de collège (en 4e par exemple) de
retenir un segment de phrase significatif lu et répété par
le professeur. Il faut sans cesse redire, rabâcher et
certains élèves n'écrivent leur dictée qu'au mot-à-mot.
Dans ces conditions, ils n'ont pas la possibilité de
comprendre vraiment ce qu'ils écrivent, il n'est plus
possible au professeur de transmettre le rythme de la
phrase et des mots, les liaisons, et la dictée devient la
copie désagréable et ennuyeuse d'une suite de mots qui
ne forment guère sens. Les choses ne sont d'ailleurs que
peu différentes quand il s'agit de copier un texte :
beaucoup d'élèves ajoutent les mots aux mots sans
vraiment se préoccuper de la signification de ce qu'ils
copient plus ou moins correctement, habitués qu'ils sont,
sans doute, à faire plusieurs choses simultanément :
parcourir une BD le casque sur les oreilles pendant qu'un
film défile sur l'écran qu'ils ont en main et qu'ils
essayent encore d'envoyer un SMS ! Dans les lycées
même, certains professeurs de lettres ne se fixent plus
comme objectif raisonnable que de parvenir à faire écrire
à leurs élèves une phrase correcte et de rester attentifs à
la lecture d'un texte d'une trentaine de lignes ! Après
douze années d'enseignement, nombreux sont les
bacheliers incapables de rédiger correctement un texte
personnel, incapables de situer tel ou tel auteur,
incapables de parler de livres qu'ils auraient dû lire,
incapables de résumer un texte de difficultés moyennes !
Or ces élèves sont intelligents, capables de réfléchir…
Où est l'erreur ? Je me souviens de ces copies d'histoire
oubliées sur le bureau par un collègue de l'établissement
205
où j'exerçais encore il y a peu de temps. Les notes étaient
toutes excellentes. Il s'agissait de la classe parallèle à la
mienne. Étonné de voir de tels résultats quand je savais la
difficulté qu'avait la majorité de mes propres élèves à
rédiger un paragraphe, j'entrepris de lire quelques copies
en attendant l'arrivée de ma classe. Je n'ai pas eu besoin
de beaucoup de temps pour me faire une opinion : les
textes que je venais de déchiffrer étaient quasiment
illisibles : orthographe fantaisiste, syntaxe bousculée et
absence de ponctuation ! Pourtant, mon collègue avait
généreusement distribué les 16, les 17 et les 18 tout en
s'abstenant de la moindre correction et en se contentant
d'une courte remarque "fayotte" et creuse dans le
genre : "Excellente étude des documents ; continue
ainsi, c'est bien !" voire d'appréciations lapidaires mais
toutes outrageusement flatteuses.
Lorsque je rencontrai mon collègue, je lui remis ces
copies oubliées et lui donnai mon avis. Il s'empourpra et
me répondit qu'il n'enseignait pas le français, que si le
niveau de langue était insuffisant, c'était aux professeurs
de lettres qu'il fallait s'en prendre, en l'occurrence à moi
et non à lui, professeur d'histoire qui n'allait
certainement pas pénaliser des jeunes victimes des
incompétences d'enseignants d'autres disciplines !
Les jeunes étudiants de lettres n'ont, le plus souvent, que
peu de notions d'histoire littéraire, celle-ci étant
totalement abandonnée ou enseignée sous forme de
vagues jalons : le "Moyen Âge", la Renaissance, le
romantisme, le naturalisme… On ne leur donne plus le
goût de lire en s'en tenant au mieux à trois ou quatre
oeuvres annuelles (souvent "lues" à travers les
nombreux "digests" que proposent les éditeurs),
206
considérées comme un effort insurmontable. Les grands
écrivains de la littérature universelle, ces oeuvres qui
auraient pu illuminer leur pensée et élargir leurs horizons
si les professeurs qui se disent pressés par les
programmes avaient pu les leur faire découvrir (à
condition qu'eux-mêmes aient, au cours de leurs études,
dépassé le stade des morceaux choisis et de
l'apprentissage de quelques clichés) leur resteront
inconnus. Et puis, ils ont aussi perdu l'habitude d'écrire,
ce qui est écrire : on ne rédige plus de dissertation,
le "coupé-collé" est admis dans les exposés bégayés
devant un auditoire qui s'ennuie…
Quant à l'oral, tout est possible, plus rien n'est incorrect,
la langue s'est libérée ! Le problème est que l'enfant ne
maîtrise pas cette base à partir de laquelle il pourrait se
permettre ce qui serait alors des effets de style ! Entre les
sketches de Coluche et sa gouaille prise au pied de la
lettre, les grasses plaisanteries qu'on entend sur toutes les
radios, les personnalités qui font "peuple" en adoptant
en public un langage "cool", il ne sait plus où il en est.
En histoire, on retrouve cette disparition des repères
chronologiques à tel point que les époques se mélangent :
la renaissance sous Louis XIV, Napoléon III au XVIIIe
siècle, les dix siècles de l'histoire de Rome formant un
bloc… On préfère demander à l'élève de 12 ans de se
mettre dans la peau de l'historien professionnel en
réfléchissant à partir de documents (tirés d'un manuel ou
d'une revue pédagogique), en en faisant la critique alors
qu'on ne leur a seulement jamais appris les dates clés de
notre histoire et qu'ils n'ont aucune idée de l'évolution
de la langue, des contextes où ont été produit ces
"documents" taillés sur mesure par l'éditeur !
Les langues vivantes sont tout autant désastreuses : après
207
6 ou 7 années d'anglais, quel élève est capable de se
débrouiller à Londres, à Dublin ou à New York ? De plus,
les langues autres que l'anglo-américain sont réduites à la
portion congrue et les langues anciennes ont quasiment
disparu. J'ai reçu dans mon établissement francoallemand
des élèves préparant l'abi-bac : l'effet
d'étiquette ne tient guère. On fait croire au malheureux
élève qu'il est bilingue et ses parents s'en
enorgueillissent d'autant plus facilement qu'eux-mêmes
ne parlent pas toujours l'allemand, mais en réalité, le
professeur après son cours d'histoire en allemand fournit
aux élèves le plus souvent un résumé en français "pour
que l'heure ne soit pas totalement perdue", comme me
l'avouait l'un d'eux !
En ce qui concerne les mathématiques et le calcul, les
choses ne sont pas différentes. Sans revenir sur la
fameuse réforme des "maths modernes" dont les effets
ont été terribles particulièrement lorsqu'on a voulu
l'imposer à l'école primaire et au collège en enfermant
l'enseignement dans une approche formelle et
dogmatique coupée de l'intuition commune, totalement
inapplicable à ces niveaux, les programmes Joutard,
publiés en 2002 repoussaient l'apprentissage des quatre
opérations qui débutait autrefois dès le CP (jusqu'aux
années soixante) : l'addition au CP, un peu de
soustraction au CE1, la quasi-disparition de la division et
de la multiplication sur les décimaux de tout
l'enseignement primaire… Le rapport Thélot préconisait
même de seulement apprendre à compter (énumérer) en
CP et CE1 et de ne commencer le calcul qu'en CE2, la
division étant réservée au CM2. En même temps, la
théorie officielle est qu'il faut commencer par "donner
du sens aux opérations" ! C'est donc à n'y rien
208
comprendre puisque les nombres et les opérations sur les
nombres ne prennent de sens que les uns par rapport aux
autres : 563 est bien 5 fois 100 plus 6 fois 10 plus 3 ! On
en vient à croire que la hiérarchie a, elle aussi oublié (ou
n'a jamais acquis) le bon sens, la logique et le vrai
raisonnement ! Ce même rapport Thélod donnait pour
objectif de fin de 3e la maîtrise des "opérations
mathématiques", probablement les quatre opérations !
Au lycée la filière scientifique tant vantée voyait ses
horaires diminuer dans des proportions comparables à ce
qui s'est fait pour le Français. À la fin d'une terminale S
les élèves ont perdu l'équivalent d'une année et demie
par rapport aux Terminales C d'il y a une trentaine
d'années. Comme pour le français encore, le programme
officiel fait illusion et donne en apparence l'image d'un
savoir complet et cohérent, mais il ne reflète en rien le
véritable savoir acquis par l'élève. On ne demande
presque plus d'être capable d'établir une démonstration
en bonne et due forme et la plupart des élèves de
Terminales scientifiques arrivent au bac avec pour
bagage un petit nombre de recettes et de procédures
mémorisées sans compréhension véritable, approfondie et
intériorisée. Ainsi, savoir tracer le graphe d'une fonction
en s'aidant d'une calculatrice et reconnaître quelques
aspects qualitatifs de ce graphe suffisent aujourd'hui à
assurer la moyenne. Qu'on pose une question de
géométrie imprévue où le rôle des coordonnées est
inversé par rapport au modèle habituel, comme cela a été
le cas en 2003, et c'est une véritable catastrophe
nationale qui motive l'intervention du ministre !
D'ailleurs, si on choisit cette filière, c'est très souvent
moins par amour des sciences que pour échapper aux
autres filières dont on dit qu'elles "ne mènent à rien" et
209
dans lesquelles le chef d'établissement "met" les
professeurs les moins compétents !
L'apprentissage des matières scientifiques comme
apprentissage de réflexes conditionnés ? On prépare ainsi
sans doute le futur travailleur à accomplir son rôle à venir
de presse-bouton, de machine à produire. Quant au
jugement porté sur les filières non scientifiques, on
comprend qu'il reflète ce que la majorité manipulée,
réifiée attend de l'école : une institution qui prépare les
jeunes à un travail immédiatement monnayable et non
pas à une éducation de l'esprit, à un supplément d'âme.
On comprend aussi le dégoût de nombreux élèves pour
les matières scientifiques bien qu'ils se laissent diriger
vers cette filière S !
Si des élèves parviennent cependant à continuer à
s'intéresser aux mathématiques et font tous les efforts
possibles pour dépasser ce stade du rabâchage de recettes
insipides, c'est parce que certains professeurs ne leur
comptent pas leur temps et leur enthousiasme et aussi,
encore une fois, grâce à l'aide des familles, quand elles le
peuvent, et de remédiations extérieures à l'éducation
nationale : ces professeurs mal payés ne refusent pas les
cours privés, qui leur permettent de "mettre du beurre
dans les épinards" et… d'apporter de l'eau au moulin
des tenants d'une éducation "libéralisée".
La faiblesse des acquisitions, le manque de connaissances
structurées de la plupart des jeunes bacheliers, font qu'en
lettres, en histoire, mais aussi en mathématiques,
physique et chimie, ils éprouvent les plus grandes
difficultés à intégrer l'enseignement supérieur, qui
d'ailleurs a renoncé de son côté à être ce qu'il devrait être
et devient de plus en plus la prolongation d'un
210
enseignement secondaire appauvri. Les élèves les plus
solides choisissent ce que l'on considère encore comme
étant les filières d'excellence, les grandes écoles. Mais, là
aussi, la même érosion est à l'oeuvre. Des professeurs des
meilleures classes préparatoires scientifiques se plaignent
d'avoir à faire à des étudiants qui ignorent les principes
de la démonstration et les règles élémentaires de la
logique. Si, dans ces filières, on parvient à combler plus
ou moins les manques, les jurys des Écoles normales
supérieures ou de l'École polytechnique observent
régulièrement d'étonnantes carences parmi même les
candidats reçus aux concours d'entrée ! Dans les
entreprises, on s'étonne des lacunes des stagiaires, de leur
fatigabilité, de leur manque d'engagement…
Toutes ces dérives vont au-delà des volontés du
"marché", des désirs des donneurs d'ordre et ils sont
prêts à rompre le pacte qui les lie à l'École en profitant de
ces faiblesses pour imposer des solutions qui garantiront
mieux le respect de leurs exigences. Bien entendu, il
n'est pas question de supprimer cette École, qui peut
encore rendre des services : dans le domaine du primaire,
pour les formations de bas niveau, pour les "cas"…,
mais dès que les choses deviennent sérieuses, comme il
le fait depuis quelque temps, le néolibéralisme pousse au
développement de ses propres formations en entreprise,
par le biais d'écoles et d'universités privées, demandant
simplement à l'État d'accorder (pour la poudre aux yeux
démocratique) sa bénédiction sous forme d'une
reconnaissance "diplômée" des formations ainsi
dispensées !
Pour les défenseurs d'une institution scolaire digne des
211
ambitions humanistes qui devraient être les siennes, on
est arrivé au développement prévisible d'une tendance
évidente : le système aura toujours besoin d'une l'École,
cette École devra de plus en plus lui être inféodée, dès
qu'elle ne sera plus suffisamment fiable, on passera à
l'étape suivante : la revendication d'une double
institution scolaire : une École d'état réservée au
dégrossissement, aux basses tâches et à des formations
les moins valorisantes, puis des écoles privées,
émanations du système et fidèles aux lois du marché. La
pudeur n'est plus de mise, les enjeux économiques sont
trop importants. Quand le citron est pressé, on jette
l'écorce, disait Frédéric II, l'auteur de l'Anti-Machiavel,
en parlant de Voltaire…
Le refus (ou l'incapacité) de l'État d'assumer sa mission
républicaine et démocratique en fournissant à tous les
futurs citoyens une formation digne de ce nom provient
du fait que cet État, lui-même, se gère aujourd'hui
comme une entreprise et n'obéit plus qu'au principe de
rentabilité, tel que les économistes néolibéraux le
conçoivent, ce qui ne va pas sans poser la question du
sens de la démocratie elle-même. Sous la pression
économique, il réduit tout ce qui est service, tout ce qui
n'aboutit pas à un retour immédiat sur investissement.
Alors, bien sûr, une des causes des faiblesses de l'École
actuelle est qu'elle a un coût difficilement acceptable par
cet État libéral même si les réformes, les augmentations
d'effectif, l'accroissement de la durée des études, tout
cela se fait quasiment à budget constant en rognant ici
pour créer l'illusion là, déshabiller Paul pour habiller
Pierre, en donnant l'impression que l'esprit des
démocraties, les droits fondamentaux de l'homme sont
pris en compte : l'éternelle duplicité du politique et de
212
nos "représentants" coincés entre l'arbre et l'écorce,
une fesse (parfois) à l'Assemblée et l'autre qui se partage
les sièges de conseils d'administration les plus divers. La
démocratie représentative telle qu'elle a plus ou moins
fonctionné au siècle précédent paraît largement
dépassée !
L'institution scolaire se heurte à la fois au problème de
ses finalités et à celui des dépenses qu'elle engage,
particulièrement en période de crise, comme on veut nous
persuader l'être depuis trente ans ! Faire plus et mieux
avec quasiment moins est illusoire. Avec des classes plus
chargées, des enseignants moins nombreux et de moins
en moins formés, des horaires allégés, le défi paraît
difficile à relever. Ce qui sauve encore la mise, c'est
l'effet d'annonce. Les moyens mis en oeuvre, cela est
secondaire. La France est un pays qui cultive l'effet
d'annonce et ce n'est pas pour rien que les présidents et
leurs premiers ministres ont toujours écouté avec
beaucoup d'attention les conseils que leur donnent les
Ségala de tout acabit.
*
Faut-il donc se contenter de ce modèle immuable d'une
institution qui a toujours prétendu être au service de
l'enfant et de l'homme, mais qui, en réalité, a toujours été
instrumentalisée par les puissances dont elle dépend,
faut-il accepter des réformes qu'on nous présente comme
irréversibles et qui vont dans le sens du cannibalisme
néolibéral ou peut-on imaginer qu'un jour, la volonté
nationale et citoyenne, vraiment démocratique,
déscolarisera cette école poussiéreuse et hypocrite, la fera
sortir de ses murs, inventera un tout nouveau modèle
éducatif ?
213
Une constatation s'impose, le vieux système ne satisfait
plus personne. Les enseignants vivent mal leur condition,
les élèves traduisent leur mal-être par des comportements
violents, par un désintérêt, par l'absentéisme, la maladie.
Les chefs d'établissement sont partagés sur leur rôle Les
parents craignent que cette école publique n'offre plus ce
qu'ils attendent : des résultats, de la discipline, la fin de
leurs propres soucis en matière d'éducation, le
développement harmonieux de leur enfant.
Ceux que nous avons appelés les "donneurs d'ordre"
n'ont plus confiance dans l'esclave fidèle des cent
dernières années, dans les enseignants, dans les
apprentissages, dans les élèves et étudiants. Ils voudraient
désormais passer à la vitesse supérieure : que les écoles
suivent en tout les modèles que fournit le marché, qu'on
s'éloigne d'un service public considéré comme ingérable,
que le système éducatif appartienne entièrement à ceux
pour lesquels il est destiné : à eux-mêmes, aux "
donneurs d'ordre".
Les parents courent - quand ils le peuvent - les cours
privés se ruinent à payer les classes à bachotage pendant
les vacances, les formations privées pour rejoindre les
prépas considérées comme l'antichambre d'un monde
officiellement détesté, mais secrètement envié où tout
n'est que "calme, luxe et volupté".
Les proviseurs et autres directeurs écoutent en majorité
beaucoup les sirènes qui feraient volontiers d'eux des
"patrons": leur boîte doit être une boîte d'excellence avec
des résultats extraordinaires, des anciens qui ont réussi
les grandes écoles prestigieuses et qui forment une
association puissante, des formations qui "en jettent",
des classes prépas en veux-tu? en voilà ! des soutiens, des
groupes de pression… Ah ! Être parmi les premiers de la
214
liste palmarès publiée annuellement par Le Point ou
L'Express ou Le Nouvel Obs !
Pour les élèves, seules les notes comptent, on le sait, on
le leur a tant seriné et ils font en sorte - au mieux - de
s'en sortir en les obtenant d'une manière ou d'une autre :
des cours, la triche, la menace...
Certains enseignants continuent à rêver d'autre chose,
d'une école vraie, digne, indépendante.
Heureusement !
215
IV. Au diable l'École ?
216
217
Belle unanimité dans la réprobation donc !
Mais, si convergence des opinions, il y a entre ceux qui,
comme nous, dénoncent une institution qui n'a jamais été
qu'aux ordres des puissances qui l'ont asservie, et ces
dernières qui tirent désormais à boulets rouges sur elle
parce qu'elle ne répond plus suffisamment à leurs
exigences, cette convergence n'est qu'apparente, car nous
revendiquons un tout autre destin pour l'École que celui
auquel les "lois" du marché et les collusions du
politique voudraient la condamner, un destin que
définissent plus ou moins directement les enquêtes de
type PISA, un destin forgé par un système économique
qui ronge son frein, impatient qu'il est de profiter d'une
réputation désormais ruinée, qu'il a su programmer et
provoquer pour imposer les conditions qui lui
conviennent.
On nous reprochera de faire le jeu de ces fossoyeurs de
l'idéal scolaire en critiquant l'Institution, mais nous
répondrons qu'aucune demi-mesure n'est plus possible,
que la langue de bois est une forme de l'acceptation et
qu'il faut au contraire profiter de la situation de
déliquescence actuelle pour réclamer la naissance d'une
École qui nous appartiendra entièrement, la véritable
École républicaine qui n'a jamais été jusqu'à ce jour que
discours, masques et illusions.
Le système libéral ne pense que globalement. Dans le
fond, il tolère cette "baisse des niveaux", car ce qu'il
perd sur le plan des savoirs du futur producteur, il le
récupère de toute façon sur le dos du futur consommateur
d'autant plus taillable à merci ! Et puis, il a adopté une
218
autre stratégie, une stratégie double : le développement
d'écoles primaires et secondaires privées et surtout la
mise en coupe de l'enseignement supérieur également par
le biais d'écoles, d'institut et d'universités privés, ne
renonçant tout de même pas aux subsides de l'État !
La France compte à ce jour environ 14 000 écoles
privées, tendance en hausse. Si l'enseignement primaire
et secondaire privé connaît une progression sans
commune mesure depuis une vingtaine d'années, quelle
que soit sa situation juridique, il est encore placé sous la
férule de l'État et doit respecter un certain nombre
d'obligations ainsi que les programmes des
établissements publics. Il ne diffère qu'assez peu de ces
derniers sinon par un confort et des conditions
d'enseignement que la rétribution payée par les parents
favorise le plus souvent. En revanche, profitant de
l'affirmation de la loi selon laquelle "L'enseignement
supérieur est libre" (même si, là aussi, quelques petites
exigences font croire que l'État exerce un droit de
regard : déclaration à l'État, administrateurs et
enseignants doivent avoir un casier judiciaire vierge) on a
vite compris que le créneau "éducation",
particulièrement supérieure, était porteur et rémunérateur,
comme il l'est dans les pays dits en voie de
développement. Des groupes entiers se sont créés et
proposent leurs services aux étudiants ayant les moyens
de s'acquitter de rétributions élevées… Ce n'est pas
vraiment une nouveauté, mais l'ampleur du phénomène
doit être rapprochée de cette méfiance envers le système
scolaire d'État dont on vient de parler. A côté des écoles
de commerce déjà anciennes (ESSEC, HEC) se sont
multipliés de véritables trusts comme l'ESSCA, l' ISG,
l'ISEG... Ce dernier, dont la raison sociale est ainsi
219
exprimée sur son site : L'ISEG a été créé en 1980 par
Marc Sellam, ingénieur issu de l'ESME Sudria qui, sur
la base d'une solide expertise des univers de l'entreprise
et de l'éducation, souhaitait apporter des réponses
nouvelles à un modèle souvent trop conformiste, est
constitué de trois écoles, réparties dans plusieurs villes
l'ISEG Business School, l'ISEG Marketing &
Communication School l'ISEG Finance School (on
notera les noms racoleurs, en anglais bien sûr) qui
comptent 4500 étudiants en 2010 et 15 000 anciens ! Le
phénomène est le même pour les écoles d'ingénieurs
(ISEN, EFREI, ECE Paris, ESME Sudria, EPITA, IPSA,
ESTACA, EPF...), d'aéronautique (ELISA, ESMA,
Airways, Institut Mermoz...), d'internet (Sup'Internet et
EEMI), de création numérique (E-Artsup), de décoration
et de design (Sup Déco)... À côté desx structures
d'enseignement supérieur privé d'inspiration catholique,
(Fédération universitaire et polytechnique de Lille,
Institut catholique de Paris, Institut catholique de
Toulouse, Institut catholique d'études supérieures,
Facultés libres de l'Ouest et Institut catholique de Lyon)
des universités privées laïques se créent comme la
fameuse "fac Pasqua", qui contournent impunément la
loi du 18 mars 1880 relative à cette liberté de
l'enseignement supérieur dont ils se réclament, interdisant
aux établissements privés de prendre le titre d'université
(interdiction répétée par le Code de l'Éducation en
vigueur), par des appellations comme "faculté libre"
autorisées pour les établissements disposant de docteurs
de l'université parmi leurs professeurs, voire "Pôle
Universitaire" comme la création de Charles Pasqua !
L'enseignement privé scolarisait, en 2007, 2 167 000
220
élèves :
317 000 élèves en maternelle
565 000 dans le primaire
655 000 en collège
301 000 en lycée (filière générale et technologique)
139 000 en lycée professionnel
108 000 en établissements d'enseignement agricole
(collège et lycée)
6 000 en lycée post-bac
26 000 dans divers "Dispositifs spécifiques de
scolarisation" (handicapés etc.)
(Selon le budget 2007).
Ces écoles privées, ainsi que les formations type École
d'enseignement technique Michelin ou BTS FNAC lancé
il y a quelques années, sont les réponses que les donneurs
d'ordre ont trouvé face à un système scolaire qui ne leur
convient plus tel qu'il est. Dans ces écoles et formations,
on retrouve une ambiance "saine" : on remet les
étudiants "à niveau" en tentant de résoudre les carences
de l'enseignement traditionnel dans les matières de base,
on n'enseigne que de l'utile, le lieu n'est pas à la
discussion : on y travaille, on y apprend ce qui doit être
appris et on rêve de carrières, de salaires mirobolants, de
primes, de boni. On ne se préoccupe pas des
personnalités, on a à former les cadres du système. Ces
écoles privées, souvent consulaires, sont soutenues
financièrement par les collectivités publiques et cela au
détriment du système scolaire traditionnel : les moyens
ne sont pas extensibles à l'infini (on nous le répète assez)
et c'est à ce niveau qu'on peut particulièrement juger du
désengagement du politique (ou de son engagement). Ce
qui est octroyé à ces établissements privés est en moins
221
pour les établissements publics. Un seul exemple : fin
octobre, les largesses du Conseil Général et de la région
pour l'école de commerce de Pau ont fait la une de la
presse alors que l'université de cette ville est en déficit !
Une partie des subventions accordées à l'ESC par le
Conseil Régional d'Aquitaine en particulier aurait suffi à
ne pas laisser l'université s'enfoncer dans une situation
désespérée, situation que Jean-Jacques Nicomette
décrivait ainsi dans Sud-Ouest le 17 mai 2011 :
Tous les financements attendus de l'État ne sont pas
arrivés. Et l'étau se resserre. L'argent file et les
inquiétudes s'accroissent. Les syndicats d'étudiants
FSE et SUD ne cachent pas la crainte que leur
inspirent les difficultés financières auxquelles se
heurte l'université de Pau et des Pays de l'Adour. "
Comme le prévoit la loi, expliquent-ils, celle-ci doit
disposer d'un fonds de roulement de huit millions
d'euros. Celui-ci lui permet de faire face à tout
imprévu. Voici un peu plus d'un an, tout allait bien.
Cette somme était de 9,5 millions".
"Mais trois millions ont dû y être puisés pour éviter
les déficits. Une autre ponction de deux millions a été
opérée début 2001. Et on est très loin de la fin de
l'année. L'UPPA doit donc trouver de l'argent pour
revenir à la normale."
Principal accusé : l'État. "On attend toujours les fonds
supplémentaires promis par celui-ci en raison de
l'élargissement des compétences de l'UPPA".
Un manque d'argent qui risque d'avoir de lourdes
conséquences sur le fonctionnement de l'université. "
Chaque responsable d'unité de formation et de
recherche (UFR) doit diminuer d'environ 10 % le
volume de son activité de cette structure" assurent les
étudiants, qui siègent dans les différentes instances de
l'UPPA. Ce qui représenterait, selon eux, 3 600 heures
en lettres, 3 000 heures en sciences et 2 000 heures en
droit. Selon la FSE et Sud, ces mesures auront de
222
multiples conséquences. "En sciences, le tutorat
intersession, qui est un soutien apporté aux étudiants,
sera par exemple divisé par trois. On peut aussi
supposer que le plan de rigueur va augmenter le
nombre de personnes qui suivent les travaux dirigés et
pratiques. Sans parler du risque de fermeture d'options
estimées non rentables, comme la licence de sociologie
qui avait été envisagée pour la rentrée prochaine".
Une situation jugée d'autant plus préoccupante par la
FSE et SUD, qu'elle commence à entretenir un climat
délétère au sein de l'université. En risquant d'entraîner
une concurrence entre des UFR "où chacun cherchera
à sauver sa peau".
Jeudi, un conseil d'administration de l'UPPA permettra
de faire un point sur la situation financière de
l'Université, et d'évoquer son plan d'action
quinquennal 2011-2015. Un avenir que les étudiants
envisagent avec difficulté, et quelque amertume. "
Chaque fois que l'on réagit, on nous dit que l'on
fantasme. Pourtant, au fil des ans, on voit nos craintes
se réaliser".
Les choix politiques gouvernementaux et régionaux sont
clairs !
L'université de Bretagne sud connaît les mêmes
difficultés, d'autres établissements universitaires ne vont
guère mieux alors que le secteur privé de l'enseignement
supérieur ne s'est jamais aussi bien porté, financé qu'il
est par le denier public, les entreprises et les droits
souvent très élevés payés par les étudiants, persuadés que
c'est pour eux le seul moyen d'obtenir la bonne place,
d'avoir un salaire mirobolant et de rejoindre un jour la
cohorte des privilégiés du pays !
La France dans ce domaine de l'implantation du modèle
libéral est cependant moins "avancée" que d'autres pays
ou procède de façon moins visible : le jésuitisme a laissé
223
des traces dans l'inconscient collectif ! En Allemagne,
par exemple, l'emprise de l'entreprise est complète ; les
grandes firmes possèdent leur propre système de
formation et elles recrutent dès le niveau de la seconde.
Lidl, Aldi, ces grands discounters par exemple, forment
leur personnel sans trop se préoccuper de ce qu'a fait
l'École. Les jeunes gens recrutés deviendront aussi bien
les simples vendeurs que les cadres de l'entreprise et ils
ont la possibilité de conclure leur formation par un
mastère puisque ces formations reçoivent la bénédiction
des autorités scolaires et universitaires.
En Allemagne, la politique éducative du gouvernement
fédéral à partir des années 90 a clairement été de tenter
de mettre en place les prémices d'une réorganisation
néolibérale en matière d'éducation publique avec cette
idée centrale au libéralisme que le savoir est un produit
comme un autre, susceptible d'obéir aux lois du marché
et de la commercialisation. Le prétexte officiel (Président
Roman Herzog : "Notre système éducatif ne doit pas
devenir la lanterne rouge de la société") était la menace
d'une institution trop protégée et s'endormant loin d'un
monde où règne la compétition, une réaction contre un
manque d'agressivité orchestré par les pédagogues trop
marqués par l'héritage de mai 68 et les cultures
alternatives très en vogue dans ce pays. Les
privatisations, le resserrement des études, l'importance
des notes, apparaissaient à de très nombreux
responsables, mais aussi - grâce à une habile politique de
communication - à la société civile et particulièrement à
la classe moyenne comme la panacée… Les hommes
politiques allemands profitaient de la réunification, des
difficultés causées, de l'anti-modèle constitué par
l'ancienne RDA et de "la crise". Le gouvernement
224
social-démocrate pressait le pays dans une cure de
rigueur avec son agenda 2010. Un discours parallèle,
soutenu par des résultats assez mauvais aux enquêtes
PISA, s'appliquait tout naturellement à l'institution
scolaire, tandis qu'on fantasmait sur le tigre chinois, les
universités indiennes ou le modèle finnois. Ce qu'on
annonçait moins, c'est qu'à l'horizon de ces réformes, il
était clair que l'accès au savoir (écoles, universités,
bibliothèques, banques de données, portails internet)
serait en fin de compte contrôlé directement ou
indirectement par des multinationales et les "fondations
" qui en dépendent. Ces services seraient en outre,
comme le veut le marché, payants. Une telle évolution
suivait en gros les recommandations de l'OCDE (dont on
fait aussi grand cas en France) et de l'OMS,
recommandations qui visent d'ailleurs tous les secteurs
publics sur le plan mondial et que des think tanks comme
le Cato Institute, la Mont Pelerin Society ou le World
Economic Forum, les cercles fréquentés, inspirés par
Hayek et Friedman, ont préparé. En Allemagne, la
fondation Bertelsmann (aussi représentée en France) a,
dans ce processus, un rôle-clé. Les médias répercutant
pour leur part les "ordres de marche" !
Ces avancées libérales ont profité également des erreurs
du système scolaire fédéral, des différences entre les
Länder habilement exploitées, et de l'idée généralement
répandue en Allemagne qu'un équilibre s'établira
naturellement tôt ou tard entre le pouvoir politique et les
exigences du marché.
Or, il semble bien que le néolibéralisme, dernier avatar
du capitalisme et facteur essentiel dans la délégitimation
du politique, prépare dans le cadre de ce qu'il est
convenu d'appeler la mondialisation, les accords
225
internationaux qui rendent vain le contrôle par les lois
nationales des investissements et de la politique des
multinationales, comme l'avait prévu le Multilateral
Agreement on Investment (MAI) ou le General
Agreement on Trade in Services (Gats).
Même si, en ce moment, il semble - sans doute en raison
de la crise - que le politique reprenne de l'assurance, il
ne s'agit probablement que du chant du cygne. En
matière d'éducation, particulièrement, il est exclu que
l'on fasse marche arrière tant les forces en présence sont
inégales et tant l'idée même de commercialisation a fait
de progrès : plus qu'en France encore, le système libéral,
a jeté son dévolu principalement sur les formations
supérieures : créations d'écoles privées, d'universités
privées, liaison étroite entre l'université et le système
économique, droits d'inscriptions en forte
augmentation... Cependant, les formations intermédiaires
ne sont pas oubliées et la plupart des grandes entreprises
proposent aux jeunes un complet cursus de formation,
l'État n'étant plus là que pour entériner, cautionner les
diplômes distribués. Bien entendu, comme nous sommes
encore dans une période de transition, le système libéral
cherche à donner l'impression d'une coopération avec
l'État et exhibe (dans les médias, dans les programmes
mis en place) des gages de son "humanisme". Mais
pour combien de temps encore ? En attendant, l'État
(même si la situation fédérale de l'Allemagne rend les
faits plus difficiles à définir globalement) navigue au plus
près : réduction des dépenses en matière d'éducation (ce
qui à la fois va dans le sens de ce que réclament les
chantres du libéralisme et confirme paradoxalement leur
critique : l'enseignement d'État est incapable d'assurer
un enseignement de qualité) et intérêt porté au contrôle
226
des performances des établissements scolaires et des
universités par ces sortes d'agences de notation que sont
les TIMMS, PISA, LAU…, qui ne font en fait, par leurs
recommandations, que préparer le désengagement total
de l'État et la disparition de l'idée même d'une institution
scolaire nationale. Lorsque les résultats des premières
enquêtes PISA ont été donnés, ils ont créé en Allemagne
un véritable choc : alors que les citoyens vivaient dans la
croyance de bénéficier d'un excellent système scolaire,
on leur apprenait que c'était tout le contraire et qu'il était
temps de se rapprocher de la réalité (entendons des lois
du marché). L'école ne devait plus ronronner mais
devenir la base sur laquelle se forgerait une société
libérale et dynamique, compétitive et désireuse d'en
"vouloir" !
La discussion autour de l'école continue à être vive, mais
il sera probablement difficile de résister à un
néolibéralisme qui fait flèche de tout bois et sait
parfaitement dissimuler ses finalités derrière des
arguments qui à première vue paraissent aller de soi, ou
peuvent passer pour progressistes en première analyse :
pourquoi passer un bac après 13 années de scolarité alors
que la quasi-totalité de l'Europe ne consacre que douze
années à ces études ? Pourquoi ne pas commencer plus
tôt à fréquenter l'école ? Pourquoi ne pas généraliser
l'accueil dès un an ? Pourquoi ne pas introduire la
journée d'école complète ? Pourquoi ne pas multiplier les
universités libres ? En réalité, il convient d'économiser :
12 années reviennent à moins cher que 13 et puis, il
faudra forcément tailler dans les programmes trop vastes,
ne garder que l'utile… Derrière chaque explication
teintée de reflets "humanistes", raisonnable en
apparence se cachent les raisons du marché, le profit,
227
l'instrumentalisation des formations et des individus. Le
président de l'association des patrons, s'emporte pour sa
part et réclame, applaudi par la classe politique, moins de
savoirs et davantage de compétences! Cette classe
politique en grande partie inféodée aux lois du marché se
refuse à envisager d'autres voies et sert de courroie de
transmission à ces revendications que la presse, les
innombrables shows télévisés rendent banales, allant de
soi.
L'idée même des fameux chèque-éducation de Milton
Friedmann a été reprise (sous une forme dérivée il est
vrai, mais c'est le moyen d'expérimenter) par la ministre
du travail à propos de la réforme du Hartz-IV (RMI
allemand). Les enfants de ces familles défavorisées ont
droit à des chèques éducation qui remplacent en partie les
prestations en argent versées aux parents jusqu'alors pour
eux afin que ces enfants puissent vraiment profiter de ces
prestations sous forme de cours, de loisirs organisés…
En France, on peut se croire loin de tout cela. L'école
républicaine ne paraît pas aussi menacée. Cependant, ce
"retard" français ne doit pas faire illusion et nous avons
rappelé plus haut la part que se taille actuellement le
privé. La restructuration néolibérale du système éducatif
a pris son essor : les coûts sont tenus au plus bas quand
ils ne régressent pas (et la "crise" permet de faire passer
à peu près tout) ; l'inégalité devant le savoir n'a pas
diminué malgré l'illusoire démocratisation des peaux
d'âne ; enfin, on a su fasciner la classe moyenne en
semblant aller dans son sens en dénonçant la faiblesse
des niveaux tout en lui faisant croire que ses enfants, en
fréquentant les grandes écoles, les instituts privés
228
arriveront au sommet de la société : réputation, argent…
Sous la pression d'une polarisation sociale de plus en
plus menaçante en ces temps de globalisation, les classes
moyennes cherchent à échapper à la spirale de la
dégradation salariale et à permettre à leurs enfants - à
quelque prix que ce soit - d'accéder au niveau des nantis,
ce qui repousse aux calendes grecques, une fois de plus,
toute espoir de justice d'égalité des chances. C'est sur de
telles situations que les "donneurs d'ordre" désormais
s'appuient dans le monde entier. En Inde, une famille
sacrifiera tous ses membres pour collecter suffisamment
d'argent nécessaire aux études de l'un d'eux dans une
université privée prestigieuse. À charge de revanche
quand il aura réussi ! Le phénomène est semblable au
pays de Confucius et de Mao où les parents se saignent à
blanc pour la réussite, sociale et financière, de leur
enfant.
*
Pour l'ordre cannibale libéral (Jean Ziegler), il est clair
que l'École est un enjeu important : lieu de formation, il
faut le contrôler, lieu de profits, il faut encore mieux
l'assujettir aux lois du marché. La stratégie qui s'est mise
en place au cours de trente ou quarante dernières années
est simple. La première phase consiste dans la
diffamation des systèmes scolaires d'État (et c'est une
des raisons pour lesquelles les critiques "républicaines"
portées contre l'école doivent toujours mettre en
perspective le projet libéral pour s'en distinguer), une
phase allant de soi dans la mesure où le politique, s'il
affirme publiquement son importance, fait en sorte que la
mission qui devrait être celle de l'École ne puisse se
229
réaliser correctement. Il est alors facile d'emboucher la
trompette de la contestation avec la foule des familles,
avec l'opinion publique habilement travaillée, facile à
convaincre de cette dégradation de l'École : "Non !
Vraiment, une telle école ne remplit plus sa mission ! Nos
enfants ne savent plus rien ! La pagaille !". À tous ceux
qui réclament alors un autre engagement de l'État, plus
de moyens, de meilleures conditions voire une autre
école, exigences naturellement onéreuses ou dangereuses,
les donneurs d'ordre opposent un système qui ne coûte en
apparence rien à la communauté, dont les maîtres mots
ont été forgés par Milton Friedmann et consorts dans les
années cinquante : le libre choix de l'établissement
scolaire, l'ouverture de l'école à la compétition et les
chèques éducation, le reste allant de soi. Le facteur
essentiel du développement d'une institution scolaire qui
irait dans le bon sens, c'est-à-dire dans les perspectives
du marché, le nerf de la guerre, serait l'émulation,
comprise comme un nouveau "struggle for life" : jouer
les écoles contre les écoles dans les recrutements comme
dans l'acquisition de moyens financiers, récompenser les
enseignants considérés comme méritants et sévir auprès
de ceux qui ne satisfont pas. Si les clients d'une
entreprise s'en détournent, si les financeurs font la sourde
oreille, il n'y a que deux solutions : la fermeture ou un
sursaut salutaire allant dans le sens des lois du marché et
de la compétition. Pour un établissement scolaire, il
devrait en être de même : sa réputation ferait sa "
clientèle" et déciderait de son avenir, des ressources dont
il disposerait. Ceci implique une démarche managériale
des chefs d'établissement : s'arranger pour avoir une offre
excellente (statistiques des résultats, budgets
excédentaires…), se faire connaître, en un mot, savoir se
230
vendre. L'excellence, de ce type, implique elle-même le
recrutement ou le renvoi d'enseignants susceptibles
d'avoir une influence sur l'image que l'on veut propager
(titres, capacités mises en avant, moralité…), donc, un
contrôle sévère de ces derniers en fonction de critères qui
ne sont pas nécessairement en accord avec la déontologie
de la profession, et une diversité des salaires versés, tout
comme elle implique une sélection au niveau des élèves
(officiellement au nom du nombre de places possibles)
qui se présentent. Ce système existe déjà dans les "
bonnes" écoles australiennes. En Nouvelle-Galles-du-
Sud par exemple, pour être enseignant, il faut être
titulaire d'une "licence" qui fait de vous certes un
fonctionnaire, mais qui ne vous garantit pas l'emploi :
muni de cette licence délivrée par l'État à la suite des
études, chaque professeur peut proposer sa candidature
aux établissements scolaires et il sera retenu pour un laps
de temps plus ou moins long afin d'y développer un
projet qu'il aura su défendre devant une commission et
qui aura convaincu.
Une véritable compétition entre établissements exige en
outre une certaine transparence : coûts, dépenses,
recrutements, un panel d'offres assez diverses et une
autonomie en matière de pédagogie et de finalités,
chaque établissement proposant à la limite un autre projet
ou concept pédagogique avec à l'horizon la possibilité de
demander aux familles des contributions supplémentaires
exceptionnelles ou régulières, dans la mesure ou l'offre et
les résultats attendus dépassent les possibilités de
financement des "chèques éducation" !
Le risque (la conséquence !) d'un tel système est bien
entendu la ségrégation sociale et la hiérarchie des
231
établissements. Enfin, comment concilier l'obligation
scolaire et ce modèle marqué par les prétendues lois du
marché telles que les néolibéraux les formulent ? Si un
établissement voit son recrutement diminuer à cause de
sa mauvaise image de marque, il devra fermer, comme un
supermarché ferme quand il n'a plus de clients. Or, si le
nombre d'établissements diminue, si certains se sentent
autorisés à exiger des parents des droits d'écolage
toujours plus élevés, comment scolariser tous les enfants
puisque beaucoup d'établissements disparaîtront ? Une
seule solution : reconstituer ou préserver une école
parallèle, "à l'ancienne", dirigée directement par l'État
et réservée aux jeunes n'ayant pas trouvé de place dans le
"bon" système, ceux dont personne ne veut…
L'avantage est double : chacun est à sa place et on peut
continuer à faire croire à l'existence d'une école
républicaine ! Ceci débouche naturellement sur la
revendication de la suppression de la carte scolaire, et sur
celle du libre choix de l'école, un choix qui trouve son
pendant, sa réciproque dans l'acceptation ou le refus des
candidatures par l'école !
Les "chèques éducation" évoqués plus haut participent
de cette stratégie. Le budget réservé à l'éducation
publique n'est plus entièrement versé aux établissements
par l'intermédiaire du ministère par exemple ou de
l'administration scolaire. L'État choisit de passer par
l'élève. Un "chèque éducation" est établi au nom de
celui qui doit en bénéficier (l'élève, l'étudiant…) ou de
ses tuteurs (parents…). Le montant du chèque est fixé par
l'État et est le même pour tous, quelle que soit la
situation familiale. Avec ce chèque, le jeune pose sa
candidature pour telle ou telle école, reconnue par l'État,
correspondant à ce qu'il désire. L'établissement
232
échangera ce chèque auprès des caisses de l'État pour
subvenir à tous ses coûts (personnel, locaux…) dans le
cadre de l'autonomie de son administration. L'idée -
formulée dès les années cinquante par Milton Friedmann
- était de parvenir à un effort mesuré de l'État en matière
d'éducation et de formation, plus efficace
économiquement tout en respectant le droit à l'éducation
inséparable des démocraties modernes.
Ce ne sont pas là des spéculations. Aux États-Unis,
plusieurs expériences ont été menées avec ces chèques
éducation dans le but officiel de voir s'ils pouvaient
permettre à certains enfants de milieu défavorisé de
fréquenter de meilleures écoles que celles auxquelles ils
étaient destinés. À New York, par exemple, ces bons
devaient faciliter le recours à des cours de rattrapage
et/ou offrir la possibilité de suivre des formations dans un
collège privé. Il y eut d'abord plus de candidats que de
chèques ce qui impliqua un tirage au sort et de devoir
s'en tenir à un enfant par famille, les frères et soeurs
servant de groupe de contrôle ! Au bout de quatre années,
l'examen des résultats (comparaison des groupes) a
montré qu'il n'y avait aucune différence dans la
population blanche ou asiatique et de très légères chez les
noirs sur le seul plan des compétences en matière de
lecture. Les résultats ont été aussi décevants en d'autres
endroits. On aurait pu s'y attendre puisque la plus grande
expérimentation a eu lieu au Chili, avec la prise de
pouvoir de Pinochet. Les chèques y ont été introduits en
1981 de manière très large et ont favorisé la naissance de
plus de 1000 écoles privées, mais une étude de 2005
montrait une influence négative sur les apprentissages et
les résultats, en revanche une ségrégation
particulièrement prégnante des populations d'élèves. Ceci
233
ayant été constaté dès les années 1990, les responsables
avaient dû faire marche arrière devant le gâchis qu'ils
avaient créé, mais le travail destructif commis a laissé des
traces indélébiles malgré les changements politiques. On
peut encore citer les mêmes échecs en Afrique du Sud, en
Argentine, à Hong Kong, au Mexique, en Nouvelle-
Zélande où le "cool Choice", l'autonomie des
établissements devaient améliorer la qualité de
l'institution scolaire en milieu urbain et où, au contraire,
les écarts ethniques se sont accentués…
*
Le modèle néolibéral d'une institution scolaire gérée
selon les principes de ce que l'on appelle les lois du
marché est majoritairement négatif dans ses résultats. Ses
conséquences sont la ségrégation, la baisse des niveaux
globaux et des écoles d'État (quand elles existent encore)
réduites à gérer ce que ce système rejette, avec une
pénurie de moyens et n'obtenant bien évidemment que
des résultats faibles !
En France, nous n'en sommes peut-être pas encore là,
mais l'observateur attentif peut remarquer que des "
avancées" se font (à couvert) dans le sens des exigences
du libéralisme au moins depuis l'ère Mitterrand et la mise
en avant des chevaliers d'industrie modernes comme
Bernard Tapie qui sera même ministre d'un
gouvernement socialiste sans que cela étonne : la
revalorisation de la position et de la carrière des chefs
d'établissement qui deviennent des managers auxquels on
pourra verser de modestes "surprimes" mais surprimes
tout de même, des chefs d'établissement qui bientôt
234
noteront leurs enseignants en toute indépendance, l'idée
d'une d'ENA qui leur serait réservée, la plus grande
autonomie des établissements, la place de la société civile
dans les conseils d'administration, la progression au
mérite des carrières, les primes versées, la suppression
progressive de la carte scolaire, l'accent mis sur les
enseignements de base et la possibilité de voir les
matières dites secondaires passer au rang d'options (nous
ne sommes pas éloignés des chèques éducation), les
projets d'aménagement du temps scolaire hors
enseignement avec des ateliers, des activités que le jeune
pourra choisir plus ou moins librement, ateliers dirigés
par des "moniteurs" n'appartenant pas à l'éducation
nationale, rétribués par les établissements…
Mais dans notre pays, répétons-le, les avancées dans le
sens du marché se font prudemment, de manière voilée
pour ne pas effrayer l'opinion. La ségrégation elle-même
a toujours indirectement été suscitée par le système et ses
acteurs, parfois naïvement. Il y a peu d'années encore, je
participais aux jurys de choix des candidats à une place
dans plusieurs BTS de l'Est de la France. Environ 120
dossiers pour 24 places. Les professeurs importants
(enseignant les matières techniques essentielles)
écartaient les dossiers de candidats ayant un nom
étranger, plus exactement à consonance arabe. Après les
protestations rituelles de non-racisme, ils avançaient les
raisons les plus diverses et les plus extravagantes : les
jeunes Maghrébins peuvent être bons en théorie, mais dès
qu'il s'agit de pratique, on ne peut leur faire confiance
(ah ! le "travail arabe" !) ; ils sont trop brouillons pour
une spécialité qui réclame de l'exactitude ; il sera
impossible de leur trouver un stage : "Les entreprises
n'en veulent pas" et quand on réussit à leur en trouver
235
un "on n'a toujours des histoires. Rappelez-vous les
ennuis qu'on a eus avec Mohamed X… !".
Pour faire plaisir au prof de français qui proteste et
montrer sa bonne volonté républicaine, on acceptait tout
de même parfois d'en prendre un ou deux. Mais leurs
dossiers étaient alors exceptionnels et il s'agissait en
général de candidates : "Les jeunes Maghrébines, c'est
pas tout à fait la même chose !"
Coûts de la scolarité en France et en Allemagne
(2007) - intéressant dans l'optique des "chèques
éducation" (en Euro : Sources Ministères de l'EN)
France Allemagne
Préélémentaire 4970
Élémentaire 5440 3362
Collège 7930 4600(Haupt+ Realschule)
Lycée gén./techn. 10420 5132
Notons qu'en Allemagne, malgré des salaires des enseignants
beaucoup plus élevés, ces dépenses sont de loin inférieures à ce
qu'elles sont en France. Il faut dire que l'enseignement
préélémentaire est en phase de gestation et que la participation
parentale est de règle, que le primaire ne dure que 4 années, que la
Hauptschule prend fin après neuf années de scolarité (une dixième
est prévue) et la Realschule se termine à la fin de la dixième année
de scolarité ! L'enseignement professionnel est en grande partie
géré par les chambres économiques et les entreprises et il n'y a pas
de classes prépa. Pas d'infirmerie avec son personnel, pas de CDI
au sens où on l'entend en France, de rares cantines, pas de
surveillants (rôle attribué aux professeurs), pas d'employés, hormis
le concierge (qui souvent se partage deux établissements). Les
travaux sont effectués par des équipes tournantes (appartenant à la
ville) ou par des firmes privées recrutées par la commune.
*
236
Cet essai refuse totalement un système scolaire en
adéquation parfaite avec les prétendues lois du marché et
qui ne viserait qu'à établir une société inégalitaire et
inhumaine, entièrement réifiée avec pour seule finalité le
profit matériel poussé à l'infini, la rentabilité comme
moyen et finalité. Il plaide au contraire pour une véritable
école citoyenne, un service public au bénéfice de futurs
citoyens responsables, épanouis et sans hésiter à le dire,
plus heureux qu'actuellement. Le libéralisme rêve (s'il
rêve jamais !) au contraire d'établissements privés en
compétition constante, aux ordres exclusifs de la
demande des marchés et préparant à la lutte économique,
abandonnant au service public les fractions de la
population qu'il refuse de prendre en compte ou dont
l'absence de qualification lui est encore nécessaire.
Pour remplir la mission qui devrait être la sienne, le
secteur public doit cependant évoluer, ne plus être
l'apanage de "spécialistes", de professionnels, de
fonctionnaires visant d'abord une "carrière" à leur
avantage. Un véritable service public fait partie, est
constitutif de l'identité républicaine, de la res publica. Il
nous concerne tous et n'a pas à être cette forteresse tenue
par ces "fonctionnaires" qui font trop souvent passer
l'esprit de corps avant le zèle qu'on attendrait d'eux, qui
songent d'abord à leur situation avant d'être au service de
leurs concitoyens. On a vu à une certaine époque quelles
dérives menaçaient un tel service public coincé entre la
crainte de perdre quelques minces privilèges et les
exigences de "l'État français" ! Affaire de tous, un
service public d'éducation ne devrait plus, pour de
fausses raisons d'efficacité, n'être incarné que par
quelques-uns, uniquement par des "professionnels"
237
quand le concept même d'éducation dépasse largement le
cadre d'une profession et que la transmission des savoirs
doit utiliser tous les vecteurs possibles. C'est à chaque
citoyen d'y contribuer dans la mesure de ses capacités au
sein d'une société réorganisée qui saura faire passer au
second plan les impératifs de productivité, de profit,
d'accumulation des biens, le mythe du travail, celui de la
réussite sociale basée sur la situation… Tout le monde
aura quelque chose d'important à apporter à l'édifice
commun.
Le terme "service" retrouverait son sens, la profession
d'enseignant sa déontologie et sa justification : un
professeur libre dans une école indépendante de tous les
pouvoirs, mais au service de tous.
On peut imaginer, auprès de pédagogues particulièrement
formés, la foule des citoyens qui consacrerait,
périodiquement, une partie de son temps à l'éducation, à
la formation humaine puis professionnelle des
générations montantes. Un service social allant de soi !
Enfin et surtout : que la proscription du principe de
rentabilité dans l'École !
La transformation intégrale de l'institution scolaire est
urgente pour au moins deux raisons principales.
D'abord parce qu'il faut prendre en considération
l'évolution générale de la société - une évolution amenée
et imposée par la main de fer des marchés - avec une
moindre importance accordée dans tous les milieux à
l'étude et aux disciplines intellectuelles pour elles-mêmes
puisque la tendance est à l'utile, à ce qui est
immédiatement monnayable, avec une déstructuration de
couches sociales entières frappées par le chômage, la
précarité et l'incertitude des lendemains, avec
238
l'implantation rendue artificiellement difficile de
populations immigrées, avec un consumérisme qui
s'érige en valeur suprême et un individualisme
grandissant qui frise parfois à l'autisme (la classe
politique étant elle-même - mais à un autre niveau -
selon le mot de Peter Sloterdijk un "club d'autistes"
(Davos, le G20, le G8…) -, chaque individu vivant
désormais, si le mouvement se poursuit, dans sa coquille,
en autarcie intellectuelle, avec son portable, son I-Pod, sa
musique, ses films… Au lien social traditionnel se
substituent les grands rassemblements épisodiques
(apéro-géants, défilés type homo pride, festivals…), les
face-book et autres plateformes sociales qui donnent
l'illusion d'être au centre du monde, écouté par des
centaines d' "amis", en un mot : la télécommunication
remplaçant la communication, l'isolement dans la foule
palliant illusoirement la solitude pure et simple.
Une vie réduite à l'instant, au moment vécu, sans rapport
désormais avec un passé inconnu et qui ne signifie plus
rien ou qui ne survit que par l'image dévaluée qu'en
donnent les médias, le cinéma, les jeux vidéo, et un
avenir qui est le "no future", l'ancienne objurgation des
Punks, un avenir qui ne peut être que noir et qu'on se
refuse à envisager. Un "carpe diem" en quelque sorte,
mais un carpe diem sombre, imposé, auquel Horace
n'avait certainement pas pensé.
Ensuite, parce que l'histoire nous l'a montré : telle
qu'elle a toujours existé, cette institution n'a jamais été
que la voix de ses maîtres et, aujourd'hui, où, malgré
tout, les individus parviennent à un certain degré de
savoirs (le plus souvent indépendants de l'école) et qu'ils
revendiquent davantage ces droits individuels qu'on leur
fait miroiter pour des raisons mercantiles, elle est
239
entièrement obsolète avec son fonctionnement et des
finalités datant d'un autre temps. Son organisation est
restée globalement ce qu'elle était en dépit des évolutions
sociales, technologiques et d'une massification de
l'enseignement, certes, souhaitable mais géré dans le
cadre étroit des pensées, des méthodes et des moyens
d'hier.
Inutile de se retourner vers les vertus de l'école ancienne,
si tant est qu'elles aient eu un semblant de réalité à
certaines époques où la misère absolue de la majorité
pouvait faire passer un moindre mal pour un bien et que
Victor Hugo écrivait cette phrase ambiguë et riche de
prolongements : "Ouvrez des écoles et vous fermerez
des prisons". N'était-ce pas reconnaître que cette école,
même pour les poètes établis, était la garante de l'ordre
bourgeois et capitaliste qui se mettait en place ? Héritière
sous sa forme moderne de son ancêtre du XIXe siècle qui
avait pour but principal la reproduction des rapports de
domination et de richesse comme l'ont montré par
exemple Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron,
l'institution scolaire actuelle a conservé son organisation
hiérarchique, autoritaire, coercitive et antidémocratique
que tous les make-up modernes, la phraséologie ne
dissimulent pas (conseils de classe, délégués élèves,
conseils d'établissement, consultations en tous genres…),
elle est un univers de contraintes (les horaires, les
devoirs, les emplois du temps, la classe, les notes,
l'enseignement frontal, l'obligation de rester assis des
heures, tuant le temps en copiant ou recopiant la parole
du "maître", en dessinant, en bavardant à mi-voix, en
s'enfuyant par le rêve…), un univers de contraintes où
l'argument d'autorité écrase toute parole vraie. Elle
transmet des contenus et des comportements
240
capitalistophiles (apparente méritocratie, éloge constant
du "travail", de la performance, des résultats,
enseignements et programmes allant dans ce sens et dans
celui de la consommation, du "toujours plus"). Elle est
le microcosme de notre société, le creuset où cette société
se forge : elle obéit en tout à la dictature du capital.
À ces raisons qui se suffisent, on pourrait en ajouter
d'autres comme le malaise actuel, dont le burn-out des
enseignants ou la violence scolaire ne sont que des
épiphénomènes, malaise qui ne se résoudra ni avec des
doses de réformisme ou de pédagogisme, de didactisme
plus ou moins importantes ni avec un retour des
méthodes autoritaires.
L'école est tout simplement dépassée. C'est tout le
système qui est à repenser : les programmes, leur
émiettement, l'organisation des établissements, la
responsabilité des différents acteurs, l'adéquation avec
les exigences de l'industrie, de la productivité moderne et
du capitalisme libéral, avec pour conséquence immédiate
le déclin des valeurs intellectuelles, l'oubli des impératifs
humanistes, le désir de ne plus former que des pions
"utiles". On taille et on retaille les programmes pour ne
conserver que cet "utile", ce qui sera, pense-t-on,
susceptible de servir au futur citoyen-consommateurproducteur,
dont on espère une intégration la plus rapide
(et la plus longue) possible au monde "réel" de cette
production-consommation…
À cela s'ajoute le fait que l'enfant, l'adolescent ne sont
plus les mêmes qu'il y a vingt ou trente ans : nous vivons
dans un contexte nouveau qui voit la fin des anciennes
structures sociales, familiales, des repères traditionnels.
L'enfance est de plus en plus courte (on demande même
241
au gamin de 10 ans (voire moins) de développer des
"projets de vie" !) et les médias, par le fatras incontrôlé
des informations véhiculées y concourent fortement.
Certains croient pouvoir dire qu'il s'agit là de
conséquences inéluctables de la marche du temps,
pourtant on peut en douter si l'on croit au libre arbitre de
l'être humain, que l'on refuse de voir dans l'humanité une
immense fourmilière tout en rêvant d'une nouvelle
mission pour l'École.
Le développement actuel de l'humanité n'est qu'un
modèle de développement, la conséquence d'une
idéologie. On peut en imaginer d'autres. Il y a trente ans,
qui aurait pensé la fin des communismes d'état ?
En outre, l'institution scolaire refuse de prendre
sérieusement en compte les évidences catastrophiques de
l'exploitation irréfléchie de la planète : les ressources
énergétiques et matérielles, la saturation de
l'environnement ! On est resté très positivistes dans
l'éducation nationale : le "progrès" technique y est
toujours présenté comme illimité, les atteintes à
l'environnement secondaires ou causées par trop peu de
technologie et quand on emmène les élèves visiter une
centrale atomique, c'est en rang par deux, pour des
raisons de sécurité, mais aussi parce que le but de telles
visites est d'abord de montrer le génie scientifique du
pays, d'étonner ces jeunes face au dieu-progrès, quitte à
concéder une rencontre avec un "responsable" qui saura
éventuellement rassurer et mettre les rieurs de son côté si
des questions trop critiques sont posées.
C'est d'ailleurs un cas général : l'éducation nationale, à
l'exemple de ses représentants "en mission", courbe le
dos lorsqu'elle est confrontée au monde extérieur, à la
"réalité" ! Une sorte de complexe d'infériorité qui fait
242
que le prof en contact avec une entreprise, une banque,
une usine quelconque se montre excessivement
respectueux et réclame de ses élèves (visiteurs ou
stagiaires) la plus grande déférence face aux
professionnels rencontrés dans ces lieux où se fera leur
avenir.
Il m'est arrivé en compagnie de collègues de rendre visite
à nos stagiaires BTS chez Peugeot ou ailleurs. Plus
l'entreprise était grande, moins il convenait de faire état
des critiques des étudiants : "On ne s'occupe pas de
nous", "Je passe mon temps à rentrer les voitures sur le
parking ; c'est pas mal dans un sens, mais ça rime à
quoi ?" "Mon maître de stage m'a mis à classer des
documents et cela n'a rien à voir avec ce que
j'attends"… Pas folle l'équipe des profs : on ne va pas
écouter les gamins, sinon, l'an prochain "ils" ne nous
proposeront plus de stage et on aura l'air fin ! Le
pédagogue se sent mal à l'aise face à l'ingénieur qui le
reçoit, l'ingénieur avec toute la mythologie qui l'entoure,
son air assuré, son dynamisme apparent. Lui, le prof, il a
un peu honte de ses vacances, de sa qualité de
fonctionnaire, de ses horaires étriqués, de son petit
traitement. Si la conversation évoque tout cela, il sort le
moulin à paroles de ses jérémiades habituelles : ses
corrections, ses heures de préparations, les classes
surchargées… Il croit devoir se justifier et en rajoute
pour montrer que lui aussi travaille énormément ! Les
ingénieurs et contremaîtres qu'il rencontre le raillent en
effet un peu : trois mois de vacances ! La gabegie dans
les écoles ! Le petit niveau des élèves ! Le prof s'excuse
avec un sourire contraint. Que peut-il dire d'autre ? Eux
perçoivent de gros salaires, pas lui ! Eux ont une situation
enviée, ils vivent la vraie vie, la science, le modernisme,
243
pas lui !...
Alors, en classe, il fait du zèle, il veut donner aux élèves
le goût du travail. On ne parle que de travail à l'école !
Comme dans la "vraie" vie !
Travailler toujours plus pour produire plus et consommer
davantage alors que les ressources planétaires au sens
large sont mesurées ! Les 35 heures du projet socialiste
étaient une plaisanterie allant dans le sens des réformettes
avec lesquelles on endort les populations ! Pourquoi 35
heures (on pourrait parodier le "Français, encore un
effort pour devenir républicains" de Sade !) alors que
des études récentes montrent que travailler quelques
heures quotidiennement serait suffisant pour conserver un
niveau de vie comparable à celui des années 80-90 et
l'assurer dans un avenir plus ou moins proche à la totalité
de la population mondiale !
Cela suffirait pour protéger raisonnablement
l'environnement et laisser aux générations à venir une
base de vie acceptable ! En 1977, le collectif Adret
publiait un livre ayant eu alors un retentissement certain :
Travailler deux heures par jour. Ce livre (rarement
réédité) a été un best-seller et démontrait avec rigueur
l'absurdité des conditions de travail et de sa
sacralisation : 80% de l'énergie était parfaitement
"improductive" ! Je me souviens de l'intérêt qu'y
avaient pris mes étudiants de BTS Bureau d'études et
Photonique…
Malheureusement, comme trop souvent, les meilleures
lectures, les meilleures idées ne servent que d'exutoire,
car il y a toujours loin de la coupe aux lèvres. Pourtant,
c'est peut-être là que l'école aurait tout son rôle à jouer !
244
Travailler deux heures par jour a eu une "suite" lors des
mouvements sociaux de 1995, sous le titre Résister (Minuit) : les
témoignages de ceux qui, refusant les aspects inégalitaires et
inhumains de la société, proposaient des solutions alternatives.
Actuellement, le collectif s'est reconstitué face à la question du
changement climatique et a sorti en 2007 Le changement
climatique: aubaine ou désastre ? (Cerf).
Le même espoir relie ces trois ouvrages écrits le temps d'une vie
d'adulte : celle du refus de l'ubac et le choix du versant ensoleillé
des montagnes ; continuer à croire qu'on peut s'opposer à tout ce
qu'on nous propose comme "fatalité" alors que derrière les
événements, il n'y a pas de fatum mais bel et bien des hommes !
Prendre notre destin en main en faisant passer l'individu avant les
marchés !
*
La remise en question radicale d'une institution qui a
abandonné toute autonomie pour se mettre totalement au
service des dérives socio-économiques actuelles est bien
la seule réponse possible : pas de replâtrage, mais une
déconstruction totale d'un modèle dépassé dans les pays
dits riches et la refondation d'une nouvelle école
indépendante dans un contexte nouveau partout dans le
monde. L'institution scolaire a toujours été le lieu de la
formation des futurs rouages du système politique ou/et
économique (pour ne pas revenir trop en arrière : les
rouages de la société capitaliste et de son dernier avatar le
libéralisme actuel), le creuset où se forgent avec
raffinement les chaînes voulues par les États. Il ne peut
donc pas avoir de réforme possible. Il ne peut y avoir de
véritable transformation de cette institution, sans
séparation totale d'avec tous les systèmes qui l'inféodent
et élaboration d'une éducation libre de toute intention.
C'est pourquoi la première revendication doit être celle
245
d'un service public indépendant. Une démocratie digne
de ce nom devrait s'appuyer sur 4 pouvoirs : l'exécutif, le
législatif, la justice et l'École. C'est-à-dire que
l'éducation obligatoire et gratuite devrait ne dépendre
que des acteurs qui la composent : les enfants, les
enseignants, les parents. Tous les trois devraient y être
impliqués avec la même importance. Nous l'avons
évoqué au début de cet essai : l'école doit à la fois aider
les personnalités à se "faire", éduquer et instruire. Les
pédagogues, s'ils demeurent indispensables, ne peuvent
continuer ni à assumer toutes les tâches ni rester
enfermés dans leur tour d'ivoire. L'École nouvelle devra
être une entreprise réclamant l'implication et la
collaboration de tous sans être inféodée au politique ou à
l'économie.
Qu'elle soit composée d'une école primaire ou
fondamentale pour l'apprentissage des bases et le
développement des personnalités de chaque enfant par un
apprentissage libre comme l'ont suggéré les pédagogues
depuis Rabelais et Montaigne jusqu'à Freinet en passant
par Rousseau qui - s'il n'imaginait pas de système
scolaire de masse - réclamait que l'enfant, dans les
étapes de son développement successives, soit la seule
mesure de tout enseignement ou découverte guidée par
des professeurs (pas des "maîtres") sensibles et
modestes sachant respecter l'enfant (il n'y a pas de
meilleur principe), qu'elle prenne d'autres formes,
définisse une seconde école destinée aux plus grands et
davantage ouverte aux activités futures du jeune adulte
ou permette aux citoyens, leur vie durant de se former, de
changer d'activité, sera à définir par l'ensemble de la
population.
246
Il n'est pas en effet du propos de ce livre de faire des
propositions. Comme le disait récemment Jean Ziegler à
qui une journaliste demandait quelles seraient les
remèdes qu'il faudrait appliquer à ce monde malade qu'il
tance d'importance dans son dernier livre : "L'essentiel
est de changer la conscience générale, les pratiques
suivront".
J'ajouterai que dans les pages qui précèdent j'ai essayé
de montrer que la source de tous les maux (pas seulement
de l'École) est l'absence d'indépendance de l'institution
et l'incapacité des dirigeants politiques d'avoir des
conduites vraiment démocratiques. En outre, à toutes les
époques, on a trop attendu l'homme ou la femme
exceptionnelle, providentiel, le Sauveur alors que ces
sauveurs se sont révélés être le plus souvent des Führer
désastreux pour la majorité ! Il faut toujours se méfier de
celui qui pousse à sortir de la caverne.
Il serait paradoxal que je pense pouvoir - après avoir
pointé du doigt ce que je crois être les errances de
l'institution scolaire - moi seul, donner des solutions,
élaborer un plan d'éducation qu'il revient à la société
civile dans son ensemble de développer. Il est toujours
mauvais d'imaginer qu'on puisse concevoir, en matière
de société, abstraitement, seul, un système valable,
démocratique et républicain au vrai sens du mot. C'est
d'ailleurs pourquoi Rousseau refusait de considérer son
Émile comme un ouvrage pédagogique voire un recueil
de propositions visant au renouvellement des études.
L'École nouvelle doit naître de la société civile, pas de
ses représentants, pas de technocrates ou d'impulsions
particulières, de mouvements d'humeur forcément
subjectifs.
Cessons seulement de penser qu'on a à faire à des enfants
247
qui n'ont pas droit au chapitre, à des parents qui se
déchargent de leurs responsabilités, à des pédagogues qui
ont LE savoir. Les jeunes, même les plus jeunes ont leur
mot à dire, leur parole vaut autant que celle des autres
partenaires. Les parents ont cette chance d'avoir vécu
l'école et d'être essentiels dans l'éducation de leurs
enfants qu'ils connaissent autrement que les enseignants.
Enfin, en matière de pédagogie, il n'y a pas de
professionnels : le meilleur professeur que j'ai eu était un
monsieur qui ne préparait jamais ses cours, venait quand
il avait le temps, ne donnait jamais de devoirs, mais
savait intéresser et ne nous considérait pas comme des
enfants… Pensons donc qu'on a à faire à une
communauté qui doit agir ensemble, et concevoir
ensemble une institution qui sera toujours en devenir
parce que le monde évoluera.
L'École n'a pas à s'ouvrir sur la vie parce qu'elle est la
vie, mais elle doit se trouver dans la Cité et non à sa
périphérie et appliquer le principe renouvelé de la
coéducation en mettant sur le même plan les parents, les
enseignants et les enfants, puis les jeunes...
Le rôle de l'École véritable est la transmission de savoirs
fondamentaux, le développement des capacités
intellectuelles des enfants et des jeunes, l'épanouissement
sur les plans sociaux et personnels des individus : ceci
justifie la revendication d'une institution scolaire en
totale rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à nos jours.
C'est un impératif moral : une école qui ne prépare plus à
une société des profits et des inégalités voulues par telle
idéologie ou par tel système économique, une école qui
aide des individus à se définir et à se former, à devenir
autonomes ; des citoyens qui décideront des orientations
que prendra la société dans laquelle ils vivent, des
248
citoyens qui sauront que la planète doit être autrement
gérée que comme un tas de richesses à exploiter sans
précaution.
D'autres structures devront être prévues qui permettront
l'intégration des adolescents dans la cité puisqu'ils leur
faudra un jour travailler (ce qu'il faut, sans plus),
consommer (ce qu'il faut, sans plus), avoir des loisirs,
mais leur formation devrait leur permettre de ne plus
accepter n'importe quoi comme activité parce que seul le
salaire compte, de ne plus y voir la finalité d'une vie, de
ne plus consommer avec une boulimie insensée et de
remplir leur temps libre d'activités sensées et
enrichissantes (il n'est pas inutile de rappeler que le mot
"école" vient du latin schola issu du grec σχολή, mot qui
désignait l' "arrêt de travail", ou bien un "loisir
consacré à l'étude" !)
*
Si l'utopie d'un projet bien ficelé nous est interdite pour
les raisons avancées plus haut, quelques pistes de
réflexion termineront cet essai.
On parle sans cesse d'égalité en France, peut-être parce
que la parole nous paraît être un substitut suffisant à ce
qu'on n'a pas, mais, pour que tous les enfants aient des
chances équivalentes, quelles que soient leurs origines et
qu'ils accèdent tous au savoir, à la culture (qu'il
conviendrait de redéfinir) et au développement de leurs
potentialités, la première revendication est de ne rien
céder sur des programmes solides qui mettent en avant la
réalisation de l'individu dans ses liens avec le passé, le
présent et le futur. Il ne faut rien céder non plus sur les
niveaux d'exigence et cesser de payer les efforts des
249
enfants avec de la monnaie de singe. Cela signifie des
maîtres nombreux et bien formés, des heures d'études
bien organisées ouvertes aux enfants et aux parents qui
souhaitent accompagner leurs enfants dans leurs
découvertes, car il ne peut y avoir de véritable
refondation de l'école dans une participation active de
ces trois acteurs.
L'école n'a pas à singer les dernières évolutions de la
société, les derniers développements de la science. Son
rôle doit s'en tenir à la transmission des acquis les plus
fondamentaux et d'un patrimoine culturel nécessaire au
lien social et seule base solide à des évolutions
ultérieures. Sans mémoire, une société n'est rien et ne
peut - au mieux - que tourner en rond. Les acquis
nouveaux seront intégrés progressivement, après mûre
réflexion.
Le principe d'égalité, excellent en soi, ne doit cependant
pas devenir un frein, une censure interdisant la
diversification. Il ne faudrait plus contraindre tous les
enfants du même âge à avoir les mêmes activités. Des
jugements comme "Cet élève est en avance" ou "Cet
élève est en retard" sont des non-sens puisqu'on ne peut
être confronté qu'à soi-même dans l'optique d'un
enseignement vraiment centré sur l'enfant ou plutôt
centré sur chaque enfant. Cette diversification signifie
aussi une offre très large d'activités et d'apprentissages,
des filières si l'on veut, qui ne devraient pas entrer en
concurrence en fonction des ouvertures qu'elles
prépareraient. L'adolescent pourrait choisir des filières
encourageant le travail intellectuel pur, d'autres
permettraient davantage l'éclosion d'aptitudes manuelles
ou artistiques. Il faut en finir avec l'obsession des études
rapides, des bacs à 15 ans, du professeur agrégé à 21 ans
250
ou du médecin installé dans son cabinet à 23 ans !
Donner du temps au temps, permettre aux jeunes de
multiplier les parcours. L'école doit cesser d'être un
passage obligé le plus court possible et le professeur n'a
pas à être un sélectionneur au service de qui que ce soit.
De même, l'égalité ne doit pas interdire une gestion
personnalisée du temps, des progressions et des
acquisitions, ce qui revient à dire que le groupe classe, tel
qu'il est conçu doit céder la place à d'autres formes, à des
groupes ouverts, modulables et inégaux dans les effectifs
comme dans les progressions. L'enseignement doit être à
l'aune de l'élève : à la mesure de ce qu'il peut apprendre
et pas inversement. Ce que Montaigne disait il y a près de
quatre siècles quand il écrivait :
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme
quelqu'un qui verserait dans un entonnoir, et notre
charge n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je
voudrais qu'il corrige cette partie, et que, tout de suite,
selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commence à
la mettre sur la montre, en lui faisant goûter les choses,
les choisir et discerner d'elle-même ; quelquefois lui
ouvrant le chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je
ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il
écoute son disciple parler à son tour. Socrate faisait
premièrement parler ses disciples, et puis il leur parlait
à eux.
Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de
son train, et juger jusqu'à quel point il doit se rabaisser
pour s'accommoder à sa force. Par manque de cette
mesure nous gâtons tout, et savoir la choisir, le faire
correctement, est l'une des besognes les plus ardues
que je connaisse. C'est la preuve d'une haute âme et
bien forte, que de savoir condescendre à ces allures
puériles et les guider. Je marche plus sûrement et plus
ferme vers le mont que vers la vallée.
251
Enfin, la question de l'évaluation doit être revue moins
dans le sens de l'acquisition de compétences que dans
celui du développement de capacités susceptibles de
rendre l'individu maître de soi et de son destin dans la
cité.
On parle aujourd'hui beaucoup trop de compétences et
leur évaluation est toujours conçue dans la perspective
ancienne des "programmes" et de la notation
traditionnelles. Il faudrait au moins arriver à ce que le
professeur, l'élève et les parents puissent juger par
d'autres voies, plus "subjectives" de ces acquisitions et
du bon accomplissement des quatre étapes nécessaires :
l'apprentissage, les exercices d'approfondissement et
d'enracinement, les réemplois personnels et les
extrapolations.
À ce propos, et pour entrer dans quelques détails, on a
probablement trop accordé d'importance à l'approche
ludique des apprentissages en oubliant que ce ne peut être
là justement qu'une approche, un hors-d'oeuvre - et
jusqu'à un certain âge - ne remplaçant en rien le travail
personnel, la mémorisation, passages peut-être ingrats
mais obligatoires. De la même façon, le rôle des "aides
pédagogiques" a été surévalué : la place des médias, de
la télévision et de la vidéo, de l'ordinateur… Qu'une
initiation sérieuse à l'utilisation, aux avantages et aux
dangers de ces techniques soit possible tombe sous le
sens, mais qu'une partie du cours de français (parfois non
négligeable) soit consacrée à visionner des films, à "faire
des recherches" sur internet ou à étudier les mille et une
approches publicitaires est du temps perdu, surtout
quand, le film vu, on échange au mieux trois paroles et
on passe à autre chose.
252
Certes, depuis pas mal de temps, je rêve d'une école nue,
d'une école qui se serait débarrassée des colifichets que
l'industrie et les éditeurs, les concepteurs font passer
pour indispensables : le monde autour de soi, voilà ce
qu'il faut. Nul besoin d'électronique, de salles de
projection, d'auditorium, de ce "matériel pédagogique"
dont on nous rebat les oreilles, qui coûte très cher et est
vite obsolète. Trop de technique tue les avantages de la
technique… Une expérience au Vanuatu, dans des classes
surchargées, "dénuées de tout matériel pédagogique"
m'a prouvé que, jusqu'à un certain niveau, on pouvait
travailler avec efficacité sans ces "moyens" : les
apprentissages fondamentaux se font sans sollicitation
extérieure. Et ils se font bien, je puis en témoigner. De
toute façon, en matière d'enseignement, le facteur
humain est essentiel et primordial, tout le reste est
secondaire.
*
Dans notre société éclatée, au nombre de mères seules
croissant, aux familles recomposées, aux enfants
d'origines culturelles diverses, aux enfants connaissant
des situations familiales difficiles, l'École devra en outre
être le garant moins d'une égalité toujours illusoire que
d'une homogénéité toujours menacée : tout faire pour
éviter l'exclusion, la ghettoïsation. L'École, en dépit de
l'intérêt qu'elle devrait porter à chaque enfant, à ses
particularités, à ses rythmes aurait aussi à initier à une
discipline de vie qui rende possible l'écoute,
l'apprentissage, la mise en pratique de ce qui a été appris
et la prise en compte de l'autre. Il faudrait encore une fois
pour cela que la charge n'en incombe pas seulement aux
253
enseignants, sous prétexte qu'ils sont des éducateurs,
mais que la classe intègre en plus de recommandations
institutionnelles fortes l'apport, la collaboration de
dispositifs associatifs, que ce soient des clubs de lecture,
d'animation culturelle et scientifiques, des aides au
travail personnalisées apportées par des étudiants, des
retraités volontaires ou n'importe quel membre de la
société civile par exemple.
On parle également beaucoup d'éducation à la
citoyenneté en France et cela se traduit par des opérations
largement médiatisées : concours d'écriture sur tel thème
"social", visite de lieux de mémoire, lecture de lettres
de jeunes résistants… Tout cela reste abstrait, intellectuel.
En même temps, la seule réponse aux difficultés actuelles
auxquelles sont confrontés les établissements est
l'exigence d'une augmentation des personnels de
surveillance alors qu'il serait logique, dans une
perspective "citoyenne" de développer l'autodiscipline,
de rendre les élèves responsables de la gestion de leur
école et d'eux-mêmes dans une proportion plus ou moins
grande suivant les âges. Ceci signifie également que
l'équipe des agents de service, responsable du bon
fonctionnement technique de l'établissement et de sa
propreté devrait être réduite et qu'un certain nombre des
tâches qui lui incombent soient prises en charge par les
élèves. Voilà des perspectives vraiment éducatives, alors
que le surveillant (spécialité très française !) sera
toujours l'empêcheur de tourner en rond qu'il faut d'une
manière ou une autre tromper, l'établissement établissant
une frontière entre deux populations : les adultes sur
lesquels repose l'ordre et les enfants qui sont privés de
toute responsabilité. Une situation infantilisante alors
qu'on souhaite éduquer ! Et qu'on ne me traite pas
254
d'utopiste : j'ai eu la chance d'assurer la codirection d'un
lycée binational de 800 élèves où la section française
correspondait dans sa structure sociale à un établissement
moyen de France (il ne s'agissait pas d'une section de
"gosses de familles privilégiées"). Nous ne disposions
ni de surveillants, ni de personnel de service, ni
d'infirmière ou d'infirmier, ni de conseillers principaux
d'éducation, ni…. Les deux directeurs, français et
allemand, le concierge, les équipes tournantes de la ville,
quelques professeurs ayant une formation aux premiers
soins ou en psychologie et des élèves responsabilisés
suffisaient à permettre à l'établissement de fonctionner
de façon "parfaite" si tant est que l'on puisse le dire
puisque les finalités étaient tout de même d'être un
établissement d'excellence et de se situer parmi les
meilleurs !
On n'insistera enfin jamais assez sur le fait que
l'enseignement de base doit être bien entendu celui de la
langue française.
Ce doit être l'objectif primordial de l'école primaire ou
du niveau qui lui correspondrait à peu près dans une
école repensée : maîtrise de l'orthographe parce qu'elle
participe de la richesse de la langue et des libertés que
cette dernière offre à celui qui la domine, de la
grammaire (par l'apprentissage des règles), de la
conjugaison des verbes, de l'emploi des temps et des
modes pour les mêmes raisons et parce qu'autrement les
nuances de la pensée s'estompent, disparaissent. Ceci
acquis progressivement, l'élève pourra, tout aussi
progressivement se lancer dans les exercices de rédaction
(sous tous ses types : description, récit…) et développer
en liaison avec la lecture son lexique, autant de garanties
de sa future autonomie.
255
Ce savoir particulièrement négligé aujourd'hui est
essentiel pour la "construction" d'un être indépendant,
capable de penser par soi-même, vraiment citoyen (seules
évaluations dignes de ce nom, car ces acquis ne sont que
des moyens), mais aussi dans la perspective des sciences,
car tout texte scientifique est en fait un genre en soi, un
type de rédaction, et toute réflexion, toute pensée
élaborée se construit en écrivant.
L'accès aux oeuvres littéraires doit se faire tôt : il vient
aider, entretenir et soutenir les apprentissages de la
langue, mais aussi faire découvrir les oeuvres du
patrimoine culturel français et universel. Cette initiation
ne doit pas non plus se faire dans le désordre, mais dans
le cadre solide de l'histoire littéraire, elle-même inscrite
dans celui de l'Histoire, une histoire adaptée d'abord à
leur imaginaire et dont l'enchaînement des faits serait
structurant vis-à-vis d'apprentissages comme la
numération ou la causalité. Qu'on ne s'y trompe pas,
pour de nombreux scientifiques, la littérature et la poésie
est un passage obligé vers la découverte du sens de la
beauté et de l'esthétique, une esthétique de la pensée que
l'on retrouve dans les mathématiques et dans les
sciences.
Ce savoir fondamental de la langue doit être accompagné
de l'apprentissage de celui des nombres et des opérations
sur les nombres et on devrait également familiariser les
jeunes avec les grandeurs concrètes et le repérage dans
l'espace. Les sciences expérimentales viennent apporter
ce cadre nécessaire du concret par le contact qu'elles
apportent avec les objets et en unissant l'observation à la
réflexion logique, l'utilisation pratique des nombres, des
opérations et des figures, le travail de groupe, la réflexion
et l'écriture des expériences.
256
Il serait également nécessaire de redonner à l'enfant le
sens de son environnement au lieu de se perdre dans des
discours abstraits qui dépassent les possibilités de son
entendement et de son expérience en lui faisant connaître
le nom des plantes, des arbres, des animaux, des
formations végétales et géologiques, des phénomènes
naturels courants. Ceci amène à évoquer la géographie,
un savoir nécessaire pour pouvoir se situer dans le monde
et dans son pays, un apprentissage de la lecture de cartes,
des fleuves, des mers et des régions dont ils entendent
parler.
Plus tard ces apprentissages devront se systématiser pour
donner aux enfants des repères solides, chronologiques et
géographiques, politiques et économiques.
L'enseignement des langues devrait être entièrement revu
et après une période d'initiation, des périodes bloquées,
des stages internationaux, des camps de jeunes, des
échanges seraient d'une efficacité sans doute meilleure.
La perspective à développer serait celle d'un bilinguisme,
voire d'un trilinguisme dès le primaire et l'intégration de
matières enseignées totalement ou partiellement en
langue étrangère.
Les langues anciennes devraient au moins donner lieu à
une initiation. Rappelons que Heisenberg affirmait que
sans sa connaissance du grec et de Platon, il n'aurait pas
eu l'idée du principe d'incertitude et n'aurait pas
découvert la physique quantique !
Enfin, les travaux manuels n'ont pas à être traités en
parents pauvres : fabriquer concrètement des objets en
liant l'intelligence conceptrice et la main, les lois de la
physique concrète et le développement des facultés
motrices…
Mais c'est trop entrer là dans des détails sans grand
257
intérêt parce qu'ils ne représentent que l'opinion d'une
seule personne. Encore une fois, c'est l'image même de
l'École qui doit changer, ce sont ses finalités qui
demandent à être repensées, c'est son indépendance qui
doit être assurée.
Ensuite, il sera temps de se remettre à construire.
Tous ensemble.
258
Conclure ?
259
260
Une critique (au sens propre) de l'École n'a rien à voir
avec une dénonciation de ses fondements humanistes ni a
fortiori avec l'affirmation que l'éducation est inutile.
Mais comme l'École a toujours été (et sans doute plus
que jamais) à l'image de la société, soumise à des
"intérêts supérieurs", comme elle n'a jamais agi de
façon souveraine, cette école n'a jamais rempli sa
mission. Elle a servi les privilégiés et aidé à tenter de
pérenniser ces privilèges, jadis ceux d'une société bâtie
sur la prééminence du religieux lié à des intérêts très
séculaires, ensuite ceux d'une société progressivement
puis entièrement livrée au capitalisme et au libéralisme
avec des États qui ne se conçoivent plus eux-mêmes que
comme des courroies de transmission de la sphère
économique dans lesquels les chefs d'État n'hésitent pas,
se glorifient même d'être des VRP multicartes qui
"vendent" de l'avion, du train, de la centrale nucléaire,
des armes ("Ce sera tout, ma petite dame ?"). Une
critique de l'École vise donc à distinguer le bon grain (les
éléments divers d'une véritable éducation) de l'ivraie (les
procédés d'aliénation qui ne profitent qu'au(x) système(s)
économique ou/et idéologiques).
L'École véritable serait un lieu de vie libre et ouvert dans
lequel interagissent élèves et enseignants, parents et
intervenants issus de la société civile. Un lieu où l'on
focalise particulièrement sur la socialisation des jeunes
gens, mais une socialisation qui se ferait au bénéfice des
individus, qui ne gommerait ni les personnalités ni les
différences et ne les enfermerait pas dans des modèles
communs. Socialiser ne signifie ni cloner comme on veut
trop le faire croire ni établir (ou répéter) des hiérarchies.
Préparer à la vie future professionnelle certes, mais
261
d'abord citoyenne et humaine, sans enfermer dans
d'étroites spécialisations, dans des clichés réducteurs,
dans des choix illusoires. (Ce qui explique d'ailleurs le
rejet par une majorité de nos concitoyens de tout discours
sur l'intégration ou l'identité nationale, car personne ne
veut plus du prêt-à-porter franchouillard, de Clovis, de
Jeanne d'Arc, de la baguette, du béret et de l'Angélus de
Millet !)
L'École doit rendre possible un regard intéressé et
critique sur les plus importants domaines du savoir et du
travail, sur les phénomènes de la consommation, sur
l'écologie, sur la société, certes, mais elle devrait surtout
développer certaines attitudes et valeurs : la discipline
personnelle, la volonté d'être soi tout autant que
l'ouverture à l'autre, le respect de l'autre et de son
"quant-à-soi". Elle doit renouer avec l'ambition de
l'éducation dans la Grèce antique (alors réservée à
quelques-uns) en la généralisant à tous et en prenant la
mesure de l' "horloge intellectuelle ou biologique"
propre à chacun (certains sont aptes à tel ou tel
enseignement à tel âge, d'autres plus tard ; l'essentiel est
le résultat obtenu, pas le moment), cette ambition
hellénique qui voulait que l'homme en devenir, le jeune
être, bénéficie d'une éducation qui assurerait à la fois son
épanouissement, et développerait son potentiel tout en
l'émancipant pour devenir un citoyen responsable et un
membre de la cité.
Or si l'institution scolaire a toujours prétendu aller dans
cette direction, au cours des 2500 ans pendant lesquels
l'existence d'écoles est à peu près attestée, on a toujours
fait autre chose.
Dans l'Angleterre de la révolution industrielle, l'accès à
l'école se généralise. Celle-ci fournit un savoir à l'ouvrier
262
qui lui permettra d'exercer une activité professionnelle et
d'échapper à la misère, mais elle devient en même temps
le champ clos du recrutement, le foirail, pour les
capitaines d'industrie - modernes maquignons - en mal de
capital humain. On passe vite, presque simultanément,
d'une institution civile (voire civique dans ses
fondements) à une instance économique, à un
département de l'économie dédié à la formation de jeunes
travailleurs dans le sens des intérêts capitalistes. La
gentry continuant pour sa part à fréquenter ses propres
institutions, bien entendu.
Nous avons vu qu'en France les revendications de la
bourgeoisie, monarchiste, révolutionnaire et post
révolutionnaire, républicaine ou libérale, ne signifiaient
rien d'autre que la volonté d'établir un précapitalisme
rompant avec les habitudes de l'ancien régime pour
défendre leurs intérêts de classe montante. La propriété
est au coeur des Droits de l'Homme, la liberté
économique est inscrite au verso du triptyque Liberté,
Fraternité, Égalité, qui impliquait un marché libre et une
certaine indépendance des tenants du nouvel ordre vis-àvis
des puissances civiles. Il est amusant de noter que
lorsque, peu avant la Révolution, La Chalotais se bat
contre l'absolutisme royal, il le fait au nom des libertés
bretonnes. Officiellement. Et cela lui permet
d'instrumentaliser les foules. Pourtant, ce qu'il appelle
"libertés bretonnes", ce n'est rien d'autre qu'un
ensemble de privilèges féodaux et de droits économiques
qui ne concernent que quelques-uns, de droits nouveaux
qui ne regardent que la grande bourgeoisie à laquelle il
appartient, alliée à la plus vieille aristocratie. C'est ce
même La Chalotais qui, le 24 mars 1763, rendait public
un mémoire intitulé : Essai d'éducation nationale et Plan
263
d'études pour la jeunesse, admiré de Diderot ou Voltaire
et des principaux philosophes. La Chalotais proposait des
changements radicaux d' "une éducation qui n'était
propre, tout au plus, qu'à former des sujets pour l'école".
Il réclamait alors "une éducation civile qui prépare
chaque génération naissante à remplir avec succès les
différentes professions de l'État". Pour cela, il souhaitait
qu'on en finisse avec une éducation basée sur la vieille
scolastique et enseignée par le clergé. Au lieu du latin et
des prêtres, le pays a besoin de sciences et d'hommes
formés aux instruments du progrès. Le seul but louable de
l'éducation est le bien public (et l'on sait ce que cela veut
dire). En ce qui concerne la petite enfance, il reprenait à
son compte les principes de Rousseau, quelques idées de
Pestalozzi sans doute, puis développait surtout un
programme - intéressant en soi - mais destiné aux
collèges et au public qui les fréquentait, c'est-à-dire la
bourgeoisie montante et l'aristocratie qui n'hésitait pas à
déroger. Ce défenseur des libertés préparait l'aliénation
des masses salariées au XIXe siècle, au nom du progrès et
du bien public ! Son plan est le prototype de tous les
discours sur l'école qu'on entendra en France jusqu'à nos
jours !
Plus tard, en effet le droit à l'école ne dérangera certes
pas le bourgeois même ultra, même conservateur : sans
éducation, pas de travail, pas de travailleur moins de
profits. Il ira même jusqu'à accepter d'envisager la
gratuité puis à y souscrire, car cette dépense interdit au
moins d'y couper et assure la réalité des contingents de
travailleurs pas totalement illettrés dont ON a besoin ! Et
puis, la générosité n'aura plus de limites : obligation
scolaire jusqu'à 13 ans puis 14 ans puis 16 ans…
La France n'est pas une exception !
264
En Allemagne, l'école obligatoire vient assez
tardivement. Ce n'est qu'en 1870 que la Prusse l'introduit
alors que le pays s'industrialise et poursuit une politique
impérialiste. Son exemple sera rapidement suivi par la
plupart des états des pays allemands. Les écoles
publiques sont alors conçues pour dispenser un savoir et
une éducation allant d'abord dans le sens d'une Prusse
militarisée. Tous les enfants de 6 à 14 bénéficiaient donc
d'une scolarité gratuite, mais une éducation calquée sur
les principes éducatifs militaires : un sévère entraînement
physique et une obéissance absolue venaient encadrer les
matières traditionnelles : lire, compter, apprendre par
coeur et réciter des passages de la Bible. Ces écoles
étaient aussi, bien entendu, le lieu de recrutement des
futurs soldats, particulièrement dans les milieux
défavorisés puisque les enfants des classes supérieures
poursuivaient leurs études au lycée. Enfin, ces écoles
devaient permettre de couvrir les besoins de l'industrie en
personnel plus ou moins qualifié. Après l'intermède de la
République de Weimar, qui inscrit l'obligation scolaire
dans sa constitution, le IIIe Reich poursuit la tradition
prussienne avec l'école comme lieu d'apprentissage de la
discipline, de respect de l'autorité, de l'obéissance
absolue et de la fidélité à l'idéologie nazie en liaison avec
les organisations de jeunesse, la Jeunesse Hitlérienne et
l'Association des Jeunes Filles Allemandes.
L'école nazie est le lieu privilégié de la formation de
futurs combattants fanatisés non seulement par les
exigences qu'elle pose mais aussi par un endoctrinement
auquel participent directement les cours de raciologie ou
les exercices sportifs paramilitaires (chorales, théâtre,
lancer de grenades, simulation d'affrontements armés...).
Inutile d'évoquer l'école dans les deux Allemagne, après
265
1949, pas plus que l'école en URSS ou dans les pays de
ce qu'on appelait le bloc de l'Est qui ont certes rompu
avec l'implantation idéologique capitaliste des
établissements scolaires mais l'on remplacé par leur
dogmatisme puis par les principes d'un capitalisme d'état
qui n'avait rien à envier au capitalisme pur et simple…
Pas d'exceptions donc : partout, les États sont peu enclins
à dépenser des milliards pour simplement donner à leurs
citoyens les moyens d'acquérir un savoir qui en ferait des
individus libres, indépendants et critiques. Le savoir est
une puissance, certes, mais ce qui contrôle la façon dont
il est dispensé est encore plus puissant ! L'École est
dégradée au niveau de simple outil de politiques
économiques et militaristes. Elle est totalement
instrumentalisée.
Pour en revenir au cas français, il est troublant de voir
que face à l'école, les positions sont quasiment les mêmes
que l'on soit à droite ou à gauche. Seul le discours et la
manière de présenter les choses changent. L'institution
scolaire n'est pas là pour autre chose que pour préparer le
futur adulte à entrer dans une société constituée, à en
devenir un rouage. Jamais il n'est, comme on ne rougit
pas de l'affirmer avec cynisme, au "centre" des
préoccupations. On veut bien "tourner autour du pot" en
multipliant les réformes, en "innovant sur le plan
pédagogique", en enseignant la didactique, en modifiant
la carte scolaire, les horaires, en multipliant les
"matières" et leur saupoudrage, en ergotant sur les
"matières d'éveil", en "développant" le secteur
parascolaire, en proclamant partout que les établissements
sont des "lieux de vies" où la cantine s'appelle
266
désormais le restaurant et la bibliothèque la
médiathèque : l'École relookée en apparence, avec un
bon coup de badigeon, c'est jeune, c'est cool, moderne en
un mot ! Les réformes que propose actuellement Vincent
Peillon iraient sans doute sur un point dans le bon sens
(redéfinir les rythmes scolaires) mais pour le reste, il est
dans la droite ligne de ses prédécesseurs et n'a aucun
projet digne d'étonner. On plâtre et on replâtre. Avec
timidité (la première vertu sociale démocrate) et les
enseignants font comme s'ils avaient peur de perdre des
avantages inexistants, les parents comme s'ils avaient
encore confiance dans cette École, la société civile
comme si elle devait se gargariser d'un excellent
baccalauréat cuvée 2012, malgré les milliers de jeunes
qui n'auront rien obtenu de leur scolarité. On peut
s'amuser à parcourir le fameux site à l'ambitieux intitulé :
www.refondonslecole.fr. Comme si M. Hollande, comme
si un clône du système que nous dénonçons pouvait
jamais avoir la force ou le désir de refonder quoi que ce
soit! Cynisme? Inconscience? Non! simplement,
incapacité à penser autrement qu'en rond, frileusement, à
donner une fois de plus le change en ces temps de
gesticulation et de verbe creux, de faussaires et
d'imposteurs.
Pendant ce temps, mine de rien, les écoles privées
continuent à prospérer.
Les hommes politiques, de quelque tendance qu'ils aient
été, au moins à partir de la IIIe République ayant su
habilement faire de l'École le flambeau de la République
et de la Démocratie, le lieu où concentrer toutes la
démagogie possible, une critique radicale de l'école telle
que l'ont pratiquée les milieux anarchistes est restée très
discrète en France même si les principaux représentants
267
de cette critique n'ont manqué ni de public ni de soutiens.
Une des figures des plus connues internationalement de
ce mouvement est celle de Pierre Kropotkine (1842-1921)
collaborateur à la Géographie Universelle d'Élisée
Reclus. Après des années d'incarcération en Russie et un
séjour en Grande-Bretagne, il s'installe en Suisse, y
milite, écrit, publie et fonde en 1879 le journal Le
Révolté. Arrêté en France en 1883 par la toute récente IIIe
République, à la suite des grèves des soieries lyonnaises,
il est emprisonné à Lyon mais amnistié en 1886. De
retour en Angleterre, il publie des ouvrages de géographie
et de politique. L'Entraide, un facteur d'évolution lui vaut
le respect de la communauté scientifique. Contre l'école
conçue comme l'instrument du capitalisme, il suggère
l'établissement d'une anti-pédagogie qui aurait pour but
de détacher l'école de son ancrage capitaliste et de fournir
une éducation libre de toute téléologie, seulement axée
sur les besoins (individuels et sociaux) de l'enfant. Il a eu
connaissance des tentatives et de la réflexion de Tolstoï
dont l'école Jasnaja Poljana a essayé un nouveau type
d'enseignement prenant en compte la personnalité de
chaque enfant et refusant de devenir une propédeutique à
la vie active dans la Russie impériale (1852-1862).
Francisco Ferrer aura en France une audience importante
avec son École Nouvelle et sa Ligue internationale pour
l'éducation rationnelle de l'Enfance : "(…) des écoles
(…) où seront appliqués directement les principes
répondant à l'idéal que se font de la société et des
Hommes, ceux qui réprouvent les conventions, les
préjugés, les cruautés, les fourberies et les mensonges sur
lesquels est basée la société moderne.".
Dans les années 20, le mouvement anarchiste sera très
actif et produira des études critiques de l'école (le FAUD,
268
le SAJD…). Avant que ne se referme la main de fer du
IIIe Reich, Walter Borgius avec son livre L'école, un
affront à la jeunesse jouira également d'une certaine
écoute : "L'école est pour l'État un moyen d'aliénation
particulièrement habile, créé pour habituer tous les
citoyens à l'obéissance depuis leur petite enfance, leur
faire croire dur comme fer que l'État est absolument
nécessaire."
Aux États-Unis, dans les années 60, le Free-School-
Movement partira aussi d'une critique radicale d'une
école "au service de…" pour créer par exemple la First
Street School à New York dans laquelle des essais de
pédagogie libertaire seront pratiqués. Des auteurs comme
John Holt, A. S. Neill, Paul Goodman, and George
Dennison seront particulièrement lus.
Les critiques de Bourdieu et Passeron, leur analyse de la
reproduction par l'école des inégalités sociales et des
inégalités devant la culture auront aussi un important
écho, mais comme toujours, le système peut se permettre
le luxe de ces voix discordantes. La démocratie
proclamée admet (dans une certaine mesure) la liberté
d'opinion tant qu'elle reste sans conséquences pratiques,
tant qu'elle demeure objet de discussions entre
intellectuels ou soupape de sécurité pour évacuer les
attaques trop menaçantes…
*
Une école digne de ce nom doit avoir pour but
l'épanouissement intégral de l'homme. Jean-Claude
Milner avait parfaitement défini sa vocation : un
"processus par lequel un sujet est censé s'accomplir
entièrement". Corrigeons tout de même :
269
l'accomplissement entier et définitif est par définition
impossible puisque c'est un processus qui se déroule sur
la vie et qui dépasse le cadre de l'école. Disons plutôt
qu'elle met en place les bases, les outils qui permettront à
l'enfant de s'accomplir au cours de sa vie.
Elle doit certes viser à l'intégrer dans une société, mais
sans que cette intégration signifie aliénation. C'est-à-dire
qu'elle ne doit pas viser à en faire ni un individu
anonyme perdu dans la masse, ni l'outil d'un système
économique ou idéologique réglementant cette société.
Cela n'est possible que si, au premier plan, elle permet à
l'enfant de développer ses potentialités physiques et
intellectuelles, mais sans non plus l'enfermer dans une
spécialisation prématurée. Ce n'est qu'alors qu'elle lui
fournit les moyens d'intégrer, tout en conservant une
distance critique, la société dans laquelle il vit.
Elle doit éduquer et instruire. Éduquer, c'est-à-dire
amener l'enfant à partager un certain nombre de valeurs
universelles, de valeurs susceptibles d'être partagées par
tout être raisonnable, ces valeurs que les Droits de
l'homme représentent assez bien et que l'école publique,
s'adressant à tous, doit défendre, car elles nous
concernent tous et pas seulement une partie de la
population. Instruire parce que l'Homme est un être social
et qu'il est fait pour vivre avec d'autres pour profiter des
savoirs et des savoir-faire existant et faire profiter les
autres de ce que lui-même pourra le cas échéant apporter,
la pierre qu'il ajoutera à l'édifice.
*
L'histoire de l'école dans ses "révolutions" montre au
moins qu'elle n'a jamais été indépendante mais toujours
270
l'objet de convoitise de la part des pouvoirs parce que
l'on voit en elle le moyen de former les hommes tels
qu'on les souhaite. Elle est donc toujours et d'abord un
instrument d'aliénation au service de puissances qui la
dépassent. Si ces puissances sont des "dictatures"
fondées sur une idéologie (URSS, IIIe Reich, Chine
communiste maoïste, Cambodge "démocratique"), ou
une religion (Pays européens à peu près jusqu'au XVIIe
siècle, pays musulmans puis islamistes …), l'école est le
lieu même de la formation des membres de la fourmilière.
La réification à laquelle elle concourt est totale. Si ces
puissances se teignent d'une nuance de démocratie et
remplacent le totalitarisme idéologique par un
totalitarisme économique, elles génèrent une école Janus :
les paroles, le discours se veut humaniste, la réalité est
plus pragmatique, on se contente d'ajuster par l'école le
flux des générations aux besoins du système économique
ambiant. Enfin, lorsque le libéralisme triomphant,
l'économie mondialisée, celle que Noémie Klein
décrivait dans son livre The shock doctrine, domine tout,
l'école devient un produit comme un autre.
On en arrive donc à penser que l'école n'a jamais pu et ne
pourra jamais être libre, ne pourra jamais se consacrer à
l'éducation des jeunes générations sans tenir compte de
systèmes qui la dépassent.
Pourtant, les démocraties et leurs théoriciens ont bien su
développer une théorie de la séparation des pouvoirs,
seule garante de l'existence possible de cette forme de vie
en commun : séparer l'exécutif du législatif et de la
justice. Aujourd'hui, personne, dans nos pays dits
démocratiques n'envisage en effet une justice qui serait
aux mains des deux autres pouvoirs comme cela a été le
cas dans les périodes noires de dictature. On en est même
271
à définir et exiger l'absolue indépendance de ce
quatrième pouvoir que sont les médias. Or, personne n'a
jamais songé à inscrire dans le marbre des constitutions la
liberté totale et absolue de l'École !
C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer…
*
Nous avons débuté dans cet essai par une visite de la
caverne platonicienne. Retournons-y pour le terminer.
Nous sommes enchaînés dans cette caverne, esclaves de
nous-mêmes et de notre éducation. La lumière est au
dehors, nous dit-on, mais il faut du courage et beaucoup
de foi pour la rejoindre, supporter la souffrance et la peur
pour affronter une vérité à laquelle on a du mal à croire.
Nous devrions parcourir le sentier, qui est celui de la
philosophie, pour espérer entrevoir cette lumière, nous
répète-t-on.
Nous pouvons bien sûr suivre ce philosophe "illuminé",
croire en ces paradis qu'il promet, mais on peut aussi
renoncer à le suivre, ce philosophe bavard qui prêche les
avantages d'un ailleurs. Hic et nunc peut être notre
devise ! Restons dans la caverne puisque c'est après tout
notre séjour habituel, mais débarrassons-nous de nos
chaînes en faisant table rase de tout ce qui nous attache à
notre banc, et une part de ces liens a été tissée par l'école.
Un autre philosophe nous a parlé de cette table rase,
Descartes, dans son Discours de la méthode que chaque
Français (ne nous targuons-nous pas d'être cartésiens
quasiment par nature ?) pense avoir lu !
"Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée",
nous dit Descartes qui avait décidé, contrairement à la
272
plupart des savants de son temps, d'écrire son ouvrage en
français : chacun devant pouvoir comprendre son
discours et en tirer profit. Il exposait alors par le
truchement de la narration de sa vie, qui avait valeur
d'apologue, la gestation d'une méthode dont lui-même
avait profité, tout en refusant de se croire infaillible. Déçu
par l'enseignement scolastique qu'il avait reçu (lui aussi
ou lui déjà), et après en avoir rejeté en bloc les fleurons :
éloquence, poésie, mathématiques, morale, théologie et
philosophie (ouf !) pour atteindre le vrai, Descartes s'était
résolu à "ne chercher plus d'autre science que celle qui
se pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grand
livre du monde" et "à ne rien croire trop fermement", à
s'efforcer "toujours de pencher du côté de la défiance,
plutôt que vers celui de la présomption".
Il semble que nous ayons oublié ses leçons d'un
philosophe qui ne cherchait ni à nous tromper ni à nous
montrer un univers éthéré, un au-delà enchanteur. Restons
dans notre caverne dit-il, tirons en toutes les ressources
possibles, mais prenons notre destin en mains et chaque
fois remettons sur le métier l'ouvrage car rien n'est
jamais sûr, évident définitif sinon cette certitude que nous
sommes capables de faire par nous-mêmes, de penser
donc d'être !
Voilà résumée la meilleure pédagogie et la meilleure
définition de l'École, telle qu'elle devrait être, libre de
tous les a priori, patrie des jugements purs avec ces quatre
règles qui sont autant de viatiques :
1. "Ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je
ne la connusse effectivement pour telle ; c'est-à-dire
d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention"
2. "Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en
273
autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis
pour les résoudre."
3. "Conduire par ordre mes pensées, en commençant par
les objets les plus simples (...) pour monter peu à peu (...)
jusqu'à la connaissance des plus composés, en supposant
même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point
naturellement les uns les autres"
4. "De faire partout des dénombrements si entiers, et des
revues si générales, que je fusse assuré de ne rien
omettre".
Le résultat de cette réflexion est premièrement qu'on peut
croire en l'existence de SON esprit et en SA raison,
deuxièmement qu'on ne conduit pas SA raison n'importe
comment ni suivant n'importe quelle recette apprise de
tel ou tel "maître" mais que chacun doit inventer,
imaginer sa méthode, celle qu'il propose n'étant qu'une
méthode possible, celle qui lui convient à lui, René
Descartes.
Existe-t-il une meilleure pédagogie ?
Prenons donc notre destin en main et commençons par
l'École. Faisons enfin coïncider, nous les cartésiens,
notre réputation avec la vérité.
274
Préface.
Refuser l'école ! Une aberration, un scandale pour la
plupart de nos concitoyens, nourris de l'idée reçue que
cette école, républicaine, est l'indispensable, l'inaliénable
garant de notre démocratie. On confond à plaisir, jusqu'à
en faire des synonymes l'école et l'éducation. On
encense une institution nécessairement dépendante d'un
milieu, d'une époque, d'une idéologie en l'assimilant à
une aspiration profondément humaine. On mélange de
même école et instruction, l'homme instruit étant celui
qui possède le savoir que l'on est censé acquérir au terme
du cursus scolaire fourni par une institution forcément
"au service de…". Suivant les époques : ânonner un peu
de latin, pénétrer les arcanes de la lectio et de la
disputatio, trousser une prosopopée à la manière de…ou
pondre une dissertation en trois parties, connaître des
bribes de l'étroit Parnasse des Classiques dûment
estampillé par l'ordre national, disposer de quelques
repères historiques périodiquement revus, régulièrement
falsifiés, posséder les bases de l'arithmétique voire de la
géométrie ou jongler avec l'étude des fonctions et des
ensembles, s'ouvrir aux technologies nouvelles, être
capable de déchiffrer une notice, de "programmer", de
lire un journal, de découvrir la rouerie des publicitaires…
En revanche, "refuser l'école" fait immanquablement
penser à cette parole de Wolfgang Borchert : "
Imaginons : c'est la guerre et personne n'y va…". En
7
effet, la guerre, la défense de la patrie, la haine de
l' "ennemi" font aussi partie de ces idées reçues. Lors
des mobilisations, ils sont rares ceux qui refusent, les
insoumis, et d'autant plus rares que la sanction est fatale.
L'attitude est quasiment la même que face à l'école : il
faut bien y aller, sinon ce serait la catastrophe ! Et on ne
veut pas faire l'effort de comprendre que la catastrophe,
c'est justement d' "y aller" ! Récemment, une amie un
peu dépressive me disait : "la société, c'est comme le
vélo. Quand on est dessus, faut bien pédaler, sinon on
tombe !". Peut-être que le cul par terre, à regarder filer le
peloton, on ne serait pas plus mal, ai-je pensé ! Il est des
"chutes", des ruptures, des changements d'orientation
salutaires…
Les mêmes remarques pourraient d'ailleurs être faites à
propos de la police ou de la prison. Ces institutions sont
fondamentalement semblables à ce qu'elles étaient au
cours des siècles. On a pu émettre l'opinion que la prison
représentait un progrès en ce sens qu'aux origines, le
délinquant ou l'ennemi capturé était purement et
simplement tué, puis qu'on substitua à ce châtiment
l'esclavage ou le bagne et qu'enfin l'emprisonnement
donne la possibilité à plus ou moins longue échéance
d'une deuxième chance, mais il est des constantes qui
sont tout de même troublantes : jadis, on oubliait
l'indésirable dans un cul de basse fosse et aujourd'hui il
disparaît dans une cellule d'un quartier de haute sécurité !
S'il y a eu progrès - un temps, peut-être - ce progrès
s'est bien vite figé comme une sauce froide !
*
Il est primordial d'établir une stricte différence entre
l'"Éducation", qui est une légitime aspiration de chacun
et l'"École" qui est une institution supposée faire entrer
8
dans les faits cette aspiration revue et corrigée par le
milieu et l'époque. En effet, si la première est éternelle au
royaume des idées et des désirs, la seconde, elle, est
lourde, attachée à la terre, tellement complexe qu'elle ne
peut guère évoluer, chargée du poids des ans, des
traditions, des clichés et des fausses raisons, inféodée,
aliénée à tel ou tel système idéologique et économique,
bonne si la société qui la génère est - si tant est que cela
soit possible - bonne, négative pour l'Individu plus
généralement. Elle a le poids et la souplesse du béton
quand l'aspiration à l'éducation possède la légèreté de la
plume ou, pour s'appuyer sur une fable, la véritable
éducation est ce jonc souple et indestructible tourné vers
le ciel tandis que l'institution scolaire est davantage ce
chêne en apparence vénérable et impressionnant mais
enraciné dans un sol qui mériterait des amendements. On
sait ce qu'il arrive par temps de tempête !
Il y a de cela plus de trente ans, Margaret Mead voyait
trois modèles éducationnels possibles et son analyse
paraît toujours aussi juste :
- l'éducation post figurative
- l'éducation cofigurative
- l'éducation pré figurative
Dans le premier cas, il s'agit globalement de reproduire
ce qui existait avant. La jeunesse est appelée à refaire la
geste de ses pères. La position des Anciens, pour
reprendre une image littéraire. Une école
"endogamique" en quelque sorte devant assurer le
renouvellement des "cadres", mais un renouvellement
quasiment à l'identique de la société existante, avec -
concession démocratique - quelques ouvertures
apparentes, fausses fenêtres pour la symétrie,
9
Dans le second cas, on cherche à faire coïncider cette
éducation avec les réalités du moment. Une sorte de no
man's land éducatif, d'entre-deux essentiellement
utilitaire. L'école est toujours le pilier des sociétés, mais
au service exclusif des systèmes économiques,
technologiques et idéologiques, façonnant les esclaves
dont ils ont besoin. L'école fonctionnant selon les critères
que son environnement lui impose plus ou moins
ouvertement.
Enfin, il existe une dernière voie qui conduirait à préparer
l'enfant à un monde nouveau, qu'il aura lui-même à
définir. Cette école rêvant d'un vrai renouveau, qui
s'esquisse dès la Renaissance, se précise avec le Droit à
l'école pour tous réclamé par exemple par Pestalozzi et
la revendication d'une école formatrice de l'individu en
soi, la poursuite de lendemains qui chanteront, quand
l'homme sera réconcilié avec lui-même.
Il est évident que cette troisième forme - la seule digne
de l'Homme - est aussi la moins pratiquée, la plus
exigeante, la plus réprouvée en raison de ses dangers
apparents. Si l'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas où
l'on va. Cette dernière voie, susceptible de répondre au
vrai désir d'éducation, est malheureusement le parent
pauvre qu'on ressort de temps en temps du placard aux
idées pour calmer les inquiétudes en donnant un
badigeon altruiste aux deux autres voies qui, elles, se
conjuguent parfaitement.
*
Cet essai est écrit contre l'École telle qu'elle est par
rapport à ce qu'elle devrait être : un instrument de
transmission de savoirs et de compétences sélectionnés
par l'idéologie et/ou le système économique ambiant et
10
un instrument de préparation, d'anticipation aux
développements envisagés par ce système, alors que sa
vocation est d'être plus que jamais un contre-pouvoir au
service de l'homme dans un monde où il n'a jamais été
aussi réifié.
*
Il ne faudra pas, dans ces quelques pages, chercher les
solutions-miracles à une situation aussi complexe que la
place de l'institution scolaire dans la société moderne.
Les réflexions qui suivent sont seulement l'expression
des sentiments d'un enseignant qui pense qu'enseigner
pourrait vouloir dire autre chose que ce à quoi le réduit la
grande machine de l'Éducation Nationale. Il ne s'agit pas
d'une étude en bonne et due forme, mais de libres propos
reposant sur quarante années d'enseignement, une longue
expérience à travers le privé et le public, les écoles
primaires, les collèges, les lycées, les IUT, les
Universités, les IUFM…. On pourra en regretter les
approximations, voire probablement certaines
inexactitudes, l'absence de vision originale, l'étroitesse
des points de vue… Il n'en reste pas moins qu'on a là un
témoignage et que dans une démocratie tous les
témoignages devraient avoir leur importance.
Cet essai n'est donc- son titre et l'allusion à la chanson
bien connue sont un indice - en réalité pas dirigé contre
l'École dans son essence ni même totalement contre cette
école réifiante que nous connaissons et supportons tous,
dont la nécessité peut paraître une fatalité à la majorité
dans un monde où l'égalité des chances est loin d'être un
fait. Il n'est pas non plus écrit contre une École qui, pour
une part seulement, préparerait à acquérir des
compétences professionnelles et à intégrer ensuite le
11
monde du travail. Chacun sait que ventre affamé n'a
point d'oreilles et qu'avant de parler de démocratie, de
liberté, d'éducation, de culture, il faut donner aux
personnes la possibilité de vivre honnêtement et
correctement. Même dans une société imparfaite. On
verra ensuite (à condition de ne pas oublier ni de faire
passer une situation d'urgence pour une vénérable
tradition !)…
En revanche, il est dirigé contre les mensonges et la
sclérose d'une institution qui, dans nos pays prétendus
développés, ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas se
réformer et tourne en rond, car entre les formes qu'elle
avait au milieu du XIXe siècle voire plus tôt encore et
celles qu'elle emprunte aujourd'hui, il n'y a pas,
globalement, de grandes différences alors que les
exigences imposées à l'individu ont changé, que la
société des pays industriels s'est, en apparence au moins,
totalement transformée, que les aspirations individuelles
sont paradoxalement de plus en plus fortes alors que
l'aliénation (les idéologies, les modes, la langue de bois,
le consumérisme, la télécommunication…) des individus
n'a jamais été aussi terrible.
Il doit certes exister une école de l'urgence, comme il
existe des médecins aux pieds nus, mais il ne peut s'agir
en tout état de cause que d'un état passager, transitoire.
Vers 1850, lorsque la malnutrition, l'absence d'hygiène,
les accidents du travail, le chômage, des salaires de
misère, le travail des enfants décimaient les populations,
il était urgent de donner à ce prolétariat, qui était déjà un
précariat, l'instruction qui lui serait nécessaire pour
s'adapter à la nouvelle réalité sociale qui naissait, à
l'industrie et au capitalisme triomphants, pour avoir au
moins "la tête hors de l'eau" voire pour résister à ce
12
nouveau monde voulu par les nantis et les sectateurs
aveugles du progrès technologique. Il était obligatoire,
existentiel que ces hommes et ces femmes qui avaient
quitté leurs campagnes puissent prendre pied dans un
univers où il fallait bien savoir lire et écrire, compter
pour survivre, accéder plus facilement à un emploi seul
garantie du pain quotidien ou prétendre à l'aléatoire
qualité de citoyen. La situation était celle que l'on
rencontre toujours sur les trois quarts de la planète, qu'on
parle de tiers-monde ou de pays en voie de
développement : l'école comme moyen d'adaptation à
une réalité nouvelle avec pour retombée éventuelle un
savoir qui idéalement servirait à échapper à l'aliénation
que le diptyque travail/consommation propulse avec elle.
Mais cela ne veut pas dire que cette école se ferme
définitivement à des ambitions plus hautes. Si elle doit se
mettre un temps au service des nécessités premières, si
elle assure les démarrages, elle ne doit pas oublier que sa
mission est de former des hommes au sens noble de
l'expression, c'est-à-dire d'aider à la naissance d'un
individu libre de toutes chaînes, capable d'assumer
pleinement sa liberté au sein d'une humanité pacifiée et
pacifique.
Or, malheureusement, l'école d'aujourd'hui est restée
prisonnière du passé, elle se considère encore et, hélas !
De plus en plus comme la pourvoyeuse en hommes du
système économique ambiant, que l'on parle de
communisme, de capitalisme ou de libéralisme. Les seuls
changements, si l'on peut utiliser ce terme, consistent
dans un ajustement erratique aux réalités économiques
ambiantes!
Il est tout de même remarquable de voir que depuis le
XVIe siècle au moins (une recherche sérieuse montrerait
13
certainement qu'il faut aller bien au-delà), les plus grands
esprits partagent le même sentiment : l'éducation doit
servir avant tout l'individu, le révéler à lui-même, lui
indiquer les voies de sa propre réalisation. Ce n'est
qu'ensuite, lorsqu'il est entièrement libre, que cet
individu peut s'adonner raisonnablement à l'édification
d'une société harmonieuse, respectueuse de chacun et de
tous, des hommes comme de la nature. Et pourtant,
malgré ces déclarations d'intention, la réalité impose tout
autre chose.
En France, on étudie les principes éducatifs de Rabelais,
on les revoit sous la plume de Montaigne ou celle de
certains maîtres de Port-Royal, on étudie L'Émile… et
puis on oublie ces trop belles idées, pressés par l'urgence
des réalités.
Croit-on !
Walter Borgius, Célestin Freinet, Margaret Mead, Ivan
Illich s'inscrivent en fait dans la droite ligne de ces
grands ancêtres, mais on leur accorde peu d'importance
même si, çà et là, des expériences sont menées…
On lit avec plaisir les colères d'Alphonse Daudet contre
l'école, celles de Jules Vallès, de Nizan…, mais on n'en
tire aucune leçon.
Comment cela peut-il être possible ? Quelle perversion
fait qu'à l'école justement, on demande à l'élève de rire
de Thubal Holopherne et d'écouter avec attention et
respect les conseils de Montaigne sur l'éducation, alors
que dans l'école même on n'a que faire de ces exigences
et que les Ponocrates sont forcément rares ?
C'est d'abord cette hypocrisie que les pages qui suivent
tentent de documenter.
14
Les cahiers au feu? Non ! bien sûr, mais recentrer
l'institution scolaire, lui redonner une âme, le sens des
vraies valeurs qui transcendent les paradis éphémères,
clinquants de la consommation et prennent enfin en
compte l'individu à la fois dans son unicité et dans son
rapport aux autres, qui accordent aux hommes et à
l'environnement le respect auquel ils ont droit, c'est tout
le propos de ce livre.
Fanch Babel
15
Introduction
À tout esprit qui partage des idées libertaires et qui fait de
l'autonomie de l'individu, de son épanouissement
personnel le bien suprême, l'école apparaît comme une
relique de la société bourgeoise autoritaire qui s'est
définitivement établie dans les pays occidentaux au XIXe
siècle. Au même titre que toutes les institutions mises
alors en place sous le masque de la démocratie (qui ne
sont d'ailleurs le plus souvent que la démarque trafiquée,
voire "perfectionnée" de ce qu'elles étaient au stade
historique précédent) par cette société qui prend le relais
des régimes aristocratico monarchistes eux-mêmes
aboutissement des régimes féodaux, l'école frappe par
son aspect obsolète. Un esprit raisonnable et objectif
dirait qu'elle n'est pas la seule dans ce cas et que toutes
les autres institutions sont du "même tonneau" : la
prison, la police, l'armée, la justice… C'est justement ce
qui rend important une réflexion de fond vers cette
"vache sacrée" qu'est l'école, car refuser les raisons qui
servent à la justifier ne va beaucoup plus loin que la
critique d'une institution particulière : c'est la remise en
cause globale d'une société, d'une forme de vie, d'une
culture, d'un mode d'être au monde qui est en
perspective.
Cette école, qui, dans son excellence présumée, n'est
cependant qu'un discours, un tissu de mots, cette école,
16
objectivement, sert bien peu au développement de la
personnalité individuelle ou sociale de l'individu et,
quand on a l'impression qu'elle y parvient, c'est parce
que l'aliénation qui en résulte a été tellement bien
intériorisée que sa victime ne se rend plus compte qu'elle
est devenue une marionnette, un simple écho, la voix de
son maître. Les drames propres à l'école : la course aux
bonnes notes, l'angoisse des résultats, le sentiment de
l'échec ou l'obligation de faire mieux ou au moins aussi
bien que l'autre, aussi vite, avec autant de passion
apparente, l'ennui des heures perdues, ce corps
condamné à rester cloué sur une chaise, l'obligation
continuelle de faire semblant…, tout autant que les
éternelles querelles pédagogiques à propos des contenus
d'enseignement, des méthodes d'approche pour
apprendre sans coup férir son bonheur à l'élève, des
ambitions didactiques avec des démarches empruntées à
la tactique militaire parfois enrobées d'un excipient
ludique…, tous ces "drames" donc témoignent bien peu
de ce but supérieur même si on répète sans cesse vouloir
placer l'enfant au centre du système scolaire (ce qui ne
devrait être qu'une tautologie et non un "projet"),
rendre l'individu à lui-même, l'aider à se définir et à
développer ses qualités potentielles, intégrer et
comprendre le monde qui l'entoure, s'y insérer en restant
autonome.
En revanche, la nécessité de parvenir à une société
"déscolarisée" comme l'écrivait Illich, paraît s'imposer,
mais déscolarisée, en référence à une institution scolaire
symbole des autres institutions, une déscolarisation qui
serait alors une grande révolution culturelle. Parvenir à
une société des libertés et des individus libres pour enfin
mettre en accord les paroles d'une institution se
17
réclamant du bien de l'enfant et la réalité des faits dans
laquelle la hiérarchie est toute puissante où, "d'en
haut", on décide de ce qui est bon pour "l'élève", où
l'on remplace le développement de la curiosité naturelle
par un gavage de "paquets de savoir" prédéfinis,
normés, standardisés, aseptisés, par l'apprentissage de
comportements qui préfigurent ceux d'une société de la
compétition et de la consommation au lieu de soutenir le
désir et l'énergie du savoir, d'accompagner les
expériences sociales et individuelles.
Ce qui étonne, c'est qu'à de rares exceptions, l'École
n'est presque jamais remise fondamentalement en
question dans son existence même, dans ses fondements.
Les critiques lancées à son encontre sont le plus souvent
l'expression d'un ressentiment personnel contre des
déviations qui ne remettent pas en cause son essence. Le
tabou est total : l'école, comme la prison, la police ou
l'armée peuvent être critiquées sur tel ou tel point, mais
on ne peut toucher à leur principe. L'École fait partie du
paradis des vérités éternelles, ces dogmes imposés une
fois pour toutes et que les meilleurs esprits ont
intériorisés.
Alphonse Daudet ou Jules Renard, Flaubert ont réglé
leurs comptes avec elle sans toucher à ses fondements, à
la justification de son existence : ils dénoncent par
l'anecdote les mauvais maîtres, une discipline inadaptée,
une pédagogie inexistante, des locaux tristes, au pire une
entreprise de dépersonnalisation. Ils en font un
délassement littéraire.
Seuls peut-être, Jules Vallès au XIXe siècle et Paul Nizan
au XXe siècle exprimeront des critiques assez radicales
face à une institution qui trahit les attentes que l'on
pourrait placer en elle, mais la fameuse trilogie du
18
premier, après avoir été longtemps "mise en touche" est
désormais étiquetée ouvrage de littérature et les écrits du
second n'ont jamais été très populaires, rejetés dans
l'oubli par les oeuvres célèbres d'autres normaliens assez
fiers, eux, de leurs parcours scolaires et universitaires. La
société n'aime pas celui qui "crache dans la soupe" ou,
moins vulgairement : "malheur à celui par qui le
scandale arrive" ou risquerait d'arriver.
Il est cependant un fait accepté par tous : l'école, le
système scolaire n'est pas parfait. La conséquence
s'impose : il faut travailler à le rendre meilleur ! Les
ministres, les inspecteurs généraux, les inspecteurs
d'académie, les inspecteurs régionaux, les associations de
parents d'élèves, les coordinations de lycéens, les IUFM,
les pédagogues, les didacticiens, les auteurs, les éditeurs,
unissent apparemment leurs efforts pour réformer,
améliorer, transformer cette école presque aussi vieille
que l'histoire. Faisons leur confiance pour faire du neuf
avec du vieux !
En revanche, dire "non" à l'École apparaît comme un
scandale, voire le scandale, car cette institution est
généralement présentée comme le fer de lance des
démocraties et du progrès!
Bien sûr, on connaît quelques illuminés qui se sont
attaqués à cette imprenable redoute, les anarchistes
parfois, Paul Robin, Peter Kropotkine, Francisco Ferrer,
André Colomer ou Walther Borgius par exemple. On peut
les laisser crier tant qu'ils veulent, l'école telle qu'elle est
tellement entrée dans les moeurs que personne ne sera
tenté par ce chant des sirènes. Inutile de s'attacher au mât
ou de se boucher les oreilles avec des boulettes de cire,
plus de deux mille ans d'habitude, d'hébétude et le
19
consensus est quasiment total sur l'école. Les
psychologues parlent parfois d' "identification avec
l'agresseur" pour évoquer cette attitude qui fait que la
victime peut prendre fait et cause pour ce qui l'opprime,
refusant de voir plus loin que le bout de son voile ou de
sa salle de classe, une myopie, une cécité induite,
inaltérable, quasiment définitive.
Un certain nombre d' "évidences" appartiennent ainsi à
notre séjour carcéral librement - en apparence - accepté :
l'inégalité sociale, la liberté invariablement limitée, le
travail-qui-permet-à-l'homme-de-se-réaliser, la
méritocratie laïque, l'argent, la consommation (du
festival "off" d'Avignon aux trois paquets de nouilles
pour le prix d'un, du dernier best-seller de Houellebecq à
l'IPad de Apple), le PIB, la gauche et la droite, la
démocratie représentative, la crise-qui-exige-dessacrifices…
On peut en discuter, bien entendu, puisque
nous sommes en démocratie, mais la marge de manoeuvre
est étroite, les cadres semblent définitivement tracés.
En fait, la grande question qui se pose est de savoir si
l'homme doit être considéré comme sujet ou comme
objet, encore que cette formulation ne manque ni
d'ambiguïté ni de saveur puisque, en jouant sur les mots,
le "sujet" est bel et bien l'objet d'un pouvoir qui
s'impose à lui ! Pas d'échappatoire !
Si l'on s'en tient à la définition grammaticale de ces
termes, cela revient à dire : l'homme est-il considéré
comme un être autonome, capable de décider de ses
choix ou de ses désirs, créatif, actif, "existentialiste" à
l'intérieur d'une société, ou est-il un simple élément de
cette société, une brique qui doit s'insérer dans le mur de
la demeure sociale, essentiellement manipulable,
malléable, au-service-de… ? La société est-elle une
20
espèce de zoo ou de ménagerie dans laquelle on inflige
un traitement aux pensionnaires qui, tout en donnant
l'impression de conserver au plus près la nature, n'en
dévie pas moins de cette nature ? C'est la question
fondamentale qui se pose à l'École. Son devoir est-il de
proroger, de prolonger, voire d'éterniser un système dans
lequel l'individu n'est qu'un rouage ou bien doit-elle
chercher, en dehors de ces cadres, de nouvelles voies
permettant à l'individu de se réaliser ? L'école a-t-elle
pour vocation de presser des générations de jeunes dans
un moule préexistant et qui n'a guère évolué dans ses
grands traits, structurellement depuis des siècles ou bien
doit-elle chercher à faire éclater ces cadres pour ouvrir à
l'individu la terra incognita de la liberté ?
Croire en l'École est ainsi une sorte de profession de foi
voire d'acte de foi. Les esprits les plus frondeurs sont, à
son égard, étonnamment conformistes. On veut bien
réformer, modifier, adapter, mais fondamentalement elle
reste la même : un bâtiment à part, des classes, des
professionnels (fonctionnaires ou assimilés) de
l'éducation, un rapport, certes variable, mais un rapport
enseignants/enseignés qui perdure avec plus ou moins de
fortune, des programmes choisis par des adultes
respectueux des injonctions de l'État et des exigences du
monde de l'économie…, alors qu'il faudrait tout
repenser, faire table rase de ce qui existe puisqu'une
innovation véritable ne pourra sans doute se faire qu'en
dehors de ce cadre aliénant.
Il est évident que la déscolarisation de la société ne
pourra s'envisager tant que les fondements tabouisés de
la civilisation actuelle ne seront pas démasqués ou
dépassés : la foi en une société de la compétition, en une
21
productivité toujours accrue, en une consommation seule
source du bonheur, en une fuite en avant vers toujours
plus, en une sacralisation du travail ou plutôt de l'activité
rémunérée, en un veau d'or aux avatars nombreux, en
l'aveuglement des pays riches, qui ont basé leur mode de
vie exorbitant sur l'exploitation des pays pauvres et le
pillage des ressources. Décider de ne pas se résoudre à
abandonner l'individu à être un simple producteur /
consommateur, exploité / exploiteur, mais vouloir
s'engager dans le long processus de sa réévaluation, celle
de son essence et de ses acquis par opposition aux
dogmes et traditions, aux exigences d'un système aveugle
dont la finalité humaine a disparu et qui n'a plus pour but
que de produire plus pour vendre plus, toujours plus, un
système qui échappe en fait à tout contrôle et se
développe en toute autonomie sous le couvert illusoire
des États, qui, dans le fond, n'en peuvent mais… Cette
déscolarisation est en fait le symbole, le point d'ancrage
d'une désaliénation dans le sens de formes de vie et de
cultures libertaires et vraiment démocratiques dans
lesquelles l'accent serait mis sur le développement
harmonieux de chacun plutôt que sur la pérennisation
d'une école destinée à former des clones que l'on
persuade par divers tours de passe-passe qu'ils ont pu
développer leur vraie personnalité.
Cet essai n'ambitionne pas d'apporter des réponses aux
questions qu'il soulève. Il part de l'expérience de vie
d'un enseignant qui s'est toujours interrogé sur son rôle,
qui a cru longtemps pouvoir concourir à faire évoluer
l'institution scolaire de l'intérieur et qui croit savoir
aujourd'hui qu'il n'y a pas de demi-mesure, pas de
réformette possible en matière d'École, qu'il faut la
22
refonder entièrement. Les bons sentiments, les efforts
personnels ne suffisent pas et ne servent trop souvent que
d'alibis commodes.
Puissent ces quelques réflexions aider à prendre
conscience.
23
I. Les cahiers au feu et le maître dans le
milieu ?
24
25
Il paraît évident que l'enfant a besoin d'une éducation et cela
au moins pour deux raisons : il possède en lui des facultés
latentes, des virtualités qui ne demandent qu'à être développées
et il naît au sein d'une communauté, dans un monde dont
l'existence est réglée par un certain nombre de déterminations
qu'il devra connaître ne serait-ce que pour s'en affranchir, s'il
le souhaite plus tard. Seul, abandonné à lui-même, il
parviendrait peut-être à survivre, mais la nature nous montre
que tout être vivant passe obligatoirement par une phase
d'apprentissage au cours de laquelle l'exemple d'un individu
formé, adulte est essentiel dans la transmission des savoirs.
Cette vérité première soulève toutefois d'emblée des questions.
Si l'animal est amené à répéter ce que des générations
d'individus de son espèce ont appris, s'il n'y a pas de progrès
ou des progrès très lents dans l'apprentissage, progrès qui sont
plutôt des adaptations à de nouvelles données
environnementales par exemple, si les différences entre
individus sont relativement peu importantes, le cas est
totalement autre quand il s'agit de l'homme. Le petit enfant
possède une personnalité, une individualité, des capacités qui
en font un être unique même s'il doit intégrer un jour une
communauté dans laquelle il devra probablement rogner sur ses
particularités, mais "rogner" le moins possible ! Il ne faudrait
pas que l'éducation devienne simple conditionnement ni que
les éducateurs soient essentiellement les chiens de garde d'un
système, d'une idéologie ou d'une morale. Qui seront-ils donc,
ces éducateurs ? Au nom de quels principes agiront-ils ? De qui
dépendront-ils ? De quel droit useront-ils ? Cette éducation
doit-elle passer par l'école telle que nous la connaissons ?
Avant de tenter de répondre à ces questions, relisons le mythe
26
platonicien de la caverne.
Platon et sa caverne
Maintenant représente-toi comme il suit l'état de notre
nature du point de vue de l'instruction et l'ignorance.
Imagine des hommes dans une demeure souterraine, en
forme de caverne, disposant sur toute sa largeur d'une
entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont là depuis
leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte
qu'ils ne peuvent ni bouger ni regarder ailleurs que
devant eux la chaîne les empêchant de tourner la tête;
la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur,
au loin derrière eux; entre le feu et les prisonniers
passe une route élevée. Cette route est longée par un
petit mur, pareil à ces cloisons que les marionnettistes
disposent devant eux et au-dessus desquelles ils font
voir leurs merveilles.
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des
hommes portant des objets de toutes sortes, qui
dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et
d'animaux, en pierre, en bois et en toutes sortes de
matières. Tout naturellement parmi ces porteurs
certains parlent et d'autres se taisent.
Voilà bien, s'écria Glaucon, un étrange tableau et
d'étranges prisonniers.
Ils nous ressemblent; et d'abord, songe que, dans une
telle situation, ils n'ont jamais vu autre chose d'euxmêmes
et de leurs voisins que les ombres projetées par
27
le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face.
Et comment, observa Glaucon, puisqu'ils sont forcés de
rester la tête immobile durant toute leur vie !
Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de
même ?
Sans contredit.
Si donc ils pouvaient discuter, ne penses-tu pas qu'ils
prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils
verraient ?
Absolument.
Et si la paroi du fond de la prison renvoyait un écho
chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croiraientils
entendre autre chose que l'ombre qui passerait
devant eux ?
Non, par Zeus !
De tels hommes n'attribueront certainement de réalité
qu'aux ombres des objets fabriqués. Considère
maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les
libère de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur
ignorance. Qu'on délivre l'un de ces prisonniers, qu'on
le force à se redresser immédiatement, à tourner la tête,
à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en faisant
tous ces mouvements, il souffrira et l'éblouissement
l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure
il percevait les ombres. Que crois-tu donc qu'il
rétorquera si quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu
jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent,
28
plus près de la réalité et tourné vers des objets plus
réels, il voit plus juste ? Si, enfin, en lui montrant
chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de
questions, à dire ce que c'est ? Ne penses-tu pas qu'il
sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à
l'heure continueront à lui paraître plus vraies que les
objets qu'on lui montre maintenant ? Et si on le force à
regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils
pas blessés? N'en fuira-t-il pas la vue pour se
retourner vers les choses qu'il peut regarder, et ne
croira-t-il pas que ces dernières sont vraiment plus
distinctes que celles qu'on lui montre ?
Assurément !
Et si on l'arrache de sa caverne, qu'on le force à
gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le libère
pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil,
ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas
de ces violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la
lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat,
distinguer une seule des choses que maintenant nous
appelons vraies ?
Il ne le pourra pas, du moins dès l'abord.
Il aura, je pense, besoin d'habitude pour distinguer les
objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les
ombres qu'il percevra le plus facilement, puis les
images des hommes et des autres objets qui se reflètent
dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après
cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la
lune, contempler plus facilement pendant la nuit les
corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour le
29
soleil et sa lumière. À la fin je l'imagine, ce sera le
soleil - non ses vaines images réfléchies dans les eaux
ou en quelque autre endroit - mais le soleil lui-même à
sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il
est.
Nécessairement !
Après cela, il en viendra à conclure à propos du soleil,
que c'est lui qui fait les saisons et les années, lui qui
gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une
certaine manière est la cause de tout ce qu'il voyait
avec ses compagnons dans la caverne. Or donc, se
souvenant de sa première demeure, de la sagesse que
l'on y professe, et de ceux qui furent ses compagnons
de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du
changement et plaindra ces derniers ?
Si, certes.
Et s'ils se décernaient entre eux louanges et honneurs,
s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait
de l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se
rappelait le mieux celles qui avaient coutume de
paraître les premières ou les dernières, ou d'avancer
ensemble, et qui par-là était le plus habile à deviner
leur apparition, penses-tu que notre homme fût jaloux
de ces distinctions, et qu'il portât envie à ceux qui,
parmi les prisonniers, sont honorés et puissants? Ou
bien comme ce héros d'Homère, ne préféra-t-il pas
mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un
pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que
de revenir à ses anciennes illusions de vivre comme il
vivait ?
30
Je suis de ton avis, dit Glaucon, il préférera tout
souffrir plutôt que de vivre de cette façon- là.
Imagine encore que cet homme redescende dans la
caverne et aille reprendre son ancienne place : n'aurat-
il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant
brusquement du plein soleil? Et s'il lui faut entrer de
nouveau en compétition, pour juger ces ombres, avec
les prisonniers qui n'ont point quitté leurs chaînes,
dans le moment où sa vue est encore confuse et avant
que ses yeux ne se soient à nouveau habitués
(l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps
assez long), ne prêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et
les autres ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en
est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est
vraiment pas la peine d'essayer d'y monter? Et si
quelqu'un tente de les délier et de les conduire là-haut,
et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le
tueront-ils pas ?
Sans aucun doute.
Maintenant, mon cher Glaucon, il faut appliquer point
par point cette image à ce que nous avons dit au début,
comparer le monde que nous découvre la vue au séjour
de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire, à la
puissance du soleil. Quant à la montée dans la région
supérieure et à la contemplation de ses objets, si tu la
considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu
intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée,
puisque aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si
elle est vraie. En ce qui me concerne, voilà mon
opinion : dans le monde intelligible, l'idée du bien est
perçue la dernière et difficilement, mais on ne peut la
31
percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce
qu'il y a de droit et de beau en toutes choses; qu'elle a,
dans le monde visible, engendré la lumière et le
souverain de la lumière; que dans le monde intelligible,
c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité
et l'intelligence; et qu'il faut la voir pour se conduire
avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique.
Je partage ton opinion, autant que je le puis.
Eh bien ! Partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne
pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne
veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que
leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut.
Mais quoi, penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme
qui passe des contemplations divines aux misérables
choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à
fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et
n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres
environnantes, il est obligé d'entrer en dispute, devant
les tribunaux ou ailleurs, à propos des ombres de
justice ou des images qui projettent ces ombres, et de
combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui
n'ont jamais vu la justice elle-même...
À propos de ce mythe
Le mythe de la caverne est une allégorie destinée à
illustrer la situation des hommes par rapport à la vraie
lumière, c'est-à-dire par rapport à la Vérité.
Mais la fable de Platon est, comme disent les linguistes,
éminemment polysémique. C'est une caverne qui tient un
32
peu de l'auberge espagnole, chacun y apporte ce qu'il
veut, ce dont il sait avoir besoin ; chacun en fait son bien
et l'interprète à sa façon. En extrapolant les intentions du
philosophe grec, le plus couramment, on dit que cette
caverne représente l'univers social et culturel dans lequel
nous sommes plongés dès la naissance. Nos habitudes,
nos systèmes de pensée, nos relations sociales, notre
culture, toutes ces ombres en peuplent l'obscurité
abyssale et la caverne devient le lieu de toutes les
dictatures, de tous les sur-moi, visibles et invisibles.
C'est ce que tout élève de philo apprend et comprend
généralement.
L' "éclaireur", le philosophe, celui qui sait, se déclinera
alors, suivant les époques en une infinité de personnages
qui tous - du prêtre au dictateur - indiqueront aux foules
innocentes, médusées et angoissées la voie suprême, celle
qui mène à cette vraie lumière, celle qui permet
d'échapper aux ténèbres, à l'aliénation.
D'une aliénation l'autre, nous apprend d'ailleurs
l'Histoire !
Le bon père Prévost effaré de voir que les lecteurs de son
Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
(deux "écoliers" !) avaient négligé le message
moralisateur qu'il avait probablement voulu propager
(mais en était-il lui-même dupe ?) fit précéder les
rééditions de son histoire à succès d'une préface
explicative, dogmatique, didactique, accompagnée d'une
gravure soulignant l'évidence de la leçon. En effet, au
centre de celle-ci un vieillard barbu indique d'un doigt
impératif à un jeune homme effondré les nuées d'où
émerge, nimbée de rayons lumineux, une croix plantée
33
dans le coin supérieur droit de l'image tandis que, au
fond d'une caverne sombre, en bas et à gauche, se
morfond une jeune fille en pleurs. On ne pouvait être plus
explicite puisque l'image venait doubler la préface. Dans
un geste impliquant une lecture diagonale gauche-droit,
bas-haut de la gravure (avec toute la symbolique attachée
à ces directions), le barbu philosophe montre ainsi au
pécheur qu'il vient d'extirper de la caverne du stupre la
vraie lumière, celle née un jour sur les flancs du
Golgotha : abandonne, mon fils, les plaisirs incertains du
séjour chthonien pour la gloire éternelle des beautés
supérieures !
Les lecteurs pourtant ne s'en laissèrent pas compter et
continuèrent à donner le nom de l'héroïne sulfureuse à
leur cher roman, à le plébisciter, n'éprouvant au mieux
qu'une tiède pitié pour le malheureux chevalier revenu en
fin d'aventures sur ses erreurs de jeunesse. Je passe sur
les continuations que la foule des aficionados réclama,
car la mort de Manon ne pouvait satisfaire et il suffisait
d'un trait de plume pour lui redonner vie…
Un exemple anecdotique de ces mentors qui essayent de
vendre leur lumière aux aveugles des cavernes et ce qu'il
s'ensuit parfois, heureusement…
Du philosophe à l'enseignant
Un autre de ces mentors est l'enseignant, et le chemin qui
mène à la "vraie lumière" est pavé des bonnes
34
intentions de l'institution scolaire. D'ailleurs, la première
phrase de l'allégorie platonicienne est claire à ce sujet :
Maintenant représente-toi de la façon suivante l'état de
notre nature du point de vue de l'instruction et de
l'ignorance.
L'Instruction et
l'Ignorance.
La caverne dans l'obscurité et ses habitants condamnés à
croire à la réalité des vaines ombres projetées sur le mur
qui leur fait face, c'est l'humanité sans instruction et dans
cette ignorance qu'il faut combattre. Quand on a dit cela,
on n'est guère avancé, car tous ces mots manquent de
définitions précises.
Toutefois, ce mythe de la caverne ressemble assez à un
mythe d'origine qui serait alors celui de l'enseignant. Ce
dernier a pour métier de guider vers les lumières du
savoir, d'éduquer. Éduquer, ex ducare, conduire vers,
hors de… Mais hors de quoi ? Hors de l'ignorance (et
alors, qu'est-ce que l'ignorance ?) ? Hors de la caverne ?
Hors de soi ? Et conduire vers où ? Vers quoi ? Pour
quoi ? Pourquoi ?
Platon, bien entendu, répond à toutes ces questions :
l'homme vit dans un monde d'apparences sans grand
intérêt et il doit faire l'effort de s'élever vers les vérités
tangibles et éternelles. Il lui faut détacher son regard des
pâles imitations qui l'entourent pour tenter d'apercevoir
les vrais modèles et, au-delà de ces modèles, le créateur !
On comprend au passage pourquoi Platon était en odeur
de sainteté chez les chrétiens et qu'il n'a pas fallu
attendre la Contre-réforme catholique pour qu'un
néoplatonisme plus ou moins diffus imprègne la doctrine
35
chrétienne ! La vraie vie est ailleurs, l'eschatologie
chrétienne rejoint un platonisme à peine revisité.
L'École d'Athènes de Raphaël peut d'ailleurs passer pour
une sorte de figuration emblématique servant de pendant
illustré à ce mythe de la caverne. Entourés de tous les
mentors de l'Antiquité (et des temps modernes puisque le
peintre, dans sa représentation, n'aurait pas oublié
Copernic), Aristote montre d'un geste large la terre, le
séjour terrestre tandis que Platon lève le doigt vers les
cieux, le lieu des vérités éternelles, l'arrière-monde des
Idées, la transcendance du réel, et, tout autour, les grands
philosophes s'affairent à accroître le savoir humain.
Deux domaines, le ciel et la terre.
Le premier prône la raison et l'empirisme, le second en
appelle à des lumières sans doute plus essentielles et
moins immédiatement utiles. L'École rapproche, unit
Aristote et Platon, comme l'Église et ses Pères le firent,
Thomas et Augustin en particulier, au grand dam des
hérétiques de tout poil faisant pencher la balance vers
l'un ou l'autre des deux philosophes.
La fresque de Raphaël représente une école, l'école du
genre humain, une école rassemblant les meilleurs esprits
et affirmant qu'il ne faut rien privilégier, ni l'idéalisme ni
le rationalisme.
Le maître aujourd'hui y aurait-il sa place et quelle place ?
Toujours est-il que, lui aussi, se croit investi de la mission
de mener à la lumière. Mais quelle lumière ? Est-il
aristotélicien ? Est-il platonicien ? Est-il capable
d'effectuer la synthèse ? N'est-il pas tout simplement
l'instrument d'un système qui le dépasse ?
"Voulez-vous prendre une idée de l'éducation publique,
36
lisez la République de Platon. Ce n'est point un ouvrage
de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent des
livres que par leurs titres : c'est le plus beau traité
d'éducation jamais fait", écrivait J.-J. Rousseau dans son
Émile ou de l'éducation. Et il est vrai que le Platon
originel donne de belles idées de l'éducation, mais les
leçons d'Aristote sont tout aussi solides et lui au moins
ne fait pas du poète un interdit de séjour !
Éduquer, éduquer ? Vous
avez dit "éduquer"?
Restons-en aux mots. Educare, ex ducare, en latin,
erziehen, er-ziehen en allemand…, les exemples
pourraient être multipliés et se ramènent tous et partout à
la même expérience : éduquer, c'est conduire hors de soi,
tirer vers ailleurs.
C'est aussi forcément "arracher". Éduquer ne se fait pas
sans une certaine violence. Pas de formation sans
déformation ! Il y a quelques décennies, quand un
individu encore jeune semblait quitter le "bon chemin",
on l'enfermait dans une "maison de redressement" !
Chez les Padaungs, en Birmanie, lorsqu'une petite fille a
entre cinq et neuf ans, on lui passe sur le cou une
pommade et on pose le premier anneau d'un collier qui
fera d'elle au cours des années une femme-girafe, une
"Karen au long cou". Elle sera alors apte à se marier.
Son éducation de femme et son intégration dans le
groupe se payent d'une terrible déformation aux
conséquences effroyables. De tels exemples de
modifications physiques sont monnaie courante dans les
diverses civilisations et illustrent de façon choquante
37
d'autres formations/déformations moins sensibles, celles
qui sont la conséquence de l'éducation.
Ajoutons tout de même que l'éducation des femmesgirafes
heurte certes le sens commun et que cette
violence ainsi affichée, ne touchant que le sexe féminin,
est aussi inacceptable que l'excision mutilant quantité
d'adolescentes et marquant à jamais la vie des femmes
dans de nombreux pays. Cependant, si l'on reprend
l'exemple des Padaungs, on sait qu'il y a encore peu de
temps, il était quasiment impossible de rencontrer ces
femmes dont certaines, dès la puberté, portent déjà la
totalité des anneaux. Les régions que ces populations
habitent étaient réputées dangereuses et inaccessibles.
Cette coutume barbare se vivait donc en vase clos. Il y
avait, certes, mutilation mais en quelque sorte par erreur,
sans le vouloir, parce qu'une tradition vicieuse s'était
établie et transmise de génération en génération avec
l'oubli de ses causes probables (on a évoqué la nécessité
de protéger le cou des attaques d'animaux sauvages par
exemple…). Un rite donc en apparence nécessaire pour
affirmer l'appartenance au groupe voire sa cohésion dans
un milieu souvent hostile.
Depuis au moins l'Humanisme de la Renaissance et les
premières Lumières - Rabelais, Érasme, Pascal, Bayle,
Leibniz, Locke ou Fontenelle - nous savons en Europe
qu'autorité et tradition sont de bien mauvais maîtres. Les
Padaungs se moquent de nos références poussiéreuses,
mais on peut penser qu'un certain progrès des idées, une
réflexion sur les tenants et aboutissants, une prise de
conscience allant dans le sens des droits de l'homme fera
ou aurait fait avancer les choses. Mais voilà, alertés par
les chromos publiés par des revues prestigieuses sur
papier glacé, des touristes sont attirés par ces femmes
38
girafes comme jadis on se pressait dans les foires pour
regarder les monstres - Hugo et son Homme qui rit en
ont donné le roman terrible pour le XIXe siècle.
Alors, certains Birmans, plus évolués (?) ont enlevé des
femmes et des jeunes filles et les exposent désormais
dans leurs villages, accessibles, eux, aux voyageurs en
mal d'exotisme. Réduites à l'état de bêtes de zoo,
exposées dans des baraques, ces femmes souvent
prostituées font la fortune des souteneurs et la joie
malsaine de touristes avides d'expériences limites. On a
même "exporté" certaines de ces pauvres existences
sous prétexte de leur venir en aide dans des villages-zoos
en Thaïlande ! Ne nous récrions pas trop, nous, Français :
il y a moins de quatre-vingts ans, la France exposait ses
"sauvages" ses "Canaques" (le mot n'avait pas encore
le sens qu'il possède désormais) lors de la dernière
exposition coloniale (1931) ! Cannibale de Didier
Daenincks en a fourni une illustration bouleversante !
Si l'on tire la leçon de cette anecdote, on peut dire qu'une
éducation - vicieuse en soi mais considérée dans son
milieu comme indiscutable - est détournée à des fins
encore plus ignobles. La femme-girafe ne subit plus son
martyre pour appartenir de plein droit à une communauté,
mais pour devenir l'objet d'une curiosité malsaine, du
lucre et de perversions occidentales. Elle est
définitivement enlevée à soi, réifiée, rayée de l'humanité.
A l'origine, la déformation imposée à la femme-girafe
fait partie de ces rites qui maintiennent la cohésion du
groupe, cohésion essentielle en milieu hostile et ce
groupe est plus important que l'individu, qui seul ne
pourrait survivre. Sans justifier ces pratiques, on peut les
comprendre. Aujourd'hui, la situation est autre et le
39
maintien de cette tradition sans excuses : le groupe n'est
plus exposé aux mêmes dangers que jadis et
l'exploitation de ces femmes (tourisme, prostitution) est
une perversion, une hypocrisie inacceptable.
Cet exemple nous rappelle que l'enfant est
essentiellement malléable. Il a certes besoin de recevoir
une culture qui fera de lui un être complet et lui permettra
d'intégrer une communauté, de s'intégrer ensuite à une
civilisation, mais il possède aussi des qualités
personnelles qui ne doivent pas disparaître. Ce serait
peut-être même là le passage de la culture à la
civilisation.
En effet, la culture, qu'on peut définir comme l'identité
d'une communauté, est constituée par l'ensemble des
règles, conventions, croyances, traditions et réflexes qui
établissent une relation conviviale et utilitaire entre les
membres de cette communauté. C'est enfin le point de
départ des droits et des obligations. Elle n'est pas innée et
est également liée à l'autorité. Elle possède aussi un
aspect "cultuel".
La civilisation, pour sa part, peut être considérée comme
l'affinement de formes culturelles par l'apport des
sciences et des techniques, de toutes les conquêtes faites
dans un sens humano centriste. La civilisation se
rapporte au "cives" par opposition au "sauvage", à la
libération des contraintes naturelles et à la préservation
de la sphère personnelle, ce qui veut dire que l'individu
ne doit évidemment pas devenir l'otage d'un nouveau
maître, l'économie ou l'idéologie, passer des obligations
du clan à une autre forme de dépossession de soi. Il
devrait au contraire profiter personnellement de cette
évolution.
40
Tout cela passe évidemment par une éducation, par cet
"arrachement" auquel je faisais plus haut allusion. Le
film de François Truffaut, L'enfant sauvage, a mis en
images de façon magistrale, à partir du témoignage
émouvant du docteur Jean Itard combien, sans cette
éducation l'homme était inachevé et combien celle-ci
devait avoir lieu tôt, dès la naissance. Cependant, on ne le
dira jamais mieux que Rabelais, Montaigne ou
Rousseau : l'éducation doit se faire au bénéfice de
l'enfant et de l'homme qu'il deviendra.
C'est là tout le problème : que signifie "au bénéfice de
l'enfant puis de l'homme" ? Y a-t-il un développement
intrinsèque à garantir, une personnalité à enrichir ou bien
l'individu doit-il avant tout être intégré à la société qui
l'entoure, au système dans lequel il est né ? Dans le
premier cas, ne risque-t-on pas de privilégier une
hypothétique nature de l'individu et de négliger ce qui
paraît essentiel, la culture et la civilisation ? Dans l'autre,
le danger de réifier, de condamner l'homme à être la
fourmi de la fourmilière, la femme-girafe. Le choix est-il
seulement entre l'individualisme forcené et un
totalitarisme écrasant ? Certainement pas et c'est là le
principal problème que soulève une éducation bien
pensée. On pourrait imaginer une nouvelle École
d'Athènes façon XVIIIe siècle (Paris est d'ailleurs alors
souvent qualifiée de l'Athènes nouvelle) unissant Jean-
Jacques et Denis, le premier, un volume de ses Rêveries
serré contre sa poitrine, montrant son coeur du doigt et le
second, l'Encyclopédie à ses pieds et indiquant d'un
geste large la foule des hommes. Le nécessaire
individualisme de l'auteur des Confessions (mais aussi du
Contrat Social !) et la non moins nécessaire
41
"convivialité" chère au père de l'Encyclopédie (mais
aussi des lettres à Sophie Volland !). Karl Marx affirmait
ainsi - contrairement à ce que la praxis communiste a le
plus souvent montré - que le développement harmonieux
de chaque individu conditionnait le développement
harmonieux du groupe !
L'enfant a certes besoin d'acquérir une culture et
d'intégrer une civilisation, mais il n'est pas une tablette
de cire vierge. Biologiquement, psychologiquement, il
possède un certain nombre de déterminations, de
"talents", de "particularités", une "nature", qui
l'individualisent et qui ne doivent ni disparaître ni être
contraints.
Instruire et Éduquer
Instruire c'est transmettre des connaissances. C'est la première
définition qui vient à l'esprit.
Instruire peut être aussi le fait de remplir un formulaire vide ou de
préparer un procès. On reçoit encore des instructions - des ordres
- de son supérieur et l'évêque diligente son instruction pastorale
auprès de ses diocésains. Tous ces sens ont quelque chose en
commun : l'idée de "remplir", de "mettre en état de…", de
conduire un procès ou son existence, de combler un vide dans son
savoir, de rectifier un jugement… Mais le juge d'instruction n'est
pas un pédagogue et le prélat non plus ! Si l'on s'en tient à cette
définition de la transmission des connaissances, celle-ci peut vite
prendre l'allure d'un gavage autoritaire, d'une mise au pas, d'un
dressage. Il n'y a guère de temps encore, un individu mal éduqué
était quelqu'un qui n'avait aucune politesse, qui ne possédait par
les clefs du sésame social, qui ne savait pas se comporter et qui se
situait en marge. Il échappait ainsi à ce "dressage" de la majorité
qu'on appelait les bonnes manières. Une telle transmission
entachée d'autoritarisme et dont la finalité est l'intégration à une
communauté rappelle le fameux "hors de l'Église point de salut".
D'ailleurs on doit se demander si le savoir peut réellement se
transmettre au sens propre de ce verbe. Les lecteurs du Banquet se
souviennent de l'ironie de Platon à ce propos quand Agathon
42
demande à Socrate de venir s'asseoir auprès de lui afin que cette
proximité permette la communication de la science du philosophe,
par capillarité en quelque sorte. "Il serait à souhaiter, dira Socrate
en s'asseyant, que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d'un
homme qui en est plein dans un homme qui en est vide par l'effet
du contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du
morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide".
Ce n'est hélas ! ou heureusement ! jamais le cas et il n'existe pas
de transmission passive, mais plus exactement un accaparement,
une "prise en soi" par ce que l'autre propose.
Instruire, étymologiquement, c'est "équiper", c'est donc
permettre à un individu d'acquérir l' "équipement" qui le rendra
autonome, c'est-à-dire donner les moyens à quelqu'un de
construire ses connaissances en se construisant lui-même. Toujours
ce conseil de Montaigne au pédagogue : ne pas marcher devant
mais derrière. Ni gavage, ni réification.
Connaître, c'est arriver au stade de la co-naissance : ce qui est
hors-moi me pénètre et par innutrition devient présence en moi,
mais une présence fictive sous la forme d'un double mental
résultant de mes perceptions ou/et de mes réflexions. Connaître,
c'est faire naître en soi et avec soi la forme intelligible de ce qui
est hors moi. Ce que le maître a pensé ne sera pas, ne doit pas être
semblable à ce qui naîtra dans l'esprit de l'élève et la forme qui
naîtra dans l'esprit de chaque élève sera aussi différente. Dans tous
les cas différente mais ressemblante pour une part. Pas de clonage
en matière d'éducation mais une richesse de nuances, la richesse
de la diversité dans la ressemblance. Pour bien comprendre cela, il
faudrait établir une distinction entre le concept objectif, si tant est
qu'il existe (l'idée d'arbre, de soleil, de mer) et le concept
"personnel", le résultat de cette innutrition ou maturation plus
haut évoquée. Ces deux concepts se recouvrent en grande partie
mais les marges existent et c'est dans les marges que se situent les
différences, la diversité, les nuances et la richesse des points de
vue. L'apprenant respecté est un apprenant actif, pas une machine à
digérer ce qu'on lui impose et instruire vraiment ce n'est ni
transmettre "son" savoir en espérant le retrouver dans l'esprit de
l'autre ni modeler une intelligence dans une perspective préétablie.
Rien de bien nouveau dans ces truismes : les pédants de jadis
distinguaient la lectio (la parole du maître) de la disputatio (la
43
critique active de l'élève, l'accaparement qu'il faisait de cette
parole). Le vrai savoir n'existe que si l'on pense par soi-même,
sans autisme bien entendu et l'on a besoin du maître mais
d'un "maître" qui ne se conduise pas en potentat. Il n'est encore
que de relire Platon pour s'en convaincre : le dialogue est le moyen
privilégié de parvenir à ce vrai savoir, mais un dialogue entre deux
partenaires : le maître qui n'impose rien et que respecte l'élève et
cet élève, respecté par le maître, qui veut assimiler la parole de ce
dernier, la faire sienne. Sa maïeutique est avant tout l'art
d'accoucher les esprits des vérités qui sont au fond d'eux-mêmes !
Toute éducation qui s'y refuse est indigne et ne correspond qu'au
gavage dénoncé plus haut. À la place du respect règne le mépris ou
l'indifférence.
De même, on peut ajouter qu'il n'existe pas de savoir vrai sans un
effort personnel, effort pour comprendre ce qui est à connaître,
mais effort aussi pour aller plus loin en impliquant sa propre
intelligence et en renonçant au confort de la routine et des
préjugés ! Et cela est aussi vrai pour le maître que pour l'élève. Si
instruire c'est en quelque manière désaliéner les individus, non pas
en leur donnant une liberté clé en main, mais en leur offrant la
possibilité de la construire et de la remettre sans cesse en question,
il est clair qu'une des premières missions est de lutter contre ces
"préjugés qui tiennent chaud", contre les a priori, les jugements
hâtifs et confortables, l'autorité et la tradition, ce prêt-à-porter de
la pensée. Mais Fontenelle, bien après beaucoup d'autres, nous l'a
spirituellement seriné. C'était il y a plus de trois siècles et tous les
élèves de France sont depuis censés étudier la fable de la Dent
d'Or, sans en tirer, malheureusement le plus souvent, une leçon de
vie !
Éduquer est un verbe que l'on confond de plus en plus souvent
avec instruire. On débat d'ailleurs régulièrement du rôle des
professeurs : doivent-ils instruire ou éduquer ? Quelle est la
priorité s'ils se sentent responsables dans les deux domaines ?
Récemment, un enseignant retraité confiait aux auditeurs sur une
chaîne publique que, jusque dans les années 80, il s'était surtout
senti dispensateur de l'instruction, mais qu'ensuite il s'était de plus
en plus vu dans le rôle d'un éducateur… Les populations ont
changé, les temps aussi, concluait-il.
Éduquer vient d'educatio, un verbe qui désignait à l'origine
l'élevage animal. On retrouve l'idée de gavage et de dressage,
44
mais l'homme, contrairement à l'animal n'a pas un instinct qui le
ferait se satisfaire de l'engraissage qu'il subit et de l'apprentissage
qu'on lui impose. Il a une raison, puissance latente qui ne demande
qu'à être activée et qui ne peut se contenter du confort des réflexes
culturels inculqués, réflexes conditionnés qui ont le seul avantage
d'intégrer socialement l'individu, de l'intégrer au "troupeau"
national ou tribal ou religieux, mais dont le gros désavantage est de
lui faire en même temps perdre toute autonomie, tout libre arbitre.
La cité humaine confondue avec la termitière ! Il faut rendre vive
cette raison et quel moyen sinon l'éducation. C'est ce que Kant
préconisait après bien d'autres et en même temps que Pestalozzi
par exemple ! Kant considérait qu'après une période assez brève
de conditionnement nécessaire - ce qu'il appelait la discipline -
devant permettre à l'homme de se révéler dans l'être vivant qu'il
est, il fallait passer à un stade proposant à sa liberté les valeurs qui
rendront la vie humaine, digne. Éduquer ne serait rien moins que
de conduire sans arrachement, progressivement de la nature à la
liberté, de réussir la synthèse de "lui" et de "moi". Ceci bien sûr
sans chercher à remplacer les déterminations naturelles (égoïsme,
avidité, instinct de soi…) par des surdéterminations sociales ou
idéologiques, une sorte de sur-moi qui étoufferait dans l'oeuf ces
déterminations naturelles.
Éduquer donc ! La vie entière est éducation, c'est-à-dire
généralement éloignement d'une nature propre, mais
jugée insuffisante ou plutôt une suite de prises de
distance, d'accommodements, une accumulation
d'adaptations plus ou moins nécessaires, une résultante
aux composantes multiples...
Ces adaptations sont polymorphes et s'effectuent au gré
des rencontres et des événements, une série
ininterrompue de ricochets, de renvois, d'échos, chacun
influant d'ailleurs sur le suivant sans qu'il soit sans doute
jamais possible de repasser par "la case départ", de
revenir aux sources. Tout cela ressemblerait assez à la
45
façon dont se structure un cerveau. Une grande partie du
cortex cérébral est dédiée à la communication. Une
particularité du petit d'homme est qu'il va très vite
acquérir le langage. Parallèlement, son cerveau sera
modifié par ses expériences et par l'acquisition même de
ce langage qui, pour faire simple, lie un mot à une
perception, à un concept. Les gènes (naguère on aurait dit
"la nature" et il y a plus longtemps encore "la
Nature") ont pourvu le cerveau de structures qui vont
faciliter cet apprentissage, mais, en termes de neurones,
des connexions vont se faire, et d'autres se défaire.
En conséquence, une grande partie des neurones va
cesser toute activité voire mourir afin de laisser le champ
libre à ceux d'entre eux qui sont les plus efficaces.
L'expérience acquise joue alors un rôle essentiel dans le
remodelage du cerveau en opérant cette sélection des
circuits neuronaux les plus performants.
Le processus d'éducation est assez semblable : de
composante en composante, d'interdit en injonctions, de
suppressions en ajouts se crée un nouvel être qui n'est
plus ni tout à fait lui-même ni tout à fait un autre, plus
apte à s'intégrer dans le milieu où il vit. Il ne faudrait pas
que cette éducation le métamorphose, fasse disparaître les
potentialités qu'il avait en lui. Le cerveau évolue mais
conserve sa substance fondamentale ; l'individu éduqué
ne doit pas être purement et simplement coupé de luimême.
Tous les choix, les orientations, les formations imposés
dépendent du milieu, de l'époque, de la "civilisation"
pour reprendre les catégories de Taine ne vont pas sans
mauvaise foi ni regrets et ils laissent derrière eux un
sentiment d'incomplétude voire d'absence ou de manque,
si justement l'éducation n'accorde pas une place
46
essentielle à ce que l'auteur des Origines de la France
contemporaine appelait la "faculté maîtresse", le
tempérament !
Quelque chose m'échappe constamment dans ces
attitudes qui s'imposent et qui m'en imposent, qu'on
m'impose. Entre l'enfant jouant avec ses crayons de
couleurs et l'adulte en costume trois-pièces, il y a à
l'évidence solution de continuité, spécialisation, abandon
de l'ensemble des facultés potentielles pour une sélection
utile, mais utile à qui ? A l'individu ? A la société ? Au
système économique ambiant ? Qu'a-t-on fait de la
"faculté maîtresse" ?
Il arrive un moment où la question se pose devant
l'écheveau des parcours et des attitudes, des admirations
et des renoncements, des affirmations et des négations :
Qui suis-je donc ? A quoi bon tout cela ?
Une évidence : je suis fait.
Fait par les autres, les parents, les maîtres, tout ce qu'on
m'inculque directement ou indirectement.
Je suis fait. Un homme fait. Je suis "fait" avec toute
l'ambiguïté de l'expression ! "Je suis fait" signifie aussi
dans le langage courant "on m'a eu", "je me suis fait
flouer" !
Peut-être faudrait-il écrire tout simplement : "Je suis
refait" !
Tension insupportable.
Besoin d'authenticité.
Conscience que toutes les attitudes n'ont été que des
réponses circonstancielles et apparemment pragmatiques.
Or ces attitudes forment un ensemble hétéroclite de
47
facettes qui rarement harmonisent ensemble.
Sous l'écheveau des attitudes l'individu souffre et déteste
un jour le manteau d'Arlequin dont on l'affuble et qui
risque fort de ressembler à la tunique de Nessus.
Sartre donnait comme définition de l'existentialisme :
"Faire quelque chose de ce qu'on a fait de soi".
L'intention, le conseil est excellent et éminemment
réaliste, mais seulement possible s'il demeure en moi un
"je" majeur, une troisième instance, entre "moi" et
"eux", capable de faire la synthèse. Et ce serait sans
doute la finalité d'une éducation bien pensée que de faire
surgir cette troisième instance capable d'unir
harmonieusement le "vieux" fond et l'apport
culturel/civilisatoriel, les potentialités natives et les
contraintes du milieu et de l'époque où l'on naît,
l' "éternel", l'en-soi et le contingent ?
Une des tartes à la crème de l'enseignement des lettres
est depuis des années l'autobiographie. On lit et on relit
Philippe Lejeune et ses épigones, on commente, on
distingue le journal, la biographie, les mémoires. On
cherche les raisons, les justifications… On ne s'interroge
cependant pas assez sur les causes profondes de ce goût
(très habilement induit d'ailleurs : il faudrait aussi
démêler la part du "marketing") qui fait que l'homme
éprouve le besoin de se pencher sur son passé et ce
depuis une époque relativement récente, qui correspond
au moment même où prend naissance cette période de
l'histoire qu'on appelle les temps modernes. A
l'évidence, cet individu engoncé dans les contraintes
d'une société qui l'aliène de plus en plus cherche
48
seulement à reconstituer une personnalité qu'il croit
écrasée, disparue. Son Graal, aussi légendaire sans doute
que l'objet de la quête de Perceval, mais tout aussi
nécessaire pour remédier à la "gaste terre" des
quotidiennetés.
En quête des fragments d'un moi riche et ouvert, libre,
l'individu formaté, simplifié, réifié des sociétés
contemporaines, le diariste malheureux répond de temps
en temps à la nostalgie du paradis perdu.
Comme on peut le penser, ce paradis perdu d'une nature
glorieuse ne serait que rêve, que mythe et les temps
d'Astrée appartiennent à la poésie ou à la religion, mais
sa nostalgie indique au moins que la situation actuelle est
insatisfaisante et qu'on a - par pragmatisme, par une
conscience trop aiguë de l'importance de la réussite
sociale et des besoins matériels - dérivé vers une
conception étriquée de l'existence humaine.
La seule question véritable - et qui reprend toutes les
autres - est donc de savoir quelle éducation est digne de
l'Homme et quelle école il lui faut, quels maîtres.
Rechercher l'harmonie en soi et hors de soi.
Commençons par un paradoxe.
Partout l'école est présentée comme l'institution
démocratique par excellence. C'est l'école qui permet à
chacun, quelle que soit son origine, de profiter de
l'ascenseur social, de devenir un acteur (important) du
49
monde dans lequel il va évoluer. Tous ceux de ma
génération et leurs parents ont lu ces merveilleuses
histoires d'enfants très méritants mais pauvres et qui,
grâce à la Communale et à la clairvoyance de
l'instituteur, sont devenus généraux, hommes politiques
ou savants, faisant profiter de leur génie le pays, voire
l'humanité.
C'est par l'école que l'enfant échapperait au non savoir, à
l'ignorance crasse, à la "caverne", c'est par elle qu'il
apprendrait à utiliser ses facultés, c'est par elle qu'il se
socialiserait, acquerrait l'esprit critique et pourrait
prétendre jouir sinon d'une liberté totale, au moins d'une
autonomie qui s'en rapproche.
Scolariser les enfants est ainsi la première tâche à
laquelle doivent se livrer les gouvernements quand ils
sont démocratiques. Quand on se lance dans les
comparaisons entre les pays, dans les statistiques
permettant de juger du progrès des nations, à côté du
PIB, le taux de scolarisation est considéré comme un
indicateur de première importance. Dans les sociétés
dites avancées, c'est le nombre de bacheliers ou celui de
bac +3, 4 ou 5…
Ajoutons que l'école permettrait enfin l'accès à la culture
et que cette culture est supposée enrichir la vie puisque la
sensibilité aiguisée, l'intelligence accrue, le panel des
plaisirs possibles s'augmentera sensiblement, comme les
professeurs s'efforcent de le seriner et de le faire dire à
leurs élèves dans les copies de dissertation dont le sujet
tourne autour des sempiternels clichés nature et culture.
Un peu comme ces "nez" qui en parfumerie par un
travail constant parviennent à mémoriser plus de 200
fragrances alors que le commun des mortels s'en tient
plus ou moins à une douzaine, l'école élargirait les
50
horizons, développerait les potentialités, agrandirait le
registre des compétences et des jouissances. L'oeil ne
serait plus éteint par l'habitude du seul nécessaire,
émoussé par le quotidien étroit ; grâce à l'école et à la
culture distillée, il acquerrait une acuité vraiment
admirable. Voltaire et son Mondain ont laissé plus que
des traces !
L'homme cultivé devient ainsi créatif, et dans cet acte de
création, il est à l'image du dieu des religions !
La culture littéraire par exemple n'est sans doute pas
vitale. "Je hais les livres ; ils n'apprennent qu'à parler de
ce qu'on ne sait pas", écrivait Rousseau !
Chacun en convient. Robinson ("Heureux traité de
l'éducation naturelle", selon Jean-Jacques) sur son île a
d'autres chats à fouetter. Il se contente de la lecture
quotidienne de sa Bible, le livre qui le relie tout de même
à son ancienne vie, le livre de tous les temps et de tous
les lieux !
Cependant, dira le professeur de lettres (pardon !
aujourd'hui on parle en toute simplicité de professeur de
français), posséder une culture littéraire ouvre aux
bonheurs incestueux de l'intertextualité, aux délices
proustiennes des pastiches et mélanges, à la mise en
perspective de toutes ses lectures passées, aux frissons de
la rencontre avec un auteur, à la sublimation de sa propre
condition et à l'enrichissement (l'amendement) de ses
goûts et sensations…, bien qu'en réalité les morceaux
choisis de Lagarde et Michard et consorts, leurs
commentaires donnent de la littérature une vision bien
insipide.
Pareillement, le professeur de biologie rappellera que sa
science introduit aux secrets de la vie, démythifie,
simplifie, explique et fait s'effacer les peurs ancestrales,
51
disparaître les angoisses séculaires, s'évanouir les
croyances infondées, les superstitions affolantes…, ce qui
n'empêche pas les Créationnistes de reprendre du poil de
la bête !
L'histoire et la géographie agissent dans le même sens
d'un supplément d'existence ; savoirs "situationnels",
ils fixent notre assiette diachroniquement et
synchroniquement, permettant de comprendre le monde,
l'instant dans lequel on vit, d'avoir des perspectives,
d'ouvrir les horizons tout en se refusant à tout
dogmatisme, à tout esprit de système en relativisant tous
les savoirs, toutes les cultures, toutes les époques.
L'avenir est gros du passé et les commémorations dont on
parle tant nous rappellent les aléas de notre devenir …,
mais l'histoire qu'on racontait à l'ouest du mur de Berlin
et celle qu'on prêchait à l'Est ne se ressemblaient guère !
Les beaux-arts nous initient aux joies de l'esthétique ;
nous sommes convaincus que le beau, le to kalon sur
lequel ironisait le patriarche de Ferney, se décline de
toutes les façons possibles et que loin de s'en formaliser
ou de s'en étonner, il faut s'en réjouir : Qu'est-ce que le
beau pour un crapaud ? C'est évidemment sa crapaude !
Nous, les hommes, nous pouvons aller plus loin,
imaginer nos crapaudes !
Les mathématiques nous apprennent la rigueur,
l'abstraction, le raisonnement et annoncent le passage de
la théorie à la pratique sans lesquels il n'est pas de
progrès possible. La physique, la chimie…, mais il est
inutile de multiplier les exemples.
Soyons donc créatifs, inventifs, savants, laissons parler
cette part de notre être à laquelle la vie laisserait trop peu
la chance de s'exprimer s'il n'y avait l'École…
52
Le bien-fondé des enseignements est - en théorie -
indiscutable. Ceux qui leur dénient l'évidence d'un
surplus d'existence, d'un supplément d'âme, feraient
preuve de mauvaise foi, disent les inconditionnels de
l'École.
Pourtant, cette École, c'est aussi et surtout ce lieu où l'on
apprend ce qui est d'abord utile à une société, les
bénéfices pour l'individu paraissant plutôt faire partie des
retombées collatérales, en quelque sorte, un peu comme
dans un autre domaine la "Révolution verte" a été
propagée d'abord pour permettre aux industries de guerre
de se reconvertir dans l'agrochimie et de continuer à
engranger des bénéfices gigantesques ; les éventuelles
avancées sur le plan de l'amélioration des conditions de
vie des populations du Tiers-Monde n'étant que le leurre
lancé au public, des avancées de toute façon limitées dans
le temps et qui se sont payées par des dépendances totales
et catastrophiques pour l'avenir du monde.
L'enseignement en latin s'est d'abord fait parce que de
telles études soudaient une classe sociale et parce que le
latin était la langue de l'Église, le premier soutien des
gouvernements monarchiques et bourgeois. Une
association à bénéfices réciproques que dénonceront
certains humanistes puis les philosophes des Lumières
comme Diderot, l'abbé Raynal ou Anacharsis Cloots et
que fera éclater pour un temps trop bref la revendication
du doublement du Tiers-État lors des États Généraux, une
collusion que ne cesseront également de mettre en
lumière les penseurs socialistes ou communistes du siècle
suivant.
Lorsque la IIIe République décide - après quelques
atermoiements - de généraliser ce que la bourgeoisie des
53
fabricants et manufacturiers réclamait pour une large part
depuis longtemps, l'école obligatoire et gratuite, c'était
moins pour satisfaire aux désirs déjà anciens d'un
Condorcet, d'un Léonard Bourdon voire d'un Lakanal
que pour répondre à la demande d'une société dont les
structures économiques sont en pleine évolution.
Quand Jules Ferry créera les écoles d'arts et métiers, il ne
le fera pas parce qu'il désire ardemment que les enfants
des couches populaires obtiennent un niveau d'études
enrichissant leur existence, même pas pour leur permettre
d'accéder à tous les postes et dignités possibles et
imaginables, mais, selon ses propres paroles devant les
députés, pour fournir à l'industrie nouvelle les petits
chefs dont elle a besoin : "des sous-officiers pour
l'armée du travail"
Ainsi, le 3 mai 1883, le ministre de l'Instruction
publique vint à Vierzon poser la première pierre de
l'école primaire supérieure et professionnelle, un type
d'enseignement qu'il venait aussi de créer.
À cette occasion, il prononce un discours dont il n'est pas
inutile de citer certains passages, mais auparavant nous
rapporterons quelques paroles du.président de
l'Assemblée Nationale, Henri Brisson, ayant ouvert à
l'occasion de cette inauguration l'offensive des
"homélies" !
Après avoir rappelé tous les efforts consentis en faveur
d'une école primaire supérieure et professionnelle, qui
"serait admirablement placée à Vierzon", et rappelé
l'injustice qu'il y avait à laisser 150 000 à 200 000 jeunes
poursuivre leurs études "jusqu'à 20 ans, 22 ans, 24
ans", tandis que pour les autres, 4 à 5 millions, "la
tutelle nationale cessait à 12 ou 13 ans", il concluait en
citant l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de
54
l'esprit humain (10e époque), de Condorcet :
"On peut instruire la masse entière d'un peuple de tout
ce que chaque homme a besoin de savoir pour
l'économie domestique, pour l'administration de ses
affaires, pour le libre développement de son industrie et
de ses facultés ; pour connaître ses droits, les défendre et
les exercer ; pour être instruit de ses devoirs, pour
pouvoir les bien remplir ; pour juger ses actions et celles
des autres, d'après ses propres lumières, et n'être étranger
à aucun des sentiments élevés ou délicats qui honorent la
nature humaine… Dès lors, les habitants d'un même pays
n'étant plus distingués entre eux par l'usage d'une langue
plus grossière ou plus raffinée ; pouvant également se
gouverner par leurs propres lumières ; n'étant plus bornés
à la connaissance machinale des procédés d'un art et de
la routine d'une profession ; ne dépendant plus, ni pour
les moindres affaires, ni pour se procurer la moindre
instruction, d'hommes habiles qui les gouvernent par un
ascendant nécessaire, il doit en résulter une égalité réelle,
puisque la différence des lumières ou des talents ne peut
plus élever une barrière entre des hommes à qui leurs
sentiments, leurs idées, leur langage, permettent de
s'entendre ; dont les uns peuvent avoir le désir d'être
instruits par les autres, mais n'ont pas besoin d'être
conduits par eux ; peuvent vouloir confier aux plus
éclairés le soin de les gouverner, mais non être forcés de
le leur abandonner avec une aveugle confiance".
À ce préambule philosophique, humaniste, démocratique
ancré dans les principes de la Révolution de l'an II, la
cerise avant le gâteau, le ministre répondit avec plus de
pragmatisme et sans se soucier d'une cohérence
quelconque avec le discours de son collègue en
55
politique :
"Nous voulons essayer ici, de réaliser dans de vastes
proportions une idée que la première République a
poursuivie et caressée, qu'elle a formulée avec une
précision étonnante, et qui s'est retrouvée dans l'esprit
public toutes les fois que la démocratie a fait un pas en
avant, aussi bien après la révolution de 1830 qu'après la
révolution de 1848.
Cette pensée mère, cette préoccupation qui remonte déjà
à près d'un siècle dans notre pays, et qui voit aujourd'hui
la réalité s'ouvrir devant elle, l'idée qu'il faudrait pouvoir
graver sur le fronton de cet édifice, c'est que l'École
nationale, dans une démocratie de travailleurs comme la
nôtre, doit être essentiellement l'école du travail.
Oui, Messieurs, c'est à ce point de vue que nous avons
révolutionné l'école, nous avons commencé cette
transformation bienfaisante, et, si l'avenir nous est
donné, elle ne périclitera pas entre nos mains.
La visée suprême, le but final, la mission sociale de
l'école moderne, c'est l'éducation de cette démocratie
ouvrière qui n'est pas seulement la majorité du nombre,
mais dont les vertus laborieuses font la force du pays De
là le caractère professionnel de notre éducation primaire,
telle que les nouveaux programmes la constituent.
Je le dis bien haut, et je signale ce fait considérable aux
travailleurs qui m'écoutent, et auxquels on ne se lasse pas
de répéter que notre politique est, pour ce qui les
concerne, stérile ou indifférente, l'école primaire
d'aujourd'hui, celle que nous avons organisée d'après
l'idéal entrevu par la Révolution française, cette petite
école est, dès la première heure, professionnelle, c'est-àdire
qu'elle a pour but de préparer l'enfant à devenir,
56
comme l'immense majorité des citoyens français, un
travailleur.
Qu'est-ce que c'est, en effet, Messieurs, que ces
méthodes nouvelles que vous voyez appliquer dans
l'école ? Qu'est-ce que c'est que ces leçons de choses,
que ces musées scolaires dans lesquels l'industrie du
maître ou des élèves s'étudie à rassembler les différents
produits, soit du sol, soit les métiers locaux ? Qu'est-ce
que c'est que tout cela, sinon le commencement, la
première forme de l'enseignement professionnel, la
préparation élémentaire à la vie pratique, à la vie
laborieuse qui donne à chacun dans cette France le droit
de porter le front haut et de s'appeler citoyen ?
(…)
Ainsi se passent les années de l'école primaire, messieurs
; mais, quand l'enseignement primaire a parcouru ce
premier cercle un vide singulier et inquiétant s'ouvre
sous les pas de l'adolescent : plus d'école, plus rien entre
la douzième ou la treizième année et le commencement
de l'apprentissage.
C'est ce vide que nous voulons combler par l'école
professionnelle, et c'est un type d'école professionnelle
de cet ordre que nous voulons instituer ici ; je tiens à en
bien définir le caractère, à en limiter avec précision
l'étendue et la portée. Nous ne voulons pas créer à
Vierzon une école professionnelle qui double ou qui
copie les écoles d'arts et métiers de Chalons, d'Aix,
d'Angers. Non ; ces écoles ont un but déterminé : elles se
proposent de former des contremaîtres, des sous-officiers
pour l'armée du travail ; ici, nous voulons préparer des
soldats pour cette armée.
Ingénieurs, conducteurs de travaux, dessinateurs,
contremaîtres, ce sont les cadres du travail et de
57
l'industrie française. Ce n'est pas de cela que nous nous
préoccupons ici ; c'est de la grande masse ouvrière ellemême
; c'est le travailleur que nous voulons élever ; c'est
à lui que nous voulons donner une éducation pratique et
intellectuelle qui le rendra supérieur à sa tâche
journalière, et qui, loin de l'en dégoûter et de l'en
distraire, le rattachera à elle par un lien plus intime et
plus profond.
(…)
Ennoblir le travail manuel, messieurs, nous le voulons
aussi ; ce voeu, nous l'avons inscrit en grandes lettres
dans nos programmes. Le programme d'enseignement
moral et civique, arrêté par le conseil supérieur de
l'Instruction publique, porte un article ainsi conçu :
"Noblesse du travail manuel". Et pour que la noblesse du
travail manuel soit reconnue, non seulement de ceux qui
l'exercent, mais de la société tout entière, on a pris le
moyen le plus sûr, le seul pratique : on a placé le travail
manuel dans l'école même ! Croyez-le bien, lorsque le
rabot et la lime auront pris, à côté du compas, de la carte
géographique et du livre d'histoire, la même place, la
place d'honneur, et qu'ils seront l'objet d'un
enseignement raisonné et systématique, bien des préjugés
disparaîtront, bien des oppositions de castes
s'évanouiront, la paix sociale se préparera sur les bancs
de l'école primaire, et la concorde éclairera de son jour
radieux l'avenir de la société française.
Messieurs, l'enseignement professionnel qui sera donné
ici aura pour caractère distinctif de ne point constituer un
enseignement spécial pour une industrie quelconque : il
sera professionnel sans spécialité ; il distribuera les
principes généraux sur lesquels reposent toutes les
industries ; il associera, par exemple, les notions qui
58
président à l'industrie du fer à celles qui dirigent
l'industrie du bois. Pendant les trois ans que les jeunes
élèves de Vierzon passeront à l'école professionnelle,
entre la douzième et la seizième année, ils deviendront
sans peine - l'expérience en est faite, les programmes
arrêtés, le temps d'études fixé dès à présent -, ils
deviendront experts dans ces deux branches
fondamentales du travail manuel, le travail du fer et le
travail du bois. Et quelle sera la conséquence de cette
éducation professionnelle générale, qui ne lui donnera
pas encore un métier, mais qui le rendra capable
d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux celui
qu'il lui plaira de choisir ?
Cette conséquence est double : d'abord, il est évident que
la durée de l'apprentissage lui-même sera singulièrement
réduite, ce qui est un avantage considérable, et, en second
lieu, pendant ces trois ans d'études, l'enfant aura le temps
de faire ce qu'il ne peut pas aujourd'hui, de choisir
librement et en connaissance de cause la carrière qui lui
convient, de déterminer sa vocation. Enfin, il sera armé
contre ce danger de la spécialité mécanique, de la
division du travail à l'infini, qui est une des nécessités du
progrès industriel moderne, mais qu'il est de la sagesse
humaine, de la sagesse du gouvernement, des éducateurs
du peuple, de prévenir et d'atténuer dans ses mauvais
effets ; il pourra donc lutter contre une spécialité
tyrannique, il pourra, au besoin, changer de métier, et il
ne sera pas nécessairement attaché à l'industrie du fer,
puisqu'il sera aussi bien préparé à celle du bois.
Voilà, Messieurs, ce que je tenais à dire ici du caractère
distinctif et du but pratique de la nouvelle école. Je
n'hésite pas à déclarer que c'est une des oeuvres les plus
populaires et les plus démocratiques que l'on puisse
59
tenter en ce temps-ci - et j'ajoute que c'est une oeuvre
éminemment nationale. L'enseignement professionnel tel
que nous le voulons, nous parviendrons à l'organiser, car
nous sommes merveilleusement secondés par le
mouvement de l'esprit public. Il y a à ce sujet des chiffres
magnifiques que je veux vous signaler en passant :
l'enseignement professionnel s'est déjà associé à
l'enseignement primaire supérieur en plus d'un lieu, sur
une moindre échelle, avec un moindre luxe que dans
notre école de Vierzon ; on peut le tenir pour formé,
constitué et sérieusement établi dans 400 villages ou
chefs-lieux de cantons de France ; et depuis combien de
temps, Messieurs ? Depuis 1789. En 1789, il y avait 40
écoles primaires supérieures et professionnelles, en
France, nées un peu au hasard de la bonne volonté des
municipalités et de la spontanéité de l'esprit public ; et,
depuis 1789, sans intervenir autrement qu'en tendant la
main au bon vouloir naissant, il s'en est créé 400 sur
cette terre de France !
Messieurs, cet enseignement, qui a, comme vous le
voyez, de si profondes racines dans la nation elle-même,
répond à un double intérêt, un grand intérêt moral et
social, à un grand intérêt économique.
Messieurs, le savoir est pour l'ouvrier, sans doute, un
grand instrument de force, de puissance sur la matière,
mais c'est aussi un grand moyen d'apaisement et de
pacification : les passions anarchiques sont toutes filles
de l'ignorance. Apprendre à l'ouvrier, non seulement les
lois naturelles avec lesquelles il se joue dans l'exercice
de son métier, mais lui apprendre également la loi
sociale, lui faire voir clair dans ces phénomènes
économiques que les adversaires de la société actuelle,
qui est pourtant la plus démocratique et la plus libre des
60
sociétés, cherchent à travestir ou à obscurcir autour
d'elle, donner à l'ouvrier des notions justes sur les
problèmes sociaux, c'est en avancer beaucoup la
solution. Ce qui n'était dans d'autres temps qu'une
résignation religieuse ou sombre à des nécessités
incomprises, peut devenir, par les progrès du savoir et
l'habitude de la réflexion, une adhésion raisonnée et
volontaire à la loi naturelle des choses, adhésion qui se
rachète et se compense, en quelque sorte, par une
conception plus pratique des moyens à l'aide desquels on
peut espérer en atténuer les rigueurs.
J'ai dit enfin, Messieurs, qu'il y a dans cette affaire un
grand intérêt économique à considérer. Certes, la France
est une grande nation laborieuse : elle a remporté sur les
champs pacifiques de la libre concurrence européenne de
bien grandes victoires ! Mais tout annonce aux yeux
prévoyants qu'ici, sur d'autres champs de bataille, il
importe de ne pas s'endormir sur les victoires passées.
Nous avons, tout autour de nous, à nos portes comme audelà
de l'Atlantique, des concurrents extrêmement
redoutables dans l'ordre du travail. Ce qui nous arrive de
leurs produits, les rapports qui nous sont faits et, pardessus
tout, la concurrence que nous rencontrons sur les
marchés du dehors, nous donnent à cet égard des
avertissements qu'il ne faut pas dédaigner !
Oui, Messieurs, sur le champ de bataille industriel
comme sur l'autre, les nations peuvent tomber et périr :
sur ce champ de bataille comme sur l'autre, on peut être
surpris, on peut, par excès de confiance, par adoration de
soi-même ou par l'inertie des pouvoirs publics, perdre en
peu de temps une supériorité jusqu'alors incontestée ;
c'est à ce grand danger que doit parer l'enseignement
professionnel dans notre pays ; il n'est pas d'intérêt
61
national plus considérable, et je puis dire et répéter ici,
sans crainte d'être démenti par personne : à l'heure qu'il
est, Messieurs, relever l'atelier, c'est relever la patrie !"
Si l'on passe sur les trémolos très IIIe République, sur la
métaphore militaire, sur le fait que le ministre ne
s'adresse jamais apparemment aux (nombreuses) femmes
de l'assistance (Messieurs,…Messieurs,… !) à peu près
considérées comme les fleurs qui décorent la tribune, ce
discours pourrait être parfaitement contemporain et
concerner cette mondialisation dont on nous rebat les
oreilles.
Le ministre indique trois directions principales : d'abord,
il inscrit l'école dans une perspective générale
d'économie ("il est évident que la durée de
l'apprentissage lui-même sera singulièrement réduite"),
d'efficacité puisque l'ouvrier pourra ainsi être polyvalent
et mieux se plier à l'évolution de l'industrie ("à
l'industrie du fer, puisqu'il sera aussi bien préparé à celle
du bois") et de compétition économique internationale,
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique étant des
adversaires ("Nous avons, tout autour de nous, à nos
portes comme au-delà de l'Atlantique, des concurrents
extrêmement redoutables dans l'ordre du travail."), les
causes de la récente défaite militaire (excès de confiance,
adoration de soi-même, inertie, endormissement) devant
être éradiquées pour ne pas subir un sort semblable sur ce
terrain où les enjeux sont essentiels.
Puis, il définit l'école dans une perspective d'adéquation
des forces vives de la nation avec les réalités
économiques (et politiques) nouvelles, le tout noyé dans
un vocabulaire apparenté aux idéaux de 1789 et justifiant
ses affirmations : l'enfant est appelé à devenir avant tout
62
un serviteur, un travailleur ("Révolutionner l'école",
"l'école nationale, dans une démocratie de travailleurs
comme la nôtre, doit être essentiellement l'école du
travail", "une démocratie ouvrière", "elle a pour but
de préparer l'enfant à devenir, comme l'immense
majorité des citoyens français, un travailleur", "Qu'estce
que c'est que tout cela, sinon le commencement, la
première forme de l'enseignement professionnel, la
préparation élémentaire à la vie pratique, à la vie
laborieuse qui donne à chacun dans cette France le droit
de porter le front haut et de s'appeler citoyen ?",
"Former dès l'enfance l'homme et le citoyen, préparer
des ouvriers pour l'atelier, c'est notre tâche, et, si la
génération actuelle a le temps de la remplir, elle pourra se
coucher glorieuse dans sa tombe!")
Enfin, l'école répondrait à des impératifs de paix sociale.
L'oisiveté étant la mère de tous les maux, il ne convient
pas de laisser trop de temps libre aux classes ouvrières
qui pourraient devenir des classes dangereuses : "plus
d'école, plus rien entre la douzième ou la treizième année
et le commencement de l'apprentissage". Il ne faudrait
pas que le travailleur se laisse gagner par les appels des
"adversaires de la société actuelle (…), la plus
démocratique et la plus libre des sociétés". "C'est aussi
un grand moyen d'apaisement et de pacification : les
passions anarchiques sont toutes filles de l'ignorance."
Parallèlement, il convient de développer une morale :
"Le programme d'enseignement moral et civique, arrêté
par le conseil supérieur de l'Instruction publique, porte
un article ainsi conçu : "Noblesse du travail manuel" : "
Et pour que la noblesse du travail manuel soit reconnue,
non seulement de ceux qui l'exercent, mais (justification
suprême) de la société tout entière, on a pris le moyen le
63
plus sûr, le seul pratique : on a placé le travail manuel
dans l'école même !"
Retenons encore l'expression "fournir à l'industrie"
comme quelques dizaines d'années plus tard, il faudra
fournir de la chair à canon pour une cause qui dépasse
99% des malheureux engagés des deux côtés, mais qui
fera la fortune des Schneider, Krupp et autres capitaines
(ou chevaliers !) d'industrie ! On fait d'ailleurs appel au
même patriotisme ("ici, nous voulons préparer des
soldats pour cette armée") et le champ lexical de la
"bataille", d'une lutte quasi militaire et patriotique tisse
le texte d'un discours ponctué par La Marseillaise.
L'école primaire moderne sert donc en premier lieu à
"fournir" ou à faire du travailleur, et l'image finale de
l'ouvrier se couchant dans sa tombe avec la satisfaction
de la tâche accomplie est une trouvaille tout de même
extraordinaire qui annonce des lendemains sanglants !
Les choses n'ont guère changé de république en
république, de gouvernement de droite en gouvernement
de gauche. Ce qui hier paraissait utopie ne l'est plus par
d'habiles tours de passe-passe : on prédisait naguère 80%
d'une classe d'âge obtenant son baccalauréat. Cette année
2011, toutes sessions confondues, on a atteint les 95% !
Le ministre voulait "ennoblir le travail manuel" (une
obsession et un échec constant de toutes les
républiques !) et le couronnement de cet effort
démagogique aura été la "savonnette à vilains" que
représente le bac pro : Tu seras ouvrier, mal payé, mal
considéré, mais la République t'auras au moins donné tes
lettres de noblesse (!) : ton bac ! Ces annonces
apparemment généreuses, comme l'étaient celles des
64
ministres de la IIIe république, n'avaient rien, elles non
plus, à voir avec un altruisme foncier, mais bien avec une
demande exprimée par le monde de l'économie et de la
production, par des impératifs de sécurité publique. On a
toujours et on aura toujours besoin des sous-officiers de
l'industrie nouvelle et ces sous-off devront régimenter
l'armée des travailleurs toujours mieux formés à
accomplir les tâches qu'on attend d'eux, toujours plus
aptes à être plus finement aliénés !
Récemment, un député a cru bien faire en dénonçant
l'inutilité des épreuves de culture générale dans certains
concours de la fonction publique, ouvrant apparemment
ainsi une boîte de Pandore, car si, dans son esprit, il
s'agissait de ne plus enseigner que de l'utile, de
l'immédiatement utilisable et de ne vérifier que ces
connaissances-là, on ne peut, de toute façon s'empêcher
de s'interroger sur la "culture générale", telle qu'elle est
enseignée actuellement et qui ressemble davantage aux
questions du jeu des Mille Euros qu'à une culture
destinée à enrichir l'individu !
Au diable donc tout humanisme, toute philosophie.
Platon levait les yeux vers le ciel ; son univers était celui
des idées ; il montrait le chemin permettant de quitter la
caverne. Sans doute, avait-il tort, diront certains,
puisqu'il échangeait la contemplation des ombres célestes
contre la quête d'illusions tout comme les enfants
malhonnêtes de Babeuf, Cabet, Proudhon voire Marx ou
Bakounine croyant sincèrement qu'on allait un jour
quitter l'antre sombre dans laquelle se morfondaient les
peuples pour les douceurs des paradis communistes ou
anarchistes, faisant semblant de ne pas voir qu'on allait
65
échanger - pour une période transitoire au moins - un
type d'aliénation par un autre.
Zarathoustra en a fait l'amère expérience : même quand
dieu est mort, les hommes dans leur ensemble n'ont
aucune envie d'en tirer des conséquences. Le surhomme
nietzschéen est une espèce rare et surtout une espèce à
chaque fois menacée.
L'habitant de la caverne se contente, lui, de son sort, de
son confort précaire et il n'aime pas qu'on lui dise qu'il
se trompe. Il accepte parfois de changer de caverne, mais
c'est tout. Il reste prisonnier d'un univers carcéral, d'un
confort carcéral ! La caverne d'aujourd'hui est équipée
en ombres et images électroniques aussi fausses et
aliénantes que celles du passé. D'une cellule l'autre !
On tourne en rond ! Qui pourrait lui dire qu'il se
trompe ? Il faudrait encore un Zarathoustra, un Titan, or
Zarathoustra n'est que le héros d'une épopée
philosophique et les Titans sont prisonniers des pages de
la Théogonie d'Hésiode ! Prométhée est enchaîné à un
rocher quelque part dans le Caucase et Zarathoustra se
refuse en définitive lui-même à la pitié !
Le Maître aujourd'hui n'a rien ni d'un Titan, ni de
Zarathoustra. Il est (encore) un fonctionnaire, c'est-à-dire
qu'il contribue au fonctionnement d'un ensemble qui le
dépasse, il est un simple rouage du système économique
et social et ce système qui s'est établi dans la caverne se
moque pas mal des idées, des rêves de Platon comme des
adjurations de Zarathoustra ou des états d'âme de
l'individu en quête d'authenticité. Le maître en blouse
grise ou le jeune prof en jeans qui fait une demande pour
enseigner en ZEP ou dans un quartier difficile, sont
sincères et ils n'ont qu'un tort, croire en leur utilité
66
désintéressée, oublier qu'ils sont manipulés, utilisés,
réifiés dans leur rôle eux aussi. Dans mon enfance,
j'éprouvais un grand respect pour un missionnaire qui
revenait de temps en temps de la lointaine Afrique pour
rendre visite à sa vieille mère, une voisine. J'allais le
voir. Il me parlait de ses missions, évoquait son travail,
ses conversions. Il n'était pas rare qu'il eût la larme à
l'oeil tant le récit de ses efforts l'émouvait. J'étais touché
par tant de sincérité, par un tel don de soi, par son
émotion. Je l'admirais. Il était certainement honnête et
d'une vertu solide mon missionnaire à la grand barbe
blanche et à l'odeur de moisi, il était honnête comme un
instituteur, mais il n'empêche qu'il se trompait, comme
tous les hussards noirs de la République, il se trompait,
car - si on lui fait crédit d'une grande probité - croyant
dur comme fer qu'il sauvait les âmes de la lointaine
Afrique, il se refusait à réfléchir et à comprendre
combien il était instrumentalisé par l'idéologie coloniale!
On ne quitte ainsi pas la caverne. On l'aménage pour le
profit immédiat de quelques-uns sachant que toute
eschatologie est vaine. Toute pseudo évolution se fait
désormais intra-muros, mais rien ne change en fait. Les
ombres projetées sur le mur de la caverne paraissent de
plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, de plus
en plus denses. Une sarabande de formes, une danse
macabre, un mélange vertigineux qui donne l'illusion de
la nouveauté.
C'est hélas ! aux Maîtres d'aménager ce séjour puisque
l'imposture du chemin du haut s'est révélée, à eux de
faire passer de nouvelles illusions.
Aux Maîtres d'aménager, en effet, car eux-mêmes, sontils
capables de voir plus loin que ce pour quoi on les a
formés ?
67
Donc…
L'École est-elle émancipatrice, libératrice, formatrice au
sens noble que ce terme pourrait avoir ou n'est-elle qu'un
institut de formatage (on a inventé il y a 20 ans les IUFM
= Instituts Universitaires de Formatage des Maîtres ! On
ne pouvait trouver mieux !), une fabrique de clones, un
lieu de dépersonnalisation et d'uniformisation ? Et ce
Maître alors, est-il encore l'éveilleur qu'il a cru parfois
être ou qu'on a voulu voir en lui ? Est-il tout simplement
un de ces chiens de garde qu'un célèbre pamphlet
dénonçait dans les années trente, un manipulateur par
force, voire un maton par goût ?
Avant de répondre à ces graves questions, je vous invite à
un petit excursus dans le temps. Qu'a été l'école aux
époques passées ? Comment a-t-elle évolué ? Quelles en
ont été les objectifs constants et les nouveautés ?
Il n'est pas question ici de recommencer ce que d'autres
ont très bien fait en racontant l'histoire de l'enseignement
et je prierai mon lecteur de se référer à la bibliographie
en fin d'ouvrage si le rapide survol que je lui propose le
laisse un peu sur sa faim. Il ne sera pas non plus question
d'entrer dans le détail des enseignements et des
méthodes. Je me contenterai d'insister davantage sur
l'enseignement des lettres moins parce que cet
enseignement est supposé être potentiellement formateur
au sens noble du mot, mais surtout parce que mes
quarante années de prof de lettres ont forcément fait
pousser des oeillères dont il m'est impossible de faire
abstraction. Midas sur un autre plan sans doute.
68
69
II. L'École, une institution mise en place par les
puissants pour les puissants (les puissances en
place)
ou
Comment les tenants ou les représentants d'un système
décident de faire entrer dans les têtes des enfants des
principes utiles à leurs projets.
70
71
Il était une fois…
Avant ce bon Charlemagne, l'inventeur putatif et
mythique de l' "école", l'enseignement, lorsqu'il est
dispensé, est entièrement entre les mains du clergé qui
organise des écoles à vocation essentiellement
"professionnelles". Dès le VIIe s., voire plus tôt, cet
enseignement se décline de trois façons principales.
Les écoles monastiques qui n'existent que pour
l'accueil et la formation des futurs clercs,
Les écoles épiscopales ou cathédrales dans lesquelles
se trouvent en particulier manécanteries et petits
séminaires,
Les écoles presbytérales ou paroissiales qui ont pour
mission d'assurer la succession des prêtres.
Il est bien entendu qu'il n'existe pas d'organisation
générale et que chacun de ces trois types d'école
fonctionne à vue, de même qu'à l'intérieur de chaque
classe - si l'on peut dire - règne la diversité la plus
joyeuse.
Pourtant, un point commun : toutes ces institutions ont
une finalité qu'elles sont allées chercher en dehors de
préoccupations purement pédagogiques. L'école est là
pour permettre à de rares individus d'assurer un rôle
social, pour les intégrer à un système dont la clé de voûte
est l'Église et son omnipotence, pour qu'un jour ils soient
à même - à leur tour - de participer et de faire
fonctionner ce système. On n'apprend pas - quand on
apprend ! - pour accroître son savoir ou "s'épanouir",
72
on apprend pour s' "imbriquer" dans un monde qui
préexiste et qui doit se maintenir. On fait des moines, des
abbés et des curés parce que l'Église domine la société et
entend pérenniser sa puissance, parce que Dieu est la
figure masculine par excellence et que les cadres de cette
théocratie ne peuvent être que des hommes.
Les méthodes utilisées par les maîtres sont en rapport
avec la rigueur des existences : un principe, la sévérité,
particulièrement envers les adolescents, qui s'éveillent à
toutes ces concupiscences qu'il convient de réprimer ou
de voiler, car elles risquent d'aller contre l'ordre établi.
En revanche, les enfants subissent moins les foudres des
maîtres. On leur laisse plus volontiers la bride sur le cou
puisqu'ils sont si près de l'innocence angélique. Avec
mesure, cela s'entend !
On pratique le plus souvent une pédagogie par l'image
(prédication muette) car ce n'est pas d'hier qu'on sait
déjà l'impact de l'iconographie ; l'apprentissage du latin
(la langue de LA caste) est la principale activité dans le
secondaire et le supérieur (glossaires et copiage); les
élèves ne bénéficient d'aucune formation littéraire : on
insiste seulement sur la grammaire dont le caractère
apparemment indiscutable prévient toute échappée de
l'imaginaire. Quelques autres enseignements complètent
cette formation : les Écritures, un peu d'arithmétiques,
quelques rudiments de botanique et d'astronomie,
quelques savoirs manuels jugés nécessaires…Certes, de
rares intellectuels dans la lignée de Cassiodore de Sicile
au VI e s. poursuivent, rapporte-t-on, la tradition littéraire
de l'Antiquité davantage dirigée vers la réflexion et
l'échange, mais ils sont l'exception et les endroits où ils
enseignent réservés à une élite.
73
À partir de ce que certains historiens appellent la
Renaissance carolingienne (mais chaque période
historique, si l'on y réfléchit bien, voit plusieurs
"renaissances" : le terme est un peu galvaudé) on
constate une petite ouverture à ces études littéraires
négligées, sous l'influence d'Alcuin (735-804) dans de
nombreuses écoles épiscopales et monastiques, mais
encore une fois, ces évolutions ne se font qu'à doses
homéopathiques et ne profitent qu'à bien peu de
bénéficiaires. L'école tant vantée de Charlemagne,
l'École du Palais, n'est qu'une sorte d'Académie
ambulante fréquentée par de jeunes patriciens ayant passé
par le préceptorat ou l'école épiscopale. Rien à voir avec
la Communale !
Sept arts dits libéraux vont structurer l'enseignement
secondaire comme l'enseignement supérieur et se
divisent en deux valences :
- Le trivium, ou arts philologiques, correspond aux
lettres (grammaire, rhétorique et dialectique), un
enseignement qui préfigure ce qui se fera dans les
collèges de l'Ancien Régime avec l'importance
accordée aux lectio et disputatio.
- Le quadrivium (arts des nombres) qui regroupe ce
qu'on appellerait aujourd'hui les matières
scientifiques : arithmétique, géométrie, astronomie,
musique.
Dans les écoles épiscopales, on enseigne parfois le
trivium en insistant particulièrement sur la grammaire,
car on pense alors que les catégories grammaticales sont
le pendant des catégories logiques : le nom et l'adjectif
définissent la substance et l'attribut. Le maître lit (lectio)
et commente en latin ce qu'il a lu, s'appuyant le plus
74
souvent sur les inscriptions ou gloses en marge des livres,
gloses qui sont de son fait ou l'héritage d'un professeur
précédent.
Dans les villes, l'Église commence à créer des écoles
pour enfants pauvres, mais il faudra attendre le Concile
du Latran (1179-1215) pour qu'on donne dans presque
chaque cathédrale des cours à quelques nécessiteux. Là
encore, le peu d'enfants touchés par cet enseignement est
destiné à la sphère ecclésiale. L'Église se constitue le
vivier dont elle a besoin. L'enrichissement personnel,
l'acquisition d'une culture qui serait le bien propre de
l'individu est quasiment inimaginable.
Et l'Université fut
Un fait important cependant, c'est que vers la fin du XIIe
et le début du XIIIe siècle apparaissent les corporations
enseignantes. Le terme devient d'ailleurs officiel en
1262. Ces corporations commencent à échapper en partie
au contrôle de l'évêque, mais c'est pour tomber de
Charybde en Scylla : elles sont immédiatement la cible
des puissances laïques comme la monarchie française
dont les contours se dessinent au sein d'une féodalité
encore bien vivante, un État qui a de plus en plus besoin
de juristes, d'architectes, d'ingénieurs, de médecins,
moins d'intellectuels que de praticiens, dirions-nous pour
oser un anachronisme.
Un peu plus tôt, à Paris, plusieurs écoles monastiques (St
75
Germain, Ste Geneviève, St Victor et l'école épiscopale
de l'Ile St Louis) forment le berceau de l'université au
sein du Quartier Latin, avec des maîtres prestigieux
comme le malheureux et valeureux Abélard (1079-1142).
De nombreuses écoles particulières ouvrent aussi.
Les maîtres sont masculins, le plus souvent
ecclésiastiques mais, ce qui est nouveau, parfois laïcs.
Comme les élèves, ils doivent être cependant catholiques
et restent ainsi plus ou moins directement sous le contrôle
de l'Église.
En ces années qui voient une timide émancipation de
l'institution scolaire supérieure et universitaire, il n'existe
pas d'édifice particulier. Un tel pas est encore
inconcevable. On se regroupe en hospita (Collège des
Dix-Huit). Ces collèges se développent (bibliothèque,
salles particulières...) La maison de la Sorbonne (Robert
de Sorbon, 1257) est un collège qui héberge 16 étudiants
qui, petit à petit, reçoivent un enseignement dans le lieu
qui prendra le même nom.
En outre, les universités sont d'abord européennes avant
d'être nationales, ce qui se comprend puisque le concept
même d'état ou de nation en est à ses premiers
balbutiements. L'université de Paris est ainsi divisée en
quatre nations: France, Normandie, Picardie, Angleterre.
Le privilégié fait sa théologie à Bologne, sa médecine à
Montpellier ou Salente....
L'Université enfin est différenciée sur le plan des
enseignements : à Paris, elle compte ainsi quatre facultés
(arts, théologie, droit et médecine au milieu du XIIIe s.).
La faculté des arts constitue une sorte de propédeutique
et les trois autres ont une vocation professionnelle. Le
droit et la médecine sont davantage tournés vers le
76
monde, mais de nombreux médecins par exemple sont
liés à l'Église. L'université, comme l'école, conforte le
système en place, qu'il soit laïc ou ecclésial.
La faculté des arts délivre:
- la déterminance (14-16 ans) octroyée par les Nations
après une dispute publique qui devient le baccalauréat au
XVes.)
- la licence (au moins 21 ans et 6 ans d'études) est un
examen passé devant jury et comprend lui aussi une
dispute)
- la maîtrise ès arts qui sera plus tard le doctorat.
L'essentiel de l'enseignement est basé sur la logique et la
grammaire (le formalisme grammatical est un jeu
intellectuel qui ne dérange personne et surtout pas
l'Église) Pour le reste, on débat de thèmes religieux et
philosophiques comme déjà au XIIe siècle avec la
controverse des universaux animée par Abélard dont la
dialectique tentait de concilier foi et raison. On ne
pouvait être plus…conciliant. Pascal s'en souviendra.
L'intention était philosophiquement noble, mais le
glissement Foi/Église-Raison/État aisé et par là même
l'union des deux puissances pour le plus malheur de la
majorité !
En 1280, on compte cent vingt enseignants, à la faculté
des arts contre trente pour les autres.
Le nombre d'étudiants rapporté à la population globale
est infime. Au début du XVe s. Paris compte 3500
étudiants dont 10 à 15% d'étrangers.
La fin du Moyen Âge est marquée par la rigidité des
organisations et de l'enseignement scolastique, une
rigidité dont Rabelais a donné l'image comique pour
mieux mettre en valeur le renouvellement pédagogique
77
auquel il croit et qui a déjà commencé dans certains
collèges bien avant que Pantagruel et son fils ne voient le
jour. Une éducation primaire au sens où nous l'entendons
est inexistante.
Jusqu'à la Renaissance, l'enseignement - à l'école ou
dans les Universités - reste ainsi marqué par la présence
de l'Église, directement ou indirectement. Si on étudie
d'abord pour intégrer l'Église et pour la servir,
l'évolution politique et sociale entraîne cependant des
changements modérés. La formation d'un État centralisé,
une aristocratie plus avide de connaissances qui la
cimentent, la prise en compte de la bourgeoisie des villes
impliquent le développement de nouvelles compétences
et de nouveaux savoirs, mais, dans tous les cas, c'est
cette évolution qui crée l'instrument - à son service -, et
non pas l'inverse : l' "école" au sens large n'a
jusqu'alors jamais existé que pour entériner, formaliser
les résultats d'une gestation sociale et politique lente, une
réglementation après-coup, le soutien d'une situation
nouvelle.
L'Église et l'État s'appuient certes l'un sur l'autre (la
première fournit la plupart du temps les cadres au
second), mais l'école reste pour longtemps aux mains de
l'Église, une Église de plus en plus "gallicane" il est
vrai, c'est-à-dire ayant reconnu le primat de l'État, et,
lorsqu'une nouvelle Église tentera sa chance, le pouvoir,
qui y verra une menace, l'écrasera au bénéfice de sa
vieille alliée. Un roi, une foi, une loi. L'école sert une
noble cause : dieu, le roi, la religion. Ajoutons le
renouvellement des cadres et l'ordre intérieur,
78
immuable ! On tourne en rond. Toute échappée est
condamnée et l'affaire Galilée par exemple dépasse le cas
d'espèce, la mise en question de la cosmologie officielle :
il est d'abord celui qui s'attaque à l' "ordre" établi,
crime parmi les crimes ! On se contente d'interdire
(violemment !) ce qui gêne et de chercher dans le passé
les justifications du présent : Aristote puis Platon en
odeur de sainteté…
Comme larrons en foire, on s'entend bien sûr et pour des
siècles. Helvétius fera encore scandale en plein XVIIIe
siècle en dénonçant, après quelques autres, cette
association à bénéfices réciproques et lorsque
Robespierre s'opposera à la vague de déchristianisation
qui menace de se transformer en raz-de-marée, son
opposant Anacharsis Cloots lancera ce cri : "Gare le
Piège ! Hommes libres, on voudrait fixer vos yeux vers le
ciel, pour vous jouer quelque mauvais tour", une
constatation ou un avertissement valable pour tous les
temps et en tous les lieux du globe !
Essor de l'enseignement secondaire sous
l'Ancien Régime.
L'évolution des XVI e et XVIIe s. poursuit ce modèle
malgré les apparences et les voeux pieux des humanistes.
Le monde s'ouvre, l'image qu'on en a évolue et le vieux
cadre dans lequel a vécu le monde éclate et fait place à de
nouvelles vues. Cette évolution d'abord technique puis
intellectuelle, politique, les difficultés auxquelles est
confrontée l'Église romaine impliquent une rénovation
pédagogique.
L'honnête homme de la Renaissance a de nouveaux
79
besoins face au savoir : pour rompre avec des traditions
qui ont fait leur temps, le rapport au livre et au texte
(ancien) doit changer. Un formalisme littéraire remplace
le formalisme logique jusqu'alors en vigueur. On cherche
à mettre en valeur les aspects esthétiques ou moraux
d'une pensée plus que l'enchaînement des arguments.
Dans un monde qui voit se déliter la puissance de
l'Église et se renforcer le rôle des États, des
commerçants, des banquiers, de l'argent et des échanges
économiques et techniques, un nouveau code se dessine,
se moule dans l'ancien, celui de l'éthique et du bon goût
commun de quelques-uns. D'autre part, face à une Église
qui a confisqué, expurgé, commenté les textes de
l'Antiquité, l'humaniste désire remonter aux sources,
consulter les originaux. Le livre imprimé, enfin,
commence à se répandre.
Une nouvelle société chercherait à définir de nouvelles
bases culturelles correspondant davantage à un monde
qui se découvre d'autres centres d'intérêt et la nécessité
d'accorder un droit à l'éducation à davantage de
privilégiés, mais les anciennes habitudes, la routine ne
disparaissent pas du jour au lendemain. L' "école" va
alors être chargée de peaufiner, d'organiser ce qui est
déjà en gestation, mais si elle reste entre les mains de
l'Église, c'est d'une Église qui, confrontée à cette
évolution, poussée par les événements de la Réforme,
doit évoluer, en apparence au moins. C'est en tout cas
dans les pays catholiques le grand apport des Jésuites
dont le général siège à Rome. Ceci dit, le déroulement de
l'enseignement de ces derniers n'évoluera quasiment pas
pendant deux siècles. Si l'accent était particulièrement
mis sur la religion et la formation morale, une partie du
programme était marquée par l'humanisme. On étudiait
80
les auteurs de l'Antiquité dans le texte (expurgés, choisis)
et, pendant plusieurs années, les élèves pouvaient
s'imprégner d'une pensée et d'une philosophie nonchrétienne,
ce qui explique pour une part que des
sceptiques comme Voltaire ou Helvétius aient gardé un
excellent souvenir de leurs études. En outre, les jésuites
organisaient des discussions, des conférences publiques,
des représentations théâtrales qui développaient les
capacités des enfants qu'on leur confiait. Ils mettaient
tout en oeuvre pour inculquer les règles du discours et de
l'expression des idées. Enfin, des cours de métaphysique,
d'éthique et de logique étaient organisés à partir de
passages extraits principalement d'Aristote et de certains
philosophes scolastiques.
Cependant,
L'essor économique de la bourgeoisie au XVIIe et surtout
au XVIIIe s. impliquera naturellement un renouvellement
des valeurs éducatives: un enseignement secondaire
ouvert sur la vie et des programmes réalistes répondant
au développement économique et technologique tout en
prenant en compte une certaine mobilité sociale. Les
jésuites se verront reprocher de négliger les sciences, ce
"moteur du progrès", de pratiquer un enseignement
beaucoup trop théorique et peu apte à préparer les
individus à la vie. Une majorité des anciens élèves des
jésuites s'élèvent contre l'enseignement du latin
considéré comme désormais inutile à une société
moderne : la critique ira en s'accroissant et, au XVIIIe
siècle, Maubert de Gouvest consacre un ouvrage entier à
argumenter sur ce thème et il n'est ni le seul ni le
premier. L'Émile peut être lu sous un certain angle
comme un contre-modèle. Il paraît d'ailleurs l'année
suivant le départ des jésuites de France !
81
Les Oratoriens tiendront davantage compte de cet
environnement nouveau, ce qui expliquera leur succès
jusqu'à la Révolution : ils sauront mieux se positionner
par rapport à un monde en pleine transformation
intellectuelle, technique et économique.
L'idée se fait que l'enseignement secondaire aura pour
tâche de former cette bourgeoisie (grande et petite) qui
doit accompagner l'évolution économique.
Notons bien que pendant toute cette période, un
enseignement primaire de masse est encore impensable
quand la majorité de la population va exactement sur les
brisées de la génération précédente et ne fait que
reproduire le modèle existant. Le paysan prolongera la
routine dans laquelle vivent ses parents, même si
quelques progrès dans l'alphabétisation doivent être
signalés - surtout pour les garçons et de façon nullement
linéaire. Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), chanoine
de Reims (1666-1683), crée l'Institut des Frères des
Écoles chrétiennes, voués à l'éducation chrétienne des
"enfants des artisans et des pauvres"," mais il ne
touche que peu d'enfants et à sa mort, en 1719, l'Institut
compte 120 Frères établis en 22 villes, d'autres
congrégations toucheront aussi peu d'enfants et les
petites écoles végètent jusqu'à la Révolution et
fonctionnent de manières très diverses. En outre, le
paysan a besoin de ses enfants pour l'aider dans son
travail et il sait qu'un supplément d'éducation ne
mènerait qu'à des difficultés, quasiment jamais à une
amélioration du sort de ses enfants (les Mémoires de
Marmontel sont intéressantes à ce sujet). En outre, ceux
qui avaient appris à lire dans les campagnes n'utilisaient
le plus souvent leur savoir que pour lire ce qui était en
82
rapport étroit avec leur travail. La petite école n'avait que
cet usage, même si les exemples contraires d'enfants de
petite extraction parvenant à des études secondaires
tendent à nuancer cette constatation : une proportion
importante de la République des Lettres au XVIIIe siècle
est d'origine très modeste, mais, toute proportion gardée
(Le portrait du "Pauvre Diable" que nous a légué
Voltaire en témoigne), l'éducation reçue a
essentiellement valeur de "savonnette à vilain".
Les ordonnances de Louis XIV en 1695 et en 1698, de la
Régence en 1719 et de Louis XV en 1724 prescrivant la
fréquentation des écoles et le paiement du traitement du
maître (souvent évoquées) ne changent rien, car
beaucoup de communes n'ont pas les moyens de cette
politique et ces ordonnances venant après la Révocation
poursuivent en réalité la même politique : l'école comme
moyen de conversion ; elles n'ont que peu à voir avec des
visées éducatives dignes de ce nom.
Le pouvoir royal n'a pas de politique scolaire et les "petites
écoles" à la campagne, sont le fait" d'initiatives locales ou
privées : l'assemblée des habitants d'une paroisse, un bienfaiteur…
Dans les villes, les petites écoles sont parfois initiées par la
municipalité, mais le plus souvent par des communautés dévotes
ou des particuliers.
L'enseignement dans ces écoles primaires est laissé aux bons soins
de ses organisateurs et elles sont quasiment seulement fréquentées
par les garçons. Une grange, le logis du maître, le porche de
l'église tiennent lieu le plus souvent de salle de classe. Trois
enseignements essentiels sont dispensés : l'éducation religieuse,
l'instruction scolaire (lire et compter) et des préceptes de civilité.
Cet enseignement est gratuit pour les familles les plus pauvres,
mais rares sont les familles qui peuvent se permettre de renoncer
au travail des enfants en les scolarisant vraiment même seulement
quelques années. L'analphabétisme, recule au XVIIe-XVIIIe siècle,
mais il reste très important : en 1686-1690, 28 % des hommes
83
signent, contre 14 % des femmes ; peu avant la Révolution, on
passe à 47 % et 26 %. Le Nord et le Nord-est de la France sont
davantage alphabétisés que le Sud.
L'enseignement secondaire réservé à la frange privilégiée
de la population reste fondamentalement marqué par la
puissance de l'Église. Le recteur de l'Université de Paris,
Charles Rollin, l'auteur du Traité des études qui fit
souffrir des générations d'élèves, défendra certes
l'éducation humaniste, mais il ne la conçoit que liée à
une solide éducation religieuse. Sa conception est
essentiellement morale. Le but de l'éducation, dit-il, est
l'amélioration de l'homme, mais cette amélioration n'est
conçue qu'en fonction des exigences chrétiennes voire de
l'eschatologie. De bons maîtres n'accordent de l'intérêt
aux sciences que dans la mesure où elles mènent à ce but.
Un honnête homme est préférable à un homme instruit,
mais il est impossible de former un honnête homme sans
s'appuyer sur la religion et celle-ci doit demeurer le
début et la fin de l'enseignement.
Il est évident que cette question des rapports entre la
morale et la religion allait être la tasse de thé (ou de
chocolat) de tous les philosophes au cours du siècle et
plus tard.
*
Tous les élèves apprennent (ou apprenaient) que la partie
de bras de fer entamée en France dès la Renaissance entre
l'Église, les pouvoirs et les partisans d'une plus grande
liberté de pensée atteint un sommet à l'époque de la
fameuse querelle du Tartuffe et qu'un des conflits les plus
importants du XVIIIe siècle en France est celui qui se
déchaînera à propos de l'enseignement, l'Église désirant
84
conserver son monopole et les philosophes cherchant à
l'abolir, car le jeu en vaut la chandelle : tout le monde est
d'accord là-dessus !
Le renvoi des jésuites en 1762 marque l'acmé de cette
querelle. En apparence Aristote indiquant la terre
l'emporte sur Platon montrant le ciel. En apparence
seulement. L'Église (gallicane), force à la fois séculière
et spirituelle, représentante de l'ordre divin sur terre et
immensément possessionnée, monstre multicéphale a pu
supporter sans problème la disparition des jésuites ces
ultramontains souvent détestés ; elle voit dans
l'enseignement l'instrument par excellence lui assurant sa
prédominance dans ces deux domaines ; les philosophes
- pour la plupart - en veulent à cette puissance séculière
de l'Église qui met un frein au développement d'abord
économique puis intellectuel, car elle n'a pas intérêt à ce
que les choses changent vraiment. Le nombre de jours
chômés en raison de telle ou telle fête religieuse dépasse
quasiment le nombre de jours où le travail est permis ! La
production en souffre, pas les revenus du clergé ! À
l'image de Voltaire, les philosophes cependant ne veulent
pas, à de rares exceptions, la supprimer mais simplement
briser sa superbe, la renvoyer à des obligations qu'ils
jugent premières, le soin des âmes, l'eschatologie, le
contrôle de la morale des petites gens. Chacun sait dans
les salons que la canaille a besoin de religion et qu'une
société prospère et ordonnée se doit d'avoir une Église.
Relisons Voltaire ! Que celle-ci soit catholique ou
protestante, peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle
existe et apprenne à la populace à bien se tenir pour
mériter le paradis. La récompense viendra. Patience ! Au
grand jour du jugement dernier, les premiers seront les
derniers et les derniers les premiers ! On n'exclut certes
85
pas une évolution, mais ce sera pour dans très, très
longtemps. Peut-être qu'alors, aux calendes grecques, on
pourra rediscuter la place et l'importance de cette
Église…
Quelques dates
- Collège de France, 1530
- Édit de Villers Cotterêt, 1539
- Concile de Trente (1545-63) Chaque église devrait entretenir une
petite école dont le maître sera choisi par l'évêque.
- 1er collège jésuite à Paris 1551 (Collège de Clermont qui devient
Louis-Le-Grand en 1683).
- Édit de Nantes, 1598. Le roi nomme une commission pour
élaborer les statuts de l'Université de Paris : "à prier le roi trèschrétien,
à lui être soumis, et à obéir aux magistrats".
- Oratoriens à Dieppe en 1614
- Petites écoles de Port Royal 1637. Richelieu et la langue
française : Académie, dictionnaire de l'Académie.
- Sous Louis XIV : succès des Jésuites et répression des Oratoriens
(soupçonnés de jansénisme) et suppression des écoles protestantes,
des académies protestantes en 1685.
- Enseignement primaire gratuit proposé en de nombreuses villes
par les Frères de St Jean Baptiste de la Salle.
- Au XVIIIe s. tendance à séculariser l'enseignement secondaire et
fin des discriminations religieuses en 1787. L'intendant intervient
auprès des évêques dans la vie des petites écoles.
- Expulsion des Jésuites en 1762
- Rousseau publie L'Émile en 1762 : l'épisode du Vicaire Savoyard
déchaîne certes les passions, mais qu'un laïc, un Protestant se fasse
pédagogue paraît à l'Église être une provocation autrement
insoutenable alors que le combat entre théologiens et philosophes
n'a jamais été aussi dur. Ceci d'autant plus que contrôler
l'éducation, c'est bien sûr contrôler sinon les âmes au moins les
esprits !
- Écoles techniques et militaires.
- La Chalotais publie son Essai d'éducation nationale (1762),
Guyton de Morveau son Mémoire sur l'éducation publique (1764)
et Maubert de Gouvest sa critique Le temps perdu ou les Écoles
86
publiques (1765).
- Concours d'agrégation (1766)
- Idée d'un ministère de l'instruction publique avec Turgot qui
considère qu'on manque d'ingénieurs. Une réflexion qui est reprise
par de nombreux philosophes. La société civile commence à
réclamer une école qui soit au service de la société moderne. En
arrière-fond bien entendu, la certitude que progrès matériel et
progrès moral sont liés. Faire des ingénieurs, c'est accélérer le
progrès, ce progrès dont tous les hommes profiteront !
Enfin la Révolution se fit !
On ne trouve pas d'écho d'une problématique scolaire
dans les Cahiers de Doléance si ce n'est que le clergé
cherche à renforcer ses prérogatives en ce domaine. On
en est encore à des objections d'ordre moral contre
l'instruction populaire. On souhaite à la rigueur des
formations pratiques (sages-femmes, hydrographes,
militaires, des formations professionnelles…). La
Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen sera
d'ailleurs étrangement muette à ce sujet !
L'action en faveur de l'école sous la Révolution est
inséparable des leçons des philosophes d'une part (bien
commun, progrès, réalisme des apprentissages en vue de
ce bien commun) et de l'attitude face au clergé d'autre
part.
On peut distinguer plusieurs phases avec pour point de
départ l'abolition du monopole du clergé :
- surveillance par les pouvoirs civils en 1789 des
87
écoles existantes.
- 2 novembre 1789, les biens du clergé sont désormais
à la disposition de la nation et, en 1790, la
Constitution civile du Clergé est adoptée
- Avec la Constitution de 1791 apparaît une grande
nouveauté : "Il sera créé une instruction publique
commune à tous les citoyens", proclame-t-on. Mais
ce futur de l'indicatif reste bien hypothétique, la
France va entrer en guerre, la conscription de masse
va s'imposer. On pensera à l'éducation plus tard… si
on a le temps !
- Le 18 août 1792, les congrégations sont interdites et
avec cette interdiction, l'enseignement ou ce qu'il en
reste en cette période troublée est forcément
sécularisé. Notons que cette sécularisation ressemble
assez à la disparition des jésuites en 1762. Quelques
maîtres choisissent l'émigration, la plupart prennent
l'habit laïc : il faut bien vivre. Les contenus
d'enseignement et les méthodes n'évoluent
évidemment guère : on sait que l'habit ne fait pas le
moine !
- Le 8 mars 1793 les biens des congrégations sont mis
en vente.
- Pendant l'été 1793 on décide de supprimer les
académies, les écoles militaires, les universités car
symboles d'un passé aboli.
- Le 15 septembre 1793 un décret abolit les collèges de
l'Ancien Régime et établit 3 degrés d'éducation.
* Beaucoup d'idées… sans suites (1789-1794)
88
La question de l'éducation est certes posée dès la
Constituante comme sous la Législative mais celles-ci ne
proposent aucun texte de loi.
Il est évident que l'éducation représente un enjeu qui
apparaît à tous essentiel et la Constitution de l'an I
affirme qu' "il sera créé et organisé une instruction
publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard
des parties de l'enseignement indispensables pour tous
les hommes (…)" mais elle ne va pas plus loin et on
reste tout de même très peu précis sur ces "parties de
l'enseignement indispensables à tous les hommes" !
Notons qu'on parle désormais d'Instruction publique et
cette expression comme l'apprend l'étymologie signifie
qu'il s'agit d'équiper, de munir voire d'armer. Les
connotations militaires du substantif sont à peine voilées
("L'instruction de la jeune recrue"). L'adjectif, en
revanche, provoque d'indéniables échos démocratiques.
L'instruction publique permettrait à tous les citoyens
d'acquérir les connaissances indispensables pour intégrer
la société nouvelle, pour y tenir leur place. Mais quelle
place ?
La création d'un Comité d'Instruction Publique (octobre
1791) comme il existera un Comité de Salut Public, qui
se réunira régulièrement sous la Législative et la
Convention obéit aussi à un principe qui paraît évident.
La Révolution marque, dans l'esprit de ses propagateurs,
le début d'un renouveau, d'une régénération et l'École -
qui est en gros imaginée sur le modèle des établissements
de l'ancien régime - devrait paradoxalement y contribuer.
Le Comité est certes entièrement favorable à toute
mesure qui diminue le pouvoir de l'Église, avec pour
objectif une éducation citoyenne susceptible de rendre
89
inutile dans le futur toute religion, mais rien de concret
n'est proposé.
Si les assemblées restent dans le vague, les projets
d'éducation sont particulièrement nombreux : des
ecclésiastiques (Corbin, Delas, Paris, Villiers, Auger,
Daunou…), ou des laïcs comme J.-J. Mounier, J.-J.
Bachelier, Lacépède, Bourdon…, en rédigent et les
journaux s'en font l'écho. Pourtant, ces projets euxmêmes
vont davantage dans le sens d'une adaptation à
une époque conçue comme nouvelle qu'à un véritable
nouveau départ, une régénération dont les principes
resteraient à fixer.
Régénérer la Nation par l'Éducation soulève de toute
façon bien des problèmes, car si tout le monde pense
qu'il faut révolutionner la pensée, personne ne sait
comment. Certains esprits avancés comme Anacharsis
Cloots considèrent dès 1791 qu'une véritable renaissance
n'est possible qu'en l'ancrant dans le peuple parce que ce
peuple forme la partie la plus nombreuse de la société et
qu'il a été le moins contaminé par les habitudes de
l'Ancien Régime, si ce n'est par la religion. Ces hommes
pensent qu'il faudra patienter et que l'esprit ancien ne
sera définitivement extirpé que dans l'esprit des
générations futures. Que faire en attendant ? Comment
trouver les maîtres susceptibles d'assurer la transition ?
De par leurs études, leurs biographies, ils appartiennent à
ce passé abhorré et il n'est pas possible qu'ils échappent,
en dépit de leur bonne volonté et de leur foi
révolutionnaire, à ce qui les a formés. Pourtant, on a
besoin d'eux, dans cette phase de transition et, lorsque la
République sera proclamée, Anacharsis pensera que cela
90
ne sera possible qu'en créant un véritable service public
d'enseignement susceptible de former des hommes
nouveaux, un service public, écho des préoccupations
populaires, de "la partie saine de la Nation", ayant
défini un programme que les maîtres appliqueront.
Mais ces réflexions radicales de quelques-uns resteront
simple matière de discussion, sujets d'entretiens et de
polémiques au Comité d'éducation ou dans les couloirs
de l'Assemblée, car l'heure est à des préoccupations qui
paraissent plus urgentes avec cette coalisation des
puissances, l'agitation antirévolutionnaire qui trouble de
nombreuses campagnes et provinces, la chouannerie…
On s'en tiendra donc à des projets plus sages et plus
immédiatement réalisables.
Talleyrand (1754-1836) présente un projet à la
Constituante en septembre 1791. Sa ligne de pensée se
résume en quelques mots : apprendre à vivre heureux et
utile.
Ces deux derniers adjectifs sont importants, car, dans le
fond, ils paraissent représenter la finalité bien comprise
de toute éducation. Être utile parce que l'individu
appartient à une communauté, à une société et son action
s'inscrit dans un vaste contrat social dont il sera à la fois
une des chevilles ouvrières et un des bénéficiaires ; être
heureux parce que depuis les maîtres de l'Antiquité, on
ne peut l'être sans le Savoir : se connaître soi-même,
connaître son environnement et ses origines, penser par
soi-même, être libre…
En même temps ces deux termes peuvent paraître
tautologiques, car il est clair que dans une société
constituée et régénérée, l'individu ne peut être heureux
sans être utile. Dans l'esprit de Talleyrand et de nombre
91
de ses contemporains des Lumières bonheur et utilité
sont indissociables : il y a du bonheur à se rendre utile et
la certitude de son utilité est source de bonheur. Pourtant,
ces deux termes restent nimbés d'un flou sémantique
important car d'autres courants - la vague préromantique
s'enfle en cette période dramatique - rapportent
davantage la notion de bonheur à la subjectivité de l'être.
De toute façon, si l'utilité fait à première vue davantage
partie de la sphère sociale, personne ne nie qu'elle n'en
possède pas moins aussi une dimension spirituelle. En
effet, qui est utile? Celui qui produit des objets
manufacturés ? Celui qui travaille dans les champs ?
Celui qui écrit des poèmes ? Celui qui parle ou celui qui
se tait ? L'ouvrier, le paysan, le banquier ou l'artiste ?
Ce sera au législateur de préciser ce qu'il entend. Or, ce
projet reste très discret sur tous ces points, donnant
seulement la priorité à l'organisation d'un enseignement
public comme si le cadre, la forme devait conditionner
les contenus. Apprendre à vivre heureux et utile, paraît
donc être davantage une clause, un slogan qui résume les
aspirations des Lumières. Ceci dit, ce préambule énoncé,
Talleyrand passe aux choses sérieuses et esquisse les
contours de l'éducation telle qu'il l'entend.
*L'Éducation générale (écoles primaires) serait du ressort
du canton. Elle devrait être gratuite (au canton de payer !)
et fournir aux enfants les rudiments nécessaires pour
savoir lire, écrire et calculer. Quelques connaissances de
la géographie du département s'y ajouteraient et bien sûr
les enseignements parallèles de la religion et de la morale
civique et civile. L'accent est mis sur l'apprentissage du
français pour faire reculer "les patois" synonymes
d'ignorance, d'arriération et de particularisme. La
Révolution doit en effet supprimer tout ce qui risque de
92
fragmenter la société : on voit immédiatement les dangers
de la démarche !
*L'Éducation supérieure, quant à elle, devrait dépendre
du district. Elle servirait à préparer "utilement à tous les
états de la société". Cet enseignement sur sept ans serait
payant et considéré comme "nuisible et inutile au plus
grand nombre", destiné évidemment aux métiers certes
utiles mais n'exigeant que peu de connaissances !
*Des écoles départementales formeraient les
ecclésiastiques, les médecins, les hommes de loi, les
militaires. Les cadres de la société recevraient ainsi une
formation particulière.
Dans ces deux derniers types d'écoles, les éducateurs
seraient recrutés parmi les citoyens susceptibles de
transmettre un savoir : les prêtres, les juristes, les
médecins, les officiers etc., pas de pédagogues donc mais
des "professionnels".
*Enfin, un Institut National, sorte d'Académie de
l'enseignement, serait réservé aux "talents supérieurs".
On note immédiatement l'écart existant entre les bons
sentiments apparents du préambule et les moyens
envisagés. Si l'utilité du citoyen reste un critère évident,
être heureux semble signifier savoir rester à sa place : le
prêtre, le chevalier et le paysan en quelque sorte !
Pour ce qui est de l'organisation de l'administration de
l'Éducation, le projet prévoit une Commission de
l'Enseignement Public (avec des membres nommés par le
roi), une sorte de ministère de l'Éducation avant l'heure,
chargé de faire valoir les droits du politique.
93
On retrouve assez dans ce projet ce que Bernard Germain
Étienne de Laville-sur-Illon, comte de Lacépède avait
proposé dans ses Vues sur l'enseignement public (1790)
et qui avait eu un certain écho : un système distinguant
soigneusement les "productifs" et les "élites", un
enseignement n'ayant pour but que les activités
productives et l'enrichissement du pays. La gratuité du
primaire n'est pas vraiment décidée, mais envisagée
seulement.
La laïcité n'est pas une obligation et la religion demeure
matière d'enseignement. Les garçons sont surtout
concernés et l'on évoque simplement un "enseignement
domestique" pour les filles jusqu'à huit ans.
Les plans d'instruction publique de Mirabeau ou de
Daunou iront dans le même sens : une obligation scolaire
limitée au minimum lorsqu'elle est mentionnée, la
gratuité n'est pas non plus affirmée et l'éducation des
filles quasiment omise. D'ailleurs, Mirabeau, s'inspirant
de Rousseau, considère qu'hommes et femmes,
remplissant des fonctions différentes au sein de la
société, n'ont pas besoin du même enseignement.
L'administration est déléguée aux autorités locales et
dans tous les cas, on insiste sur une double formation :
- la première adaptée aux besoins sociaux, sachant que la
grande majorité du peuple est destinée à un travail ne
nécessitant que le peu de connaissances nécessaires pour
intégrer le "vaste atelier" social,
- la seconde civique et religieuse pour régénérer les
moeurs.
Il est intéressant de s'arrêter un instant sur la pensée de
94
Mirabeau, car il est l'auteur d'un double discours : celui
du philosophe et celui du pragmatique, ce qui n'est pas
sans saveur et préfigure (ou continue) la litanie des
déclarations démagogiques en matière d'éducation. Dans
un discours de 1791 (imprimé par Cabanis) De
l'instruction publique ou de l'organisation du corps
enseignant, Mirabeau (ou ses collaborateurs) définit ainsi
l'éducation "L'art de l'éducation n'est que celui de faire
prendre aux hommes les habitudes qui leur seront
nécessaires dans les circonstances auxquelles ils sont
appelés".
La formule est ambiguë, mais on comprend que suivant
la nature de la société l'éducation aura des caractères
différents et que surtout l' "homme" est plus objet que
sujet. Elle est conçue comme une force coercitive, un
moule qui, au nom de valeurs supérieures, permettra de
répondre aux impératifs d'utilité du moment et aussi de
confirmer les prédéterminations sociales. Les
circonstances et l'origine sont essentielles, pas l'enfant,
pas l'individu.
Il va ensuite paradoxalement opposer le passé révolu au
présent pour mieux définir l'avenir : "Tous les
législateurs anciens se sont servis de l'éducation publique
comme du moyen le plus propre à maintenir et à
propager leurs institutions. Quelques-uns d'entre eux ont
regardé la jeunesse comme le domaine de la patrie et
n'ont laissé aux pères et mères que la satisfaction d'avoir
produit des citoyens. C'est dans le premier âge qu'ils ont
voulu jeter les semences de la moisson sociale. Mais les
législateurs anciens cherchaient tous à donner à leurs
peuples une tournure particulière, et ne prétendaient
souvent à rien de moins qu'à les dénaturer, pour ainsi
dire, et à leur faire prendre des habitudes destructives de
95
toutes nos dispositions originelles."
Les premières remarques, qui font de l'éducation -
publique - l'arme privilégiée des États pour inféoder les
générations, sont suivies d'une vraie profession de foi
"libérale", un partisan déclaré du laisser-faire qui ne
surprend pas trop chez un homme de 1789. D'une part,
Mirabeau met en avant les "circonstances" auxquelles
les hommes sont "appelés" et d'autre part, il dénonce
ces états qui "dénaturent" leurs citoyens aux dépens de
"nos dispositions originelles". Le chaud et le froid ! Il
poursuit d'ailleurs avec une générosité étonnante ou
emporté par ses talents d'orateur : "Quant à vous,
messieurs, vous n'avez pas d'opinions favorites à
répandre ; vous n'avez aucune vue particulière à remplir ;
votre objet unique est de rendre à l'homme l'usage de
toutes ses facultés, de le faire jouir de tous ses droits, de
faire naître l'existence publique de toutes les existences
individuelles librement développées, et la volonté
générale de toutes les volontés privées. Il ne s'agit point
de faire contracter aux hommes certaines habitudes, mais
de leur laisser prendre toutes celles vers qui l'opinion
publique ou des goûts innocents les appelleront. Ainsi,
c'est peut-être un problème de savoir si les législateurs
français doivent s'occuper de l'éducation publique,
autrement que pour en protéger les progrès, et si la
constitution la plus favorable au développement du moi
humain, et les lois les plus propres à mettre chacun à sa
place, ne sont pas la seule éducation que le peuple doive
attendre d'eux."
La phrase centrale doit en particulier être relevée : "faire
naître l'existence publique de toutes les existences
individuelles librement développées, et la volonté
générale de toutes les volontés privées". Le disciple de
96
Rousseau ne peut manquer de rendre hommage à son
maître à penser. Il poursuit d'ailleurs en mettant en
question le rôle de l'État dans cette entreprise.
Selon Mirabeau, l'Assemblée nationale n'aurait en fait à
s'occuper de l'éducation que "pour l'enlever à des
pouvoirs ou à des corps qui peuvent en dépraver
l'influence", et pour la livrer ensuite à elle-même ; car,
dans une société bien ordonnée, "sans qu'on s'en mêle,
l'éducation sera bonne ; elle sera même d'autant
meilleure, qu'on aura plus laissé à faire à l'industrie des
maîtres et à l'émulation des élèves". Le voeu pieux d'un
philosophe libéral condamné à faire le grand écart entre
les principes d'utilité et de bonheur.
Cette finalité idéale dont rêve apparemment Mirabeau-
Janus est inscrite dans un futur lointain et le pragmatique
tribun revient sur son idée de départ : il faut tenir compte
des préjugés et des circonstances : "L'ignorance du
peuple est si profonde, l'habitude de regarder les
établissements pour l'instruction publique et gratuite
comme le plus grand bienfait des rois est si générale, et
les idées que j'énonce se trouvent si peu conformes à
l'opinion dominante, qu'en les supposant démontrées
dans la théorie, il serait sans doute dangereux, peut-être
même impossible, de les mettre en pratique sans de
grandes modifications."
Aussi Mirabeau effectue-t-il un rétablissement hardi :
l'intervention des pouvoirs publics dans l'éducation est
nécessaire pour que cette éducation se fasse d'après des
vues nationales : "Il convient que la volonté toutepuissante
de la nation forme partout des centres, soit par
les académies, soit par les écoles, d'où les lumières iront
se répandre au loin."
Après avoir refusé l'Éducation nationale au nom de la
97
liberté des individus, ce maître du double langage qu'est
Mirabeau prône tout de même une étape transitoire
illimitée, celle du rôle de l'État ! La synthèse entre les
aspirations du philosophe et le pragmatisme de l'homme
politique est osée, mais Mirabeau met en place un type de
discours qui se répétera jusqu'à nos jours : d'une part des
finalités généreuses et allant toutes dans le sens d'une
mise en exergue de l'individu et puis d'autre part
l'obstacle des réalités tout en faisant croire que l'utopie
humaniste, libertaire reste l'amer lointain vers lequel se
dirige le navire éducation forcé de louvoyer.
L'enfant au centre du système, déjà, dans les discours !
Le Comité d'instruction publique est nommé le 13
octobre 1792 et le 26 juin 1793, c'est Lakanal (1762-
1845) qui présente, au nom de ce Comité, le projet de
décret pour l'établissement de l'instruction nationale, qui
avait été préparé par Sieyès et Daunou. Il ne met plus à la
charge de la nation que les écoles primaires, auxquelles le
Comité enlève d'ailleurs ce nom — qui en effet n'aurait
plus eu de sens — pour les appeler "écoles nationales".
Ce projet fut repoussé par la Convention le 3 juillet, et,
sur la proposition de Robespierre, une Commission de six
membres fut alors chargée de préparer un nouveau projet
de décret sur l'éducation et l'instruction publique.
Lakanal fut élu membre de cette Commission des Six :
mais il n'y joua qu'un rôle de comparse. Les rapporteurs
de la Commission furent successivement Robespierre,
Romme et Léonard Bourdon.
Le 13 juillet 1793, Robespierre à son tour y allait de son
projet. Il rêvait de voir tous les garçons et les filles de 5 à
12 ans élevés en commun aux dépens de la République :
98
"mêmes vêtements, même nourriture, mêmes
professeurs, même instruction, mêmes soins".
Le travail manuel devait avoir une place importante et se
dérouler dans les maisons d'éducation nationale
surveillées par le conseil des pères. Des sanctions
devraient être prises contre les élèves qui n'atteindraient
pas la norme !
Les plus doués, après l'âge de 12 ans pourraient entrer
par concours au Lycée mais ce concours justement
marque les limites de la méritocratie à laquelle il songe :
la quasi-totalité des enfants auraient seulement le choix
entre des écoles secondaires ou l'apprentissage. L'enfant
devait ainsi être préparé à entrer au service de la
République menacée, les préoccupations premières de
Robespierre étant utilitaires, nationales et éventuellement
égalitaires.
Ce plan sera voté, mais son application reportée sur une
pétition de la Commune de Paris qui avait un contreprojet
basé sur l'acquisition de degrés moyens et
supérieurs d'instruction. Une simple querelle politique et
de préséance : les objectifs, quant à eux, étaient assez
semblables.
Le 5 septembre 1793, le régime dictatorial de "la
Terreur" est instauré.
Le calendrier républicain conçut par Romme et Fabre
d'Églantine est mis en place. Le 15 septembre, pour
départager la Commission des Six, la Convention décide
d'adjoindre trois autres membres dont Romme.
La Convention vote, en brumaire an II (octobre 1793),
divers décrets sur les écoles nationales justement
présentés par ce dernier au nom de la Commission
d'éducation nationale, constituant pour la première fois
99
une législation de l'instruction primaire qui, en
particulier, exclut les ecclésiastiques de l'enseignement.
Suite au discours de Chénier, qui n'est plus membre du
Comité d'instruction, la révision de ces décrets est
décidée. Romme, de nouveau choisi comme rapporteur
par le Comité d'instruction, fait lecture des révisions
effectuées par le Comité. Une commission nommée par
le Comité de salut public les rejette en bloc et présente un
nouveau projet : le plan Bouquier. Celui-ci est adopté le
29 frimaire an II (19 décembre 1793). Il proclame la
liberté d'enseignement. L'instruction serait gratuite et
obligatoire ; les instituteurs, fonctionnaires publics
salariés par la République à raison du nombre d'élèves.
Le programme de l'enseignement primaire se réduirait à
la lecture, à l'écriture, et aux premières règles de
l'arithmétique.
Gabriel Bouquier est né à Terrasson en 1739, dans une famille de
bonne bourgeoisie d'office, ami de Joseph Vernet et de Greuze,
puis de David, passionné de littérature et de poésie, de voyages et
d'archéologie, il était membre de l'Institut de Bologne et de
l'Académie des Arcades de Rome.
En mars 1789, il est un des principaux rédacteurs du cahier des
"plaintes, doléances et remontrances des habitants de Terrasson".
Députés de la Dordogne à la Convention, il fait partie de la
Montagne et vote la mort du roi. Il devient membre du Comité
d'instruction publique propose assez vite un nouveau "plan
d'instruction publique", dont l'impression est décidée. Il est
présenté à la Convention qui lui accorde la priorité sur d'autres
plans. Ce plan qui est probablement la synthèse de conversations
auxquelles Bouquier a participé se résume en ces quatre
dispositions principales : "L'enseignement est libre. — Il est fait
publiquement, sous la surveillance des autorités et des citoyens. —
Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'enseignement sont
salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui
fréquentent leurs écoles. — Ils sont tenus, pour le premier degré
d'instruction, de se conformer dans leur enseignement aux livres
100
élémentaires adoptés et publiés par la représentation nationale."
Bouquier succédera à Anacharsis Cloots à la présidence des
Jacobins pour une quinzaine.
Son jacobinisme le condamne ensuite au silence mais il n'est pas
proscrit après la Terreur commet la plupart des autres Montagnards
en vue. Sa candidature au Conseil des Cinq-Cents est un échec et il
se retire à Terrasson où il renoue avec un catholicisme
intransigeant.
La liberté de l'enseignement c'est d'abord pour ceux qui
la défendent, comme Chénier, le droit laissé au prêtre
d'exercer les fonctions d'instituteur. Prié de prendre la
porte, l'ecclésiastique rentre par les fenêtres ! Le projet
Romme en revanche, frappant d'ostracisme les ministres
des cultes, excluait par là même la religion de l'école. La
loi Bouquier établit une sorte d'équilibre précaire, elle
reste silencieuse sur ce point et rend tout possible. Les
questions idéologiques prennent le pas sur une réflexion
de fond concernant l'éducation des citoyens et l'avenir de
la République.
Certains députés songent pourtant aux instruments qui
institueraient une éducation nationale digne de ce nom.
Le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794), Grégoire, au nom
du Comité, présente un rapport sur un concours à ouvrir
pour la composition des livres élémentaires. Un jury est
formé en messidor, premier pas vers un contrôle des
contenus d'enseignement et de l'application de
programmes (encore à faire !) nationaux. L'examen des
divers manuscrits envoyés prend un temps considérable
et ne se termine qu'après la Convention ; ce sont alors les
Conseils législatifs institués par la Constitution de l'an III
qui ont à se prononcer. Sept ouvrages sont couronnés :
Les Éléments de grammaire française par Lhomond, la
Grammaire élémentaire et mécanique par Panckoucke,
101
des Éléments d'arithmétique avec des observations pour
les instituteurs, les Éléments d'histoire naturelle par
Millin, les Principes de la morale républicaine par La
Chabeaussière, le Portefeuille des enfants par Duchesne
et Le Blond et l'Art de la natation par Turquin et
Deligny.
Le 8 pluviôse (27 janvier 1794), Barère fait, au nom du
Comité de salut public, un rapport sur les idiomes
étrangers et l'enseignement de la langue française dont le
décret est adopté sans discussion. "Nous enseignerons le
français, dit-il, aux populations qui parlent le basbreton,
l'allemand, l'italien ou le basque, afin de les
mettre en état de comprendre les lois républicaines, et de
les rattacher à la cause de la Révolution". Le français
est la langue du progrès, il convient d'en faire bénéficier
- manu militari s'il le faut - toutes les minorités ! Le zèle
missionnaire n'est pas très éloigné et l'on reste dans la
droite ligne du Discours sur l'Universalité de la Langue
Française du "comte" Rivarol, premier prix ex-æquo
(et non sans difficulté !) de l'Académie de Berlin en
1784. Cependant, on remarquera que quand on veut faire
avant tout une nation, l'attention prêtée à l'individu, aux
particularismes baisse naturellement.
En bref, dans toute cette période, l'utile, oui ; le bonheur,
on n'y pense plus ou alors il découlerait simplement de
l'utile conçu comme l'adhésion totale aux principes
énoncés par le gouvernement révolutionnaire. Le citoyen
heureux est celui qui accomplit sa tâche, celui qui reste à
sa place, peut-on ajouter sans trop extrapoler. À la limite,
on pourrait dire que les théoriciens de l'État féodal ne
disaient pas autre chose : le noble payait l'impôt du sang
102
pour la défense commune, le roturier produisait les
richesses et les biens nécessaires à l'ensemble de la
communauté, l'ecclésiastique préparait l'au-delà pour
tous. Tout le monde était satisfait !
En outre, les législateurs des premières années de la
Révolution ne font qu'annoncer ce que les siècles
suivants mettront en pratique. L'éducation (l'instruction !
le terme se généralise) n'est pas là pour servir l'individu.
Au diable l'humanisme réactionnaire ! L'éducation doit
servir le pays et servir le pays se déclinera à chaque
génération un peu différemment au gré des évolutions
techniques et des théories économiques voilées par le
drapeau des vertus civiques et républicaines, par les
discours lénifiants ou héroïques, cache-misère permettant
de faire passer des vessies pour des lanternes à la
majorité. L'utilité se mesure au travail des campagnes,
puis de plus en plus au labeur en manufacture, puis en
usine, puis au sang répandu sur les champs de bataille,
puis…
Pourtant, certains esprits illuminés n'ont pas totalement
désarmé. Sous la Convention, Anacharsis Cloots, lui
aussi membre du Comité d'Instruction, se battra pour
faire exister sa République Universelle et des concepts
éducatifs qui vont dans le sens de cette ambition, celle de
la république universelle des individus, une république
respectueuse des différences et des cultures dont le défi
est de faire cohabiter les intérêts du genre humain, ceux
des diverses nations et ceux de chaque individu !
Condorcet (1741-1794), comme quelques autres encore
tiendra à l'idéologie de la transmission d'un savoir moins
directement conçu pour l'utilité du système que pour
l'émancipation de l'individu, ou plutôt parce qu'il est
103
persuadé qu'il faut changer le rapport habituel : c'est
cette émancipation des individus, leur harmonie qui
définira une vraie république, pas l'inverse ! Le vingt
avril 1792, il a présenté son Rapport et projet de décret
sur l'organisation générale de l'instruction publique.
Inutile d'entrer dans le détail d'une pensée très élaborée :
il suffit de retenir que ce projet est l'expression de la
philosophie de celui qui a écrit l'Esquisse d'un tableau
historique du progrès de l'espèce humaine. Condorcet
croit au perfectionnement constant et graduel de l'homme
et il est persuadé que l'école, si elle est ouverte à tous,
garçons et filles - et gratuitement -, est le meilleur
instrument de ce progrès. Développer les aptitudes
individuelles et perfectionner l'espèce humaine seraient
ses finalités. L'utile en étant l'évidente retombée.
Condorcet bouleverse les rapports si on le compare à
Talleyrand. L'homme, l'individu est la préoccupation
centrale, pas l'ouvrier, le producteur. Nullement utopiste,
il prône cette véritable libération parce qu'un de ses buts
est aussi d'accroître la rentabilité du travail, de rendre le
producteur plus souple face aux évolutions futures, de
pouvoir continuer sa formation tout au long de sa vie et
de faire de l'école le lieu où l'on apprend à apprendre… Il
pense enfin qu'il est essentiel de lutter contre les effets
délétères et sclérosants de la monotonie inévitable aux
générations condamnées aux mêmes tâches. Dans cette
perspective, il songe en outre à des activités culturelles, à
un enrichissement des loisirs…
Hélas ! Condorcet meurt, victime de la Terreur en 1794.
Son projet rejoint le paradis des beaux projets de tous les
temps remisés aux oubliettes ou réservés aux érudits
discoureurs : la Dîme de Vauban, le Cyrus de Ramsay, le
Projet de Paix perpétuelle de l'abbé Mably, l'Anti-
104
Machiavel, le Contrat Social, La République Universelle
d'Anacharsis,…tous trop parfaits, trop difficiles, trop
exigeants probablement pour devenir vérités humaines !
Ce plan de Condorcet sera repoussé, mais cependant
jamais oublié des esprits les plus sensibles. Le Peletier de
Saint Fargeau (1760-1793) s'en inspirera et tentera de
convaincre sans plus de succès, lui qui dans l'Acte
constitutionnel du 24 juin 1793 faisait écrire :
"La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès
de la raison publique et mettre l'instruction publique à la
portée de tous les citoyens".
S'inspirant également des idées de Condorcet, mais avec
une conception assez différente de l'Homme, Lavoisier
composa un petit traité intitulé Réflexions sur
l'instruction publique, "présentées à la Convention
nationale par le bureau de la consultation des Arts et
métiers", et imprimées par Dupont de Nemours vers
1793 :
"L'homme naît avec des sens et des facultés, écrivait-il
dans son préambule, mais il n'apporte avec lui en
naissant aucune idée : son cerveau est une table rase qui
n'a reçu aucune impression, mais qui est préparée pour
en recevoir."
Lavoisier proposait un enseignement laïc, orienté vers les
arts utiles et comportant quatre niveaux : écoles
primaires, secondaires, instituts nationaux, et lycées (les
équivalents des facultés) ; une société centrale des
sciences et des arts couronnerait le tout. Il revendiquait,
encore, l'importance du jeu comme vecteur éducatif, et
suggérait que l'éducation primaire suive la méthode
naturelle. Ce devoir de la société vis-à-vis de l'enfant
devait être gratuit. Il souhaitait, enfin, pour
l'enseignement secondaire une grande éducation
105
scientifique car "Une nation chez laquelle les sciences et
les arts languiraient dans un état de stagnation, serait
bientôt devancée par les nations ses rivales". Lavoisier
devait présenter ses Réflexions à la Convention, le 22
septembre 1793. Le vote, cinq jours auparavant, de la
"loi des suspects" provoquant la Terreur, remisa toute
idée d'instruction, même publique. Lavoisier n'avait plus
quelques mois à vivre.
*
La plupart des plans développés sous la Terreur essayent
de faire la synthèse entre une volonté explicite de
régénérer l'homme tout en préparant un citoyen au
service de la patrie par ses qualifications professionnelles
et défensives. Il y avait là une contradiction qu'on ne
pouvait résoudre qu'en considérant l'homme à la manière
de Lavoisier comme étant le produit exclusif d'une
culture, d'un apprentissage et en niant l'idée même de
qualités intrinsèques, toute chose qui allait contre le
mouvement des idées, la sensibilité qui, en dépit des
événements tragiques du temps, marquait les esprits
depuis plusieurs décades. Les problèmes idéologiques
soulevés étaient nombreux car, en peu de temps, il fallait
mettre à plat, sans toutefois tout désintégrer, un tissu
national nécessaire pour assurer la défense du pays dans
une situation particulièrement difficile. Comment alors
envisager la place de la religion, celle de la famille, celle
de l'individu ?
106
*Moins de théorie, plus de praxis (juillet 1794-novembre
1799).
L'épisode de la Terreur passé, la Révolution prend en
apparence un virage "pragmatique". En matière
d'éducation, on ressent le besoin de trancher, d'instituer.
On ajuste donc certains des projets présentés, on les
amende, on légifère en n'oubliant pas de garder le "ton"
patriotique des grands élans généreux d'un Condorcet par
exemple. Si la rupture n'est pas complète, on
"aménage" dans un sens plus directement pragmatique :
il est temps de remettre la France au travail…
Le décret du 17 novembre 1794 (27 brumaire 1794)
renoue avec certaines dispositions du plan Lakanal-
Daunou-Sieyès et chaque école se voit dotée de 2
sections, une pour chaque sexe. Les contenus
d'enseignement seront identiques, mais les filles auront
en plus des cours de travaux manuels (domestiques). Le
texte amendé sera adopté le 25 octobre 1795.
En outre, pour le premier degré (Loi Lakanal du 17
novembre 1794) : tous les jeunes citoyens doivent
apprendre à lire, écrire et compter. Il y aura une école par
canton ou par 1000 habitants. Les instituteurs seront
nommés par le peuple, agréés par un jury et rémunérés
par l'État.
Ces projets seront ramenés à des proportions plus
modestes le 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) par la loi
Daunou sur l'organisation de l'instruction publique, un
des derniers actes de la Convention : moins d'écoles
primaires au profit des écoles centrales, plus de gratuité.
Ces écoles centrales destinées à remplacer les anciens
collèges à raison d'une école par 300 000 habitants ou
107
une par département rural ont été créées par un décret du
25 février 1795 modifié ensuite par le titre II de la loi
Daunou. Elles fonctionneront dès 1796 mais pour une
période assez courte.
Cette loi revient sur l'obligation scolaire prévue par la loi
Bouquier du 29 frimaire an II. Elle instaure une
rétribution à la charge des familles des élèves, mais on
prévoit qu'un quart d'entre eux au maximum par
municipalité, considérés comme indigents, pourra être
exonéré. Les instituteurs se voient confier un local pour
la classe et le logement, mais sont payés par le produit de
l'écolage. La loi prévoit une école par canton au moins,
le canton étant à l'époque l'administration territoriale de
base. Les programmes du primaire se limitent à la
lecture, l'écriture, le calcul et la morale républicaine.
C'est le 22 août 1795 que Daunou et ses collaborateurs
du Comité d'éducation ont en effet rendu leur copie :
- 3 degrés sont prévus (les écoles primaire/les écoles
centrales/l'Institut National) auxquels doivent s'adjoindre
des écoles spéciales (anatomie, géométrie, mécanique...)
- On nomme un directeur de l'instruction publique, sorte
de ministre de l'Éducation avant l'heure, qui est,
précision intéressante, subordonné au ministre de
l'Intérieur !
- La liberté de l'enseignement est proclamée (mais l'on
sait ce que cela veut dire !).
En revanche, ne sont plus prévues ni la gratuité ni
l'obligation.
Cette loi Daunou est essentielle car elle résume en partie
le résultat des travaux du Comité d'instruction publique,
108
et reprend partiellement des dispositions législatives déjà
adoptées, mais sur certains points elle les complète ou les
contredit. Elle peut être considérée, par son plan et par
son contenu, comme la loi d'application du titre X,
consacré à l'instruction publique, de la Constitution de
l'an III, déjà adoptée le 1er vendémiaire an IV.
TITRE X - Instruction publique.
Article 296. - Il y a dans la République des écoles primaires où les
élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de
la morale. La République pourvoit aux frais de logement des
instituteurs préposés à ces écoles.
Article 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République, des
écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel,
qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
Article 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national
chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les
sciences.
Article 299. - Les divers établissements d'instruction publique
n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de
correspondance administrative.
Article 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements
particuliers d'éducation et d'instruction, et des sociétés libres pour
concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
Article 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la
fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la
patrie et aux lois.
109
La loi "Daunou"
L'article 1er prévoit de constituer une école centrale par
département, mais les articles 10 à 12 autorisent l'établissement
d'"écoles centrales secondaires" pour les villes qui ne sont pas
chef-lieu de département et qui disposent déjà d'un collège, à
condition que l'établissement soit financé par la commune.
L'enseignement y est divisé en trois sections (art. 2). Les élèves
sont admis dans la première à 12 ans, dans la deuxième à 14 et
dans la troisième à 16 (art. 3). À chacune de ces sections
correspond un enseignement dans un certain nombre de
disciplines. Pour la première, le dessin, l'histoire naturelle, les
langues anciennes et, dans certains cas et après autorisation, les
langues vivantes ; pour la seconde, les mathématiques, ainsi que la
physique et la chimie expérimentales ; pour la troisième la
grammaire, les belles-lettres, l'histoire et la législation.
Les professeurs seront choisis par un "jury d'instruction" (art. 5)
et sont révocables, mais le Directoire doit donner son accord pour
toute révocation (art. 6). Leur traitement fixe est celui d'un
administrateur de département (art. 7), mais ils perçoivent une part
de la rétribution scolaire payée par les familles à raison de 25
livres par an au maximum (art. 8).
L'article 4 oblige chaque école centrale à disposer d'une
bibliothèque ouverte au public, d'un jardin, d'un cabinet d'histoire
naturelle et d'un cabinet de sciences expérimentales (c'est-à-dire
d'un laboratoire).
Les écoles centrales se sont installées petit à petit. Dans de
nombreuses villes, les locaux de l'ancien collège ont été réutilisés
pour installer l'école. Pour constituer la bibliothèque, les
110
administrations ont regroupé les bibliothèques de district.
Dès juin 1797, on compte une centaine d'écoles centrales dont 68
sont en pleine activité.
À Paris, il est projeté d'établir cinq écoles centrales pour tenir
compte de l'importance de la population, mais trois seulement
verront le jour :
- l'école centrale de la rue Antoine, futur lycée Charlemagne ;
- l'école centrale du Panthéon, futur lycée Henri-IV ;
- l'école centrale des Quatre-Nations, qui occupe le palais du
même nom, aujourd'hui Institut de France.
Ces écoles centrales sont critiquées comme par l'enquête lancée en
1801 par le ministre de l'Intérieur Jean-Antoine Chaptal. On leur
reproche de ne pas tenir compte de l'enseignement primaire, de ne
pas proposer d'éducation morale et religieuse, d'offrir en revanche
une liberté jugée excessive aux élèves, qui sont censés progresser à
leur rythme et en effectuant des choix libres… Le choix des
méthodes est d'ailleurs laissé à l'appréciation des professeurs. Ce
libéralisme paraît outré à de nombreux observateurs et professeurs.
La réforme Daunou ne satisfait ni les partisans des acquis
révolutionnaires ni ceux du retour à l'ordre. Enfin, les écoles
centrales paraissent peut-être trop libertaires au goût du nouveau
régime. La loi Daunou reste en vigueur jusqu'à la loi du 11 floréal
an X (1er mai 1802) qui réorganisera encore une fois
l'enseignement : les écoles centrales les plus importantes seront
remplacées par des lycées d'État et les autres par des écoles
secondaires ou collèges, financés par les communes ou de manière
privée (par les familles).
Les bibliothèques des écoles centrales seront attribuées aux
communes par une décision du 28 janvier 1803 et formeront le
point de départ des bibliothèques municipales.
La Loi du 25 octobre 1795 marque une étape décisive sur
un autre plan car elle se soucie de la formation des
maîtres avec la création d'écoles normales à Paris et dans
les districts. Cependant, ces dernières n'ouvriront pas ou
seront jugées d'un niveau trop bas.
L'École Normale (dite "de l'an III" pour signifier que
son existence fut éphémère) qui avait été créée par la
111
Convention le 9 brumaire an III et avait ouvert ses cours,
un mois après l'École centrale des Travaux publics, en
pluviôse (janvier 1795) avait pour mission d'instruire des
instituteurs pour les futures écoles secondaires avec un
programme encyclopédique : sciences, histoire,
géographie, philosophie et grammaire. avaient été retenus
pour enseigner à l'École Normale. Les enseignants
étaient particulièrement brillants : Lagrange, Monge,
Berthollet, Laplace, Haüy, La Harpe, Bernardin de Saint-
Pierre etc. Très différente des autres "grandes écoles"
quant à ses objectifs et sa mission, l'École Normale
l'était aussi par son recrutement : des élèves de tout âge
(1400 environ), en général de plus de 25 ans, dont
certains étaient déjà dotés d'un fort bagage intellectuel.
Au printemps de 1795, à la fin d'un hiver rigoureux, les
émeutes et les soulèvements populaires de germinal et
prairial déclenchèrent une violente réaction antijacobine à
la Convention, ce qui précipita la fin des cours de l'École
Normale.
Pour compléter l'ensemble, au niveau de l'enseignement
supérieur doivent également être créées dix grandes
écoles, les "écoles spéciales" à visée supérieure et
professionnelle. Certaines resteront à l'état de projet,
comme l'École des antiquités ou l'École des sciences
politiques. En revanche on assiste à la création de l'École
centrale des travaux publics qui deviendra Polytechnique
(Fourcroy (1755-1809) a repris l'idée que des
représentants de la Montagne avaient en leur temps
lancée), de l'École Normale supérieure, de l'École de
Mars ou École militaire, du Conservatoire des Arts et
Métiers (à laquelle s'est attaché l'abbé Grégoire (1750-
1831), de l'École des langues orientales vivantes, de la
112
Bibliothèque Nationale, du Bureau des longitudes, de
l'École de santé, de l'Institut et des grandes écoles
techniques de la fin de l'Ancien Régime, qu'on rouvre
alors.
Le système mis en place fonctionne mal, la liberté de
l'enseignement permettant toutes les dérives. Il restera
cependant en vigueur jusqu'en 1802.
*
L'utopie d'une éducation démocratique permettant à
chacun de s'épanouir et de développer ses capacités n'est
plus du tout envisagée. Jusqu'alors on évoquait l'utile et
le bonheur ; désormais seul le premier terme paraît être
une finalité digne et le sens même de ce mot évolue :
l' "utile" n'est autre que ce que les débuts de
l'industrialisation et ses conséquences vont mettre en
place. Le pragmatisme des proclamations est patent.
Lakanal dira ainsi : "Il est bon, il est nécessaire que le
grand nombre de jeunes citoyens, sans aspirer à une
instruction plus étendue, se distribue, en quittant les
écoles primaires, dans les champs, dans les ateliers, dans
les magasins, sur vos navires, dans vos armées."
Rien de nouveau en fait. On retrouve la pensée d'un
Talleyrand sans les fioritures altruistes, qui ont fait leur
temps former des individus utiles à l'État et cet État n'est
ni une commune insurgée ni un pays en Révolution
cherchant à donner une nouvelle image de l'homme. La
France moderne vient d'accoucher et cherche à rattraper
les retards qu'elle a pu accumuler au cours des années de
bouleversements qu'elle a connus, pour devenir ou rester
une puissance, non seulement militaire mais aussi
économique. En gros, la récré est terminée, on se remet
113
au boulot, chacun à sa place, même si pour quelques
années encore, il flottera dans l'air des discours un peu de
cet idéalisme qui avait lancé les hommes à l'assaut des
bastilles, de quelque nature qu'elles soient. La
généralisation d'une éducation publique primaire fait son
chemin, mais moins en songeant aux individus qu'aux
défis annoncés par une révolution industrielle et
technologique déjà bien avancée en Angleterre par
exemple.
Le monopole napoléonien.
On connaît la fameuse déclaration des consuls au
lendemain du 18 brumaire : "La révolution est fixée aux
principes qui l'ont commencée ; elle est finie".
En matière d'éducation, ce fut particulièrement le cas.
Bonaparte, premier Consul, signe avec le pape le
Concordat le 16 juillet 1801 qui abolit la loi de 1795
séparant l'Église de l'État.
Chaptal, ministre de l'Intérieur, présente au Conseil
d'État un projet de loi sur l'instruction publique
ressemblant à l'ancien projet d'éducation nationale de
Lakanal (1793), mais qui n'est pas agréé.
Fourcroy, propose alors au Corps législatif, un nouveau
projet qui aboutira à la loi sur l'instruction publique du
11 floréal an X (1er mai 1802) qui vient transformer une
organisation scolaire qui satisfaisait peu :
114
- Des Écoles secondaires ou collèges sont créés,
- Les Lycées se substituent aux écoles centrales,
- On juge de l'état déplorable de l'enseignement primaire
et, toujours sans décréter ni obligation ni gratuité, on
cherche une échappatoire à ses difficultés (manque de
coordination, de programmes, de maîtres qualifiés, de
locaux adéquats…), on encourage alors les Frères des
Écoles Chrétiennes à prendre en charge ce type d'école !
Un retour en arrière ou le moyen d'effectuer une
transition bon marché. Les deux sans doute. Le signe
également que le primaire est sacrifié, ce qui veut dire
que la majorité des enfants est à nouveau confiée aux
bons soins des religieux, l'Église retrouvant une sorte de
légitimation.
On délègue aux communes les petites écoles prétextant
que les conseils municipaux sont les meilleurs juges des
intérêts locaux. Les instituteurs sont choisis par les
maires et les conseils municipaux. Leur traitement se
compose du logement fourni par les communes et d'une
rétribution payée par les parents, et déterminée par les
édiles. Les indigents sont exemptés de toute charge ; cette
exemption ne peut néanmoins excéder le cinquième des
enfants.
L'instruction des filles, que Lakanal avait constamment
mis au même rang que celle des garçons, est laissée de
côté.
Le 18 mai 1804, l'Empire est proclamé.
Devant le manque d'enseignants, on se tourne de plus en
plus, pour le primaire, vers les congrégations, décimées à
la Révolution. L'intérêt impérial est d'ailleurs davantage
115
tourné vers le couronnement du système scolaire :
l'enseignement supérieur et une université dignes des
temps nouveaux et surtout colonnes inébranlables du
régime.
Fourcroy, directeur général de l'Instruction publique, est
le maître d'oeuvre des différents textes législatifs et
réglementaires.
Le décret-loi qui fonde l'Université est adopté le 10 mai
1806.
Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un
corps chargé exclusivement de l'enseignement et de
l'éducation publique dans tout l'empire, et que les
membres du corps enseignant contracteraient des
obligations civiles, spéciales et temporaires.
Après son adoption Napoléon donne de nouvelles
instructions à Fourcroy pour son organisation.
Le décret impérial portant sur l'organisation de
l'Université est promulgué le 17 mars 1808 et précise son
profil (organisation administrative, statut du personnel,
fonctionnement pédagogique). Nous sommes loin des
idées généreuses des hommes de l'an II voire d'un
marquis de Condorcet : l'université est conçue comme
devant être un des rouages essentiels de l'empire.
Aucune école ne peut être créée hors de l'Université.
Mais en réalité, les écoles primaires ne sont pas vraiment
concernées, ne formant pas un corps d'État. Les Frères
des Écoles chrétiennes dont les statuts sont approuvés par
arrêté le 4 août 1810, resteront en dehors de ces
prescriptions, tout en étant soumis à contrôle.
L'Université est régie et gouvernée par un grand-maître.
Chaque académie est gouvernée par un recteur résidant
116
au chef-lieu des académies. Portalis, ministre des cultes,
se fait le porte- parole de tous les revanchards qui
réclament le retour de l'Église en matière d'éducation :
Les enfants sont livrés à l'oisiveté la plus dangereuse, au
vagabondage le plus alarmant. Ils sont sans idée de la
Divinité, sans notion du juste et de l'injuste. De là des
moeurs farouches et barbares; de là un peuple féroce ! Si
l'on compare ce qu'est l'instruction à ce qu'elle devrait
être, on ne peut s'empêcher de gémir sur le sort qui
menace les générations futures... Ainsi, toute la France
appelle la religion au secours de la morale et de la
société.
Napoléon écoute d'autant plus son ministre qu'il désire
faire aussi de la religion une alliée au service de son
pouvoir. Il écarte Fourcroy, l'ancien conventionnel, de la
grande maîtrise de l'Université au profit de l'onctueux
Louis de Fontanes très lié au clergé et aux milieux
catholiques. Celui-ci réorganise entièrement le système
scolaire français et crée les postes d'inspecteurs
généraux.
Décret du 17 mars 1808.
Organisation générale de l'Université.
Art. 1er- L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié
exclusivement à L'Université.
2 - Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction,
ne peut être formé hors de l'Université Impériale, et sans
l'autorisation de son chef.
3 - Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être
117
membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses
facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des
archevêques et évêques, chacun dans son diocèse…
4 - L'Université impériale sera composée d'autant d'académies
qu'il y a de cours d'appel.
5 - Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans
l'ordre suivant :
1° Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des
grades ;
2° Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique,
la logique, et les élémens (sic) des sciences mathématiques et
physiques ;
3o Les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments
des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des
sciences ;
4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers,
où l'enseignement se rapproche de celui des collèges ;
5° Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres
particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des
institutions ;
6° Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à
lire, à écrire, et les premières notions du calcul.
Notons bien : "autant d'académies qu'il y a de cours
d'appel" et l'accent mis sur les lycées (au second rang)
alors que les écoles primaires sont citées en dernier !
On compte 37 lycées en 1808.
Quelques rares élèves bénéficient de bourses (familles
indigentes), mais la majorité des lycéens appartient aux
couches sociales les moins défavorisées car, non
seulement les candidats au lycée doivent avoir 9 ans,
savoir lire et écrire, être recommandés, ils ont aussi une
rétribution à payer.
Le latin reste à la base de l'enseignement, mais un intérêt
118
marqué pour les mathématiques et les sciences
commence à se manifester.
Après 5-6 ans de lycée, l'élève peut s'orienter vers les
écoles spéciales
Fourcroy avait ainsi projeté de créer 10 écoles de Droit, 3
de médecine, 4 d'histoire naturelle, physique et chimie, 2
d'arts mécaniques, 1 de mathématiques, 1 d'histoire,
géographie, économie politique, 1 de dessin, 1 école
militaire spéciale (toutes ne verront pas le jour).
Malgré l'appel fait aux Frères des écoles chrétiennes, et
la présence d'institutions et de pensionnats privés le
monopole étatique est évident : préfets et sous-préfets
organisent et surveillent le primaire (choix des
inspecteurs généraux, des directeurs) ; les proviseurs de
lycée sont soumis au même contrôle :
- Impossibilité d'ouvrir un établissement scolaire sans
autorisation.
- Contrôle commun au public et au privé.
- La religion chrétienne reste prépondérante.
- Recteurs, inspecteurs d'académie, dépendent du
Grand Maître de l'université.
- Les Lycées dépendent de l'État ; les écoles
secondaires ou collèges des communes.
On est également plus sévère sur le recrutement des
enseignants Pour enseigner il faut posséder le
baccalauréat, la licence ou le doctorat conférés par la
Faculté. Le corps des agrégés, supprimé sous la
Révolution est rétabli en 1808 et devient le cadre d'élite
auquel on accède par concours.
Le primaire, quasiment rétrocédé à l'enseignement privé
confessionnel, intéresse peu : la majorité des élèves
119
n'aura pas accès au secondaire, un enseignement minimal
leur suffira, la religion pourvoyant au reste !
Cette création de l'Université impériale n'a cependant
réglé en rien la question de la concurrence entre
établissements publics et institutions privées qui, bien
que soumises à l'Université, avaient conservé une grande
part d'autonomie et Napoléon décide alors d'une enquête
auprès des préfets confiée à Savary, le ministre de la
police, pour prendre la mesure de la concurrence que font
aux lycées ces institutions privées, particulièrement les
écoles secondaires ecclésiastiques. Tout cela s'effectue
dans un climat de tension extrême avec le Saint-Siège
puisque Pie VII a été placé à Savone en résidence
surveillée, et que les catholiques doivent subir des
mesures coercitives. Savary demande aux préfets de
surveiller le choix des textes pour en déduire
l'attachement ou l'opposition du maître à l'État, de voir
comment l'histoire de la famille régnante est traitée…
L'Église n'apparaît plus, en dehors du primaire, comme
le soutien de l'État mais comme un adversaire possible,
qu'il faut préserver en le muselant.
À la suite de cette enquête, on décide, en 1810, de
renforcer l'importance des lycées en augmentant leur
nombre et les effectifs tout en limitant le nombre des
écoles secondaires confessionnelles. Le décret
d'application est signé le 15 novembre 1811. Il ne doit en
outre plus exister qu'un petit séminaire par département.
Pour revenir à l'enseignement primaire, après avoir laissé
se développer les congrégations religieuses enseignantes,
à l'image de la congrégation des Frères des Écoles
chrétiennes, l'État constate en 1811 que le nombre de
120
frères de cette dernière institution s'élève à 274, répartis
dans 42 maisons et il paraît urgent que leur contrôle soit
plus intensif. On encourage ainsi les instituteurs laïcs à
prendre leur autonomie par rapport au clergé, par
exemple en acceptant la charge de secrétaire de mairie
plutôt que celle de sacristain.
L'enseignement féminin conserve son autonomie et sa
fragilité sous l'Empire. Si ce n'est quand il encourage la
création des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
l'Empire s'en préoccupe peu. Pourtant, bien qu'en retrait
par rapport à celui des garçons, l'enseignement primaire
des filles se développe, grâce en particulier à l'essor des
congrégations féminines que l'État a encouragé. Cette
instruction a pour finalité de former de bonnes mères de
famille. Les jeunes filles n'ont cependant accès ni aux
lycées ni à l'enseignement supérieur ni à aucune des
écoles spéciales, réservés à l'élite des lycéens.
L'Université napoléonienne se soucie assez peu d'une
École qui apporterait à chacun les mêmes chances et qui
aurait pour premier but de concourir au développement
de l'individu. L'Empire a besoin de cadres, d'ouvriers, de
militaires et plus encore de "sujets" soumis, ce qui
explique son intérêt pour la rénovation du système
scolaire, mais aussi, après avoir cru en profiter et avoir
ainsi calmé les esprits religieux, son attitude vis-à-vis des
congrégations. L'empereur ne veut surtout pas voir se
reconstituer la puissance de l'Église, une sorte d'État
dans l'État, mais en même temps, il désire conserver un
allié soumis et contrôlé, qui prend en charge une grande
part du parent pauvre de l'enseignement : le primaire, en
veillant à une éducation morale et religieuse garante
121
d'obéissance.
.
Après l'Empire.
En matière d'enseignement primaire, on assiste au début
de l'enseignement mutuel dont on copie les
développements en Angleterre, à l'incitation des milieux
libéraux (enseignement mutuel de Bell et Lancaster dont
les traités sont adaptés dès la fin de l'Empire : Plan
d'éducation pour les enfants pauvres d'après les deux
méthodes combinées du Dr. Bell et de M. Lancaster, la
fameuse méthode Jacotot sous la Restauration). Le
monde de l'industrie anglo-saxon a découvert depuis
longtemps la valeur économique et sociale de
l'instruction populaire et certains esprits "ouverts" en
France pensent de même. Lazare Carnot prônera ainsi
l'éducation du peuple: "pour les intérêts de la
civilisation, pour ceux des bonnes moeurs et de l'ordre
public, pour ceux de la liberté, pour ceux enfin de
l'industrie agricole et manufacturière."
On ne pense plus du tout au bonheur de l'individu, mais
définitivement aux "intérêts de la civilisation", intérêts
supérieurs bien entendu et qui sont aisés à définir ! Le
bonheur pour la majorité sera dans une autre vie.
L'eschatologie expliquée au peuple justifie tout !
Ces préoccupations ont été clairement exprimées dans les
statuts de L'école mutuelle.
122
Son introduction en 1816 répondait à un triple objectif :
- économique, car la méthode n'exige que peu de
dépenses,
- social, car elle fournira la main-d'oeuvre qualifiée
nécessaire en ces premiers temps de l'ère industrielle,
- politique puisque les promoteurs de ce type
d'enseignement veulent comme sous l'Empire - assurer
la mainmise de l'État sur le système scolaire. La méthode
mutuelle est aussi une réplique à la méthode simultanée
mise en place par les Frères des écoles chrétiennes et elle
sera partiellement utilisée dans les salles d'asile qui
apparaîtront bientôt et sur lesquelles nous reviendrons.
Sur l'école mutuelle on se reportera à l'excellent livre d'Anne
Quérien, L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace ? Éd. Les
empêcheurs de penser en rond, qui en retrace l'histoire, une
histoire que l'école de la République ignore étrangement. L'école
mutuelle avait été créée pour les déshérités, le but étant de sortir
les enfants de la rue et de leur donner un savoir minimal conforme
à leur classe sociale : lire, écrire, compter, un objectif certes
discutable à nos yeux puisqu'il cloisonne apparemment les classes
sociales, mais il faut replacer ces tentatives dans leur contexte
historique. D'ailleurs, plusieurs intellectuels socialistes du XIXe
siècle - comme Proudhon - lui doivent leur essor ! En gros, le
nombre d'enfants par classe est important (économie de
personnel !), les élèves travaillent en groupes : ceux qui ont
compris expliquent aux autres. Tour à tour, chacun est élève et
"maître". Les différences de niveau ne sont plus un obstacle au
bon fonctionnement mais en deviennent le moteur. Cette école a
été rejetée pour deux raisons principales : les élèves apprenaient en
trois ans le curriculum prévu pour six et on prétendait qu'ils
n'apprenaient pas le respect du savoir ! On comprend que - en
dehors de considérations idéologiques - l'idée à la base de cette
méthode n'ait pas trouvé grâce auprès du corps enseignant, dont le
rôle, le savoir et la caste étaient menacés ! Si aujourd'hui, on parle
peu de cette méthode dans les IUFM, c'est pour les mêmes raisons
corporatistes et parce que le "maître" (la voix de son maître) est
123
encore le garant des droits du système, alors qu'il y a là une voie
intéressante pour "déscolariser l'école" si l'on ne se contente pas
d'y voir le moyen d'assigner chacun à sa place en fonction de ses
origines et/ou des besoins économiques.
Selon Anne Quérien, la méthode simultanée des Frères des écoles
présente pour sa part les caractéristiques suivantes, qui la
distinguent de la méthode mutuelle :
L'enseignant a un rôle d'autorité exclusif
Le maître indique ce qu'il faut lire, écrire, compter
Les tâches du maître ne sont pas cantonnées à l'organisation et à
la surveillance
Le maître corrige sur des cahiers de devoirs
Il n'y a pas d'autocorrection systématique et exclusive
La discipline est imposée et l'autorité non partagée
Une surveillance constante est recommandée, et favorisée par
l'architecture
L'enseignement est uniforme, les programmes sont normalisés
Les élèves ont même maître, même livre, même leçon, même
correction
Les élèves ont une place fixe, dans une classe déterminée par le
niveau scolaire
L'architecture et le fonctionnement sont normalisés
L'homogénéité des élèves (âge, aptitudes) est un facteur
d'efficacité
Le silence et l'immobilité sont requis avec insistance
Le nombre maximal d'enfants par enseignant est plutôt limité
Le niveau individuel ne coïncide pas nécessairement avec le
niveau du groupe
L'attention spontanée de l'élève est peu ou pas courante
L'apprentissage est fondé sur l'effort, l'enfant quitte la classe sans
regret
L'élève apprend l'obéissance pour travailler, non pour commander
La soumission à l'autorité du maître est un facteur d'efficacité.
En bref : l'esprit contestataire et militant, la solidarité
qu'encourage l'enseignement mutuel est systématiquement
supprimé. Le désir de travailler par obéissance subsiste presque
seul. Le collectif est mis sous surveillance, la coopération
quasiment impossible, les comportements uniformisés. On
comprend l'intérêt qu'y porte l'état bourgeois !
124
En 1820-1830 l'introduction progressive du machinisme
et l'industrialisation entraînent en effet la division et la
déqualification du travail traditionnel. Pour favoriser le
progrès industriel, il est alors nécessaire de former une
classe ouvrière susceptible de s'adapter aux évolutions de
cette industrie nouvelle. Les cours du soir fleurissent
alors. La formation professionnelle est cependant d'abord
moins technique qu'idéologique. La finalité réelle est de
contrôler et mettre au pas les travailleurs : enfants comme
adultes, une "mise au pas" qui avait été pendant des
siècles la mission de l'Église et que, face à cette alliée
désormais souvent indocile, on préférait "laïciser". Bien
entendu, tous ces jeunes gens, ces intellectuels comme le
poète breton Brizeux dont on admire alors le poème
Marie, qui donnent généreusement des cours du soir aux
ouvriers, le font par idéalisme et désir d'enrichir
l'homme, d'accélérer le progrès social, mais ils ne sont
pourtant que les instruments d'un système qui les dépasse
et a d'autres visées !
Un catholicisme social a toujours été une composante plus ou
moins importante de l'Église. Claude Fauchet, sous la Révolution,
en a été un des représentants. Après l'Empire, les milieux opposés
au libéralisme politique et économique et certains milieux
progressistes, attachés à la démocratie, lui redonnent un nouvel
élan. Les premiers considèrent que le "libéralisme économique"
est issu de la Révolution et que la situation de pauvreté dans
laquelle se trouvent les ouvriers est le résultat de l'abolition des
corporations. Leur premier réflexe est d'appliquer les principes de
la charité, qui peut alors prendre les formes du paternalisme, tout
en rêvant d'un monde où chacun aurait sa place, serait conscient de
ses devoirs envers l'autre dans une société harmonieuse et fixée
sous les auspices d'une solidarité revivifiée par la religion. Les
seconds tentent de développer un socialisme chrétien qui, s'il
125
s'oppose moins nettement au libéralisme économique, refuse
l'exploitation - telle qu'elle se pratique - des individus. Félicité de
Lamennais (1782-1854), Philippe Buchez (1796-1865), Henri
Lacordaire (1802-1861) puis Frédéric Ozanam (1813-1853) ou
Charles de Montalembert (1810-1870) en sont les représentants les
plus éminents.
Entre l'État qui encourage l'école mutuelle jusqu'en
1840 et le mouvement ouvrier naissant, il existe
d'ailleurs une convergence de vues sur le mutualisme
scolaire : le premier parce qu'il y voit le moyen
d'éduquer un grand nombre d'enfants à peu de frais dans
le sens des besoins du développement industriel, le
second parce qu'il est idéologiquement séduit par le
mutualisme social. Cependant, dans les deux cas, le
travail est considéré comme la valeur essentielle (le
mouvement révolutionnaire de 1848 se structurera autour
de la revendication du travail pour tous) ce qui se
comprend quand un important prolétariat urbain ou rural
n'a pour toute ressource que la force de ses bras, mais
cette réalité se mêle d'une mythification du travail, le
moyen de vivre devenant quasiment l'essence de
l'individu, sa justification sociale (quand il n'appartient
pas aux "nantis" !). Une aristocratie ouvrière formée
des plus qualifiés de ses membres, participe de cette
mythification que les patrons, l'Église et l'État
encouragent, une nouvelle aristocratie qui écrit, fréquente
les écrivains et les penseurs comme Agricol Perdiguier,
Avignonnais-la-Vertu, l'auteur des Mémoires d'un
compagnon et l'ami de George Sand, une minorité qui
donne l'impression que l'école permet à chacun d'avoir
au fond de sa musette son bâton de maréchal… comme
si devenir maréchal était la finalité de l'enseignement !
126
L'ensemble de ces mouvements se fait toutefois dans le
cadre d'une certaine peur de la bourgeoisie qui voit à la
fois dans l'école une nécessité pour l'industrie qui se
développe, un danger dans la mesure où l'accession à un
certain degré de culture menace son pré carré, sans parler
d'une dépense insupportable.
De 1815 à 1830, la révolution industrielle poursuit donc
ces tendances et induit une réflexion sur l'éducation qui,
d'une part, la "professionnalise" : il convient de
préparer les individus à leur rôle social de futurs
producteurs (on ne parle pas encore de consommateurs,
mais cela viendra vite) et de sélectionner ceux qui seront
les cadres de la nation. D'autre part, des médecins
intéressés à l'enfance déficiente comme les docteurs
Itard, Seguin se préoccupent aussi d'éducation dans une
perspective hygiéniste et rejoignent ceux qui clament,
pour toutes sortes de raisons (humanistes, sociales,
sécuritaires…) la nécessité de faire garder les enfants des
cohortes de parents enfermés douze heures dans les
usines.
Dans les pays allemands (particulièrement de confession
luthérienne) certains pasteurs et pédagogues prennent très tôt en
compte la petite enfance. En France, à la fin du XVIIIE SIÈCLE, sous
l'influence de Rousseau et de Pestalozzi, des initiatives privées
comme celle du pasteur Jean-Frédéric Oberlin qui ouvre dès 1771
une "école de tricots" dans les Vosges, accueillent les tout petits.
Mais ce type d'établissement (Oberlin implique des préoccupations
pédagogiques) est rare, la plupart ne sont au mieux que des
garderies ("salles d'accueil") qui se multiplieront avec la
révolution industrielle. Leurs promoteurs (souvent des
bourgeoises) désirent offrir un lieu de protection aux enfants dont
les parents travaillent pour les soustraire à la rue. Ce type de refuge
est appelé salle d'asile ou salle d'hospitalité à l'exemple de celle
fondée par Adélaïde Piscatory de Vaufreland, marquise de Pastoret
dès 1801, et les préoccupations sont d'abord sociales, hygiénistes,
127
charitables et morales. Le modèle des infant schools du Royaume-
Uni inspire de nombreuses âmes charitables sous la Restauration.
L'une d'elle, Émilie Oberkampf, se dépensera sans compter pour
les premières salles d'asile parisiennes et la formation des
éducatrices en amont, car on veut aller plus loin que le simple
gardiennage. En 1836, ces salles, qui se sont multipliées sous une
forme ou sous une autre (voir plus bas) sont rattachées au ministère
de l'Instruction publique La loi Falloux marque le premier pas vers
leur intégration dans le système scolaire. Elles reçoivent une
impulsion décisive grâce à Marie Pape-Carpantier et prennent le
nom d'écoles maternelles, d'abord le 28 avril 1848, puis le
deviennent officiellement en 1881 sous l'autorité de Pauline
Kergomard, première inspectrice générale du maternel. Celle-ci
s'oppose à la tendance majoritaire qui veut faire de ces écoles des
lieux d'instruction à part entière, voulant plutôt favoriser le
"développement naturel" de l'enfant, en faire de véritables lieux
d'éveil ce qui n'ira pas toujours dans le sens des ministres de la
République dont elle dépendra !
Les libéraux et socialistes prônent pour leur part une
éducation intégrale (Proudhon, Fourier, Saint-Simon ou
Marx), mais, à de rares essais près, ils en restent à la
théorie et ne font pas… école. Marqués par l'esprit des
Lumières, le principe de l'utilité sociale demeure chez
eux central et cette tendance occulte le principe d'un
développement personnalisé de l'individu.
Ainsi, Saint Simon (mort en 1825) accorde une grande
importance à l'éducation, mais pour lui, le savoir est une
conséquence directe du développement de la production.
Il imagine une société fondée sur les sciences, possédant
un système éducatif centralisé et obligatoire. Il distingue
l'éducation et l'instruction, accordant sa préférence à la
première : "c'est l'éducation proprement dite qui forme
les habitudes, qui développe les sentiments, qui épanouit
la capacité en prévoyance générale, c'est elle qui
apprend à chacun à faire application des principes et à
128
s'en servir comme de guides certains pour diriger sa
conduite."
Pour lui, prenant l'exemple de la Russie, il est évident
que des prolétaires français ne sachant ni lire ni écrire
mais ayant reçu l'éducation qu'il prône, seront davantage
capables de travailler utilement que des moujiks auxquels
leur propriétaire aura fait apprendre à lire et écrire. En
effet, ces prolétaires français "sont en état de bien
administrer une propriété ; ceux qui sont attachés à la
culture sont capables de diriger des travaux de ce genre ;
il en est de même pour ceux qui sont attachés à des
travaux d'arts et métiers : tandis que les Russes, à qui on
aura enseigné la lecture et l'écriture, n'auront reçu de
leurs parents qu'une éducation semblable à celle que
ceux-ci avaient reçue eux-mêmes, c'est-à-dire une
éducation très mauvaise ; et si vous essayez de confier
l'administration d'une propriété quelconque à ces
Russes sachant lire et écrire, vous verrez ces propriétés
dépérir dans leurs mains."
À son avis, l'éducation et l'instruction publique doivent
assurer la "propagation des connaissances". Le jeune
doit apprendre à lire, compter, écrire, dessiner, faire de la
musique et cette éducation ne doit plus dépendre de
l'Église. Saint Simon est enthousiasmé par la jeunesse
populaire qu'il idéalise et qui est "avide d'instruction
bien plus que les oisifs de nos salons." Il s'intéresse de
près à toute la jeunesse, qu'il divise entre trois groupes.
D'abord l'enfant, de 0 à 7 ans, puis l'adolescent de 7 à 14
ans, âge où les passions "s'enflamment dans l'individu,
en même temps qu'il acquiert la faculté de produire son
semblable" ; enfin, le jeune homme, de 14 à 21 ans qui
doit devenir immédiatement utile à la société, mais il
s'agit de la société dont il rêve !
129
*
Sur le plan du déroulement de la politique scolaire,
pendant cette période, on conserve globalement l'héritage
institutionnel napoléonien. Un évêque sera même Grand
Maître de l'Université (Frayssinous).
En bref, sous la Restauration, les partisans modérés de
Decazes soutiennent les projets de la Société pour les
progrès de l'instruction élémentaire (Journal
d'éducation).
On institue certes un brevet de capacité pour les
instituteurs, mais ils sont inspectés par les curés et des
subventions sont accordées aux écoles élémentaires
Avec les Ultras et Villèle (1820-1828) on redonne des
avantages aux congrégations et le mouvement du
primaire stagne.
Avec Martignac et les modérés (1828-1829) se poursuit
le développement de l'éducation mutuelle et surtout les
salles d'asile sous une nouvelle forme.
En effet, en 1826 Jean-Marie-Denys Cochin (1789-1841)
tout récent maire du XIIe arrondissement, est frappé par
la pauvreté et l'abandon de beaucoup d'enfants en bas
âge, délaissés par leurs parents par misère, paresse ou
parce qu'ils doivent travailler. Il reprend alors l'idée tant
de fois abandonnée des salles d'asile et réunit des petits
indigents dans deux pièces qu'il loue rue des Gobelins. Il
s'occupe lui-même de ces enfants, imagine et développe
une méthode appropriée à leur âge, et la transmet à ceux
dont il veut faire des maîtres. Son exemple devait vite
faire des émules. À la même époque, par exemple,
comme nous l'avons indiqué, en 1828, Émilie
Oberkampf, fait ouvrir une salle d'asile parisienne.
130
Encouragé par ses résultats et l'écho qu'il en recevait,
Cochin décide pour sa part de fonder un établissement
qui servirait de préparation à l'école primaire. Son
Manuel des salles d'asile (publié en 1833) couronné par
l'Académie française comme le meilleur livre publié
dans l'année est consacré à ce projet : "C'est pour
suppléer, écrit-il, aux soins, aux impressions, aux
enseignements que chaque enfant devrait recevoir de la
présence, de l'exemple et des paroles de sa mère, qu'il a
paru nécessaire d'ouvrir des salles d'hospitalité et
d'éducation en faveur du premier âge."
Il sollicite Mme Millet, l'épouse du peintre Frédéric
Millet, dont il a fait la connaissance et qui s'intéresse à
ses travaux pour se rendre en Angleterre où, elle passe
deux mois à visiter les écoles et à étudier l'organisation
des Infants schools. À son retour, elle ouvre un premier
asile rue des Martyrs qui annonce par certains aspects les
futures écoles maternelles. Parallèlement, Cochin ne
relâche pas ses efforts et peaufine son projet d'une "
maison complète d'éducation primaire" dont la salle
d'asile telle qu'il l'imagine sera à la fois le point de
départ et la structure de base, le fondement.
Cependant, ce plan proposé au préfet de la Seine, est
considéré comme impraticable, mais on ne manque pas
de saluer le rêve d'un homme de bien !
Ce refus ne le décourage pas et, en quelques mois, il met
en place un établissement susceptible d'accueillir plus
d'un millier d'élèves tout en offrant quatre logements
destinés aux maîtres. Une École normale, des salles
d'asile, dirigées par Mme Millet, complètent le dispositif.
Le succès est immédiat et conduira l'administration
municipale à le solliciter pour devenir propriétaire de
l'établissement et lui succéder (début 1831). Voyant dans
131
cette demande le fruit de ses efforts et les prémisses d'un
élargissement national, il donne son accord et n'accepte
qu'un dédommagement dérisoire. Dès le 22 mars 1831,
par ordonnance royale, son nom sera donné à
l'établissement. L'État relayait en quelque sorte la
reconnaissance publique.
En 1836, ces salles, qui se sont multipliées sous une
forme ou sous une autre, seront rattachées au ministère de
l'Instruction publique La loi Falloux marquera le premier
pas vers leur intégration dans le système scolaire. Elles
recevront une impulsion décisive grâce à Marie Pape-
Carpantier (qui sera révoquée en 1874 pour librepensée
!) et prennent le nom d'écoles maternelles,
d'abord le 28 avril 1848 et pour une courte période, puis,
officiellement et durablement, en 1881, sous l'autorité de
Pauline Kergomard, première inspectrice générale du
maternel.
Toute cette action s'inscrit globalement dans le cadre des
préoccupations charitables, caritatives de la société
bourgeoise du temps. Les préoccupations pédagogiques,
l'idée d'un développement harmonieux des individus ne
sont certes pas totalement absentes des préoccupations
des initiateurs, mais on souhaite en premier lieu juguler
la misère, permettre à des enfants autrement condamnés à
grossir les rangs d'un prolétariat misérable et en
définitive dangereux - moralement, économiquement,
politiquement - d'acquérir le minimum d'éducation qui
permettra d'en faire d'honnêtes travailleurs.
132
Libéraux et clergé réclament la liberté de
l'enseignement ; la République nous
appelle…
François Guizot (1787-1874) est ministre de l'Instruction
publique de 1832 à 1837. La loi qu'il fait passer, du 28
juin 1833 marque une étape importante : libre ouverture
d'écoles à ceux qui ont les titres, action concertée de
l'Église et de l'État pour une école moralisant et
consolidant le nouvel ordre économique et social tout en
favorisant l'essor économique.
- Chaque commune de plus de 500 habitants doit avoir
et entretenir une école primaire de garçons puis de
filles.
- Création d'écoles primaires supérieures dans les
chefs-lieux ou dans chaque ville de plus de 6000
habitants.
- Création d'Écoles normales
- Inspection primaire décrétée dès 1835. Les salles
d'asile (maternelles) sont officialisées en 1836. Des
cours d'adultes et des écoles pour filles non
obligatoires sont conseillés la même année.
- Le ministre lance un dispositif centralisé de direction
et d'administration de l'institution primaire. Son
collaborateur, Paul Lorain, parvient à réconcilier les
anticléricaux avec la méthode simultanée, ce qui
133
marque la fin de l'enseignement mutuel et des
potentialités libertaires qui pouvaient y être liées.
1848 voit une victoire à la Pyrrhus des Républicains : la
loi Guizot est modifiée dans le sens de la gratuité et de la
laïcité avec la liberté de l'Enseignement. La bourgeoisie
libérale effrayée par les événements et la montée des
idéaux révolutionnaires comme en témoigne par exemple
l'Association fraternelle des instituteurs socialistes, fait
voter la loi Falloux (1850), (liberté de l'enseignement
secondaire, fin des EPS, et la loi Parieu même année
contre les instituteurs propagandistes de la République).
Thiers, le futur contempteur de la Commune, écrit alors :
"Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup
plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte beaucoup
sur lui pour propager cette bonne philosophie qui
apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir".
Le travail ne doit pas être une partie de plaisir, la vie non
plus. L'école fera profit de ces hautes pensées, l'école
primaire particulièrement !
Profession de foi de l'Association fraternelle des instituteurs,
institutrices et professeurs socialistes - 1849 - Gustave
Lefrançais, Pauline Roland, Pérot
"En présence de Dieu et de l'Humanité, nous, démocrates
socialistes, nous associons dans le but de faire participer aux
bienfaits d'une éducation républicaine tous les enfants et tous les
adultes, hommes et femmes, qui pourront profiter de cette
éducation. [...]
Nous croyons de tout notre esprit, de tout notre coeur, de toutes nos
forces, en Dieu, principe de toute vie.
Nous croyons à l'Unité du genre humain, à la Solidarité, à la
Fraternité de tous les hommes entre eux.
Nous croyons que l'Humanité contient dans son sein, à titre de
membres égaux, tous les individus qui composent la famille
humaine.
134
Nous croyons à l'Égalité parfaire de l'homme et de la femme, à
l'Égalité parfaite de tous les êtres humains entre eux.
Nous croyons à la perfectibilité de l'homme et de l'Humanité, à
leur progrès incessant et indéfini.
Nous croyons qu'il n'y a de salut pour l'Humanité que dans une
Association volontaire, religieuse, parfaitement libre, fraternelle et
égalitaire de tous les hommes entre eux.
Nous croyons que toutes les nations sont soeurs et doivent se
considérer comme les membres divers d'une même famille.
Nous croyons à la souveraineté du Peuple ; la République est à nos
yeux la seule forme de gouvernement légitime. Elle doit réaliser
pleinement la Liberté, Égalité, Fraternité.
Nous croyons au droit, à la sainteté et à l'éternité de la Famille,
société particulière, qui doit subsister d'une façon harmonique au
sein de la grande société humaine à laquelle elle est liée.
Nous croyons qu'il ne doit plus y avoir ni riches, ni pauvres, ni
privilégiés, ni déshérités, ni supérieurs, ni inférieurs, ni enfin
d'autre hiérarchie que celle qui est nécessaire pour le jeu des
diverses fonctions que nous reconnaissons comme étant toutes
égales entre elles.
Nous croyons que tous les hommes étant égaux et frères, ils ont
tous un droit égal et imprescriptible au développement de leurs
facultés physiques, morales et intellectuelles.
Nous croyons que chaque homme se doit à tous et que tous se
doivent à chacun.
Nous croyons que chacun a droit au travail ; que chacun a le devoir
du travail dans la limite de ses forces et de ses aptitudes.
Enfin, nous croyons que la formule républicaine : Liberté, Égalité,
Fraternité, contient le mot et la règle de la vie, et nous nous
engageons à ne jamais rien faire, rien dire, rien professer que dans
le but de réaliser cette formule sacrée ; de la faire comprendre,
aimer, pratiquer par tous ; et nous jurons de baser sur elle tout
notre enseignement, comme toute notre vie ".
In : Souvenirs d'un révolutionnaire, par Gustave Lefrançais, Paris
Société encyclopédique française 1972.
135
Sous le Second empire on assiste à une certaine
libéralisation, mais le contrôle des professeurs est
institué, moins sur le plan professionnel que sur celui de
leur inféodation. Avec Victor Duruy (1863-1869), on
assiste à la création d'un enseignement secondaire
moderne qui prend effet en 1865 pour les garçons
(moderne parce qu'il élargit les programmes dans le sens
d'une ouverture au monde, aux sciences avec toutes les
ambiguïtés que cela signifie : "une instruction
appropriée aux besoins des industriels, des agriculteurs et
des négociants"), et en 1867 pour les filles.
Les sciences et l'enseignement primaire
En 1833, sous Guizot, une loi prévoit au niveau de l'école primaire
supérieure l'étude des premiers éléments des sciences physiques et
de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie.
En 1848, Hippolyte Carnot, décide de l'enseignement des notions
simples concernant les phénomènes de la nature tant dans
l'enseignement élémentaire que supérieur.
En 1850, la loi Falloux rend facultatif l'enseignement des sciences
physiques et de l'histoire naturelle et le ministre Fortoul ira jusqu'à
leur suppression complète pour le primaire: "Pas de sciences dans
une école primaire circonscrite au lire, écrire, compter."
On réintroduit une initiation aux sciences, en 1860, par le biais
d'une bibliothèque dans chaque école primaire où l'on trouvera des
ouvrages vantant les avantages du progrès technique. Sous la
forme de récits d'un abord aisé, on pratique une politique de
vulgarisation de certains savoirs : l'histoire d'une rivière, du ciel,
d'une technique… L'hygiène et la morale sont directement liées à
ces approches.
En 1867, Victor Duruy renforce l'instruction scolaire au-delà de
l'âge de 12 ans en doublant les connaissances de base
(orthographe, grammaire, arithmétique) par de nouveaux
enseignements facultatifs tels que la chimie, l'histoire naturelle et
la physique. Pour reprendre les termes de l'époque l'enseignement
136
scientifique primaire passe de "superflu (…) au rang de bénéfice
supplémentaire que l'Instruction publique offre aux enfants des
classes laborieuses".
Puis, la leçon de choses est institutionnalisée : elle doit faire
comprendre aux élèves les bienfaits de l'observation et de la
réflexion, des savoirs utiles à celui qui va bientôt entrer dans le
monde du travail.
En 1882, la loi Ferry rend l'enseignement scientifique obligatoire
pour offrir aux enfants de la République, "un viatique de
connaissances positives utiles, immédiatement investissables (sic)
dans leur vie quotidienne", c'est-à-dire dans leur vie de
travailleurs.
Si le primaire stagne globalement malgré ces quelques
modifications et un statut plus affirmé (le ministre, qui
est un enseignant, fait revaloriser la condition des
instituteurs et voter la loi d'avril 1867 : toute commune
de plus de 500 habitants doit avoir une école de filles, les
communes pauvres seront aidées par l'État pour subvenir
aux frais d'une école gratuite. Les bourses sont
réorganisées et la création d'une "caisse des écoles" est
destinée à aider les élèves dans le besoin), la concurrence
avec l'Allemagne concentre toutes les attentions sur les
études supérieures et l'on cherche à donner un véritable
élan à la création d'écoles réservées à l'élite des
étudiants. Cela devient une affaire d'état. Ainsi, le 31
juillet 1868, un décret fonde l'École pratique des hautes
études "afin de développer la recherche et de former des
savants".
*
Toutes ces réformes, qui peuvent paraître raisonnables et
aller dans la bonne direction, on en fait toujours le même
but : venir au-devant des bouleversements économiques
137
et techniques que connaît la France ! Duruy, comme ses
prédécesseurs depuis le Directoire, pense que le pays a
besoin d'une école susceptible de former les individus
dont l'économie, le système libéral ne pourront se passer.
Qu'il en résulte une augmentation générale de la
fréquentation des écoles et une accession d'un plus grand
nombre à une classe moyenne en train de se constituer
(lentement) sont des conséquences secondaires dont ce
ministre peut sans doute se réjouir, mais qui en réalité
n'ont pas plus d'importance qu'un accroissement des
savoirs de la majorité puisque la finalité reste toujours la
même : l'adéquation des populations avec le système
économique et les productions.
C'est dans le même sens que la loi de 1867 a encouragé
les cours d'adultes et l'enseignement primaire féminin.
Rien de gratuit ! L'école dans son ensemble s'adapte à un
monde qui change. Pas l'inverse.
*
Les grandes révoltes des années 1830 (notamment celle
des canuts en 1831), la révolution de 1848 ont effrayé les
bien-pensants et provoqué une accélération du contrôle
de l'école primaire par l'État car l'instruction nécessaire
est une arme à double tranchant : l'ouvrier qui sait lire et
écrire peut déchiffrer une notice, un règlement, signer...,
mais il peut aussi se procurer de mauvais journaux, des
ouvrages proscrits ! Il peut revendiquer !
En 1833, Guizot a créé une direction centralisée de
l'instruction primaire. Il s'agissait moins d'assurer la
cohérence du système que de le surveiller ! Dès que
l'agitation sociale pointe l'oreille ou prépare des
barricades, la bourgeoisie qu'elle soit libérale ou ultra, se
retrouve contre l'adversaire commun : la classe ouvrière.
138
Dans cette optique, en plus de la préparation du futur
ouvrier aux tâches qui seront les siennes, l'École doit être
la gardienne, de l'ordre public. Elle doit préparer l'enfant
à affronter le monde du travail en contrebalançant "
l'influence pernicieuse que trop souvent la fréquentation
des ateliers exerce sur l'enfance" (Préambule de la loi
du 11 janvier 1850 sur l'ouverture le soir des écoles
d'apprentis). L'École est conçue comme un modérateur
d'opinion, le creuset du conformisme social !
Les ouvriers et leurs amis, les esprits avancés, ne sont pas
dupes de cette "machination", mais ils continuent à
vouloir voir dans l'École le moteur des changements
possible, le seul instrument capable d'avoir une action
révolutionnaire en éclairant les individus, car un homme
instruit serait un homme capable de se défendre, de
défendre ses droits même si personne n'oublie que cette
école tant voulue appartient à l'État bourgeois, et de plus
en plus. Selon François Furet et Mona Ozouf
(L'Alphabétisation en France de Calvin à Ferry) la
demande scolaire n'est pas le propre d'une catégorie
sociale mais de l'ensemble de la population (habilement
manipulée). Pourtant, certains libéraux et de nombreux
intellectuels que nous dirions aujourd'hui de gauche
s'interrogent sur le sens de cette éducation : est-elle
vraiment le moyen de contrebalancer l'aliénation qui
menace le futur ouvrier ? Fait-elle en sorte que l'enfant
ne soit pas livré sans défense au patronat ou bien n'estelle
pas avant tout simplement moralisatrice en
inculquant de fait les valeurs de la bourgeoisie, une sorte
de préparation à cette aliénation ? Quant aux rares
enfants de milieux défavorisés qui "réussissent" ne
sont-ils pas alors simplement de nouveaux bourgeois,
139
l'école et les diplômes servant en quelque sorte de lettres
de bourgeoisie avant de devenir les alibis du système qui,
avec la République, se donnera pour essentiellement
démocratique ?
Il est alors difficile de répondre à ces questions, car on en
est à un stade de pauvreté de la classe ouvrière, de
paupérisme, qui - comme actuellement pour certains
pays en voie de développement - fait que l'école doit
d'abord servir à permettre de survivre, c'est-à-dire d'être
plus apte à trouver un emploi et toute discussion sur une
éducation qui mettrait en retrait la problématique du
travail et ne viserait qu'à l'enrichissement de l'individu
est encore un luxe. On ne fait pas la Révolution avec un
peuple qui a faim, disait Gandhi, quand Ghelderode
affirmait qu'on ne fait pas la révolution sans discours !
La problématique n'a pas évolué. L'auteur de cet essai a eu
l'occasion de se rendre en Inde (Tamil Nadu) pour aider à la mise
en place d'une école primaire patronnée par une ONG reconnue
pour son sérieux et ses réalisations. Pour le volontaire découvrant
cet immense pays, la première source de réflexion est constituée
par le fait que l'Inde possède un système scolaire d'État,
obligatoire et gratuit, les enfants recevant d'ailleurs un repas le
midi (ce qui le rend "attractif" pour les plus malheureux !).
Cependant, le poids des mentalités aidant, nombreux sont les
enfants (de castes défavorisées - même si celles-ci n'existent
officiellement plus, résidant dans des zones excentrées, dans des
états pauvres…) qui ne la fréquentent pas ou seulement pour y
recevoir la nourriture promise. Il est en outre vrai que ces écoles
publiques sont parfois (souvent ?) assez mal gérées : les classes
sont surchargées, certains enseignants, fonctionnaires titulaires,
délèguent parfois leurs pouvoirs à des "remplaçants" rétribués
par eux afin de s'adonner librement à des activités encore plus
rémunératrices, plus juteuses. Les niveaux sont forcément très
divers… Le but de cet enseignement est essentiellement de
140
permettre que tous les futurs adultes atteignent un ensemble de
connaissances seulement suffisant pour former les travailleurs
utiles au "tigre" indien. Les études supérieures sont certes
également développées, mais ouvertes à une minorité d'élèves
fréquentant le secteur public et à une majorité d'enfants inscrits
dans le secteur privé, qui s'est très vite développé : il existe un
véritable marché de l'éducation en Inde (comme dans tous les pays
en voie de développement) avec des écoles proposant en échange
de frais d'écolage modestes ou énormes un enseignement prétendu
de "qualité" (ce qui est malheureusement souvent faux, car les
escrocs sont nombreux) et des réseaux qui permettront à l'enfant
de réussir dans une société particulièrement dure. Quels parents ne
seraient pas prêts à tous les sacrifices pour qu'au moins un de leurs
enfants "réussisse" et fasse rejaillir ensuite cette réussite sur
l'ensemble de la famille ?
Mon école, initialement prévue pour scolariser les nécessiteux,
était donc par la force des choses une école de droit privé. Les frais
de scolarité très bas (une centaine d'euro par an) ne permettaient
l'accès qu'à des enfants de la toute petite bourgeoisie de cette
région très pauvre. Les parents, qui faisaient de réels efforts,
voyaient d'un mauvais oeil que des enfants de familles dénuées de
moyens, parrainés par des Européens, soient assis à côté de leurs
enfants pour lesquels ils payaient, eux, une rétribution ! L'école
était là dans l'esprit des parents pour que les enfants qui la
fréquentent aient plus tard "une bonne situation" et gagnent
beaucoup d'argent en se recommandant justement d'avoir effectué
leur scolarité puis leurs études en dehors du système national
gratuit, un avenir solide que les écoles d'état ne pourraient (à leur
avis) pas assurer !
On demandait en bref à une ONG de préparer la ségrégation
sociale de demain !
Dans les dernières années du second Empire, toutefois,
une évolution se marque : la conscience de classe
s'impose à la conscience "professionnelle".
141
On clame le besoin et la valeur d'une bonne éducation
générale, bénéfique à l'individu, au détriment du modèle
qui se développe le plus : l'école professionnelle, car il
est désormais clair que cette antichambre de l'atelier ou
de l'usine ne sert qu'à maintenir la division des classes et
l'immobilité sociale.
L'écrasement de la Commune marque pratiquement la fin
de ce débat. Et Jules Ferry fera de l'école comme
l'indique E. Plénel "un lieu clos soumis à l'autorité sans
partage de l'État" et comme toujours, le chemin de
l'enfer sera pavé de bonnes intentions ! Nous avons déjà
eu l'occasion de voir quelle était son attitude : il n'innove
en rien ni avec l'école primaire ni avec les écoles
professionnelles et l'espérance d'une promotion pour
ceux qui seront les "sous-officiers" de l'industrie
nouvelle.
Cependant, cette autorité sans partage ne se fera pas d'un
coup.
La République est certes proclamée après la défaite de
1871, mais c'est une république des grandes villes et
l'exercice du pouvoir lui échappe en fait. La population
rurale ou semi-rurale continue à voter pour les notables
associés comme toujours au clergé. Comment faire
d'ailleurs autrement puisqu'ils sont les seuls censés
posséder "l'instruction" ! Aussi, dès que les
Républicains parviennent à assurer le pouvoir exécutif en
1879, ils considèrent que la priorité des priorités est de
généraliser une instruction primaire qui, certes, depuis la
monarchie de juillet avait fait d'énormes progrès, mais
qui ne s'était en rien affranchie de la tutelle cléricale. Dès
1869, ils avaient réclamé "l'instruction primaire, laïque,
gratuite et obligatoire", seul moyen d'échapper à
142
l'emprise des prêtres. Dès 1880, le Conseil supérieur de
l'instruction publique est laïcisé : n'en sont plus membres
que des enseignants élus et n'appartenant pas au clergé.
La lettre d'obédience des enseignants congréganistes n'a
plus aucune valeur : pour enseigner, il faut désormais au
moins un "brevet de capacité". À partir du 9 août 1879,
chaque département doit se doter d'une école normale
primaire de filles et de garçons et, en juillet 1880, l'école
normale de Fontenay est créée pour former les
professeurs d'écoles normales. En 1881, l'enseignement
primaire est (enfin) rendu vraiment gratuit ; en mars
1882, l'obligation scolaire et la laïcité entrent dans les
faits (6 à 13 ans) et en 1886 la loi Gobelet décide de la
laïcisation des enseignants des établissements publics.
En compensation à cette charge contre le monopole de
fait que l'Église s'était reconstitué après le premier
Empire, le jeudi est "libre" pour que les parents qui le
souhaitent puissent envoyer leurs enfants au catéchisme.
Sur un autre plan, la défaite de 1871 impose
définitivement l'idée qu'il faut réformer l'Université sur
le modèle allemand (!) et accorder davantage
d'importance aux sciences. Parallèlement, les grandes
écoles se développent, car on souhaite former de plus en
plus d'ingénieurs, particulièrement dans les technologies
nouvelles.
La République a ainsi deux objectifs principaux : former
la masse de la population à un niveau qui lui permettra
d'échapper à l'influence du clergé et participer à l'effort
de modernisation ; créer de nouveaux notables,
républicains et techniciens capables d'assurer le lien
entre les masses salariées et le patronat, nouveaux
notables dont semble avoir besoin un pays qui vient
d'être vaincu et qui se remet mal de la défaite. En même
143
temps se dessine une élite administrative de hauts
fonctionnaires formés dans de grandes écoles payantes
dont l'École libre des sciences politiques, une
technocratie avant l'heure, alors que l'université
réformée "à l'allemande" n'a qu'un but : créer une élite
intellectuelle.
Élite donc d'une part pour ne pas dire nouvelle
aristocratie (qui englobe tout de même une bonne part de
l'ancienne !), ouvriers et employés d'autre part, et une
école primaire sous le régime d'une apparente
méritocratie permettant à quelques enfants du peuple de
devenir ces "sous-officiers de l'industrie nouvelle" ou
les hussards noirs de la République, voire parfois mais
rarement - alibi suprême de l'égalité républicaine, de
rejoindre l'élite.
Le mouvement ouvrier, récemment organisé, est à
nouveau partagé : faut-il tenter de "détruire" cette école
qui a toujours été l'instrument des puissants ou faut-il
jouer le jeu et en tirer le meilleur parti dans un monde qui
semble ne pas pouvoir échapper au "modernisme" ? En
réponse à l'école officielle qu'il accuse de conforter les
inégalités, il "bottera en touche" et favorisera les
passerelles souvent illusoires : les Bourses du travail
(fédérées en 1892) et les Universités populaires (1899),
soutenues au départ par la bourgeoisie libérale.
Cependant, l'illusion est de courte durée : les intellectuels
qui viennent y enseigner, souvent avec les meilleurs
sentiments du monde comme leurs prédécesseurs
idéalistes en 1830 et 1848, sont à mille lieues de leur
public et des problèmes qui les assaillent. Le discours
passe mal. Quant aux diplômes, ils sont inexistants. Les
Bourses du travail tentent la création d'écoles syndicales
en 1900 mais sans succès. La guerre de 1914-1918
144
marque leur fin définitive. Le monopole de l'État est
gravé dans le marbre.
Instrument de l'Église à ses origines, puis lieu de
rencontre entre ces deux alliés que sont l'État
monarchiste et l'Église, l'École devient l'objet de l'État
et de l'idéologie capitaliste qui le sous-tend ou le tient en
otage.
*
Au-delà du consensus sur les vertus émancipatrices de
l'instruction, la lutte entre l'Église et l'État pour le
contrôle de l'appareil scolaire a masqué un autre enjeu.
En effet, deux conceptions de l'éducation des enfants du
peuple ont été envisagées au cours du XIXème siècle
autour de la question de savoir s'il fallait ou non marquer
un lien entre école et production. Au terme du siècle, la
République semble refuser en apparence ce lien direct
pour les plus petits. Elle bâtit, pour assurer sa pérennité et
maîtriser le corps social, une école fermée sur elle-même.
Pour reprendre les termes de Plénel, "c'est parce que
l'école républicaine s'élève contre le travail des enfants,
ce délitement de la famille ouvrière, qu'elle réussit à
imposer l'État éducateur". En réalité, ayant diminué
pour une large part l'influence de l'Église, c'est aussi
pour s'y substituer et assurer une "préparation" parfaite
à une société laïque marquée par le positivisme : passé
par le crible de la morale, des mythes nationaux et de la
discipline scolaire, pourvu du minimum nécessaire à sa
future exploitation, la majorité des enfants des classes
défavorisées est intellectuellement apte à entrer dans le
monde du travail tel qu'on le conçoit désormais pour
elle ! Pour le coup, on comprend pourquoi les rares
145
tentatives pour inscrire l'éducation des enfants du peuple
dans le réel d'un autre type de production que celle à
laquelle ils seront destinés, qu'il s'agisse d'un Paul Robin
ou plus tard d'un Célestin Freinet, n'ont pu se réaliser
qu'en marge du système !
De son côté le mouvement ouvrier, dans sa majorité,
détourne ses espoirs en l'instruction nationale au profit
d'un outil qu'il veut plus efficace ou plus immédiat, car il
vise d'abord à la nécessaire amélioration matérielle des
conditions de vie de la classe ouvrière, pas à un
changement structurel, idéologique (inimaginable pour la
majorité) de société : le syndicat. Dans la même logique,
il confie au syndicalisme enseignant le soin de réformer
l'école officielle dans le sens des attentes d'un monde
misant sur le progrès technologique et la rivalité des
nations. On pourrait conclure avec Bernard Charlot que "
l'école primaire de la IIIème République naîtra à partir de
ce consensus qui concilie l'entreprise bourgeoise de
moralisation et la revendication ouvrière de dignité" si
l'on ne devait souligner que rien ne change
fondamentalement. L'Église avait longtemps fait de
l'école sa chasse gardée et un élément important de son
pouvoir ; la montée en puissance de l'État se fait certes à
son détriment, mais l'État, dans un consensus quasiment
absolu, en fait à son tour sa chose, la confisque à son
profit et au profit du système économique auquel il est
inféodé. L'Église, bien implantée dans le siècle,
puissance plus séculaire que spirituelle, cherchait à
conforter l'ordre social qui lui était favorable sous le
prétexte de préparer ainsi pour le mieux de tous
l'eschatologie qu'elle proposait ; l'État, république de
nom, mais pas de fait, est l'objet de quelques-uns, avec la
fallacieuse apparence d'une démocratie véritable et
146
l'École qu'il met en place est d'abord là pour conforter
un ordre social basé sur l'idéologie scientiste et la foi en
un progrès d'abord technique et matériel, les deux
colonnes sur lesquelles s'édifie le capitalisme.
L'enfant, au centre des préoccupations, ce sera pour plus
tard.
En bref, d'une eschatologie l'autre !
Dans tous les cas, l'École et l'instruction, l'éducation
qu'elle doit dispenser sont contrôlées par des puissances
qui les dépassent. Elle en est l'otage. Purement et
simplement instrumentalisée, elle est au mieux ornée
d'un discours lénifiant faisant croire à des finalités
idéales, l'excipient verbeux destiné à masquer
l'amertume des réalités. Par-delà toutes les proclamations
et déclarations d'intention généreuses, l'École telle
qu'elle a toujours été dans les faits n'a eu que deux visées
ou plutôt n'a été dévoyée que dans deux buts principaux :
assurer ce qui a été établi (composante conservatrice) et
préparer ce que les forces au pouvoir croient nécessaire
pour mieux assurer encore leur suprématie (composante
prédicative). La revanche de 1870, par exemple, s'appuie
sur un patriotisme particulièrement distillé dans les salles
de la communale alors que le conflit de 1914 aura
essentiellement des causes économiques et impérialistes.
Le patriotisme ne servira qu'à sublimer, à voiler
pudiquement, pour l'opinion publique, la lutte
économique et coloniale que se livrent particulièrement
la France et l'Allemagne. Des fortunes y ont intérêt et le
bond technologique attendu de la guerre fait espérer des
lendemains qui "moderniseront" les pays.
147
La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père, qu'est-ce qu'il fait le père ?
Il fait des affaires…
Plus tard, l'exemple du national-socialisme sera
particulièrement clair à cet effet, les systèmes totalitaires
ne faisant que rendre plus visible ce que le discours et les
apparences démocratiques dissimulent dans tous les
autres régimes.
On développera une éducation et un enseignement qui, en
histoire, par exemple mais aussi dans les matières
scientifiques et littéraires, sportives, tend à montrer
l'éternelle supériorité de l'Allemagne, un enseignement
qui prépare l'avenir de la théorie raciale de l'espace vital.
L'école en Union Soviétique aura des caractéristiques
semblables : former les robots du système.
L'enseignement du français : un exemple caractéristique d'une
culture de classe
L'université napoléonienne a fondé le lycée et celui-ci est le
sanctuaire dans lequel, pour la majorité, les enfants des classes non
populaires, donc non destinés à un travail de production, reçoivent
une éducation plus académique. On pourrait penser que cet
enseignement, par définition moins immédiatement utilitaire,
permettrait aux jeunes gens d'acquérir une vraie culture, de
développer leurs talents, d'enrichir leur personnalité, que l' "école"
à ce niveau serait plus respectueuse de la mission que lui ont
assignée tous les vrais pédagogues : l'épanouissement de chaque
enfant.
En fait, les programmes des lycées conduisent à la même aliénation
que ceux de l'école primaire, sur un autre plan. Si l'on prend pour
exemple ce qui est longtemps le fleuron de l'enseignement, les
148
lettres, avant que les mathématiques ne les détrônent (pour des
raisons aisées à comprendre), on note que leur apprentissage loin de
donner à chaque élève les moyens de se révéler, d'épanouir ses
capacités, ses potentialités créatives ne vise qu'à maintenir
l'intégrité d'une classe (en gros, celle des possédants) par le biais
d'une culture commune, tout en donnant l'impression d'un
enseignement marqué par un certain humanisme. Les auteurs sont
soigneusement choisis en fonction d'une morale favorable à
l'immobilisme social, les exercices également. L'enseignement des
lettres possède au moins trois fonctions jusque vers les années 1871-
1880 et ne se distingue que peu de ce qui se faisait sous l'Ancien
Régime :
- Établir une filiation entre l'élite des siècles passés et l'élite
contemporaine (la place des études classique, la place du
latin, un Parnasse soigneusement limité à quelques "grands
auteurs" du XVIIe siècle voire du XVIIIe siècle puis à des
contemporains "sûrs"…)
- Préparer ces élites à la maîtrise du discours et de l'écrit
(nécessaire aux "carrières"),
- Créer l'honnête homme moderne (raisonnablement
scientiste, lecteur d'une certaine presse, maître de sa plume,
raisonnablement religieux, patriote et gestionnaire de sa
fortune).
On a donc à faire à un enseignement de transition alors que la
révolution industrielle s'impose et que les ombres du passé sont
encore bien présentes, mais un enseignement destiné à conforter
diachroniquement et synchroniquement une classe sociale
privilégiée.
- La classe de 1ère est la Rhétorique. Ses finalités sont claires :
maîtriser l'art de la parole et du discours, art que devait jadis
posséder le juriste ou l'ecclésiastique et que devra acquérir le
futur député, le futur patron, la future notabilité. Ceci implique
un certain nombre d'exclusions: des genres, comme le roman ou
la poésie, des époques comme le moyen-âge, des écrivains
(certains auteurs de la Renaissance, du dix-huitième siècle, les
contemporains "libéraux"...)
- Si l'art d'écrire peut paraître privilégié, c'est parce que la forme
est particulièrement travaillée et que l'imitatio joue un grand
149
rôle. Le fond est moins valorisé. À la limite, peu importe ce qui
est dit (tant que cela reste "neutre") le comment seul intéresse :
les Considérations de Montesquieu sont traitées comme un livre
de littérature et Boileau demeure la référence principale.
Le manuel de français le plus utilisé jusqu'en 1870, le Noël et
Delaplace (Leçons françaises de littérature et de morale, 29 éditions
officielles entre 1804 et 1862), est intéressant à feuilleter à ce
propos:
"Tout dans ce recueil est le fruit du génie, du talent, de la vertu;
tout y respire le goût le plus exquis et la morale la plus pure", peuton
lire en guise de déclaration d'intention.
Les auteurs s'appuient sur Rollin et son Traité des études, qu'ils
citent, pour justifier leur entreprise : le "choix exquis" (jugement
porté par les auteurs sur leur travail ?) des morceaux choisis qui
composent leur livre : "Il ne s'agit pas pour lors de faire
comprendre aux jeunes gens la suite d'un raisonnement long et
obscur, ce qui est beaucoup au-dessus de leur âge, mais de les former
à la pureté du langage, et de leur donner de bons principes" !
Leur but est avant tout l'acquisition d'un langage élégant, de bon
goût, allant surtout de pair avec une morale solide.
Le chapitre introductif intitulé Règles de l'art d'écrire, est constitué
par un extrait du discours de Buffon lors de sa réception à
l'Académie Française.
Ce choix d'un homme du siècle précédent célèbre pour son style et
scientifique tout de même un peu dépassé, est très éclairant sur les
finalités qu'on se propose alors de l'enseignement du français, le
"goût" est essentiel :
"Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui passeront à la postérité
: la quantité de connaissances, la singularité des faits, la nouveauté
même des découvertes ne sont pas de sûrs garants de l'immortalité.
Si les ouvrages qui les contiennent ne roulent que sur de petits
objets, s'ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie, ils
périront, parce que les connaissances, les faits et les découvertes
s'enlèvent aisément, se transportent et gagnent même à être mis en
oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses sont hors de l'homme,
le style est l'homme même. Le style ne peut donc ni s'enlever, ni se
transporter ni s'altérer. S'il est élevé, noble, sublime, l'auteur sera
également admiré dans tous les temps, car il n'y a que la vérité qui
soit durable et même éternelle."
150
Les objectifs des programmes sont clairement résumés par Noël et
Delaplace :
"Chaque morceau de ce Recueil, en offrant un exercice de lecture
soignée, de mémoire, de déclamation, d'analyse (analyse des tropes,
des périodes, de la composition !), de développement oratoire, est en
même temps une leçon de vertu, d'humanité ou de justice, de
religion, de dévouement au prince et à la patrie, de désintéressement
ou d'amour du bien public."
La connaissance d'aspects choisis de l'Antiquité, les classiques
français, quelques philosophes soigneusement expurgés et des
auteurs modernes (choisis pour leurs "performances" scripturales,
pas pour leurs idées) illustrent cette volonté.
Le lycée est alors coupé de la vie et maintenu en dehors des études
pratiques. On ne souhaite que former l'homme de tous les temps ou
plutôt l'homme moderne façonné sur les exemples du passé.
Au cours du siècle, les grands de la littérature classique se
maintiendront avec des fortunes diverses ou en fonction d'oeuvres
nouvelles, pour se résumer, le fameux : Une Corneille perchée sur
une Racine de La Bruyère Boileau (!) de La Fontaine Molière. S'y
ajouteront avec parcimonie jusqu'en 1870 (V. Duruy travaillera dans
ce sens, mais insuffisamment) des ecclésiastiques, des professeurs,
des modèles de "bonne vie", des critiques. Rousseau, Voltaire, puis
Chateaubriand ou Balzac sont présents au fur et à mesure des
éditions, mais sous forme d'extraits particulièrement bien choisis et
rendant tendancieusement d'abord compte de leur valeur moralisante
ou stylistique. Ceci conduit, en dépit d'un semblant d'ouverture à
une atrophie du domaine de la littérature : elle n'est qu'instrument
de la rhétorique et de la morale. On assiste au triomphe de la
littérature didactique (sermonnaires, prédicateurs, moralistes,
religieux, puis auteurs "patriotes", mémoires d'enfants du peuple
ayant "réussi"...), extraits expurgés au nom du beau et du bien. Il
s'établit une anthologie de "morceaux" inoubliables comme
"Télémaque élève modèle", "Mentor professeur modèle" que tout
lycéen doit "posséder" pour la vie.
On utilise Rousseau pour illustrer tel titre de chapitre: "Les jeunes
gens corrompus de bonne heure sont inhumains et cruels, le jeune
homme sage jusqu'à vingt ans est le meilleur et le plus aimable des
hommes" ! Massillon pour développer l'idée que "La victoire la
plus glorieuse est celle que l'on remporte sur soi-même", Le Père
151
Guénard pour étudier les bornes que la religion doit mettre à l'esprit
philosophique, La Harpe pour convaincre que "La retraite est
essentielle au travail" ou Chateaubriand pour donner un exemple de
l'éloquence chrétienne…
Voltaire sera essentiellement un conteur, un maître du style, pétillant
et malicieux…
En bref, on cherche à former des jeunes gens de bien, d'honneur et
de religion, maîtrisant une langue de bon goût façonnée par les
modèles qu'on leur présente. Les têtes parlantes du siècle précédent,
la Voix de son maître des futurs débuts du phonographe !
Jusqu'à la réforme de Jules Ferry, ce nombre réduit d'auteurs laisse
la littérature française en seconde position (malgré les avancées dues
à V. Duruy). Il n'y a qu'à l'agrégation de lettres où un sujet de
littérature française est imposé (1850: "Pourquoi la tragédie
moderne et en particulier la tragédie française n'a-t-elle pas admis
l'emploi du choeur?")
Les lettres, qui sont alors pour le second degré, le fleuron de
l'enseignement, ne visent qu'à permettre à la classe dirigeante de se
"retrouver", de communier aux mêmes accents, de célébrer les
mêmes valeurs.
Les exercices écrits demandent alors de composer à la manière de...
(Monologue d'Hannibal devant les portes de Rome; Prosopopée
d'Ajax sur les ruines de Troie...) et ce n'est qu'après 1870 qu'ils
seront remplacés par l'explication de texte, mais une explication,
elle aussi très cadrée.
Les préoccupations politiques et idéologiques sont évidentes et
l'instrumentalisation de la littérature en témoigne. Le rappel constant
du lien entre le beau, bien dit, bien écrit et le bon, la morale
(préoccupation des vieilles perruques du XVIIe siècle), cache ou
occulte le vrai et devient l'alibi d'un conservatisme obsédé par
l'ordre. La littérature est donc à la fois prisonnière des objectifs
scolaires de l'enseignement secondaire et des objectifs idéologiques
du pouvoir. Longtemps avant Baudelaire, la littérature prouvera que
le beau dépasse largement le bien, l'État, lui, a une autre vision : il
prépare ses futures élites capables d'études secondaires et met tout
en oeuvre pour s'en assurer la fidélité.
L'idée même de littérature que comprennent les promoteurs de
l'école au XIXes., continue à véhiculer de toute façon cette vision
moralisatrice héritée du XVIIe siècle : elle exclut la littérature
152
d'imagination pour ne privilégier que la littérature (au moins jusque
1850) prenant racine dans l'humanisme d'un XVIe siècle édulcoré,
soigneusement émondé de ses prolongements philosophiques, qui
semble ne chercher qu'à améliorer l'homme en le guidant par la
morale.
Sur cette situation se greffe le débat entre 1830 et 1870 à propos des
rôles spécifiques de la culture scientifique et de la culture littéraire.
Quelle est la place du progrès technique et social face à l'invariable
grandeur morale de l'homme? Les tenants, de plus en plus
nombreux, sinon d'un changement de paramètre au moins d'une
évaluation nouvelle de l'apport (indiscutable depuis le Siècle des
Lumières) des sciences (ce qui n'est pas encore le modèle
mathématique qui triomphera à partir de l'entre-deux-guerres) se
battent pour faire triompher leurs idées : le monde moderne
(entendons, le système économique) sera scientifique ou ne sera pas
et le nouvel honnête homme doit être l'homme de science,
l'ingénieur, voire le technicien. Un bon exemple est fourni par le
débat parlementaire qui opposa Lamartine à Arago, le poète au
savant. Lamartine eut cette phrase : "Si le genre humain était
condamné à perdre entièrement un de ces deux ordres de vérité, ou
toutes les vérités mathématiques, ou toutes les vérités morales, je dis
qu'il ne devrait pas hésiter à sacrifier les vérités mathématiques, car
si toutes les vérités mathématiques se perdaient, le monde industriel
subirait sans doute un grand dommage, un immense détriment, mais
si l'homme perdait une seule de ces vérités morales dont les études
littéraires sont le véhicule, ce serait l'homme lui-même, ce serait
l'humanité entière qui périrait."
Cette pensée, dans sa substance, n'a certes pas vieilli. Arago, pour sa
part, réclamait un enseignement moderne, une éducation
"exclusivement professionnelle, scientifique, industrielle" et
Lamartine refusait cet adverbe "exclusivement" ; il pensait au
contraire qu'il fallait conserver les lettres, la formation humaine.
Cependant, il n'était pas non plus pour une éducation fermée au
monde, au progrès, à l'évolution des sociétés. Comme Rousseau en
quelque sorte, il désirait qu'on établisse un ordre dans la succession
des apprentissages : d'abord une "éducation morale, littéraire, (…)
commune", puis "cette éducation spéciale et industrielle", quand
l'individu est assez fort pour en prendre la vraie mesure.
Un certain nombre de décades encore, et la cohabitation souhaitée
153
par l'auteur de Graziella allait s'imposer ; plus tard, le rapport
s'inversera...
Mais si les critères (littérature ? Sciences ?) pourront changer, le
propos demeurera le même : hier comme aujourd'hui, l'École
demeurera prisonnière d'un discours ambigu : en paroles de plus en
plus "ouvert", tourné vers l'individu et en actes qui pérennisent sa
fonction aliénante. L'écart entre le discours et la réalité, entre
l'apparence et la vérité des faits sera de plus en plus évident.
L'École au sens large est le moule dans lequel il contraint les
générations : par l'école primaire, faire des producteurs capables et
respectueux de cet ordre ; par le lycée former des élites liées entre
elles par un sentiment de classe, d'appartenance à un groupe de
privilégiés destinés à prendre en main les destinées du pays.
Ajoutons que, lorsque les lettres devront céder le pas aux sciences,
on assistera simplement à une mise au pas définitive d'un
enseignement destiné à servir un système économique productiviste
qui désormais se montrera dans toute sa vérité voire sa brutalité
même si le discours officiel fera en sorte de démontrer que la
formation humaine par les mathématiques est par certains aspects
supérieure à la formation "littéraire" mais dans les deux cas en se
refusant à admettre que ce ne sont là que des conséquences d'une
valeur considérée comme supérieure : le marché, le système
économique, la permanence d'une hiérarchie sociale.
On ne connaîtra vraiment quelques auteurs français modernes
qu'après 1870 et parce que les nécessités d'un sursaut national
conjuguées avec la laïcité mènent à élargir le Panthéon littéraire. La
République a besoin de grands hommes, une idée que la Révolution
de l'an II avait déjà cherché à populariser. La littérature nationale
doit se mettre au service de la patrie, ce qui ne voudra pas dire que
les programmes s'ouvriront à tous les auteurs. Un Panthéon en
chassera un autre, rien de plus.
*
154
Au XIXème siècle, siècle des révolutions, s'est joué le sort
de l'école primaire et de l'institution scolaire.
À la fin de la période, juste avant le premier conflit
mondial, le triomphe de l'école obligatoire ne résulte pas
seulement d'un affrontement entre l'État et l'Église pour
le contrôle de l'éducation du peuple, elle est aussi le
produit d'une autre lutte menée autour du rapport entre
l'école et le travail. En effet, évacuant la question d'une
éducation permettant à l'individu d'être à la fois
totalement soi et membre à part entière de la société dans
laquelle il vit, voire de la communauté humaine dans son
ensemble, tout le siècle est traversé par la question de
savoir si la socialisation des enfants du peuple doit passer
par l'école ou par le travail. Il faut s'entendre sur ce
terme de socialisation, polysémique s'il en est, mais qui
ne signifie alors principalement que l'intégration à une
société du travail et de la production en pleine évolution.
Tantôt l'éducation par l'école est perçue, par la
bourgeoisie au pouvoir, comme perverse (elle inoculerait
aux enfants des classes "dangereuses" le désir de
changer de classe sociale) et l'éducation par le travail est
alors considérée comme préférable pour les masses car
moralisatrice; tantôt la promiscuité des enfants du peuple
avec les ouvriers développerait de façon précoce leur
conscience de classe et serait donc corruptrice, voire
dangereuse.
On se met d'accord sur une synthèse frileuse ou
hypocrite permettant de ménager la chèvre et le chou, les
postulations généreuses et humanistes de quelques-uns
(mises en avant, étendard philosophique et
philanthropique, cache-misère pratique en apparence)
avec ce qui est présenté comme l'impératif de la
155
compétition internationale : l'école doit certes servir
l'individu en lui offrant quelques chances de
développement, elle doit aussi et principalement l'amener
à intégrer le rang qui lui est dû dans la société (de par ses
origines plus qu'en raison de capacités, qui pour la
plupart demeureront inexploitées mais aussi de par les
développements sociaux économiques en cours ou
prévus). Le discours officiel des dirigeants et des
notables est ambigu, altruiste seulement en apparence ; il
est hésitant en ce qui concerne les syndicats partagés
entre les nécessités d'assurer le pain à tout le monde, de
donner des cadres à la classe ouvrière et des aspirations
plus humanistes. Il reste profondément ancré dans les
réalités immédiates économiques, sans perspectives, sans
"téléologie", myope.
Les deux discours de J. Ferry et du président de
l'Assemblée à Vierzon évoqués plus haut sont à ce
propos de véritables paraboles : Janus républicain ne se
dissimule pas et la pratique du double idiome en matière
d'éducation se généralisera : une duplicité qu'on retrouve
partout et qui culmine dans les régimes autoritaires et
totalitaires.
L'école devient une propédeutique sociale.
On peut comprendre voire accepter que, pour la période
qui va, en gros, jusqu'au début des années 70, la pauvreté
criante d'une large fraction de la population française,
qui ne dispose pas du minimum nécessaire l'explique
certes et le justifie : il faut pallier au plus pressé, comme
probablement aujourd'hui dans les pays dits "en voie de
développement" : permettre à la quasi-totalité des
populations d'acquérir ce minimum "culturel"
156
considéré comme vital puisqu'il semble offrir à chacun
de meilleures chances d'obtenir une activité assurant
l'existence matérielle. Ce faisant, cependant, au lieu de
rompre avec un système qui sème l'illusion, on ne fait
que repousser l'échéance inévitable. Dans cette course
poursuite infinie, le "système" possède les meilleures
cartes : il pourra toujours placer plus loin la carotte
insaisissable. Certes les premiers besoins seront satisfaits
mais au prix d'autres contraintes, d'autres maux. La
quantité de "bonheur" varie peu. Hier, les esprits
avancés désiraient que tous les enfants sachent au moins
lire et compter ; aujourd'hui d'autres esprits avancés
revendiquent l'accès au bac pour tous, voire des études
supérieures. La démarche est la même et le résultat assez
comparable : la création d'un véritable prolétariat, car si
le prolétaire selon sa définition est celui qui ne possède
que la force de ses bras, si le prolétaire du XIXe siècle
ressemble assez au tableau qu'en ont fait les romanciers
naturalistes, qu'il dispose aujourd'hui d'une voiture et
d'un réfrigérateur, d'une télé XXL et d'un I Pod ou I Pad
ne change pas grand-chose à sa situation morale.
Il est toujours sur le dernier échelon d'une échelle de
coursive, dans l'eau jusqu'au cou et s'il a l'impression
que sa situation s'améliore, qu'il s'élève chaque
génération davantage, ce n'est qu'illusion : la mer monte
et le bâtiment auquel il s'accroche et sur lequel il désire
prendre pied monte avec la marée. Sa situation n'évolue
qu'en apparence.
Les responsables politiques, les ministres peuvent parler
de progrès, s'en gargariser : les choses n'ont en fait pas
tellement évolué. L'institution scolaire demeure
l'instrument essentiel des États, qui ne sont plus (mais
157
l'ont-ils jamais été ?) l'expression démocratique des
volontés populaires. L'appareil d'État s'est
progressivement réduit à une sorte de superstructure ou
plutôt d'interface entre l'ensemble des citoyens et ce
qu'on peut appeler le monde de l'économie et du travail.
Le chef de l'État, lui-même, se transformant simplement
en une sorte de super VPR à la recherche de marchés
nouveaux ! Le G20, Davos, … prétendent régir le
monde !
Que ce monde soit capitaliste, communiste, libéral ou ce
qu'on voudra ne change d'ailleurs structurellement rien.
L'institution scolaire n'est là que pour préparer aux
changements qu'on lui demande. À partir de 1850, il était
inconcevable que l'on intègre un monde du travail de plus
en plus compliqué sans un minimum de connaissances de
base comme le calcul et l'écriture, la lecture ; en l'an
2011, il est tout aussi inconcevable de ne pas disposer
d'un vivier de travailleurs capables d'effectuer des tâches
plus complexes qu'aux premiers temps de
l'industrialisation et susceptibles de changer d'emploi, de
pays au gré de l'évolution technologique et financière.
L'accès aux études, les quasis 100% de reçus au bac,
l'université ouverte à tous se paye d'arrières pensées qui
n'ont rien d'altruiste.
On pourrait encore arguer de cette seconde chaîne qui
s'est ajoutée aux liens qui paralysent l'individu: le
citoyen moderne ne doit pas seulement être d'une
manière ou d'une autre un producteur efficace et
polyvalent, il doit aussi se manifester comme
consommateur. Or une consommation solide, moderne et
efficace se prépare. Ça a été toute l'ambiguïté d'une
formule dévoyée comme : "Ouvrir l'école sur la vie",
dont les responsables politiques (mais aussi les
158
pédagogues et trop d'enseignants) ont fait un de leurs
slogans à partir des années 70, comme si une des finalités
de l'école n'aurait jamais dû être autre. La question étant
alors de savoir ce qu'on appelle la vie ! La duplicité de
cette formule, c'est que pour le système économicopolitique
il s'agit de la vie professionnelle et de la
fonction consommatrice, alors que pour les enseignants
et les pédagogues (il faut l'espérer !) c'est aussi autre
chose, un apport plus directement enrichissant pour
l'individu. Ainsi, les vacances paraissent-elles une
nécessité pour l'équilibre de l'enfant et leur répartition
judicieuse, leur rythme, leur durée doit être sérieusement
établie. Or, si jusqu'en 1914, les fameux trois mois de
vacances n'ont jamais été qu'une concession au travail
des champs, les enfants paraissant plus utiles à aider leurs
parents qu'à user leurs culottes sur les bancs de l'école,
aujourd'hui encore, le calendrier scolaire est établi en
fonction des lobbys touristiques : vacances d'hiver,
vacances d'été, étalement des vacances pour prolonger le
temps d'utilisation des pistes de ski (utilisées en outre par
une fraction de la population), pour soutenir la
fréquentation des plages, des centres de loisirs (les
vacances du prof n'ayant jamais été autre chose que ce
qu'on qualifie en terme administrativo-juridique de
"droit d'aubaine" : l'instituteur pendant longtemps n'a
été rétribué que sur 9 mois de travail avec un salaire
réparti sur les douze mois !)… Ainsi, les classes de neige
aideront (dimension noble à valoriser dans le discours) à
cimenter une classe, à découvrir le milieu, à initier à
plusieurs activités sportives et en même temps
(dimension plus discrète), elles donneront l'envie de
consommer de l'or blanc !…
Les vacances sont un exemple de cette emprise
159
continuelle d'agents extérieurs sur l'école : d'abord les
fêtes religieuses comme justification et puis désormais
les impératifs économiques. La discussion bouffonne
autour des rythmes scolaires serait un autre exemple avec
la semaine de quatre jours, celle de quatre et demi, celle
de cinq…
Ainsi, non seulement l'école voit son fonctionnement
dicté par des considérations qui n'ont rien à voir avec ce
qui devrait être sa mission première, mais elle collabore à
la formation du consommateur dont l'économie a besoin.
Soutien indéfectible du monde de l'édition (le livre
scolaire représente un marché énorme et les lectures
suivies servent de fonds de roulement aux éditeurs), c'est
aussi à l'école qu'on apprend le sens du mot loisir, et cela
d'une manière elle aussi fort ambiguë. En effet,
l'ouverture sur le monde, c'est aussi fréquenter les
spectacles, aller au théâtre, participer en rangs par deux
aux semaines du cinéma ou autres manifestations
nationales, c'est encore visiter les musées, les lieux
patrimoniaux, voir les Disneyland ou les parcs à vocation
scientifique… Combien de ces lieux ne survivent que
grâce à l'obole des écoliers ? Bien entendu, il est du
devoir de l'école d'initier les enfants, tous les enfants à
ces formes de la convivialité et de la culture moderne,
mais en même temps, ces classes entières entraînées dans
des voyages ou des visites insuffisamment préparées,
sans lendemain le plus souvent, obligatoires, sans
discussion critique postérieure ressemblent davantage à
un conditionnement allant dans le sens de la
consommation voulue par le système.
L'exemple de l'informatique est aussi patent à ce sujet :
bien entendu, il faut former les jeunes à l'utilisation de
ces désormais indispensables instruments, mais il ne
160
faudrait pas élever en mythe ce qui n'est que technologie
ni rendre l'enfant esclave de ce nouveau progrès au
détriment d'autres voies de la connaissance. Lorsque
l'école remplace le réel des expériences, des découvertes,
des observations par le virtuel et l'audiovisuel, elle a une
action qui va uniquement dans ce sens et éloigne l'enfant
de sa vérité profonde. Elle manipule au profit de
l'univers de la consommation et ce ne sont pas les
quelques manifestations montées en épingle par le
battage médiatique, comme les opérations Fête des
sciences, La main à la pâte…, (bonnes en soi mais
n'ayant que valeur d'alibi) qui changent grand-chose !
161
III. Un système qui se fissure, des
craquements sinistres, de l'eau dans
le gaz
162
163
Les volontés particulières, les beaux livres, les belles
phrases et les projets admirables ne suffisent pas. Ce qui
fait vraiment bouger le monde, c'est l'événement auquel
on ne s'est pas attendu, le séisme qui vient bouleverser ce
qui paraissait établi. Peut-être en approchons-nous enfin,
peut-être y sommes-nous ! En effet, de l'intérieur le
système scolaire tel qu'il est montre des signes
d'essoufflement. Parallèlement, l'association économicopolitique
n'a plus trop confiance dans une institution qui
répond à son avis désormais imparfaitement à ses
exigences. Cette association ne voit plus en elle l'alliée
de toujours. Pour faire face à la demande, les états ont
choisi les solutions les plus économiques, la formation
attendue en souffre et les élèves, sur de nombreux plans,
ne répondent plus aux attentes…
Le système en effet se mord la queue : si le monde
économique réclame une constante augmentation globale
des savoirs et des savoir-faire, des compétences de
chacun nécessaires à son évolution et à ses profits en
même temps qu'une obéissance absolue fallacieusement
compensée une consommation sans frein (du travail et
des jeux !), il ne peut s'empêcher de constater les
prémisses de ce qui arrivera inévitablement le jour où
l'intelligence des nations, l'intelligence de la société
civile sera assez forte pour contrebalancer voire pour
combattre toutes les aliénations. On commence d'ailleurs
à le voir : les jeunes générations sont moins sensibles aux
mirages qu'on leur propose : une trompeuse réussite
sociale payée par un stress insupportable, le règne absolu
du veau d'or, la fuite en avant vers un toujours plus
forcément insatisfaisant, la massification des goûts et des
choix… Un monde de frustrations dont les illusoires
164
garde-fous mis en place par le système s'estompent : la
religion, la morale républicaine, le respect de la
hiérarchie, de l'argument d'autorité, du savoir, du travail
voire de la propriété…
Les foules qui manifestent contre les abus bancaires, les
occupations d'usines, les initiatives locales, le
mouvement des Indignés voire les événements en
Égypte, Libye, Tunisie, Syrie en sont le signe avantcoureur
avec un élément remarquable : ces mouvements
se font avec des foules très mêlées, parfois peu marquées
par l'école, mais qui ont tout de même profité de savoirs
véhiculés par les médias. On pourra toujours alléguer que
les foules tunisiennes par exemple ou libyennes ont été
instrumentalisées par les Islamistes, il n'en reste pas
moins qu'elles ont refusé de continuer à croire aux
promesses creuses des dictateurs qui les méprisaient et
les gouvernements Islamistes qui découleront de ces
bouleversements devront en prendre bonne note !
À l'école, le prof est plus que jamais déconsidéré parce
qu'il représente l'agent d'un étouffant système de plus en
plus mal ressenti. Il est un des derniers matons qui, en
apparence, cherchent à imposer le vieil ordre voulu par
un système économique qui échappe à tout contrôle, à
toute justification, à toute réflexion. L'école elle-même,
telle qu'elle est, ne fait plus illusion et chacun sait que
l'élève est payé - dans sa majorité - en monnaie de singe.
Les diplômes sur lesquels s'appuie une méritocratie en
paroles ne valent plus grand-chose et il en faut toujours
davantage pour espérer profiter des avantages que
quelques-uns tentent de préserver. Demain, on sera
instituteur avec un bac plus sept !
Le malaise est grand et touche tous les membres de la
communauté enseignante : les usagers (les "usagés"
165
pourrait-on dire) d'abord, élèves, parents et professeurs,
mais aussi le monde politique et les donneurs d'ordre.
Du côté des élèves, désillusion, ras-le-bol
et contestation.
Pour les premiers, pour les élèves, on assiste à une
véritable révolution des comportements qui mène à une
résolution de la schizophrénie inhérente au système : le
brave élève qui accepte quasiment tout ce que l'on veut
de lui et qui dissimule sa vraie personnalité pour la vivre
éventuellement ailleurs que dans le cadre scolaire se fait
de plus en plus rare.
Jusqu'alors, l'élève était docile. Le prof respectait son
chef d'établissement et son inspecteur, le chef
d'établissement respectait le Recteur… Tout ce monde
appartenait encore en grande partie à la même famille.
Une société des connivences : on partageait peu ou prou
les mêmes "valeurs", les mêmes idées fondamentales,
ce qui était loin de vouloir dire qu'il n'y avait pas
diversité d'opinions, sinon, il n'y aurait jamais eu ces
soubresauts de l'histoire qui, d'une manière ou d'une
autre, un peu comme les modifications génétiques, font
évoluer les choses. Comme dans les meilleures familles,
les disputes, les querelles et les répudiations existent. Il y
a toujours quelque part un fils prodigue mais le retour de
ce fils prodigue est de toute façon prévu et source de tant
166
de joies feintes ! Il est d'ailleurs tout à fait pertinent de se
demander si ces soubresauts justement ne sont pas eux
aussi inscrits, programmé dans ce grand tout dont fait
partie le monde de l'école. Cela ne signifiait donc pas
que cet élève (ou le prof, ou le chef d'établissement, ou le
Recteur, ou…) n'eût aucune réflexion personnelle, qu'il
fût fait d'une pâte essentiellement malléable ! Il avait
pour sa part simplement enregistré les règles d'un
système qui réclame l'impersonnalité, la répétition, le
rabâchage, le masque. Son véritable moi se développait
comme en retrait, à un autre niveau : en classe, dans
l'amphithéâtre, il parlait la langue du prof, la langue
qu'on attendait de lui avec les quelques variantes plus ou
moins autorisées, mais il avait, lorsqu'il était seul, avec
ses amis, quand il était en confiance, son propre idiome,
son jardin secret. Derrière les apparences lisses et
standardisées qu'imposaient son enseignement, son
éducation, se développait une autre personnalité, riche,
rugueuse, insaisissable, désireuse d'originalité, mais
dissimulée. Sans aller jusqu'à dire que notre
enseignement favorisait (ou favorise encore car rien ne
change radicalement) les psychoses, voire une sorte de
schizophrénie particulière, il est clair qu'il poussait
(pousse) à la sournoiserie, aux faux-semblants, à une
certaine hypocrisie prudente et surtout, en profondeur, à
une distance prise avec ce qui était enseigné.
Tant que le modèle scolaire prolongeait, doublait,
accompagnait le modèle patriarcal en vigueur dans les
familles, les choses sont allées leur train de sénateur, leur
petit bonhomme de chemin, assez confortablement.
Petites filles modèles et garçonnets respectueux devant
un papa façon Robert Gérane et une maman Folcoche,
élèves attentifs et silencieux devant un Maître impérieux :
167
mais, "par derrière", on n'en pense et on n'en réagit pas
moins.
Le petit Français a appris à vivre à deux vitesses, à avoir
deux vies, deux langues, deux mimiques.
Une richesse dans un sens !
Mon expérience à la tête d'un établissement bilingue dépendant de
l'AEFE et accueillant deux populations d'élèves, allemands et
français, est à la source de cette réflexion. Les premiers
réagissaient en général beaucoup plus spontanément, beaucoup
plus directement que leurs condisciples français. Ils n'hésitaient
pas, en cours, à intervenir, à donner leur opinion, voire à critiquer
avec un aplomb et une sûreté surprenants chez de très jeunes gens.
Face à la direction et aux enseignants, ils se comportaient le plus
souvent sans complexes comme des partenaires (idées et
propositions pour l'organisation d'activités diverses, pour l'avenir
de l'établissement… ; interventions lors des conseils de classe,
demandes d'éclaircissement sur certaines décisions des conseils de
classe, sur les programmes, sur le bien-fondé de certains
apprentissages…) Face à l'ensemble des élèves, ils représentaient
leur lycée et combattait tout vandalisme, laisser-aller, dégradations
diverses… Ils étaient les défenseurs des droits des élèves mais
aussi les gardiens attentifs de ce qu'ils considéraient être leurs
devoirs. Par contre, leurs camarades français, dans leur majorité et
surtout les premières années, étaient remarquables par leur
mutisme : peu de participation orale en cours, peu de dialogue avec
les enseignants ou la direction. Ils gardaient les distances,
présentant toujours à l'observateur une façade lisse et
respectueuse, en apparence, des règles. Le lycée n'était pas tant
leur lycée que l'endroit où ils devaient séjourner pour effectuer
leurs études, un lieu où la volonté parentale les avait placés. Ils
fuyaient plutôt les contacts qu'ils ne les suscitaient.
Inviter un élève allemand à venir donner son opinion sur ce qui
allait bien ou mal dans l'établissement, c'était s'engager dans une
longue discussion face à un jeune à l'aise dans le fauteuil où il
s'était installé. Inviter un élève français au même exercice, c'était
avoir devant soi une jeune fille ou un jeune homme à l'évidence
sur ses gardes, la pointe des fesses sur le bord du siège, peu
loquace ou veillant à ne livrer que des paroles convenues et sans
168
conséquences, se précipitant vers la porte dès la fin de
l'entretien" !
Heureusement, dans cet établissement vivant très bien
l'autodiscipline (qui exige en fait une vraie discipline), le jeune
Français ne tardait pas à abandonner ses réflexes culturels à la
frontière et à adopter dans l'établissement une conduite qui ne le
distinguait guère, en fin de scolarité, de ses camarades allemands !
En revanche, depuis que les certitudes d'une certaine
tradition commencent à chanceler, depuis que tout fout le
camp comme on s'est amusé à le dire et à le répéter,
depuis que les nouvelles classes dangereuses ont accès
aux études, avec stupeur, ni les parents ni les maîtres ne
reconnaissent leurs chères têtes blondes et ces dernières
sont moins enclines que jamais à danser, disons, pour
faire image, une vie durant, le ballet Jekill/Hyde ! Les
problèmes commencent alors ! Révolution culturelle !
Bouleversements ! Rien de sûr désormais… La chienlit
du Général et les solutions à la Sarkozy, le karcher.
On a déjà connu ça lors de la Révolution, la Grande : à la
base un refus des "Pères" ! Anacharsis Cloots
écrivait bien avant les événements de 1789 :
Le respect craintif, la vénération profonde pour les
vieillards, tant recommandée par les moralistes, est la
source de mille maux en politique. L'Orient est engourdi
par l'ascendant de la vieillesse ; on a cherché la cause
de la stagnation des sciences et de la durée du
despotisme dans ces contrées immenses ; je la trouve
dans l'autorité des vieillards, pendant que le savant
Bailli la cherche en vain chez un peuple primitif, inconnu
à lui et à nous. Les républiques anciennes qui donnaient
le droit de vie et de mort sur leurs enfants devaient par
cela seul marcher vers la décadence : l'ignorance des
pères accumula les erreurs des enfants ; les préjugés se
169
multiplièrent avec les générations.
Et, en 1793, à quelques jours de sa propre et fatale
arrestation, il notait avec une satisfaction prématurée :
Les fils, malgré leurs pères, ont sauvé la patrie dans
notre mémorable Révolution. L'obéissance des enfants
eût bouleversé toutes nos villes à parlements et à sièges
royaux. Nous étions perdus, si la verte jeunesse avait
sanctionné les erreurs des faibles vieillards.(…) Notre
Révolution est l'oeuvre des jeunes gens. Il y a plus de nerf
et de civisme dans un écolier de 4e que dans les quatre ou
cinq académies du Louvre.
Il suffit de regarder l'âge des hommes de la Révolution
pour nous convaincre de la justesse de ses propos, nous
qui attribuons des brevets de jeunesse aux quinquas et
sexas qui nous gouvernent ! Le problème est que les
jeunes gens d'aujourd'hui sont les vieillards de demain !
Depuis pas mal de temps, donc, la fameuse connivence
culturelle qui cimentait l'échafaudage scolaire s'effrite de
plus en plus. Certains rejettent la faute sur les soixantehuitards
qui auraient sapé les fondements de l'ordre
traditionnel. Dans ce cas, hommage leur soit rendu, mais
regret que leur action ait été récupérée ou plutôt qu'ils
aient été les très innocents instruments d'une évolution
qui devait, par un surprenant retour des choses, se passer
au bénéfice d'un système peu enclin aux cadeaux et aux
explosions libertaires.
Aujourd'hui, ces cohortes de jeunes gens menées à la
baguette-carotte vers le baccalauréat, ces cohortes
dressées à devenir les braves rouages du système et les
non moins braves consommateurs des produits de leur
travail (moins évidemment les plus-values encaissées par
170
d'autres, l'érosion de leurs ressources par le jeu de la
spéculation et de la dévaluation, les réflexes
consommatoires induits et cultivés) semblent avoir
décidément pris à leur propre jeu les instances qui les
manipulent : les nouvelles générations refusent la
contradiction qu'elles ressentent désormais entre les
apparences données par le discours scolaire, ses
promesses et la réalité de la vie qui leur sera imposée.
Elles prétendent obtenir ce qu'on leur a fait miroiter.
Pour ces générations, ces bacs (bons marchés) dont on les
décore doivent avoir la même valeur que les
baccalauréats que passaient jadis les enfants de la
bourgeoisie. Elles veulent tellement croire au miracle des
études, à l'ascenseur social dont on leur a rebattu les
oreilles qu'elles souhaitent obtenir la récompense des
efforts qu'elles pensent avoir consenti sur les bancs de
l'école, du lycée et de l'université, les monnayer puisque
la seule valeur qu'on leur a inculquée est celle de l'argent
et de la consommation (en apparence) facile. Le jeune en
possession de son diplôme n'est plus prêt à accepter
n'importe quoi, à être traité comme les générations
passées qui n'avaient eu droit qu'à quelques années
d'école. Il se met à revendiquer directement
(manifestations, violence, abstention lors des votes, choix
de candidats extrémistes…) ou indirectement
(absentéisme, maladies, accomplissement à la limite de
l'acceptable des tâches imposées…). ll réclame en bref
les dividendes des placements qu'on l'a amené à
effectuer…, ou un autre monde.
En outre, si la démocratisation apparemment complète de
l'institution scolaire, l'accès généralisé au bac et aux
études supérieures se fait au premier chef en raison de la
171
demande en compétences de la société productive, la
réification induite des individus possède naturellement
son revers. Revers pour le système qui l'a mise au point,
bien entendu, revers pour le système qui a cru avoir
inféodé l'école pour l'éternité. Certes, pendant des
siècles, son fonctionnement a été assez parfait : parvenir
à une adéquation totale entre la "mission" de
l'institution scolaire et les exigences socio-économico
politiques, tout en se dédouanant en exhibant de plus en
plus le masque souriant d'une école qui serait au service
des individus et en laissant quelques soupapes de
sécurité : les discours des pédagogues, les tentatives
pédagogiques, les réformes scolaires, les statistiques
montrant la croissance du nombre de diplômés, la
publicité faite sur la réussite scolaire de tel ou tel "Petit
Chose"… Mais dialectique historique oblige comme
l'auraient jadis écrit les vieux marxistes, la mise en coupe
de la quasi-totalité des individus s'est payée du besoin de
leur accorder en même temps et globalement plus de
"culture", de réflexion, d'intelligence pour parvenir à
remplir des tâches de plus en plus complexes et il arrive
un moment où le système bascule : le plus de savoir
nécessaire à la pérennisation des structures de
domination, se retourne contre le dominateur puisque le
dominé est à même désormais de mieux comprendre
l'aspect négatif de sa situation et de réagir contre. La
monarchie absolue a joué la montée de la bourgeoisie -
agglomérat de personnages possédant la culture
nécessaire à la gestion de l'État absolutiste mais n'ayant
aucune existence politique - contre la menace que
constituait l'aristocratie, rival qu'il convenait de réduire
au silence, "d'encager à Versailles" en lui refusant tout
pouvoir réel. On connaît le résultat : sûre d'elle-même et
172
de ses capacités, la bourgeoisie a pu développer un esprit
de corps puis de classe, des valeurs propres et s'est
imposée à cette monarchie absolue qui croyait la tenir en
laisse.
L'élève, le jeune, en est au même point : il s'indigne, il
revendique, il refuse.
Notre époque voit aussi la fin des fausses modesties, de
l'acceptation d'un destin tout tracé. Les médias, les
modes, la culture moderne donnent l'impression à chacun
d'avoir les mêmes droits que l'autre. La langue ellemême
s'est "démocratisée", simplifiée : au diable les
registres de langue, tout le monde semble parler le même
idiome bon enfant. La faute n'existe plus. La forme est
secondaire, seul le message compte, comme l'ont seriné
les linguistes. Tout le monde (ou presque !) boit du
champagne et déguste du foie gras, tout le monde (ou
presque !) possède une voiture, tout le monde (ou
presque !) peut passer des vacances sur des plages
enchanteresses, tout le monde (ou presque !) profite des
mêmes libertés sexuelles (ou presque), des mêmes
drogues (ou presque), des mêmes pratiques sportives (ou
presque)… On ne se pose pas la question de savoir si le
champagne consommé à la Tour d'Argent est le même
que celui proposé en promotion par Lidl ou Max Plus, on
ne veut pas savoir que les trois tranches de foie gras de
canard vendues en pack plastique par telle grande surface
n'ont rien à voir avec le bloc de foie gras d'oie Rougie
proposé par Fauchon, on feint d'ignorer que la semaine
de vacances à Mallorca pour 199 euros tous frais compris
n'a qu'une lointaine ressemblance avec la semaine passée
dans la suite d'un ressort-hôtel de Tahiti ou de Floride où
une seule nuit revient à 1000 ou 2000 euros…
173
Je suis donc comme tout le monde et j'ai les mêmes
droits. Finies les hiérarchies, toutes les hiérarchies,
qu'elles soient fondées sur la naissance, la richesse, la
culture, le savoir et les diplômes. Chacun peut devenir
riche, célèbre, envié, désiré : nous n'allons tout de même
pas accepter qu'on nous relègue au niveau de nos pères !
Paradoxalement, dans ce monde massifié, "grégarisé",
la revendication de l'individualisme est devenue la
marque des temps. Chacun veut, exige son droit au
bonheur clamé, mis en images par les médias et le
système, son droit à la réussite matérielle promise, à
l'argent et cela le plus vite possible, immédiatement.
Il est vrai que, contrepoids à cette massificationmondialisation,
le discours du système (la politique,
l'économie, la publicité, les médias) tend à faire accroire
cette idée que chaque individu n'a jamais été aussi
"unique" qu'aujourd'hui !
Ce système, pour se prolonger, a été amené à emboucher
cette trompette de l'individualisme-roi, à flatter les
individus dans le sens de leur singularité supposée, à leur
faire croire qu'en s'habillant comme tout le monde, en
écoutant la musique produite par l'industrie du CD, en
regardant les films produits par l'industrie du cinéma, en
assistant aux concerts organisés par les industriels des
events qui font tourner leur écurie, en croyant aux mythes
vulgarisés par les médias, en acquérant les mêmes
diplômes…, on serait néanmoins unique et parfaitement
heureux. Tout cela accroît l'égoïsme naturel et entre en
contradiction avec la réification qui s'empare de chacun
et dont on prend conscience de temps en temps avec
horreur ! Plus dure est la chute : les pauvres sont encore
plus pauvres, les attentes sont sans lendemain, le
chômage, la crainte de l'avenir, la peur de l'écocide qui
174
menace un monde livré au toujours plus, s'emparent des
esprits et des corps. Le clinquant, les images cathodiques
ou digitales, le bling-bling ne satisfont plus : no future !
Alors, le choix est simple : soit l'apathie, la fuite vers
d'autres paradis, artificiels, le désir de mort ou la révolte,
l'indignation dont on parle tant depuis quelque temps. Ne
plus être joué devient le mot d'ordre, faire coïncider la
morale avec les faits, peut-être, comme le proclamait
encore Anacharsis Cloots la veille de gravir les marches
menant à la guillotine.
Cette révolte, ce refus d'entendre les beaux discours est
entré dans l'École, s'est immiscé dans les esprits. On
commence à ne plus croire en cette École qui n'a pas su
changer vraiment d'esprit et de forme. On ne croit plus
en ces profs qui apparaissent trop comme les derniers
mainteneurs d'un ordre qui se défait, les CRS d'une
institution en pleine déréliction. On ne croit plus en cet
avenir qu'on nous promet par l'intermédiaire de diplômes
dévalués. On a conscience de n'avoir qu'une vie. On veut
le bonheur et on se demande si ce bonheur est vraiment
inscrit dans les finalités matérielles offertes à la
consommation, dans l'électronique et ses mondes
virtuels, dans les objets et les loisirs de masse…
La société française se caractérise en outre dans sa
composition par l'ouverture qui s'est faite (non sans
difficulté) aux filles et fils de l'immigration. La part
importante de ces jeunes gens dans l'ensemble de la
population scolaire aide aussi à mieux comprendre la
méfiance dont est désormais entourée l'institution
scolaire.
Une nation renfermée sur elle-même peut célébrer à
175
l'infini ses propres mythes, ses a priori, ses stéréotypes.
Sans l'apport d'un sang nouveau, elle serait condamnée
au mieux à un immobilisme qui lui ferait, peut-être,
accepter comme allant de soi ce que les générations
précédentes lui ont transmis.
Le monde moderne d'abord, la mondialisation en marche
depuis plus longtemps qu'on ne le dit généralement ne
permettent plus cette isolation source d'un conservatisme
total. Or, les générations d'immigrés arrivés en France
depuis la fin de la guerre de 1914 et surtout depuis les
années soixante représentent ce sang nouveau susceptible
d'amender le monde dans lequel ils sont entrés de force.
Ces immigrés ont aussi été une concession accordée au
reste de la population qui a cru ainsi se retrouver dans la
position du maître face à ces nouveaux venus. Ils étaient
surtout le tribut à payer à une évolution qui oblige à aller
chercher ailleurs qu'en France les travailleurs non
qualifiés et bons marchés dont le système économique a
besoin. Ces nouveaux esclaves arrivent donc pour
constituer les bataillons de producteurs qui ne coûtent
quasiment rien, d'autant plus qu'on pense les renvoyer
quand ils ne seront plus nécessaires.
Mais là encore, on s'est trompé. La décolonisation, une
main-d'oeuvre moins manoeuvrable qu'on le prévoyait, les
réactions d'une partie de la société civile, des
organisations syndicales et humanitaires, de certains
partis ont fait que ces gens ont difficilement, au cours de
longues années, tout de même réussi à obtenir un certain
nombre de droits élémentaires et ceux qui ne devaient
être qu'une main-d'oeuvre d'appoint taillable et corvéable
à merci ont pu (encore imparfaitement) s'imposer dans la
société française à un tel point que leur absence serait
aujourd'hui impensable : la France est cette mosaïque
176
jamais complète de citoyens venus de tous les horizons et
qui font souche sur son territoire. Qui font souche, mais
qui n'oublient - pas plus que le Breton, le Corse ou
l'Alsacien - jamais leurs origines. Ces gens venus
d'ailleurs ont considéré les habitudes françaises avec le
regard de l'Usbek des Lettres persanes, le regard naïf de
celui pour qui les habitudes, les traditions, les vérités
établies n'ont rien de sacré. Le roi est nu à leurs yeux !
Cette jouvence d'une vision neuve a certainement
beaucoup apporté à la France et lui apportera encore, car
elle seule est capable de montrer ce que les habitudes font
qu'on ne remarque plus.
En particulier, les jeunes gens issus de ces familles et de
cultures n'ont pas été préparées à idolâtrer l'école laïque,
et n'ont que faire des images d'Épinal, de ces enseignants
qui seraient les héros de la République, de cette
consensualité sur des valeurs établies avant eux, donc
sans eux. Protégés par leurs propres a priori, ils
considèrent avec distance le puéril folklore scolaire et ne
s'y sentent pas trop à l'aise. L'École a continué à
fonctionner ces dernières décades parce qu'elle a
bénéficié de préjugés habilement distillés dans les esprits
par le système économico-politique ambiant : vieille
dame respectable, qu'on peut certes chercher à
"améliorer" par des réformettes inoffensives, mais
qu'on ne doit pas mettre en question dans ses
fondements. La tradition et l'autorité, le respect sont une
obligation pour une école laïque et républicaine qui n'est
là que pour le bien de tous… Cette règle non écrite est
obsolète désormais. Les jeunes issus de l'immigration
savent sans doute mieux articuler leur colère contre un
système qui les déçoit et contre son alliée, l'École, qui
continuent à faire d'eux, dans leur majorité, les perdants
177
ou les parents pauvres auxquels on consent quelques
mendicités en osant par exemple parler de discrimination
positive ! Leur colère, leur côté iconoclaste ne reste
d'ailleurs pas leur seul fait, l'incendie se propage et tous
les élèves désormais, de quelque origine qu'ils soient, ne
voient plus l'École avec les yeux de leurs parents.
Avec une population scolaire dans laquelle ils
représentent une forte proportion, il n'est plus possible de
tenir les mêmes discours ni d'avoir les mêmes réponses
aux problèmes soulevés qu'il y a ne serait-ce que vingt
ans. Certains de ces jeunes ont fait souffler - parfois avec
violence - un vent de revendication dans les
établissements scolaires et c'est en les écoutant que
l'école pourra changer, se métamorphoser, car ils
représentent des jeunes gens qui ont besoin de tout autre
chose que de l'École poussiéreuse qui essaye de les
presser dans son moule dépassé. Par leur regard venu
d'ailleurs, ils sont le levain nécessaire à des
transformations qui devront prendre forme.
Dans le fond, on ne peut être que satisfait de voir que ces
générations nouvelles ont été, par leur refus de l'école,
les premières à dire ses vérités à cette vieille dame
indigne !
Si l'apport des enfants de l'immigration a servi pour une
part à débloquer la société et à relancer le
questionnement sur les formes et les finalités de
l'institution scolaire, un autre facteur est essentiel :
l'accession à "sa majorité" de la moitié de la population
française : celle des jeunes filles et des femmes. On l'a vu
plus haut : jusqu'au premier conflit mondial, l'éducation
scolaire féminine est traitée en parent pauvre. Pour le
système, la femme n'intègre pas encore réellement (bien
178
que le nombre des travailleuses augmente fortement
jusqu'en 1914) le monde de l'économie et de la
production. Son action est généralement considérée
comme négligeable et il ne paraît pas opportun de se
mettre en frais pour celle qui n'est considérée au mieux
que comme l'aide, voire l'esclave de l'homme. Les
choses cependant commencent à évoluer dès avant le
premier conflit mondial : la voix des femmes, leur
revendication se fait entendre et la place qu'elles
prennent au cours de cette guerre est considérée par tous
les observateurs et historiens comme le pas décisif dans
l'acquisition de droits qui les amèneront très
progressivement à la parité juridique avec leurs
homologues masculins. Sans entrer dans le détail d'une
prise de conscience et d'une transformation de la
condition féminine (toujours incomplète : les mentalités
évoluent lentement) sur les plans psychologiques,
sociaux, juridiques et politiques, on peut noter que
l'école mettra tout de même environ un demi-siècle à
prendre la mesure des évolutions en cours. Jusqu'à une
date relativement récente, les sexes sont séparés et la
poursuite d'études demeure une des prérogatives
masculines : écoles de filles et de garçons, lycées de
jeunes filles et de jeunes gens, agrégation masculine et
féminine, impossibilité à un homme d'enseigner dans le
maternel… Désormais, au moins sur le plan théorique,
ces freins, ces réflexes, n'existent plus et l'institution
scolaire ne fait quasiment plus de différence entre les
sexes, même si les pesanteurs intellectuelles, parfois
ravivées, suivent avec un certain retard : l'enseignement
technique est toujours moins ouvert aux filles sauf dans
les filières destinées au tertiaire ; on se répète encore que
les jeunes filles seraient plus littéraires, les garçons plus
179
scientifiques…, tant de fariboles qui se survivent dans les
bureaux de la rue de Grenelle comme dans le secret des
conseils de classe.
Cette accession à sa majorité donc de la population
féminine, au moins autant que l'apport des enfants de
l'immigration, ne pouvait se faire sans que le modèle
scolaire machiste dans son essence ne soit remis en
question.
Du côté des enseignants : des hussards de
la République au prolétariat intellectuel…
Si du côté des élèves, l'impatience face à l'institution
scolaire se généralise, c'est au moins autant le cas chez
les enseignants. Nous sommes désormais loin de la
période glorieuse de l'instituteur et de l'institutrice en
blouse grise et de la mythologie dans laquelle on les a
drapés. La situation a bien changé. La position sociale
n'est plus la même qu'il y a seulement quelques années
encore et le travail est tout autre. L'enseignant est devenu
la bonne à tout faire en matière d'éducation. Mal préparé
à toutes les tâches qu'on lui demande, il est à la fois
chargé de garder les petits pour - officiellement -
socialiser les enfants, pallier les différences sociales en
assurant à tous les mêmes chances de départ, permettre
aux parents de vaquer à leurs occupations
professionnelles ou autres. Il doit éduquer, intéresser,
amuser. On attend aussi de lui qu'il transmette savoirs et
180
savoir-faire…
Il y a peu de temps encore, les choses étaient plus
simples. Je peux en témoigner !
Jadis et Naguère
Le jeune Renan disait être entré en Allemagne et avoir cru pénétrer
en un temple, le Temple du savoir et de la philosophie. Mon
émotion devait être à peu près la même que la sienne lorsque,
bachelier tout frais émoulu, échappant enfin au ronron des cours du
lycée, je fis mes premiers pas dans le hall de la Faculté des lettres
de Rennes. Mai soixante-huit venait de passer et l'Université avait
jeté au feu la toge ou le costume trois-pièces pour enfiler des
jeans : elle se voulait désormais au moins en surface foncièrement
irrespectueuse et libertaire. La vieille dame coincée s'était
transformée en une pétroleuse irrésistible.
Disait-on.
Les Premières années, les bleus comme moi, avaient en apparence
tous les droits, rien n'était plus imposé. Le carcan des siècles
passés avait laissé place à la bride sur le cou ! Alors que les "libreservice
" commençaient à se développer dans le pays, il était tout
naturel que ce monument de la tradition qu'était l'université évolue
aussi dans ce même sens d'une inimaginable et infinie liberté.
Nous avions le droit de choisir nos enseignements, de faire nos
emplettes en quelque sorte, le panier à la main, dans un
gigantesque marché des idées. Les murs de l'amphithéâtre où
avaient lieu les inscriptions étaient couverts d'immenses listes
bariolées qui proposaient aux futurs étudiants un nombre
incroyable de cours et de combinaisons de matières possibles. On
pouvait s'inscrire en lettres, mais en même temps en philo et en
psycho, en dramaturgie, en arts plastiques... Si l'envie vous en
prenait, vous pouviez ajouter à votre sélection d'autres
"valences" : de l'anthropologie, de la musicologie, de l'histoire
de l'art voire des mathématiques "modernes", du breton ou des
langues anciennes grâce à des cours pour grands débutants dont
certains étaient programmés le soir afin de permettre aux étudiants
travailleurs de profiter des mêmes chances que leurs camarades
181
plus favorisés par la fortune. Nous applaudissions à de telles
débauches de générosité, à de telles avancées sociales, ne
cherchant d'ailleurs pas à imaginer la fraîcheur du malheureux
étudiant-travailleur à la fin de sa journée !
La seule inscription en lettres vous amenait donc à vous décider
pour un certain nombre de cours ou d'unités de valeur (!) parmi
une offre aussi diverse que variée. Ainsi, chacun faisait-il ses choix
attiré par les intitulés les plus flamboyants, les plus étranges, les
plus baroques. Comme dans les halles de la place des lices, le
marché hebdomadaire de Rennes, on pesait et repesait les offres,
on les flairait, les tâtait, les plaçait précautionneusement au fond de
son porte-documents, on y renonçait ensuite parce que l'étal
suivant proposait quelque chose d'encore plus alléchant, de plus
surprenant, de plus inattendu, d'absolument inconnu mais si riche
en potentialités : la littérature comparée, la linguistique, la
sémiotique, le structuralisme, des auteurs du second rayon appelés
à un nouvel avenir, "Les petits Romantiques", "Le roman
policier", "Romans de gare et romans photos", "Le théâtre de
l'absurde", "Le nouveau roman", "L'OULIPO"… Les héros du
moment s'appelaient Goldman, Lefebvre, Barthes, Richard,
Jakobson, Foucault, Deleuze, Derrida, Lévi-Strauss, Saussure,
Piaget, Chomsky, Greimas, Kristeva, Georges Bataille, Gilbert
Lely… Ils rejoignaient leurs grands aînés dont on avait entendu
vaguement parler en classe : Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Freud,
Marx et son copain Engel…
Je restai en équilibre sur un pied devant une grande affiche qui
faisait ainsi la retape :
"La clef du structuralisme analysé dans ce cours est le primat de
l'opération, avec tout ce qu'il comporte en épistémologie
mathématique ou physique, en psychologie de l'intelligence et
dans les relations sociales entre la praxis et la théorie. C'est en les
coupant de leurs sources que nous tenterons d'aboutir à faire des
structures des essences formelles lorsqu'elles ne demeurent pas
verbales : c'est en les y replongeant que l'on rétablira leur
solidarité indissociable avec le constructivisme génétique ou
historique et avec les activités du sujet. Le cours aura lieu le mardi
de 13 heures à 15 heures. En raison des TP, le nombre de
participants sera limité à 30."
Tout cela me paraissait tout de même fort compliqué et, reprenant
ma déambulation, je passais au stand suivant où un grand maigre
182
barbu promettait une nouvelle lecture parallèle de Rimbaud et de
Corbière à partir des écrits de Wilhelm Reich… Il avait l'air sympa
ce type. Les Amours Jaunes me tentaient (un titre pareil flattait ma
curiosité et puis ce Corbière-là était breton comme moi) ; on disait
en outre que Reich allait bien plus loin que Freud, mais, réflexion
faite, le Dormeur-du-Val qui n'était pas-sérieux-quand-on-a-seizeans
entrevu au lycée ne m'attirait plus trop… On avait passé des
heures d'ennui et de récitations ânonnées avec un prof qui, en
guise d'explication, ne savait que se gargariser du "génie
précoce" de Rimbaud, ironiser sur notre propre nullité et nous
conseiller avec condescendance d' "en prendre de la graine".
En définitive, j'avais choisi de faire un peu de philo, un rien de
psycho et d'ajouter une pincée d'histoire de l'art au plat de
résistance constitué par la littérature, ne me décidant, par curiosité
ou par conformisme moderniste, que pour une initiation à la
linguistique. La grammaire - qu'elle soit structurale ou générative
- ne m'intéressait pas. Je n'en avais plus fait depuis la quatrième et
tout le monde s'accordait pour affirmer qu'avec toutes ses règles
arbitraires, elle était parfaitement ringarde et inutile. Un instrument
de classe par excellence auquel nous, les enfants de Mai et d'un
Marx jamais lu mais toujours revendiqué, n'allions tout de même
pas accorder nos faveurs. D'ailleurs les deux profs qui, seuls dans
leur coin, proposaient ce cours, avec leurs cheveux coupés en
brosse et leurs costumes étriqués façon IVe République, leur collier
de barbe à la Robert Hue avaient l'air particulièrement réacs, ce
qui était une preuve du bien-fondé de l'exclusion dont ils étaient
les victimes, une caution de notre mépris.
En littérature, je jetai mon dévolu sur les Petits Romantiques parce
que cet intitulé m'intriguait : Auguste Barbier, Claude Tillier,
Louis Ménard, Pétrus Borel, Célestin Nanteuil, Philothée
O`Neddy, Xavier Forneret, Aloysius Bertrand, Aloysius Block…,
tous ces jeunes gens pétris d'idées ardentes et généreuses, ces
génies maltraités et qu'il convenait de ressusciter, ces mal-aimés
honteusement oubliés de Lagarde et Michard. Je trouvais
scandaleux que ces malheureux aient dû attendre 1968 pour que les
gardiens de l'establishment, les chiens de garde de la bourgeoisie,
soient contraints de leur concéder une petite place dans le
Panthéon littéraire occupé par les gloires établies. Un impératif
moral catégorique guidait mes choix, un sentiment de justice me
183
poussait donc vers eux. Puis, je m'inscrivis à un cours sur L'Idiot
de la famille, parce que ce titre me plaisait et que j'allais enfin
faire du Sartre, Sartre que les profs du lycée évoquaient en pinçant
les lèvres ou en nous laissant entendre les paradis sulfureux de la
planète existentialiste. Je fus aussi tenté par un cours sur la
Pornographie au siècle des Lumières, à une étude du roman
prolétarien : Poulaille, Dabit, Constant Marva, sur lequel,
d'emblée, je choisis de faire un exposé bien que n'ayant ni lu une
seule ligne de cet auteur ni même jamais entendu parler de lui ! Sa
qualité de "mineur du Borinage" suffisait à le rendre attirant !
Mon voisin de table se rabattit - à partir des mêmes critères sans
doute - sur Rose Combe, garde-barrière auvergnate... Je décidai
aussi de prendre part à une série de conférence sur le Théâtre de
l'absurde. Bien que n'ayant jamais de ma vie mis les pieds dans
une salle de théâtre, je préférais négliger les Classiques parce
qu'ils ne pouvaient être que dégouttant d'une arrogance
insupportable. L'absurde me paraissait être plus près des réalités et
plus caustique, plus décapant, plus dans l'air du temps. Beckett,
Adamov ou Ionesco, cela changeait des Molière, Racine et
Corneille vaguement rencontrés au lycée et synonymes d'ennui.
Voilà. Ma première année s'est d'ailleurs bien terminée.
Les autres aussi. Je me suis passionné pour l'Imagologie, le roman
policier, le roman noir, le mélodrame, le roman initiatique au
XVIIIe siècle… J'ai glosé comme je pouvais sur le nouveau roman
alors que j'avais à peine feuilleté Balzac ou Zola. Je me suis pris
de passion pour Pédro Arrabal et Ariane Mnouchkine quand je
n'avais lu que Le Cid, Phèdre et Le médecin malgré lui en matière
de classiques. Je fis ma maîtrise sur Léo Malet et passai un
certificat sur La Maison du peuple de Louis Guilloux, mais
j'ignorai les ouvrages de Proust, Gide, ou Mauriac. J'ai fait
semblant d'adorer les surréalistes parce que cela se faisait, mais je
n'avais plus vu une ligne de Hugo depuis l'école primaire. J'ai
même eu 18 sur 20 à un exposé sur Les premiers échos de
l'inconscient chez Proust, dont j'avais au mieux feuilleté quelques
pages à la bibliothèque universitaire entre deux rendez-vous
amoureux, et réchauffé les poncifs traînant dans l'Histoire
littéraire des éditions sociales et un "Que Sais-je ?" rapidement
survolé !
184
J'ai passé mes concours avec succès puisque j'étais devenu maître
dans l'art de composer une dissertation selon les règles et que je
savais mettre en application cet aphorisme qui fleurissait sur les
murs de la Sorbonne : La culture, c'est comme la confiture : moins
on en a plus on l'étale. Et moi, j'étalais avec assez de doigté ce
que je m'étais mis à apprendre à marches forcées dans le Lagarde
et Michard exécré quelques années plus tôt, pour faire bonne figure
lors de ces concours : un peu de chacun, un saupoudrage
généralisé, les clichés les mieux établis... Rutebeuf, l'ancêtre de
Villon ; Rabelais, le géant, Agrippa ou le poète sous le harnais ;
Ronsard, l'Orphée du Vendômois ; Cyrano dans la lune ; le viril
Corneille, Racine si féminin ; Molière, le Martyr du théâtre ; La
Fontaine, notre Homère ; Montesquieu le Sage ; Diderot,
philosophe et pornographe ; le chat Voltaire ; le sensible
Rousseau ; Chateaubriand le rêveur ; Hugo le poète engagé ;
Lamartine et son lac ; Rimbaud le révolté ; Zola le naturaliste….
De quoi faire illusion, le digest d'un digest. Pauvre nourriture !
Je me suis donc retrouvé devant mes élèves, prêt à leur resservir ce
que j'avais appris pour qu'ils en prennent de la graine.
Pendant des années donc j'ai bravement fait mon travail
d'enseignant et de fonctionnaire respectueux, comblant mon
indigence intellectuelle par des préparations intensives et
rébarbatives faisant la part belle à la compilation. J'ai fonctionné
comme on le voulait. Petit engrenage au coeur de la grande
machine Éducation Nationale. Cependant, fonctionner avant et
après 68 n'avait pas tout à fait la même signification. Avant,
l'éducation nationale, c'était la grande muette ; après il fallait en
plus donner l'impression d'avoir l'esprit critique, d'être capable de
s'encanailler en entraînant les élèves hors des sentiers battus de
Lagarde, Michard, Castex tout en respectant cependant les
programmes. Alors, il convenait de reprendre - à dose
homéopathique - ce que l'on avait fait en fac : accueillir quelques
minores en ironisant sur les vieilles barbes, s'intéresser au romanfeuilleton,
aux journaux, aux revues, à la littérature de "kiosques
de gare", aux romans photos, à la pub… Il fallait introduire
prudemment de nouvelles techniques : les exposés à plusieurs pour
favoriser l'esprit de recherche et le travail de groupe, les panneaux
expositions, les discussions chaises en rond, le philips 6x6, les
incursions au CDI, les invitations d'auteurs, les projets culturels, le
théâtre, la vidéo… Il fallait en finir avec les manuels et faire
185
marcher la ronéo à alcool puis la photocopieuse car un-bon-proffait-
tout-du-début-à-la-fin : recherche de textes abordables par ses
élèves, préparation des activités, recherche de documents
iconographiques et cinématographiques, invention d'aides
pédagogiques, sans oublier le "ludique" car on n'apprend que par
le plaisir et le plaisir, c'est bien connu, ça se trouve dans le jeu !
C'était donc cette époque inénarrable où quatre malheureux élèves
serrés sur une estrade, une feuille en main, se poussaient du coude
pour se donner la parole, adressaient des petits signes aux copains
du fond de la salle, éclataient de fou rire ou, écrasés de timidité,
n'arrivaient pas à sortir une parole audible, ânonnaient ce qu'ils
avaient gribouillé sur leur pense-bête. Le prof faisait semblant
d'écouter, l'air inspiré, de prendre des notes. Il surveillait sa
montre. Huit minutes l'exposé, sinon, on ne s'en sort pas ! Allez,
aux suivants. On fera le bilan demain. Une note de groupe, un
corrigé distribué-à-lire-pour-la-semaine-prochaine-et-à-collerdans-
le-cahier et on passe à la suite. Dépêchez-vous s'il vous
plaît : on n'a pas que ça à faire !
C'était cette époque joyeuse où des profs de lettres (mais aussi de
mathématiques ou d'histoire) écrivaient avec leurs élèves des
livres policiers ou des recueils de poèmes, des contes illustrés et
des romans photos. Ils faisaient semblant de croire qu'ils ne
servaient que de guide et que le génie de leurs chères têtes blondes
était entièrement responsable du résultat final, tiré à trente
exemplaires, distribué aux parents ravis, à la bibliothèque du CDI
et à monsieur ou madame le proviseur qui y allait d'un petit
discours ému flattant l'imagination des jeunes, le dévouement de
l'enseignant et les lendemains heureux qui attendaient ces vingtcinq
jeunes gens si créatifs, si bien préparés à affronter les
difficultés de la vie.
C'était cette époque joyeuse où des profs montaient des pièces de
théâtre en transformant les jeunes en marionnettes, emplacements
marqués à la craie sur le plancher de la scène et costumes cousus
par une maman dévouée, avatars modernes des détestables Fêtes
de la Jeunesse de ma propre enfance...
C'était cette époque joyeuse où des profs organisaient des cafés
littéraires, des expositions en faisant comme si l'idée, la réalisation
venaient de l'enthousiasme juvénile des élèves. Les "jeunes" sont
formidables et moi je suis l'éveilleur celui qui permet ces
opérations hautement culturelles et susceptibles d'un grand
186
retentissement sur l'épanouissement de chacun… Le journaliste de
la rédaction locale passait parfois et la documentaliste recueillait
précieusement les découpures de journaux dans un press-book
qu'on ressortait aux grandes occasions.
Tours de passe-passe, illusions, illusionnisme, encensés par la
presse, les revues pédagogiques, les inspecteurs pédagogiques
régionaux, les missions culturelles académiques, les inspecteurs
d'Académie, les recteurs, le ministre, les concours, les sponsors
divers et variés : Crédits Mutuels, Caisses d'Épargne, BNP...
Nos jeunes sont formidables, notre système scolaire fait l'envie de
tous les pays du monde.
Nous sommes formidables.
Suis-je formidable ?
La parole de Madame ou de Monsieur l'Inspecteur Pédagogique
avait alors valeur d'oracle. Lorsque Son Autorité prenait la peine
de se déranger pour assister à un de mes cours et vérifier
l'orthodoxie de mon enseignement, c'était comme une apparition :
Sa Bonhomie soulignait l'excellence de mon travail, la valeur de
mon engagement, insistait sur mon avenir de professeur tout en
relevant, çà et là quelques petites incongruités, vénielles bien
entendu, qui n'entachaient pas la vision d'ensemble, mais
prouvaient que Son Autorité ne s'était pas déplacée pour rien. Avec
l'onction d'un prélat aux doigts boudinés, Sa Grandeur m'indiquait
alors d'une façon artiste, les quelques voies que je pourrais
emprunter pour améliorer encore ma pratique. Nous nous quittions
émus jusqu'aux larmes, lui ou elle devant ce brave fantassin de
l'éducation, devant ce Poilu qui en redemandait, et moi face à cette
Autorité si simple, si disponible, si républicaine, si satisfaite de
moi, si satisfaite d'elle-même. D'ailleurs, preuve indubitable de
cette collégialité, au moment de se serrer la main, Son Abnégation
daignait descendre de son nuage et prouver à l'inspecté qu'on le
considérait comme un collègue, comme un pair en s'intéressant
même à ses affaires intimes :
On m'a dit que vous effectuiez des recherches personnelles. Elles
avancent, ces recherches, cher collègue ?
Bien sûr, monsieur l'inspecteur, et…
C'est parfait mon cher. Continuez. Il n'y a rien de tel pour son
187
équilibre que de cultiver son jardin secret. Moi aussi je publie, pas
autant que je le voudrais, hélas ! mais notre métier est tellement
passionnant ! Au revoir et à bientôt. Dans deux ou trois ans peutêtre.
J'aimerais vous retrouver plus régulièrement, mais nous
sommes si peu nombreux !...
Napoléon pinçait bien l'oreille de ses grognards lors des revues.
Bien entendu, comme je mettais en pratique les conseils citoyens
qu'on me dispensait, ma carrière se déroulait au grand choix : je
franchissais les échelons rapidement et allègrement, le salaire
augmentait, les heures sup étaient majorées. Les inspecteurs
m'appelaient parfois - distinction insigne - pour préparer les sujets
de bacs, ceux de BTS et nous passions d'extraordinaires aprèsmidi
dans le Parnasse d'une inspection académique (car
l'inspecteur aimer à sonder la profondeur des provinces) à discuter
sur les textes et les sujets de dissertation que nous devions imposer.
Imaginez la salle Leclerc de Hautecloque, le portrait en pied du
chef de guerre, un drapeau tricolore recouvrant le coin supérieur
gauche du tableau, les hautes croisées entrouvertes sur un petit
parc vert sombre, les stucs au plafond, des corniches compliquées,
la moquette de haute lisse, des armoires ventrues cirées et
luisantes, quelques vieux livres dans une vitrine....
C'était l'occasion de longs débats où chacun des élus à ces
aréopages délicieux mettait son point d'honneur à lancer des
propositions irréalistes, mais au combien dignes de témoigner de
sa propre valeur intellectuelle, de son imagination, de son
originalité, de son modernisme érudit voire de son
anticonformisme… Une discussion de bas-bleus, une agréable
conversation de salon. Allions-nous proposer une phrase de
Wittgenstein ou un jeu de mots de Lacan pour ce bac ? Comment,
vous trouvez Lacan trop difficile pour nos élèves ? Mais l'humour
voyons, et la profondeur ! Nos jeunes s'y retrouveront plus vite
que vous ne croyez, cher collègue. Je puis vous assurer que… Moi,
dès la seconde, j'ai… D'ailleurs, l'interrompait un autre d'un geste
péremptoire, la subversion du sujet et la dialectique du désir
touchent particulièrement l'adolescent. À ce moment-là, ajoutait
narquoisement une sceptique, on pourrait s'interroger sur la
signification du phallus lors de l'érection du phare d'Ar Men !…
Na, na, na, mesdames et messieurs ! Pas de débat universitaire,
disait avec un bon sourire madame l'Inspectrice enchanté du
188
brainstorming que provoquait sa présence. Nous préparons les
sujets du bac ! Nous ne sommes pas en faculté, en licence, même si
vos propos se permettent quelques licences, voire licence ! Rires,
gloussements, rougissements, trémoussements de plaisir de la
basse-cour professorale… Vos intentions sont excellentes, mais
appuyons-nous davantage sur l'actualité, sur l'événementiel. J'ai
songé pour le bac G à un sujet dans le genre : Que pensez-vous des
nouvelles mères ? Nous utiliserions comme texte d'appui, un
article d'Evelyne Sullerot que j'ai apporté, là…
Tous sourires avalés, le collège des concepteurs de sujets se
penchait alors, mine sérieuse, soucieuse même sur le projet de
madame l'inspectrice. Il convenait de le trouver globalement bon
et intéressant, mais d'exprimer tout de même quelques réserves
assez solides pour montrer qu'on savait réfléchir, des réserves qui
ne devaient toutefois pas sembler décisives au point de vexer
madame l'IPR !
L'idée me paraît splendide, mais Évelyne Sullerot, je ne sais pas,
un peu trop catho sans doute… Mais mon cher, vous confondez
sans doute ! Sullerot catho ! Non ! Elle est socialiste, je vous
assure.
Et si on prenait un texte de la femme du ministre, ah ! comment
s'appelle-t-elle, la philosophe du féminisme ? Oui, la femme du
ministre de la justice… Vous voulez dire Élisabeth Badinter,
intervient une collègue charitable et condescendante ? Oui, c'est
cela, un texte de son histoire de l'amour maternel par exemple…
Ah ! Quelle belle biographie de Condorcet, elle nous a donné,
Élisabeth Badinter ! Condorcet, mais oui, l'auteur du fameux
projet d'éducation. Comment ? Vous ne situez pas ? Mais si…
Et pourquoi pas l'incipit d'Ainsi soit-elle alors, répliquait une
bonne élève entre deux âges ? Moi, je ne suis pas d'accord,
rétorquait un autre voulant se signaler à madame l'Inspectrice, car
il n'avait encore rien dit. Benoîte Groult, c'est tout de même un
peu léger pour le bac et Badinter, c'est toujours tellement
tarabiscoté. Sans son ministre de mari, son livre !... Je pense
comme madame l'inspectrice : Sullerot me convient mieux, et puis
nous avons le texte sous les yeux !...
Le temps passait et la proposition de madame l'inspectrice était
adoptée à l'unanimité. Quelle belle idée dans le fond ; quelle belle
journée avec son point d'orgue dans cet accord unanime sur le
texte choisi par Madame l'Inspectrice.
189
Et si nous allions prendre un café au coin de la rue du Rectorat,
proposait l'inspectrice ? En toute simplicité ! Il y a là-bas un petit
troquet pas mal du tout et nous l'avons bien gagné ce café. "Un
troquet" ! Madame l'inspectrice est délicieuse !
Les ordres de mission signés sur un coin de table pour obtenir le
remboursement des frais de déplacement, la garde rapprochée des
valeurs de la République, ses prétoriens respectueux emboîtaient le
pas à madame l'inspectrice et le petit groupe se dirigeaient alors
dans un joyeux brouhaha vers le caboulot fraternellement proposé.
On y évoquait les spectacles vus, les derniers livres lus. Chacun
attendait poliment son tour, se creusant la cervelle pour ne pas
paraître le nigaud de la bande.
Chacun payait sa tasse, bien entendu.
Ces années soixante-dix, c'était encore une époque
calme, tranquille. Les lycées ronronnaient. Une
association à bénéfices réciproques. Le Ministère avait su
intégrer quelques revendications soixante-huitardes et
nous avions l'impression - à condition de ne pas trop se
poser de questions - que tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Le nombre de bacheliers croissait,
l'objectif des 80% d'une classe d'âge au bac ne paraissait
plus utopique. Les mauvais esprits qui se plaignaient
d'une baisse des exigences ne disaient plus rien. Tout
semblait s'être normalisé. D'ailleurs, la généralisation
des jurys de bac ou de brevet, les ajustements
académiques et nationaux dans une perspective d'égalité
des chances, tout allait dans le sens d'une amélioration
des résultats.
Mais aujourd'hui, les jeunes professeurs sont de moins en
moins prêts à accepter le rôle qui a été celui de leurs
prédécesseurs : des vocations mal payées condamnées à
faire ce qu'on leur demande sans trop de réflexion. La
grande muette retrouve de la voix et l'enseignant n'est
190
plus d'accord pour exercer son métier comme une
vocation, avec une rigueur et une obéissance
ecclésiastique. Il exerce un travail comme un autre, il
exige qu'on honore ce travail comme il se doit et il refuse
de servir de bouc émissaire pour les problèmes de société
qui surgissent même s'il revendique de son appartenance
au service public.
De plus en plus conscient qu'on l'a relégué dans une
sorte de prolétariat intellectuel, il ne rêve pas d'un passé
prétendument glorieux, mais enrage d'avoir été tant de
temps le dindon de la farce et de l'être plus que jamais. À
quoi l'a-t-on réduit ? Un accessoire, un bras séculier, un
parlement croupion qui manifeste rituellement pour
défendre un statut de plus en plus précaire, pour lutter
contre des conditions de vie et de travail indignes.
Chaque enseignant fait ce qu'il peut à son niveau.
Certains s'effondrent et ils sont de plus en plus à ne plus
tenir devant les tâches multiples qu'on leur impose,
devant des responsabilités toujours plus nombreuses et
qu'ils croient de moins en moins être de leur ressort.
Récemment, on pouvait lire à la une des journaux que
quand 13% de la population exerçant une activité
professionnelle souffre de "burn out", 17% des
enseignants en sont les victimes ! Et ces chiffres ne sont
rien. Face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés
puisqu'ils sont tout de même les représentants en
première ligne d'un système, d'une école que quantité
d'élèves refusent, les stratégies sont nombreuses avant
d'en arriver à ce "burn out" dont on ose parler :
distribuer uniquement de bonnes notes, multiplier les
absences maladies, abuser de vidéos et de films pour
avoir un semblant de calme… À cela s'ajoute le fait que
le métier exercé est totalement découplé des études
191
effectuées : un étudiant qui s'est spécialisé dans le
Moyen Âge se retrouvera en lycée amené à enseigner
bien évidemment tout autre chose et celui qui aura bossé
à fond Pascal pour son concours de l'agrégation n'en dira
pas un mot dans sa salle de classe. On pourra objecter
que cela a toujours été le cas et que la formation
intellectuelle reçue devrait permettre de s'adapter
rapidement à d'autres thèmes, qu'elle sait susciter une
certaine plasticité de l'esprit et qu'un des axes du travail
de l'enseignant est de continuer à se former
intellectuellement au cours de sa vie. Une chose est tout
de même évidente, depuis la disparition quasi totale
d'une formation professionnelle entrevue quelques
années, le jeune enseignant se retrouve directement, sans
préparation, sans savoir comment s'y prendre, souvent
angoissé devant la classe. Un peu comme si un ingénieur,
qui aurait étudié la problématique de la fission nucléaire
au sein d'une équipe de chercheurs, devait, du jour au
lendemain, construire un pont et diriger le chantier ! Les
IUFM n'étaient pas la panacée, mais au moins ils avaient
cet avantage de présenter les statuts de la profession, d'en
éclairer quelques aspects, d'aborder un certain nombre de
situations possible, d'apprendre aux jeunes gens à
préparer un cours en fonction des programmes, à
planifier une année, à prendre cette habitude de travailler
collégialement en n'hésitant pas à résoudre en commun
les difficultés rencontrées, à réfléchir non seulement sur
les pratiques mais aussi sur leur bien-fondé et sur celui
des programmes, à avoir une vision critique des manuels,
à acquérir le sentiment qu'on ne se rend pas totalement
désarmé dans une classe même si les moyens mis à la
disposition de ces IUFM étaient dérisoires…
Ajoutons à cela l'ignominie de salaires seulement
192
acceptables en fin de carrière. Les jeunes professeurs, qui
perçoivent à peu de choses près le SMIC sont condamnés
à louer à plusieurs de petits appartements dans la région
parisienne par exemple ou dans les grandes villes pour
survivre. Certains sont contraints d'avoir recours à une
seconde activité pour s'en tirer lorsque le conjoint n'a pas
d'emploi. Heureusement, ils peuvent, la plupart du
temps, profiter de la cantine, ai-je entendu siffler
aigrement lors d'une rencontre de chefs d'établissement !
Et on parle de salaire au mérite pour remédier à
l'indécence du "traitement" des enseignants, avec en
perspective les recommandations de l'OCDE et des
porte-parole du système libéral : établir une concurrence,
une émulation, recommandations sur lesquelles je
reviendrai !
Tout est pourtant à revoir sérieusement à ce niveau
puisque chacun est d'accord pour affirmer que
l'éducation doit être une priorité !
Mais cette situation a ceci de bon que l'on est peut-être
allé trop loin et que les jeunes professeurs non seulement
sont de moins en moins prêts à continuer de se laisser
tondre comme des moutons mais qu'ils prennent aussi
conscience de l'inadaptation du système scolaire face à
des jeunes qui eux non plus n'acceptent plus tous les
diktats et toutes les fausses promesses dont on leur rebat
les oreilles. Ils constatent que le profil d'une classe
d'aujourd'hui est totalement différent sur les plans
socioculturels de ce qu'il était vingt ou trente ans
auparavant, d'autant plus que la place du lycée et des
études longues a changé du tout au tout, l'économie
réclamant davantage de diplômés, même si ces diplômes,
en dépit de dénominations quasiment immuables veulent
193
dire tout à fait autre chose. Ils savent que les techniques
de communication ont évolué, que le livre, l'écrit n'est
plus la forteresse culturelle par excellence. Ils n'ignorent
pas que la culture des jeunes se fait davantage hors
l'école que dans l'école et qu'on les oblige, eux, les
enseignants, à quantité d'activités pour lesquelles ils
n'ont pas été formés et qu'on ne leur laisse que la
possibilité d'enseigner en gros comme on enseignait il y
a quelques lustres…
Toujours est-il que le jeune prof, dès les années 80
d'ailleurs, a commencé à se poser des questions et à se
demander si ce qu'il avait totalement pris pour argent
comptant, ce rôle d'animateur et de gardien qu'on lui
demandait, ce rôle de distributeur de diplômes en grande
partie dévalués qu'on attendait de lui, n'était pas une
vaste fumisterie et que lui, pauvre innocent, n'était que
l'instrument d'un système inacceptable.
Alors, il a compris qu'il ne suffisait plus d'être moderne
pour changer le monde, de quelques photocopies tirées de
Libé pour faire un cours formateur, que demander à ses
élèves de composer des poèmes surréalistes pour
apprendre à écrire était une vue de l'esprit quand on ne
possède pas les bases de la langue, qu'imaginer une mise
en scène novatrice de telle pièce de théâtre classique en
transformant par exemple Le Cid en un western-écrit-enfrançais-
de-tous-les-jours n'améliorait ni la culture
littéraire ni les compétences rédactionnelles et
n'accroissait en rien l'autonomie de ces jeunes citoyens.
Il a compris devant le désastre qui s'annonçait que le
Bled et consorts, aussi honnis les uns que les autres,
n'avaient pas que de mauvais côtés et qu'avant de jongler
avec les notions, les savoirs et les savoir-faire, avant de
s'épuiser à un actionnisme brouillon, il convenait
194
d'assurer des bases solides sans lesquelles il n'est pas de
pensée sérieuse ni de liberté des individus.
Et il n'est plus d'accord avec ce système politicoéconomique
qui l'exploite comme jamais et qui lui
demande de faire de l' "abattage", de fournir les
diplômés, les fonctions, dont il a besoin au mépris de la
personnalité des élèves et du développement réel de ces
personnalités. Il commence à regimber, et pas seulement
pour défendre sa caste comme on le lui reproche souvent,
mais parce qu'il voit vers quel gouffre la réification des
individus risque de mener.
Il se rebiffe et le système n'a plus confiance en lui.
Il se rebiffe mais en même temps - on ne peut lui en
vouloir - il s'accroche à sa profession, à son statut, à
cette école qu'il veut croire améliorable alors que tout est
à transformer…
Du côté de la coalition politicoéconomique
:
le vertige et les nouvelles stratégies.
Le système lui-même, petit à petit, prend ses distances
d'avec une école qui lui apparaît comme de moins en
moins fiable.
195
Depuis 50 ans au moins, le ministère s'appuie sur des
statistiques qui doivent démontrer au public l'excellence
du système scolaire français, qui illustrent sa vocation
profondément démocratique et égalitaire : de plus en plus
de bacheliers, de plus en plus d'étudiants ensuite, des
diplômes en veux-tu ? en voilà ! Une évolution positive
au premier regard, allant tout à fait dans le sens des
aspirations profondes du peuple français, du pays des
Droits de l'homme, du pays de la fusée Ariane, des TGV,
de l'Airbus et des centrales nucléaires-qui-assurent-notreindépendance,
une évolution qui va aussi dans le sens de
ce que l'industrie, les services, la banque réclament! Le
ministère se targue encore de réformes, sans doute jugées
trop nombreuses par les parents, les observateurs, mais
qui mèneraient en fin de compte à une amélioration
globale des résultats, ces réformes devant en effet être
comprises comme autant d'efforts consentis pour le bien
exclusif des jeunes Français. Certes, reconnaît-on en
haut-lieu (reconnaître sa faute, son erreur est l'élégance
suprême en matière de communication et de démagogie),
la plupart d'entre elles n'ont pas abouti aux résultats
espérés, mais c'est l'intention qui compte, globalement…
Le système économique se réjouit en apparence comme
le ministre de l'accès de 90 ou 98% d'une classe d'âge au
baccalauréat. Il aurait tort de ne pas le faire puisqu'il ne
s'agit que de se mettre en adéquation avec les
recommandations de l'OCDE, l'agence de notation
pédagogique qui distribue satisfecit et blâmes comme
Moody's ou Standard and Co à l'égard de la Grèce, du
Portugal, de l'Italie ou de la France. Le mot d'ordre est
clair, l'économie mondiale a besoin de diplômés, de plus
en plus de diplômés. Au début des années 90, on lavait
les cerveaux en apprenant aux foules émerveillées que la
196
quasi-totalité des ouvriers de l'automobile japonaise
possédaient le bac et que c'était là la raison du succès des
marques nipponnes partout dans le monde ! Que le
ministère forme donc des diplômés et régule comme on
le lui demande les flux de futurs travailleurs. Qu'il garde
au parking scolaire le trop-plein qui gonflerait les chiffres
du chômage et oriente vers les métiers qui ont de l'avenir
les jeunes en faisant croire à tout le monde
qu'aujourd'hui tout est mieux qu'hier et que nos chères
têtes blondes bénéficient d'une meilleure et plus
complète éducation, qu'ils seront mieux armés à affronter
la vie et les défis d'un monde qui change si vite !
Continuons à présenter ces examens comme l'ascenseur
social par excellence même si toutes les études sérieuses
montrent que rien ne change dans une société figée dans
ses structures. Et cette société est d'autant plus figée que
l'ouverture de l'école sur le monde, ce maître mot tant
proclamé de la pédagogie des années 80-90 ne contribue
qu'à servir cet impératif d'adéquation entre ce qui est
appris et ce qui est exigé par l'industrie, la finance, les
marchés : former un exécutant et un consommateur
puisque les deux fonctions essentielles de l'homo sapiens
moderne sont désormais l'inscription dans le processus
de production au sens large du terme et la consommation,
aucune classe, aucun âge, aucun sexe, aucune confession
ne devant échapper à cette double dépersonnalisation des
individus.
Peu importe que la part qui reste à l'être en soi et à sa
réalisation soit devenue peau de chagrin, détail de
l'histoire.
En réalité, le néolibéralisme triomphant enrage qu'on
n'aille pas plus vite et autrement. Il aurait voulu qu'on
197
presse encore davantage et mieux les futurs producteursconsommateurs
dans le moule qu'il a rêvé pour eux. Par
souci d'efficacité, il a réussi à faire supprimer ou réduire
au strict minimum les enseignements jugés inutiles, il est
parvenu à faire accepter l'augmentation des effectifs des
classes et à ne plus recruter qu'un-enseignant-sur-deuxpartant-
à-la-retraite ! Mine de rien, il a imposé les débuts
d'une rationalisation, d'une gestion économicotechnocratique
à la rue de Grenelle. Mais il aurait voulu
plus et dissimule encore son impatience derrière le rideau
des belles paroles prononcées par les ministres, recteurs
et autres marionnettes politiques, ce discours altruiste en
apparence, uniquement préoccupé du bien de l'enfant, on
connaît la chanson !
L'école n'a rien d'un ascenseur social en dépit des statistiques
officielles qui cherchent à montrer une progression de la
fréquentation de l'université dans toutes les couches sociales. Ces
indicateurs n'ont aucun sens dans la mesure où les filières
universitaires sont libres d'accès, non sélectives et que la
démographie a explosé entre les années 1950 et 2005 ! Mon cours
de dissertation pour les premières années de lettres à l'Université
de M. était fréquenté en octobre par 87 étudiants. Ils n'étaient plus
qu'une quarantaine en novembre et seulement une bonne vingtaine
avait rendu les devoirs nécessaires et effectué les exercices prévus.
Peut-être étais-je responsable de cette désaffection, mais mes
collègues étaient aussi mal lotis ou aussi incapables. En réalité,
nombreux sont les étudiants qui ont seulement besoin d'une
couverture sociale et qui n'envisagent pas sérieusement d'étudier.
Nombreux sont aussi ceux qui, tout simplement, ne disposent pas
du bagage minimal qui leur permettrait de s'en sortir…
Une récente étude (octobre 2011) effectuée sur les bacheliers de
2008 montre que 31% sont entrés en licence à l'université mais
que 1 sur 2 ne continue pas en 2e année et les bacheliers
technologiques sont ceux qui abandonnent le plus. 32%
poursuivent en filière courte (BTS…) mais si 90% se retrouvent en
198
seconde année, les bacheliers professionnels réussissent le moins :
en Bretagne, par exemple, en 2011, on a constaté que 80%
échouent à l'Université en 1ère année, 50% abandonnent dans les
BTS ou IUT (qui n'en ont reçu que 38 sur les 7800 bacs pro !).
Enfin, si 8% des bacheliers sont entrés en classe prépa, un quart
abandonne en cours ou à la fin de la première année…
Dans le cas des grandes écoles (qui se sont multipliées !) les
effectifs démentent en effet l'enthousiasme démocratique des
statistiques ministérielles : X, l'ENA, l'ENS, HEC ne constatent
pas une augmentation de la part d'étudiants d'origine populaire par
rapport aux années 50, mais une diminution nette malgré les
décisions de s'ouvrir, comme à HEC, aux étudiants socialement
défavorisés par une politique (partielle) de recrutement faisant
passer dans les actes une discrimination positive mesurée.
Comme le rappelait un responsable de l'enseignement supérieur et
de la recherche : "Les trois quarts des bacheliers pro sont issus de
milieux défavorisés, alors que les trois quarts des bacheliers
généraux viennent de milieux favorisés".
Pourquoi cette impatience ? Parce que les donneurs
d'ordre semblent pris à leur propre piège ou pire encore,
ils se sont rendu compte que l'institution scolaire
traditionnelle qui avait été tant d'années leur alliée
silencieuse et indéfectible, cette institution était à bout de
souffle : la formation donnée ne correspondrait plus à ce
qu'ils attendent, les "niveaux" seraient catastrophiques,
et les jeunes gens arrivant sur le marché du travail
n'auraient plus tout à fait la même attitude que leurs
aînés : ils revendiquent, n'accordent plus la première
place dans leur vie à l'activité qu'ils exercent…
Les donneurs d'ordre doutent en outre de cette École
"conservatrice" : le statut de fonctionnaire des
professeurs qui en fait ces intouchables qu'ils aimeraient
voir disparaître, les hésitations à se débarrasser de
certains enseignements qui gênent, la montée en
puissance des élèves et des parents qui se mettent à élever
199
la voix, la difficulté qu'il y a à imposer qu'un
établissement scolaire doit se gérer comme une PME…
Cette École leur apparaît de moins en moins contrôlable
et ils craignent que leurs exigences ne soient plus
respectées, que les compétences demandées ne soient pas
obtenues… Ils ne voient plus dans l'École l'alliée
silencieuse de toujours. Leur critique de l'institution
scolaire va de pair avec celle des États : on écouterait
trop la rue, on serait trop sensible à la société civile et à
ses nouvelles exigences…
"Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse" ! À
force de réclamer davantage de diplômés, de charger
l'École de quantités de tâches, tout en acceptant, en
exigeant, une école "amincie", la moins coûteuse
possible, on devait s'attendre à l'apparition de certaines
difficultés : niveaux, ambiance générale, réactions des
acteurs...
Les donneurs d'ordre, qui ont plus d'un tour dans leurs
poches, ont vite effectué un rétablissement : ils insistent
sur ces difficultés, probablement pour faire le ménage,
passer au fameux "plan B" : se débarrasser d'une alliée
inefficace et favoriser en bon libéralisme l'apparition
d'un nouveau type d'institution scolaire fonctionnant,
elle, suivant les règles du marché.
L'argumentation sur laquelle ils s'appuient n'est pas sans
solidité et aisée à faire partager par tous ceux qui peuvent
le vérifier, parents, employeurs, voire enseignants : même
dans ses fonctions les plus "basiques", celle de
l'acquisition de la langue et des rudiments du calcul,
l'école n'est plus qu'un échec patent.
Si on arrive à quasiment 90% de reçus au baccalauréat,
on dissimule le fait que des dizaines de milliers d'élèves
200
quittent l'institution scolaire sans diplôme ni formation !
Quant à ceux qui réussissent, ce ne sont ni les concours
généraux, ni les grandes écoles, ni les médailles Fields
qui peuvent faire illusion (effets d'annonce encore) ! Le
bac et le succès aux examens universitaires ne mesurent
rien de significatif quant aux performances réellement
formatives (diront les uns), quant aux "compétences"
(diront les autres), du système éducatif.
Tiens, à propos, vous avez participé à un jury de bac ? Je parie que
non ! Eh bien, voilà !
Après péréquation nationale et académique, voire départementale,
dans un souci d'égalité, des profs correcteurs sont convoqués. On
va expédier mettons 100 candidats notés entre 8 et 9,9 à l'issue des
épreuves du bac (ça peut être entre 7,… et 9,9, voire…). Au
maximum, deux ou trois heures de jury sont prévues. Après,
signature des ordres de mission pour le remboursement des frais de
déplacement éventuels. Important ça, les frais et les indemnités de
jury. Un peu d'argent de poche. Pour les vacances. Un plateau de
fruits de mer sur la côte peut-être, ou une après-midi au centre de
thalassothérapie. Aux frais de la princesse !
Un universitaire (qui n'a plus jamais mis les pieds dans un
établissement du second degré depuis son propre bac) préside
l'absence de débats. Un professeur par matière est présent.
Volontaire désigné d'office, comme l'écrivait spirituellement
l'Almanach Vermot.
Le président, après une courte allocution prouvant qu'il vient bien
de Sirius et, faisant sourire (poliment) la piétaille qu'il a face à lui,
passe les dossiers à la chaîne : "Tel candidat a obtenu 8,1 de
moyenne ; il a eu 2 en philosophie et avait un 6 aux épreuves
anticipées de français. Si le professeur de philosophie et le
professeur de français sont d'accord, on peut proposer de majorer
les notes dans ces deux matières afin qu'il arrive à 10 de moyenne
générale, condition sine qua non de l'attribution du bac.
J'ajouterais que son carnet scolaire ne me semble pas trop
mauvais, précise le président après avoir jeté un coup d'oeil sur le
dit carnet."
Les deux professeurs incriminés pensent qu'il reste encore 90
201
dossiers, qu'on voudrait bien partir avant 17 heures. Ils n'ont rien
contre. Comment pourrait-il d'ailleurs en aller autrement ? On
majore donc. Candidat reçu ! Les statistiques prévisionnelles et les
résultats vont bientôt coïncider…
C'est comme cela qu'on établissait les statistiques économiques
dans la défunte Union Soviétique ; on est resté très politburo dans
notre France du XXIe siècle !
Lorsque l'élève recevra sa collante, il s'émerveillera d'avoir eu un
10 en philo alors que son prof, cette carne, ne l'a jamais gratifié
d'une note supérieure à 5. Dans le fond, il le savait, il n'est pas si
nul et les profs jugent vraiment à la tête du client. Ce salopard de
pseudo- philosophe, y pouvait pas m' blairer ! Ce 10, c'est une
sacrée baffe qu'il reçoit : il faut que je le voie pour le lui dire et lui
mettre les poin(g)(t)s sur les i !
Rien n'est parfait, hélas !
Les savoirs considérés par l'institution elle-même comme
fondamentaux sont très imparfaitement maîtrisés par une
majorité croissante d'élèves sortant de ce système dotés
de diplômes (et ces manques sont particulièrement
déplorables sur le plan humain puisque le jeune adulte ne
reçoit pas de l'école ce qui pourrait en faire un être
complet et autonome, l'éternel alibi de l'école
républicaine).
Les scientifiques s'inquiètent de la "somme
impressionnante de signaux alarmants" corroborant les
visions les plus pessimistes. À l'université, la maîtrise de
la langue est insuffisante chez de nombreux étudiants, ce
qui non seulement pose des problèmes aux responsables
des enseignements en sciences humaines, mais de telles
carences soulèvent aussi des difficultés pour
l'apprentissage des mathématiques et des sciences tant il
est impossible de raisonner sans cette bonne maîtrise de
la langue ! J'ai moi-même pu constater que de futurs
professeurs de lettres préparant le CAPES rendent des
202
dissertations très insuffisantes sur le plan de
l'orthographe d'usage, de l'orthographe grammaticale et
de la syntaxe, sans évoquer la pauvreté du style et du
lexique employé. Il est vrai qu'on ne demande plus aux
correcteurs de ces concours d'accorder la même
importance à la perfection formelle que naguère, quand,
par exemple, une ou deux défaillances orthographiques
suffisaient à éliminer un candidat à l'agrégation ! Jadis,
cinq fautes en dictée privaient l'élève de son certificat
d'études, ce qui était exagéré, alors qu'aujourd'hui on
n'ose plus compter les fautes du bachelier (ou alors on
décide d'appliquer la fermeté (!) et de retirer au
maximum un ou deux points si le devoir est cousu
d'incorrections, ce qui permettra de dire que les jurys ont
été sévères et qu'on renoue avec les grandes traditions
d'excellence) ; naguère encore, on ne pouvait devenir
agrégé avec une expression écrite même légèrement
défectueuse, alors que désormais la "forme" ne compte
plus guère ! Sans faire une vache sacrée de l'orthographe
ou de la syntaxe (il est bien des règles qui pourraient être
réformées, simplifiées, mais réformer et simplifier, c'est
se contraindre à de nouvelles règles, ce n'est pas faire
n'importe quoi !), il faut bien reconnaître qu'une langue
pour sa précision, pour sa richesse a besoin des nuances
qu'elles introduisent et que les négliger, comme négliger
le vocabulaire, c'est condamner l'apprenant à une
expression frustre, à une pauvreté pour dire soi et le
monde…
Ces faits sont avérés. Pour faire ce que les donneurs
d'ordre voulaient, c'est-à-dire donner la priorité aux
nouvelles formations, à ce qui sera utile pour le futur
producteur-consommateur, on a diminué le nombre
d'heures consacrées au français dans le primaire et les
203
collèges dans des proportions importantes depuis trente
ans alors que d'un point de vue purement humain,
spécifiquement éducatif, il aurait été sage de procéder
autrement... La lecture à voix haute, les dictées,
l'apprentissage de poésies, celui systématique du
vocabulaire et des règles grammaticales sont de plus en
plus rares ou ne représentent qu'une part infime du temps
scolaire. Dès le départ, l'enseignement primaire ne
remplit plus sa fonction : la lecture, le calcul,
l'observation, l'écriture n'y sont plus acquis
véritablement par une proportion croissante d'enfants.
Ceux-ci ne sont plus censés acquérir la maîtrise de
l'idiome en apprenant de leurs maîtres des savoirs
grammaticaux et lexicaux déjà constitués, d'abord
simples puis au cours des années plus complexes, un
apprentissage renforcé par des exercices d'application
soigneusement dosés puis des travaux d'écriture, de
réemploi, personnels, mais en les découvrant eux-mêmes,
par l'observation des extraits de textes qui, d'ailleurs,
dans leur "saucissonnage" sont souvent d'une telle
banalité voire d'une telle pauvreté qu'ils ne peuvent que
donner le dégoût de la littérature quand le jeune apprenti
lecteur découvre que l'auteur de ces trois ou quatre lignes
rébarbatives s'appelle Chateaubriand, Balzac, Gide ou
Camus.
On est revenu, certes, sur les méthodes dites globales de
lecture, mais les méthodes "semi-globales" qui les ont
remplacées restent insuffisantes et induisent parfois de
mauvais réflexes. Les parents qui le peuvent - et
l'importance des origines sociales n'est plus à souligner
en dépit de tous les discours égalitaristes - se chargent
donc de cet apprentissage et les vieilles méthodes
syllabiques, l'ancienne méthode Boscher, Léo et Léa sont
204
à nouveau demandées !
J'ai pu constater qu'un des obstacles à la dictée
traditionnelle était l'impossibilité d'une fraction
importante des élèves de collège (en 4e par exemple) de
retenir un segment de phrase significatif lu et répété par
le professeur. Il faut sans cesse redire, rabâcher et
certains élèves n'écrivent leur dictée qu'au mot-à-mot.
Dans ces conditions, ils n'ont pas la possibilité de
comprendre vraiment ce qu'ils écrivent, il n'est plus
possible au professeur de transmettre le rythme de la
phrase et des mots, les liaisons, et la dictée devient la
copie désagréable et ennuyeuse d'une suite de mots qui
ne forment guère sens. Les choses ne sont d'ailleurs que
peu différentes quand il s'agit de copier un texte :
beaucoup d'élèves ajoutent les mots aux mots sans
vraiment se préoccuper de la signification de ce qu'ils
copient plus ou moins correctement, habitués qu'ils sont,
sans doute, à faire plusieurs choses simultanément :
parcourir une BD le casque sur les oreilles pendant qu'un
film défile sur l'écran qu'ils ont en main et qu'ils
essayent encore d'envoyer un SMS ! Dans les lycées
même, certains professeurs de lettres ne se fixent plus
comme objectif raisonnable que de parvenir à faire écrire
à leurs élèves une phrase correcte et de rester attentifs à
la lecture d'un texte d'une trentaine de lignes ! Après
douze années d'enseignement, nombreux sont les
bacheliers incapables de rédiger correctement un texte
personnel, incapables de situer tel ou tel auteur,
incapables de parler de livres qu'ils auraient dû lire,
incapables de résumer un texte de difficultés moyennes !
Or ces élèves sont intelligents, capables de réfléchir…
Où est l'erreur ? Je me souviens de ces copies d'histoire
oubliées sur le bureau par un collègue de l'établissement
205
où j'exerçais encore il y a peu de temps. Les notes étaient
toutes excellentes. Il s'agissait de la classe parallèle à la
mienne. Étonné de voir de tels résultats quand je savais la
difficulté qu'avait la majorité de mes propres élèves à
rédiger un paragraphe, j'entrepris de lire quelques copies
en attendant l'arrivée de ma classe. Je n'ai pas eu besoin
de beaucoup de temps pour me faire une opinion : les
textes que je venais de déchiffrer étaient quasiment
illisibles : orthographe fantaisiste, syntaxe bousculée et
absence de ponctuation ! Pourtant, mon collègue avait
généreusement distribué les 16, les 17 et les 18 tout en
s'abstenant de la moindre correction et en se contentant
d'une courte remarque "fayotte" et creuse dans le
genre : "Excellente étude des documents ; continue
ainsi, c'est bien !" voire d'appréciations lapidaires mais
toutes outrageusement flatteuses.
Lorsque je rencontrai mon collègue, je lui remis ces
copies oubliées et lui donnai mon avis. Il s'empourpra et
me répondit qu'il n'enseignait pas le français, que si le
niveau de langue était insuffisant, c'était aux professeurs
de lettres qu'il fallait s'en prendre, en l'occurrence à moi
et non à lui, professeur d'histoire qui n'allait
certainement pas pénaliser des jeunes victimes des
incompétences d'enseignants d'autres disciplines !
Les jeunes étudiants de lettres n'ont, le plus souvent, que
peu de notions d'histoire littéraire, celle-ci étant
totalement abandonnée ou enseignée sous forme de
vagues jalons : le "Moyen Âge", la Renaissance, le
romantisme, le naturalisme… On ne leur donne plus le
goût de lire en s'en tenant au mieux à trois ou quatre
oeuvres annuelles (souvent "lues" à travers les
nombreux "digests" que proposent les éditeurs),
206
considérées comme un effort insurmontable. Les grands
écrivains de la littérature universelle, ces oeuvres qui
auraient pu illuminer leur pensée et élargir leurs horizons
si les professeurs qui se disent pressés par les
programmes avaient pu les leur faire découvrir (à
condition qu'eux-mêmes aient, au cours de leurs études,
dépassé le stade des morceaux choisis et de
l'apprentissage de quelques clichés) leur resteront
inconnus. Et puis, ils ont aussi perdu l'habitude d'écrire,
ce qui est écrire : on ne rédige plus de dissertation,
le "coupé-collé" est admis dans les exposés bégayés
devant un auditoire qui s'ennuie…
Quant à l'oral, tout est possible, plus rien n'est incorrect,
la langue s'est libérée ! Le problème est que l'enfant ne
maîtrise pas cette base à partir de laquelle il pourrait se
permettre ce qui serait alors des effets de style ! Entre les
sketches de Coluche et sa gouaille prise au pied de la
lettre, les grasses plaisanteries qu'on entend sur toutes les
radios, les personnalités qui font "peuple" en adoptant
en public un langage "cool", il ne sait plus où il en est.
En histoire, on retrouve cette disparition des repères
chronologiques à tel point que les époques se mélangent :
la renaissance sous Louis XIV, Napoléon III au XVIIIe
siècle, les dix siècles de l'histoire de Rome formant un
bloc… On préfère demander à l'élève de 12 ans de se
mettre dans la peau de l'historien professionnel en
réfléchissant à partir de documents (tirés d'un manuel ou
d'une revue pédagogique), en en faisant la critique alors
qu'on ne leur a seulement jamais appris les dates clés de
notre histoire et qu'ils n'ont aucune idée de l'évolution
de la langue, des contextes où ont été produit ces
"documents" taillés sur mesure par l'éditeur !
Les langues vivantes sont tout autant désastreuses : après
207
6 ou 7 années d'anglais, quel élève est capable de se
débrouiller à Londres, à Dublin ou à New York ? De plus,
les langues autres que l'anglo-américain sont réduites à la
portion congrue et les langues anciennes ont quasiment
disparu. J'ai reçu dans mon établissement francoallemand
des élèves préparant l'abi-bac : l'effet
d'étiquette ne tient guère. On fait croire au malheureux
élève qu'il est bilingue et ses parents s'en
enorgueillissent d'autant plus facilement qu'eux-mêmes
ne parlent pas toujours l'allemand, mais en réalité, le
professeur après son cours d'histoire en allemand fournit
aux élèves le plus souvent un résumé en français "pour
que l'heure ne soit pas totalement perdue", comme me
l'avouait l'un d'eux !
En ce qui concerne les mathématiques et le calcul, les
choses ne sont pas différentes. Sans revenir sur la
fameuse réforme des "maths modernes" dont les effets
ont été terribles particulièrement lorsqu'on a voulu
l'imposer à l'école primaire et au collège en enfermant
l'enseignement dans une approche formelle et
dogmatique coupée de l'intuition commune, totalement
inapplicable à ces niveaux, les programmes Joutard,
publiés en 2002 repoussaient l'apprentissage des quatre
opérations qui débutait autrefois dès le CP (jusqu'aux
années soixante) : l'addition au CP, un peu de
soustraction au CE1, la quasi-disparition de la division et
de la multiplication sur les décimaux de tout
l'enseignement primaire… Le rapport Thélot préconisait
même de seulement apprendre à compter (énumérer) en
CP et CE1 et de ne commencer le calcul qu'en CE2, la
division étant réservée au CM2. En même temps, la
théorie officielle est qu'il faut commencer par "donner
du sens aux opérations" ! C'est donc à n'y rien
208
comprendre puisque les nombres et les opérations sur les
nombres ne prennent de sens que les uns par rapport aux
autres : 563 est bien 5 fois 100 plus 6 fois 10 plus 3 ! On
en vient à croire que la hiérarchie a, elle aussi oublié (ou
n'a jamais acquis) le bon sens, la logique et le vrai
raisonnement ! Ce même rapport Thélod donnait pour
objectif de fin de 3e la maîtrise des "opérations
mathématiques", probablement les quatre opérations !
Au lycée la filière scientifique tant vantée voyait ses
horaires diminuer dans des proportions comparables à ce
qui s'est fait pour le Français. À la fin d'une terminale S
les élèves ont perdu l'équivalent d'une année et demie
par rapport aux Terminales C d'il y a une trentaine
d'années. Comme pour le français encore, le programme
officiel fait illusion et donne en apparence l'image d'un
savoir complet et cohérent, mais il ne reflète en rien le
véritable savoir acquis par l'élève. On ne demande
presque plus d'être capable d'établir une démonstration
en bonne et due forme et la plupart des élèves de
Terminales scientifiques arrivent au bac avec pour
bagage un petit nombre de recettes et de procédures
mémorisées sans compréhension véritable, approfondie et
intériorisée. Ainsi, savoir tracer le graphe d'une fonction
en s'aidant d'une calculatrice et reconnaître quelques
aspects qualitatifs de ce graphe suffisent aujourd'hui à
assurer la moyenne. Qu'on pose une question de
géométrie imprévue où le rôle des coordonnées est
inversé par rapport au modèle habituel, comme cela a été
le cas en 2003, et c'est une véritable catastrophe
nationale qui motive l'intervention du ministre !
D'ailleurs, si on choisit cette filière, c'est très souvent
moins par amour des sciences que pour échapper aux
autres filières dont on dit qu'elles "ne mènent à rien" et
209
dans lesquelles le chef d'établissement "met" les
professeurs les moins compétents !
L'apprentissage des matières scientifiques comme
apprentissage de réflexes conditionnés ? On prépare ainsi
sans doute le futur travailleur à accomplir son rôle à venir
de presse-bouton, de machine à produire. Quant au
jugement porté sur les filières non scientifiques, on
comprend qu'il reflète ce que la majorité manipulée,
réifiée attend de l'école : une institution qui prépare les
jeunes à un travail immédiatement monnayable et non
pas à une éducation de l'esprit, à un supplément d'âme.
On comprend aussi le dégoût de nombreux élèves pour
les matières scientifiques bien qu'ils se laissent diriger
vers cette filière S !
Si des élèves parviennent cependant à continuer à
s'intéresser aux mathématiques et font tous les efforts
possibles pour dépasser ce stade du rabâchage de recettes
insipides, c'est parce que certains professeurs ne leur
comptent pas leur temps et leur enthousiasme et aussi,
encore une fois, grâce à l'aide des familles, quand elles le
peuvent, et de remédiations extérieures à l'éducation
nationale : ces professeurs mal payés ne refusent pas les
cours privés, qui leur permettent de "mettre du beurre
dans les épinards" et… d'apporter de l'eau au moulin
des tenants d'une éducation "libéralisée".
La faiblesse des acquisitions, le manque de connaissances
structurées de la plupart des jeunes bacheliers, font qu'en
lettres, en histoire, mais aussi en mathématiques,
physique et chimie, ils éprouvent les plus grandes
difficultés à intégrer l'enseignement supérieur, qui
d'ailleurs a renoncé de son côté à être ce qu'il devrait être
et devient de plus en plus la prolongation d'un
210
enseignement secondaire appauvri. Les élèves les plus
solides choisissent ce que l'on considère encore comme
étant les filières d'excellence, les grandes écoles. Mais, là
aussi, la même érosion est à l'oeuvre. Des professeurs des
meilleures classes préparatoires scientifiques se plaignent
d'avoir à faire à des étudiants qui ignorent les principes
de la démonstration et les règles élémentaires de la
logique. Si, dans ces filières, on parvient à combler plus
ou moins les manques, les jurys des Écoles normales
supérieures ou de l'École polytechnique observent
régulièrement d'étonnantes carences parmi même les
candidats reçus aux concours d'entrée ! Dans les
entreprises, on s'étonne des lacunes des stagiaires, de leur
fatigabilité, de leur manque d'engagement…
Toutes ces dérives vont au-delà des volontés du
"marché", des désirs des donneurs d'ordre et ils sont
prêts à rompre le pacte qui les lie à l'École en profitant de
ces faiblesses pour imposer des solutions qui garantiront
mieux le respect de leurs exigences. Bien entendu, il
n'est pas question de supprimer cette École, qui peut
encore rendre des services : dans le domaine du primaire,
pour les formations de bas niveau, pour les "cas"…,
mais dès que les choses deviennent sérieuses, comme il
le fait depuis quelque temps, le néolibéralisme pousse au
développement de ses propres formations en entreprise,
par le biais d'écoles et d'universités privées, demandant
simplement à l'État d'accorder (pour la poudre aux yeux
démocratique) sa bénédiction sous forme d'une
reconnaissance "diplômée" des formations ainsi
dispensées !
Pour les défenseurs d'une institution scolaire digne des
211
ambitions humanistes qui devraient être les siennes, on
est arrivé au développement prévisible d'une tendance
évidente : le système aura toujours besoin d'une l'École,
cette École devra de plus en plus lui être inféodée, dès
qu'elle ne sera plus suffisamment fiable, on passera à
l'étape suivante : la revendication d'une double
institution scolaire : une École d'état réservée au
dégrossissement, aux basses tâches et à des formations
les moins valorisantes, puis des écoles privées,
émanations du système et fidèles aux lois du marché. La
pudeur n'est plus de mise, les enjeux économiques sont
trop importants. Quand le citron est pressé, on jette
l'écorce, disait Frédéric II, l'auteur de l'Anti-Machiavel,
en parlant de Voltaire…
Le refus (ou l'incapacité) de l'État d'assumer sa mission
républicaine et démocratique en fournissant à tous les
futurs citoyens une formation digne de ce nom provient
du fait que cet État, lui-même, se gère aujourd'hui
comme une entreprise et n'obéit plus qu'au principe de
rentabilité, tel que les économistes néolibéraux le
conçoivent, ce qui ne va pas sans poser la question du
sens de la démocratie elle-même. Sous la pression
économique, il réduit tout ce qui est service, tout ce qui
n'aboutit pas à un retour immédiat sur investissement.
Alors, bien sûr, une des causes des faiblesses de l'École
actuelle est qu'elle a un coût difficilement acceptable par
cet État libéral même si les réformes, les augmentations
d'effectif, l'accroissement de la durée des études, tout
cela se fait quasiment à budget constant en rognant ici
pour créer l'illusion là, déshabiller Paul pour habiller
Pierre, en donnant l'impression que l'esprit des
démocraties, les droits fondamentaux de l'homme sont
pris en compte : l'éternelle duplicité du politique et de
212
nos "représentants" coincés entre l'arbre et l'écorce,
une fesse (parfois) à l'Assemblée et l'autre qui se partage
les sièges de conseils d'administration les plus divers. La
démocratie représentative telle qu'elle a plus ou moins
fonctionné au siècle précédent paraît largement
dépassée !
L'institution scolaire se heurte à la fois au problème de
ses finalités et à celui des dépenses qu'elle engage,
particulièrement en période de crise, comme on veut nous
persuader l'être depuis trente ans ! Faire plus et mieux
avec quasiment moins est illusoire. Avec des classes plus
chargées, des enseignants moins nombreux et de moins
en moins formés, des horaires allégés, le défi paraît
difficile à relever. Ce qui sauve encore la mise, c'est
l'effet d'annonce. Les moyens mis en oeuvre, cela est
secondaire. La France est un pays qui cultive l'effet
d'annonce et ce n'est pas pour rien que les présidents et
leurs premiers ministres ont toujours écouté avec
beaucoup d'attention les conseils que leur donnent les
Ségala de tout acabit.
*
Faut-il donc se contenter de ce modèle immuable d'une
institution qui a toujours prétendu être au service de
l'enfant et de l'homme, mais qui, en réalité, a toujours été
instrumentalisée par les puissances dont elle dépend,
faut-il accepter des réformes qu'on nous présente comme
irréversibles et qui vont dans le sens du cannibalisme
néolibéral ou peut-on imaginer qu'un jour, la volonté
nationale et citoyenne, vraiment démocratique,
déscolarisera cette école poussiéreuse et hypocrite, la fera
sortir de ses murs, inventera un tout nouveau modèle
éducatif ?
213
Une constatation s'impose, le vieux système ne satisfait
plus personne. Les enseignants vivent mal leur condition,
les élèves traduisent leur mal-être par des comportements
violents, par un désintérêt, par l'absentéisme, la maladie.
Les chefs d'établissement sont partagés sur leur rôle Les
parents craignent que cette école publique n'offre plus ce
qu'ils attendent : des résultats, de la discipline, la fin de
leurs propres soucis en matière d'éducation, le
développement harmonieux de leur enfant.
Ceux que nous avons appelés les "donneurs d'ordre"
n'ont plus confiance dans l'esclave fidèle des cent
dernières années, dans les enseignants, dans les
apprentissages, dans les élèves et étudiants. Ils voudraient
désormais passer à la vitesse supérieure : que les écoles
suivent en tout les modèles que fournit le marché, qu'on
s'éloigne d'un service public considéré comme ingérable,
que le système éducatif appartienne entièrement à ceux
pour lesquels il est destiné : à eux-mêmes, aux "
donneurs d'ordre".
Les parents courent - quand ils le peuvent - les cours
privés se ruinent à payer les classes à bachotage pendant
les vacances, les formations privées pour rejoindre les
prépas considérées comme l'antichambre d'un monde
officiellement détesté, mais secrètement envié où tout
n'est que "calme, luxe et volupté".
Les proviseurs et autres directeurs écoutent en majorité
beaucoup les sirènes qui feraient volontiers d'eux des
"patrons": leur boîte doit être une boîte d'excellence avec
des résultats extraordinaires, des anciens qui ont réussi
les grandes écoles prestigieuses et qui forment une
association puissante, des formations qui "en jettent",
des classes prépas en veux-tu? en voilà ! des soutiens, des
groupes de pression… Ah ! Être parmi les premiers de la
214
liste palmarès publiée annuellement par Le Point ou
L'Express ou Le Nouvel Obs !
Pour les élèves, seules les notes comptent, on le sait, on
le leur a tant seriné et ils font en sorte - au mieux - de
s'en sortir en les obtenant d'une manière ou d'une autre :
des cours, la triche, la menace...
Certains enseignants continuent à rêver d'autre chose,
d'une école vraie, digne, indépendante.
Heureusement !
215
IV. Au diable l'École ?
216
217
Belle unanimité dans la réprobation donc !
Mais, si convergence des opinions, il y a entre ceux qui,
comme nous, dénoncent une institution qui n'a jamais été
qu'aux ordres des puissances qui l'ont asservie, et ces
dernières qui tirent désormais à boulets rouges sur elle
parce qu'elle ne répond plus suffisamment à leurs
exigences, cette convergence n'est qu'apparente, car nous
revendiquons un tout autre destin pour l'École que celui
auquel les "lois" du marché et les collusions du
politique voudraient la condamner, un destin que
définissent plus ou moins directement les enquêtes de
type PISA, un destin forgé par un système économique
qui ronge son frein, impatient qu'il est de profiter d'une
réputation désormais ruinée, qu'il a su programmer et
provoquer pour imposer les conditions qui lui
conviennent.
On nous reprochera de faire le jeu de ces fossoyeurs de
l'idéal scolaire en critiquant l'Institution, mais nous
répondrons qu'aucune demi-mesure n'est plus possible,
que la langue de bois est une forme de l'acceptation et
qu'il faut au contraire profiter de la situation de
déliquescence actuelle pour réclamer la naissance d'une
École qui nous appartiendra entièrement, la véritable
École républicaine qui n'a jamais été jusqu'à ce jour que
discours, masques et illusions.
Le système libéral ne pense que globalement. Dans le
fond, il tolère cette "baisse des niveaux", car ce qu'il
perd sur le plan des savoirs du futur producteur, il le
récupère de toute façon sur le dos du futur consommateur
d'autant plus taillable à merci ! Et puis, il a adopté une
218
autre stratégie, une stratégie double : le développement
d'écoles primaires et secondaires privées et surtout la
mise en coupe de l'enseignement supérieur également par
le biais d'écoles, d'institut et d'universités privés, ne
renonçant tout de même pas aux subsides de l'État !
La France compte à ce jour environ 14 000 écoles
privées, tendance en hausse. Si l'enseignement primaire
et secondaire privé connaît une progression sans
commune mesure depuis une vingtaine d'années, quelle
que soit sa situation juridique, il est encore placé sous la
férule de l'État et doit respecter un certain nombre
d'obligations ainsi que les programmes des
établissements publics. Il ne diffère qu'assez peu de ces
derniers sinon par un confort et des conditions
d'enseignement que la rétribution payée par les parents
favorise le plus souvent. En revanche, profitant de
l'affirmation de la loi selon laquelle "L'enseignement
supérieur est libre" (même si, là aussi, quelques petites
exigences font croire que l'État exerce un droit de
regard : déclaration à l'État, administrateurs et
enseignants doivent avoir un casier judiciaire vierge) on a
vite compris que le créneau "éducation",
particulièrement supérieure, était porteur et rémunérateur,
comme il l'est dans les pays dits en voie de
développement. Des groupes entiers se sont créés et
proposent leurs services aux étudiants ayant les moyens
de s'acquitter de rétributions élevées… Ce n'est pas
vraiment une nouveauté, mais l'ampleur du phénomène
doit être rapprochée de cette méfiance envers le système
scolaire d'État dont on vient de parler. A côté des écoles
de commerce déjà anciennes (ESSEC, HEC) se sont
multipliés de véritables trusts comme l'ESSCA, l' ISG,
l'ISEG... Ce dernier, dont la raison sociale est ainsi
219
exprimée sur son site : L'ISEG a été créé en 1980 par
Marc Sellam, ingénieur issu de l'ESME Sudria qui, sur
la base d'une solide expertise des univers de l'entreprise
et de l'éducation, souhaitait apporter des réponses
nouvelles à un modèle souvent trop conformiste, est
constitué de trois écoles, réparties dans plusieurs villes
l'ISEG Business School, l'ISEG Marketing &
Communication School l'ISEG Finance School (on
notera les noms racoleurs, en anglais bien sûr) qui
comptent 4500 étudiants en 2010 et 15 000 anciens ! Le
phénomène est le même pour les écoles d'ingénieurs
(ISEN, EFREI, ECE Paris, ESME Sudria, EPITA, IPSA,
ESTACA, EPF...), d'aéronautique (ELISA, ESMA,
Airways, Institut Mermoz...), d'internet (Sup'Internet et
EEMI), de création numérique (E-Artsup), de décoration
et de design (Sup Déco)... À côté desx structures
d'enseignement supérieur privé d'inspiration catholique,
(Fédération universitaire et polytechnique de Lille,
Institut catholique de Paris, Institut catholique de
Toulouse, Institut catholique d'études supérieures,
Facultés libres de l'Ouest et Institut catholique de Lyon)
des universités privées laïques se créent comme la
fameuse "fac Pasqua", qui contournent impunément la
loi du 18 mars 1880 relative à cette liberté de
l'enseignement supérieur dont ils se réclament, interdisant
aux établissements privés de prendre le titre d'université
(interdiction répétée par le Code de l'Éducation en
vigueur), par des appellations comme "faculté libre"
autorisées pour les établissements disposant de docteurs
de l'université parmi leurs professeurs, voire "Pôle
Universitaire" comme la création de Charles Pasqua !
L'enseignement privé scolarisait, en 2007, 2 167 000
220
élèves :
317 000 élèves en maternelle
565 000 dans le primaire
655 000 en collège
301 000 en lycée (filière générale et technologique)
139 000 en lycée professionnel
108 000 en établissements d'enseignement agricole
(collège et lycée)
6 000 en lycée post-bac
26 000 dans divers "Dispositifs spécifiques de
scolarisation" (handicapés etc.)
(Selon le budget 2007).
Ces écoles privées, ainsi que les formations type École
d'enseignement technique Michelin ou BTS FNAC lancé
il y a quelques années, sont les réponses que les donneurs
d'ordre ont trouvé face à un système scolaire qui ne leur
convient plus tel qu'il est. Dans ces écoles et formations,
on retrouve une ambiance "saine" : on remet les
étudiants "à niveau" en tentant de résoudre les carences
de l'enseignement traditionnel dans les matières de base,
on n'enseigne que de l'utile, le lieu n'est pas à la
discussion : on y travaille, on y apprend ce qui doit être
appris et on rêve de carrières, de salaires mirobolants, de
primes, de boni. On ne se préoccupe pas des
personnalités, on a à former les cadres du système. Ces
écoles privées, souvent consulaires, sont soutenues
financièrement par les collectivités publiques et cela au
détriment du système scolaire traditionnel : les moyens
ne sont pas extensibles à l'infini (on nous le répète assez)
et c'est à ce niveau qu'on peut particulièrement juger du
désengagement du politique (ou de son engagement). Ce
qui est octroyé à ces établissements privés est en moins
221
pour les établissements publics. Un seul exemple : fin
octobre, les largesses du Conseil Général et de la région
pour l'école de commerce de Pau ont fait la une de la
presse alors que l'université de cette ville est en déficit !
Une partie des subventions accordées à l'ESC par le
Conseil Régional d'Aquitaine en particulier aurait suffi à
ne pas laisser l'université s'enfoncer dans une situation
désespérée, situation que Jean-Jacques Nicomette
décrivait ainsi dans Sud-Ouest le 17 mai 2011 :
Tous les financements attendus de l'État ne sont pas
arrivés. Et l'étau se resserre. L'argent file et les
inquiétudes s'accroissent. Les syndicats d'étudiants
FSE et SUD ne cachent pas la crainte que leur
inspirent les difficultés financières auxquelles se
heurte l'université de Pau et des Pays de l'Adour. "
Comme le prévoit la loi, expliquent-ils, celle-ci doit
disposer d'un fonds de roulement de huit millions
d'euros. Celui-ci lui permet de faire face à tout
imprévu. Voici un peu plus d'un an, tout allait bien.
Cette somme était de 9,5 millions".
"Mais trois millions ont dû y être puisés pour éviter
les déficits. Une autre ponction de deux millions a été
opérée début 2001. Et on est très loin de la fin de
l'année. L'UPPA doit donc trouver de l'argent pour
revenir à la normale."
Principal accusé : l'État. "On attend toujours les fonds
supplémentaires promis par celui-ci en raison de
l'élargissement des compétences de l'UPPA".
Un manque d'argent qui risque d'avoir de lourdes
conséquences sur le fonctionnement de l'université. "
Chaque responsable d'unité de formation et de
recherche (UFR) doit diminuer d'environ 10 % le
volume de son activité de cette structure" assurent les
étudiants, qui siègent dans les différentes instances de
l'UPPA. Ce qui représenterait, selon eux, 3 600 heures
en lettres, 3 000 heures en sciences et 2 000 heures en
droit. Selon la FSE et Sud, ces mesures auront de
222
multiples conséquences. "En sciences, le tutorat
intersession, qui est un soutien apporté aux étudiants,
sera par exemple divisé par trois. On peut aussi
supposer que le plan de rigueur va augmenter le
nombre de personnes qui suivent les travaux dirigés et
pratiques. Sans parler du risque de fermeture d'options
estimées non rentables, comme la licence de sociologie
qui avait été envisagée pour la rentrée prochaine".
Une situation jugée d'autant plus préoccupante par la
FSE et SUD, qu'elle commence à entretenir un climat
délétère au sein de l'université. En risquant d'entraîner
une concurrence entre des UFR "où chacun cherchera
à sauver sa peau".
Jeudi, un conseil d'administration de l'UPPA permettra
de faire un point sur la situation financière de
l'Université, et d'évoquer son plan d'action
quinquennal 2011-2015. Un avenir que les étudiants
envisagent avec difficulté, et quelque amertume. "
Chaque fois que l'on réagit, on nous dit que l'on
fantasme. Pourtant, au fil des ans, on voit nos craintes
se réaliser".
Les choix politiques gouvernementaux et régionaux sont
clairs !
L'université de Bretagne sud connaît les mêmes
difficultés, d'autres établissements universitaires ne vont
guère mieux alors que le secteur privé de l'enseignement
supérieur ne s'est jamais aussi bien porté, financé qu'il
est par le denier public, les entreprises et les droits
souvent très élevés payés par les étudiants, persuadés que
c'est pour eux le seul moyen d'obtenir la bonne place,
d'avoir un salaire mirobolant et de rejoindre un jour la
cohorte des privilégiés du pays !
La France dans ce domaine de l'implantation du modèle
libéral est cependant moins "avancée" que d'autres pays
ou procède de façon moins visible : le jésuitisme a laissé
223
des traces dans l'inconscient collectif ! En Allemagne,
par exemple, l'emprise de l'entreprise est complète ; les
grandes firmes possèdent leur propre système de
formation et elles recrutent dès le niveau de la seconde.
Lidl, Aldi, ces grands discounters par exemple, forment
leur personnel sans trop se préoccuper de ce qu'a fait
l'École. Les jeunes gens recrutés deviendront aussi bien
les simples vendeurs que les cadres de l'entreprise et ils
ont la possibilité de conclure leur formation par un
mastère puisque ces formations reçoivent la bénédiction
des autorités scolaires et universitaires.
En Allemagne, la politique éducative du gouvernement
fédéral à partir des années 90 a clairement été de tenter
de mettre en place les prémices d'une réorganisation
néolibérale en matière d'éducation publique avec cette
idée centrale au libéralisme que le savoir est un produit
comme un autre, susceptible d'obéir aux lois du marché
et de la commercialisation. Le prétexte officiel (Président
Roman Herzog : "Notre système éducatif ne doit pas
devenir la lanterne rouge de la société") était la menace
d'une institution trop protégée et s'endormant loin d'un
monde où règne la compétition, une réaction contre un
manque d'agressivité orchestré par les pédagogues trop
marqués par l'héritage de mai 68 et les cultures
alternatives très en vogue dans ce pays. Les
privatisations, le resserrement des études, l'importance
des notes, apparaissaient à de très nombreux
responsables, mais aussi - grâce à une habile politique de
communication - à la société civile et particulièrement à
la classe moyenne comme la panacée… Les hommes
politiques allemands profitaient de la réunification, des
difficultés causées, de l'anti-modèle constitué par
l'ancienne RDA et de "la crise". Le gouvernement
224
social-démocrate pressait le pays dans une cure de
rigueur avec son agenda 2010. Un discours parallèle,
soutenu par des résultats assez mauvais aux enquêtes
PISA, s'appliquait tout naturellement à l'institution
scolaire, tandis qu'on fantasmait sur le tigre chinois, les
universités indiennes ou le modèle finnois. Ce qu'on
annonçait moins, c'est qu'à l'horizon de ces réformes, il
était clair que l'accès au savoir (écoles, universités,
bibliothèques, banques de données, portails internet)
serait en fin de compte contrôlé directement ou
indirectement par des multinationales et les "fondations
" qui en dépendent. Ces services seraient en outre,
comme le veut le marché, payants. Une telle évolution
suivait en gros les recommandations de l'OCDE (dont on
fait aussi grand cas en France) et de l'OMS,
recommandations qui visent d'ailleurs tous les secteurs
publics sur le plan mondial et que des think tanks comme
le Cato Institute, la Mont Pelerin Society ou le World
Economic Forum, les cercles fréquentés, inspirés par
Hayek et Friedman, ont préparé. En Allemagne, la
fondation Bertelsmann (aussi représentée en France) a,
dans ce processus, un rôle-clé. Les médias répercutant
pour leur part les "ordres de marche" !
Ces avancées libérales ont profité également des erreurs
du système scolaire fédéral, des différences entre les
Länder habilement exploitées, et de l'idée généralement
répandue en Allemagne qu'un équilibre s'établira
naturellement tôt ou tard entre le pouvoir politique et les
exigences du marché.
Or, il semble bien que le néolibéralisme, dernier avatar
du capitalisme et facteur essentiel dans la délégitimation
du politique, prépare dans le cadre de ce qu'il est
convenu d'appeler la mondialisation, les accords
225
internationaux qui rendent vain le contrôle par les lois
nationales des investissements et de la politique des
multinationales, comme l'avait prévu le Multilateral
Agreement on Investment (MAI) ou le General
Agreement on Trade in Services (Gats).
Même si, en ce moment, il semble - sans doute en raison
de la crise - que le politique reprenne de l'assurance, il
ne s'agit probablement que du chant du cygne. En
matière d'éducation, particulièrement, il est exclu que
l'on fasse marche arrière tant les forces en présence sont
inégales et tant l'idée même de commercialisation a fait
de progrès : plus qu'en France encore, le système libéral,
a jeté son dévolu principalement sur les formations
supérieures : créations d'écoles privées, d'universités
privées, liaison étroite entre l'université et le système
économique, droits d'inscriptions en forte
augmentation... Cependant, les formations intermédiaires
ne sont pas oubliées et la plupart des grandes entreprises
proposent aux jeunes un complet cursus de formation,
l'État n'étant plus là que pour entériner, cautionner les
diplômes distribués. Bien entendu, comme nous sommes
encore dans une période de transition, le système libéral
cherche à donner l'impression d'une coopération avec
l'État et exhibe (dans les médias, dans les programmes
mis en place) des gages de son "humanisme". Mais
pour combien de temps encore ? En attendant, l'État
(même si la situation fédérale de l'Allemagne rend les
faits plus difficiles à définir globalement) navigue au plus
près : réduction des dépenses en matière d'éducation (ce
qui à la fois va dans le sens de ce que réclament les
chantres du libéralisme et confirme paradoxalement leur
critique : l'enseignement d'État est incapable d'assurer
un enseignement de qualité) et intérêt porté au contrôle
226
des performances des établissements scolaires et des
universités par ces sortes d'agences de notation que sont
les TIMMS, PISA, LAU…, qui ne font en fait, par leurs
recommandations, que préparer le désengagement total
de l'État et la disparition de l'idée même d'une institution
scolaire nationale. Lorsque les résultats des premières
enquêtes PISA ont été donnés, ils ont créé en Allemagne
un véritable choc : alors que les citoyens vivaient dans la
croyance de bénéficier d'un excellent système scolaire,
on leur apprenait que c'était tout le contraire et qu'il était
temps de se rapprocher de la réalité (entendons des lois
du marché). L'école ne devait plus ronronner mais
devenir la base sur laquelle se forgerait une société
libérale et dynamique, compétitive et désireuse d'en
"vouloir" !
La discussion autour de l'école continue à être vive, mais
il sera probablement difficile de résister à un
néolibéralisme qui fait flèche de tout bois et sait
parfaitement dissimuler ses finalités derrière des
arguments qui à première vue paraissent aller de soi, ou
peuvent passer pour progressistes en première analyse :
pourquoi passer un bac après 13 années de scolarité alors
que la quasi-totalité de l'Europe ne consacre que douze
années à ces études ? Pourquoi ne pas commencer plus
tôt à fréquenter l'école ? Pourquoi ne pas généraliser
l'accueil dès un an ? Pourquoi ne pas introduire la
journée d'école complète ? Pourquoi ne pas multiplier les
universités libres ? En réalité, il convient d'économiser :
12 années reviennent à moins cher que 13 et puis, il
faudra forcément tailler dans les programmes trop vastes,
ne garder que l'utile… Derrière chaque explication
teintée de reflets "humanistes", raisonnable en
apparence se cachent les raisons du marché, le profit,
227
l'instrumentalisation des formations et des individus. Le
président de l'association des patrons, s'emporte pour sa
part et réclame, applaudi par la classe politique, moins de
savoirs et davantage de compétences! Cette classe
politique en grande partie inféodée aux lois du marché se
refuse à envisager d'autres voies et sert de courroie de
transmission à ces revendications que la presse, les
innombrables shows télévisés rendent banales, allant de
soi.
L'idée même des fameux chèque-éducation de Milton
Friedmann a été reprise (sous une forme dérivée il est
vrai, mais c'est le moyen d'expérimenter) par la ministre
du travail à propos de la réforme du Hartz-IV (RMI
allemand). Les enfants de ces familles défavorisées ont
droit à des chèques éducation qui remplacent en partie les
prestations en argent versées aux parents jusqu'alors pour
eux afin que ces enfants puissent vraiment profiter de ces
prestations sous forme de cours, de loisirs organisés…
En France, on peut se croire loin de tout cela. L'école
républicaine ne paraît pas aussi menacée. Cependant, ce
"retard" français ne doit pas faire illusion et nous avons
rappelé plus haut la part que se taille actuellement le
privé. La restructuration néolibérale du système éducatif
a pris son essor : les coûts sont tenus au plus bas quand
ils ne régressent pas (et la "crise" permet de faire passer
à peu près tout) ; l'inégalité devant le savoir n'a pas
diminué malgré l'illusoire démocratisation des peaux
d'âne ; enfin, on a su fasciner la classe moyenne en
semblant aller dans son sens en dénonçant la faiblesse
des niveaux tout en lui faisant croire que ses enfants, en
fréquentant les grandes écoles, les instituts privés
228
arriveront au sommet de la société : réputation, argent…
Sous la pression d'une polarisation sociale de plus en
plus menaçante en ces temps de globalisation, les classes
moyennes cherchent à échapper à la spirale de la
dégradation salariale et à permettre à leurs enfants - à
quelque prix que ce soit - d'accéder au niveau des nantis,
ce qui repousse aux calendes grecques, une fois de plus,
toute espoir de justice d'égalité des chances. C'est sur de
telles situations que les "donneurs d'ordre" désormais
s'appuient dans le monde entier. En Inde, une famille
sacrifiera tous ses membres pour collecter suffisamment
d'argent nécessaire aux études de l'un d'eux dans une
université privée prestigieuse. À charge de revanche
quand il aura réussi ! Le phénomène est semblable au
pays de Confucius et de Mao où les parents se saignent à
blanc pour la réussite, sociale et financière, de leur
enfant.
*
Pour l'ordre cannibale libéral (Jean Ziegler), il est clair
que l'École est un enjeu important : lieu de formation, il
faut le contrôler, lieu de profits, il faut encore mieux
l'assujettir aux lois du marché. La stratégie qui s'est mise
en place au cours de trente ou quarante dernières années
est simple. La première phase consiste dans la
diffamation des systèmes scolaires d'État (et c'est une
des raisons pour lesquelles les critiques "républicaines"
portées contre l'école doivent toujours mettre en
perspective le projet libéral pour s'en distinguer), une
phase allant de soi dans la mesure où le politique, s'il
affirme publiquement son importance, fait en sorte que la
mission qui devrait être celle de l'École ne puisse se
229
réaliser correctement. Il est alors facile d'emboucher la
trompette de la contestation avec la foule des familles,
avec l'opinion publique habilement travaillée, facile à
convaincre de cette dégradation de l'École : "Non !
Vraiment, une telle école ne remplit plus sa mission ! Nos
enfants ne savent plus rien ! La pagaille !". À tous ceux
qui réclament alors un autre engagement de l'État, plus
de moyens, de meilleures conditions voire une autre
école, exigences naturellement onéreuses ou dangereuses,
les donneurs d'ordre opposent un système qui ne coûte en
apparence rien à la communauté, dont les maîtres mots
ont été forgés par Milton Friedmann et consorts dans les
années cinquante : le libre choix de l'établissement
scolaire, l'ouverture de l'école à la compétition et les
chèques éducation, le reste allant de soi. Le facteur
essentiel du développement d'une institution scolaire qui
irait dans le bon sens, c'est-à-dire dans les perspectives
du marché, le nerf de la guerre, serait l'émulation,
comprise comme un nouveau "struggle for life" : jouer
les écoles contre les écoles dans les recrutements comme
dans l'acquisition de moyens financiers, récompenser les
enseignants considérés comme méritants et sévir auprès
de ceux qui ne satisfont pas. Si les clients d'une
entreprise s'en détournent, si les financeurs font la sourde
oreille, il n'y a que deux solutions : la fermeture ou un
sursaut salutaire allant dans le sens des lois du marché et
de la compétition. Pour un établissement scolaire, il
devrait en être de même : sa réputation ferait sa "
clientèle" et déciderait de son avenir, des ressources dont
il disposerait. Ceci implique une démarche managériale
des chefs d'établissement : s'arranger pour avoir une offre
excellente (statistiques des résultats, budgets
excédentaires…), se faire connaître, en un mot, savoir se
230
vendre. L'excellence, de ce type, implique elle-même le
recrutement ou le renvoi d'enseignants susceptibles
d'avoir une influence sur l'image que l'on veut propager
(titres, capacités mises en avant, moralité…), donc, un
contrôle sévère de ces derniers en fonction de critères qui
ne sont pas nécessairement en accord avec la déontologie
de la profession, et une diversité des salaires versés, tout
comme elle implique une sélection au niveau des élèves
(officiellement au nom du nombre de places possibles)
qui se présentent. Ce système existe déjà dans les "
bonnes" écoles australiennes. En Nouvelle-Galles-du-
Sud par exemple, pour être enseignant, il faut être
titulaire d'une "licence" qui fait de vous certes un
fonctionnaire, mais qui ne vous garantit pas l'emploi :
muni de cette licence délivrée par l'État à la suite des
études, chaque professeur peut proposer sa candidature
aux établissements scolaires et il sera retenu pour un laps
de temps plus ou moins long afin d'y développer un
projet qu'il aura su défendre devant une commission et
qui aura convaincu.
Une véritable compétition entre établissements exige en
outre une certaine transparence : coûts, dépenses,
recrutements, un panel d'offres assez diverses et une
autonomie en matière de pédagogie et de finalités,
chaque établissement proposant à la limite un autre projet
ou concept pédagogique avec à l'horizon la possibilité de
demander aux familles des contributions supplémentaires
exceptionnelles ou régulières, dans la mesure ou l'offre et
les résultats attendus dépassent les possibilités de
financement des "chèques éducation" !
Le risque (la conséquence !) d'un tel système est bien
entendu la ségrégation sociale et la hiérarchie des
231
établissements. Enfin, comment concilier l'obligation
scolaire et ce modèle marqué par les prétendues lois du
marché telles que les néolibéraux les formulent ? Si un
établissement voit son recrutement diminuer à cause de
sa mauvaise image de marque, il devra fermer, comme un
supermarché ferme quand il n'a plus de clients. Or, si le
nombre d'établissements diminue, si certains se sentent
autorisés à exiger des parents des droits d'écolage
toujours plus élevés, comment scolariser tous les enfants
puisque beaucoup d'établissements disparaîtront ? Une
seule solution : reconstituer ou préserver une école
parallèle, "à l'ancienne", dirigée directement par l'État
et réservée aux jeunes n'ayant pas trouvé de place dans le
"bon" système, ceux dont personne ne veut…
L'avantage est double : chacun est à sa place et on peut
continuer à faire croire à l'existence d'une école
républicaine ! Ceci débouche naturellement sur la
revendication de la suppression de la carte scolaire, et sur
celle du libre choix de l'école, un choix qui trouve son
pendant, sa réciproque dans l'acceptation ou le refus des
candidatures par l'école !
Les "chèques éducation" évoqués plus haut participent
de cette stratégie. Le budget réservé à l'éducation
publique n'est plus entièrement versé aux établissements
par l'intermédiaire du ministère par exemple ou de
l'administration scolaire. L'État choisit de passer par
l'élève. Un "chèque éducation" est établi au nom de
celui qui doit en bénéficier (l'élève, l'étudiant…) ou de
ses tuteurs (parents…). Le montant du chèque est fixé par
l'État et est le même pour tous, quelle que soit la
situation familiale. Avec ce chèque, le jeune pose sa
candidature pour telle ou telle école, reconnue par l'État,
correspondant à ce qu'il désire. L'établissement
232
échangera ce chèque auprès des caisses de l'État pour
subvenir à tous ses coûts (personnel, locaux…) dans le
cadre de l'autonomie de son administration. L'idée -
formulée dès les années cinquante par Milton Friedmann
- était de parvenir à un effort mesuré de l'État en matière
d'éducation et de formation, plus efficace
économiquement tout en respectant le droit à l'éducation
inséparable des démocraties modernes.
Ce ne sont pas là des spéculations. Aux États-Unis,
plusieurs expériences ont été menées avec ces chèques
éducation dans le but officiel de voir s'ils pouvaient
permettre à certains enfants de milieu défavorisé de
fréquenter de meilleures écoles que celles auxquelles ils
étaient destinés. À New York, par exemple, ces bons
devaient faciliter le recours à des cours de rattrapage
et/ou offrir la possibilité de suivre des formations dans un
collège privé. Il y eut d'abord plus de candidats que de
chèques ce qui impliqua un tirage au sort et de devoir
s'en tenir à un enfant par famille, les frères et soeurs
servant de groupe de contrôle ! Au bout de quatre années,
l'examen des résultats (comparaison des groupes) a
montré qu'il n'y avait aucune différence dans la
population blanche ou asiatique et de très légères chez les
noirs sur le seul plan des compétences en matière de
lecture. Les résultats ont été aussi décevants en d'autres
endroits. On aurait pu s'y attendre puisque la plus grande
expérimentation a eu lieu au Chili, avec la prise de
pouvoir de Pinochet. Les chèques y ont été introduits en
1981 de manière très large et ont favorisé la naissance de
plus de 1000 écoles privées, mais une étude de 2005
montrait une influence négative sur les apprentissages et
les résultats, en revanche une ségrégation
particulièrement prégnante des populations d'élèves. Ceci
233
ayant été constaté dès les années 1990, les responsables
avaient dû faire marche arrière devant le gâchis qu'ils
avaient créé, mais le travail destructif commis a laissé des
traces indélébiles malgré les changements politiques. On
peut encore citer les mêmes échecs en Afrique du Sud, en
Argentine, à Hong Kong, au Mexique, en Nouvelle-
Zélande où le "cool Choice", l'autonomie des
établissements devaient améliorer la qualité de
l'institution scolaire en milieu urbain et où, au contraire,
les écarts ethniques se sont accentués…
*
Le modèle néolibéral d'une institution scolaire gérée
selon les principes de ce que l'on appelle les lois du
marché est majoritairement négatif dans ses résultats. Ses
conséquences sont la ségrégation, la baisse des niveaux
globaux et des écoles d'État (quand elles existent encore)
réduites à gérer ce que ce système rejette, avec une
pénurie de moyens et n'obtenant bien évidemment que
des résultats faibles !
En France, nous n'en sommes peut-être pas encore là,
mais l'observateur attentif peut remarquer que des "
avancées" se font (à couvert) dans le sens des exigences
du libéralisme au moins depuis l'ère Mitterrand et la mise
en avant des chevaliers d'industrie modernes comme
Bernard Tapie qui sera même ministre d'un
gouvernement socialiste sans que cela étonne : la
revalorisation de la position et de la carrière des chefs
d'établissement qui deviennent des managers auxquels on
pourra verser de modestes "surprimes" mais surprimes
tout de même, des chefs d'établissement qui bientôt
234
noteront leurs enseignants en toute indépendance, l'idée
d'une d'ENA qui leur serait réservée, la plus grande
autonomie des établissements, la place de la société civile
dans les conseils d'administration, la progression au
mérite des carrières, les primes versées, la suppression
progressive de la carte scolaire, l'accent mis sur les
enseignements de base et la possibilité de voir les
matières dites secondaires passer au rang d'options (nous
ne sommes pas éloignés des chèques éducation), les
projets d'aménagement du temps scolaire hors
enseignement avec des ateliers, des activités que le jeune
pourra choisir plus ou moins librement, ateliers dirigés
par des "moniteurs" n'appartenant pas à l'éducation
nationale, rétribués par les établissements…
Mais dans notre pays, répétons-le, les avancées dans le
sens du marché se font prudemment, de manière voilée
pour ne pas effrayer l'opinion. La ségrégation elle-même
a toujours indirectement été suscitée par le système et ses
acteurs, parfois naïvement. Il y a peu d'années encore, je
participais aux jurys de choix des candidats à une place
dans plusieurs BTS de l'Est de la France. Environ 120
dossiers pour 24 places. Les professeurs importants
(enseignant les matières techniques essentielles)
écartaient les dossiers de candidats ayant un nom
étranger, plus exactement à consonance arabe. Après les
protestations rituelles de non-racisme, ils avançaient les
raisons les plus diverses et les plus extravagantes : les
jeunes Maghrébins peuvent être bons en théorie, mais dès
qu'il s'agit de pratique, on ne peut leur faire confiance
(ah ! le "travail arabe" !) ; ils sont trop brouillons pour
une spécialité qui réclame de l'exactitude ; il sera
impossible de leur trouver un stage : "Les entreprises
n'en veulent pas" et quand on réussit à leur en trouver
235
un "on n'a toujours des histoires. Rappelez-vous les
ennuis qu'on a eus avec Mohamed X… !".
Pour faire plaisir au prof de français qui proteste et
montrer sa bonne volonté républicaine, on acceptait tout
de même parfois d'en prendre un ou deux. Mais leurs
dossiers étaient alors exceptionnels et il s'agissait en
général de candidates : "Les jeunes Maghrébines, c'est
pas tout à fait la même chose !"
Coûts de la scolarité en France et en Allemagne
(2007) - intéressant dans l'optique des "chèques
éducation" (en Euro : Sources Ministères de l'EN)
France Allemagne
Préélémentaire 4970
Élémentaire 5440 3362
Collège 7930 4600(Haupt+ Realschule)
Lycée gén./techn. 10420 5132
Notons qu'en Allemagne, malgré des salaires des enseignants
beaucoup plus élevés, ces dépenses sont de loin inférieures à ce
qu'elles sont en France. Il faut dire que l'enseignement
préélémentaire est en phase de gestation et que la participation
parentale est de règle, que le primaire ne dure que 4 années, que la
Hauptschule prend fin après neuf années de scolarité (une dixième
est prévue) et la Realschule se termine à la fin de la dixième année
de scolarité ! L'enseignement professionnel est en grande partie
géré par les chambres économiques et les entreprises et il n'y a pas
de classes prépa. Pas d'infirmerie avec son personnel, pas de CDI
au sens où on l'entend en France, de rares cantines, pas de
surveillants (rôle attribué aux professeurs), pas d'employés, hormis
le concierge (qui souvent se partage deux établissements). Les
travaux sont effectués par des équipes tournantes (appartenant à la
ville) ou par des firmes privées recrutées par la commune.
*
236
Cet essai refuse totalement un système scolaire en
adéquation parfaite avec les prétendues lois du marché et
qui ne viserait qu'à établir une société inégalitaire et
inhumaine, entièrement réifiée avec pour seule finalité le
profit matériel poussé à l'infini, la rentabilité comme
moyen et finalité. Il plaide au contraire pour une véritable
école citoyenne, un service public au bénéfice de futurs
citoyens responsables, épanouis et sans hésiter à le dire,
plus heureux qu'actuellement. Le libéralisme rêve (s'il
rêve jamais !) au contraire d'établissements privés en
compétition constante, aux ordres exclusifs de la
demande des marchés et préparant à la lutte économique,
abandonnant au service public les fractions de la
population qu'il refuse de prendre en compte ou dont
l'absence de qualification lui est encore nécessaire.
Pour remplir la mission qui devrait être la sienne, le
secteur public doit cependant évoluer, ne plus être
l'apanage de "spécialistes", de professionnels, de
fonctionnaires visant d'abord une "carrière" à leur
avantage. Un véritable service public fait partie, est
constitutif de l'identité républicaine, de la res publica. Il
nous concerne tous et n'a pas à être cette forteresse tenue
par ces "fonctionnaires" qui font trop souvent passer
l'esprit de corps avant le zèle qu'on attendrait d'eux, qui
songent d'abord à leur situation avant d'être au service de
leurs concitoyens. On a vu à une certaine époque quelles
dérives menaçaient un tel service public coincé entre la
crainte de perdre quelques minces privilèges et les
exigences de "l'État français" ! Affaire de tous, un
service public d'éducation ne devrait plus, pour de
fausses raisons d'efficacité, n'être incarné que par
quelques-uns, uniquement par des "professionnels"
237
quand le concept même d'éducation dépasse largement le
cadre d'une profession et que la transmission des savoirs
doit utiliser tous les vecteurs possibles. C'est à chaque
citoyen d'y contribuer dans la mesure de ses capacités au
sein d'une société réorganisée qui saura faire passer au
second plan les impératifs de productivité, de profit,
d'accumulation des biens, le mythe du travail, celui de la
réussite sociale basée sur la situation… Tout le monde
aura quelque chose d'important à apporter à l'édifice
commun.
Le terme "service" retrouverait son sens, la profession
d'enseignant sa déontologie et sa justification : un
professeur libre dans une école indépendante de tous les
pouvoirs, mais au service de tous.
On peut imaginer, auprès de pédagogues particulièrement
formés, la foule des citoyens qui consacrerait,
périodiquement, une partie de son temps à l'éducation, à
la formation humaine puis professionnelle des
générations montantes. Un service social allant de soi !
Enfin et surtout : que la proscription du principe de
rentabilité dans l'École !
La transformation intégrale de l'institution scolaire est
urgente pour au moins deux raisons principales.
D'abord parce qu'il faut prendre en considération
l'évolution générale de la société - une évolution amenée
et imposée par la main de fer des marchés - avec une
moindre importance accordée dans tous les milieux à
l'étude et aux disciplines intellectuelles pour elles-mêmes
puisque la tendance est à l'utile, à ce qui est
immédiatement monnayable, avec une déstructuration de
couches sociales entières frappées par le chômage, la
précarité et l'incertitude des lendemains, avec
238
l'implantation rendue artificiellement difficile de
populations immigrées, avec un consumérisme qui
s'érige en valeur suprême et un individualisme
grandissant qui frise parfois à l'autisme (la classe
politique étant elle-même - mais à un autre niveau -
selon le mot de Peter Sloterdijk un "club d'autistes"
(Davos, le G20, le G8…) -, chaque individu vivant
désormais, si le mouvement se poursuit, dans sa coquille,
en autarcie intellectuelle, avec son portable, son I-Pod, sa
musique, ses films… Au lien social traditionnel se
substituent les grands rassemblements épisodiques
(apéro-géants, défilés type homo pride, festivals…), les
face-book et autres plateformes sociales qui donnent
l'illusion d'être au centre du monde, écouté par des
centaines d' "amis", en un mot : la télécommunication
remplaçant la communication, l'isolement dans la foule
palliant illusoirement la solitude pure et simple.
Une vie réduite à l'instant, au moment vécu, sans rapport
désormais avec un passé inconnu et qui ne signifie plus
rien ou qui ne survit que par l'image dévaluée qu'en
donnent les médias, le cinéma, les jeux vidéo, et un
avenir qui est le "no future", l'ancienne objurgation des
Punks, un avenir qui ne peut être que noir et qu'on se
refuse à envisager. Un "carpe diem" en quelque sorte,
mais un carpe diem sombre, imposé, auquel Horace
n'avait certainement pas pensé.
Ensuite, parce que l'histoire nous l'a montré : telle
qu'elle a toujours existé, cette institution n'a jamais été
que la voix de ses maîtres et, aujourd'hui, où, malgré
tout, les individus parviennent à un certain degré de
savoirs (le plus souvent indépendants de l'école) et qu'ils
revendiquent davantage ces droits individuels qu'on leur
fait miroiter pour des raisons mercantiles, elle est
239
entièrement obsolète avec son fonctionnement et des
finalités datant d'un autre temps. Son organisation est
restée globalement ce qu'elle était en dépit des évolutions
sociales, technologiques et d'une massification de
l'enseignement, certes, souhaitable mais géré dans le
cadre étroit des pensées, des méthodes et des moyens
d'hier.
Inutile de se retourner vers les vertus de l'école ancienne,
si tant est qu'elles aient eu un semblant de réalité à
certaines époques où la misère absolue de la majorité
pouvait faire passer un moindre mal pour un bien et que
Victor Hugo écrivait cette phrase ambiguë et riche de
prolongements : "Ouvrez des écoles et vous fermerez
des prisons". N'était-ce pas reconnaître que cette école,
même pour les poètes établis, était la garante de l'ordre
bourgeois et capitaliste qui se mettait en place ? Héritière
sous sa forme moderne de son ancêtre du XIXe siècle qui
avait pour but principal la reproduction des rapports de
domination et de richesse comme l'ont montré par
exemple Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron,
l'institution scolaire actuelle a conservé son organisation
hiérarchique, autoritaire, coercitive et antidémocratique
que tous les make-up modernes, la phraséologie ne
dissimulent pas (conseils de classe, délégués élèves,
conseils d'établissement, consultations en tous genres…),
elle est un univers de contraintes (les horaires, les
devoirs, les emplois du temps, la classe, les notes,
l'enseignement frontal, l'obligation de rester assis des
heures, tuant le temps en copiant ou recopiant la parole
du "maître", en dessinant, en bavardant à mi-voix, en
s'enfuyant par le rêve…), un univers de contraintes où
l'argument d'autorité écrase toute parole vraie. Elle
transmet des contenus et des comportements
240
capitalistophiles (apparente méritocratie, éloge constant
du "travail", de la performance, des résultats,
enseignements et programmes allant dans ce sens et dans
celui de la consommation, du "toujours plus"). Elle est
le microcosme de notre société, le creuset où cette société
se forge : elle obéit en tout à la dictature du capital.
À ces raisons qui se suffisent, on pourrait en ajouter
d'autres comme le malaise actuel, dont le burn-out des
enseignants ou la violence scolaire ne sont que des
épiphénomènes, malaise qui ne se résoudra ni avec des
doses de réformisme ou de pédagogisme, de didactisme
plus ou moins importantes ni avec un retour des
méthodes autoritaires.
L'école est tout simplement dépassée. C'est tout le
système qui est à repenser : les programmes, leur
émiettement, l'organisation des établissements, la
responsabilité des différents acteurs, l'adéquation avec
les exigences de l'industrie, de la productivité moderne et
du capitalisme libéral, avec pour conséquence immédiate
le déclin des valeurs intellectuelles, l'oubli des impératifs
humanistes, le désir de ne plus former que des pions
"utiles". On taille et on retaille les programmes pour ne
conserver que cet "utile", ce qui sera, pense-t-on,
susceptible de servir au futur citoyen-consommateurproducteur,
dont on espère une intégration la plus rapide
(et la plus longue) possible au monde "réel" de cette
production-consommation…
À cela s'ajoute le fait que l'enfant, l'adolescent ne sont
plus les mêmes qu'il y a vingt ou trente ans : nous vivons
dans un contexte nouveau qui voit la fin des anciennes
structures sociales, familiales, des repères traditionnels.
L'enfance est de plus en plus courte (on demande même
241
au gamin de 10 ans (voire moins) de développer des
"projets de vie" !) et les médias, par le fatras incontrôlé
des informations véhiculées y concourent fortement.
Certains croient pouvoir dire qu'il s'agit là de
conséquences inéluctables de la marche du temps,
pourtant on peut en douter si l'on croit au libre arbitre de
l'être humain, que l'on refuse de voir dans l'humanité une
immense fourmilière tout en rêvant d'une nouvelle
mission pour l'École.
Le développement actuel de l'humanité n'est qu'un
modèle de développement, la conséquence d'une
idéologie. On peut en imaginer d'autres. Il y a trente ans,
qui aurait pensé la fin des communismes d'état ?
En outre, l'institution scolaire refuse de prendre
sérieusement en compte les évidences catastrophiques de
l'exploitation irréfléchie de la planète : les ressources
énergétiques et matérielles, la saturation de
l'environnement ! On est resté très positivistes dans
l'éducation nationale : le "progrès" technique y est
toujours présenté comme illimité, les atteintes à
l'environnement secondaires ou causées par trop peu de
technologie et quand on emmène les élèves visiter une
centrale atomique, c'est en rang par deux, pour des
raisons de sécurité, mais aussi parce que le but de telles
visites est d'abord de montrer le génie scientifique du
pays, d'étonner ces jeunes face au dieu-progrès, quitte à
concéder une rencontre avec un "responsable" qui saura
éventuellement rassurer et mettre les rieurs de son côté si
des questions trop critiques sont posées.
C'est d'ailleurs un cas général : l'éducation nationale, à
l'exemple de ses représentants "en mission", courbe le
dos lorsqu'elle est confrontée au monde extérieur, à la
"réalité" ! Une sorte de complexe d'infériorité qui fait
242
que le prof en contact avec une entreprise, une banque,
une usine quelconque se montre excessivement
respectueux et réclame de ses élèves (visiteurs ou
stagiaires) la plus grande déférence face aux
professionnels rencontrés dans ces lieux où se fera leur
avenir.
Il m'est arrivé en compagnie de collègues de rendre visite
à nos stagiaires BTS chez Peugeot ou ailleurs. Plus
l'entreprise était grande, moins il convenait de faire état
des critiques des étudiants : "On ne s'occupe pas de
nous", "Je passe mon temps à rentrer les voitures sur le
parking ; c'est pas mal dans un sens, mais ça rime à
quoi ?" "Mon maître de stage m'a mis à classer des
documents et cela n'a rien à voir avec ce que
j'attends"… Pas folle l'équipe des profs : on ne va pas
écouter les gamins, sinon, l'an prochain "ils" ne nous
proposeront plus de stage et on aura l'air fin ! Le
pédagogue se sent mal à l'aise face à l'ingénieur qui le
reçoit, l'ingénieur avec toute la mythologie qui l'entoure,
son air assuré, son dynamisme apparent. Lui, le prof, il a
un peu honte de ses vacances, de sa qualité de
fonctionnaire, de ses horaires étriqués, de son petit
traitement. Si la conversation évoque tout cela, il sort le
moulin à paroles de ses jérémiades habituelles : ses
corrections, ses heures de préparations, les classes
surchargées… Il croit devoir se justifier et en rajoute
pour montrer que lui aussi travaille énormément ! Les
ingénieurs et contremaîtres qu'il rencontre le raillent en
effet un peu : trois mois de vacances ! La gabegie dans
les écoles ! Le petit niveau des élèves ! Le prof s'excuse
avec un sourire contraint. Que peut-il dire d'autre ? Eux
perçoivent de gros salaires, pas lui ! Eux ont une situation
enviée, ils vivent la vraie vie, la science, le modernisme,
243
pas lui !...
Alors, en classe, il fait du zèle, il veut donner aux élèves
le goût du travail. On ne parle que de travail à l'école !
Comme dans la "vraie" vie !
Travailler toujours plus pour produire plus et consommer
davantage alors que les ressources planétaires au sens
large sont mesurées ! Les 35 heures du projet socialiste
étaient une plaisanterie allant dans le sens des réformettes
avec lesquelles on endort les populations ! Pourquoi 35
heures (on pourrait parodier le "Français, encore un
effort pour devenir républicains" de Sade !) alors que
des études récentes montrent que travailler quelques
heures quotidiennement serait suffisant pour conserver un
niveau de vie comparable à celui des années 80-90 et
l'assurer dans un avenir plus ou moins proche à la totalité
de la population mondiale !
Cela suffirait pour protéger raisonnablement
l'environnement et laisser aux générations à venir une
base de vie acceptable ! En 1977, le collectif Adret
publiait un livre ayant eu alors un retentissement certain :
Travailler deux heures par jour. Ce livre (rarement
réédité) a été un best-seller et démontrait avec rigueur
l'absurdité des conditions de travail et de sa
sacralisation : 80% de l'énergie était parfaitement
"improductive" ! Je me souviens de l'intérêt qu'y
avaient pris mes étudiants de BTS Bureau d'études et
Photonique…
Malheureusement, comme trop souvent, les meilleures
lectures, les meilleures idées ne servent que d'exutoire,
car il y a toujours loin de la coupe aux lèvres. Pourtant,
c'est peut-être là que l'école aurait tout son rôle à jouer !
244
Travailler deux heures par jour a eu une "suite" lors des
mouvements sociaux de 1995, sous le titre Résister (Minuit) : les
témoignages de ceux qui, refusant les aspects inégalitaires et
inhumains de la société, proposaient des solutions alternatives.
Actuellement, le collectif s'est reconstitué face à la question du
changement climatique et a sorti en 2007 Le changement
climatique: aubaine ou désastre ? (Cerf).
Le même espoir relie ces trois ouvrages écrits le temps d'une vie
d'adulte : celle du refus de l'ubac et le choix du versant ensoleillé
des montagnes ; continuer à croire qu'on peut s'opposer à tout ce
qu'on nous propose comme "fatalité" alors que derrière les
événements, il n'y a pas de fatum mais bel et bien des hommes !
Prendre notre destin en main en faisant passer l'individu avant les
marchés !
*
La remise en question radicale d'une institution qui a
abandonné toute autonomie pour se mettre totalement au
service des dérives socio-économiques actuelles est bien
la seule réponse possible : pas de replâtrage, mais une
déconstruction totale d'un modèle dépassé dans les pays
dits riches et la refondation d'une nouvelle école
indépendante dans un contexte nouveau partout dans le
monde. L'institution scolaire a toujours été le lieu de la
formation des futurs rouages du système politique ou/et
économique (pour ne pas revenir trop en arrière : les
rouages de la société capitaliste et de son dernier avatar le
libéralisme actuel), le creuset où se forgent avec
raffinement les chaînes voulues par les États. Il ne peut
donc pas avoir de réforme possible. Il ne peut y avoir de
véritable transformation de cette institution, sans
séparation totale d'avec tous les systèmes qui l'inféodent
et élaboration d'une éducation libre de toute intention.
C'est pourquoi la première revendication doit être celle
245
d'un service public indépendant. Une démocratie digne
de ce nom devrait s'appuyer sur 4 pouvoirs : l'exécutif, le
législatif, la justice et l'École. C'est-à-dire que
l'éducation obligatoire et gratuite devrait ne dépendre
que des acteurs qui la composent : les enfants, les
enseignants, les parents. Tous les trois devraient y être
impliqués avec la même importance. Nous l'avons
évoqué au début de cet essai : l'école doit à la fois aider
les personnalités à se "faire", éduquer et instruire. Les
pédagogues, s'ils demeurent indispensables, ne peuvent
continuer ni à assumer toutes les tâches ni rester
enfermés dans leur tour d'ivoire. L'École nouvelle devra
être une entreprise réclamant l'implication et la
collaboration de tous sans être inféodée au politique ou à
l'économie.
Qu'elle soit composée d'une école primaire ou
fondamentale pour l'apprentissage des bases et le
développement des personnalités de chaque enfant par un
apprentissage libre comme l'ont suggéré les pédagogues
depuis Rabelais et Montaigne jusqu'à Freinet en passant
par Rousseau qui - s'il n'imaginait pas de système
scolaire de masse - réclamait que l'enfant, dans les
étapes de son développement successives, soit la seule
mesure de tout enseignement ou découverte guidée par
des professeurs (pas des "maîtres") sensibles et
modestes sachant respecter l'enfant (il n'y a pas de
meilleur principe), qu'elle prenne d'autres formes,
définisse une seconde école destinée aux plus grands et
davantage ouverte aux activités futures du jeune adulte
ou permette aux citoyens, leur vie durant de se former, de
changer d'activité, sera à définir par l'ensemble de la
population.
246
Il n'est pas en effet du propos de ce livre de faire des
propositions. Comme le disait récemment Jean Ziegler à
qui une journaliste demandait quelles seraient les
remèdes qu'il faudrait appliquer à ce monde malade qu'il
tance d'importance dans son dernier livre : "L'essentiel
est de changer la conscience générale, les pratiques
suivront".
J'ajouterai que dans les pages qui précèdent j'ai essayé
de montrer que la source de tous les maux (pas seulement
de l'École) est l'absence d'indépendance de l'institution
et l'incapacité des dirigeants politiques d'avoir des
conduites vraiment démocratiques. En outre, à toutes les
époques, on a trop attendu l'homme ou la femme
exceptionnelle, providentiel, le Sauveur alors que ces
sauveurs se sont révélés être le plus souvent des Führer
désastreux pour la majorité ! Il faut toujours se méfier de
celui qui pousse à sortir de la caverne.
Il serait paradoxal que je pense pouvoir - après avoir
pointé du doigt ce que je crois être les errances de
l'institution scolaire - moi seul, donner des solutions,
élaborer un plan d'éducation qu'il revient à la société
civile dans son ensemble de développer. Il est toujours
mauvais d'imaginer qu'on puisse concevoir, en matière
de société, abstraitement, seul, un système valable,
démocratique et républicain au vrai sens du mot. C'est
d'ailleurs pourquoi Rousseau refusait de considérer son
Émile comme un ouvrage pédagogique voire un recueil
de propositions visant au renouvellement des études.
L'École nouvelle doit naître de la société civile, pas de
ses représentants, pas de technocrates ou d'impulsions
particulières, de mouvements d'humeur forcément
subjectifs.
Cessons seulement de penser qu'on a à faire à des enfants
247
qui n'ont pas droit au chapitre, à des parents qui se
déchargent de leurs responsabilités, à des pédagogues qui
ont LE savoir. Les jeunes, même les plus jeunes ont leur
mot à dire, leur parole vaut autant que celle des autres
partenaires. Les parents ont cette chance d'avoir vécu
l'école et d'être essentiels dans l'éducation de leurs
enfants qu'ils connaissent autrement que les enseignants.
Enfin, en matière de pédagogie, il n'y a pas de
professionnels : le meilleur professeur que j'ai eu était un
monsieur qui ne préparait jamais ses cours, venait quand
il avait le temps, ne donnait jamais de devoirs, mais
savait intéresser et ne nous considérait pas comme des
enfants… Pensons donc qu'on a à faire à une
communauté qui doit agir ensemble, et concevoir
ensemble une institution qui sera toujours en devenir
parce que le monde évoluera.
L'École n'a pas à s'ouvrir sur la vie parce qu'elle est la
vie, mais elle doit se trouver dans la Cité et non à sa
périphérie et appliquer le principe renouvelé de la
coéducation en mettant sur le même plan les parents, les
enseignants et les enfants, puis les jeunes...
Le rôle de l'École véritable est la transmission de savoirs
fondamentaux, le développement des capacités
intellectuelles des enfants et des jeunes, l'épanouissement
sur les plans sociaux et personnels des individus : ceci
justifie la revendication d'une institution scolaire en
totale rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à nos jours.
C'est un impératif moral : une école qui ne prépare plus à
une société des profits et des inégalités voulues par telle
idéologie ou par tel système économique, une école qui
aide des individus à se définir et à se former, à devenir
autonomes ; des citoyens qui décideront des orientations
que prendra la société dans laquelle ils vivent, des
248
citoyens qui sauront que la planète doit être autrement
gérée que comme un tas de richesses à exploiter sans
précaution.
D'autres structures devront être prévues qui permettront
l'intégration des adolescents dans la cité puisqu'ils leur
faudra un jour travailler (ce qu'il faut, sans plus),
consommer (ce qu'il faut, sans plus), avoir des loisirs,
mais leur formation devrait leur permettre de ne plus
accepter n'importe quoi comme activité parce que seul le
salaire compte, de ne plus y voir la finalité d'une vie, de
ne plus consommer avec une boulimie insensée et de
remplir leur temps libre d'activités sensées et
enrichissantes (il n'est pas inutile de rappeler que le mot
"école" vient du latin schola issu du grec σχολή, mot qui
désignait l' "arrêt de travail", ou bien un "loisir
consacré à l'étude" !)
*
Si l'utopie d'un projet bien ficelé nous est interdite pour
les raisons avancées plus haut, quelques pistes de
réflexion termineront cet essai.
On parle sans cesse d'égalité en France, peut-être parce
que la parole nous paraît être un substitut suffisant à ce
qu'on n'a pas, mais, pour que tous les enfants aient des
chances équivalentes, quelles que soient leurs origines et
qu'ils accèdent tous au savoir, à la culture (qu'il
conviendrait de redéfinir) et au développement de leurs
potentialités, la première revendication est de ne rien
céder sur des programmes solides qui mettent en avant la
réalisation de l'individu dans ses liens avec le passé, le
présent et le futur. Il ne faut rien céder non plus sur les
niveaux d'exigence et cesser de payer les efforts des
249
enfants avec de la monnaie de singe. Cela signifie des
maîtres nombreux et bien formés, des heures d'études
bien organisées ouvertes aux enfants et aux parents qui
souhaitent accompagner leurs enfants dans leurs
découvertes, car il ne peut y avoir de véritable
refondation de l'école dans une participation active de
ces trois acteurs.
L'école n'a pas à singer les dernières évolutions de la
société, les derniers développements de la science. Son
rôle doit s'en tenir à la transmission des acquis les plus
fondamentaux et d'un patrimoine culturel nécessaire au
lien social et seule base solide à des évolutions
ultérieures. Sans mémoire, une société n'est rien et ne
peut - au mieux - que tourner en rond. Les acquis
nouveaux seront intégrés progressivement, après mûre
réflexion.
Le principe d'égalité, excellent en soi, ne doit cependant
pas devenir un frein, une censure interdisant la
diversification. Il ne faudrait plus contraindre tous les
enfants du même âge à avoir les mêmes activités. Des
jugements comme "Cet élève est en avance" ou "Cet
élève est en retard" sont des non-sens puisqu'on ne peut
être confronté qu'à soi-même dans l'optique d'un
enseignement vraiment centré sur l'enfant ou plutôt
centré sur chaque enfant. Cette diversification signifie
aussi une offre très large d'activités et d'apprentissages,
des filières si l'on veut, qui ne devraient pas entrer en
concurrence en fonction des ouvertures qu'elles
prépareraient. L'adolescent pourrait choisir des filières
encourageant le travail intellectuel pur, d'autres
permettraient davantage l'éclosion d'aptitudes manuelles
ou artistiques. Il faut en finir avec l'obsession des études
rapides, des bacs à 15 ans, du professeur agrégé à 21 ans
250
ou du médecin installé dans son cabinet à 23 ans !
Donner du temps au temps, permettre aux jeunes de
multiplier les parcours. L'école doit cesser d'être un
passage obligé le plus court possible et le professeur n'a
pas à être un sélectionneur au service de qui que ce soit.
De même, l'égalité ne doit pas interdire une gestion
personnalisée du temps, des progressions et des
acquisitions, ce qui revient à dire que le groupe classe, tel
qu'il est conçu doit céder la place à d'autres formes, à des
groupes ouverts, modulables et inégaux dans les effectifs
comme dans les progressions. L'enseignement doit être à
l'aune de l'élève : à la mesure de ce qu'il peut apprendre
et pas inversement. Ce que Montaigne disait il y a près de
quatre siècles quand il écrivait :
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme
quelqu'un qui verserait dans un entonnoir, et notre
charge n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je
voudrais qu'il corrige cette partie, et que, tout de suite,
selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commence à
la mettre sur la montre, en lui faisant goûter les choses,
les choisir et discerner d'elle-même ; quelquefois lui
ouvrant le chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je
ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il
écoute son disciple parler à son tour. Socrate faisait
premièrement parler ses disciples, et puis il leur parlait
à eux.
Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de
son train, et juger jusqu'à quel point il doit se rabaisser
pour s'accommoder à sa force. Par manque de cette
mesure nous gâtons tout, et savoir la choisir, le faire
correctement, est l'une des besognes les plus ardues
que je connaisse. C'est la preuve d'une haute âme et
bien forte, que de savoir condescendre à ces allures
puériles et les guider. Je marche plus sûrement et plus
ferme vers le mont que vers la vallée.
251
Enfin, la question de l'évaluation doit être revue moins
dans le sens de l'acquisition de compétences que dans
celui du développement de capacités susceptibles de
rendre l'individu maître de soi et de son destin dans la
cité.
On parle aujourd'hui beaucoup trop de compétences et
leur évaluation est toujours conçue dans la perspective
ancienne des "programmes" et de la notation
traditionnelles. Il faudrait au moins arriver à ce que le
professeur, l'élève et les parents puissent juger par
d'autres voies, plus "subjectives" de ces acquisitions et
du bon accomplissement des quatre étapes nécessaires :
l'apprentissage, les exercices d'approfondissement et
d'enracinement, les réemplois personnels et les
extrapolations.
À ce propos, et pour entrer dans quelques détails, on a
probablement trop accordé d'importance à l'approche
ludique des apprentissages en oubliant que ce ne peut être
là justement qu'une approche, un hors-d'oeuvre - et
jusqu'à un certain âge - ne remplaçant en rien le travail
personnel, la mémorisation, passages peut-être ingrats
mais obligatoires. De la même façon, le rôle des "aides
pédagogiques" a été surévalué : la place des médias, de
la télévision et de la vidéo, de l'ordinateur… Qu'une
initiation sérieuse à l'utilisation, aux avantages et aux
dangers de ces techniques soit possible tombe sous le
sens, mais qu'une partie du cours de français (parfois non
négligeable) soit consacrée à visionner des films, à "faire
des recherches" sur internet ou à étudier les mille et une
approches publicitaires est du temps perdu, surtout
quand, le film vu, on échange au mieux trois paroles et
on passe à autre chose.
252
Certes, depuis pas mal de temps, je rêve d'une école nue,
d'une école qui se serait débarrassée des colifichets que
l'industrie et les éditeurs, les concepteurs font passer
pour indispensables : le monde autour de soi, voilà ce
qu'il faut. Nul besoin d'électronique, de salles de
projection, d'auditorium, de ce "matériel pédagogique"
dont on nous rebat les oreilles, qui coûte très cher et est
vite obsolète. Trop de technique tue les avantages de la
technique… Une expérience au Vanuatu, dans des classes
surchargées, "dénuées de tout matériel pédagogique"
m'a prouvé que, jusqu'à un certain niveau, on pouvait
travailler avec efficacité sans ces "moyens" : les
apprentissages fondamentaux se font sans sollicitation
extérieure. Et ils se font bien, je puis en témoigner. De
toute façon, en matière d'enseignement, le facteur
humain est essentiel et primordial, tout le reste est
secondaire.
*
Dans notre société éclatée, au nombre de mères seules
croissant, aux familles recomposées, aux enfants
d'origines culturelles diverses, aux enfants connaissant
des situations familiales difficiles, l'École devra en outre
être le garant moins d'une égalité toujours illusoire que
d'une homogénéité toujours menacée : tout faire pour
éviter l'exclusion, la ghettoïsation. L'École, en dépit de
l'intérêt qu'elle devrait porter à chaque enfant, à ses
particularités, à ses rythmes aurait aussi à initier à une
discipline de vie qui rende possible l'écoute,
l'apprentissage, la mise en pratique de ce qui a été appris
et la prise en compte de l'autre. Il faudrait encore une fois
pour cela que la charge n'en incombe pas seulement aux
253
enseignants, sous prétexte qu'ils sont des éducateurs,
mais que la classe intègre en plus de recommandations
institutionnelles fortes l'apport, la collaboration de
dispositifs associatifs, que ce soient des clubs de lecture,
d'animation culturelle et scientifiques, des aides au
travail personnalisées apportées par des étudiants, des
retraités volontaires ou n'importe quel membre de la
société civile par exemple.
On parle également beaucoup d'éducation à la
citoyenneté en France et cela se traduit par des opérations
largement médiatisées : concours d'écriture sur tel thème
"social", visite de lieux de mémoire, lecture de lettres
de jeunes résistants… Tout cela reste abstrait, intellectuel.
En même temps, la seule réponse aux difficultés actuelles
auxquelles sont confrontés les établissements est
l'exigence d'une augmentation des personnels de
surveillance alors qu'il serait logique, dans une
perspective "citoyenne" de développer l'autodiscipline,
de rendre les élèves responsables de la gestion de leur
école et d'eux-mêmes dans une proportion plus ou moins
grande suivant les âges. Ceci signifie également que
l'équipe des agents de service, responsable du bon
fonctionnement technique de l'établissement et de sa
propreté devrait être réduite et qu'un certain nombre des
tâches qui lui incombent soient prises en charge par les
élèves. Voilà des perspectives vraiment éducatives, alors
que le surveillant (spécialité très française !) sera
toujours l'empêcheur de tourner en rond qu'il faut d'une
manière ou une autre tromper, l'établissement établissant
une frontière entre deux populations : les adultes sur
lesquels repose l'ordre et les enfants qui sont privés de
toute responsabilité. Une situation infantilisante alors
qu'on souhaite éduquer ! Et qu'on ne me traite pas
254
d'utopiste : j'ai eu la chance d'assurer la codirection d'un
lycée binational de 800 élèves où la section française
correspondait dans sa structure sociale à un établissement
moyen de France (il ne s'agissait pas d'une section de
"gosses de familles privilégiées"). Nous ne disposions
ni de surveillants, ni de personnel de service, ni
d'infirmière ou d'infirmier, ni de conseillers principaux
d'éducation, ni…. Les deux directeurs, français et
allemand, le concierge, les équipes tournantes de la ville,
quelques professeurs ayant une formation aux premiers
soins ou en psychologie et des élèves responsabilisés
suffisaient à permettre à l'établissement de fonctionner
de façon "parfaite" si tant est que l'on puisse le dire
puisque les finalités étaient tout de même d'être un
établissement d'excellence et de se situer parmi les
meilleurs !
On n'insistera enfin jamais assez sur le fait que
l'enseignement de base doit être bien entendu celui de la
langue française.
Ce doit être l'objectif primordial de l'école primaire ou
du niveau qui lui correspondrait à peu près dans une
école repensée : maîtrise de l'orthographe parce qu'elle
participe de la richesse de la langue et des libertés que
cette dernière offre à celui qui la domine, de la
grammaire (par l'apprentissage des règles), de la
conjugaison des verbes, de l'emploi des temps et des
modes pour les mêmes raisons et parce qu'autrement les
nuances de la pensée s'estompent, disparaissent. Ceci
acquis progressivement, l'élève pourra, tout aussi
progressivement se lancer dans les exercices de rédaction
(sous tous ses types : description, récit…) et développer
en liaison avec la lecture son lexique, autant de garanties
de sa future autonomie.
255
Ce savoir particulièrement négligé aujourd'hui est
essentiel pour la "construction" d'un être indépendant,
capable de penser par soi-même, vraiment citoyen (seules
évaluations dignes de ce nom, car ces acquis ne sont que
des moyens), mais aussi dans la perspective des sciences,
car tout texte scientifique est en fait un genre en soi, un
type de rédaction, et toute réflexion, toute pensée
élaborée se construit en écrivant.
L'accès aux oeuvres littéraires doit se faire tôt : il vient
aider, entretenir et soutenir les apprentissages de la
langue, mais aussi faire découvrir les oeuvres du
patrimoine culturel français et universel. Cette initiation
ne doit pas non plus se faire dans le désordre, mais dans
le cadre solide de l'histoire littéraire, elle-même inscrite
dans celui de l'Histoire, une histoire adaptée d'abord à
leur imaginaire et dont l'enchaînement des faits serait
structurant vis-à-vis d'apprentissages comme la
numération ou la causalité. Qu'on ne s'y trompe pas,
pour de nombreux scientifiques, la littérature et la poésie
est un passage obligé vers la découverte du sens de la
beauté et de l'esthétique, une esthétique de la pensée que
l'on retrouve dans les mathématiques et dans les
sciences.
Ce savoir fondamental de la langue doit être accompagné
de l'apprentissage de celui des nombres et des opérations
sur les nombres et on devrait également familiariser les
jeunes avec les grandeurs concrètes et le repérage dans
l'espace. Les sciences expérimentales viennent apporter
ce cadre nécessaire du concret par le contact qu'elles
apportent avec les objets et en unissant l'observation à la
réflexion logique, l'utilisation pratique des nombres, des
opérations et des figures, le travail de groupe, la réflexion
et l'écriture des expériences.
256
Il serait également nécessaire de redonner à l'enfant le
sens de son environnement au lieu de se perdre dans des
discours abstraits qui dépassent les possibilités de son
entendement et de son expérience en lui faisant connaître
le nom des plantes, des arbres, des animaux, des
formations végétales et géologiques, des phénomènes
naturels courants. Ceci amène à évoquer la géographie,
un savoir nécessaire pour pouvoir se situer dans le monde
et dans son pays, un apprentissage de la lecture de cartes,
des fleuves, des mers et des régions dont ils entendent
parler.
Plus tard ces apprentissages devront se systématiser pour
donner aux enfants des repères solides, chronologiques et
géographiques, politiques et économiques.
L'enseignement des langues devrait être entièrement revu
et après une période d'initiation, des périodes bloquées,
des stages internationaux, des camps de jeunes, des
échanges seraient d'une efficacité sans doute meilleure.
La perspective à développer serait celle d'un bilinguisme,
voire d'un trilinguisme dès le primaire et l'intégration de
matières enseignées totalement ou partiellement en
langue étrangère.
Les langues anciennes devraient au moins donner lieu à
une initiation. Rappelons que Heisenberg affirmait que
sans sa connaissance du grec et de Platon, il n'aurait pas
eu l'idée du principe d'incertitude et n'aurait pas
découvert la physique quantique !
Enfin, les travaux manuels n'ont pas à être traités en
parents pauvres : fabriquer concrètement des objets en
liant l'intelligence conceptrice et la main, les lois de la
physique concrète et le développement des facultés
motrices…
Mais c'est trop entrer là dans des détails sans grand
257
intérêt parce qu'ils ne représentent que l'opinion d'une
seule personne. Encore une fois, c'est l'image même de
l'École qui doit changer, ce sont ses finalités qui
demandent à être repensées, c'est son indépendance qui
doit être assurée.
Ensuite, il sera temps de se remettre à construire.
Tous ensemble.
258
Conclure ?
259
260
Une critique (au sens propre) de l'École n'a rien à voir
avec une dénonciation de ses fondements humanistes ni a
fortiori avec l'affirmation que l'éducation est inutile.
Mais comme l'École a toujours été (et sans doute plus
que jamais) à l'image de la société, soumise à des
"intérêts supérieurs", comme elle n'a jamais agi de
façon souveraine, cette école n'a jamais rempli sa
mission. Elle a servi les privilégiés et aidé à tenter de
pérenniser ces privilèges, jadis ceux d'une société bâtie
sur la prééminence du religieux lié à des intérêts très
séculaires, ensuite ceux d'une société progressivement
puis entièrement livrée au capitalisme et au libéralisme
avec des États qui ne se conçoivent plus eux-mêmes que
comme des courroies de transmission de la sphère
économique dans lesquels les chefs d'État n'hésitent pas,
se glorifient même d'être des VRP multicartes qui
"vendent" de l'avion, du train, de la centrale nucléaire,
des armes ("Ce sera tout, ma petite dame ?"). Une
critique de l'École vise donc à distinguer le bon grain (les
éléments divers d'une véritable éducation) de l'ivraie (les
procédés d'aliénation qui ne profitent qu'au(x) système(s)
économique ou/et idéologiques).
L'École véritable serait un lieu de vie libre et ouvert dans
lequel interagissent élèves et enseignants, parents et
intervenants issus de la société civile. Un lieu où l'on
focalise particulièrement sur la socialisation des jeunes
gens, mais une socialisation qui se ferait au bénéfice des
individus, qui ne gommerait ni les personnalités ni les
différences et ne les enfermerait pas dans des modèles
communs. Socialiser ne signifie ni cloner comme on veut
trop le faire croire ni établir (ou répéter) des hiérarchies.
Préparer à la vie future professionnelle certes, mais
261
d'abord citoyenne et humaine, sans enfermer dans
d'étroites spécialisations, dans des clichés réducteurs,
dans des choix illusoires. (Ce qui explique d'ailleurs le
rejet par une majorité de nos concitoyens de tout discours
sur l'intégration ou l'identité nationale, car personne ne
veut plus du prêt-à-porter franchouillard, de Clovis, de
Jeanne d'Arc, de la baguette, du béret et de l'Angélus de
Millet !)
L'École doit rendre possible un regard intéressé et
critique sur les plus importants domaines du savoir et du
travail, sur les phénomènes de la consommation, sur
l'écologie, sur la société, certes, mais elle devrait surtout
développer certaines attitudes et valeurs : la discipline
personnelle, la volonté d'être soi tout autant que
l'ouverture à l'autre, le respect de l'autre et de son
"quant-à-soi". Elle doit renouer avec l'ambition de
l'éducation dans la Grèce antique (alors réservée à
quelques-uns) en la généralisant à tous et en prenant la
mesure de l' "horloge intellectuelle ou biologique"
propre à chacun (certains sont aptes à tel ou tel
enseignement à tel âge, d'autres plus tard ; l'essentiel est
le résultat obtenu, pas le moment), cette ambition
hellénique qui voulait que l'homme en devenir, le jeune
être, bénéficie d'une éducation qui assurerait à la fois son
épanouissement, et développerait son potentiel tout en
l'émancipant pour devenir un citoyen responsable et un
membre de la cité.
Or si l'institution scolaire a toujours prétendu aller dans
cette direction, au cours des 2500 ans pendant lesquels
l'existence d'écoles est à peu près attestée, on a toujours
fait autre chose.
Dans l'Angleterre de la révolution industrielle, l'accès à
l'école se généralise. Celle-ci fournit un savoir à l'ouvrier
262
qui lui permettra d'exercer une activité professionnelle et
d'échapper à la misère, mais elle devient en même temps
le champ clos du recrutement, le foirail, pour les
capitaines d'industrie - modernes maquignons - en mal de
capital humain. On passe vite, presque simultanément,
d'une institution civile (voire civique dans ses
fondements) à une instance économique, à un
département de l'économie dédié à la formation de jeunes
travailleurs dans le sens des intérêts capitalistes. La
gentry continuant pour sa part à fréquenter ses propres
institutions, bien entendu.
Nous avons vu qu'en France les revendications de la
bourgeoisie, monarchiste, révolutionnaire et post
révolutionnaire, républicaine ou libérale, ne signifiaient
rien d'autre que la volonté d'établir un précapitalisme
rompant avec les habitudes de l'ancien régime pour
défendre leurs intérêts de classe montante. La propriété
est au coeur des Droits de l'Homme, la liberté
économique est inscrite au verso du triptyque Liberté,
Fraternité, Égalité, qui impliquait un marché libre et une
certaine indépendance des tenants du nouvel ordre vis-àvis
des puissances civiles. Il est amusant de noter que
lorsque, peu avant la Révolution, La Chalotais se bat
contre l'absolutisme royal, il le fait au nom des libertés
bretonnes. Officiellement. Et cela lui permet
d'instrumentaliser les foules. Pourtant, ce qu'il appelle
"libertés bretonnes", ce n'est rien d'autre qu'un
ensemble de privilèges féodaux et de droits économiques
qui ne concernent que quelques-uns, de droits nouveaux
qui ne regardent que la grande bourgeoisie à laquelle il
appartient, alliée à la plus vieille aristocratie. C'est ce
même La Chalotais qui, le 24 mars 1763, rendait public
un mémoire intitulé : Essai d'éducation nationale et Plan
263
d'études pour la jeunesse, admiré de Diderot ou Voltaire
et des principaux philosophes. La Chalotais proposait des
changements radicaux d' "une éducation qui n'était
propre, tout au plus, qu'à former des sujets pour l'école".
Il réclamait alors "une éducation civile qui prépare
chaque génération naissante à remplir avec succès les
différentes professions de l'État". Pour cela, il souhaitait
qu'on en finisse avec une éducation basée sur la vieille
scolastique et enseignée par le clergé. Au lieu du latin et
des prêtres, le pays a besoin de sciences et d'hommes
formés aux instruments du progrès. Le seul but louable de
l'éducation est le bien public (et l'on sait ce que cela veut
dire). En ce qui concerne la petite enfance, il reprenait à
son compte les principes de Rousseau, quelques idées de
Pestalozzi sans doute, puis développait surtout un
programme - intéressant en soi - mais destiné aux
collèges et au public qui les fréquentait, c'est-à-dire la
bourgeoisie montante et l'aristocratie qui n'hésitait pas à
déroger. Ce défenseur des libertés préparait l'aliénation
des masses salariées au XIXe siècle, au nom du progrès et
du bien public ! Son plan est le prototype de tous les
discours sur l'école qu'on entendra en France jusqu'à nos
jours !
Plus tard, en effet le droit à l'école ne dérangera certes
pas le bourgeois même ultra, même conservateur : sans
éducation, pas de travail, pas de travailleur moins de
profits. Il ira même jusqu'à accepter d'envisager la
gratuité puis à y souscrire, car cette dépense interdit au
moins d'y couper et assure la réalité des contingents de
travailleurs pas totalement illettrés dont ON a besoin ! Et
puis, la générosité n'aura plus de limites : obligation
scolaire jusqu'à 13 ans puis 14 ans puis 16 ans…
La France n'est pas une exception !
264
En Allemagne, l'école obligatoire vient assez
tardivement. Ce n'est qu'en 1870 que la Prusse l'introduit
alors que le pays s'industrialise et poursuit une politique
impérialiste. Son exemple sera rapidement suivi par la
plupart des états des pays allemands. Les écoles
publiques sont alors conçues pour dispenser un savoir et
une éducation allant d'abord dans le sens d'une Prusse
militarisée. Tous les enfants de 6 à 14 bénéficiaient donc
d'une scolarité gratuite, mais une éducation calquée sur
les principes éducatifs militaires : un sévère entraînement
physique et une obéissance absolue venaient encadrer les
matières traditionnelles : lire, compter, apprendre par
coeur et réciter des passages de la Bible. Ces écoles
étaient aussi, bien entendu, le lieu de recrutement des
futurs soldats, particulièrement dans les milieux
défavorisés puisque les enfants des classes supérieures
poursuivaient leurs études au lycée. Enfin, ces écoles
devaient permettre de couvrir les besoins de l'industrie en
personnel plus ou moins qualifié. Après l'intermède de la
République de Weimar, qui inscrit l'obligation scolaire
dans sa constitution, le IIIe Reich poursuit la tradition
prussienne avec l'école comme lieu d'apprentissage de la
discipline, de respect de l'autorité, de l'obéissance
absolue et de la fidélité à l'idéologie nazie en liaison avec
les organisations de jeunesse, la Jeunesse Hitlérienne et
l'Association des Jeunes Filles Allemandes.
L'école nazie est le lieu privilégié de la formation de
futurs combattants fanatisés non seulement par les
exigences qu'elle pose mais aussi par un endoctrinement
auquel participent directement les cours de raciologie ou
les exercices sportifs paramilitaires (chorales, théâtre,
lancer de grenades, simulation d'affrontements armés...).
Inutile d'évoquer l'école dans les deux Allemagne, après
265
1949, pas plus que l'école en URSS ou dans les pays de
ce qu'on appelait le bloc de l'Est qui ont certes rompu
avec l'implantation idéologique capitaliste des
établissements scolaires mais l'on remplacé par leur
dogmatisme puis par les principes d'un capitalisme d'état
qui n'avait rien à envier au capitalisme pur et simple…
Pas d'exceptions donc : partout, les États sont peu enclins
à dépenser des milliards pour simplement donner à leurs
citoyens les moyens d'acquérir un savoir qui en ferait des
individus libres, indépendants et critiques. Le savoir est
une puissance, certes, mais ce qui contrôle la façon dont
il est dispensé est encore plus puissant ! L'École est
dégradée au niveau de simple outil de politiques
économiques et militaristes. Elle est totalement
instrumentalisée.
Pour en revenir au cas français, il est troublant de voir
que face à l'école, les positions sont quasiment les mêmes
que l'on soit à droite ou à gauche. Seul le discours et la
manière de présenter les choses changent. L'institution
scolaire n'est pas là pour autre chose que pour préparer le
futur adulte à entrer dans une société constituée, à en
devenir un rouage. Jamais il n'est, comme on ne rougit
pas de l'affirmer avec cynisme, au "centre" des
préoccupations. On veut bien "tourner autour du pot" en
multipliant les réformes, en "innovant sur le plan
pédagogique", en enseignant la didactique, en modifiant
la carte scolaire, les horaires, en multipliant les
"matières" et leur saupoudrage, en ergotant sur les
"matières d'éveil", en "développant" le secteur
parascolaire, en proclamant partout que les établissements
sont des "lieux de vies" où la cantine s'appelle
266
désormais le restaurant et la bibliothèque la
médiathèque : l'École relookée en apparence, avec un
bon coup de badigeon, c'est jeune, c'est cool, moderne en
un mot ! Les réformes que propose actuellement Vincent
Peillon iraient sans doute sur un point dans le bon sens
(redéfinir les rythmes scolaires) mais pour le reste, il est
dans la droite ligne de ses prédécesseurs et n'a aucun
projet digne d'étonner. On plâtre et on replâtre. Avec
timidité (la première vertu sociale démocrate) et les
enseignants font comme s'ils avaient peur de perdre des
avantages inexistants, les parents comme s'ils avaient
encore confiance dans cette École, la société civile
comme si elle devait se gargariser d'un excellent
baccalauréat cuvée 2012, malgré les milliers de jeunes
qui n'auront rien obtenu de leur scolarité. On peut
s'amuser à parcourir le fameux site à l'ambitieux intitulé :
www.refondonslecole.fr. Comme si M. Hollande, comme
si un clône du système que nous dénonçons pouvait
jamais avoir la force ou le désir de refonder quoi que ce
soit! Cynisme? Inconscience? Non! simplement,
incapacité à penser autrement qu'en rond, frileusement, à
donner une fois de plus le change en ces temps de
gesticulation et de verbe creux, de faussaires et
d'imposteurs.
Pendant ce temps, mine de rien, les écoles privées
continuent à prospérer.
Les hommes politiques, de quelque tendance qu'ils aient
été, au moins à partir de la IIIe République ayant su
habilement faire de l'École le flambeau de la République
et de la Démocratie, le lieu où concentrer toutes la
démagogie possible, une critique radicale de l'école telle
que l'ont pratiquée les milieux anarchistes est restée très
discrète en France même si les principaux représentants
267
de cette critique n'ont manqué ni de public ni de soutiens.
Une des figures des plus connues internationalement de
ce mouvement est celle de Pierre Kropotkine (1842-1921)
collaborateur à la Géographie Universelle d'Élisée
Reclus. Après des années d'incarcération en Russie et un
séjour en Grande-Bretagne, il s'installe en Suisse, y
milite, écrit, publie et fonde en 1879 le journal Le
Révolté. Arrêté en France en 1883 par la toute récente IIIe
République, à la suite des grèves des soieries lyonnaises,
il est emprisonné à Lyon mais amnistié en 1886. De
retour en Angleterre, il publie des ouvrages de géographie
et de politique. L'Entraide, un facteur d'évolution lui vaut
le respect de la communauté scientifique. Contre l'école
conçue comme l'instrument du capitalisme, il suggère
l'établissement d'une anti-pédagogie qui aurait pour but
de détacher l'école de son ancrage capitaliste et de fournir
une éducation libre de toute téléologie, seulement axée
sur les besoins (individuels et sociaux) de l'enfant. Il a eu
connaissance des tentatives et de la réflexion de Tolstoï
dont l'école Jasnaja Poljana a essayé un nouveau type
d'enseignement prenant en compte la personnalité de
chaque enfant et refusant de devenir une propédeutique à
la vie active dans la Russie impériale (1852-1862).
Francisco Ferrer aura en France une audience importante
avec son École Nouvelle et sa Ligue internationale pour
l'éducation rationnelle de l'Enfance : "(…) des écoles
(…) où seront appliqués directement les principes
répondant à l'idéal que se font de la société et des
Hommes, ceux qui réprouvent les conventions, les
préjugés, les cruautés, les fourberies et les mensonges sur
lesquels est basée la société moderne.".
Dans les années 20, le mouvement anarchiste sera très
actif et produira des études critiques de l'école (le FAUD,
268
le SAJD…). Avant que ne se referme la main de fer du
IIIe Reich, Walter Borgius avec son livre L'école, un
affront à la jeunesse jouira également d'une certaine
écoute : "L'école est pour l'État un moyen d'aliénation
particulièrement habile, créé pour habituer tous les
citoyens à l'obéissance depuis leur petite enfance, leur
faire croire dur comme fer que l'État est absolument
nécessaire."
Aux États-Unis, dans les années 60, le Free-School-
Movement partira aussi d'une critique radicale d'une
école "au service de…" pour créer par exemple la First
Street School à New York dans laquelle des essais de
pédagogie libertaire seront pratiqués. Des auteurs comme
John Holt, A. S. Neill, Paul Goodman, and George
Dennison seront particulièrement lus.
Les critiques de Bourdieu et Passeron, leur analyse de la
reproduction par l'école des inégalités sociales et des
inégalités devant la culture auront aussi un important
écho, mais comme toujours, le système peut se permettre
le luxe de ces voix discordantes. La démocratie
proclamée admet (dans une certaine mesure) la liberté
d'opinion tant qu'elle reste sans conséquences pratiques,
tant qu'elle demeure objet de discussions entre
intellectuels ou soupape de sécurité pour évacuer les
attaques trop menaçantes…
*
Une école digne de ce nom doit avoir pour but
l'épanouissement intégral de l'homme. Jean-Claude
Milner avait parfaitement défini sa vocation : un
"processus par lequel un sujet est censé s'accomplir
entièrement". Corrigeons tout de même :
269
l'accomplissement entier et définitif est par définition
impossible puisque c'est un processus qui se déroule sur
la vie et qui dépasse le cadre de l'école. Disons plutôt
qu'elle met en place les bases, les outils qui permettront à
l'enfant de s'accomplir au cours de sa vie.
Elle doit certes viser à l'intégrer dans une société, mais
sans que cette intégration signifie aliénation. C'est-à-dire
qu'elle ne doit pas viser à en faire ni un individu
anonyme perdu dans la masse, ni l'outil d'un système
économique ou idéologique réglementant cette société.
Cela n'est possible que si, au premier plan, elle permet à
l'enfant de développer ses potentialités physiques et
intellectuelles, mais sans non plus l'enfermer dans une
spécialisation prématurée. Ce n'est qu'alors qu'elle lui
fournit les moyens d'intégrer, tout en conservant une
distance critique, la société dans laquelle il vit.
Elle doit éduquer et instruire. Éduquer, c'est-à-dire
amener l'enfant à partager un certain nombre de valeurs
universelles, de valeurs susceptibles d'être partagées par
tout être raisonnable, ces valeurs que les Droits de
l'homme représentent assez bien et que l'école publique,
s'adressant à tous, doit défendre, car elles nous
concernent tous et pas seulement une partie de la
population. Instruire parce que l'Homme est un être social
et qu'il est fait pour vivre avec d'autres pour profiter des
savoirs et des savoir-faire existant et faire profiter les
autres de ce que lui-même pourra le cas échéant apporter,
la pierre qu'il ajoutera à l'édifice.
*
L'histoire de l'école dans ses "révolutions" montre au
moins qu'elle n'a jamais été indépendante mais toujours
270
l'objet de convoitise de la part des pouvoirs parce que
l'on voit en elle le moyen de former les hommes tels
qu'on les souhaite. Elle est donc toujours et d'abord un
instrument d'aliénation au service de puissances qui la
dépassent. Si ces puissances sont des "dictatures"
fondées sur une idéologie (URSS, IIIe Reich, Chine
communiste maoïste, Cambodge "démocratique"), ou
une religion (Pays européens à peu près jusqu'au XVIIe
siècle, pays musulmans puis islamistes …), l'école est le
lieu même de la formation des membres de la fourmilière.
La réification à laquelle elle concourt est totale. Si ces
puissances se teignent d'une nuance de démocratie et
remplacent le totalitarisme idéologique par un
totalitarisme économique, elles génèrent une école Janus :
les paroles, le discours se veut humaniste, la réalité est
plus pragmatique, on se contente d'ajuster par l'école le
flux des générations aux besoins du système économique
ambiant. Enfin, lorsque le libéralisme triomphant,
l'économie mondialisée, celle que Noémie Klein
décrivait dans son livre The shock doctrine, domine tout,
l'école devient un produit comme un autre.
On en arrive donc à penser que l'école n'a jamais pu et ne
pourra jamais être libre, ne pourra jamais se consacrer à
l'éducation des jeunes générations sans tenir compte de
systèmes qui la dépassent.
Pourtant, les démocraties et leurs théoriciens ont bien su
développer une théorie de la séparation des pouvoirs,
seule garante de l'existence possible de cette forme de vie
en commun : séparer l'exécutif du législatif et de la
justice. Aujourd'hui, personne, dans nos pays dits
démocratiques n'envisage en effet une justice qui serait
aux mains des deux autres pouvoirs comme cela a été le
cas dans les périodes noires de dictature. On en est même
271
à définir et exiger l'absolue indépendance de ce
quatrième pouvoir que sont les médias. Or, personne n'a
jamais songé à inscrire dans le marbre des constitutions la
liberté totale et absolue de l'École !
C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer…
*
Nous avons débuté dans cet essai par une visite de la
caverne platonicienne. Retournons-y pour le terminer.
Nous sommes enchaînés dans cette caverne, esclaves de
nous-mêmes et de notre éducation. La lumière est au
dehors, nous dit-on, mais il faut du courage et beaucoup
de foi pour la rejoindre, supporter la souffrance et la peur
pour affronter une vérité à laquelle on a du mal à croire.
Nous devrions parcourir le sentier, qui est celui de la
philosophie, pour espérer entrevoir cette lumière, nous
répète-t-on.
Nous pouvons bien sûr suivre ce philosophe "illuminé",
croire en ces paradis qu'il promet, mais on peut aussi
renoncer à le suivre, ce philosophe bavard qui prêche les
avantages d'un ailleurs. Hic et nunc peut être notre
devise ! Restons dans la caverne puisque c'est après tout
notre séjour habituel, mais débarrassons-nous de nos
chaînes en faisant table rase de tout ce qui nous attache à
notre banc, et une part de ces liens a été tissée par l'école.
Un autre philosophe nous a parlé de cette table rase,
Descartes, dans son Discours de la méthode que chaque
Français (ne nous targuons-nous pas d'être cartésiens
quasiment par nature ?) pense avoir lu !
"Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée",
nous dit Descartes qui avait décidé, contrairement à la
272
plupart des savants de son temps, d'écrire son ouvrage en
français : chacun devant pouvoir comprendre son
discours et en tirer profit. Il exposait alors par le
truchement de la narration de sa vie, qui avait valeur
d'apologue, la gestation d'une méthode dont lui-même
avait profité, tout en refusant de se croire infaillible. Déçu
par l'enseignement scolastique qu'il avait reçu (lui aussi
ou lui déjà), et après en avoir rejeté en bloc les fleurons :
éloquence, poésie, mathématiques, morale, théologie et
philosophie (ouf !) pour atteindre le vrai, Descartes s'était
résolu à "ne chercher plus d'autre science que celle qui
se pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grand
livre du monde" et "à ne rien croire trop fermement", à
s'efforcer "toujours de pencher du côté de la défiance,
plutôt que vers celui de la présomption".
Il semble que nous ayons oublié ses leçons d'un
philosophe qui ne cherchait ni à nous tromper ni à nous
montrer un univers éthéré, un au-delà enchanteur. Restons
dans notre caverne dit-il, tirons en toutes les ressources
possibles, mais prenons notre destin en mains et chaque
fois remettons sur le métier l'ouvrage car rien n'est
jamais sûr, évident définitif sinon cette certitude que nous
sommes capables de faire par nous-mêmes, de penser
donc d'être !
Voilà résumée la meilleure pédagogie et la meilleure
définition de l'École, telle qu'elle devrait être, libre de
tous les a priori, patrie des jugements purs avec ces quatre
règles qui sont autant de viatiques :
1. "Ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je
ne la connusse effectivement pour telle ; c'est-à-dire
d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention"
2. "Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en
273
autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis
pour les résoudre."
3. "Conduire par ordre mes pensées, en commençant par
les objets les plus simples (...) pour monter peu à peu (...)
jusqu'à la connaissance des plus composés, en supposant
même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point
naturellement les uns les autres"
4. "De faire partout des dénombrements si entiers, et des
revues si générales, que je fusse assuré de ne rien
omettre".
Le résultat de cette réflexion est premièrement qu'on peut
croire en l'existence de SON esprit et en SA raison,
deuxièmement qu'on ne conduit pas SA raison n'importe
comment ni suivant n'importe quelle recette apprise de
tel ou tel "maître" mais que chacun doit inventer,
imaginer sa méthode, celle qu'il propose n'étant qu'une
méthode possible, celle qui lui convient à lui, René
Descartes.
Existe-t-il une meilleure pédagogie ?
Prenons donc notre destin en main et commençons par
l'École. Faisons enfin coïncider, nous les cartésiens,
notre réputation avec la vérité.
274
Franc-Maçonnerie : À propos de la traduction du livre des Constitutions d'Anderson par Louis-François de la Tierce (1733/1742/1745)
C'est sans doute dans le journal d'un ami et collaborateur de Prosper Marchand, le marquis d'Argens, que se trouve une critique compte-rendu très intéressante car elle explique le médiocre succès de ce qui devait, selon son promoteur, servir de fondation à une maçonnerie rationaliste à visée politico-morale en Europe.
Ce journal, la Nouvelle Bibliothèque, ou Histoire littéraire des principaux Ecrits qui se publient parut d'octobre 1738 à juin 1744 en Hollande et compte dix-neuf volumes.
Elle a quatre auteurs ou responsables, tous, hormis le premier, réfugiés protestants : Jean-Baptiste de Boyer d'Argens (1703-1771), Charles Chais (1700-1735), Armand de La Chapelle (1676-1746), Jean Barbeyrac (1674-1744) et Charles de La Motte (1667-1751).
Jean Sgard, dans le Dictionnaire des Journaux la décrit ainsi : "La Nouvelle Bibliothèque est un journal savant destiné à fournir des extraits et comptes rendus des principales publications dans tous les domaines: histoire, belles-lettres, philosophie, théologie, sciences, etc. Les nouvelles littéraires, assez brèves, sont regroupées à la fin de chaque livraison, et dans un article particulier à la fin des t. XIV-XIX", une revue donc de haute volée et les communications sont toujours très solides.
Jean Sgard conclut d'ailleurs ainsi : "La collaboration des pasteurs libéraux et du marquis d'Argens a donné pendant quelques années un rôle de premier plan à la Nouvelle Bibliothèque dans la controverse philosophique; le réseau de collaborateurs dont s'était entouré Paupie, et sans doute aussi la précision méticuleuse de Prosper Marchand dans le rôle de correcteur et d'intermédiaire littéraire, ont donné à cette revue une régularité et un sérieux qui permettent de la compter parmi les grandes bibliothèques savantes de l'époque."
Notons toutefois que le marquis d'Argens quitte la Hollande pour la Prusse en 1740.
Il semble que l'article consacré à La Tierce soit du pasteur Armand Boisbeleau de La Chapelle.
*
Nouvelle bibliothèque ou Histoire littéraire des principaux écrits qui se publient, À La Haye, Chez Pierre Paupie, Juin 1742.
Histoire, Obligations, &Statuts de la très vénérable Confraternité des Francs -Maçons; tirez de leurs Archives, & conformes aux Traditions les plus anciennes, approuvez de toutes les loges, & mis au jour pour l'usage commun des loges répandues fur la surface de la Terre. Francfort sur le Meyn chez François Varrentrapp 1742. Avec approbation, & privilège petit 8°. Pag. 238 pour le Corps de l'Ouvrage, sans en compter une trentaine de plus pour l'Epitre dédicatoire, pour le Discours préliminaire &c. Au bas de l'Epitre Dédicatoire adressée à Mr. Gottbert Keitler (sic), Chambellan de l'Impératrice des Russies, l'Auteur, de cet Ouvrage se donne le nom de Frère de la Tierce, qui est sans doute son nom de guerre dans les beuvettes de la Confraternité. Je ne sai (sic) néanmoins quel Mystère il entend à se masquer de la sorte aux yeux du Public, car je ne vois pas qu'il garde les mêmes ménagements pour ses confrères, qu'il désigne tous par les noms de famille sous lesquels ils sont connus dans le monde ; ne faisant même aucun scrupule d'y ajouter celui de leur Baptême. Son Approbateur est le Frère Friard, Secrétaire de la loge des François (Refugiez), à Londres dans le Rue de Suffolk à l'enseigne du Duc de Lorraine. Il dit à la Page 164. que le très noble Prince Jean Duc de Montagu, ayant été élu Grand-Maitre, en I72I. Il nomma Jean Beal, Docteur en Médecine, son député Grand-Maitre, & que la Grande loge élut Mr. Villeneau, premier Grand Surveillant, & Mr. Thomas Morris, second Grand Surveillant. C'est par tout ailleurs la même Méthode, & d'où vient que le Frère de la Tierce est ici le seul qui ait honte de se faire connaitre. Seroit il possible, ou que son vrai nom déshonorât la confrairie, ou que la confrairie ne fit pas assez d'honneur à ce nom ? Assurément, ce n'est pas de son Ouvrage même qu'il peut avoir crû qu'il eût à rougir. Car s'il s'y agit en gros de faire l'éloge de la Maçonnerie, se peut-il de plus beau sujet ? Un Art noble, un Art Royal, & qu'elle n'est point encore la magnificence des Epithètes qu'il lui donne ? Les Savans qui se sont amusez à faire le Panégyrique de Néron, de l'Ane, de la Folie, avoient des raisons bien plus naturelles de demeurer Pseudonymes. Cependant ils ont eu l'audace de se nommer, Le Frère de la Tierce seroit-il plus modeste ou plus timide que ces Messieurs là ? D'ailleurs, il a tellement rehaussé sa matière par l'Art dont il l'a enrichie, qu'un Ouvrier si habile n'auroit pas dû envier au Public le plaisir de le connaitre. Le fameux Ecrivain du Chef d'uvre d'un inconnu n'en a pas approché, quelque immortel qu'il se soit rendu par son spirituel, & avant Commentaire sur une vieille Chanson du Pont-Neuf. Ici vraiment c'est bien une autre profusion d'esprit & de savoir. On s'y promène au large dans tous les Païs, dans tous les tems, dans tous les arts, dans toutes les sciences. On y voit l'abrégé de l'Histoire universelle. La Chaldée, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, le Pérou, le Mexique, les Migrations des premiers Habitans de la Terre, l'Origine des Villes, leurs Fondateurs, leurs Murailles, leurs Edifices, des Colonnes, des Statues, des Arcs de Triomphe, des Inscriptions, des Epitaphes, des Passages de l'Ecriture expliquez, des Observations profondes de Littérature, de Critique, d'Antiquariat. O que de belles choses ensemble ! II est vrai qu'après avoir bien lû on est fort étonné de n'avoir rien appris, sur tout de ce que l'on cherche. Apparemment que ce n'est pas la faute du Frère de la Tierce. Il faut croire que plutôt celle de la Société qui ne veut pas, & qui peut-être craint d'être connuë, & qui se joue ainsi du Public à lui Conter des Balivernes. Quel autre Titre donner en effet, à toute la partie Historique que ce Volume renferme ? Tout s'y termine à équivoquer, perpétuellement, sur les termes en insinuant qu'il y a eu des Loges de Francs-Maçons, dans tous les tems, & dans tous les lieux du monde, où l'on a bâti de Brique, ou de Pierre, & où par conséquent il y a eu de la Maçonnerie. Je n'en donnerai pour preuve que ces paroles du Discours Préliminaire à la Page 13. "On peut conjecturer que, les premiers Habitans de l'Amérique, y sont venus, les uns des extrémités, Orientales de l'Asie, &les autres des côtes Occidentales de l'Europe & de l'Afrique. C'est un fait constant que les Carthaginois y ont envoyé des Colonies. Les Conjectures semblent d'autant mieux fondées que la plûpart des Migrations des Peuples s'étant faites, au commencement, par Mer, ils n'auront point tardé à chercher de nouveaux Païs, dès que ceux de notre Continent se seront assez peuplez. Quoi que les Principes fondamentaux de l'Art-Royal, fussent presque entièrement oubliez dans ce nouveau Continent, lorsque Christophe Colomb en fit la découverte, les Empires du Mexique & du Pérou ne laissoient pas d'avoir encore bon nombre de Loges & des Edifices magnifiques & curieux." Donc il y a eu des Loges de Francs-Maçons dans le Mexique & dans le Pérou, parce qu'il y a eu des Edifices. Donc encore l'Historien a prétendu que de la Maçonnerie, en général, on conclut à l'existence particulière de la Franche - Maçonnerie & à celle des Loges de cette dernière. Or pour démêler l'Equivoque, il est nécessaire que j'instruise les Etrangers de ce que l'on appelle des Francs-Maçons en Angleterre, & singulièrement dans la Ville de Londres. Mais pour le faire avec ordre, il faut aussi que je leur donne une idée générale du gouvernement de cette grande Ville, considérée simplement dans ce que l'on appelle Cité, & je ne saurois mieux donner cette idée générale, qu'en traduisant ce que Stowe en dit dans sa Description de Londres. Liv. V. Chap. Ix. p. 173. Ed. 1720. "Comme le Gouvernement de cette Cité, dit-il, est principalement maintenu, par les Magistrats supérieurs, c'est-à-dire le Maire, les Shérifs, &les Aldermans, il y en a aussi une Partie qui consiste, nécessairement dans les Compagnies de ceux qui sont Francs, qu'il semble qu'autrefois on appellât Barons. [...] C'est de ces Barons, ou de ces Bourgeois Francs que les Compagnies sont composées ; & comme la Cité de Londres consiste en Personnes de divers Métiers, c'est à-dire qui font & qui vendent les choses dont on a besoin pour établir de l'ordre entre elles, il a fallu des Loix & des Règles selon lesquelles elles, exercent leurs Métiers, leurs Arts, & leurs occupations manuelles. Pour cet effet les Gens de chaque Métier, ou, comme on l'appelle, de chaque Mystère, sont distinguez par Compagnies, ou Sociétez, ou Fraternitez. Elles ont séparément leurs Halles, ou lieux d'Assemblée, qui sont en général des Bâtimens magnifiques, où ils confèrent ensemble tous les Mois, ou plus souvent touchant leurs propres affaires, comme ils s'y trouvent aussi certains jours fixes, pour se festiner. Ils ont aussi leurs Maîtres, leurs Surveillans, leurs Assistans, leurs Secrétaires, & d'autres Officiers pour consulter, aviser & donner les ordres sur toutes les choses qui regardent le bien de leurs Sociétez respectives, & pour punir ou reformer tous les abus qui peuvent se commettre dans leurs Métiers. C'est là ce que l'on appelle des Corporations, parce qu'elles sont incorporées ou formées en Corps de Métier, par des Chartes émanées des Rois ou des Reines d'Angleterre, ou fondées sur des Actes de Parlement avec certaines Libertez & certains Privilèges".
Entre ces Confrairies, qui sont au nombre de plus de 8o, la trentième en ordre est celle des Maçons, dont voici ce que dit le même Stowe à la Page 215 "La Compagnie des Maçons, autrement nommés les Francs-Maçons, est d'une ancienne origine & en bonne estime, à cause de ses fréquents rendez-vous qui se font d'une manière courtoise & amicale, comme il convient à une Fraternité, où l'on s'aime. Cette mutuelle Assemblée étoit fréquentée dès le Règne de Henri IV l'an 12 De ce Règne. Elle reçut ses Armes (qui sont un Compas entre trois Tours) de Guillaume Hanckeslow, Clarencieux Roi d'Armes le 13. d'Edouard IV".
Ajoutons à ceci, que dans toutes ces Compagnies, on est aggrégé par voie d'acceptation, non en vertu d'un Chef d'uvre, mais en considération de l'argent qu'on donne pour acquérir le droit de franchise; que sans avoir la moindre connoissance de ce que l'on appelle l'Art & le Mystère d'une Compagnie, on peut s'en faire accepter, que cette acceptation suffit pour être Franc de la compagnie, qu'il y a donc un grand nombre de membres qui ne sont Francs du Métier que de cette manière, & que cependant il y a aussi une infinité de Gens de la profession qui ne sont point Francs de la Confrairie. Après ces éclaircissemens, qu'il nous soit permis de supposer, pour un moment, que la Confraternité des Francs-Maçons, dont le Frère de la Tierce nous donne ici l'Histoire & l'Eloge, n'est réellement autre chose qu'une imitation, ou qu'une extention de la Compagnie des Francs-Maçons, qui fait partie de celles de la Ville de Londres. Il en résultera d'une manière évidente, 1°que la première n'est en aucun sens ni plus Ancienne, ni plus Noble, ni plus Royale que la seconde, 2°que les deux ensemble ne sont ni plus Anciennes, ni plus Nobles, ni plus Royales que toutes les autres Confraternitez qui forment les divers Corps de Métier de la Ville de Londres; 3° que le Titre de Franc, ajouté à celui de Maçon, désigne uniquement un Homme qui est accepté dans la Confrairie quoiqu'il n'entende rien à la Maçonnerie, &qu'il n'appartienne en aucune façon au Métier; & que par conséquent, 4° enfin l'Histoire de la Maçonnerie ne fait rien du tout à celle de la Confraternité des Francs-Maçons. Car si elle y faisoit quelque chose, on pourroit faire, dans le même goût, de gros Ouvrages sur toutes les Compagnies qui composent la Bourgeoisie de Londres. Il y a des Francs Pelletiers, des Francs Barbiers, des Francs Brocanteurs, des Francs Fruitiers &c. Ne seroit-il pas plaisant que des Gens qui s'érigeroient en Historiens de ces Confrairies particulières à la Ville de Londres, s'avisassent, l'un de nous débiter les antiquitez de la Chasse, des Sacrifices, de la Boucherie &c. pour en faire des preuves du Noble & Royal Art de la Franche Pelleterie, l'autre de se prévaloir de l'usage qu'on a fait, en tout tems & par tout, des Fruits de toutes les sortes, crus, ou preparez de toutes les manières, pour nous donner l'Eloge Historique de l'Art Noble & Royal de la Francbe Fruiterie, & ainsi du reste. Ne diroit on pas que ces gens -là se moquent du Monde, & ne cherchent qu'à se divertir aux dépens du Public ? N'est-ce pas cependant dans ce même goût-là que le Frère de la Tierce a fait l'Histoire de sa Confraternité ! De tout tems & par tout on a bâti de Pierre ou de Brique. Donc de tout tems & par tout il y a eu une Confrairie de Francs-Maçons, émanée ou imitée de celle de Londres. Qu'à huit (sic) clos, & parmi la populace des Confrères, on raisonne de cette manière, je le conçois sans peine ; car je sais que ces Messieurs ne sont pas trop délicats sur le choix de leurs Membres, & qu'ils acceptent, sans beaucoup de façon, toutes les petites gens qui demandent d'être admis. Mais qu'aux yeux du grand monde, on ait la confiance de produire ces Babioles, c'est ce que l'on ne croiroit pas si l'on ne le voyoit & fi l'on ne les avoit pas entendu sortir de la bouche d'un Théologien, Mathématicien fameux, pendant le séjour qu'il a fait à la Haye. On se souvient encore, qu'étant alors le Député de sa Confrairie en Hollande, où je crois aussi qu'il en a été le premier Fondateur, qu'alors, dis-je pour répondre aux questions que certaines gens lui faisoient sur son Ordre, il parloit gravement des Francs -Maçons qui bâtirent la Tour de Babel; du Grand Maitre Nabuchodonozor qui bâtit les Murs de Babylone; de l'Art Royal qui fut porté en Egypte par Mitzraim, second fils de Cham, & de tous ces autres contes bleus que le Frère de la Tierce donne à tas & à piles avec la même gravité dans son Livre. Tout cela ne seroit il - pas plus que visible, s'il ne s'agissoit, après tout que d'un Corps de Métier de la Ville de Londres ? Examinons donc à cette heure, si c'est autre chose, & fi la supposition que nous avons faite, pour un moment, que des deux Confrairies qui portent le même nom, l'une pourroit être purement une Imitation, ou une extension de l'autre, si cette supposition, dis-je, ne seroit point une réalité. Mais quel doute peut-il y avoir là-dessus? 1° La chose est possible. Il n'est point sans exemple que les Compagnies de la Cité de Londres s'accommodent, à prix d'argent, pour la participation de certaine partie de leurs Privilèges. Ainsi l'on vit sous Guillaume III la Confrairie des Fourbisseurs vendre le droit de faire des Lames d'Epée, à quelques gens à projets, qui s'associèrent pour acquérir les Biens confisquez en Irlande, parce qu'ils avoient besoin d'un Titre pour s'ériger en Corps, sans recourir à l'autorité du Roi, ou à celle du Parlement Je ne crois pas qu'il doive en avoir beaucoup coûté pour obtenir de la Confraternité des Francs-Maçons quelque part à un Titre de la même Nature. 2°La chose est extrêmement vraisemblable Car on voit dans les deux Societez le même Ordre, le même Esprit, les mêmes Ornemens, le même Langage. La Compagnie de Londres s son Maitre, son Député, ses Surveillans ; elle se pique singulièrement de bienveillance, & d'union fraternelle entre ses Membres ; elle fait une profession extérieure de Maçonnerie, quoi qu'elle accepte, quantité de gens qui n'y entendent rien; l'affaire la plus importante de ses Assemblées est de se réjouir ensemble, & de se festiner; elle veut que dans ces Rendez-vous on paroisse en habit décent, avec des Truelles, des Tabliers, des Gands de femme. Tout cela convient aux fameuses Loges des Francs-Maçons du Frère de la Tierce. Or si l'une des deux Confrairies a servi de Modèle à l'autre, il est tout à fait probable que c'est la première, & cela d'autant plus que l'Origine de la dernière est toute récente. On n'a jamais ouï parler d'une Fraternité de Francs -Maçons avant l'érection de celle de la Compagnie Bourgeoise de Londres, qui à ce que dit Stowe étoit déjà ancienne de son tems, & ce n'est que depuis 25 ou 30 ans, tout au plus, qu'on a dit un mot des Francs-Maçons du Frère de la Tierce. 3°Enfin, je ne m'en tiens, ni à la possibilité, ni à la vraisemblance ; je dis que la chose est vraie, parce qu'elle est avouée. En plusieurs endroits de son Livre, le Frère de la Tierce confesse que c'est de la Grande-Bretagne que sort sa Confrairie ; car après un Verbiage infini pour faire croire aux Duppes que cet Ordre, dont Adam fut le premier Grand Maitre, se continua par ses Enfans, & se répandit, par tout, avec eux, il reconnait que, dans les derniers tems, la connoissance ne s'en étoit conservée qu'en Angleterre. "Peu à peu, dit -il, à la Page 139, Nos Loges & nos Solemnitez furent négligées dans la plupart des lieux. De là vient que de tant d'Historiens ceux de la Grande Bretagne, sont les seuls qui parlent de notre Ordre". Il ajoute à la Page 130 que ce fut sous Edouard fils de Henri IlI que " la Colonie des Frères s'établit en Angleterre...&... que les Membres de cette Confraternité prirent le nom de Francs-Maçons, & que depuis ce tems- là la, Grande Bretagne fut le Siège de l'Ordre, la Conservatrice de ses Loix & la dépositaire de ses secrets, & que des Iles Britanniques l'Art Royal commence à repasser dans la France".
Sans copier les fréquentes répétitions qu'il fait de la même chose, on m'avouera que ces seules paroles, renferment une Confession bien précise, que la Compagnie Bourgeoise des Francs-Maçons de la Cité de Londres, a été la Mère & la source de l'autre. Tout ce que l'Auteur en dit de plus n'est donc que pure équivoque, & que vrai badinage. Ce n'est pas pour tant qu'il n'y ait une différence notable & réelle entre les deux Compagnies. Car il me parait que les Francs-Maçons du Frère de la Tierce, bien qu'issus des autres s'en sont fort écartez, & pour expliquer ce que j'en pense on me permettra de faire observer, qu'il n'y a pas encore long tems que les maisons à Caffé n'étant pas fi communes à Londres, qu'elles le sont à présent, on y suppléait par un Usage presque universel, & dont on ne parle guères plus depuis l'introduction de ces rendez-vous publics, qui sont bien plus commodes. Cet Usage étoit que des gens de connoissance formassent entre eux, ce que l'on nommoit, un Club, ou une Coterie régulière, parce que chacun payoit son Ecot. Les Assemblées se faisoient dans une Maison à Bière, ou à Vin, dont la plus belle & la plus grande Salle y étoit ordinairement destinée. Pour y établir quelque Ordre, on faisoit des Loix, qui étoient écrites, & placées dans un endroit de la Chambre, où tout le monde pouvoit les voir, & les lire. Ces Loix réglaient l'Ecot, le commencement, la fin de la Séance, la manière de l'admission, & tout ce qui y étoit relatif, comme le rang des Officiers, leur pouvoir, leur élection, la conduite des Membres & Les Règlements les plus communs étoient d'interdire les Sermens, les obscenitez, les injures, les querelles sous peine d'Amande, ou d'Expulsion. Pendant la Séance, marquée par les Statuts, on n'admettoit dans l'Assemblée aucun Etranger. Les Femmes n'y étoient jamais admises, & quant au reste les Loix étoient plus ou moins étenduës, selon le caractère de ceux qui formoient la Coterie, ou qui la composoient. Il y avoit de ces Clubs en quantité, dans tous les Quartiers, & la liberté Angloise leur étoit si favorable, qu'ils n'y passèrent jamais ni pour suspects, ni pour illicites, ce que Mrs les Francs -Maçons du Frère de la Tierce appellent, pompeusement, des Loges, ne sont donc proprement que des Clubs de la même Nature, si ce n'est qu'il y a entre elles une Correspondance, une Communauté de Loix, une participation de Titre & peut-être aussi une subordination qu'il n'y avoit point entre les autres. A d'autres égards encore cette Société diffère de la Compagnie proprement dite des Francs-Maçons de la Bourgeoise, parce que cette dernière s'assemble toujours dans la même Halle commune ; que, dans ses Festins, les Etrangers sont admis sans façon lorsque l'un des Membres les introduit, ou les y convie, & que ses Loix, tant Originales que dérivées, sont publiques, & peuvent être connuës de tout le Monde, En ces trois choses principales consiste la différence essentielle contre les deux Confrairies. 1°. Celle du Frère de la Tierce fait ses Assemblées par Pelotons en différentes Maisons de la Ville, & peut les faire de même dans toute la surface de la Terre, pour me servir de fon Expression; ce qui constituë la nécessité d'un Caractère Symbolique auquel tous les Confrères se puissent reconnaitre dans tous les Païs. 2°. Elle n'admet à ses Séances, & à ses Festins que les Membres qui ont été acceptés, afin de pouvoir donner quelque Air de Mystère distinctif, peut-être à des riens, mais à des riens qui sont nécessaires pour le Symbole. Enfin 3°. & c'est ici la différence la plus considérable, cette Coterie mystérieusement & ridiculement façonnière, s'est fait, pour son Gouvernement intérieur, un Corps de Loix singulières, & qu'elle cache, avec tant de soin, que, jusqu'ici, le secret n'en a pû transpirer, ce qui a fait naitre contre elle de terribles soupçons.
Je sais que les Confrères se récrient tous, avec force, contre les divers bruits que l'on fait courir à leur désavantage, & que c'est, en partie pour s'en justifier, qu'ils ont fait imprimer, pour la seconde fois, cet Ecrit Apologétique. Copions ici ce que le frère de la Tierce en dit dans son Discours Préliminaire, à la Page 15. " Le jour de la St. Jean-Baptiste de l'An de la Maçonnerie, cinq mille sept cent ving & un, le très haut, & très illustre Seigneur Mylord Duc de Montagu fut solemnellement élu grand Maitre... non, content de s'acquitter des fonctions ordinaires, il fit extraire des Archives, tout ce qui pouvoit se mettre, par écrit, touchant l'Histoire, les Statuts, & les Règlements de la Confraternité. Le célèbre Dr. Anderson, Prêtre de l'Eglise Anglicane, fut le digne Membre qu'on chargea de cet Ouvrage, qui parut bientôt imprimé en Anglois Le Recueil qu'on met aujourd'hui au jour en Langue Françoise sans s'écarter de ce qui a été publié par le Dr. Anderson, contient une multitude de faits Historiques, dont ce savant frère n'avoit fait aucune mention. Celui qui les a rassemblez il y a plusieurs années, est un ancien Membre de la Loge du Duc de Lorraine, à Londres.... Nous croyons ne pouvoir mieux finir ce Discours que par une Apologie des Francs-Maçons, composée il y a quelques années par le savant & digne frère Procope, Docteur en Médecine à Paris.
"Quoi! mes Frères, souffrirons-nous Que notre auguste Compagnie Soit sans cesse exposée aux coups De la plus noire Calomnie ? Non, c'est trop endurer d'injurieux soupçons. Souffrez qu'à tous ici ma voix se fasse entendre. " Permettez moi de leur apprendre" Ce que c'est que les Francs-Maçons &c".
Mais en vérité ces Messieurs s'entendent bien mal à écrire des Apologies. De la manière qu'ils s'y sont pris dans leur propre Cause, je ne voudrois pas leur confier le soin de la mienne. On diroit qu'ils n'ont appréhendé que les Sots, auxquels on en impose aisément par le jargon & par le babil, & qu'occupez de cet objet méprisable, ils n'ont pas fait la moindre attention au Public éclairé & judicieux, auquel ils donnent furieusement à penser. Je ne reviendrai point à leur impertinente Manuvre dans la Partie Historique. Je m'en tiendrai ici à ce qu'ils publient de leurs Statuts & de leurs Règlemens Sans parler de l'air perpétuel de Mystère qui y règne, & que l'on y avoue, il y a même dans leurs aveux bien des choses qui ne peuvent que révolter les personnes sensées.. 1°Le rapport qu'ils reconnoissent entre leur institut, & celui de la Société des Jésuites Pag. 130 " Nous avons, parmi nous trois espèces de Confrères; des Novices, ou des Apprentifs ; des Compagnons, ou des Profès ; des, Maitres, ou des Parfaits. On explique aux premiers les Vertus Morales ; aux seconds les Vertus Historiques ; aux derniers les Vertus Chrétiennes".
Il suit de là que leurs Assemblées sont des Espèces de Collèges où l'on montre à des gens, déjà Chrétiens, une autre Religion Chrétienne, que celle qu'ils avoient apprise dans ·leur Catéchisme, & dans la Bible même. 2° La Conformité qu'ils avouent entre leurs Mystères, & ceux du superstitieux Paganisme. Page 134. " Oui, Messieurs, les fameuses Fêtes de Cérès à Eleusis, d'Isis en Egypte, de Minerve à Athènes, d'Uranie chez les Phéniciens, & de Diane en Scythie avoient du rapport aux nôtres. On y célébroit des Mystères, où se trouvoient plusieurs vestiges de l'ancienne Religion de Noé & des Patriarches". C'est donc la Religion aussi ancienne que le Monde, ou pour parler plus net, la Religion de Mr. Tyndal, que ces Messieurs enseignent dans leurs Collèges Bacchiques. 3°. Les Sermens extraordinaires par lesquels les Confrères sont obligez au secret Page 138. " Ils convinrent de plusieurs signes anciens, & de mots, Symboliques, tirez du fonds de la Religion... On ne communiquoit ces signes & ces paroles, qu'à ceux, qui promettoient solemnellement, & fouvent même au pied des Autels, de ne les jamais révéler. Cette promesse sacrée n'étoit donc pas un serment exécrable, comme on le débite, mais un lieu respectable, pour unir les Chrétiens de toutes les Nations dans une même Confraternité".
Prit-on jamais de semblables précautions quand on ne s'engage qu'à taire des bagatelles, ou qu'à cacher de bonnes actions ? 4°. La force de ce Serment prêté pour le secret, supérieure aux obligations de la Conscience. Page 208 "Les Ecclésiastiques se croyoient en droit de savoir tous les secrets, par la vertu de la Confession auriculaire, & les Francs-Maçons, se gardoient bien de s'en confesser".
De quelle Nature doivent être des Engagemens qui tiennent en respect un Catholique Romain consciencieux qui connait sa Religion, & qui en est de bonne foi ? 5°. L'abus visible & scandaleux des termes consacrez par la Religion & par l'usage de nos Ecrivains sacrez eux-mêmes. Page 152. " Le plus expert d'entre les Compagnons sera choisi, établi Maitre ou inspecteur des Travaux du Seigneur. Le Maitre se sentant lui-même capable & adroit entreprendra l'Ouvrage du Seigneur, aussi raisonnablement qu'il se pourra Tant le Maitre que les Maçons qui reçoivent leurs Gages, avec justice, seront fidèles au Seigneur, & finiront leur ouvrage honnêtement".
Le travail du Seigneur, l'Ouvrage du Seigneur, la fidélité au Seigneur, en parlant de la manière dont il faut grimacer dans la Séance, ou tout au plus faire quelque Maçonnerie ! quelle profanation !
6. L'abjuration formelle de toute Religion Révélée. Cet Article est grave, & que faut il, néanmoins, pour le prouver que transcrire ici le 1. Chef General des obligations que le Frère de la Tierce exprime de la manière suivante ? Touchant Dieu, & la Religion. Un Maçon est obligé, "en vertu de son Titre, d'obéir à la Loi Morale, & s'il entend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide, ni un Libertin sans Religion. Dans les anciens tems les Maçons étoient obligez, dans chaque Paîs, de professer, la Religion de leur Patrie, ou Nation, quelle qu'elle fut ; mais aujourd'hui laissant à eux-mêmes, leurs opinions particulières, on trouve plus à propos de les obliger à suivre la Religion sur laquelle tous les Hommes sont d'accord. Elle consiste à être bons, sincères, modestes & gens d'honneur, par quelque dénomination, ou croyance particulière qu'on puisse être distingué : d'où il s'ensuit que la Maçonnerie est le centre de l'Univers, & le moyen de concilier une sincère Amitié parmi des Personnes, qui n'auroient jamais pu sans cela se rendre familières entre elles".
Pour peu d'attention que l'on daigne faire sur ces 6. Articles, dont il m'auroit été facile de grossir le nombre, on m'avouera qu'une Societé, qui voudroit elle-même se rendre suspecte de tout ce qu'on lui impute, ne pouvoit jamais prendre une plus sûre Méthode. Mais après en avoir montré le mauvais côté, la justice veut que j'en montre le bon. Ceci regardera l'esprit d'Aumone (sic) fraternelle qui règne dans la Confrairie. J'en avois déjà oui parler, avant que ce livre parût. J'avois appris, de bon lieu, que les Confrères avoient entre eux une bourse commune pour s'assister mutuellement dans le besoin ; que leur coutume étoit même de s'appuyer en tout, dans les affaires, dans le Négoce, dans les Projets, & que c'étoit là l'attrait qui y faisoit entrer quantité de personnes, dont la fortune étoit délabrée; & que malgré la petitesse de leur Etat, ou de leur Rang, on ne laissoit pas d'accepter, parce que tout sert à grossir le nombre. J'ai donc pû m'eclaircir là-dessus, à présent, par moi-même, en jettant les yeux à la Page 272, sur le "Règlement des Francs-Maçons touchant les fonds & les aumones", le premier projet en fut proposé dans la grande Loge du 21 Nov. 1724. On régla d'abord que " chaque nouvelle loge fourniroit pour sa création, deux Guinées à la Caisse commune". On fit ensuite des cueillettes dans les ·Assemblées Le 13. Nov. 1730, quelques Frères indigens ayant présenté requeste. Il fut resolu que l'on ne donneroit point à chacun au-delà de 3 Livres Sterling .
Le 16 Mars 1731, la Commission pour les Aumones eut pour agréable qu'on ne lira aucune requête quand le suppliant ne se trouvera pas en personne devant elle, excepté en cas de Maladie, d'impotence, ou de Prison Le 24. Mai 1731, la Résolution fut prise que la commission aura pouvoir de donner à un pauvre frère 5 Livres Sterling, mais non d'avantage, jusqu'à ce que la grande Loge s'assemble Le 18. Juin 1731. il plût à la Commission des Aumones qu'aucun pauvre frère, qui a une fois reçu une assistance, ne pourra, pour la seconde, présenter Requête, à moins qu'il n'ait quelque chose de nouveau à alléguer Le 8 Juin 1732, le Député Batson, ayant donné connoissance que malgré les assistances communes, quelques pauvres Frères, au grand scandale de la Société, importunoient certains Frères de qualité & autres Francs-Maçons, par des demandes particulières d'Aumones, il fut résolu que tout frère qui fera à l'avenir des demandes particulières, sera privé à jamais de tout secours... Le 31 Mars 1735, il fut agréé qu'aucun frère Etranger, c'est à-dire, qui n'aura pas été reçu régulièrement, mais clandestinement, ou dans la vue de participer aux Aumones, non plus que quiconque qui aura eu part à une reconnoissance de cette espèce, ne devra jamais être habile à jouir, en quelque chose, du bénéfice de la Caisse commune... La commission soulage plusieurs Frères indigens avec de petites sommes qui ne passent pas cinq Livres Sterling. La grande Loge a souvent ordonné au Trésorier de donner à quelques Supplians I0, I5 ou 20 Livres Sterling". Mes Lecteurs qui pourroient avoir des vuës intéressées, sur la Confrairie, pourront, s'il leur plait, régler, par ce Plan, celui de leurs desseins, & de leurs espérances... Tous les autres en concluront, fort naturellement, qu'une fraternité si tendre, qui n'a commencé sa caisse commune pour les Aumones que depuis l'an 1721 qu'on en proposa le Projet, ne peut être d'une fort ancienne Origine. Spectatum admissi risum teneatis Amici.
En bref, une critique très sévère mais qui apporte des explications intéressantes sur la réception de la traduction et montre au moins qu'il ne faudra pas attendre l'abbé Grandidier (entre autres) pour savoir ce que sont les origines de la franc-maçonnerie. L'auteur savait-il que La Tierce était lui-même protestant ? La débauche de références, l'érudition appuyée du texte de ce dernier exaspèrent les intransigeants pasteurs de Hollande tout autant que la première obligation qui leur semble particulièrement suspecte.
Des pasteurs philosophes comme Rousset de Missy réagissent autrement avec une vision plus positive de ce texte (voir son Épilogueur Moderne (1752). Entre la rationalité des observateurs, leur profession de foi réformée et la volonté symbolique et mythologique de La Tierce, son déisme, se creuse tout le fossé duquel surgiront les incompréhensions, les volontés de diriger la nouvelle fraternité dans tel ou tel sens, la polymorphie maçonnique, son foisonnement au XVIIIe siècle.
J'avais émis l'hypothèse, il y a fort longtemps dans ma thèse sur le "message maçonnique", que, vers la fin des années 1730, un certain nombre de frères, souvent d'origine huguenote, se répandent sur le continent pour y dispenser la bonne parole maçonnique alors que depuis la mort de l'empereur Charles VI de "grandes manuvres" politiques et militaires sont en train de transformer l'Europe et que les guerres menacent à nouveau de se perpétuer. Ces maçons qui prônent la tolérance, la chrétienté réunifiée, la paix, les sciences et le progrès..., semblent appartenir à un réseau de loges qui provignent, grâce à des frères tous liés à l'Union de Londres, au Portugal et à Paris (John Coustos), en Espagne (Charles de Labeylie), en Saxe (Steinheil, auteur d'un livre fort lu : Le franc-maçon dans la République), en Hollande (Vincent La Chapelle), en Allemagne (De La Tierce), en Russie (le baron Kettler, dédicataire de la traduction de De La Tierce), en Suisse avec James de la Cour Ces loges, marquées par l'origine réformée de nombre de leurs membres, par la personnalité et les discours du chevalier Ramsay, par la pensée de Leibniz, de Fénelon et de Pierre Poiret, par les écrits de l'abbé de Saint-Pierre, confiantes en l'auteur de l'Anti-Machiavel (1740) et partisanes du "plan allemand" de Belle-Isle, avaient pu croire que le sacre de Charles-Albert participerait de la mise en place d'un Saint-Empire redéfini, au-dessus des partis et des querelles de la politique européenne, sur des bases morales, les Lumières et une chrétienté cuménique, tolérante, dépassant les clivages imposés par les réformes et les schismes, un Empire dégagé de l'emprise politique et servant pourtant de charpente aux états séculiers gagnés par l'idéal maçonnique de paix, de fraternité, de tolérance, de vertu et de progrès. Cela n'était possible qu'avec un empereur comme l'électeur bavarois, moins avec un empereur autrichien en raison de la puissance de l'Autriche.
Ces maçons avaient donc pu rêver, l'espace du sacre de Charles-Albert de Bavière (1697-1745), Charles VII, à Francfort, de se placer sous la protection de l'empereur des Romains, de revivifier ainsi cet Empire qui n'existait quasiment plus que pour le décorum. Ils avaient cru rapprocher les hommes de bonne volonté pour parvenir au souverain bien : la paix, fondement de progrès et d'harmonie, une harmonie en définitive inscrite dans le projet divin tel qu'Anderson et Désaguliers l'interprétaient dans l'historique des Constitutions maçonniques de 1723 et qu'avait souligné Louis-François de La Tierce dans sa traduction (1733/1742) présentée en grande pompe à Francfort lors des cérémonies du couronnement de Charles VII. Cette "nation spirituelle", dont parlait déjà le chevalier Ramsay dans son fameux Discours (1736) adressé au Cardinal Fleury, dont la dimension philosophique serait portée par la franc-maçonnerie, dont la chrétienté formerait la substance religieuse et le Saint-Empire la structure fédérative temporelle, cette "nation" ne s'imposerait pas aux états : ses membres, comme le maçon dans sa loge, demeureraient attachés à leur souverain et respectueux de leur religion, comme le prescrivent les devoirs du maçon ! La loge en quelque sorte microcosme d'une organisation appelée à s'étendre au monde.
Ce rêve irénique et philosophique ne devait malheureusement pas résister au poids des réalités : Charles VII meurt dès 1745, la loge l'Union de Francfort, berceau de ces idées, entrera alors en sommeil pour se réouvrir, différente, quelques années plus tard. La franc-maçonnerie se développe dans une extraordinaire diversité le plus souvent peu en rapport avec le sérieux philosophique et politique de frères plus haut évoqués. Frédéric II, pour sa part, se révèle être un foudre de guerre. L'Europe, le monde bientôt avec la guerre de Sept ans seront à feu et à sang.
James de la Cour, journaliste d'origine anglaise, reçu dans la loge londonienne se réunissant à la Three Tuns Tavern dans les années 1730, installé à Francfort après avoir lui aussi semé la "bonne parole" maçonnique telle que nous l'avons interprétée en Suisse et ailleurs, abandonne ses fonctions de secrétaire de loge et de "frère visiteur" dès le milieu du siècle, comme La Tierce qui se retire à Braunfels ou le vénérable de l'union de Francfort von Stockhum qui cesse de maçonner. Charles de Labeylie, Vincent La Chapelle, ces hérauts de la maçonnerie, prennent ou ont pris aussi leurs distances. Les hauts grades, les systèmes et le maquis des obédiences s'imposent aux préoccupations philosophiques. La France ne veut céder en rien de sa politique hégémonique, l'Angleterre et la Russie, l'Autriche et la Prusse sont des puissances belligérantes Dans sa dernière production, Le Nouveau Cordial, James de la Cour, en 1753, défend encore la (vraie) Fraternité en renvoyant aux Constitutions d'Anderson seul texte solide selon lui (comme d'ailleurs l'Épilogueur Moderne (1753) de Rousset de Missy) : "Quoiqu'il en soit, les vrais Francs-Maçons devroient peu s'inquiêter de tous ces efforts de leurs envieux; qu'ils se contentent de tenir leur promesse & pratiquent les Statuts de l'Ordre touchant Dieu, le Souverain, & leur Prochain, avoir une conduite aussi tranquile qu'irréprochable. On les trouve vrais dans l'Histoire, Obligations & Statuts de l'Ordre, imprimés à Francfort chez Varrentrap en 1742 & composés en Anglois par le Dr. Désaiguilliers, & autre par ordre de S. A. le Prince & Duc de MONTAGU, Grand-Maitre en 1720", il ne peut admettre quelque mois plus tard les " Loges Furtives constituées sans vocation & sans autorité par des Maîtres de Passage. Nous mettons dans ce rang la plûpart des Loges de France, constituées après les trois ou quatre premières années que la Maçonnerie y a été portée, & que les Petits- Maîtres ont pertintaillées & défigurées à leur manière, jusqu'à y introduire des Femmes, après qu'ils eurent révélé aux prudentes & secrètes Actrices de l'Opéra & de la Comédie, ce qu'ils avoient attrapé de nos Mystères à la volée; car je puis protester en mon particulier que de trente, je n'en ai jamais trouvé deux qui sçussent nos véritables secrets, ce qui les a sauvés de la publicité. On ne m'alléguera pas toutes les Brochures mal fagotées, qui ont promis de les découvrir. Les vrais Maçons ont tout sujet d'en rire, aux dépens de ces Ecrivains, dont le Public est la Dupe, puisqu'ils ne lui ont raconté que ce qu'ils ne savoient pas & n'ont pû savoir, fût-ce même ce qu'on a publié sous le nom d'un T. Wolson, nom Anglois à la vérité, qu'on a emprunté pour mieux tromper le Public, sans avoir réfléchi qu'un Anglois est incapable d'une action aussi noire & aussi criminelle, indigne du caractère de tout honnête homme. Cette Brochure se réture assez elle-même, & on s'est donné la peine d'en faire connoitre toute la Futilité".
De son côté, Louis-François de la Tierce qui, en 1741, publiait à Francfort une Épître à Frédéric II pleine d'espoir, constatera avec peine son erreur et imaginera trouver plus tard en Catherine II le souverain susceptible de faire triompher ses idées. Il ne vivra plus assez longtemps pour constater que là encore il s'est trompé
François Labbé
Annexe
1. Cliché de la dédicace de la première page du livre des Constitutions de 1723 se trouvant à la bibliothèque d'Eutin (Allemagne ; exemplaire provenant de la bibliothèque de l'évêque de Cologne). On y voit la signature de Désaguliers. La remise de ces constitutions eut lieu en Hollande en 1729.
2. Notice de Prosper Marchand concernant la traduction de La Tierce et l'ouvrage du "zélé" franc-maçon, Rousset de Missy, sa Lettre d'un Franc-Maçon de la loge de St Louis de Nimègue (1752)
S'il faut en croire le Sr. Rousset de Missy, zélé Franc-Masson, dans sa Lettre d'un Franc-Maçon de la loge de St Louis de Nimègue au vénérable Everhard Havercamp, ministre ds la même ville, traduite du hollandais et imprimée dans le Monde Franc-Maçon aux dépens de l'ordre et des lecteurs curieux, MDCCLII. 3737, p. 155, cette Histoire, Obligations et Statuts, de la vénérable c.fraternité desFrancs-maçons, tiréz de leurs Archives et conforme aux Traditions les plus anciennes, approuvez Dans toutes les grandes Loges, et mis au jour pour l'Usage commun des Loges répandues sur la Surface de la Terre, et imprimez à Francfort sur le Meyn chés François Varentrap en 1742, avec Approbation et Privilège en 283 pages in 8 (?) préliminaires ; et de la Commission du Docteur Désaguliers, Membre de la Société Royale d'Angleterre et composé par Ordre du Duc de Montaigue Grand Maître après l'avoir vue plusieurs fois en (?) à Londres.
3. Extrait de la Lettre d'un Franc-maçon de la loge de S. Louis de Nimègue (par Rousset de Missy)
"[ ] c'est leur Secret qui révolte contr'eux, qui ? des curieux, qui peuvent l'aprendre à tous moment s'ils sont gens de Probité & de bonnes murs, qualités requises pour être admis. Mais pourquoi ces Messieurs produisent-ils contre nous, les Ouvrages d'un infame Moine, qui s'est sauvé de Florence avec une Religieuse, qu'il est venu prostituer à Amsterdam au premier venu, & qui avoue qu'il n'a jamais été reçu Maçon en Loge régulière & constituée suivant nos Statuts ? que ne se servent-ils de nos propres armes pour nous combattre, nous les leur mettons en main ; C'est le Livre des OBLIGATIONS ET STATUTS DE LA TRES - VENERABLE CONFRATERNITE DES FRANCS -MAÇONS, tirés de leurs Archives & conformes aux Traditions les plus anciennes. Ce n'est pas un Avorton, ce n'est pas un Livre sans aveu, c'est l'ouvrage d'un Savant distingué dans la République des Lettres, par ses Talens, & dans la Société civile, par sa Probité, qui l'a composé par ordre exprès de Mylord Duc de MONTAGU, très vénérable Grand - Maître*, & qui a été a prouvé de S. A. & de toutes les grandes Loges, & imprimé (t) pour l'usage des Loges *) Plusieurs fois en Anglois à Londres; en François à la Haye, aux dépens de la Gr. Loge, dont étoit Maitre Mr. Rademacker, Trésorier des Domaines de S. A. S. le Prince d'Orange, & enfin à Francfort sur le Meyn in 8 chez Varentrap, en 1742 pour l'usage des loges répanduës sur la surface de la Terre. Que Messieurs du Consistoire de Nimègue se donnent la peine de lire Nos STATUTS, depuis la page 145 jusqu'à 194 de l'Edition de Francfort, & qu'ils jugent en fuite si des personnes qui suivent ces règles, méritent d'être excommuniées, pendant qu'on reçoit de la Ste. Table tant de mauvais Patriotes, tant d'Usuriers, tant d'Avares, tant d'Adultères, tant de Détenteurs du bien de la Veuve & de l'Orphelin, & c. & c. & c. connus pour tels abstractivement des on dit, mais par leur conduite au vu & scu de toute une Ville. Ce Livre devroit être remis aux Sgrs. de la Cour de Gueldres, qui y trouveront tout ce que le Moine Florentin & les autres calomniateurs ont raporté de Vrai, parce qu'ils l'ont copié dans cet ouvrage, qu'ils ont brodé des calomnies les plus atroces, sans avoir apris à leurs Lecteurs, qui ont été leurs dupes, ce que c'est que le véritable Secret des Francs - Maçons, parce qu'ils ne l'ont pu savoir, n'aiant jamais été reçus en Loge régulière. L'Equité connue des Seigneurs de cette Noble Cour ne permet pas de penser qu'ils voulurent condamner, sur le contenu de ces Libelles, l'Empereur, le Pape, les Rois de la Grande Bretagne (entr'autres l'immortel Guillaume III), le Roi de Prusse, tous les Sgrs. de sa Cour, la plupart des Princes de l'Empire, tous les Princes du Sang de la Cour de France,tout le Parlement de la Gr. Bretagne, la plupart de les Evêques, enfin tant de braves Officiers Généraux & autres & c. & c. qui sont Francs-Maçons.
4. Le Frère de La Tierce in Le Perroquet, ou Melange de diverses pieces interessantes pour l'esprit et pour le cur. Tome I 1741, semaine II, pp.27-29, Francfort chez François Varrentrapp.
Epitre au roi de Prusse
EPITRE A Sa Majesté le Roi de Prusse.
Jeune & sage Héros qui seul par Toi même,
Soutiens sans T'étonner le faix du Diadème"
A faire des heureux bornant tout Tes souhaits,
Tu Te plais à compter Tes jours par Tes bienfaits,
A peine regnes Tu, d'abord Ta prévoïance,
En dépit des Hivers rétablit l'abondance.
Le Commerce dans Toi trouvant un ferme appui,
Enrichit le Marchand & l'Etat avec lui.
Tu rends le Laboureur aux champs qui l'ont vù naître.
Et qui depuis longtems regrettoient leur vieux maître
Ainsi dans l'Age d'or, ô Rois, amis des Dieux,
Vous fîtes voir à l'Homme une immage des Cieux
Des Monstres, dont le souffle infestoit l'air & l'onde,
Vos traits victorieux sûrent purger le Monde.
L'Equité de vos Loix, la douceur de vos murs.
Des Peuples enchantez, vous soumirent les curs.
En foule au tour de vous s'élevèrent des Villes,
Des Vertus & des Arts sacrez & sùrs Asyles.
Joïeuse d'obéir à d'innocentes mains,
La Terre de Tes dons fut prodigue aux Humains.
Que nous serions heureux si des sombres abimes,
Leur art n'avoit enfin tiré l'or & les crimes
Alors le noir chagrin respectoit leurs plaisirs,
Et le peu qu'ils avoient égaloit leurs désirs.
Mais bientôt éclata la pompeuse Opulence,
Et du Pauvre et du Riche on fit la différence.
Les Honneurs jusques là dessinez aux vertus.
Furent à la richesse indignement vendus.
La misere enchaina le noble essor de l'Ame;
Du courageux Génie, elle éteignit la flamme,
Et dédaignant de plaire au superbe Ignorant,
Il cessa d'enfanter rien d'utile & de grand.
Ce désordre est banni de Ton auguste Empire,
FRÉDÉRIC, & mes Vers s'empressent à le dire,
Ton Goût savant & sûr favorise les Arts,
Tu les sais réunir avec celui de Mars
Déjà sans qu'un long âge ait mûri Ta prudence.
Elle supplée en Toi la lente expérience.
A l'ombre de la Paix Tu formes Tes Guerriers,
A courir sur Tes Pas moissonner des Lauriers.
On ne Te verra point, tel qu'un foudre à leur tête,
Voler injustement de conquête en conquête.
Content de maintenir la justice et Tes droits,
Contre l'ambition qui braveroit les Loix
Tu n'auras pas plûtôt mis un frein à sa rage,
Que Tu feras cesser les horreurs du carnage.
La tendre Humanité toujours guide un Vainqueur
Qui, comme Toi, connoit la solide Grandeur :
On a beau lui vanter les exploits d'Alexandre,
Lui nombrer les Citez qu'il réduisît en cendre,
Les Monarques vaincus; les Peuples subjuguez;
Leurs Thrésors qu'il ravit, au Soldat prodiguez:
Alexandre à ses yeux au sein de la Victoire,
N'est qu'un fou qu'à son char trainait la fausse Gloire-
Et loin de convenir qu'on dût l'appeller Grand.
Il ne rencontre en lui qu'un illustre Brigand.
Un Roi juste & qui pense est le seul respectable
Ses conseils éclairez le rendent redoutable :
Et de la vérité généreux Protecteur,
Il impose silence au perfide Flatteur.
Franc-Maçon, je déteste un Si vil caractère ;
Mais des éloges vrais qui m'oblige à les taire ?
Ou crois-Tu que tenant l'Equerre & le Compas
J'aïe en Toi pris pour grand, ce qui ne l'étoit pas ?
Non non, un Frère ami de la Vérité nuë,
Ne sait permettre qu'elle à sa bouche ingenuë:
Et si Tes actions pouvoient le démentir,
Jamais à Te louer il n'eut pû consentir.
Le Frere de la Tierce
Notes :
Les Constitutions d'Anderson, Romillat, Paris, 2002. "Les origines de la Franc-maçonnerie", par Charles Porset, p. 233-247.
La seconde édition de 1745 ajoute d'ailleurs un volume contenant les apologies et les chansons alors les plus célèbres.
Alors que la loge L'Union se donne des statuts et acquiert tout ce qui est nécessaire à ses cérémonies (une table en noyer, des nappes brodées, une bible en maroquin noir ) le 29 mars 1742, le 2 mai, la traduction est proposée au public dans un coffret de bois et apparaît tout de suite comme un ouvrage d'érudition, une curiosité bibliographique. Voir François Labbé, "Le rêve irénique du Marquis de la Tierce", in : Francia, 18/2, 1991, p. 47 à 69, et Le message maçonnique au XVIIIe siècle, Dervy, 2006. Prosper Marchand est un libraire et érudit français (1678 et 1756) auteur et journaliste (en particulier un des principaux rédacteurs du célèbre Journal Littéraire). Rousset de Missy (1686-1762) est également un juriste, journaliste (Mercure historique et politique entre autres) et écrivain réfugié aux Provinces-Unies. Franc-maçon important : en 1752, il se dit "Maître de la loge d'Amsterdam". Il a travaillé pour l'Autriche. Notons que Rousset de Missy "zélé franc-masson", comme l'indique Prosper Marchand sur la fiche qu'il a consacré à l'ouvrage de la Tierce (Universitätsbibliotheek Leiden, 654, G21/2, voir la photo en annexe), s'exprime quant à lui positivement sur cette traduction dans sa Lettre d'un Franc-maçon de la loge de Saint-Louis à Nimègues au vénérable, pieux et savant Everhard Haverkamp, 1752, lettre écrite pour répondre à un sermon dans lequel ce pasteur attaquait la confrérie, se basant sur les révélations du moine Bottarelli ou de Pérau. Rousset oppose le sérieux du texte des Constitutions et de leurs traductions aux incohérences du Secrets des Francs-Maçons. Missy y soutient aussi les opinions de l'auteur du Vatican vangé (La Haye, 1752 par le Chevalier de Lussy = le baron de Tschoudy), une défense de l'ordre des francs-maçons ironique et solide.
La Tierce ne veut pas faire uvre d'historien : il accentue l'aspect légendaire et mythique de la confraternité pour lui donner une origine plus universelle. On se reportera à Les Constitutions d'Anderson, op. cit. note 1 : F. Labbé, "Louis-François de la Tierce", p. 249-284.
F. Labbé, op. cit., note 3, p. 101 et suiv.
E. Tourneux, Reprint Kraus, 1968, T. I, p. 75.
Lui-même initié à Berlin en 1741 dans la loge est reçu aux Trois Globes de Berlin. Il est possible que l'exemplaire acquis par Marchand ait servi à De La Chapelle.
Labbé, article cité, note 4.
http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/1006-nouvelle-bibliotheque-ou-histoire-litteraire-1
Lettre à La Motte, datée du 11 février 1743, citée en partie par le Dictionnaire des Journaux.
Dans la livraison précédente (mai), la Nouvelle bibliothèque signale la toute récente parution de la traduction adaptation de de la Tierce, non sans ironie et elle figure dans le catalogue des livres nouveaux chez Pierre Paupie.
Les documents que j'ai publié (Les constitutions ) et les archives des princes de Solms à Braunfels prouvent qu'il s'agit bien de son véritable nom. En revanche, il ne m'a jamais été possible de localiser ses origines autrement que par ce qu'il en dit ou par ce que le comte Degenfeld en rapporte. Les ancêtres dont il parle sont introuvables pas plus que son père, général de brigade tué à Ramillies Il n'existe à Vincennes qu'une demande de pension du début du 18e siècle d'une dame de la Tierce.
De Thémiseul de Saint-Hyacinthe publié en 1714 avec de nombreuses rééditions et modifications, auquel Prosper marchand a participé.
Il s'agit probablement de Théophile Desaguliers (1683-1744) qui en 1725 faisait partie de la loge londonienne The Horn et fut la cheville ouvrière du Livre des Constitutions rédigé par Anderson. Ce physicien célèbre (le terme de "mathématicien" avait alors un sens très large) se rendit plusieurs fois en Hollande pour des raisons maçonniques comme lors de la réception de François de Lorraine à La Haye en juin 1731(voir annexe 1).
L'édition de 1742 (la seule qui puisse être ici relatée) aurait-elle été une 2e édition ? Sinon, l'auteur fait allusion à la traduction de Kuenen dont il sera question plus loin (note 21). Voir la fiche de Prosper Marchand en annexe (Université Leyden, Bibliothèque, Papiers Marchand, 654 G212).
Le critique ne note pas qu'il s'agit du texte du discours du Chevalier Ramsay, déjà très répandu. Dans sa réorganisation du texte andersonien, les discours préliminaires scindent l'histoire, d'une manière très symbolique en trois parties.
William Tyndale (1494-1536) traducteur de la première édition anglaise imprimée de la Bible, et la première Bible protestante, défi lancé à l'autorité de l'Église catholique et à la législation religieuse anglaise du temps.
Horace, Art Poétique Devant un pareil tableau, pourriez-vous, ô mes amis, vous empêcher de rire ?"
Reprise sous forme condensée par Dervy en 2002 (2e éd.), réédition actualisée aux Éditions Complicités, Paris, printemps 2023.
François de Lorraine avait certes été reçu franc-maçon en Hollande, mais il était l'époux de Marie-Thérèse ! Sur tous ces faits, voir François Labbé, "Le rêve irénique du Marquis de la Tierce. Franc-Maçonnerie, lumières et projets de paix perpétuelle dans le cadre du Saint-Empire sous le règne de Charles VII (1741-1745)", op. cit, et la postface de F. Labbé in : Les constitutions maçonniques, 2e édition, Romillat, Paris, 2002. Voir aussi l'Histoire de la guerre de 1741 de Voltaire et le projet qu'il prête à Belle-Isle.
Voir à ce propos l'intéressant article du No 1 (1er janvier 1745) de son journal Nouvelles amusantes. Il habite alors la Ziegelgasse chez le chirurgien Ruckman.
Amusemens historiques, no 9, pp. 70 et suivantes, 1753.
Amusemens, no 3, 1755.
Janvier 1741, le Perroquet de Varrentrapp. Dans cette Épître, il se proclame maçon et certain que le jeune roi de Prusse ne se lancera jamais dans des guerres de conquêtes (voir annexe 4).
Voir son poème Le Temple de la Gloire (1771)
Il s'agit de Giovan Gualberto Bottarelli, auteur de Les secrets de l'ordre des Francs-Maçons dévoilés et mis au jour, Amsterdam, 1745 (à ne pas confondre avec le livre de l'abbé Pérau : Le secret de l'ordre des Francs-Maçons avec un recueil de leurs chansons, S.l., 1744) et peut-être des Francs-Maçons écrasés sous le nom de Larudan. Certaines bibliographies lui attribuent aussi L'ordre des Franc-Maçons trahis dont l'auteur est généralement reconnu comme étant l'abbé Gabriel Pérau (voir Casanova qui le rencontra à Londres en 1763. Son épouse lui fit cadeau de son livre Les secrets ).
*Le Docteur Désaguliers, Mathématicien célèbre, membre de la Société Roiale d'Angleterre, qui a eu l'honneur de recevoir Franc-Maçon, S. A. R. François Duc de Lorraine, à présent Empereur des Romains.
**Plusieurs fois en Anglois à Londres; en François in 4 à la Haye, aux dépens de la Gr. Loge, dont étoit Maitre Mr. Rademacker, Trésorier des Domaines de S. A. S. le Prince d'Orange, & enfin à Francfort sur le Meyn in 8 chez Warentrap, en 1742.
Edition de la traduction de Jan Kuenen, Constitutions, histoires, loix, charges, reglements et usages, de la tres..., La Haye, Van Zanten, 1736.
Louis François De La Tierce: essai de bio-bibliographie
On peut enfin se demander qui pouvait être cet homme qui a fréquenté les plus grands, auquel les maçons londoniens ont confié la traduction du livre des constitutions maçonniques, qui a obtenu sans difficulté de l'empereur Charles VII, à quelques semaines du sacre, en pleine guerre, un privilège d'impression pour un journal français destiné au service de la chose publique". Les réponses sont encore insuffisantes et insatisfaisantes.
D'origine protestante, fils d'un brigadier des armées mort à la bataille de Ramillies en 1704, une lettre de recommandation assure qu'il est originaire du Brabant français. Il dit appartenir à une famille dont les origines remontent jusqu'à l'époque de la cour du Roi Boson en Arles. Cette affirmation sur laquelle il s'appuie quand il sollicite un préceptorat auprès des princes de Solms est probablement légendaire mais, bien qu'il ne soit apparemment nulle part question d'un marquisat de la Tierce, il était certainement de bonne naissance". En effet, il aurait séjourné à Versailles vers 1717, y aurait rencontré Pierre Le Grand et a probablement suivi des études d'ingénieur. Très jeune, il quitte la France, persuadé, dit-il que la fille aînée de l'Église ne saurait préparer un avenir digne à un gentilhomme professant la religion réformée. Selon son protecteur le comte Degenfeld-Schonburg, il aurait d'abord tenté sa chance dans le Nord de l'Allemagne ou plus sûrement de la Hollande, dans le Wattenland, puis il passe en Angleterre, vraisemblablement dans la seconde moitié des années 1720. A Londres où il séjourne, il fréquente certainement les milieux réfugiés et ne peut manquer de rencontrer Désaguliers, le pasteur d'origine rochelaise (né en 1683), un des fondateurs de la franc-maçonnerie moderne et un des rédacteurs du livre des constitutions. D'ailleurs, il est très vite initié, et un initié particulièrement considéré puisque, dès le début des années trente, on lui confie la traduction des constitutions maçonniques pour en donner la version universelle, en langue française, traduction terminée dès 1733 mais qui ne sera publiée (augmentée et amendée des années après). Il fréquente aussi la haute noblesse du pays, les Strafford par exemple chez lesquels il est un temps le précepteur de William Wenworth, 2e comte de Strafford; il est lié au baron Gotthart Kettler, appartenant à une ancienne famille de Courlande, initié en Angleterre et qui participera à la mise en place en Russie d'une loge particulièrement réservée aux écrivains russes.
Il retourne sur le continent, en 1733, en compagnie de l'envoyé prussien Christoph Martin von Degenfeld-Schonburg (1689-1762), futur général et ministre de la guerre, comte d'empire, avec lequel il restera toujours en contacts, qu'il accompagnera à Berlin (il sera reçu à la cour) et dont il assurera le préceptorat du fils aîné Auguste-Christophe. Il fréquente aussi les Kolbe de Wartenberg également très liés au Saint-Empire Romain Germanique et, comme les Degenfeld, amis des Strafford (La British Library conserve de très nombreuses lettres).
Vers 1737-1738, il sera en Autriche pendant la dernière guerre austro-turque, peut-être à Orsawa lors du siège, sans doute comme ingénieur militaire: sa lettre aux Strafford indique qu'il occupe alors une position assez importante. Il conservera des liens avec les personnalités autrichiennes de haut rang liées au devenir du Saint Empire Romain, comme le prouvent ses lettres adressées en 1759 au comte Johann Anton Pergen pour obtenir de celui-ci un passeport destiné à son neveu Frédéric Guillaume de Reitzenstein. Tous les personnages avec lesquels il entretient des relations ont été mêlés aux conflits contre la Turquie ou aux discussions diplomatiques avec la Porte.
On le retrouvera quelques années plus tard parmi les cavaliers"qui accompagnent le comte de Belle-Isle à Francfort aux cérémonies du sacre fin 1741. Il profite de l'événement (la grande loge londonienne ne peut l'ignorer puisqu'il restera en contact avec elle et sera celui qui sollicitera les patentes de la loge L'Union qu'il vient d'ériger avec quelques autres) pour publier sa traduction. Il ne s'est contenté ni de l'original de 1723 ni de la seconde édition de 1738: il y a ajouté son génie propre : découpage différent, discours intermédiaires, notes curieuses". La tendance déiste de sa version est indéniable et, en même temps, la part faite au célèbre Discours du chevalier Ramsay y apporte une dimension cuménique (qui ne doit pas étonner de la part d'un réformé) et un hymne au progrès scientifique. Le livre est présenté publiquement alors que la loge l'Union vient de se constituer et rassemble des personnages considérables liés aux différentes légations venues célébrer le sacre de Charles VII, un Wittelsbach, qui met fin en apparence à la domination des Habsbourg et semble donner à la couronne du Saint Empire une nouvelle aura. Au même moment, De La Tierce sollicite l'empereur (officiellement le 21 mars) pour obtenir de lui le privilège d'imprimer un journal (privilège de 10 années) dans la ville impériale de Hambourg, la Gazette impériale, ce qui lui est presque immédiatement accordé :
" Au plus Sérénissime, Tout puissant et Invincible Empereur Romain, Roi en Germanie et en Bohême, à l'Empereur, au Roi, au Seigneur
Votre majesté impériale et royale a daigné avoir l'indulgence de prendre connaissance des projets que je me suis fixés, autant par amour de la vérité et de la chose publique, que par un zèle particulier envers votre maison royale et impériale pour propager son fameux gouvernement et ses exploits glorieux, de me rendre Hambourg pour y faire paraître un journal en langue française, quatre fois par semaine, sous format in-quarto, deux fois sur un demi folio et les deux autres sur un quart de folio. Comme les journaux français en Allemagne sont peu courants et ne peuvent être livrés qu'à des coûts importants du fait de leur provenance de lieux étrangers au grand dam de la patrie allemande, une telle entreprise servira d'autant mieux la chose publique que de ces journaux sincères et véritables pourront être livrés à bon marché à partir d'un centre aussi bien situé pour la correspondance que Hambourg. Cela engendrera à mon encontre des frais considérables, et je dois encore craindre que cette entreprise ne soit jalousée et menacée et que mes journaux français ne soient réimprimés par d'autres ou que des journaux semblables créés sous différents prétextes ne viennent me causer du tort. Je prie donc Votre Majesté Impériale romaine et Royale de renoncer aux taxes et frais de port habituels en m'octroyant un privilège impérial d'une durée de dix ans se rapportant à ce journal français intitulé Gazette Impériale de Hambourg, publié à Hambourg et distribué sans obstacles dans tout le Saint Empire Romain quatre fois par semaine, sous format in-quarto, deux fois sur un demi folio et les deux autres sur un quart de folio, mais aussi de sévir contre toute copie et non-respect du privilège impérial par des mesures sévères.
Une telle grâce impériale sera l'objet de mes remerciements les plus humbles tout au long de ma vie ( ).
Malheureusement, les menées de la Prusse, la politique française après la mort de Fleury, les changements en Angleterre, le ressentiment en Autriche font que ce couronnement (Frédéric II a commencé ses grandes manuvres!) précède de peu la catastrophe.
On sait ce qu'il adviendra de ce règne. Charles VII meurt très vite après avoir été le jouet des appétits autrichiens et prussiens, du machiavélisme français et anglais, probablement de ses propres incompétences. Alors que certains maçons voient dans ce couronnement le début d'une nouvelle ère dans laquelle le Saint-Empire renouvelé, dégagé des événements, au-dessus de la mêlée politique, rendrait possible une Europe réconciliée, nouvelle ère dans laquelle les francs-maçons et leur philosophie auraient un rôle important à jouer, les puissances se déchaînent et les nations se lancent dans une suite de conflits, chacune voulant imposer sa prééminence à l'autre.
Juste à son arrivée sur les bords du Rhin, avant le sacre, il avait clamé son enthousiasme maçonnique dans une ode adressée au tout jeune roi de Prusse et publiée dans Le Perroquet. Il pensait encore que ce souverain philosophe, l'auteur de l'Anti-Machiavel allait transformer l'Europe dans le sens des attentes maçonniques : une chrétienté unie et tolérante dans un monde de paix, de fraternité, de progrès et de vertu.
Epitre A Sa Majesté le Roi de Prusse signée "Le Frère de la Tierce",
Jeune & sage Héros qui seul par Toi même,
Soutiens sans T'étonner le faix du Diadème"
A faire des heureux bornant tout Tes souhaits,
Tu Te plais à compter Tes jours par Tes bienfaits,
A peine regnes Tu, d'abord Ta prévoïance,
En dépit des Hivers rétablit l'abondance.
Le Commerce dans Toi trouvant un ferme appui,
Enrichit le Marchand & l'Etat avec lui.
Tu rends le Laboureur aux champs qui l'ont vù naître.
Et qui depuis longtems regrettoient leur vieux maître
Ainsi dans l'Age d'or, ô Rois, amis des Dieux,
Vous fîtes voir à l'Homme une immage des Cieux
Des Monstres, dont le souffle infestoit l'air & l'onde,
Vos traits victorieux sûrent purger le Monde.
L'Equité de vos Loix, la douceur de vos murs.
Des Peuples enchantez, vous soumirent les curs.
En foule au tour de vous s'élevèrent des Villes,
Des Vertus & des Arts sacrez & sùrs Asyles.
Joïeuse d'obéir à d'innocentes mains,
La Terre de Tes dons fut prodigue aux Humains.
Que nous serions heureux si des sombres abimes,
Leur art n'avoit enfin tiré l'or & les crimes
Alors le noir chagrin respectoit leurs plaisirs,
Et le peu qu'ils avoient. égaloit leurs désirs.
Mais bientôt éclata la pompeuse Opulence,
Et du Pauvre et du Riche on fit la différence.
Les Honneurs jusques là dessinez aux vertus.
Furent à la richesse indignement vendus.
La misere enchaina le noble essor de l'Ame;
Du courageux Génie, elle éteignit la flamme,
Et dédaignant de plaire au superbe Ignorant,
Il cessa d'enfanter rien d'utile & de grand.
Ce désordre est banni de Ton auguste Empire,
FRÉDÉRIC, & mes Vers s' empressent à le dire,
Ton Goût savant & sûr favorise les Arts,
Tu les sais réunir avec celui de Mars
Déjà sans qu'un long âge ait mûri Ta prudence.
Elle supplée en Toi la lente expérience.
A l'ombre de la Paix Tu formes Tes Guerriers,
A courir sur Tes Pas moissonner des Lauriers.
On ne Te verra point, tel qu'un foudre à leur tête,
Voler injustement de conquête en conquête.
Content de maintenir la justice et Tes droits,
Contre l'ambition qui braveroit les Loix
Tu n auras pas plûtôt mis un frein à sa rage,
Que Tu feras cesser les horreurs du carnage.
La tendre Humanité toujours guide un Vainqueur
Qui, comme Toi, connoit la solide Grandeur :
On a beau lui vanter les exploits d'Alexandre,
Lui nombrer les Citez qu'il réduisît en cendre,
Les Monarques vaincus; les Peuples subjuguez;
Leurs Thrésors qu'il ravit, au Soldat prodiguez:
Alexandre à ses yeux au sein de la Victoire,
N'est qu'un fou qu'à son char trainait la fausse Gloire-
Et loin de convenir qu'on dût l'appeller Grand.
Il ne rencontre en lui qu'un illustre Brigand.
Un Roi juste & qui pense est le seul respectable
Ses conseils éclairez le rendent redoutable :
Et de la vérité généreux Protecleur,
Il impose silence au perfide Flatteur.
Franc-Maçon, je déteste un Si vil caractère ;
Mais des éloges vrais qui m'oblige à les taire ?
Ou crois-Tu que tenant l'Equerre & le Compas
J'aïe en Toi pris pour grand, ce qui ne l'étoit pas ?
Non non, un Frère ami de la Vérité nuë,
Ne sait permettre qu'elle à sa bouche ingenuë:
Et si Tes actions pouvoient le démentir,
Jamais à Te louer il n'eut pû consentir.
Dès 1743, De La Tierce a quitté Francfort où il a épousé une jeune fille des meilleures familles de la ville, les barons de Barckhausen, qui ont logé l'empereur pendant son séjour. Il s'est probablement rendu à Hambourg où il essaye de publier son journal protégé par l'empereur : la Gazette Impériale, puis il s'installe à Mettenheim chez le comte Kolbe von Wartenberg, futur ministre. Ses relations lui permettent d'entrer au service du prince Frédéric Guillaume de Solms-Braunfels : une lettre du comte Degenfeld du 16 septembre 1744 adressée à ce haut et puissant"personnage intercède pour lui. On ne s'éloigne pas beaucoup du cercle des proches du nouvel empereur : les Solms-Braunfels viennent d'être élevés le 22 mai 1742 à la dignité de princes d'empire par l'empereur Charles VII ; Ferdinand Guillaume Ernest, le frère de Frédéric Guillaume, servira dans le Royal-Allemand, sera un ami et protégé du maréchal de Belle-Isle et deviendra l'adjudant-général de Charles VII !
Louis-François de La Tierce acquerra une honnête fortune, bien qu'en 1770 il doive écrire une supplique pour qu'on respecte ses droits (sa superbe maison de Braunfels, au pied du château, existe toujours) et, à sa mort, sans enfants, son legs servira à mettre en place une fondation au bénéfice des personnes âgées. Cette fondation est encore vivante sous la forme d'une maison de retraite destinée aux plus démunis.
Apparemment, après son séjour francfortois, il ne maçonnera plus. Déception? Interdiction? Il est impossible de donner une réponse. Pourtant, j'ai pu montrer que, dans ses écrits futurs, il restera fidèle à ce qui, selon lui, dans sa traduction des constitutions, caractérise la confraternité: l'union de tous les chrétiens pour propager dans le monde - mais sans violence et avec tolérance - la parole d'un Dieu qui laisse toute sa liberté à l'homme, la croyance dans le progrès scientifique et technique, la foi dans l'amélioration morale des individus, la paix considérée comme le bien suprême.
*
Les textes et documents de L.-F. de La Tierce ou se rapportant directement au personnage historique que nous possédons sont les suivants:
- 1738 - Une lettre adressée de Mettenheim, la résidence des comtes de Wartenberg en 1738 à Thomas Wenworth, earl of Strafford (Add.MS. 31140, f. 347) :
Monsieur, J'ai reçu une lettre de M. votre fils depuis la reddition d'Orsava, dont il n'a pas signé la capitulation. Le long blocus de cette place a retardé jusqu'ici la conclusion de sa promotion à une compagnie. Cette affaire est à présent renouée, et je compte que M. le comte de Degenfeldt en aura écrit de nouveau à S.A. le prince Max de Hesse-Cassel. En attendant Monsieur vous feriez une grande grâce à M. votre fils, si vous vouliez bien écrire en sa faveur à M. Robinson ministre de sa majesté Britannique à la cour de Vienne, il est constant que ce gentilhomme peut fortement recommander M. votre fils, déjà recommandable par sa bravoure et par sa bonne conduite pour être avancé.
Sans doute M. Schelle aura remis à M. Spellerberg les 40 L. dont il y avait erreur dans les comptes au désavantage de m. votre fils qui me demande encore un éclaircissement á ce sujet.
Je profite avec plaisir de cette occasion pour vous réitérer la respectueuse considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur De La Tierce,
Mettenheim, le 19 octobre 1738 ns."
- Ode au souverain de Prusse, in : Le perroquet, ou Mélange de diverses pièces intéressantes pour l'esprit et pour le cur. Tome I 1741, semaine II, pp.27-29, Francfort chez François Varrentrapp (l'éditeur de textes maçonniques et de la traduction des Constitutions).
- 1742 (1733) - Histoire, Obligations et Statuts de la très vénérable confraternité des Francs-Maçons, tirés de leurs archives et conformes aux traditions les plus anciennes, A Francfort sur le Meyn, Chez François Varrentrapp, 1742, Avec Approbation et Privilège.
- 1742 - Nouvelle bibliothèque ou Histoire littéraire des principaux écrits qui se publient, À La Haye, Chez Pierre Paupie, Juin 1742.
"[ ] l'Auteur, de cet Ouvrage se donne le nom de Frère de la Tierce, qui est sans doute son nom de guerre dans les beuvettes de la Confraternité. Je ne sai (sic) néanmoins quel Mystère il entend à se masquer de la sorte aux yeux du Public, car je ne vois pas qu'il garde les mêmes ménagements pour ses confrères, qu'il désigne tous par les noms de famille sous lesquels ils sont connus dans le monde ; ne faisant même aucun scrupule d'y ajouter celui de leur Baptême. Son Approbateur est le Frère Friard, Secrétaire de la loge des François (Refugiez), à Londres dans le Rue de Suffolk à l'enseigne du Duc de Lorraine. Il dit à la Page 164. que le très noble Prince Jean Duc de Montagu, ayant été élu Grand-Maitre, en I72I. Il nomma Jean Beal, Docteur en Médecine, son député Grand-Maitre, & que la Grande loge élut Mr. Villeneau, premier Grand Surveillant, & Mr. Thomas Morris, second Grand Surveillant. C'est par tout ailleurs la même Méthode, & d'où vient que le Frère de la Tierce est ici le seul qui ait honte de se faire connaitre. Seroit il possible, ou que son vrai nom déshonorât la confrairie, ou que la confrairie ne fit pas assez d'honneur à ce nom ? Assurément, ce n'est pas de son Ouvrage même qu'il peut avoir crû qu'il eût à rougir. Car s'il s'y agit en gros de faire l'éloge de la Maçonnerie, se peut-il de plus beau sujet ? Un Art noble, un Art Royal, & qu'elle n'est point encore la magnificence des Epithètes qu'il lui donne ? Les Savans qui se sont amusez à faire le Panégyrique de Néron, de l'Ane, de la Folie, avoient des raisons bien plus naturelles de demeurer Pseudonymes. Cependant ils ont eu l'audace de se nommer, Le Frère de la Tierce seroit-il plus modeste ou plus timide que ces Messieurs là ? D'ailleurs, il a tellement rehaussé sa matière par l'Art dont il l'a enrichie, qu'un Ouvrier si habile n'auroit pas dû envier au Public le plaisir de le connaitre. Le fameux Ecrivain du Chef d'uvre d'un inconnu n'en a pas approché, quelque immortel qu'il se soit rendu par son spirituel, & avant Commentaire sur une vieille Chanson du Pont-Neuf. Ici vraiment c'est bien une autre profusion d'esprit & de savoir. On s'y promène au large dans tous les Païs, dans tous les tems, dans tous les arts, dans toutes les sciences. On y voit l'abrégé de l'Histoire universelle. La Chaldée, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, le Pérou, le Mexique, les Migrations des premiers Habitans de la Terre, l'Origine des Villes, leurs Fondateurs, leurs Murailles, leurs Edifices, des Colonnes, des Statues, des Arcs de Triomphe, des Inscriptions, des Epitaphes, des Passages de l'Ecriture expliquez, des Observations profondes de Littérature, de Critique, d'Antiquariat. O que de belles choses ensemble ! II est vrai qu'après avoir bien lû on est fort étonné de n'avoir rien appris, sur tout de ce que l'on cherche. Apparemment que ce n'est pas la faute du Frère de la Tierce. Il faut croire que plutôt celle de la Société qui ne veut pas, & qui peut-être craint d'être connuë, & qui se joue ainsi du Public à lui Conter des Balivernes. Quel autre Titre donner en effet, à toute la partie Historique que ce Volume renferme ? Tout s'y termine à équivoquer, perpétuellement, sur les termes en insinuant qu'il y a eu des Loges de Francs-Maçons, dans tous les tems, & dans tous les lieux du monde, où l'on a bâti de Brique, ou de Pierre, & où par conséquent il y a eu de la Maçonnerie. Je n'en donnerai pour preuve que ces paroles du Discours Préliminaire à la Page 13. "On peut conjecturer que, les premiers Habitans de l'Amérique, y sont venus, les uns des extrémités, Orientales de l'Asie, &les autres des côtes Occidentales de l'Europe & de l'Afrique. C'est un fait constant que les Carthaginois y ont envoyé des Colonies. Les Conjectures semblent d'autant mieux fondées que la plûpart des Migrations des Peuples s'étant faites, au commencement, par Mer, ils n'auront point tardé à chercher de nouveaux Païs, dès que ceux de notre Continent se seront assez peuplez. Quoi que les Principes fondamentaux de l'Art-Royal, fussent presque entièrement oubliez dans ce nouveau Continent, lorsque Christophe Colomb en fit la découverte, les Empires du Mexique & du Pérou ne laissoient pas d'avoir encore bon nombre de Loges & des Edifices magnifiques & curieux." Donc il y a eu des Loges de Francs-Maçons dans le Mexique & dans le Pérou, parce qu'il y a eu des Edifices. Donc encore l'Historien a prétendu que de la Maçonnerie, en général, on conclut à l'existence particulière de la Franche - Maçonnerie & à celle des Loges de cette dernière.[ ]"
- 1745 - 2e édition, Histoire des francs-maçons, contenant les obligations et statuts de la... maçonnerie [un recueil de pièces apologétiques pour le très-vénérable ordre de la maçonnerie, avec une compilation de toutes les pièces de poésies qui ont été faites jusqu'à ce jour à ce sujet et un recueil des chansons... qui se chantent en loges et hors des loges, par le Frère de la Tierce, à l'Orient, chez G. de l'Etoille entre l'Equerre et le Compas, vis-à-vis le soleil couchant (en réalité cher F. Varrentrapp, Francfort), 1745 (avec la Chanson qu'un Franc-Maçon peut chanter à table et hors de la loge, attribuée à La Tierce)
- 1742 - La demande de privilège pour la Gazette Impériale. (Österreichisches Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchivs Impressoria 71, 2. Konv. Nr. 62 - cf. documents ci-joints)
- 1742 - Le privilège (cf. documents ci-joints) (Österreichisches Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchivs Impressoria 71, 2. Konv. Nr. 62.)
- Krönungsdiarium Karls VII.- Vollständiges Diarium von den merckwürdigsten Begebenheiten, die sich vor, in und nach der Höchst-beglückten Wahl und Crönung des Herrn Carls VII. in dieser Freyen Reichs- und Wahl-Stadt Franckfurt am Mayn zugetragen, Frankfurt, Jung, 1742-1743.
- 1744 - Lettre de De La Tierce au prince de Solms (in: Les constitutions d'Anderson, éd. Romillat, 2002, op. cit.)
- 1754 - Quelques lettres et fragments de lettres de sollicitation des autorités autrichiennes écrites au bénéfice de son neveu (Österreichisches Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Ministerialkorrespondenz der Reichskanzlei 107-1-15: de la Tierce, Stallmeister des Fürsten Solms-Braunfels, mit Graf Pergen. 1759.
- 1754-1755 - La Correspondance de Grimm note, à propos de la seconde édition, l'Histoire des Francs-Maçons contenant les obligations et les statuts de l'Ordre (par le Fre de La Tierce). À l'Orient, 1747, 2 vol. in-12 :
" Vous êtes peut-être instruite, madame, de l'origine, des progrès, de la chute même des francs-maçons : on vient de recueillir dans deux volumes ce qui s'est fait de meilleurs vers et de meilleure prose à leur occasion. Le morceau le plus agréable de cette compilation est une épître mêlée de vers et de prose où M. Fréron a eu l'adresse d'enchâsser les portraits de Fontenelle. Voltaire, Piron, Roy, Duclos et de quelques autres écrivains de réputation. Ce recueil ne renfermât-il que cette pensée ingénieuse, il mériterait d'être conservé."
- 1773 - Le temple de la Gloire, poème dédié à Catherine II en 1771 et publié en 1773. (Une réédition de ce texte existe: Adegi Graphics LLC; Elibron Classics series edition (2011).
- 1773 - Le poème Le triomphe de la vertu"dédié au landgrave de Hesse-Cassel Frédéric II (Staatsarchiv Marburg, 4a91Nr.22). Il s'agit d'un texte manuscrit accompagné d'un envoi (au total 14 pages). Ce poème de la nature"selon son auteur, imité de l'Astrea Placata de Metastasio, est adressé à son correspondant le 31 janvier 1771 par l'entremise de la princesse Charlotte. Le 19 février, celui-ci lui envoie personnellement ses remerciements. Il s'agit d'un texte éminemment maçonnique quant à son contenu philosophique (voir son étude: F. Labbé, Progrès, vertu et harmonie sociale pour L.-F. de la Tierce", in: Chroniques d'Histoire maçonnique, année 1997, no 48, p.3-9, et Le message maçonnique au 18e s., par F. Labbé, Dervy, 2002.)
- 1762 - Une lettre de condoléance aux Degenfeld-Schonburg à l'occasion du décès de Christoph Martin en 1762. De La Tierce y fait part de sa profonde tristesse. (Archives de la famille, Beileidsbriefe nach dem am 1. August 1762 erfolgten Hinscheiden C.M. von D.-S., den 1. Reichsgrafen zu F.a M.").
- 1777 - Deux lettres publiées en février et mai 1777 à propos de son Temple de la Gloire dans le Journal Encyclopédique :
Lettre à M. L.F. de la Tierce, Grand Écuyer de la Cour des Princes de Solms, au sujet de son poème Le temple de la Gloire.
Monsieur,
Notre Académie des Sciences publia en son tems, le commencement d'un poème historique de votre composition intitulé Le Temple de la Gloire. Le premier chant en était dédié à S.M., notre très-auguste impératrice, et troisième à Son Altesse Impériale notre grand-duc. Un succès aussi honorable pour vous, Monsieur, faisait espérer la continuation de cet ouvrage. Une dame m'a même assuré que dans une lettre à un de nos conseillers d'état, vous promettiez d'y travailler. Vous m'obligerez de m'apprendre par la voie du Journal Encyclopédique, bien connu ici, si vous persistez dans cette louable intention. Au reste, je ne puis vous dire à présent le motif de ma curiosité. J'ai l'honneur d'être. Etc., L. C. J.
A St Pétersbourg, le 25 octobre 1776.
Lettre (1) à Messeigneurs et Messieurs le directeur, vice-directeur et membres de l'académie impériale des sciences de St Pétersbourg, au sujet s'un poème intitulé : Le Temple de la Gloire.
Messeigmeurs et messieurs,
Mon zèle, plein de vénération, envers l'auguste Cathérine, est incapable de se rallentir ; et ma reconnaissance pour la grace que vous m'avez faite, de vous déclarer les protecteurs de mon Temple de la Gloire, ne m'a pas permis de me relâcher. Oserais-je, Messeigneurs et Messieurs, à présent que j'ai mis la dernière main à ce poème, vous supplier d'en informer S.M. Imp. ? Je suis persuadé qu'elle permettra que cet ouvrage soit imprimé en entier, par souscription, à St. Pétersbourg, au profit de la maison des pauvres orphelins de cette capitale.
J'attendrai vos ordres, Messeigneurs et Messieurs, pour vous faire parvenir le manuscrit par le canal de M. de Gross (2).
J'ai l'honneur d'être, etc.
L.F. de la Tierce, grand écuyer de la cour des princes de Solms
A Braunfels, près de Wetzlar, le 26 février 1777.
1. Cette lettre peut servir aussi de réponse à celle que M. L.C.J. adressa, de St. Pétersbourg, l'année dernière, à M. de la Tierce, et que nous avons insérée dans notre journal du 1er Février 1777, page 510.
2. Ministre plénipotentiaire de Russie au cercle de la Basse-Saxe.
- 1744-1783 - Les documents conservés à Braunfels : Fürst zu Solms-Braunfels'sche Rentkammer Braunfels, A 23.6 III 43, A 60.9 - 30 III 443 et CA 2c 20) dont les actes faisant état de sa donation (testament, codicille...) pour un fonds destiné à aider les pauvres des comtés de Braunfels, Greifenstein et Hungen (où demeurent de très nombreux Huguenots), qui deviendra l'asile Solms", quelques lettres, des documents comptables, les conditions de son engagement...
- 1774 - Un article de la Gazette littéraire de Berlin, dirigée par le franc-maçon (présent aux fêtes du couronnement et auteur de la feuille très lue alors: L'espion turc à Francfort, 1741-42) Dufresne de Francheville et dont Claude-Etienne Le Bauld-de-Nans est un collaborateur avant de devenir le directeur, article qui présente très favorablement Le temple de la Gloire auquel la feuille accorde 3 suites à partir de juillet 1774 :
"Les connaisseurs pourront s'apercevoir que l'auteur n'a pas fait toute son occupation de la poésie mais ils auront de la peine à croire que ces vers soient les premiers qui soient sortis de sa plume, puisqu'il s'en trouve très-peu qui pêchent contre les règles et que le nombre des mauvais est bien moindre que celui des bons, parmi lesquels il s'en trouve d'excellents. Il y a même dans ce poème de l'invention quoi qu'il ne soit proprement que l'histoire en vers de l'auguste impératrice de Russie. [ ]"
- (1850?) Excurs über die englischen Logen und besonders über Br. de la Tierce"(ad 5, sigle GON192 B 20), un manuscrit extrêmement difficile à déchiffrer de la collection Kloss a la bibliothèque du Grootoosten der Nederlanden à La Haye. Ce fond possède, disséminés, d'autres renseignements sur De La Tierce, son uvre, sa carrière maçonnique. La plupart des documents se rapportant à la loge de Francfort à l'époque du couronnement s'y trouvent (listes, protocoles...).
- Le livre de Karl Demeter, Die Frankfurter Loge Zur Einigkeit, Frankfurt am main, 1967 et les documents du fonds Georg Kloss conservés au Grand Orient des Pays-Bas à La Haye (documents se rapportant à la loge L'Union)
- Les constitutions d'Anderson Histoire, Obligations et Statuts de la très-Vénérable Confraternité des Francs-Maçons", réédition de 1742, Romillat, 2002. Cette réédition contient en particulier une annexe documentaire avec : le blason de De La Tierce, une lettre autographe de De La Tierce sollicitant son admission auprès du prince de Solms Braunfels, lettre datée du 19 décembre 1744 à Mettenheim (la résidence habituelle des Wartenberg) dans laquelle il se recommande de la comtesse de Wartenberg, se présente comme professant la Religion Chrétienne Réformée selon la Confession de Foi des Églises de France avant la Révocation de l'Édit de Nantes", comme un habile précepteur assez heureux dans l'éducation des jeunes Seigneurs qui m'ont été confiés", enfin il y affirme que sa famille est reconnue comme bonne et ancienne, ainsi que l'ont encore attestée au mois de juin dernier les généraux et officiers de distinction qui ont fréquenté la maison de monsieur le comte de Wartenberg". Autres références données quant à la reconnaissance de l'honorabilité de sa famille: le marquis de Fénelon colonel au service de l'Empereur", le marquis de Valori envoyé de France à Berlin où j'accompagnais il y a quelques années Mr. le comte de Degenfeldt-Schonberg qui parla de ma famille d'une façon si avantageuse que je reçus à cette cour toutes les marques de distinction que pouvait désirer un gentilhomme de naissance".
*
Peu de documents en vérité, mais assez pour désirer en savoir plus: que ces quelques lignes puissent relancer les énergies!
Invitation pour une réunion de l'Union de Francfort signée Steinheil/Stockum 5 mars 1753 (collection part. de l'auteur).
Lettres au comte Pergen (1759)
Demande officielle de De La Tierce auprès de l'Empereur Charles VII pour obtenir le privilège d'imprimer une gazette française à Hambourg (voir la traduction dans le texte de l'article).
Décision impériale d'accorder le privilège demandé:
Nous Charles VII faisons savoir publiquement par cette lettre que Louis François De la Tierce nous a soumis le projet pour le bien de la chose publique et de la ville impériale de Hambourg de lancer un journal en langue française, intitulé Gazette Impériale de Hambourg paraissant quatre fois semaine, sous format in-quarto, deux fois sur un demi folio et les deux autres sur un quart de folio. En prévision des frais qu'il aura et des copies qui pourront être faites de son journal, et qui lui causeront dommages et pertes, il nous a fait respectueusement la requête d'un Privilegium Impressorium impérial d'une durée de 10 ans. Nous avons considéré favorablement cette demande très humble et très obéissante et par notre puissance impériale lui accordons aimablement notre Privilegium Impressorium pour une durée de 10 ans par cette lettre: qu'il fasse imprimer dans notre ville impériale de Hambourg puis distribuer le journal sous le titre de Gazette Impériale de Hambourg quatre fois par semaine, sous format in-quarto, deux fois sur un demi folio et les deux autres sur un quart de folio (...).
De La Tierce, pto Impressorii concernant le journal français à imprimer à Hambourg. Implorant. de exhibendis solitis Exemplaribus..."(18 exemplaires devront être envoyés à chaque parution à l'empereur et une caution versée) et acceptation de cette caution - de la main de De la Tierce ?): Acceptata cautione de exhibendis consuetis 18 Exemplaribus detur petitum Privilegium ad 10 annos sub poenâ. 6 marcarum auri - 12 avril 1742"
De La Tierce Ludwig Franz in Pto Privilegii Impressorii à propos du journal français de Hambourg. Le dénommé de La Tierce sollicite humblement l'obtention la plus gracieuse d'un privilège impérial d'impression de 10 années. Exhib v. Harpprecht (...)"
(remarque: demande reçue le 21 mars 1742)
Sa Majesté l'Empereur romain, Majesté royale en Germanie et Bohême
Sollicitation très humble
Pour
L'obtention la plus gracieuse d'un privilège impérial d'impression de 10 années concernant l'impression à Hambourg de la gazette française projetée
Ludwig Frantz de la Tierce
Puncto privilegii impressorii
concernant les Gazettes Impériales de Hambourg"
Mercredi 21 mars 1742
De La Tierce Ludwig Frantz in puncto Privilegii Impressorii à propos du journal français de Hambourg. Le dénommé de La Tierce sollicite ce jour par l'intermédiaire de Harpprecht humblement l'obtention la plus gracieuse d'un privilège impérial d'impression de 10 années.
Si l'agent signataire devait d'abord recevoir en caution les 18 exemplaires, décision serait donnée ultérieurement. Matth. Wilhelm Haan
Lettre de De La Tierce " Au plus Sérénissime, Tout puissant et Invincible Empereur Romain, Roi en Germanie et en Bohême, à l'Empereur, au Roi, au Seigneur"concernant les frais causés par l'envoi hebdomadaire de 18 exemplaires de sa gazette à la cour, contrepartie du privilège. De La Tierce demande: qu'on renonce aux taxes et frais d'expédition! Il sollicite une exonération de droits et de frais pour mieux assurer son entreprise.
Notes :
La traduction du Hollandais Kuenen n'a pas eu le même écho international. Cf. F. Labbé, Le message maçonnique au XVIIIe siècle, Dervy, Paris, 2006, 2e édition.
J'ai ainsi pu publier plusieurs articles sur De La Tierce: Le rêve irénique du marquis de La Tierce", in Francia, (Bd 18, 1991); Progrès, Vertu et Harmonie Sociale pour L.-F. De la Tierce", in: Chroniques d'Histoire maçonnique, no 48, IDERM, Paris, 1997; Louis-François De la Tierce: Franc-maçonnerie et cosmopolitisme", in: Chroniques d'histoire maçonnique, no 43, Paris, 1990; Kuenen et De la Tierce", in: Humanisme, no 124, Paris, 1978... Ces articles ont servi à plusieurs chercheurs, qui les ont exploités souvent tels quels, parfois sans fournir les sources, et surtout sans poursuivre le sillon ouvert.
Voir Clément Oury, Les défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne (1704-1708), Thèse de doctorat, 2005. A Vincennes, il existe un dossier La Tierce ne contenant qu'un document: Au rolle du roy du 29 juin 1723. Sa Majesté a accordé une pension de 50'' à la dame Jumel, veuve du V(?) de La Tierce cy-devant lieutenant au régiment Royal Piedmont de Cavalerie."Peut-être un parent? Ces archives ne conservent aucune trace d'un brigadier de la Tierce mort à Ramillies : M. de Beauhoste et Branbuan sont les seuls brigadiers indiqués comme tués à cette bataille. Rien non plus dans les archives anglaises. Les historiens connaissent en outre la tragédie de Varaize (près de St Jean d'Angely) le 24 octobre 1790 où un notable, Pierre La Tierce est la victime d'une émeute.
Roi semi légendaire (910-968) appelé aussi Boson VII de Provence, comte d'Arles, d'Avignon et de Provence (949-968). Dans sa lettre au prince de Solms reproduite avec mon article sur L.-F. de la Tierce dans Les constitutions d'Anderson Histoire, Obligations et Statuts de la très-Vénérable Confraternité des Francs-Maçons", réédition de l'original de 1742, Romillat, 2002. Son double prénom étonne pour un réformé !
Jusqu'à la Révolution, il existera sous plusieurs formes une école des orphelins militaires"particulièrement destinée aux enfants d'officiers morts en service. De La Tierce aurait eu des entretiens avec le baron Pierre Pavlovich Shafirov, un des accompagnateurs de Pierre le Grand. Il restera en contact avec la Russie où se trouvent quelques documents se rapportant à lui.
Lettre du Comte Degenfeld au prince de Solms concernant l'admission de De La Tierce comme précepteur de ses enfants (16 septembre 1744, Archives de Braunfels). Il le présente comme très fort dans l'art de l'ingénieur ainsi que dans d'autres galants domaines". Le Temple de la Gloire fournit aussi bon nombre de renseignements biographiques (utilisés dans les articles cités note 2).
Il a également pu rencontrer le chevalier Ramsay qui séjourne à Londres en 1729 et 30 où il est reçu à la Royal Society, au Spalding Club et présente son succès maçonnique"et philosophique Les voyages de Cyrus (Cf. Labbé, Le message..., 2e éd. 2006). Il est probable qu'on ait aussi beaucoup parlé de son fameux Discours.
La seconde épouse de De La Tierce était une Reitzenstein. Le comte Pergen est un collaborateur de Marie-Thérèse, il sera ministre. Voir le document 2en fin d'article. (Österreichisches Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Ministerialkorrespondenz der Reichskanzlei : De la Tierce, Stallmeister des Fürsten Solms-Braunfels, mit Graf Pergen. 1759.
La loge fonctionne probablement dès fin 1741. Le 29 mars 1742, elle se donne des statuts rédigés en français et le 27 juin elle est officiellement constituée. Le 6 novembre De la Tierce s'adresse à la grande loge de Londres.
Le livre est publié chez François Varrentrapp, l'éditeur de l'Avant Coureur de La Barre de Beaumarchais dont l'exemplaire du 5 mars 1735 contient des Entretiens d'Eudoxe et de Thémiste sur l'État présent des affaires générales de l'Europe, qui évoquent un projet"assez voisin de celui des maçons francfortois dont nous parlons dans notre article de Francia (Op. Cit.): Le rêve irénique du marquis de la Tierce". On se reportera aussi au livre de Gautier de Faget (auteur de la Relation apologique et histoire de la Société des francs-ma¬çons, 1738), L'oracle de ce siècle consulté par les souverains de la terre. Ouvrage singulier sur les affaires critiques et politiques du tems, à Londres, Aux dépens de la Compagnie, 1743, à propos de l'incertitude des succès de l'Autriche, du désir de la France d'affaiblir les Habsbourg et d'avoir un empereur à sa solde. L'érudit Prosper Marchand pour sa part ne manque pas de noter cette parution, que lui a indiqué Rousset de Missy (Universiteitsbibliotheek Leiden (654 G212). Plus tard, le baron Grimm la mentionnera aussi (Correspondance de Grimm, Diderot..., par M. Tourneux - Reprint Kraus, 1968, T.1 p. 75). La première édition est imprimée à 500 exemplaires reliés en maroquin noir, présentée dans un coffret. Son prix élevé en fait un ouvrage précieux. La seconde édition, qui ne doit peut-être rien à De La Tierce, avec son extension apologétique, se veut être le recueil des textes maçonniques les plus curieux alors en circulation : c'est à la fois une véritable bible"maçonnique... et une opportunité commerciale pour Varrentrapp.
François Labbé, Le message maçonnique au XVIIIe siècle, Dervy, Paris, 2006, 2e édition.
Charles Albert est né à Bruxelles, en Brabant, comme De La Tierce! Il parle parfaitement français et son Journal (écrit dans cette langue) est parfaitement intéressant sur les événements de Francfort, mais on n'y évoque pas la franc-maçonnerie.
Österreichisches Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchivs Impressoria 71, 2. Konv. Nr. 62. Cette Gazette (maçonnique?) n'a dû avoir que quelques numéros, si elle en a eu. Le sénat de Hambourg avait confirmé le privilège en 1742 et le libraire Etienne a été chargé de l'impression: 2 jours par semaine 1/2 feuille et les autres jours 1/4 de feuille (Voir les documents en fin d'article et le Bulletin du Bibliophile belge, Bruxelles, 1855)
Voir les documents 1,2 et 12 en fin d'article: la demande de privilège de De La Tierce. Cette demande montre aussi combien le traducteur des constitutions croit encore (nous sommes en 1742) à l'universalité de la langue française. En Allemagne, cette attitude vis-à-vis du français évoluera (cf. F. Labbé, Berlin, le Paris de l'Allemagne, Orizons, Paris, 2011.
Voir l'ouvrage très documenté de R. Koch et P. Stahl, Wahl-und Krönung in Frankfurt am Main, 1742-1745, Frankfurt am Main, 1986.
La Tierce in LE PERROQUET, ou Melange de diverses pieces interessantes pour l'esprit et pour le cur. Tome I 1741, semaine II, pp.27-29, Francfort chez François Varrentrapp
L.-F. de la Tierce meurt le 15 novembre 1782, il est enterré dans la chapelle St George (chapelle du cimetière de Braunfels) aux côtés de sa première épouse décédée le 24 septembre 1756. Sa seconde épouse, Johanna Erdmutha née von Reitzenstein morte le 5 mai 1780 est enterrée dans le cimetière St Georges. Les intérêts du capital doivent d'abord être attribués à 4 personnes de son entourage (serviteurs...) puis, à la mort de chacun d'entre eux, les fonds seront attribués aux pauvres lorsque ces quatre personnes auront disparu, La Tierce demande qu'on érige alors un hospice ou un hôpital. En 1811, le fonds La Tierce (6136 florins) est partagé entre les trois communes susdites et les intérêts continuent à servir la cause des déshérités. A partir de 1855, ils sont affectés à la fondation Solms qui a érigé une Maison des pauvres, des malades et du travail. En 1892-93, le fonds La Tierce est utilisé pour des aggrandisements et la modernisation de cette institution. Ce fonds représentait alors 14300 marks, soit environ 90 000 euros (Archiv Braunfels 48-4-13 et 1-3-127). Voir aussi: Die den Armen der Stadt Braunfels gewidmeten milden Stiften", Denkschrift Fürst. Standesherrschaft, 1917 et Landes Hauptarchiv Koblenz (441 Nr 12262) Der de la Tiercesche Armenfonds zu Braunfels. 1848-1864".
Dans la livraison précédente (mai), la Nouvelle bibliothèque signale la toute récente parution de la traduction adaptation de de la Tierce, non sans ironie et elle figure dans le catalogue des livres nouveaux chez Pierre Paupie.
Les documents que j'ai publié (Les constitutions ) et les archives des princes de Solms à Braunfels prouvent qu'il s'agit bien de son véritable nom. En revanche, il ne m'a jamais été possible de localiser ses origines autrement que par ce qu'il en dit ou par ce que le comte Degenfeld en rapporte. Les ancêtres dont il parle sont introuvables pas plus que son père, général de brigade tué à Ramillies Il n'existe à Vincennes qu'une demande de pension du début du 18e siècle d'une dame de la Tierce.
De Thémiseul de Saint-Hyacinthe publié en 1714 avec de nombreuses rééditions et modifications, auquel Prosper marchand a participé.
E. Tourneux, Reprint Kraus, 1968, T. I, p. 75.
Né en 1720 et mort en 1785, Frédéric était de culture française (Genève et Lausanne).A partir de 1741, il commande les troupes hessoises au service de Charles-Albert, l'empereur Charles VII, dans la guerre de succession d'Autriche. En février 1749, il choisit de devenir catholique mais secrètement d'abord, profitant d'une visite de Clément Auguste, prince et évêque électeur (qui en 1742 avait couronné son frère à Francfort), ce qui devait avoir des conséquences importantes sur sa vie et le gouvernement de la Hesse. Pendant la guerre de Sept-Ans, il se bat avec bonheur aux côtés de la Prusse. Le conflit terminé, cet admirateur de Voltaire se lance dans une politique de grands travaux et de développement économique et industriel de sa principauté qui devient aussi un haut lieu d'activité intellectuelle. La franc-maçonnerie s'y étend très rapidement. Dès 1743, le 13 avril, la loge Aux trois lions de Marburg, est fondée et patronnée par l'Union de Francfort (patente du 8 avril 1743). On considère généralement que la première loge de Cassel sera fondée sous son égide en 1773 mais une loge, La vallée de Josaphat, y aurait déjà été créée le 2 octobre 1766 sous l'influence de maçons francfortois.
François Labbé, La gazette littéraire de Berlin, Honoré Champion, Paris, 2004, p. 116.
Littérature latine de Bretagne<em></em>
Orale d'abord, comme partout, puis écrite, très tôt certainement.
En ce qui concerne cette dernière, de par son histoire, au Moyen Âge, la Bretagne ne pouvait pas donner naissance à moins de trois types de littératures, si l'on peut dire, se rapportant chacune à un des idiomes dominants : le latin, le breton et le français.
Les quelques pages qui suivent chercheront à esquisser ce qu'a pu être la première, la littérature bretonne de langue latine.
L'Armorique a été romanisée comme toute la Gaule. La Guerre des Gaules de César évoque les cités armoricaines avant et pendant la conquête. Les vestiges de villes, de temples (colline du Haut-Bécherel à Corseul ; type répandu du fanum), de villae romaines sont nombreux. Les cinq tribus principales avaient transformé leurs oppida en de véritables cités : Condate Redonum (Rennes), capitale des Redons ; Fanum Martis (Corseul), chez les Curiosolites ; Vergium (Carhaix), pour les Osismiens ; Dariorit (Vannes), chez les Vénètes et Condevincum avec le Portus Namnetum (Nantes) chez les Namnètes, mais les données de l'épigraphie montrent un décalage villes/campagne et Est/Ouest.
La conversion au christianisme (milieu du IIIe siècle et débuts du IVe) ainsi que la perte d'importance des langues vernaculaires ont été les conséquences les plus évidentes de cet événement, particulièrement en Haute-Bretagne où la toponymie renseigne sur les domaines gallo-romains qui se développèrent et donnèrent souvent naissance par la suite à une localité. Les trois premiers évêchés de Nantes, Rennes et Vannes - peut-être Quimper - datent aussi du IVe siècle, mais il faut attendre le Ve siècle pour connaître les premiers évêques : Desiderius, Anthemius et Patern.
Avec la lente pénétration chrétienne, l'arrivée et la formation de clercs, une littérature latine (d'Armorique) prend son essor comme partout ailleurs, un essor toutefois ralenti par les invasions de ceux qu'on appelle les "barbares", dès le milieu du IIIe siècle, mais qui s'accentue au Ve avec la désorganisation de l'Empire romain. Il faudra attendre le milieu du Ve siècle et le VIe pour voir arriver des bandes de Bretons fuyant les Saxons et les Angles qui les avaient refoulés vers l'ouest de la Grande-Bretagne lorsqu'ils avaient envahi le sud de l'île (mais avant cette époque, des contacts et des échanges voire une émigration/immigration existaient naturellement entre les Cornouailles et la Bretagne). Ces vagues d'immigration n'allaient pas sans inquiéter les autorités religieuses qui voyaient d'un mauvais il les pratiques cultuelles importées, comme en témoignent les deux lettres adressées à deux prêtres bretons, Lovocatus et Catihernus, par les évêques Licinius Melanius et Eustochius leur reprochant de propager l'hérésie de Pepodius, acceptant en particulier des femmes (conhospitae) à la célébration liturgique. Ces Bretons, déjà christianisés, mais moins romanisés que les populations d'Armorique, qui émigrent progressivement sur 150 ans, receltisent en effet les territoires clairsemés de l'Ouest de la Bretagne où les dialectes celtiques n'avaient de toute façon pas disparu. À l'Est, ils s'intègrent aux populations gallo-romaines plus nombreuses qui restent plus qu'à l'Ouest sous la domination de comtes dépendants des rois mérovingiens. Les évêques - qui représentaient l'autorité la plus stable depuis la chute de l'Empire romain - virent d'ailleurs dans Clovis et ses successeurs le meilleur rempart pour assurer leur défense et les prérogatives de la religion : Melaine, l'évêque de Rennes fut ainsi le principal négociateur de la soumission à Clovis. C'est d'abord en Basse-Bretagne que s'installèrent des moines venus du Pays de Galles ou d'Irlande. Fidèles à leurs coutumes étranges, ils vivaient au milieu des populations et desservaient les paroisses.
Ils jouent alors un rôle essentiel dans le développement et l'organisation du pays. L'Église est ainsi omniprésente et un pouvoir laïc n'apparaît que sporadiquement ou sous une forme particulière, celle des machtierns, sortes de grands propriétaires, de puissances locales, avec parfois des chefs plus puissants que certaines vies de saints qualifient de rois. Mais c'est un pouvoir insuffisant pour permettre l'épanouissement de ce qui verra le jour en Irlande ou au pays de Galles, une vie intellectuelle et une littérature indépendantes du clergé, même si certains témoignages laissent à penser que ces personnages puissants avaient auprès d'eux des bardes : saint Turiau aurait été savant et chanteur d'histoire ; saint Hervé était le fils d'un harpeur de renom ; le célèbre et probablement légendaire barde Taliésin serait venu d'Outre-Manche pour séjourner à la fin du VIe siècle en Bretagne
Il semble que ces chefs aient souvent été en guerre les uns contre les autres ou contre les comtes francs des Marches. Ils étaient en tout cas redoutés des populations de Haute-Bretagne et de leurs évêques. Certains d'entre eux ont cependant laissé le souvenir - ou la légende - de princes pieux et pacifiques : Gradlon, Withur, Judicaël, roi de Domnonée, mort vers 650, qui reconnut l'autorité de Dagobert.
L'hégémonisme carolingien entraîne de nombreux conflits et Roland est le premier chef des Marches de Bretagne (marca Britanniae). Une réforme ecclésiastique fait rentrer dans le giron commun l'Église bretonne. Tous les diocèses bretons sont alors placés sous l'obédience de l'archevêque de Tours, tandis que la plupart des évêques seront d'origine gallo-franque. Ces réformes ne se font pas sans difficultés ni guerres, mais Louis le Pieux sait se concilier un chef breton du sud de la province : Nominoë. À la mort de l'empereur d'Occident (840), celui-ci s'opposera toutefois à son successeur, Charles le Chauve, et poussera ses troupes jusque dans le Poitou. Disposant d'une cavalerie de qualité, ayant avec lui d'autres chefs bretons et francs, il défait le roi des Francs à Ballon, s'empare de Rennes et de Nantes en 850.
Sur le plan intérieur, il s'assure le soutien de l'Église et aide Conwoïon, le fondateur de l'abbaye de Redon, à obtenir de larges donations de Louis le Pieux. Conwoïon soutiendra en retour Nominoë quand il voudra remplacer la plupart des évêques gallo-francs par des évêques bretons.
En même temps, en contrepartie, Nominoë cherche à faire supprimer les vieux usages celtiques, à ramener l'Église bretonne à la discipline romaine et il fait donner leur physionomie définitive aux neuf évêchés bretons.
Ses missi - sur le modèle carolingien - représentent alors son autorité auprès des machtierns.
L'expansion bretonne commencée par Nominoë se poursuivra jusqu'en 920, mais les populations romanes du Cotentin, du Maine occidental, bien que soumises, ne sont pas "bretonnisées".
Les Normands arrêteront cet expansionnisme poursuivi par Erispoë (851-857) et Salomon (857-875). Ils domineront même la Bretagne quelques années (907-937). Les abbayes et monastères du pays sont saccagés : Landévennec, Plélan, Redon en particulier, Nantes détruite, la cathédrale de Vannes L'intelligentsia des évêques, abbés, nobles et clercs quitte en grande partie la Bretagne, et ce qui peut être sauvé des bibliothèques est dispersé aux quatre vents de l'Europe. Grâce à l'alliance anglo-saxonne, les Bretons, avec Alain Barbetorte, petit fils d'Alain le Grand (duc de 936 à 952, sous la suzeraineté du roi de France), vivant en Angleterre à la cour du roi Athelstan, reprennent le contrôle de leurs territoires en 939, territoires dévastés par les mises à sac répétées des envahisseurs.
La Bretagne d'après 940, étendue jusqu'au sud de la Loire est d'abord marquée par la rivalité des maisons de Rennes et de Nantes, jusqu'au XIe siècle, sorte de siècle d'or avec Alain III et Alain Fergent mort en 1119. Des alliances difficiles avec les Normands, la participation importante à la conquête de l'Angleterre et aux expéditions en Italie du sud caractérisent cette époque. Ensuite, la Bretagne entre sous la coupe des Plantagenets puis des Capétiens. La Haute-Bretagne voit très tôt le breton s'éteindre complètement, mais représente définitivement le centre politique et religieux.
*
Sur le plan linguistique des pays celtes, du IVe au XIIIe siècle, la lingua britannicae s'est différenciée en trois langues principales : le breton, le cornique et le gallois ainsi qu'en parlers, dialectes etc.
Le vieux breton (IVe-XIe siècle), avec ses deux dialectes principaux, celui des immigrants venus du sud de la Grande-Bretagne, et celui des habitants de l'Armorique, est, à côté du latin, pour une période assez longue, la langue vernaculaire. La lingua britannicae reste le vecteur d'une tradition littéraire commune aux pays celtes jusqu'au Xe siècle pour laisser place à de nouvelles normes correspondant aux langues nées des dialectes. Alors que la Basse-Bretagne conservera jusqu'au XVIIe siècle la culture celtique et une langue bretonne différenciée régionalement, la Haute-Bretagne voit se développer le (les) parler (s) gallo (s). La langue bretonne, quant à elle, est une langue en évolution constante : les termes issus du latin et du français y sont de plus en plus présents à partir du XIIe siècle.
Léon Fleuriot évoquait une Bretagne à trois voix lorsqu'il parlait de cette Bretagne ancienne : le breton, le latin et le français sont en effet les trois langues qui se parlent alors, avec bien entendu toutes les variantes (dialectales) qui se déclinaient à partir d'elles, tous les sabirs résultant des échanges, des contaminations linguistiques et des influences respectives.
Il ressort de ce rapide tour d'horizon historique que la langue des clercs possède tout au long des aléas de ces périodes troublées l'avantage de la stabilité et d'origines prestigieuses, celui d'être la langue de la seule force existante et structurante du pays, l'Église. En outre, le mythe de l'origine troyenne commune renforce, chez les intellectuels bretons, le sentiment de parenté avec Rome, et confère au latin un prestige indéniable. C'est aussi ce qui explique l'existence jusqu'au XIIe, voire XIIIe siècle d'une véritable littérature latine de Bretagne, même si les sources dont on dispose sont relativement rares, et surtout insuffisamment inventoriées et exploitées.
*
La place du latin est en effet remarquable, quelle qu'ait pu être sa qualité, puisqu'en ces temps reculés, il est en Bretagne très probablement la seule langue écrite, en tout cas celle dont on ait quelques preuves, les manuscrits en langue bretonne, qui n'ont pu manquer d'exister, ayant quasiment totalement disparu. Contrairement à ce qui est avéré pour le pays de Galles ou l'Irlande, à l'heure actuelle, on n'a pas la preuve matérielle d'une littérature écrite en langue vernaculaire avant le XVe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, par écrit ou plus certainement oralement, l'expression de l'individualité culturelle bretonne. La puissance de l'Église et la faiblesse des pouvoirs laïcs expliquent cette importance du latin. Le Cartulaire de Redon (IXe) prouve qu'au moins dans la Bretagne du sud-est, le latin était tellement implanté que même les pièces comptables les plus courantes étaient rédigées dans cette langue !
Il est donc certain qu'il y a eu au moins coexistence d'une littérature vernaculaire orale et d'une littérature écrite latine. On possède des fragments d'une vie de saint Malo en vieil anglais ; la Vie de Brieuc précise que le texte en a été d'abord traduit du vieux breton par un latinier. La vie de saint Tudual vient aussi du vieux breton et il subsiste des traces de cette langue dans les vies de Turiau, Méloir, Goulven Le bifolio du Manuscrit de Leyde (VIIIe ou IXe siècle) comporte une trentaine de mots en vieux breton dans le texte principal. Si cette langue n'est pas réduite à un emploi secondaire, comme dans les gloses, il ne s'agit pas d'un texte littéraire, mais de quelques pages d'un traité de médecine latin.
Les tournures bretonnes modèlent parfois le latin, qui adopte une syntaxe souvent plaquée sur celle du vieux breton (vies de Judicaël, de Guthiern, de Guénolée). Des textes, comme ceux de Gérald de Galles (1146-1223), certaines vies de saints, font aussi référence aux "chanteurs d'histoire", les "cantores historici" du XIIe siècle, qui gardaient en mémoire des événements anciens et les célébraient dans leurs chants. On a pu démontrer la transmission orale de faits historiques sur neuf siècles, comme les invasions vikings sur le Yaudet (836) chantées encore au XIXe siècle ! Ces cantores historicise, qui ont aussi véhiculé la matière de Bretagne à travers l'Europe, ne sont pas "nés" spontanément, ils ont certainement eu des prédécesseurs dont on n'a plus (pas encore) la trace ! C'est aussi dans les textes hagiographiques qu'on retrouve des références à des ouvrages très anciens, comme au Brittanicum, cette possible et ancienne compilation de la protohistoire bretonne.
Ces témoignages, auxquels il faut joindre des annales, des chartes et des chroniques qui racontent plus spécifiquement les guerres entre les chefs bretons ou contre les comtes des marches, se retrouvent en particulier, comme en d'autres lieux de l'ancienne Gaule, dans les cartulaires (Cartulaire de Redon, le Cartulaire de Landévennec, le Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé ), qui composent une grande partie de la mémoire bretonne.
Le Cartulaire de Redon, par exemple, contient les copies collationnées des titres de propriété foncière de l'abbaye de Saint-Sauveur, établissement monastique fondé à Redon en 832 par Conwoïon sous la protection du roi breton Nominoë. La collation a débuté dans la seconde moitié du XIe siècle, sous l'abbatiat d'Aumod (1062-1083). On possède d'ailleurs le nom de deux des copistes : Judicaël et Gwegon.
Ce cartulaire rassemble 391 actes en latin, sur 147 parchemins. Les noms propres sont en vieux breton, principalement ceux des témoins figurant au bas de chaque acte.
Les chartes concernent des domaines ou des terres situés un peu partout en Bretagne. Un bon nombre d'entre elles correspondent à des biens qui se concentrent cependant dans la vallée de la Vilaine, à l'est du Morbihan actuel et à l'ouest du pays nantais.
Ces documents sont une source majeure d'information pour la connaissance de l'histoire de la Bretagne à l'époque médiévale, en particulier pendant le Haut Moyen Âge, ainsi que pour la toponymie et l'anthroponymie bretonnes, comme en témoigne l'index du Cartulaire de Redon établi par le linguiste Bernard Tanguy, qui regroupe 2100 noms de personnes et 800 noms de lieux. Ce cartulaire contient enfin des textes plus proprement littéraires.
Le Cartulaire de Landévennec provient pour sa part de l'ancienne abbaye de Landévennec. Il consiste en un volume de 164 feuillets de parchemin en deux parties :
- la première, écrite au IXe siècle, est composée exclusivement de documents hagiographiques, presque tous relatifs à Saint-Guénolé, le fondateur de l'abbaye.
- la seconde date des Xe et XIe siècle, et contient des titres et documents diplomatiques relatifs aux droits et possessions de l'abbaye. Le texte latin intègre, lui aussi, de nombreux noms de lieux et de noms d'hommes en vieux breton.
Quant au Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé (XIe-XIIe siècle), il renferme également les documents se rapportant au fonctionnement de l'établissement (ventes, achats, donations, relations avec les autorités civiles et ducales) et une série de chartes remontant à la période de la fondation de l'abbaye (1026). Il contient des vies de saints comme la Vie de Saint Gurthiern (Goujarne), prétendue authentique et historique (1re moitié du XIIe s.), ou la Vie de Saint Ninnoc (plus ouvertement légendaire), mais aussi des documents d'intérêt historique et littéraire, tels qu'une Chronologie universelle de la création à 1314, des fragments de chronique et la préface de Gurheden, le moine auteur du cartulaire (jusqu'en 1128).
Les textes comptables, diplomatiques , ne concernent pas à proprement parler la littérature latine de Bretagne, même s'ils ont une haute valeur historique. Tous les autres écrits subissent en revanche - comme les vies de saints ou les annales - un traitement littéraire. Leurs auteurs, leurs copistes, connaissent plus ou moins la littérature antique, les exploits des héros romains ou grecs et le même phénomène d'intertextualité relie leurs ouvrages au bien commun culturel. Ils sont aussi au courant des légendes et des chants, des complaintes parcourant le pays et évoquant les grands moments de l'histoire. Là, également, si leur but principal est de retenir par l'écriture la suite des événements, ils ne peuvent s'empêcher d'y mêler un style, une façon de faire influencés par ces derniers. Ils n'ont pu ne pas être marqués par les chants des bardes qui célèbrent (en breton et en latin) les exploits des chefs auprès desquels ils se trouvent. La réputation de certains d'entre eux a traversé les siècles : Turiau, à la fois savant et poète, Hoarvian, le père de Saint Hervé, harpiste et chanteur, le harpiste du duc Hoël, Cadiou
La littérature latine de Bretagne n'existe en soi que dans la mesure où elle rend compte à la fois d'un "travail littéraire" et s'imprègne de son milieu, de la culture vernaculaire, ou, pour le moins, qu'elle est influencée par elle ou le substrat culturel qui la fonde, ce qui la distingue des autres littératures latines d'Europe. Son intérêt particulier consiste en ce qu'elle parle de la Bretagne ou/et est porteuse de caractères communs avec les cultures du Pays de Galles ou d'Irlande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on remarque la préservation dans les textes latins de noms bretons à formes archaïques (personnages, lieux ), de celticismes, d'une syntaxe calquée sur la syntaxe bretonne, la reprise dans la poésie et la prose d'une imagerie rappelant le matériel mis en uvre dans les vers héroïques gallois ou irlandais, des fragments de légendes, des rappels historiques, les gloses
Il est moins essentiel de souligner que les clercs bretons utilisent les mêmes techniques que leurs confrères de France ou d'Europe pour "orner" les textes, comme l'appoint de références bibliques ou l'ajout de commentaires, techniques qui n'ont rien de spécifiquement breton.
Ainsi, la Bible et les commentaires de l'écriture sainte sont évidemment omniprésents par les citations qui égrènent les vies de saints, par exemple, amenant une réflexion, illustrant un destin "ut ait propheta". La Vie de Malo contient ainsi 39 références bibliques. Des descriptions savantes donnent une coloration sacrée, car on reprend des images traditionnelles, des textes de prière comme l'antiphonaire de saint Grégoire (antienne chantée par les prêtres dans cette même Vie de Malo - L'Exultet inspirant la description des abeilles dans la Vie de Guénolé), le Bréviaire ou le Missel romain. Certaines vies (ou chapitres de vies) se closent sur des formules de louange plaquées sur les doxologies (Vies de Guénael, Guénolé, Malo, Paul, Samson )
Comme dans toute la chrétienté, les Pères de l'Église sont souvent sollicités, de même que les uvres ascétiques et les historiens comme Bède (Historia Ecclesiastica) voire Gildas (De Excidio Brittaniae).
La culture des scribes et des clercs leur fait également avoir recours certes aux auteurs chrétiens comme Prudence (Uurmonoc, Vita Pauli Aureliani), Juvencus (Liosmonoc, Libellulus sacerdotalis), Cassiodore (ses Institutiones dans la première Vie de Samson), Isidore de Séville (ses Sentenses chez Uurdisten, Vie de Guénolé), Caelius Sedulius, Cyprianus Gallus, , mais également aux auteurs profanes de l'Antiquité, bien entendu Virgile (Vie de Conwoïon, de Guénolé, de Magloire ), mais aussi Ovide (Vie de Magloire), Lucain (Vie de Guénolé et de Conwoïon ), Horace (Vie de Magloire ), Tertullien (Uurdisten, Guénolé).
Ratuili, l'évêque d'Aleth, décrit, dans sa Gesta, une tempête, et se sert pour cela d'un passage de l'Énéide. Enfin, à côté de ces poètes, on trouve trace d'emprunts à quelques prosateurs comme Sallustre (Première vie de Samson), Cicéron, voire Homère.
Ces références sont d'ailleurs pensées comme toutes à l'honneur du saint dont il va être question : en commençant sa vie de Guénolé, Uurdisten énumère les noms prestigieux des auteurs sur lesquels il s'est appuyé, Augustin, Cassiodore, Grégoire, Jean Chrysostome , autant de gages de sérieux et de sacralité.
Ces enrichissements - qui sont d'ailleurs plus souvent des réminiscences que des citations -, ces ornements des textes et particulièrement des Vies - souvenirs de lectures profanes ou sacrées - forment une véritable intertextualité difficile à apprécier aujourd'hui, mais qui, à l'époque, établissait entre le créateur et ses lecteurs, forcément cultivés, une connivence source d'un probable plaisir littéraire.
*
Si l'on procède chronologiquement, cette littérature latine de Bretagne n'est elle-même avérée par des documents qu'à partir de la fin du VIIIe siècle, c'est-à-dire avec les débuts de la période carolingienne (la première Vie de Guénaël, dont quelques passages subsistent, la première Vie de Samson, le fondateur de l'abbaye épiscopale de Dol - qui est peut-être du VIIe s. -, les fragments d'un poème en l'honneur de saint Tudval ou la Vita S. Ermenlandi ; quelques bréviaires). Ces indices témoignent d'une littérature hagiographique bien avant la période des exactions normandes. On sait que, dès le IVe siècle, des groupes d'insulaires traversent la mer avec des intellectuels comme Pélage (le premier écrivain latin d'Angleterre). Avec les colons des Ve et VIe s. se sont installés à l'évidence quelques lettrés, dont on ne sait rien de tangible. La légende de Gildas, rapporte ainsi que l'auteur du De Excidio Britanniae (540-547) passa une partie de sa vie dans le Morbihan, voire qu'il y mourut. Mentionné par Colomban et Alcuin, il est lu avec un respect particulier au IXe siècle, admiré par Uurmonoc par exemple, et un manuscrit de son ouvrage se trouve alors au Mont Saint-Michel. La Vie de Samson évoque aussi un prototexte : l'auteur rapporte avoir entendu un vieux moine lui lire le récit que le diacre Hénoc, cousin de Samson, avait fait de sa vie Ces lettrés ont été les précurseurs de la littérature latine de Bretagne.
Il existe certes de nombreux écrits latins plus anciens, mais qui ne se rattachent pas à ce que nous considérons être la littérature latine de Bretagne.
Pour les IXe et Xe siècles, un important corpus de manuscrits latins d'origine bretonne contenant parfois des gloses en ancien breton est en voie d'évaluation, mais les recherches sont encore insuffisantes. Il s'agit, comme on pouvait s'y attendre, d'une majorité écrasante de textes religieux (écriture carolingienne - minuscule caroline - combinée à des abréviations et caractéristiques insulaires). Paul Fleuriot chiffrait naguère leur nombre à environ 150, mais les manuscrits ayant été dispersés, recopiés, intégrés à des textes plus tardifs, ce nombre devrait être beaucoup plus élevé. Ce corpus permet cependant d'avoir une bonne idée de ce qui était copié, étudié et composé dans la Bretagne carolingienne, même si la plupart de ces textes (hormis le code de lois Excerpta de Libris Romanorum et Francorum) n'existent pas à l'état original et ne se trouvent souvent que comme fragments intégrés à des manuscrits plus tardifs.
Ces témoignages du IXe et Xe siècle ont survécu dans des bibliothèques monacales le plus souvent hors Bretagne (à Fleury, par exemple, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ) où ils ont été transportés lors des invasions normandes. Rappelons le sac de Landévennec en 913 ou l'exil des clergés de Dol, Léhon, Redon, les moines sauvant les reliques de leurs saints et leurs manuscrits les plus précieux. Ces moines bretons poursuivront d'ailleurs quelque temps la tradition de la glose bretonne dans les nouveaux centres où ils s'installeront, mais guère plus tard qu'au début du XIe siècle.
Ce corpus comprend un grand nombre de livres, de chants religieux, de grammaires, de computus ou comput (le calcul des dates de fêtes mobiles, avec ses spécificités bretonnes), de canons, ainsi que des textes d'auteurs chrétiens comme Isidore de Séville, Paulus Orosius, Grégoire le Grand, Johannes Cassianus, l'élève d'Alcuin, Amalarius de Metz voire des écrivains de l'Antiquité comme Virgile ou Boèce. On trouve aussi une série d'ouvrages d'éducation chrétienne et de droit (Collectio Canonum Hibernensis), et le De Excidio et Conquestu Britanniae de Gildas.
Les compositions littéraires originales concernent :
quelques chants comme L'Hymne à Saint Guénolé (857/884), de Clément de Landévennec (Cartulaire de Landévennec), qui fera qu'on attribuera aussi à ce même moine Clément la Vita Winwaloei (Vie de Saint Guénolé, important témoignage sur la vie quotidienne), les bréviaires de Saint-Gatien et de Marmoutier (débuts IXe s.), le bréviaire de Landévennec (IXe s.), celui de Berne (Xe s.) ainsi que le Bradfer-Lawrence gospels (Cambridge, IXe s.), le bréviaire breton (probablement originaire de Landévennec, se trouvant à Oxford, Xe s.)
les vies de saints avec leur déroulement traditionnel : une préface précisant les intentions du narrateur, la présentation du saint (origines familiales, naissance, enfance, éducation, activités sacerdotales, voyages, miracles, la mort et les merveilles qui suivent).
La Vita Machutis (évêque d'Aleth) de Bili, le disciple de Ratuili (Vie de Saint-Malo, 866/872), la Gesta Conwoionis et aliorum sanctorum Rotonensium, 866/872 de l'évêque d'Aleth, Ratuili, la Vita Winwaloei (Guénolé, fondateur de Landévennec 880) de l'abbé de Landévénec Uurdisten, la Vita Pauli Aureliani (Saint Paul évêque du Léon), de Uurmonoc (884) , la Vita Conwoionis, Xe s. probablement, la Vita Corentini, IXe, mais peut-être plus tardive, la Vita Budoci (Budoc, Xe), la Vita Guenaili (Guénael, successeur de Guénolé à Landévennec, IXe voire plus tôt), la Vita et translatio S. Guenaili (Xe s.), la Vita Idiuneti alias dicti Ethbini (Saint Idunet, Xe, voire plus tôt, ou XIe), la Vita Iudoci (Judoce, IXe s.), la Vita I S. Machutis (première Vie de Malo, débuts du IXe s.), la Vita et translatio S. Machutis (Xe s.), la Vita I S. Melanii (première vie de Melaine, début IXe s.), Vita, translatio et miracula S. Maglorii (Magloire, l'ascète de Sercq, IXe/Xe s.), Vita et miracula S. Martini Vertauensis (Martin de Vertou, IXe s.), la Vita S. Osmannae (Osmanne, IXe s.), la Vita Petroci (Petroc, Xe s.), la Vita Ronani (Ronan, Xe s.), la Vita II S. Samsonis (2e vie de Samson, IXe/Xe s.), la Vita I Turiaui (1ère vie de Turiau, évêque de Dol, IXe s.), la Vita II Turiaui (2e vie de Turiau, Xe s.), la Vita I S. Tutguali (1re vie de Tudval, IXe), la Vita II Tutguali (2e vie de Tudval, moine de Tréguier, IXe/Xe s.), la Vita I S. Winwaloei (1re vie de Guénolé, IXe s.), la Vita S. Wohednouii (Gueznou, Xe s.)...
des textes poétiques comme le Libellulus sacerdotalis attribué à Lios Monocus (Liosmonoc) dans la tradition de la poésie hispérique (le "latin hispérique" était une sorte de littérature latine où se joignaient le jeu et l'érudition, l'adjonction de mots grecs et hébreux, créé par des moines irlandais entre les VIe et Xe siècles).
un petit ensemble d'annales fragmentaires (Annales Rotonenses, par exemple, récemment découvertes et rééditées) et de textes historiques disséminés.
Ajoutons quelques lettres comme la "Lettre à Athelstan, roi d'Angleterre", par Radbod de Dol (vers 927) et les textes liturgiques des missels comme le Sacramentaire d'Angers (Xe).
Les vies de saints sont donc essentielles par le nombre et la qualité, comme dans les périodes suivantes. L'hagiographie avait un but évident : édifier, ce qui autorisait en particulier les rapprochements, voire les emprunts avec les textes les plus connus de la tradition chrétienne, comme nous l'avons indiqué plus haut. Ceci n'est d'ailleurs en rien une spécialité bretonne, mais bien un phénomène qui se prolongera longtemps encore en tout bien tout honneur, la notion de "plagiat" étant une notion moderne. Quelques auteurs des vies sont connus et nous les avons cités : Matmonoc, Bili, Uurmonoc, Uurdisten, Liosmonoc, dont on sait encore qu'il se fixa à Fleury et y composa probablement son Libellus sacerdotallis (dont il reste 500 hexamètres), Clément de Landévennec , nombreux sont les anonymes, ce qui tend à faire penser que ces vies sont des objets de diffusion courants.
Ces récits - examinés et critiqués par Dom Lobineau au XVIIIe siècle - qui courent sur des légendes et des faits fabuleux imprégneront l'imaginaire breton après avoir donné au peuple des campagnes son organisation en paroisse (Plou) avec ses subdivisions (Tre et Lan) et ses traditions, car des versions racontées en langue vernaculaire circulent bien avant les traductions en français au XVIIe siècle par le dominicain de Morlaix Albert Legrand. Ils mettent en scène des personnages aussi fameux que le roi Gradlon et sa fille, la ville d'Is, les moines traversant la mer dans des auges de pierre, appelant la colère des cieux sur les chefs impies, combattant monstres et animaux merveilleux, multipliant les miracles, conseillant les princes, fondant des évêchés nouveaux (Vita Melanii ). En même temps, les vies sont le recueil d'une histoire, nécessaire, car elle donne ses racines à la société, et fournit la justification, par exemple, de la richesse de certaines abbayes, du pouvoir de certains abbés et des princes
Aux XIe-XIIe siècle, cette période noire pour la culture latine de Bretagne (et probablement pour d'autres documents, en langue bretonne, que les clercs jugèrent inutile d'emporter avec eux dans leur exil) est terminée et l'emprise de l'Église sur la vie intellectuelle est plus forte que jamais. De nouvelles vies de saints sont écrites, les plus anciennes sont recopiées et parfois réécrites, améliorées, ornées, versifiées. De nouveaux cartulaires sont commencés et on compose des manuscrits liturgiques.
C'est une époque qui voit apparaître des annales (Annales de Redon, XIe s.), quelques textes historiques, des récits qui sont souvent intégrés à des vies de saints recopiées comme dans les vies de Guénolé, de Gueznou, de Samson, de Gildas ou la Vita Iudicaeli d'Ingomar de Saint-Méen. Ces passages historiques sont cependant d'une transmission tardive et parfois problématique pour leur datation. Ainsi, la Chronique de Nantes (Chronicon Namnetense dont la rédaction se situe entre 1050 et 1060 - histoire épiscopale basée sur les archives de la cathédrale, peu favorable aux Bretons) se trouve en partie dans la Chronique de Saint-Brieuc (fin XIVe siècle) et en partie dans l'Histoire de Bretagne de Pierre Le Baud (1480). La Chronique de Dol (XIe s.) et celle de Quimperlé sont à l'état de fragments.
Le Livre des faits d'Arthur (Xe), qui est d'abord un texte poétique (incomplet), dans lequel est donnée une vision historico-légendaire du Léon, est connu à partir d'un manuscrit déposé aux Archives Départementales de Rennes. Il devait faire partie des matériaux collectés par Le Baud pour son histoire. Il est possible qu'il soit originaire du XIe siècle, bien que des travaux récents aient tendance à lui donner une date de composition plus tardive
Les Vies sont à nouveau très nombreuses.
À côté d'Ingomar de Saint-Méen, probablement, en plus de sa célèbre et très historique Vie de Judicaël, au moins l'auteur de la Vita Mevenni (Vie de Méen), plus encore de textes anonymes, forgés dans les scriptoria : les vies de Brieuc (Vita Briocii - XIe s.), de Budoc (Vita Budoci, XIe-XIIe), Conwoïon (Vita Conwoionis, X/XIe s.), de Corentin (Vita Corentini, IXe ? XIe ? XIIIe ?), de Cunwal (Vita Cunwali), la Vita et miracula Lauri (Laurent, XIe, voire plus tôt), la Vita II S. Melanii (XIe s.), l'Altera translatio S. Maglorii (XIe s.), la Vita S. Euflami (Efflam, XIIe s.), la Vita I S. Gildae (1re vie de Gildas, XIe s.), la Vita II S. Gildae (2e vie de Gildas, XIe s.), la Vita et historia inuentionis et miraculorum S. Gilduini (Gilduin de Combeur, XIIe s.), la Vita S. Golueni (Goulven, XIIe s.), la Vita S. Goneri (Gonéri, XIIe s.), la Vita S. Gulstani (Goustan, XIe s.), la Vita Gurthierni (Goujarne, XIIe s.), la Vita S. Hamonis (Hamon, fin XIIe s.), la Vita I S. Leonari (1re vie de Léonor), la Vita I S. Maudeti (1re vie de Maudez, XIe s.), la Vita II S. Maudeti (2e vie de Maudez, fin XIIe s.), l'Altera translatio S. Maglorii (Magloire, XIe s.), la Translatio S. Matthaei (Matthieu, XIe s.), la Vita II S. Melanii (Melaine, XIe s.), le Miracula S. Melanii (Miracle de Melaine, XI/XIIe s.), la Vita I Melori (1re vie de Méloir, XIe s.), la Vita II Melori (2e vie de Méloir, XIIe s.), la Vita III Melori (3e vie de Méloir, fin XIIe s.), la Vita Mereaduci (Mériadec, XIIe s.), la Vita Meuenni (Méen, XIe s.), la Vita S. Ninnocae (Ninnoc, XIe s.), la Vita III S. Tutguali (3e vie de Tudval, XIe s.), la Vita S. Wohednouii (Goueznou, 1019) À ces vitae, souvent doublées de versions métriques, ajoutons les Litanies des saints bretons disséminés dans plusieurs bibliothèques.
Des missels et bréviaires comme celui de Saint-Georges de Rennes (XIe s.) ou de l'abbaye Saint-Melaine de la même ville (XIIe s.), le Sacramentaire breton (XIe s.), celui de Saint-Méen (XIe s.), le calendrier de Landévennec (XIe s.), contiennent bien entendu prières, homélies, calendriers, hymnes et chants pour la période envisagée.
En cette époque favorable, que l'on a qualifiée de renaissance du XIIe siècle, où partout en Europe commencent à fleurir des littératures en langues vernaculaires, on assiste au début de l'effacement de cette littérature latine de Bretagne.
En effet, le latin conserve et développe son rang de langue internationale, soutenu par le mouvement des écoles de cathédrale et par les créations d'universités. Les intellectuels se déplacent et correspondent davantage. Cet aspect cosmopolite, qui touche forcément la littérature latine de Bretagne fait que d'une part cette littérature - en dépit de sujets touchant à la Bretagne comme la Lamentation sur la mort de Geoffroy II, comte de Rennes (1186) - n'est évidemment plus en rien différente de tout ce qui se compose alors ailleurs.
D'autre part, des auteurs réputés sur le plan européen, nés en Bretagne ou y ayant passé une grande partie de leur vie, produisent des uvres latines qui ne sont pas toujours liées à la Bretagne par leurs contenus, styles ou provenance, mais qui partagent cette vocation cosmopolite : Baudry de Bourgueil (1107-1130), Pierre Abélard (1079-1142), Jean de Châtillon, Marbode, l'évêque de Rennes, Robert d'Arbrissel, Anselm ou Bernard et Théodoric de Chartres
Le premier, archevêque de Dol (né à Meung-sur-Loire en 1060, mort en 1130), est l'auteur de vies de saints comme l'Historia translationis capitis S. Valentini martyris (1153-1164), la Vita S. Hugonis Archiespiscopi Rothomagensis (1163-1172), la Vita S. Roberti de Abrisello (1043-1058) pleine d'enseignements historiques, culturels et religieux, la Vita S. Samsonis, de textes historiques (Hierosolymitae historiae, sur la première croisade), de poésies religieuses comme les Carmina. Il écrit une longue lettre Itinerarium sive epistola ad fiscannenses aux moines de Fécamp pour les remercier de l'avoir reçu plusieurs fois, dans laquelle il donne une description enthousiaste de Fécamp et de son monastère. Son De scuto et gladio S. Michaelis tente d'expliquer les sources du culte de Saint-Michel en Bretagne et il s'interroge sur les reliques déposées au Mont Saint-Michel.
Le célèbre Abélard, né près de Nantes, qui fut un temps abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys, est l'auteur d'une uvre qui a eu une célébrité universelle. On ne retiendra que son Historia calamitum et les passages se rapportant au malaise éprouvé par cet intellectuel naguère fêté à Paris incapable de s'adapter aux usages rustres pour ne pas dire plus des moines bretons. Abélard raconte à un de ses amis ses difficultés à s'intégrer à cette abbaye de Saint-Gildas où il a choisi de s'exiler pour échapper à "la malveillance des Francs", lui qui était une sommité des écoles de Paris et qui devait subir l'implacable vengeance de Fulbert. Ce texte littéraire, autobiographique, donne, comme nous l'avons indiqué plus haut, une image peu favorable des Bretons, de la Bretagne : "une terre barbare, une langue inconnue, une population brutale et sauvage" et des moines aux "habitudes de vie notoirement rebelles à tout frein".
Jean de Chatillon, évêque de Saint Malo, est pour sa part l'auteur de lettres à Saint-Bernard et probablement, si l'on suit Ferdinand Loth, d'une Vita de saint Malo, comme son prédécesseur à Aleth, Donoald, abbé de Saint-Melaine, qui aurait écrit une vie perdue de saint Suliau, dont quelques fragments se retrouvent dans des légendaires et bréviaires du XVe siècle
On lira encore la célèbre Lettre de Robert d'Arbrissel (1047-1117) à la comtesse Ermengarde, l'épouse d'Alain Fergent, qui renferme un ensemble de préceptes pour mener une vie conforme à la religion.
Marbode (1035-1123), évêque de Rennes, était originaire d'Anjou. Nommé évêque en 1096, il reste à Rennes jusque vers 1120. Ses démêlés avec Robert d'Arbrissel sont restés célèbres. Il est l'hagiographe de Licinius, l'évêque d'Angers, de Gualterius, de Robert, abbé de La-Chaise-Dieu, de Magnobod, de Florentius de Glonne. Il a aussi composé de très nombreuses poésies : religieuses inspirées de l'Ancien Testament et de martyres ou passions de saints en hexamètres, didactiques et grammaticales, autobiographiques (Liber decem capitulorum). Ses Carmina varia sont des poèmes de circonstances. Il écrit aussi épigrammes et épitaphes. Son fabliau Le loup qui s'est fait moine (Parabola de fraude a lupo opilioni facta) donne des Rennais et de leurs murs une image satirique.
Enfin, on a de lui six lettres "administratives", dont une à Robert d'Arbrissel et une à Rainald de Martigné.
Si l'on considère les noms qui viennent d'être cités, on constate, à cette époque, une volonté d'appropriation de l'hagiographie par l'épiscopat, qui correspond à une reprise en main par le dogme romain, et aussi au désir de suppléer à un déficit causé principalement par le faible encadrement monastique en Basse-Bretagne, qui, bien que compensé graduellement, sera encore longtemps insuffisant. En Haute-Bretagne, les évêques, se méfiant des scriptoria, se sont plus volontiers tournés vers leurs chapitres cathédraux, mieux aptes à défendre leurs intérêts et à donner des saints une vision moins populaire pour ne pas dire entachée de paganisme. Ils ont alors écrit eux-mêmes ou proposé des canevas à leurs scribes. L'uvre hagiographique de Marbode comprend une douzaine de vies (mais de saints non liés à la Bretagne hormis la possible relation d'un miracle posthume de saint Melaine). Baudry de Bourgueil serait, en plus des ouvrages indiqués à l'origine de la vita de saint Gobrien.
Évêque d'Aleth, Judicaël est l'auteur des vies de son patron Judicaël, de Méen et de Léry. Donoald, qui siégeait à Aleth vers 1120-1142, écrit sans doute la vita de saint Suliau. Jean de Châtillon, évêque de Saint-Malo rédige une vita du saint patron de la cité. À Tréguier, on doit certainement à Martin, chapelain du comte d'Anjou puis chanoine du chapitre cathédral d'Angers, évêque de la ville entre 1049 et 1052-1054, l'initiative de la composition de la vita moyenne de saint Tugdual. Son successeur Hugues, évêque de Tréguier vers 1086, est probablement l'auteur de la première vita de saint Maudez et de la vita de saint Efflam. La vita longue et la vita brève de saint Tugdual continuent au XIIe siècle la production hagiographique de Tréguier alors qu'à Saint-Pol-de-Léon, Omnès, évêque du Léon vers 1047-1055, aurait écrit la première vita de saint Mélar. À Quimper, l'évêque Robert (1113-1130) est auteur de la vita de saint Ronan et d'un ouvrage sur les miracles de saint Corentin. À Vannes, Morvan, qui est le successeur de l'évêque Mengui, pourrait avoir été à l'origine d'une vita de saint Patern
Cet accaparement par l'épiscopat de la matière hagiographique s'accroît vers le milieu du XIIe s. et les saints, même les plus "locaux", sont désormais le plus souvent revêtus des dignités épiscopales, comme saint Gobrien, présenté en qualité d'évêque de Vannes, Goëznou, Goulven, Jaoua et Ténénan, dont les Vies respectives ont été composées à l'occasion de l'établissement du catalogue épiscopal par un certain Guillaume, membre du chapitre cathédral de Saint-Pol-de Léon. Ces habiles "récupérations" sont destinées à donner tout leur éclat aux évêchés, et par là même à renforcer leur puissance séculaire et spirituelle, l'aspect littéraire étant secondaire.
Notons encore ces écrivains plus tardifs qui, le plus souvent hors de Bretagne, poursuivent leur uvre, comme, au XIIIe siècle, Guillaume Le Breton qui, à la cour de Philippe-Auguste, est l'auteur d'une geste et d'un poème épique latins en l'honneur du souverain, la Gesta Philippin Augusti et le Philippidos, ou ces auteurs très fortement soupçonnés d'avoir des attaches bretonnes comme Alain de Lille (ou de l'Île = Ouessant ?) (1128-1202), Adam de Saint-Victor (1070-1146), Alfred de Beverley (autour de 1145), dont l'uvre n'a pas encore été suffisamment étudiée dans le sens des "bretonnismes", d'une couleur locale celtique qu'elle pourrait renfermer. Étienne de Fougères, évêque de Rennes de 1168 à 1178, chapelain du roi Henri II Plantagenêt, poète à ses heures, à la suite d'une illumination, écrit les vies de Guillaume Firmat, l'ermite ayant séjourné un temps près de Vitré et de Vital de Tierceville, dit de Mortain, voire celle de Hamon de Landécot, originaire de Saint-Étienne-en-Coglès
*
L'Historia Regum Brittaniae de Geoffroy de Monmouth (vers 1135) est paradoxalement le signe le plus évident de cet effacement de la culture latine de Bretagne au profit d'un courant cosmopolite : son succès est tel qu'elle véhicule la "matière de Bretagne" dans toute l'Europe occidentale et que les sources dont son auteur s'est servi sembleront longtemps être des imitations de l'imitateur ! En France particulièrement, il inspire les romances et les lais, ceux de Marie de France par exemple.
Pour notre propos, il est peu intéressant de savoir si Geoffroy de Monmouth est d'ascendance bretonne ou originaire de Cornouailles. Nous savons que les relations entre cette région et la Bretagne sont étroites tout au long des siècles et il est certain que l'Historia appartient pour une part à cette littérature latine de Bretagne, dans la mesure où Geoffroy donne bien des aspects des traditions et mentalités bretonnes même s'il vise une audience large, dépassant les limites de la France de l'Ouest. On peut dire la même chose du commentaire de Jean de Cornouailles sur les Prophéties de Merlin (Prophetia Merlini vers 1155). Ces ouvrages et les imitations, développements auxquels ils donneront lieu ont le mérite d'avoir suscité un grand intérêt chez les intellectuels pour les traditions celtiques, ce qui aura d'ailleurs pour conséquence de pousser ensuite certains auteurs bretons à reprendre à leur compte et dans leur langue vernaculaire des aspects de cette "matière bretonne".
L'Historia regum Brittaniae et la Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth situent un certain nombre des aventures d'Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde dans les forêts de l'Armorique, à Brocéliande, et l'auteur intègre à ses uvres certaines des légendes de ces régions, tant le sentiment de la parenté entre les Bretons des deux côtés de la Manche restait encore vif au XIIe siècle ! La vie d'Arthur se déroule à Caerlleon et s'achèvera à Glastonbury, près du tombeau de Joseph d'Arimathie. À Penmarc'h, à Carhaix vivait Yseult aux mains blanches
Bien entendu, Geoffroy n'est pas l'inventeur d'Arthur, pas plus que les clercs ayant rédigé et apprêté les vies de saints n'en sont les auteurs au sens propre, en des temps où l'écriture recueille surtout la tradition orale et la met en forme. On peut évoquer en amont de ces créations écrites, une matière que le souvenir et l'imagination du peuple et des bardes n'ont cessé de remanier, d'élaborer.
Geoffroy de Monmouth est aussi l'auteur ou le vulgarisateur de la légende de Conan Mériadec, le fondateur imaginaire d'un royaume breton d'Armorique dès la fin du IVe siècle, mais, là encore, la mémoire et l'imaginaire ont certainement précédé la rédaction (on parle d'un très ancien manuscrit gallois), ce qui fait que ces textes, même écrits en langue savante, viennent corroborer, fixer, revivifier des légendes sans doute encore assez répandues, prêts, à leur tour, à les transmettre à d'autres écrivains en langues vernaculaires.
L'écriture, comme les traditions, subit ainsi un continuel va-et-vient entre la réalité, la légende colportée oralement, les traditions et l'écriture, une sorte d'association à bénéfices réciproques.
Évoquer la qualité de cette littérature est impossible d'une façon globale et conduirait à des jugements de valeur dénués de sens. Pourtant, F. Kerlouégan, sur le plan formel, tout comme le professeur Léon Fleuriot, ont souligné la bonne tenue des textes et en conséquence le bon niveau de culture des auteurs : la langue est exacte même si le bilinguisme des écrivains affleure parfois, la morphologie et la syntaxe sont également correctes. Si les néologismes et des traits de langue vulgaire ne sont pas rares, il faut peut-être davantage y voir une volonté stylistique, une recherche de couleur locale qu'un signe de médiocrité. On peut être plus sévère pour les vies versifiées ou les passages de poésies intégrées aux vies de saints.
La culture des clercs est également assez diverse, comme nous l'avons rapidement évoqué, culture religieuse bien entendu, mais aussi culture profane. Il est vrai que la quasi-totalité des documents dont nous disposons se situent après les réformes carolingiennes et il serait intéressant de pouvoir déterminer si les moines bretons ont bénéficié de ces réformes ou si déjà, bien avant elles, ils avaient su conserver un certain niveau.
Ce qui est certain, c'est que tous ces textes, en particulier les vies de saints, ont très longtemps modelé les consciences en Bretagne et au-delà.
Éléments de bibliographie
On se reportera au site de la Royal Irish Academy présentant les Archives of Celtic Latin Literature (400-1200) qui offre la possibilité de consulter en ligne plus de 400 textes dont de nombreux manuscrits appartenant à la littérature latine de Bretagne.
Balcou, Jean, Le Gallo, Yves, Fleuriot, L., A.-P. Degalen, L. Le Guillou, D. Laurent, Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, Honoré Champion, Paris, 1987 /1997 (particulièrement les articles de Jean Balcou, Léon Fleuriot et de François Kerlouéarn).
Bourges, André-Yves, La production hagiographique et l'atmosphère religieuse en Bretagne aux XIe et XIIe siècles, 2006.
Deuffic, Jean-Luc, La Bretagne carolingienne, Pecia, 2008.
Lapidge, Michael, Sharpe, Richard, A bibliography of celtic-latin literature 400-1200, Dublin, 1985.
Brett, Caroline, "Breton latin literature as evidence for literature in the venacular, A.D. 800-1300", in : Cambridge medieval celtic studies, no18, p. 1-25, 1989.
La Borderie, Arthur de, Histoire de la Bretagne, Paris, 1896-1906.
Manitius, Max, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Munich, 1911-1931.
Mélanges François Kerlouégan (D. Caso, N. Fick, B. Poulle), Besançon, 1994.
Et les articles et uvres du Morlaisien Léon Fleuriot parus dans les Annales de Bretagne, Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Études celtiques, Hor Yezh etc.
*
Écrivaines bretonnes (1)
Yves Bertho : Ingrid enfin traduit en allemand
J'avais déjà terminé mes études et quitté Rennes lorsque j'appris qu'Yves Bertho venait de publier un livre qui faisait un certain bruit, Ingrid.
Ce livre, je l'ai alors lu avec un double intérêt, d'abord parce que je "connaissais" l'auteur (il était au milieu des piles de livres, plongé dans son mutisme habituel, quand j'avais acheté les Bijoux indiscrets) et en souvenir de cette librairie mémorable comme il devait hélas ! rapidement ne plus en exister. Ensuite, parce que j'avais un oncle, Jean, jovial et bon vivant, qui avait été "pris au STO" disait-il, avant de fabuler sur ses aventures amoureuses dans l'Allemagne nazie, or ce livre parlait (entre autres) du STO : une raison supplémentaire de lire un roman écrit par un Breton et qui venait tout de même de décrocher le prix Ève Delacroix de l'Académie française !
Je me souviens avoir été un peu désemparé par ce texte fort dense, par le regard de ce faux Candide (il peut être très clairvoyant et cynique) débarquant dans l'Allemagne nazie et racontant, parfois assez naïvement, ce qu'il voit, ses rencontres, ses aventures. Un témoignage sur l'Allemagne en guerre par un narrateur sinon au-dessus de la mêlée au moins en retrait. Pourtant, je n'en avais pas gardé un souvenir extraordinaire. Or, je viens de découvrir que ce n'est que maintenant, il y a quelques semaines, que ce livre a été traduit en allemand et, pour la critique allemande, il constitue un petit événement, particulièrement à Brême où se passe l'histoire narrée.
.
J'ai donc décidé de le relire et voudrais profiter de cette chronique pour le rappeler (ou le porter) à la mémoire des lecteurs, car ce livre d'Yves Bertho est un ouvrage vraiment fascinant tant sur le plan de l'écriture que sur celui de l'acuité du regard. L'amateur de littérature ne sera globalement pas déçu et celui qui voudra y lire un témoignage "objectif" (je m'expliquerai plus loin sur ce terme) sur la vie allemande en 1943/44 sera satisfait, tant le roman peut souvent dire plus que l'exposé strictement historique ou le témoignage biographique.
Sur le plan littéraire, certains regretteront sans doute qu'Ingrid soit très ancré dans l'écriture qui faisait fureur dans les années 65-80 : une syntaxe bousculée de manière parfois trop visiblement voulue, une abondance de phrases nominales et de périodes de grande longueur, parfois surchargées, un style peut-être trop volontairement métaphorique, des mises en abyme, un jeu implexe sur le (s) narrateur (s), puisque le personnage principal, Pierre, se dédouble parfois et qu'Ingrid (comme la plupart des personnages) fait entendre deux voix : la sienne et celle qu'interprète Pierre. Cette confusion des points de vue, ces regards croisés compliquent en effet la lecture, mais la rendent aussi souvent envoûtante en ce sens que la complexité des individus, leurs hésitations, leurs potentialités mais également leur incapacité à se définir s'étalent lentement en couches certes épaisses mais transparentes ne se recouvrant jamais complètement. Le titre allemand Ich war Pierre, Peter, Pjotr (J'étais Pierre, Peter, Piotr) constitue en ce sens une bonne introduction à cette lecture plurielle. Et puis, même si en notre époque de tweets, de prêt à l'emploi et à porter, de plats cuisinés-à-réchauffer-au-micro-ondes, on déteste se casser la tête, la bonne littérature ne se donne pas forcément toute cuite, elle demande au lecteur de s'investir, de consentir un effort, de "participer" car elle le respecte !
On sent encore évidemment qu'Yves Bertho n'a pas échappé à l'attrait qu'a pu exercer sur lui le Céline d'Un château l'autre, mais il ne faut surtout pas comparer les deux ouvrages, Ingrid étant en fait un roman d'éducation ou plutôt un Bildungsroman somme toute assez conventionnel en dépit de son écriture, alors que le second est une énorme fresque épique et satirique qui éclate tous les genres et raconte, expose, peint l'apocalypse. Pierre, le personnage d'Yves Bertho, est aussi un anti héros, le "frère" du Bardamus du début de Voyage au bout de la nuit : comme lui, avec la même candeur, il va vers les événements (la boucherie de 1914 pour l'un, le Service du Travail Obligatoire pour l'autre) sans trop savoir pourquoi, poussé sans doute par le désir plus ou moins inconscient de savoir qui il est. Comme Bardamus, il rencontre, perd de vue, retrouve un "Robinson" en la personne de Robert, un Breton à l'étrange personnalité et à la conduite inexplicable. Enfin, les femmes qu'il connaît sont soit des oies blanches qui reflètent sa propre incomplétude (les filles de l'organisation de jeunesse nazie BDM) soit des mères-amantes, des initiatrices comme Blanche puis surtout Ingrid, largement plus âgées que lui, mais extrêmement "rétractile", et qui l'aideront à se "construire" tandis que la ville de Brême s'enfoncera dans la catastrophe finale On peut aussi bien entendu parler ici de roman initiatique puisque le jeune homme inexpérimenté du début du roman acquiert petit à petit des "qualités" guidé (de façon assez erratiques par ses Mentor masculins et féminins, que le travailleur au STO qu'il est devenu "meurt" symboliquement avec l'effondrement de la ville (et du nazisme) et qu'il "renaît" ou pour le moins est prêt à renaître dans le nouveau monde de l'après-guerre (Ingrid à ses côtés pendant et après le bombardement final, "l'OUVERTURE ! la musique formidable", lui redonne - ou donne - la vie : ""Le temps alors s'apaise. La pression des doigts n'agit pas en un point précis de son corps, elle opère sur lui, elle assure seule le passage vital, très dense où sa vie ininterrompue s'écoule lente et brûlante ; il ne doit plus bouger.
Qui est-il ? . D'où vient-il ? .".
Brême après le bombardement de 1944
Pierre écoute alors l'exhortation d'Ingrid : "Mais pars, pars donc !" et après avoir fait l'amour une dernière fois, dans les gravats, abandonnant sa veste - signe de son identité temporaire et "allemande" -, il s'en va : "Il se retourne pour voir à l'ouest les monstrueuses fumées noires pesant là-bas sur l'horizon, au-dessus du port. À l'est, ses yeux le voient enfin : soleil rouge, glorieux, sanglant, qui se lève derrière l'usine à gaz."
Pour le lecteur que ces aspects intéressent moins, il reste que ce roman est aussi une extraordinaire fresque sur l'Allemagne de ces années de guerre. Il est vrai que rares sont les témoignages "de l'intérieur", par un regard assez objectif, celui d'un jeune homme cultivé, un étudiant, possédant l'allemand, qui a été envoyé (et n'a rien tenté pour s'y opposer : il est en recherche de lui-même, son père est mort, sa mère a un amant qu'il refuse ) par le STO à Brême, ce qui lui fait pénétrer la société allemande nazie tout en demeurant en marge de cette société par sa situation d'étranger.
Par les yeux de Pierre, le lecteur découvre une Allemagne nazie inattendue : les parcours en tramway, la jupe d'été des filles, les verres de vin dégustés au Ratskeller, les séances de cinéma, les bals, les amourettes, les balades, les boîtes de nuit interlopes, les bordels, l'homosexualité, les trafics en tous genres , et ce qui frappe le plus le nouvel arrivant qu'il est : la désorganisation, le désordre (le mot revient souvent avec celui de gabegie) du Reich, l'"incompétence allemande", qu'il ne juge cependant pas, se contentant de constater. Pourtant derrière l'observation presque impassible se double souvent d'une ironie que le lecteur doit prendre à son compte comme lorsqu'il rapporte la joie des travailleurs fêtant la centième locomotive fabriquée et portant la banderole "Wir rollen für den Sieg" (Nous roulons pour la victoire) : "[ ] tous les Français voulaient absolument avoir leur photo [ ]" ! Une réaction qu'il explique ainsi : "Le merveilleux dans le travail, c'est l'ici-maintenant, l'occupation bouchée de l'espace et du temps où la dégueulasserie de l'homme ne glisse plus".
Pierre, vaguement étudiant en mathématiques à Paris, issu du milieu bourgeois versaillais est donc requis par le STO et ne fait rien pour y échapper, saisissant l'occasion pour rompre avec une existence qui ne lui convient pas, pour en finir avec la "sujétion familiale" : "J'ai horreur des livres, la terre natale, je m'en fous, j'en ai marre des mamans [ ]". Quitter ce monde (trop) protégé et se plonger dans l'univers du travail manuel lui paraît être une possible jouvence et il est caractéristique de voir combien il jouit pendant ses premiers jours d'activité de voir ses mains salies, sa salopette tachée , comme si cette crasse qui s'empare de lui le nettoyait de la propreté bourgeoise qui l'a jusqu'alors emprisonné. Ce passage à l'usine fonctionne (au début au moins) pour lui à la fois comme une épreuve par laquelle il doit définir des qualités propres, personnelles et une phase de "purification", un "baptême". Cependant, confronté à des tâches sans intérêt (démonter des moteurs d'avion d'abord ), il comprend vite que ce n'est là qu'une illusion et que sa "transformation" exige des épreuves plus grandes : "Comment a-t-il pu croire l'usine formatrice ! Elle déforme, elle ne fait que déformer, elle n'est que le lassant battement du laminoir. Il fallait sa niaiserie d'étudiant pour dresser son sombre prestige, souscrire à ses étouffements, vouloir y naufrager par quel vicieux plaisir." Il a été affecté à Brême-Neustadt aux usines Francke de septembre 1943 jusqu'en août 1944. Quant à en avoir assez des mamans, il passe ses soirées avec Ingrid, une Allemande plus âgée que lui, séparée d'un officier, une femme à la personnalité compliquée appartenant à la bonne bourgeoisie qu'il déteste et désire à la fois. Le personnage principal du roman est cependant la ville de Brême que Pierre parcourt dans de longues flâneries. Il s'occupe à "déchiffrer la ville au hasard" faisant alterner réflexions et observations, des observations qui ne sont pas toujours bien accueillies comme ce premier soir où, dans une boîte de nuit bondée et orgiaque, une Française qu'il observe s'emporte : ""Quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Ma gueule ne te plaît pas [ ]", plus loin, un jeune Polonais fera de même. La ville a deux visages : la vie de tous les jours et la vie sous les bombes, le travail, les déplacements, les glaces qu'on mange avec des jeunes filles gaies mais pas insouciantes et les façades roussies des maisons, les ruines, le brouillard produit pour aveugler les bombardiers, les abris, les pré alertes et les alertes, le vacarme des attaques et le feu, les ateliers des travailleurs obligés, avec la distinction faite entre les Français par exemple (qui ont droit aux abris et sont payés, parfois mieux que les Allemands - ce qui provoque des mécontentements) et ceux qui portent le macaron diffamatoire OST, "marquage atroce", véritables esclaves interdits d'abris. On sent aussi qu'Yves Bertho a lu Brecht (Maître Puntilla et son valet Matti) et a fait sienne la dialectique du maître et de l'esclave, théorisée par Hegel : si le "maître" possède l'esclave, l'esclave fait le maître qui reçoit de lui son statut de Maître. En effet, dans cette ville en passe de s'effondrer comme le Reich, on ne sait plus parfois qui a besoin de qui : les nazis des travailleurs forcés ou l'inverse et les passages où le "Franzose" Pierre est en compagnie de son vieux contremaître, membre du NSDAP, Willy Suhr, sont particulièrement ambigus, une ambiguïté bien plus évidente encore lorsqu'il a cette conversation avec le responsable local de l'organisation du travail, Ackermann, qui évoque les "valeurs" communes qu'un étudiant devrait partager avec lui, cadre, membre du parti, esthète, homme de culture. Il tente de le convaincre de quitter le travail à l'usine pour devenir un de ses "hommes de confiance". Pierre écoute peu, pense à d'autres scènes qu'il vient de vivre, bien plus troublantes que ce discours et refuse : il restera ce qu'il est pour ne pas renouer avec la vie qu'il a voulu quitter en venant à Brême : "[ ] n'était-il pas venu se perdre en Allemagne, s'éloigner, s'y cacher, échapper au lassant ressac d'une vie stérile ?"
Brême est aussi assez vide : les hommes sont au front, les enfants sont envoyés à la campagne car la cité est une cible privilégiée. Il ne reste que des femmes, des personnes âgées et une foule de travailleurs venus, déportés de l'Europe entière, un "échantillonnage linguistique", note Pierre. Brême est une Babylone de la décadence. Pierre fait des rencontres marquantes : Robert, l'étrange compatriote, qui tire comme il le peut son épingle du jeu, Madame Blanche, ancienne maquerelle (qui le déniaise) et qui a la haute main sur certains trafics du marché noir, qui gère les économies des travailleurs du STO qui le veulent. Il fait la connaissance de Russes, d'Italiens, de Polonais, de Hollandais, d'Ukrainiens Pierre décrit tout ce qu'il voit sans émotion, de manière neutre, quasiment apolitique, sans laisser percevoir ni la peur ni l'angoisse ni le désespoir ou la nostalgie de sa vie d'avant et, en ce sens, Ingrid témoigne de l'effondrement de la ville de Brême et par-delà le cas d'espèce de la ruine d'un monde, sans que la réflexion idéologique ou éthique se fasse directement sentir (ce qu'on lui a reproché lors de la parution) : "[ ] devenir travailleur, - travailler en Allemagne ou ailleurs. Quelle comédie". Ceci dit, Yves Bertho ne dissimule rien : si parfois, Pierre semble vivre assez agréablement dans cette ville en proie à une guerre qui n'est pas la sienne, il observe tout autant le mal des temps, les courses vers les abris, l'attente dans l'obscurité, la présence obsédante de tous ces déportés en apparente liberté dans la ville, les équipes qui travaillent à la chaîne pour la production de guerre, maintiennent la voirie et les tramways en état, les travailleurs de l'Est considérés comme appartenant à des races inférieures Car la guerre ne se voit pas seulement dans les ruines de la ville, elle hante les cafés, les promenades, les cinémas, les esprits, la présence des uniformes des soldats nazis ou des organisations de jeunesse, les drapeaux, les portraits "du" Hitler, Stalingrad encerclé Ce qu'Yves Bertho montre aussi parfaitement c'est que la vie, en quelque circonstance que ce soit n'est jamais simple, qu'on ne peut jamais la peindre en noir et blanc, que tout se tient. Il est difficile de séparer normalité et guerre, étrangers et Allemand, amis et ennemis, amour et haine
En bref, la richesse, la diversité de ce livre en fait le prix car, constitué de plusieurs strates qui communiquent, il est à la fois, le témoignage d'une écriture particulière qui essaye de saisir l'évanescence des êtres, leur irrésolution, leur évolution, la complexité de la vie, le roman d'une éducation, un roman d'amour, un roman de guerre, le roman d'une ville et de la catastrophe propice à un nouveau départ, une autobiographie Yves Bertho, par l'acuité de son regard et son refus de prendre parti, s'oppose à tous les clichés et, en ce sens, son livre est en plus de toutes ses qualités littéraires, un vrai témoignage.
Dans une interview accordée à Helga Bories-Sawala, Professeur à Brême et spécialiste à la fois de littérature et d'histoire contemporaine, Yves Bertho confiait que pour écrire son roman, il a beaucoup travaillé au début des années soixante-dix aux archives de la ville, notant les noms de rues, de boutiques, de cafés, le parcours des lignes de tramway, les événements de la vie de la ville, les bombardements , toutes choses qu'il n'avait plus précisément en mémoire. C'est ce qui fait que son roman peut passer par certains aspects pour un véritable document et explique l'intérêt qu'on lui porte actuellement en Allemagne.
On comprend que Jean-Luc Godard ait eu l'idée d'en faire un film et que l'auteur de Pierrot le fou eût été sans aucun doute le seul capable de le réaliser !
Yves Bertho est né à Quimiac en 1921 et décédé le 25 mai 2013.
Indications bibliographiques
Amette, Jacques Pierre, "Vacances de fin du monde", in : Le Point, 18 octobre 1976.
Arnaud, Patrice, "Les femmes de l'ennemi. Représentations et réalités des liaisons amoureuses franco-allemandes des travailleurs civils français en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale", in : Hommes et masculinité de 1789 à nos jours, Paris, 2007.
Karlheinz Walraf, "Bremen im 2. Weltkrieg - Gesehen von einem Franzosen" Bremisches Jahrbuch, 1977.
Et le numéro spécial de la revue Lendemains sur le STO : Reichseinsatz : Französische Zwangsarbeiter in Deutschland 1942-1945, no 101/102, 2001, particulièrement l'article de Marcella Kuhn, "Der Roman Ingrid von Yves Bertho".
Ajoutons que la vision de l'Allemagne nazie en guerre que livre Yves Bertho s'éloigne des clichés qui généralement traitent de cette époque : espionnage continuel, raideur germanique, militarisme à tous crins, soumission sans exceptions à la dictature, le fonctionnariat allemand qui ne laisse rien échapper, une organisation sans faille "Qui traitent de cette époque", ai-je écrit, mais en fait ces clichés existent toujours or pour qui vit dans ce pays avec le regard de Sirius, un certain laisser-aller, le goût de la farniente, la joie de vivre voire pas mal d'indiscipline sont aussi (d'abord ?) la réalité de ce pays.
Nicolas Barrera, vie et oeuvre Un peintre : l'Académie de Leningrad, la guerre, le camp de centration, l'Espagne, Marseille, Paris, les Saintes-Maries -de -la -Mer, L'Allemagne
Littérature et Islamisme (Article de 2018)
Il fallait s'y attendre, la discussion sur l'islamisme est entrée en littérature. Normal ! Les hommes de plume ont toujours donné leur avis sur le monde comme il va. Ils sont d'ailleurs pas mal là pour ça. Et puis, c'est la thématique dans le vent, il y a gros à gagner. Financièrement, j'entends, parce qu'au niveau des idées Mon avis d'humble lecteur sur deux textes aux gros tirages.
Houellebecq et Soumission : du copié-collé ?
Soumission. On en a fait tout un fromage. Les raisons éditoriales et commerciales n'ont rien épargné : en pleine tragédie de Charlie, on invente un aspect sulfureux au roman, des menaces seraient proférées, une fatwa éventuelle, fuite éperdue de l'écrivain qui se prête au jeu L'argent n'a pas d'odeur et prospère à l'ombre de l'horreur en technicolor. Chacun sait cependant que tout cela fait simplement partie de la stratégie de lancement du nouveau produit Houellebecq. De la com', de la pub, de la stratégie commerciale. Malgré tout, en bon Français, on se dit qu'il faut le lire ce bouquin même si on n'a pas trop accroché aux autres Houellebecq. Comme on est prudent, on pense malgré tout qu'avant de foutre en l'air 21 euros, on va attendre la sortie en livre de poche. On attend, rien ne vient, les maisons d'éditions veulent faire avant tout du chiffre, l'édition à pas cher, ce sera pour plus tard. Heureusement, un ami qu'on a invité à un couscous-fait-maison, vous l'offre avec un extraordinaire à propos vu le menu proposé.
Alors, le couscous avalé avec ou sans harissa, le couscous digéré, quelques jours après, on se décide à lire son cinq ou sixième Houellebecq, se promettant au fil des pages que ce sera le dernier (mais c'était déjà la décision prise au second roman !).
Pénible lecture mais les chapitres sont minces.
Waterloo, morne plaine. Un roman (?) torché (mais c'est sans doute la marque de fabrique Houellebecq) : des phrases bancales, des répétitions pas stylistiques du tout, parfois un usage des temps et des modes à la limite de l'acceptable Liberté de l'auteur, pâle lecteur, Béotien coincé ! Tu ne vas tout de même pas t'en tenir à ces bagatelles !
Pourtant, j'ai du mal à accrocher. Un récit qui se traîne assaisonné de digressions nulles, du couper-coller sur Huysmans tiré d'internet, peut-être revu par un maître de conférences qui aurait aidé l'auteur comme l'affirme une note, des pages de cul sans entrain ni imagination, des personnages marionnettes
Mais tout cela, encore une fois, c'est peut-être la patte Houellebecq, un côté grunge, un humour qui peut faire plaisir à certains. Rien contre, même si ce n'est pas mon verre de pinard. Je dois avouer avoir souri de temps en temps et délaissé par instants les ciseaux d'Anastasie.
En revanche, au niveau des idées, ce n'est plus Waterloo, c'est le vide sidéral. Qu'apporte Houellebecq à une problématique bien actuelle ? Rien ! La pirouette finale n'est même pas amusante. Une brève de comptoir, au plus. On peut bien entendu réfléchir à cette perspective d'un islamisme accepté par tous et surtout par les mecs parce que, se laissant aller à leur penchant naturellement (?) macho, ceux-ci auraient dans le fond tout à y gagner. On peut y lire la dénonciation ironique d'une régression détestable. Il faut certes pour cela faire des efforts, mais un auteur digne de ce nom attend justement ces efforts de la part de ses lecteurs. Un moyen de les associer à son uvre. On peut tout justifier au royaume des lettres. Comme en peinture, comme dans tous les beaux-arts évidemment ! Tout dépend des lunettes que l'on chausse !
Ce qui me gêne davantage, c'est que Houellebecq s'est rappelé ses lectures de potache : Rhinocéros ! Mais son héros n'est pas Béranger (ce qui est tout à fait son droit).
Ionesco a donné une fable dont la richesse est justement qu'elle est inépuisable. Que la rhinocérite à laquelle succombent un à un les individus, la société qu'il met en scène, représente les religions, le fascisme, le stalinisme, le consumérisme, le prêt-à-porter intellectuel, les modes , importe peu. Cette pièce dénonce tout ce qui menace la liberté et l'individualité, tout ce qui déshumanise une société, et sa richesse réside dans le message atemporel et subtil qu'elle délivre. Quant au héros, Béranger, il entre, lui, vraiment et volontairement en résistance : "Contre tout le monde, je me défendrai ! Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout ! Je ne capitule pas !"
Houellebecq copie la démarche et en fait la caricature. Rhinocéros a une valeur paradigmatique alors que Soumission est sans épaisseur, sans portée, sans élan. La mollesse d'un abandon même si bien sûr la perspective de cet abandon peut révolter le lecteur et l'amener à réagir Mais l'uvre littéraire (question éternelle) a-t-elle pour fonction d'aiguillonner les lecteurs, de les amener à prendre position ? Est-elle simplement un moyen ? Est-elle une fin en soi ?
La pièce de Ionesco ou La Peste de Camus sont des uvres qui, si elles s'ancrent forcément dans une réalité la transcendent, continuent à vibrer bien après les événements comme un gong résonne bien après le choc du marteau, éternellement.
Soumission n'est qu'une longue de comptoir !
Patron, remettez une tournée.
Le second bouquin, je l'ai acheté. J'avais bien aimé deux ou trois livres de Boualem Sansal et, la pub aidant, son utopie funèbre, 2084, me semblait être une fameuse idée.
Accrochez-vous lecteur, on n'est plus dans le même registre que Soumission ! Pas étonnant qu'à ce que l'on dise, l'auteur n'ait pas trop apprécié les félicitations (collégiales ? pontifiantes ? maquignonnesques ?) de Houellebecq !
L'histoire n'est pas simple. On a parfois l'impression que l'auteur se cherche et que les épisodes s'enchaînent sans avoir été vraiment prévus. Mais bon, roman utopique, roman d'une recherche, on n'a pas à s'embarrasser de cohérence absolue et puis on suit avec intérêt la quête mi-erratique mi-merveilleuse de son personnage principal. Le fait que nous (et le héros) soyons entraînés dans un monde imprévisible et confus a son charme et peut porter en soi sa leçon. 2084 appartient à ce genre de livres qui demandent une première lecture de "désensibilisation", de lessivage de ses habitudes littéraires, et une seconde (au moins !) lecture qui permet de mieux profiter d'un ouvrage poétique malgré son sujet et souvent fascinant.
L'histoire se passe donc en Abistan, un pays qui a vocation d'être désormais le monde. Il est l'aboutissement de conflits et de guerres qui ont permis au culte de Yölah de s'implanter sur la planète. La dictature religieuse, la théocratie, impose ses lois : le peuple vénère Yölah et son prophète Abi. On prie neuf fois par jour ; la femme est un être inférieur. Les exécutions publiques de mécréants ou d'ennemis, les pèlerinages entretiennent pour ainsi dire la foi des masses. Pourtant, avec le personnage central, Ati, on découvre que ce monde qui se veut parfait dans sa foi et ses pratiques est parcouru de failles : d'abord, d'où viennent ces ennemis qu'on exécute pour l'amusement et l'édification des foules ? Et pourquoi ? Pour les foules qui se refusent à se poser des questions, seul le spectacle, ces nouveaux jeux du cirque comptent : panem et circenses. Le peuple vit dans la misère mais en contrepartie, il a droit à ces spectacles, il prie, il part en pèlerinage et mange à sa faim le plat national, une bouillie infâme mais nourrissante que, par habitude, il trouve délicieuse.
Nous sommes plongés dans un monde ayant apparemment réalisé les promesses du prophète. L'histoire n'a plus de signification pour les générations de ce temps, le présent est décrété éternel. Le vieux monde s'est effondré à la suite de la Grande Guerre sainte et avec lui ont disparu tout ce qui le structurait : la langue, les livres, les musées, les meubles, les habits, une nourriture variée en un mot la culture. L'Abistan est désormais le royaume de Yölah et Abi est son délégué, son représentant sur terre. On y parle une langue particulière, l'abistan, langue nouvelle conçue pour éviter la réflexion, les pensées trop profondes. Pourtant, dans ce monde réglé au millimètre, des bruits courent, des on-dit invérifiables ou subtilement véhiculés par le pouvoir : Abi vivrait dans d'innombrables palais, la Grande Guerre n'aurait pas exterminé tous les "ennemis", les mécréants, bien que la langue même ne connaisse pas le mot , des mots sont inventés (certains vont jusqu'à affubler Abi du nom de Bigaye = Big Eyes. La dette envers Orwell est malicieusement soulignée). Là commence le doute par rapport à la doxa officielle. Le héros du roman, Abi, Candide inquiet mais curieux, est amené au cours de pérégrinations forcées puis plus ou moins volontaires, à entrevoir derrière cette doxa un ensemble de faits qui démentent tout ce que les foules croient : il existerait encore de territoires qui échapperaient à l'Abiland et ces territoires seraient même tolérés pour permettre les trafics de toutes sortes. D'ailleurs, tout en affirmant la fin des temps et la toute-puissance de Yölah et d'Abi son représentant, le système fait courir le bruit de la nécessaire poursuite de guerres contre des ennemis possédés par le mal, ce qui justifie les exécutions massives et maintient une pression. Abi découvre naïvement toutes ces manipulations, les mensonges par rapport aux anciens temps, l'existence d'une histoire falsifiée. Il découvre aussi qu'une élite sans scrupule profite du système et vit dans l'abondance tandis que le peuple est cantonné dans une pauvreté et une ignorance extrêmes.
Les thèses de Boualem Sansal sont claires : son essai Les fous d'Allah montrait comment l'Islam conquiert le monde et il n'excluait pas que la France puisse devenir pays islamique. Pour lui, l'Islam est la seule force montante capable de prendre le pouvoir et de l'assumer partout dans le monde parce qu'il dispose de l'énergie nécessaire et d'un potentiel de violence suffisant. Il considère comme particulièrement dangereuses les situations en France, en Grande-Bretagne, en Russie, aux États-Unis ou un islamisme occidental particulièrement habile prend de l'importance sous le regard désemparé et impuissant des démocraties. Dans 2084, les prévisions de l'essai et la vision pessimiste de son auteur, nouveau Cassandre, se sont en quelque sorte réalisées : désormais plus besoin de djihad ou d'attentats meurtriers, les individus réifiés se soumettent volontairement, obéissent mécaniquement aux lois et à la règle imposées par Abi et ses sicaires. Pourtant, l'itinéraire d'Abi le montre, il reste une étincelle d'espoir : les individus ne sont pas totalement soumis, il demeure en eux une potentialité de révolte, que ce soit par les trafics illicites auxquels beaucoup d'entre eux se livrent, par la remise en question des dogmes imposés à la suite de découvertes fortuites et du resurgissement du vieux temps, par la persistance souterraine dans l'esprit de certain de Démoc !
Sansal peut être aussi difficile à lire que l'est Assia Djébar, ce qui n'est pas peu dire : un esthète verra dans cette écriture une performance, une maîtrise incomparable, une richesse formidable. Il aura probablement raison, mais à suivre le parcours d'Ati, je dois avouer, moi qui ne suis justement pas un esthète mais un liseur lambda, que j'étais parfois à la limite, pas loin de l'AVC. Heureusement, les chapitres sont en général courts et on peut reprendre souffle ! Que le roman ait été interdit en Algérie était prévisible de la part de Bouteflika et de sa clique mais il y a peu à croire que ce texte assez complexe aurait été dévoré par les masses.
Dans l'ensemble donc, un livre important, incomparablement plus riche sur tous les plans que celui de Houellebecq et qui vient compléter les avertissements que nous donne Sansal depuis longtemps. J'ai simplement regretté que cette uchronie n'ait pas été traitée avec un peu plus de légèreté. J'ai parlé d'Abi comme d'un nouveau Candide. J'aurais aimé que Boualem Sansal fasse couler dans sa plume un peu de l'encre de Voltaire. Sa leçon n'en aurait certainement pas perdu de sa force.
Imagologie : la représentation de la Bretagne et des Bretons <em></em>
Ils ont des chapeaux ronds vive la Bretagne Ils ont des chapeaux ronds, viive(nt) les Bretons.
Notes :
1Le sujet est largement exploité. Pour s'en convaincre, il suffit de taper sur un moteur de recherche les termes archétype, cliché, le Breton, la Bretagne pour voir apparaître plusieurs pages de références. Nous nous permettrons d'y renvoyer le lecteur. Le présent texte était à l'origine destiné à l'Encyclopédie de la Bretagne (éditions Dumane)
2Pour en revenir à Colette Baudoche, il est intéressant de noter combien l'Allemand de l'époque de la parution du roman, prisonnier de ses propres a priori sur la "grandeur germanique", refuse de voir en Asmus une caricature et ne veut le comprendre que comme un Allemand cultivé, ouvert à la France, curieux de la France, un "Allemand de Königsberg, qui porte toutes les caractéristiques de sa race" Frankfurter Zeitung, no 86, 27 mars 1909, F. Vogl " Der Mezer Roman von Maurice Barrès". Les caractéristiques (négatives) du personnage de Barrès étant positivement réinvesties par le journaliste. Voir Wiebke Bendrath, Ich, Region, Nation: Maurice Barrès im französischen Identitätsdiskurs, 2011.
3Le sujet concernait le Discours sur l'universalité de la langue (1784) et Rivarol ne l'obtint que parce que le prince Henri, frère du roi insista pour qu'il en fut ainsi, ce qui provoqua bien des tensions à l'Académie, dans Berlin et dans les pays allemands. Le professeur Schwab, qui avait produit une dissertation beaucoup plus scientifique fut déclaré ex-aequo, ce qui calma un peu les susceptibilités. Voir F. Labbé, Berlin, le Paris de l'Allemagne, Orizons, Paris, 2013 et F. Labbé, Jean-Charles Laveaux, un aventurier littéraire, Honoré Champion, Paris, 2018.
4Voir la note précédente.
5Voir Siebenmann, 1992: 1 et Fischer, 1981: 46
6Texte d'Émile Souvestre.
7De bello Gallico [5,14] "De tous les peuples bretons, les plus civilisés sont, sans contredit, ceux qui habitent le pays de Cantium, région toute maritime et dont les moeurs diffèrent peu de celles des Gaulois. La plupart des peuples de l'intérieur négligent l'agriculture; ils vivent de lait et de chair et se couvrent de peaux. Tous les Bretons se teignent avec du pastel, ce qui leur donne une couleur azurée et rend leur aspect horrible dans les combats. Ils portent leurs cheveux longs, et se rasent tout le corps, excepté la tête et la lèvre supérieure. Les femmes y sont en commun entre dix ou douze, surtout entre les frères, les pères et les fils. Quand il naît des enfants, ils appartiennent à celui qui le premier a introduit la mère dans la famille." César présente de façon très positive les deux expéditions qu'il a conduites : tous les affrontements se font à l'avantage des Romains, malgré, parfois, quelques difficultés (le premier débarquement, les chars bretons, la cavalerie, quelques échecs dus aux conditions météorologiques ) : il faut bien souligner le prix de la victoire ! Le plus remarquable est de constater que César inverse le déroulement des opérations faisant des Bretons les agresseurs (§ 27 du livre IV) !
8"Ego igitur, oppido quodam oriundus quod in ingressu minoris britannie constructum, ab urbe Namnetica versus orientem octo credo miliariis remotum, proprio vocabulo Palatium appellatur, sicut natura terre mee vel generis animo levis, ita et ingenio extiti et ad litteratoriam diciplinam facilis." (Quant à moi, je suis originaire d'une place forte construite à l'entrée de la Bretagne, à huit milles, je crois, à l'est de Nantes. Son nom précis est Palais. S'il est vrai que je dois naturellement à ma terre natale comme à mes ancêtres d'avoir fait preuve d'un caractère vif, je leur dois aussi d'avoir montré une intelligence capable d'aller vers les disciplines littéraires avec beaucoup de facilité." Historia calamitatum, Vrin, Paris, 1978).
9Chronique de Raoul Glaber, surtout le chapitre III du Livre II (Guizot, Collection des Mémoires de l'Histoire de France, Paris, 1824)
10M. Jones, Préface au livre de Frédéric Morvan, La chevalerie bretonne et la formation de l'armée ducale: 1260 à 1341, PUR, 2009.
11Il faudrait y ajouter une sexualité... débordante. En 2013, dans l'article qu'il consacre à Mangourit du Champ-Daguet (Le Monde maçonnique des Lumières, vol. III, P. 1874), Charles Porset écrit ainsi que ce qui intéresse le jeune homme à Paris c'est d'abord la lumière tamisée des bordels : "Comme tout Breton de bonne souche" !
12Voir F. Labbé, Bertrand Du Guesclin, le Dogue Noir de Brocéliande, Fanch Babel Éd., 2019.
13Voir François Labbé, Bertrand Du Guesclin, le Dogue Noir de Brocéliande, 2019.
14En Allemagne même, on sait que pour un Français de la bonne société un nom breton paraît ridicule. Helfrich Peter Sturz écrit ainsi (en français) une saynète satirique (Dialogue sur les Français et les Allemands, 1784) dans laquelle il fait parler des Français imbus de leur nation et se moquant des Allemands. Un des personnages évoque "Clostoque" (Klopstock). À ce nom impossible, tout le monde soupire et un abbé se voulant spirituel ajoute : "Le nom est bas-breton, je pense" !
Histoires figurales : des monstres médiévaux à Wonderwoman, Paris, 1998.
15Dans la première moitié du XIXe siècle, les écrivains et artistes bretons se retouveront aussi à Paris et le journal Le Globe sera souvent une adresse de ralliement (voir plus avant)
16Pelloutier fut généralement apprécié en France, En Allemagne, Johann Christoph Adelung (créateur du dictionnaire et de la grammaire) fut en revanche plus que réservé. Plus tard, l'uvre de Pelloutier fut au centre de la dispute entre celtomanes et germanomanes, qui prospéra sur le nouveau nationalisme allemand né à la suite des campagnes napoléoniennes.
17Notons que c'est aussi l'époque où un historien d'origine bretonne Jean Charles Laveaux (1749-1830) publie son Histoire de premiers peuples libres qui ont habité la France (1798), dont une des thèses est que si les Romains puis les Francs se sont imposés aux populations locales (les Gaulois), si ces derniers ont formé majoritairement le peuple, c'est dans ce peuple - épargné par la corruption romaine, franque ou féodale, que s'est trouvé le ferment du sursaut national
18Tableau pittoresque de la Suisse, 1791. On se reportera à F. Labbé : " Un neveu de Rameau breton, Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle (1749-1807)", Centre d'Histoire de Bretagne.
19Jean Rohou cite dans Fils de Plouc, parmi d'autres témoignages de "Parisiens", Jean Cau qui, dans l'Express, évoque un voyage en Bretagne en 1959 : "le Moyen Âge [ ] ; on est au bout du malheur et du monde". Son portrait de l'indigène rencontré est un condensé de tout ce qui se colporte : alcoolisme, idiotie, sournoiserie, saleté, odeur repoussante, hébétude
20Georges Cadoudal est né en 1771 dans une famille de paysans aisés, à la ferme de Kerléano, en Brech. Sa force était proverbiale et à la restauration ses frères seront anoblis par Louis XVIII. En 1788-89, avec les collégiens de saint-Yves de vannes, ses condisciples, il est ouvert aux idées nouvelles. Lorsque le futur général Moreau, alors meneur des étudiants de Rennes, s'oppose à la noblesse en janvier 1789 et appelle à l'aide la jeunesse bretonne, les collégiens de saint-Yves lui envoient un courrier et forment une "compagnie" commandée par Georges Cadoudal et devant partir pour Rennes! La constitution civile du clergé marquera la fin de son enthousiasme révolutionnaire, comme celui de la plupart de ses amis.
Voir : Vendée, chouannerie, littérature: actes du colloque d'Angers 12-15 décembre 1985, PU d'Angers, 1986.
21Voir sur ce sujet : Bernard Peschot, " L'image du Vendéen et du Chouan dans la littérature populaire du XIXe siècle", in : Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1982, pp. 257-264.
22Voir principalement : David Steel, Émile Souvestre Un Breton des lettres, 1806-1854, Rennes, 2013. Sur l'apport de Souvestre : Fañch Postic. "Le rôle d'Emile Souvestre dans le développement du mouvement d'intérêt pour les traditions orales au XIXe siècle.. Actes du colloque : Emile Souvestre, écrivain breton porté par l'utopie sociale, 2006, Brest,. pp.117-136. ffhal-00453568f
23Rappelons que ce personnage à la fois historique et légendaire, peut apparaître comme une chouanne gauloise, une Vierge héroïque. Elle incarne la résistance nationale à une occupation illicite.
Se reporter par exemple au site de Christian Souchon: http://chrsouchon.free.fr/home1b.htm
24A year in western France, 1877.
25Voir les premières photographies prises en Bretagne sur bcd.bzh/becedia.
26Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'elle soit déclarée authentique !
La petite culotte blanche, Balthus à Riehen/Bâle
Avoir la possibilité de se rendre souvent à la Fondation Beyeler à Riehen, près de Bâle est une chance extraordinaire, surtout quand on possède la carte musée de la Regio (Allemagne, France, Suisse : 250 musées). Le cadre est déjà un vrai bonheur, le parc et son pavillon, les jeux d'eaux, les perspectives et les allées, les vieux arbres majestueux, les pavillons de l'ancienne villa patricienne, la construction de Renzo Piano , en bref, une entrée en matière digne des uvres présentées.
Après la très enrichissante rétrospective Giacometti-Bacon (surtout quand on a visité l'expo de Landerneau), la Fondation a eu la bonne idée de montrer un artiste méconnu pour l'exposition automne hiver : Balthus.
Tout le monde a entendu parler de Balthus ou vu telle ou telle uvre de ce peintre sans vraiment le connaître et, si un Flaubert moderne écrivait un Nouveau Dictionnaire des idées reçues, à l'article Balthus, on pourrait sans doute lire : "Peintre qui regarde sous les jupes des fillettes de 10-12 ans et veut faire accroire que le slip immaculé de ces adolescentes est le symbole de sa propre pureté morale, le cache-sexe de ses propres turpitudes" !
En bref, Balthus, c'est la petite culotte blanche !
Alors, évidemment, chacun mine de rien, a envie de voir, pour ne pas dire toucher du doigt ! Une première question qui se pose sur le chemin de l'expo : Comment se peut-il qu'une fondation aussi réputée, à Riehen, petite ville bon chic bon genre de la banlieue bourgeoise de Bâle, en Suisse, ose présenter un peintre aussi discuté, au moins sur le plan moral, à une époque où l'on se veut, en dépit des apparences, à nouveau très "collet monté" ?
En tout cas, c'est osé, se dit-on en posant son manteau à la garde-robe ; on va voir ce qu'on va voir . D'ailleurs, quand l'exposition a été annoncée en 2016, les commissaires, rendus prudents par l'article paru dans le grand journal suisse le Neue Zürcher Zeitung à propos de la grande rétrospective Balthus de New York, marchaient sur des ufs. On pouvait en effet y lire que l'exposition rendait le visiteur complice du regard voyeuriste "de l'artiste. Plus récemment, en ces temps de rigueur morale, de Me-Too, de Balance-ton porc et de Hashtags divers et variés, une pétition signée par plus de 10000 personnes exigeait du Metropolitan Museum of Art in New York qu'il décroche le fameux tableau du maître Thérèse rêvant (la petite culotte, encore !) pour cause de voyeurisme et d'enfants dégradés en objets sexuels ! Tout cela rappelle les feuilles de vignes de Léon XIII.
Heureusement, la Fondation Beyeler a tenu bon et présenté ce qui était pour beaucoup un pari difficile à tenir.
Pour notre plaisir ! et pour rendre un hommage dû à un des artistes les plus remarquables du siècle. Une disposition parfaite et aérée sur 7 salles permet à la ronde des 40 uvres présentées d'emporter avec elle le spectateur. Les curateurs Raphaël Bouvier et Michiko Kono ont bien sûr tenu à ce que Thérèse soit présente et elle entraîne, en quelque sorte, cette ronde.
Pour jouer sur les mots. Oui ! On peut dire que Balthus est un voyeur, mais en même temps un montreur. Que peut-on attendre d'autre d'un artiste ? Ce qui frappe un visiteur moderne, c'est certainement moins la charge "pornographique" dénoncée par les soi-disant gardiens du bon ordre moral que cet art de peindre l'instant, l'entre-deux, le moment fugace auquel on ne prêterait peut-être pas attention : entre le réel et le songe, entre l'enfance et l'adolescence, entre la femme et l'homme, entre la jeunesse et la vieillesse, la beauté et la monstruosité. Le moment filigrane insaisissable, mais saisi par le pinceau d'un peintre qui recherche en fait le dessous (!) des choses. Certainement, la plupart des uvres sont voyeuristes, car elles montrent ce qu'on ne verrait pas autrement, ce sur quoi on refuse peut-être de s'arrêter. Une petite fille qui rêve sans se préoccuper de quoi que ce soit, sans prendre garde à une tenue quelconque, sans pose. Dans son monde à elle, entre deux âges peut-être : voilà Thérèse ! Le moment saisi et étrangement fixé dans une image figée, presque placative, sans effets, quasiment "morale", prise dans les glaces de couleurs vernissées d'une jeunesse au bord d'une sexualité naissante et d'une enfance encore présente. Un sujet qui ne peut que toucher chaque être, le renvoyer à sa propre histoire. Que la jupe de l'enfant ait glissé sur le genou et dévoile le triangle du sous-vêtement n'a rien à voir avec une stimulation perverse et érotique du visiteur. Ou alors, c'est son problème, au visiteur ! Le voyeur, c'est lui. En toute liberté. Non ! Ce dévoilement est davantage le signe de l'ingénuité, de la distance qu'il y a désormais entre nous, adultes, et cet enfant sans complexes ni intentions. Mais si nous oublions notre "statut" d'adulte, alors on peut tout autant y lire une vraie proximité, une intimité absolue. Le peintre n'est pas du tout le libidineux voyeur voué (par certains soi-disant gardiens du bon ordre moral) aux gémonies, mais un voyant au sens rimbaldien du terme. La toilette de Cathy et La jupe blanche (liées à ses lectures et à sa relation avec Antoinette de Watteville) vont aussi dans ce sens d'un jeu de la représentation hésitant entre dissimulation et dévoilement, une thématique qui restera centrale toute la vie du peintre. Les beaux jours, tableau d'intérieur bourgeois, montre ainsi une jeune femme nonchalante et rêveuse, poitrine quasiment dévoilée, jambes nues, allongée sur un canapé. On peut trouver la pose lascive ou pas. Cette jeune femme se regarde dans un miroir tandis que dans l'ombre un homme demi nu active le feu dans la cheminée. Deux mondes : celui du rêve éthéré et celui de la réalité de Vulcain.
Dès sa première exposition en 1934 Balthus a été autant détesté qu'admiré. Personne n'avait été insensible. On avait voulu en faire le Freud "de la peinture, celui qui dévoile les monstres qui sont en nous et que nous cherchons à dissimuler. Il est vrai que le jeune peintre avait un peu joué de cette approche pour se faire un nom, alors que l'artiste qu'il a été a su creuser son propre sillon loin des modes et des influences et si d'aucuns veulent y voir telle ou telle forme de l'art moderne, l'influence du surréalisme par exemple, tout cela reste périphérique comme le prouve l'exposition de Riehen. Son grand format La Rue a beaucoup fait parler avec ses personnages étranges, cet homme qui s'éloigne de dos, ces visages énigmatiquement monstrueux, les murs , mais il s'agit certainement moins d'une peinture narrative que de scènes simultanées mais stoppées dans leur vol, figées, comme prises dans les glaces, éternelles. Avec Passage du commerce Saint-André, ce grand format particulièrement impressionnant, il accentue cette étrangeté avec des personnages tous fantomatiques, des enfants, des adultes, des vieillards..
D'autres aspects de ce peintre sont mis en valeur dans cette exposition : l'humour (Le roi des chats), le goût de la mise en scène (Place de l'Odéon) Le témoin aussi : comme contre-feu à la guerre dont il revient brisé, il réalise des paysages et des idylles champêtres (Le cerisier) ; "Quand j'ai été démobilisé en 1940, j'ai peint Le cerisier. C'était l'expression d'une bouffée de joie. Une manière de dire zut à la guerre, au malheur, à l'Histoire ", mais ce que ne dit pas le peintre éclate quand on voit ces peintures : elles n'échappent pas à l'horreur des temps, car elles sont dominées, envahies par une ombre sombre, omniprésente, menaçante (Paysage de Champrovent). Il faudra attendre ses uvres les plus tardives pour voir sa mélancolie s'éclairer un peu par l'emploi de couleurs pastel.
Enfin, sur le plan purement esthétique, le dessin de Balthus est simplement fascinant par sa "netteté voilée" qui fait songer par instants aux fresques de la Renaissance italienne et ses couleurs sont une signature : presque toujours vernissée, formant une surface mate et brute et sur laquelle reposerait un voile gris, passeport pour le rêve.
Dans Les trois villes, Rome, Zola rappelait la décision de Léon XIII de dissimuler le sexe des statues :
"[ ] vainement, ils ont mis des feuilles de vigne aux statues, de même qu'ils ont vêtu les grandes figures de Michel-Ange : le sexe flamboie, la vie déborde, la semence circule à torrents dans les veines du monde. [ ]"
L'exposition de Riehen montre combien ces paroles sont encore vraies. Réduire Balthus à une fonction, en faire un simple érotomane, voire pire, est une absurdité. L'art, quand il est puissant n'a que faire des pisse-froid ou des esprits étroits. Il triomphe toujours et "circule à torrent".
Fondation Beyeler, Baselstr. 77, Riehen
Les succès d'un auteur français en Allemagne, Jean-Charles Laveaux (1749-1827)
Notes :
Par exemples dans les uvres posthumes de Frédéric II, Tome XI, Lettres à d'Alembert du 30 novembre 1771, celle du 28 janvier 1773 : "[ ] peut-être y a-t-il des années stériles pour la production des esprits comme il y en a pour les semences et pour la vigne. La France, comme vous le dites, se sent de cette stérilité. On y voit des talens, mais peu de génies " ; Le 19 septembre 1779, il écrit : "Vous n'avez que trop raison, Sire, sur la décadence où tout est tombé, et sur le grand vide que laisse la mort de Voltaire ; mais tel est le sort des choses humaines. Quand même notre littérature se remonterait, je doute qu'elle puisse de long-temps produire un homme aussi rare, et qui réunisse tant de talens à un aussi haut degré.[ ]" Voir encore celles du 26 avril et 8 septembre 1782 On se reportera en outre à l'opuscule de Frédéric : De la littérature allemande,[ ] Berlin, 1780, voir : F. Labbé, Berlin, le Paris de l'Allemagne, Orizons, Paris, 2011 et du même La Gazette Littéraire de Berlin, Champion, Paris, 2004. Sur la vie de Laveaux, ses autres écrits, ses luttes, voir F. Labbé, Jean-Charles Laveaux (1749-1827), un aventurier littéraire, Honoré Champion, Paris, 2017. Cette thématique est bien connue depuis au moins les travaux de Virgile Rossel, dont on lira encore avec intérêt particulièrement son livre Histoire des relations littéraires entre la France et l'Allemagne, particulièrement à partir du chapitre Le Déclin de l'influence française, p. 372 et suivantes (édition 1897, Paris, Fischbacher). Voir aussi Louis Reynaud, L'influence allemande en France au XVIIIe et au XIXe siècle, 1922 et tous les auteurs qui ont développé ces recherches fondamentales.
2 Voir F. Labbé, Berlin, le Paris de la France, Orizons, Paris, 2011.
3Les on-dit se mêlent bien sûr au fantasme. Voir : D. Reichelt, A.-F. Cranz, Ein königlicher Preußischer Kriegsrat als Schriftsteller von Profession, Bargfeld, 1996.
4Voir F. Labbé, Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière, un dramaturge sous la Révolution, l'Empire et la Restauration, Peter Lang, Bern, 1990. Dorat essaye de donner une idée favorable de la poésie allemande (Préface de Recueil de contes et de poèmes, 1768). Dès 1760, le Journal étranger affirme à propos de l'exemple de Gessner "Bientôt l'Allemagne n'aura plus à envier aux autres nations de l'Europe".
5 On se reportera à l'étude de F. Labbé : Jean-Charles Laveaux (1749-1827), un aventurier littéraire, à paraître en mars 2017 chez Honoré Champion.
6 Archives de Genève, Petit conseil, Prosélytes, 11,14.02.1775, p. 90.
7 Staatsarchiv Basel. Archivsignatur: PA 141 À 7, fol. 236.
8 "Franz. ref. Kirchenbücher der Gemeinde Neu Isenburg, Trauregister, Jg. 1775, S. 25, Nr. 5".
9 Archivsignatur: Protokolle Kleiner Rat 148, fol. 23r
10 Universitätsarchiv B 1 IV, fol. 691f.
11Archives de l'Université de Bâle, Ki. Ar.g.I 13.
12Archives de l'Université de Bâle, Ki. Ar.g.I 13, fol. 226-242. (À Solsticio Aestivo, Anno 1779 ad Item Solsticium 1780).
13 C. de Mechel (1737-1817) apprend la gravure à Nuremberg et Augsburg, puis à Paris chez Johann Georg Wille (1715-1808). Voir Das 18. Jahrhundert, "Deutsch-schweizerischer Kulturtransfer im 18. Jahrhundert", Jahrgang 26, Heft 2, Wolfenbüttel, 2002, ainsi que Lukas Wüthrich, Christian von Mechel Leben und Werk eines Basler Kupferstechers und Kunsthändlers (1737-1817), Basel, 1956.
14 Wüthrich, op. cit., p. 119.
15 Voir les Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 1782 p. 804, Carl Benjamin Lengnich, Nachrichten zur Bücher- und Münzenkunde (1782, Vol. 2, p. 410) ou Gottlieb Emanuel von Haller, Bibliothek der Schweizer Geschichte, IV. Teil, Bern, 1786, p. 6.
16 Geschichte der besten Künstler in der Schweiz nebst ihren Bildnissen, Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßli und Comp., 1770, tome 3, article Carolus Hedlinger, p. 75-123.
17 Laveaux donne sa bibliographie dans la Gazette Littéraire de Berlin (octobre 1780). Voir F. Labbé, La Gazette littéraire de Berlin, Champion, Paris, 2006.
18 Jusqu'à son départ pour Strasbourg, ce nom, choisi à Bâle, sera orthographié en Delaveaux, puis De La Veaux. Ce n'est qu'à partir de 1791 - Révolution et retour en France obligent - qu'il devient Laveaux.
19 Display & Art History: The Düsseldorf Gallery and Its Catalogue, Numéro 11, The Getty research Institute, Los Angeles, août 2011, p. 32 et suivantes. Les notices de Laveaux manifestent, dit-on, un vrai sens esthétique.
20 F. Labbé, Jean-Charles Laveaux, op. cit., p. 55 et 134.
21Immédiatement reproduit à Stuttgart (chez K. Wittwer).
221753-1813. Becker à Bâle a collaboré aux Ephemeriden der Menschheit d' Isaac Iselin. En 1780, il publie chez Breitkopf à Leipzig son Magazin der neuern französischen Literatur dans lequel il évoque rapidement la traduction de Laveaux (mais d'aucun de ses livres par la suite).
23Voir F. Labbé, L'éloge de la Folie, version trilingue", in Francia, No 44, p. 339-348. Son travail reste toujours agréable à lire car la traduction ne se fait pas sentir.
24 P. 464. "Par M. Delaveau".
25 "H. Thurneisen hat noch eine Übersetzung Ihrer Musarion veranstaltet: die Kupfer dazu sind nur noch nicht fertig. Sind Sie mit dieser Übersetzung, die von einem H. la Veau ist, einigermaßen zufrieden, so will er mit mehreren von Ihren Werken fortfahren."
26 Belle qualité de l'édition (papier, caractères Haas, frontispice gravé et dessiné par Saint-Quentin. Chaque chant est orné d'une gravure et par un cul-de-lampe ). Republié à Kehl en 1784, Avignon en 1788 chez Joseph Guichard, puis, l'an VII à Paris, par Laveaux lui-même.
27 F. Labbé, Jean Charles Laveaux , op. cit, p. 50 et suivantes, p. 80-87.
28 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste - volume: 32,1, Leipzig, mars-avril 1792. Frédéric Weinmann en fait un peu vite un traducteur mineur : "Les premiers traducteurs de la littérature allemande", in : Frontières, transferts, échanges transfrontaliers et interculturels, éd. par P. Bélar et M. Grunewald, 2005, p. 326.
29Voir l'édition critique du Livre fait par force, Berlin 1784, par F. Labbé. Son auteur, C.É. Le Bauld de Nans y fait une critique de la manie de versifier et du manque d'intérêt des poèmes figés par la versification.
30 Article reproduit dans L'esprit des journaux français et étrangers, Paris, 1783. Lorsque la Décade Philosophique et Littéraire consacre une série d'articles à Wieland ("Notice sur la vie de Wieland", No 17 et 19, T. 17, 1798), il n'est pas fait état de la traduction de Laveaux. Elle est cependant indiquée dans les principaux catalogues de libraires et journaux à la rubrique "Livres nouveaux" (comme dans la Gazette de France, 1787, no 57, le Tableau du Nouveau Palais Royal, 1788 ).
31 Les ouvrages bibliographiques du temps donnent une version française à Bâle en 1783, parfois 1784, à Bâle toujours, mais anonyme et une version publiée à Paris en 1785 par M. Delaveau.
32 L'original, Siegwart, eine Kloster Geschichte, est paru en 1776.
33 Parution deux années après Werther et chez le même éditeur ! Goethe, lui-même, rapproche les deux ouvrages tout en pointant dans Siegwart beaucoup de faiblesses : manque de psychologie, absence d'esprit et livre écrit sans art (Dichtung und Wahrheit (Goethes Werke, Berliner Ausgabe, Bd 13, Berlin und Weimar, 1971, p. 890).
34 Johann Wilhelm Appel, Werther und seine Zeit, 1896.
35 Voir Diethard Heinze "Johann Martin Millers Siegwart, eine Klostergeschichte, Der Trivial Roman und seine Leser", Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, 1, 1992, Peter Lang.
36 1er juillet, 1785, Luxembourg.
37 27 septembre 1785.
38 Juillet 1786. Il est brièvement signalé par les Gothaische gelehrte Zeitungen auf das jahr 1774-1804, 1805.
39 Marie-Antoinette le possédait dans sa bibliothèque du Perit-Trianon. Avec Werther, c'est la seule traduction de l'allemand. Cette bibliothèque ne possédait aucun ouvrage en langue allemande.
40Préface aux Voyage, p. V-VII. Des difficultés de paiement et de distribution avec l'éditeur font que le second tome ne paraîtra pas et que Laveaux interrompra ce travail.
41 (Bibliothèque universitaire de Bâle). Pour le lecteur moderne que je suis, ces Voyages sont intéressants et parfaitement rédigés, Laveaux ayant su apporter une clarté dans l'exposé qui manque peut-être dans l'original.
42 Très peu de bibliothèques le possèdent.
43Novembre 1782, p. 759.
44 Geschichte der Deutschen von Konrad dem Ersten bis auf Friedrich den Zweiten, Ulm, 1778, de Michael Ignaz Schmidt (1736-1794), le directeur des Archives de Vienne depuis 1780. Le premier tome paraît à Liège chez C. Plomteux au printemps 1784 : "Depuis les tems les plus anciens jusqu'à Charlemagne".
45 Ce qu'il annonce dans la presse (in : Berichte des allgemeinen Buchhandlung der Gelehrten,10e livraison, 1783)!
46 I. Schmidt rédige les 12 premiers volumes et son continuateur, Joseph Milbiller (1753-1816) une dizaine jusqu'en 1808 (soit 22 volumes entre 1783 et 1808). L'histoire s'arrête en 1806. En 1784, les premiers volumes traduits paraissent également à Reims (Cazin, 5 volumes in-8).
47 Abbé Carlo Denina, La Prusse littéraire, op. cit., p. 434.
48 Johann Karl Wezel (1747-1819), romancier, poète et philosophe proche de l'Aufklärung tardive. Wezel était aussi un pédagogue partageant les idées de Basedow.
491786, volume 2, no 105, p. 222-225.
50 Paris, Laveaux et Moutardier an VII [1798/99], en 5 volumes.
51 Simon Chardon de la Rochette (1753-1814), ami et collaborateur de Millin, de l'abbé Barthélémy Mercier de Saint-Léger, helléniste et savant réputé.
52ALZ, 1799, volume 3, no 211, p. 25-26
53 1799, p. 338 et suiv.
54 238 p. et XXXIV f. de planches ; An VII [1799] Paris. L'original est paru en 1778 à Nuremberg.
55 Qui ne paraîtra qu'à partir de 1785.
56 Volume 84, p.361-366. Le livre est publié "Au profit des pauvres" !
57 Sur ces circonstances, voir F. Labbé, Jean Charles Laveaux (1749-1827), un aventurier littéraire, Champion, Paris, 2017.
58 Laveaux l'indiquera aussi dans le prospectus qu'il fait publier le 30 octobre 1780 dans la Gazette littéraire de Berlin pour s'annoncer.
59 Berlin und Stettin, 1784.
60 Entretiens avec les enfans sur quelques histoires de la Bible tirées de l'ancien et du nouveau Testament, Berlin, 1782.
61 Quérard indique en 1830 une édition de 1808, chez Weigel et Schneider, Nürnberg, avec 25 estampes et un lexique français-allemand.
62 Alors qu'il dirige le Journal de la Montagne, il se fera sévèrement reprendre le 18 brumaire aux Jacobins par Hébert car il n'a pas hésité à faire l'éloge du déisme contre la Feuille de Salut Public qui avait prétendu que l'athéisme convenait aux républiques (17 brumaire an II, p. 1060). Il démissionnera alors !
63 J.C. Laveaux, Vie de Frédéric II, T. IV, Strasbourg, Treuttel, 1788 et dans le T. VII (1789).
64 Sur ces courriers, voir Laveaux, Vie de Frédéric II, op. cit. note XL.
65 Ordre de cabinet du 17 octobre 1783 signé Von Zedlitz (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, (Dahlem) I. HA Geheimer Rat, Rep. 9 Allgemeine Verwaltung D 8 Refugiertensachen Fasz. 25 u. a.: de la Veaux wird Professor, 1783. En revanche,pas un mot sur l'Académie!
66 Il paraît trimestriellement, ensuite en 2 volumes, Berlin, 1784-1785. La Gazette en parle alors (1784, p. 45). Le tome III paraîtra en 1787 chez Wever, qui redonnera une édition complète en 3 volumes en 1797.
67 Vie de Frédéric II, op. cit., p.247, note 41, Strasbourg, 1787. Laveaux historien parle de lui-même à la troisième personne.
68 Voir André Chervel, Histoire de l'enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, 2006. Pour celui-ci, les années 1780 sont celles "du décollage de la grammaire française" (p. 245)
69 " Le style des écrivains français semble dégénérer de jour en jour : la langue française, cette langue si noble, si douce, si claire, si élégante, perd tous les jours quelque chose de cette pureté qui la rendait si recommandable dans le siècle de Louis XIV. On substitue les mots aux choses ; on préfère le brillant au solide ; on prend les écarts pour le génie ; [...]
70Hormis, dit-il, le Journal de Paris et le Journal encyclopédique (qui ont parlé de ses uvres !)
71Ces remarques sont justes mais Laveaux ne tente pas de voir si la situation française est vraiment différente.
72 Il ajoute ce passage qui ne pouvait déplaire à Frédéric II : "Un grand malheur pour les États, c'est lorsque les erreurs religieuses et l'intérêt de ceux qui les enseignent sont étroitement liés avec la constitution politique".
73Le fond de ses idées (contre la tyrannie des Églises, contre la superbe aristocratique et le despotisme des souverains, pour la religion naturelle, pour la campagne contre la ville, pour la liberté de l'homme de lettres et la liberté d'opinion ) correspond assez à l'attitude qu'il aura après son retour en France fin 1791.
74 Une phrase reprenant mot pour mot Madame de Genlis, reformulant Épicure dans ses Annales de la vertu ou cours d'histoire à l'usage des jeunes personnes, Paris, 1781. Mais c'est un cliché qu'on retrouve alors souvent (cf. Les mémoires d'un honnête homme de l'abbé Prévost )
75 p. 50.
76 Cours théorique, p. 46. Suit un passage où il s'insurge violemment contre tous ces parents qui condamnent leurs enfants à l'erreur par routine et par absence d'esprit critique.
77 Les lignes qui se rapportent au pamphlet de Laveaux Défense de Raynal (attaque en règle de Borrelly "néant littéraire") y font songer.
78 Büsten berlinischer Gelehrten und Künstler, mit Devisen, Leipziger Ostermesse 1787.
79 Volume 63, p, 542-546.
80Johann Christoph Adelung (1732-1806) est le grand lexicographe et grammairien allemand. À l'époque qui nous intéresse, il publie avec un énorme succès son Dictionnaire grammatical et critique de la langue allemande, Leipzig, 1774-1786, en 5 volumes.
81Cahier 6, p. 315, Dessau et Leipzig, 1783.
82 ALZ, 1785, volume 3, no 173. Voir aussi une Lettre d'un Allemand à messieurs les auteurs de la Grammaire française parue à Berlin sous ce titre de etc. (Himbourg, Hambourg, 6 juillet 1785), très critique mais rendant hommage au "professeur de la Veaux".
83 Dans son ouvrage Sur l'orthographe française (vers 1700), l'abbé Dangeau répertoriait 33 phonèmes. On considère aujourd'hui que la langue compte 37 phonèmes et 26 graphèmes.
84 Avril 1800, no 67, p. 532-534. Elle sera couramment désignée sous le titre (encore plus mensonger) qu'elle prend dès la 2e édition : Wailly's französische Grammatik für die Deutschen. Elle est en général recommandée par les grammairiens comme Ildephons Schwarz (Anleitung zur Kenntniss derjenigen Bücher, welche den Candidaten , Coburg, 1806).
85Archives de Stuttgart, A 272 83 (doc. 12) Verzeichnis der Öffentlichen Vorlesungen welche von Ostern 1786 bis dahin 1787 in der herzoglichen hohen Carls-Schule zu Stuttgart gehalten werden.
86 Cette notion de méthode naturelle est le thème de la thèse de Basedow soutenue en 1752 à Kiel.
87 P. Meyer, "Les manuscrits français de Cambridge", in : Romania, XXXII, 1903, p. 18-120.
88 À Berlin, le pasteur Erman uvre aussi dans ce sens dès 1782, mettant en pratique des idées qu'il a depuis un certain temps et nous avons indiqué qu'il cherche à former ses professeurs du Collège français.
89 Les avant-propos des grammaires le répètent au cours du siècle ! Voir E. Stengel, Chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts nebst Angabe der bisher ermittelten Fundorte derselben, Berlin, 1890.
90ALZ, p. 456.
91 Leçons méthodiques de Langue française pour les Allemands, 1790, in der Buchdruckerei, Stuttgart. ALZ juin 1792, p. 591.
92 Dans ses Mémoires, Heinrich Heine trace le portrait de Daulnoye, qui a été son professeur.
93Streuber, op. cit., p. 105, 124 et suiv., 130
94Critique très négative dans ALZ, 1800, volume 4, no 374, p. 385-386.
95 Il se situe, assez étonnamment, lui qui écrit des "tableaux", dans la lignée de Molière.
96 Éphémère journal de très bonne tenue (continuation du Mercure Suisse) dirigé avec Jean-Pierre Heubach et édité à Lausanne, p. 121-133, et 161-168 (septembre 1784).
97Johann-Christoph Adelung l'indique en vente dès 1782: Allgemeines Verzeichniß neuer Bücher mit kurzen Anmerkungen, 7e vol. Partie 1, Leipzig, 1782.
98 ADB, 1784, p. 128-129.
99Volume 8, 1783. Ce portrait se trouve dans la préface aux Ländliche Nächte de Mylius. Nous l'avons évoqué plus haut.
100 Mais là aussi, on peut penser que décerner des couronnes à Laveaux, le pourfendeur du mauvais français d'Allemagne (mais aussi ce professeur qui pointe du doigt la médiocrité française en général !), entre dans la stratégie de la réévaluation de la culture, de la pensée et de la langue nationale.
101 Volume 2, no 111, p. 270-271.
102 Herausgegeben (édité) par Christoph Martin Wieland, Friedrich Justin Bertuch, Karl Leonhard Reinhold, Karl August Böttiger.
103 P. 25. Leçons destinées aux jeunes gens pour une conduite sage et heureuse de leur vie. Les Göttingische gelehrten Anzeigen et l'Erfurtische gelehrte Zeitung de 1784 sont également très positifs dans leurs commentaires.
104 Olla Potrida, 1783, p. 149-150. La dédicace de Mayet est la suivante : Si l'auteur que ton il contemple/Est un critique habile et rempli d'enjouement/Ses écrits sérieux et pleins de sentiment, Nous prouvent qu'aux préceptes il sait unir l'exemple. Ajoutons que ces deux livres passent assez inaperçus de la critique officielle en France, mais les catalogues de bibliothèques montrent qu'ils ont été beaucoup lus.
105 La 3e partie de son Cours pratique était réservée à des "Annonces et critiques", dans lesquelles il pouvait également se laisser aller à sa verve satirique. Il y poursuivra avec sarcasmes son uvre de démystification en démontrant et illustrant la nullité de tous ces professeurs, directeurs de collège français, pasteurs et académiciens qui accaparent les postes et sont en fait les fossoyeurs du bon français et du génie français.
106Cette amitié est probable même si les preuves définitives manquent encore. La lettre amicale de l'abbé (Collection de Froidcourt) adressée de Berlin le 28 mai 1782 lui était peut- être destinée. Raynal aurait intercédé - en vain - auprès du roi pour qu'il obtienne un emploi dans un collège.
107 Né à Salernes dans le Var, il viendra en France en 1789 attiré par la Révolution et lira devant l'Assemblée (juin) un "Examen des droits respectifs du Monarque et de la Nation, dans les Réformes et les Améliorations qu'exige la prospérité de la France".
108 L'image du Français, petit maître arrogant, règne en Allemagne chez les intellectuels et on évoque ces "Windbeutel", terme qui correspond assez à la traduction de Laveaux "petits ballons", même si au sens propre Windbeutel désigne une sorte de chou à la crème !
109 Laveaux souffre un peu du "complexe de l'exilé" et il cherche continuellement à prouver qu'il est aussi d'autres Français, dignes d'admiration : intelligents, sérieux, travailleurs, tout comme lui !
110Voir son Cours, partie Annonces et avis divers, 1784.
111Hambourg, Virchaux, 1784.
112 ALZ, 17 janvier 1786, no 14, p. 196-197.
113Georg Joachim Zollikofer, né en 1730 à St Gall. En 1754, il est nommé pasteur en Suisse puis exerce en Allemagne. En 1758, il dirige la paroisse de Neu-Isenburg (où Laveaux s'est marié) puis est en poste à Leipzig. Il meurt en 1788. Il est en relation avec les principaux représentants de l'Aufklärung.
114 Cet essai est à rapprocher de celui de l'abbé Coyer, l'Essai sur la prédication (1781) auquel Christian Cheminade a consacré un article in : 18e siècle, 2002, No 34, pp. 325-331.
115Pour répondre aux inévitables critiques qui seront faites, il donnera un supplément et plusieurs éditions améliorées, des extraits..., car il s'agit aussi d'une opération commerciale dont le maître d'uvre est le libraire strasbourgeois Treuttel.
116 Nicolai, grand connaisseur et observateur de Frédéric, cite un certain nombre d'erreurs commises. Il en veut surtout à ce Français, à la réputation discutable, dit-il, d'avoir écrit, précipitamment, ce livre. Dans une lettre à Christian Friedrich von Blanckenburg du 2 novembre 1791, il en parle encore comme d' "un brouet méprisable plein de mensonges" !
117ALZ, 1788, volume 2, no 84, p. 43-46.
118 Denkwürdigkeiten meiner Zeit, op. cit. volume 5.
119Historisch-literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, volume 2, numéro 1, p. 321, 1795. Après la Révolution, parallèlement à son uvre de dictionnariste, il poursuivre son uvre d'historien avec des livres sur Pierre III et Catherine de Russie.
120Philippe Bourdin, "Rêves d'empire chez Bonaparte. Construction intellectuelle d'un modèle politique", in : L'Empire avant l'Empire, état d'une notion au XVIIIe siècle, Cahiers du Centre d'Histoire, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, no 17, p. 130.
121 En 1783, Peter Adolph Winkopp le cite dans sa Bibliothek für Denker und Männer von Geschmack, tout comme Joachim Christoph Friedrich Schulz dans son Literarische Reise durch Deutschland (1786). Johann Samuel Ersch l'indique bien entendu (Das gelehrte Frankreich) ainsi que Johann Georg Meusel (Das gelehrte Teutschland). En 1806, il est présenté dans le Minerva d'Archenholz comme un auteur important en pédagogie et en science militaire. Goethe possédait son dictionnaire bilingue et Schiller plusieurs de ses livres...
122Kant in 3 Bänden, 1912, p. 95.
123 Kann ein Schriftsteller, wie Herr Professor Hoffmann, Einfluß auf die Stimmung der Deutschen Völker und auf die Denkart ihrer Fürsten haben? An Herrn de la Veaux, Wien, 1792.
124 La clef des langues, réimpression Slatkine Reprints, Genève, 2003 et l'instructive introduction de l'éditeur Jürgen Storost.
125 Un fils de Le Bauld-de-Nans, colonel puis général prussien, spécialiste des fortifications, collaborera et sera ami avec Lazare Carnot. Les deux hommes échangeront une nombreuse correspondance malheureusement désormais introuvable.
PETITE HISTOIRE DU THÉÂTRE BRETON
Le "théâtre" existe dans toutes les cultures. Il est célébration, imitation, jeu, pédagogie, délassement, dénonciation ou prise de position et se réfère à un événement religieux ou profane, marquant ou banal, à une légende ou à un mythe, à un récit oral ou écrit Il est participatif ou simple spectacle, la participation active cédant au fil de temps le pas à une participation émotionnelle dont la fameuse catharsis.
En Bretagne, comme ailleurs, on peut lui supposer des origines très anciennes aussi bien en pays bretonnant qu'en pays gallo ou dans les villes essentiellement francophones.
Sans essayer de retourner aux origines - si tant est qu'on puisse y parvenir - nous distinguerons deux axes principaux : le théâtre de langue française et le théâtre de langue bretonne, encore qu'il faudrait sans doute davantage considérer les publics : citadins cultivés et aisés / citadins laborieux et pauvres - paysans.
Dans les grandes villes un théâtre francophone
Pendant le Moyen-âge, comme partout en Europe, le théâtre religieux - Vies de saints, - domine, tolérant toutefois les genres plus triviaux : les farces, soties etc Ces deux aspects se poursuivront jusqu'au début du XXe siècle avec une part de plus en plus importante, dans les villes surtout, à peu près à partir du XVIe siècle, d'un théâtre profane, même s'il n'existe pas de salle qui lui soit exclusivement destinée.
À partir de la contre-réforme, l'Église et le pouvoir politique acceptent moins ce théâtre source de débordements et de "profanations" dans les campagnes comme dans les villes, car il entraîne attroupements (interdits) et circulation d'idées nouvelles (dangereuses). La première preuve d'interdiction du théâtre en Bretagne date de 1565 (Rennes), mais s'appuie sur des procédures plus anciennes et ces interdictions perdureront.
Cependant, les princes comprennent vite l'utilité politique, pédagogique et sociale de spectacles pouvant illustrer leur puissance et transmettre les valeurs morales ou civiques qu'ils veulent. Les troupes de comédiens itinérants se multiplient alors et cherchent à se fixer au XVIIe siècle dans les grandes villes, sous la protection du souverain, de son représentant ou d'un grand. Le théâtre profane s'impose dans les villes, surtout en Haute Bretagne, tandis que le théâtre d'inspiration religieuse se maintient davantage en Basse Bretagne. Notons que les " Taolennou " du père Le Nobletz relevaient assez du théâtre !
Très vite, le théâtre devient un vecteur puissant de la sociabilité et de la propagation des idées (nouvelles) : d'abord parce qu'il est un lieu de rencontre, ensuite parce que les auteurs portent sur les planches les principaux débats de société. Au XVIIIe siècle, plus ouvert qu'il ne le sera au XIXe, il touche certes un large public, mais la Bretagne apparaît comme assez en retard sur ce plan par rapport à d'autres provinces. Il est difficile de faire le point sur les troupes de passage, mais une chose est certaine, les lieux réservés au théâtre sont encore rares et le nombre de représentations plus restreint que dans la Normandie voisine par exemple.
Le premier point d'ancrage du théâtre est alors constitué par les collèges. Les jésuites de Rennes, Quimper ou Vannes accordent au théâtre une place importante dans leurs programmes. On joue des pièces latines et françaises du répertoire classique, voire écrites par des professeurs, dans la cour des établissements ou dans la chapelle. Le collège de Rennes n'aura de salle qu'à partir de 1740. Certaines de ces pièces auront un succès "national" comme Conaxa ou les gendres dupés donnée à Rennes pour la première fois vers 1711, L'école des pères joué quelques années plus tard. Ces pièces sont souvent agrémentées de ballets, de concerts. Elles peuvent disposer, comme à Rennes encore, de décors remarquables selon les mémoires du temps. Parfois, les représentations sont en lien direct avec l'actualité, comme les spectacles donnés à l'occasion du mariage de Louis XV et de la fin de la guerre. Un ballet illustre même La gloire de la Bretagne. Ainsi, encore, en août 1731, alors que le lit de justice du 24 mars 1730 a fait de la Bulle Unigenitus une loi du royaume et que la querelle du jansénisme s'enflamme à nouveau, les Rennais de la bonne société se précipitent pour assister à une comédie donnée au Petit Séminaire : La femme Docteur ou la théologie tombée en quenouille (1730), une pièce dont on parle partout, imprimée, distribuée, aux innombrables rééditions mais qui ne sera jouée qu'à Rennes après avoir eu sa première à Chaulnes. Le bruit court que l'auteur est un jésuite Breton, le célèbre Père Bougeant, l'auteur des Amusemens philosophiques sur le langage des bêtes (1739).
Le Père Guillaume-Hyacinthe Bougeant (1690-1743)
Comme tous les érudits de son temps, le Quimpérois Bougeant touche à tous les domaines : dialogues imités du grec, Anacréon et Sapho (1712), un Recueil d'observations physiques en 1719, des ouvrages d'histoire sur le Traité de Westphalie (1727 et 1744). Le jésuite qu'il est ne peut éviter de se mêler aux débats théologiques qui marquent alors l'actualité. Il écrit une Lettre sur l'Eucharistie (1727), déclenchant une controverse qui culmine avec un Traité théologique sur le même sujet (1729) ainsi que plusieurs autres ouvrages de religion dirigés contre les superstitions et les jansénistes. Controvertiste, collaborateur important des Mémoires de Trévoux, sa plume est partout reconnue autour des années 1728-1738.
Tous ces écrits sont certes de grande tenue et ont eu un écho important, mais le plus marquant pour un lecteur moderne, ce sont ses uvres plus spécifiquement littéraires. Avec La femme docteur ou la théologie tombée en quenouille (1730), il se révèle être un auteur de comédie satirique talentueux. Dans cette pièce vive, il ridiculise les jansénistes (souvent réimprimée et traduite, à l'époque partout distribuée, parfois sous le titre mortifiant d'Arlequin janséniste), comme il se moque du diacre Pâris et de ses convulsionnaires dans Le saint déniché ou la banqueroute des marchands de miracle (1732) ou Le Quakers français ou les Nouveaux Trembleurs (1732). Dans ses deux premières comédies (basses comédies !), l'emprunt à Tartuffe et aux Femmes savantes est patent : le motif de l'homme sombre qui s'insinue au sein d'une famille et cherche à la détruire, comme les jansénistes veulent détruire la société, et celui alors rebattu du "jansénisme par les femmes". Il s'inscrit, avec ces comédies, au cur des querelles relancées par le ministre Fleury et le lit de justice royal du 24 mars 1730.
Il est également intéressé par les disputes littéraires et, alors qu'Anciens et Modernes continuent à s'affronter, il publie un délicieux pamphlet : Le voyage merveilleux du Prince-Fan-Féredin en Romancie (1735), sorte d'antiroman qui est une critique de L'usage des romans de Lenglet-Dufresnoy, dans lequel il distingue très exactement la "haute" de la "basse" romancie. Il ne s'oppose pas à ce genre relativement nouveau, mais ne veut pas le voir sombrer dans ce qu'il croit être la vulgarité.
À côté de ce théâtre donné dans les collèges, important puisqu'il touche la future élite de la province et fait naître des vocations comme celles de Saint-Foix, L'Affichard, Lesage, Alexandre Duval voire le feuilletoniste du Journal de l'Empire Geoffroy, les habitants aisés des grandes villes réclament leur théâtre, comme ailleurs dans le royaume.
À Rennes, il faudra toutefois attendre la Révolution pour avoir une salle digne du nom de théâtre. Seules, en plus du collège, les troupes itinérantes (souvent invitées dans les résidences aristocratiques) permettent aux Rennais de profiter des spectacles donnés dans un des deux jeux de paume ou sur des tréteaux (comme dans les Halles de Fougères) et d'être à peu près au courant de ce qui se joue ailleurs. Il est aussi des circonstances extraordinaires où un spectacle est organisé par les États comme la représentation d'une tragédie lyrique, Atys de Quinault, mise en scène par Lully, à l'occasion des états de Bretagne tenus à Rennes en 1689.
À Nantes, où de nombreuses troupes séjournent régulièrement, comme celle de Molière en 1648, concurrencée par un marionnettiste italien, il n'y a d'abord qu'une salle de théâtre, la salle du Chapeau rouge "petite, décorée sans goût, mal tenue, mais bien éclairée", mais la ville aura sa revanche puisqu'un des plus beaux théâtres de France y est construit fin 1787 par la volonté du maire Graslin, qui en fait même le centre du nouveau quartier de la Bourse, qu'il fait édifier sur les plans de Mathurin Crucy. Arthur Young, qui admire la ville, est fasciné par ce nouveau théâtre "deux fois plus grand que Drury Lane" et plein de spectateurs ! Ce magnifique bâtiment sera malheureusement la proie des flammes en 1793, mais il sera reconstruit entre 1811 et 1813.
À Brest, une salle en bois destinée aux représentations brûle en 1765 mais en 1766, la construction d'un théâtre est décidée : une ponction sera effectuée sur la solde des officiers. Le bâtiment appartiendra à la Royale, qui décidera des programmes et des troupes invitées.
Lorient, ville où se côtoient bien des fortunes, a évidemment son théâtre avec, selon les mémoires du temps, une salle "petite mais fort jolie" ; les Malouins riches et cultivés pensent aussi à donner à leur cité une salle de représentations, mais le projet n'aboutit pas bien que le besoin se fasse sentir : de 1768 à 1789, ce sont au moins 23 troupes itinérantes qui séjournent dans la ville !
Pas d'autre théâtre public en Bretagne. Cette retenue s'explique d'abord par le fait que le pouvoir voit d'un mauvais il ces spectacles difficiles à contrôler : la première preuve d'interdiction du théâtre en Bretagne date de 1565 (Rennes) mais s'appuie sur des procédures plus anciennes. D'autres suivront en 1570, 1577 et 1598... D'autre part, les municipalités hésitent à engager des fonds alors qu'on peut se contenter des troupes de passage, dont les représentations sont d'ailleurs très suivies par la population, indépendamment des fortunes et des niveaux culturels. Le clergé enfin est très réticent, pour ne pas dire plus, même à la fin du XIXe siècle quand certaines voix ecclésiastiques vouent encore comédiens et spectacle aux gémonies !
En ce qui concerne les pièces jouées, les troupes itinérantes continuent la tradition d'un théâtre populaire profane surtout en Haute Bretagne avec, pour une large part, un répertoire de représentations travestissant des pièces à succès comme Arlequin, médecin sans le savoir (Le médecin malgré lui) ou Les Coquettes dupées (Les Précieuses ridicules), des passages de romans mis en scène, des farces. Les théâtres établis proposent surtout les succès parisiens.
Il semble qu'il y ait eu ensuite une sorte de désaffection jusque 1760 environ puis un renouveau et, alors, les spectacles rejoignent ce qui est donné dans la capitale. Comme partout en France, la réglementation évoluant, le nombre de salles se multipliera après 1789, mais le théâtre dans ses murs restera longtemps un spectacle réservé à la bourgeoisie, pourtant, Louis Guilloux a écrit combien, enfant pauvre, il était fasciné par ce théâtre que fréquentaient les bourgeois de Saint-Brieuc et prêt à tout pour y avoir accès.
Les campagnes de l'ouest et le théâtre breton
Contrairement à ce qu'affirmait Anatole le Braz (Le théâtre celtique), on est aujourd'hui certain que, comme partout en Europe, les Bretons bretonnants ont développé très tôt un théâtre dans leur idiome.
Léon Fleuriot arrivait à la conviction en étudiant le vieux breton (VIe-XIe siècle) de la très grande probabilité "d'une sorte de théâtre indigène, dans lequel les histrions, et les bouffons paraissent avoir tenu les premiers rôles [...]" (Le Vieux-Breton, éléments d'une grammaire (1964) et Dictionnaire des gloses en Vieux Breton (1964). Des noms de lieux (Goariva, Goarivan oder Hoariva) viendraient du verbe jouer (c'hoariñ), et de -va (lieu). Le livre de G. Le Menn sur le Théâtre populaire breton (1983) a repris ces travaux anciens et indiqué des voies de recherche qui redressent les jugements "colonialistes" de tous ceux qui ont longtemps prétendu que la vie littéraire de langue bretonne ne commence qu'au XIXe siècle et se ramène essentiellement à quelques chansons ou poèmes de tradition orale.
Avec le moyen-breton (jusqu'au XVIIe siècle), les témoignages sont plus nombreux de vies de saints, de mystères ou de jeux de la Passion, comme la Buhez Santez Nonn (Vie de saint Nonn), Dismantr Jeruzalem (fragment.) (XIV-XVe s.), Pasion & Resureksion, Buhez Sant Gwennolé, Buhez Santez Barba (16e), Creation ar bed Cognomerus ha santes Trifina Amourousted (fragment.) (XVIIe)..., mais un fragment subsistant prouve l'existence d'un théâtre profane : Amourousted eun den iaouank coz
À partir du XVIIe siècle, le théâtre en breton, comme ailleurs en France, surtout dans le Trégor et le Vannetais, devient un "média" complexe : informatif, distrayant et formateur, malgré l'opposition générale de l'Église et du Parlement. Ainsi, dans un Confessionnel imprimé en 1612, il est interdit aux ecclésiastiques de participer à des "comediennou profan, bancquedou, mascaradennou, hoariou, danczou, gourenerez, chasceal, festou dez, ha festou nos" tout comme aux feux de Saint-Jean ! Et dans un Doctrinal (Doctrinal ar christenien) de 1689, on peut lire :
"Nep [...] a deu da ober sellou impudicq, da dançal, da derc'hell bal, da ober françou, ha comediennou profan, a pec'h" (Celui qui a des regards concupiscents, danse, fréquente le bal, s'accorde des libertés ou joue dans des comédies profanes, est dans le péché).
Un arrêt de 1753 nous apprend encore que des représentations de mystères bretons (on disait alors tragédies bretonnes) avaient lieu dans l'évêché de Saint-Brieuc et que les acteurs étaient des "jeunes gens de la campagne", de "quarante ou cinquante enfants de famille s'attroupant et abandonnant pendant un temps assez considérable leurs devoirs et les travaux de la maison paternelle pour se mettre en état de jouer leurs rôles", ce qui était évidemment considéré comme répréhensible, d'autant plus que les représentations duraient deux ou trois jours. Quarante ans plus tôt, un arrêt du 7 novembre 1714 avait interdit ces représentations annoncées de foire en foire, par les pillaouers, les marchands ambulants, répercutées lors des veillées, "dans la ville de Guingamp", car "le peuple y accourait de plusieurs lieues à la ronde" et que de tels déplacements de population semblaient préjudiciables à l'ordre public et à l'entretien des campagnes.
Ces représentations étaient en effet l'occasion de véritables fêtes populaires et tous ceux qui le pouvaient voulaient y participer. Le prologue de Louis Eunius remercie ainsi tous les généreux donateurs qui ont permis la représentation : "Je remercie les nobles et les gens de qualité qui nous ont prêté leur assistance, et je leur souhaite l'accomplissement de tous leurs désirs en ce monde et le Paradis en l'autre." Un prologue, tiré du Mystère de Moïse est encore plus précis : "Je ne saurais remercier trop les gens du canton de nous avoir secondés, chacun suivant ses moyens, en nous prêtant des charrettes, des planches, des soliveaux et des barriques pour construire notre théâtre" ! Le clergé en quelques paroisses revient même parfois sur ces interdictions tant les paroissiens tiennent à leur théâtre, mais, en général, le théâtre reste pour lui une entreprise condamnable et l'épilogue de la Vie de monsieur saint Jean-Baptiste, conclut tristement "tout ici-bas trouve sa fin, tout, excepté la grâce de Dieu. Notre tragédie aussi touche enfin à son terme. En l'année 1763, nous avons donné une représentation de la Vie de saint Jean-Baptiste, copiée sur le cahier écrit à Pluzunet par un jeune homme du pays. Nous eussions bien désiré continuer d'en donner des représentations, mais, hélas, un ordre de monseigneur l'évêque de Saint-Brieuc défend les représentations de tragédies bretonnes dans toute l'étendue de son évêché. Il y est même dit que représenter des vies de saints est un cas réservé et cependant, interrogez l'histoire, feuilletez les livres les plus anciens du pays, vous n'y trouverez nulle part que ce soit même un péché véniel que de réciter des vies de saints".
François Luzel pensait que ces interdictions répétées et les difficultés apportées aux représentations ne firent pas disparaître le goût de ce théâtre essentiellement religieux - mais avec des scènes très réalistes comme l'accouchement de la vierge - et que, pendant les veillées, on continuait à en jouer ou à en réciter des scènes !
Sous la Révolution et l'Empire, des troupes se reconstituent, mais avec prudence : celle de Pluzunet est par exemple dirigée par Jean Le Ménager et Claude le Bihan, le premier est foumier de métier, l'autre cultivateur ! Après l'Empire, ce théâtre prend enfin sa revanche. Ainsi, aux débuts du règne de Louis-Philippe, puis sous la seconde République, le diocèse de Tréguier, à Lannion et à Pluzunet, voit une renaissance. À Lannion, les acteurs se réunissaient d'abord dans l'arrière-salle d'une maison rue de l'Allée-Verte, puis sur le Forlac'h, le champ de foire. La troupe était dirigée par un tailleur de la rue de Tréguier, Yves Le Pezron, secondé par un cordonnier et un cultivateur de Loguivy. Le répertoire religieux ne changeait guère, mais on aimait jouer et assister aux représentations ! On jouait la Vie de sainte Tryphine, la Vie de sainte Geneviève de Brabant, la Vie de sainte Hélène, surtout la Vie de Louis Eunz'us ou le Purgatoire de saint Patrice, toutes pièces que connaissait bien Charles Le Goffic, car elles avaient été éditées à Lannion par son père ! Dans le tome 1 de l'Âme bretonne (1902), il ajoutait sur ce théâtre :
"La troupe de Lannion se disloqua vers 1860. Les manuscrits qu'elle avait en sa possession ou, comme on dit en Bretagne, les "cahiers de tragédies", furent partagés entre les acteurs. Il y en avait de précieux dans le nombre. Beaucoup s'égarèrent. Ce qu'on put sauver du reste fut déposé à la Bibliothèque Nationale avec les autres mystères trouvés par Luzel dans ses diverses missions à travers la Bretagne. Mais personne ne prit soin de recueillir l'héritage dramatique de Pezron et de ses lieutenants. Le théâtre lannionnais avait cependant connu de beaux jours. On accourait en foule à ses représentations. Peut-être les acteurs n'apportaient-ils pas toujours un tact suffisant dans l'interprétation de leurs rôles. Le cidre frais et le gwin-ardent jouèrent plus d'un méchant tour, m'a-t-on dit, aux personnages sacrés de la pièce, déshabitués sans doute de nos libations terrestres. En général pourtant, ces acteurs lannionnais étaient de fort honnêtes gens, laborieux et paisibles, et que leur métier sédentaire (ils étaient presque tous tailleurs, menuisiers, tisserands, couvreurs) disposait à une certaine rêverie, compagne de leurs veilles solitaires. Les représentations qu'ils donnaient une fois l'an, si elles leur étaient un prétexte pour humer le piot de compagnie, satisfaisaient d'abord leur instinct du théâtre. Ces représentations étaient libres. Y assistait qui voulait et payait aussi qui voulait. Plusieurs représentations furent données à l'Allée-Verte, rue du Port, au Café des 50 couverts et, rue de Tréguier, au Chapeau Rouge. "De crainte que vous ne l'oubliiez, dit le prologue de Louis Eunius, je vous prie d'apporter chacun pour le moins une pièce de trente sols ; les pièces de vingt-quatre sols aussi ne seront point refusées, non plus que les rouleaux de vingt et dix sols." Dans l'épilogue de Moïse, l'acteur s'étend davantage encore sur ce point capital du libre don : "Honorables assistants, deux des acteurs vont maintenant descendre parmi vous, avec un plat chacun, et tous, j'en suis persuadé, vous ferez votre devoir et les verrez sans déplaisir. Car, comptant sur vos libéralités et pleins de confiance en votre générosité, nous espérons nous asseoir à une table bien servie et faire ce soir un peu de bonne chère." Cette "bonne chère", cette frairie de la fin, c'était à peu près tout le salaire des pauvres gens. L'intérêt, comme on voit, entrait donc pour bien peu dans leur amour du théâtre. Ils exerçaient vraiment leur métier d'acteurs comme un ministère, avec un sérieux, une foi extraordinaires. Aussi avaient-ils sur le peuple une prise irrésistible. Pierre Le Moullec racontait que dans un repas de noce, au bourg de Ploulec'h, où on l'avait prié de "déclamer quelque chose", une jeune fille, en l'entendant réciter le terrible prologue du Jugement dernier, se "mit tout à coup à crier qu'elle se voyait environnée de flammes et que des diables hideux l'entraînaient en enfer". Son faible cerveau n'avait pu résister à un tel ébranlement, elle était devenue folle. Je ne sais trop ce qui amena la dislocation de la troupe lannionnaise. L'administration impériale, sollicitée peut-être par le clergé, la voyait d'assez mauvais il. À partir de 1860, il n'y eut plus que de loin en loin, dans le diocèse de Tréguier, des représentations dramatiques. Le bourg de Pluzunet, où s'était formée une nouvelle troupe d'acteurs, en donna cependant deux, en 1867, à Saint-Brieuc, sous la direction de Luzel, et en 1878, à Pluzunet même. Lanmeur eut aussi une troupe qui se disloqua vers la même époque."
Selon G. Le Menn, dans son Histoire du théâtre populaire breton (1983), ce sont environ 250 manuscrits en breton moderne qui ont été conservés et certains édités, comme Santez Trefina hag ar roue Arzhur Cognomerus ha Santez Trefina St. Crispinus & St. Crispinianus Buhez Sant Patrice Louis Eunius / Purgator Sant Patrice Creation ar Bet Hiniveles ar mabic Jesus (Pastorale) Buhez sant Gwennolé abat, mais la plupart n'ont pas connu l'impression comme 6 pièces composant un cycle de l'Ancien testament, 8 se rapportant au Nouveau testament, 31 vies de saints, 2 pastorales, 5 comédies, etc. De nombreuses pièces ne sont en outre connues que par leur titre.
Le chevalier de Fréminville, au début du XIXe siècle rappelle qu'encore à cette époque, des "représentations dramatiques, exécutées par des paysans bas-bretons, ont lieu [ ] au milieu d'un champ ou d'une lande. On y dresse un théâtre en planches, élevé de six à sept pieds "
Et le voyageur anglais Asolphus Trollope donne même en 1840 des détails sur l'organisation de ces représentations qui poursuivent assurément une tradition séculaire adaptée aux circonstances du temps :
"Ce fond de décor tout blanc était orné de bouquets de laurier et de fleurs sauvages, avec, plutôt moins judicieusement, deux ou trois gravures en couleurs, provenant des maisons voisines et représentant Bonaparte et la Vierge."
La fin du XIXe siècle voit une renaissance du théâtre breton avec des auteurs talentueux et publiés comme Job Le Bayon ou Tanguy Malmanche, qui annoncent les grandes voix du XXe siècle : Jakez Riou, Roparz Hémon, Jarl Priel, Per-Jakez Hélias...
En 1898, Charles Le Goffic dans la Revue Hebdomadaire laissait entendre ce cri de triomphe
"La Bretagne a désormais son "Théâtre du peuple". Il se dresse en plein air, sur la place publique du petit bourg de Ploujean, près de Morlaix. La première représentation était fixée au 14 août, et le plus que j'en veuille dire est qu'on y a joué un antique mystère, la Vie de saint Gwénolé, et que les acteurs qui jouaient ce mystère étaient, à l'exception d'un ou deux, des artisans et des laboureurs, petites gens donc, sans grande éducation, sans talent même, au sens où nous le prenons des acteurs ordinaires, mais de foi vive et tout soulevés par endroits de je ne sais quelle fureur barbare et sacrée. Le chef de la troupe, Thomas Parc, dit Parkic, cumule lui-même, dans le privé, les professions de cultivateur, de fournier, d'aubergiste et de barbier. Placée sous le patronage des plus hautes autorités du monde celtique, comme MM. Gaston Paris, Alexandre Bertrand, Gaidoz, Loth, Ernault, etc., la représentation avait tout le caractère d'une reconstitution historique et marquera peut-être une date dans l'histoire du théâtre populaire breton."
Ainsi, paradoxalement, au moment où la langue bretonne commence à être moins parlée dans les campagnes, des revues, un théâtre, une littérature donnent surtout à la petite bourgeoisie mais aussi au peuple des campagnes la possibilité de stabiliser voire de perfectionner son bilinguisme et un théâtre populaire reprend vie !
Job ar Bayon (1876-1935) pense poursuivre une tradition qu'il juge immémoriale en essayant de raviver un théâtre religieux moribond. Dès 1909, il fonde la troupe de Santez Anna Wened (Ste-Anne-d'Auray) et donne, en 5 actes, une vie de ce saint populaire dans la région, Nikolazig, dont la première a lieu la même année, une uvre qui a vite un certain écho. Il utilise avant chaque acte la technique des tableaux vivants et le personnage principal, Nicolazic, dialogue avec le chur comme dans le théâtre grec. Puis viendront entre autres Er Hémenér (1910), Bah sant Guénolé (1912), Ar Hent en Hadour (1913)
Puis, sous l'influence en particulier de Roparz Hémon le théâtre breton, dans les années 1920-40 s'ouvre au monde et à la modernité. Celui-ci (Louis-Paul Némo, 1900-1978) croit d'abord, comme Le Braz, que la Bretagne n'a pas de tradition théâtrale populaire et tente de créer un théâtre breton moderne. Il s'appuie sur une revue, Gwalarn, et coopère en particulier avec l'écrivain autrichien Leo Perutz (1882-1957).
À la suite de son exil en Irlande, il comprend alors qu'un théâtre populaire n'a pu qu'exister en Bretagne et commence à éditer des textes de drames bretons.
Après la seconde guerre, le théâtre se développe en Haute et en Basse Bretagne avec des troupes amateurs et professionnelles. La Jeunesse Agricole Catholique encourage, depuis les années 30, un théâtre permettant de donner la parole au paysan et de faire passer un message de modernité. Ces amateurs renouent avec le goût traditionnel en Bretagne pour le théâtre que les mouvements d'éducation populaire, les patronages ont toujours cultivé. Dans les années soixante, se crée une association attachée à la Fédération Catholique du Théâtre Amateur (FECTAF) qui devient l'Art Dramatique Expression Culture (ADEC - à Rennes et dans le Morbihan), qui offre des formations aux personnes désireuses de découvrir la pratique d'un théâtre amateur exigeant. En 1983 naîtra le Festival Régional de théâtre amateur de Lizio (35e édition en 2018 devenu Festival de Josselin).
Sur le plan du théâtre professionnel, ce n'est qu'après 1945 que le théâtre se démocratise vraiment avec des pionniers comme Guy Parigot qui fonde avec Georges Goubert la Compagnie des Jeunes Comédiens de Rennes à l'origine de la création du Centre dramatique de l'Ouest (Hubert Gignoux, 1949). Il codirige ensuite la Maison de la culture de Rennes (1968), le théâtre du Bout du Monde et la Comédie de l'Ouest, puis cofonde le Grand Huit qui devient en 1989 le Théâtre National de Bretagne. Mais ce théâtre né de la décentralisation a vite fait des émules et de nombreuses municipalités ont développé leur propre projet comme le Théâtre de poche d'Hédé fondé par Michel Estier et Bernard Libault.
Des troupes recommencent à sillonner le pays breton et acquièrent une certaine notoriété comme Strollad Beilhadegoù Treger (de François Danno -Trégor) ou Strollad Ar Vro Bagan (Léon) tandis que des hommes comme Pierre Jakez Hélias et Pierre Trépos s'efforcent de donner des émissions radiodiffusées en breton (conversations, sketches, saynètes comme les joyeux devis de Jakez et Gwilhou - voir son Quêteur de mémoire, Plon, Paris, 1990...) qui se rapprochent d'un théâtre populaire radiodiffusé.
En 1963, un jeune auteur et metteur en scène, Jean Moign, adapte Gurvan de Tanguy Malmanche, pièce réputé impossible à représenter et c'est un succès lors de sa création par son Théâtre Populaire de Bretagne au festival de Locronan. Moign continue sur sa lancée avec des uvres de Jakez Roux et refuse rapidement de s'enfermer dans une langue ou dans l'autre, la Bretagne étant un pays bilingue. Il se tourne alors vers un théâtre à l'intention des scolaires et touche ainsi un public important dans les années 70 et 80 avec à la fois des pièces du répertoire classique français, des créations et des adaptations en breton d'extraits par exemple du Barzaz Breizh. Il tentera même d'implanter un Theâtre d'arts celtiques à Paris.
Actuellement, il suffit de consulter http://www.teatr-brezhonek.org/ et Diskor pour se rendre compte de la réalité d'un théâtre breton bien vivant. D'ailleurs, en octobre 2016, un des plus grands dramaturges bretonnants tenait l'affiche au Théâtre de la Huchette : Tanguy Malmanche avec Kou le corbeau, la version francisée de sa comédie.
En Bretagne, Strollad ar Vro Bagan continue à jouer un peu partout plusieurs pièces de cet auteur mais en breton. Ainsi en octobre 2016, à Vannes, Ar Baganiz (Les Païens) tout comme la troupe Pen ar Bed de Brest a adapté entre autres de nombreuses uvres de Guillaume Kergourlay.
Les troupes bretonnantes (strolladoù) et les représentations attirent un public croissant : au début d'abord Strollad ar Vro Bagan, troupe professionnelle dirigée par Goulc'han Kervella, puis de plus en plus de troupes semi professionnelles ou amateurs comme le Teatr Piba car, comme partout en Bretagne, la césure amateurs/professionnels disparaît comme la différence ville/campagne ainsi qu'en témoigne l'inauguration du Strapontin, le théâtre municipal de Pont-sur-Scorff, qui se veut un lieu de vie rassemblant musique, cinéma, théâtre.
Ajoutons qu'un théâtre en langue gallèse se développe avec des troupes comme le Théâtre des Préchous ou la Compagnie du Grenier Vert et que le Festival Gallo en Scène, proposait pour sa 15e édition en 2017 rien moins que trois pièces de théâtre !
Enfin, les spectacles en français ou en breton circulent sur tout le pays et attirent partout un public croissant, les mêmes troupes proposant des spectacles dans les deux langues.
Voir le portail http://www.teatr-brezhonek.org/
Voir Bretagne Culture Diversité : www.bcd.bzh
Orientations bibliographiques
http://www.albertbock.net/archiv.htm
Ar Merser, Andreo, Les Graphies du breton, Brest, Ar Helenner, 1980.
Balcou, Jean, Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, vol. 1-3, 1997.
Broudic, Fañch, "500,000 Brezoneger a zo en Breiz-Izel. Med piou int?", in : Brud Nevez, 104, p. 2-54.
Broudic, Fañch, "Ar brezoneg hag ar vrezonegerien e 1991", in: Brud Nevez, 143, p. 20-60, 1991.
Broudic, Fañch, "Perceptions d'une politique en faveur de la langue et de la culture bretonnes: principaux résultats", TMO-Ouest, Rennes, 1992.
Denez, Per, "The present state of the Celtic languages: Breton", in : Mac Eoin, Gearóid (éd.) Proceedings of the Sixth International Congress of Celtic Studies, Galway 1979, in : Dublin Institute of Advanced Studies, Dublin, 1983.
Falc'hun, François: 1955. L'orthographe universitaire de la langue bretonne, Emgleo Breiz, Brest, 1955.
Falc'hun, François, "Le breton. Forme moderne du gaulois", Annales de Bretagne, Rennes, 1963.
Favereau, Francis, Bretagne contemporaine: langue, culture, identité, Skol Vreizh, Morlaix, 1996.
Favereau, Francis, Grammaire du breton contemporain, Skol Vreizh, Morlaix, 1997.
Favereau, Francis, Dictionnaire du breton contemporain, Skol Vreizh, Morlaix, 2000.
Fleuriot, Léon, Le vieux breton. Éléments d'une grammaire. Paris, Klincksieck 1964.
Fleuriot, Léon, Les Origines de la Bretagne. Paris, Payot, 1980.
Giraudon, Daniel, Chansons populaires de Basse-Bretagne sur feuilles volantes, Skol Vreizh, 1985.
Gourlay, Patrick, Le renouveau du théâtre populaire breton, Coop Breizh, 2016.
Hamon, Kristian, Les nationalistes bretons sous l'occupation. Kergleuz: An Here, 2001. Hémon, Roparz, Grammaire Bretonne. Brest, Al Liamm. 3. éd., 1958.
Hewitt, Steve, The Degree of Acceptability of Modern Literary Breton to Native Speakers. Department of Linguistics, University of Cambridge, 1977.
Hewitt, Steve, "Réflexions et propositions sur l'orthographe du breton", in : La Bretagne Linguistique. 3. 41-54, 1986/1987.
Le Berre, Yves, "Le théâtre en breton aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles", in : Littératures classiques, 2015/2, no 87, p. 271-283.
Le Menn, Gwennolé (Éd..): Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisation. Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot. Rennes, Presses Universitaires Rennes.
Lambert, Pierre-Yves, "Le fragment médical latin et vieux-breton du manuscrit de Leyde, Vossianus lat. fo 96A", in : Bulletin de la Société archéologique de Finistère, p.315-327, 1986.
Le Bayon, A.-M., Grammaire bretonne du dialecte de Vannes. Vannes, Imprimerie Lafolye, 1878.
Le Gonidec, Jean François, Grammaire celto-bretonne. Paris, Rougeron, 1807.
Le Gonidec, Jean François, Dictionnaire celto-breton ou breton-français. Angoulême, Trémenau, 1821.
Le Roux, Pierre, Atlas linguistique de la Basse-Bretagne. 6 vols. Paris: Champion, 1924-1963.
Luzel, François-Marie, Contes traditionnels de Bretagne. Ar Releg Kerhuon, An Here - Hor Yezh, 1980.
Ternes, Elmar, "Zur inneren Gliederung der keltischen Sprachen", in: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 92, p. 195-217, 1978.
Ternes, Elmar, "Die Sonderstellung des Bretonischen innerhalb der keltischen Sprachen: Eine typologische Untersuchung", in: Zeitschrift für celtische Philologie. 37, p.214-228, 1979.
Ternes, Elmar, "The Breton Language", in: MacAulay, Donald (Ed.), The Celtic languages. Cambridge: Cambridge University Press,1992.
Williams, Rita, "Breton Literature", in: Price, Glanville (Ed.), The Celtic Connection. Gerrards Cross, 1992.
Notes :
1. Pour La Villemarqué, c'est un théâtre développé dès l'Antiquité celtique. Au début des années 60, Lucien Blocklander pense qu'il y a eu un théâtre puisant son inspiration dans de vieux textes français mais avec des apports bretons. Yves Le Berre affirme lui en 2015 que le théâtre ne devient populaire qu'avec la Révolution.
2. Voir Émile Ernault, qui a publié et traduit en partie ces textes (Revue Celtique) et le travail de l'université de Vienne sous :
https://homepage.univie.ac.at/albert.bock/archive/handouts/theater/theater_01_einfuehrung.pdf
3. Le Goffic rappelle l'essai malheureux de François Luzel en 1888 : la représentation du Mystère de sainte Tryphine et du roi Arthur avait été un four (impréparation, locaux inadaptés...) et la presse parisienne avait daubé sur le "théâtre breton" !
En 1623, la vierge apparaît à Keranna à 4 paysans et leur demande de construire une nouvelle chapelle à la place de l'ancienne qui n'est plus que ruine. Seul Nikolazig tient à accomplir ce vu tandis que tout le monde est sceptique. À la suite d'une seconde apparition et d'une guérison miraculeuse, on écoute Nicolazig et la chapelle est construite...
4. Lundi 3 octobre à 20 h, Kou le Corbeau, de Tanguy Malmanche au Théâtre de la Huchette à Paris. Avec Guy Moign, directeur de La Compagnie du Solilesse. Mise en scène de Nell Reymond, dans le cadre de la Saison 2016/2017 des Monologues de la Huchette sous le parrainage de Pierre Arditi.
Rimbaud et la musique. Une remarque
F. Labbé
Dans un article précédent, j'avais tenté de montrer combien Le Bateau ivre pouvait être considéré comme la chronique d'un échec annoncé et que la voyance rimbaldienne n'était pas "uniquement" poétique mais s'étendait à des territoires ignorés, le jeune Rimbaud ayant préscience de sa destinée.
Entre le narrateur clouant des Indiens à des poteaux de couleur pour s'élancer dans les mystères de la mer, la profondeur infinie des abysses et l' "enfant triste" accroupi à la tombée du jour devant une flaque d'eau où il lâche "un bateau frêle", une expérience poétique totale et incomparable commence, se déroule et se clôt. Mais c'est aussi la chronique de l'échec attendu de toute une existence voire de toutes les existences.
Car Rimbaud est avant tout un expérimentateur, un explorateur (un de ses derniers écrits sera adressé à la Société de Géographie), il cherche, dans tous les domaines, à "com-prendre" et à utiliser son savoir, ses expériences, ses "manipulations" pour aller plus loin, repousser autant que faire se peut les frontières qui l'étreignent : la famille, la tradition, la culture, la lecture, la littérature, les beaux-arts, la poésie renouvelée, le "dérèglement des sens"...
Il était naturel qu'il eût dans cette optique voulu explorer l'univers de la musique, particulièrement en ces temps où Wagner et son uvre continuaient à défrayer la chronique et que, avec un peu de retard sur la peinture, des compositeurs cherchaient à sortir des sentiers battus et exploraient d'autres voies novatrices.
On sait qu'en 1871, à l'Hôtel des étrangers, où se réunissent les Zutistes qu'il fréquente avec l'ami Verlaine, il apprend avec acharnement le piano guidé par le barman et musicien Ernest Cabaner qu'il seconde dans ses activités professionnelles en échange des leçons et du droit de dormir dans les lieux ("Rimbaud's Piano", W. S. Merwin Grand Street Vol. 9, No. 1 (Autumn, 1989), pp. 14-18- Son ami Ernest Delahaye situe cet apprentissage plus tard). Cabaner développe une méthode originale, "chromatique" : colorier les notes et les associer à des voyelles ! (voir : Pierre Petitfils, Rimbaud, Julliard, coll. "Les Vivants", 1992).
Jean-Louis Backès, dans un important article (Romantisme, Année 1982, No 36, pp. 51-64), a fait le point sur Rimbaud musicien. Nous y renvoyons d'autant plus que ce texte est accessible sur internet.
Dans la courte note qui suit, il s'agira moins du musicien Rimbaud que du lecteur ou du déchiffreur de partitions.
La synesthésie est une figure majeure de sa poétique et il était naturel qu'il s'intéresse d'une part aux lois de l'harmonie et surtout à la disposition graphique des notes et des accords.
En effet, le poète ne peut qu'envier le musicien disposant d'uvres pouvant se lire horizontalement et verticalement, créant ainsi des nuds harmoniques, donnant une profondeur, de l'épaisseur, un écho aux diverses lignes mélodiques.
Je ne fournirai ici qu'un seul exemple de cette tentative de captation de techniques musicales par le jeune Rimbaud.
Il suffit, par exemple, de retranscrire le Quatrain écrit certainement à l'époque de Voyelles autre recherche synesthésique immédiatement inspirée par la méthode Cabaner, et dont Verlaine a retranscrit le seul manuscrit existant sur le feuillet de ce même sonnet Voyelles.
L'étoile a pleuré rose au cur de tes oreilles
L'infini roule blanc de ta nuque à tes reins
La mer a parlé rousse à tes mammes vermeilles
Et l'homme saigne noir à ton flanc souverain
Si l'on recopie ces quatre vers dans une partition ou dans un tableau, on obtient :
L'étoile// a pleuré// rose // au cur//de tes oreilles
L'infini// roule// blanc// de ta nuque // à tes reins
La mer// a parlé// rousse// à tes mammes // vermeilles
Et l'homme// saigne// noir// à ton flanc// souverain
Il en ressort une double grille de lecture, horizontale et verticale, qu'on pourrait peut-être qualifier à la fois de superficielle et profonde. Certes, il ne faut pas être grand clerc pour reconnaître ce qu'on appelait dans les années 70 "une structure remarquable", mais le rapprochement avec la musique, à laquelle Rimbaud s'intéresse justement alors, parce qu'elle est pour lui un nouveau moyen d'investigation, n'est pas sans intérêt. L'apprenti pianiste et poète en recherche, tente d'écrire pour la main gauche des "accords", des thèmes (Immensité/ Petitesse de l'homme/ Couleurs/ Cur et corps ) et pour la main droite un texte énigmatique. Comme pour Voyelles, Rimbaud cherche par tous les moyens à dépasser la surface des mots et le carcan de la syntaxe, à aller au-delà du verbe mais par le verbe et les sons, un verbe toutefois passé à la jouvence de son imagination, de son savoir et de son vouloir.
Il est remarquable de constater que la construction des vers (Sujet /verbe/ adjectif ou/et adverbe/ complément) permet toutes les combinaisons, un jeu que les surréalistes pratiqueront aussi (voir également les Mille milliards de poèmes de Queneau).
Inutile d'essayer de donner une nième interprétation à ce quatrain, qui n'était d'ailleurs probablement qu'un essai. Il n'en a pas besoin, les deux lectures horizontales et verticales, le jeu des combinaisons se complètent et en disent assez...
On lira plutôt le sonnet que Cabaner dédia à Rimbald :
SONNET DES SEPT NOMBRES.
à Rimbald
Nombres des gammes, points rayonnants de l'anneau
Hiérarchique, - un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept -
Sons, voyelles, couleurs vous répondent car c'est
Vous qui les ordonnez pour les fêtes du Beau.
La OU cinabre, Si EU orangé, Do O
Jaune, Ré A vert, Mi E bleu, Fa I violet,
Sol U carmin - Ainsi mystérieux effet
De la nature, vous répond un triple écho,
Nombres des gammes ! Et la chair, faible, en des drames
De rires et de pleurs se délecte. - O L'Enfer,
L'Aurore ! La Clarté, La Verdure, L'Ether !
La Résignation du deuil, repos des âmes,
Et La Passion, monstre aux étreintes de fer,
Qui nous reprend ! - Tout est par vous, Nombres des gammes !
L'Armorique littéraire de Marie-Auguste Mareschal (1739-1811)
Puis viendront les recherches de Le Brigant et La Tour d'Auvergne.... On évoque le génie breton et des recherches sur les antiquités celtes (Président de Robien), sur la langue bretonne se développent. Sans lien direct avec ces travaux, mais expression d'une sorte de renouveau "national", la Société d'Agriculture, puis la Société patriotique bretonne sont créées.
Quelques années après, profitant des libertés accordées par la Révolution, un modeste bibliothécaire de Lamballe, Auguste Mareschal (1739-1811), entreprend de publier son Armorique littéraire ou Notice sur les Hommes de la ci-devant Province de Bretagne, qui se sont fait connaître par quelques écrits (Lamballe, An IIIe de la République Française). Il s'agit du premier ouvrage de ce type, de la première tentative pour établir une biobibliographie réservée aux auteurs nés ou ayant vécu en Bretagne. Dans l'Avis liminaire, Mareschal, avec beaucoup de modestie, souligne que son "essai" attend "une main plus habile pour acquérir le degré de perfection dont il est susceptible". Ses vux seront entendus au siècle suivant avec les travaux de Miorcec de Kerdanet, Notices chronologiques sur les théologiens, jurisconsultes [&c.] de la Bretagne, Brest, 1818 ; de Pierre Levot, Biographie bretonne, Vannes-Cauderan, 1852-1857, ou René Kerviller, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, publié seulement en 1978-85.
Ses 103 notices peuvent paraître insuffisantes au regard du bien plus grand nombre d'auteurs et de savants bretons qui se sont manifestés au cours des siècles. Il reconnaît lui-même ne pas avoir été très complet par manque de documents et par le parti-pris d'avoir renoncé aux auteurs vivants. En même temps, son désir est de donner à la fois une idée de la richesse intellectuelle de la province et de faire naître l'envie chez ses compatriotes de s'appliquer "encore davantage aux sciences et aux lettres, trop peu cultivées dans cette belle partie de la République Française", sous les auspices de la liberté nouvelle. Il reconnaît enfin avoir eu recours aux biographies existantes et particulièrement au Dictionnaire historique en huit volumes de 1786. Il répond en quelque sorte aux exhortations d'autres Bretons - Duclos, Fréron - ayant cultivé les lettres, dépités de considérer que le Parnasse Breton n'est pas assez connu et peut-être insuffisamment important.
L'ouvrage de Mareschal est plus qu'une simple compilation, car il a su, très souvent, ajouter tel ou tel détail qu'on ne trouvait pas avant lui. Ses successeurs lui en sauront gré, sans toujours le citer d'ailleurs. Ajoutons que son ouvrage se clôt sur des "notices bibliographiques" dans lesquelles, il donne tous les conseils possibles aux bibliothécaires : histoire de l'imprimerie et du livre, imprimeurs d'Europe, leurs enseignes, classements systématiques
Tout à fait persuadé que la nouvelle époque a plus que jamais besoin du livre, des bibliographies et des bibliothèques, il conçoit cet ouvrage comme un véritable acte civique et le point de départ d'efforts ultérieurs.
Il ne faut donc pas chercher l'exhaustivité dans ce travail, mais ces "notices" donnent parfois des renseignements jusqu'alors inconnus et conservent surtout la mémoire d'auteurs honorables, mais en voie d'être livrés à l'oubli. Ainsi, pour ne citer que quelques-uns des noms les plus menacés : Louis-Paul Abeille, un des fondateurs de la Société d'Agriculture, de commerce et des arts bretonne, le père Yves-Marie André, philosophe et mathématicien, Anneix-de-Souvenel, l'avocat poète rennais, Joseph Baudori, le successeur du père Porée à Louis-le-Grand, Belordeau de la Grée, le commentateur des coutumes de Bretagne, Exupère Joseph Bertin, médecin célèbre et littérateur abondant, Paul Hay du Châtelet, l'académicien auteur de l'Histoire de Bertrand du Guesclin, Pierre Jean Le Corvaisier, secrétaire et sauveur de l'académie d'Angers, Veyssière de la Croze qui devait devenir un des piliers du Refuge de Berlin et le bibliothécaire du roi de Prusse, Louis-Florian Desnos-des-Fossés, littérateur aimable né près de Lamballe dont la riche bibliothèque et les manuscrits furent dispersée à la Révolution, Jacques Gallet, l'inspirateur de Dom Morice, Jean-Marin Kervillars, jésuite philosophe, René le Pays de Villeneuve, un auteur fécond dont Boileau dit qu'il était "un bouffon plaisant", Claude Visdelou, le jésuite missionnaire et historien de la Chine
La notice consacrée à Descartes est particulièrement complète et Mareschal la fait suivre de celle de Catherine Descartes, la nièce du philosophe, née à Rennes et qui écrivait aussi bien en vers qu'en prose.
Il commet aussi des erreurs, comme de confondre Dol de Bretagne et Dole pour faire un Breton de Claude-François Lambert, un polygraphe dont l'Histoire générale de tous les peuples du monde connut son heure de gloire, mais qui est Franc-Comtois !
Marie-Auguste Mareschal était originaire de Plancoët, où il vit le jour le 10 décembre 1739. Issu de la petite bourgeoisie (officiers, juristes, notaires), il s'établit en 1770 à Lamballe en qualité d'entreposeur de tabac, un office qu'on se passait de père en fils. Il perd sa charge à la Révolution, dont il épouse la cause et devient officier municipal. Il exerce alors plusieurs fonctions : administrateur des biens de l'hôpital puis administrateur, président et enfin directeur du district. La Convention le nomme au comité de surveillance et, après la Terreur, il devient responsable de la bibliothèque du district, puis du département, alors que les bibliothèques privées saisies sont répertoriées et intégrées aux futures bibliothèques publiques. Il dresse d'ailleurs le catalogue des ouvrages confisqués (celles des Augustins de Lamballe, de Saint-Aubin-des-Bois en Plédéliac, des châteaux de la Moussaye en Plénée, de Bien-Assis, de Cario en Maroué Ses activités sous la Terreur et son engagement révolutionnaire lui vaudront quelques ennuis lors de la réaction thermidorienne, mais il est nommé commissaire du pouvoir exécutif près de l'administration municipale du canton de Lamballe le 30 août 1798. Il aura une action importante lors de la répression de la 3e chouannerie. Franc-maçon ("L'Union philanthropique" de Lamballe), il est l'auteur d'un mémoire dirigé contre les imprécations antimaçonniques de l'abbé Barruel, les Mémoires pour servir à l'Histoire du jacobinisme. On a de lui différents écrits imprimés ou sous forme de manuscrits (bibliothèque municipale de Saint-Brieuc : ses Annales de la guerre de la liberté depuis le 8 septembre 1793 (An X), son Véritable éloge de Napoléon (1806-1807), une comédie
Son frère aîné, Louis-Nicolas Mareschal (1737-1784), médecin à Saint-Malo, est l'auteur de drames, de contes et de poésies. C'était un homme des Lumières qui se moquait du magnétisme animal et de ses sectateurs par trop crédules ; une de ses pièces de théâtre porte pour titre : Mesmer, ou les Sots ; Salmigondi dramaticocomico lyrico philosophique, uvre posthume d'une mauvaise digestion, Jersey, 1789.
L'Armorique littéraire est à replacer dans le vaste mouvement d'idées évoqué en début d'article, même si son auteur ne fait en apparence que répéter pour la Bretagne ce que Palissot, Sabatier de Castres ou d'autres ont tenté pour la France, mais il sème une graine. En effet, le fils de Marie-Auguste Mareschal, Louis-Auguste (1772-1843), qui vivait à Pont-l'Abbé, s'intéresse à la vie traditionnelle des paysans de la région de Quimper et, avec un peintre et illustrateur, Olivier Perrin (Rostrenen 1761-1832), protégé au début de sa carrière par Millin de Grandmaison, il a l'idée de lancer une sorte de revue qui aura pour but de présenter ces traditions (textes et gravures), car il pense qu'elles forment un ensemble particulier à la province qu'il convient de conserver : la Galerie des murs, usages et coutumes des Bretons de l'Armorique (à partir de 1795), un ouvrage qui sera repris et poursuivi au XIXe siècle sous d'autres titres, en particulier sous la houlette de Alexandre Bouët, le maire de Lambézellec et fondateur du journal l'Armoricain. Celui-ci reformulera les textes davantage dans la perspective de la présentation d'une culture bretonne vivante et actuelle, tournée vers l'avenir (Galerie Bretonne ou vie des Bretons de l'Armorique, 1835-1836, avec une notice sur O. Perrin d'Alexandre Duval, puis Breizh-Izel, ou vie des Bretons de l'Armorique,1844). Il est probablement moins sensible aux arguments des "celtomanes" qui recherchent dans ces us et coutumes les bribes d'un savoir, de connaissances remontant aux temps les plus reculés, et se contente d'un travail de collecte, d'observations, de préservation pour lui-même de ce patrimoine que d'aucuns, comme les Mareschal, présentent menacé de disparition. Louis-Auguste sera aussi un des animateurs de la Muse bretonne.
Sans préjugés ni a priori, les Mareschal et leurs amis sont parmi les premiers gardiens de la mémoire bretonne voire les premiers éveilleurs à une conscience bretonne libre de tout présupposé mythique ou merveilleux.
A l'instigation de Serge Davy, libraire à Dinan, le livre de Marie-Auguste Mareschal a été republié en fac-similé en 1997. Une importante notice de Joseph Chenu (Plancoët) précède cette réédition.
Jacques Delille et Ferrette. Entre-deux géographique, historique et poétique
si de l'art des vers quelque ami généreux
Daigne un jour m'accorder de modestes hommages,
Ah ! qu'il ne place pas le chantre des bocages
Dans le fracas des cours ou le bruit des cités.
Vallons que j'ai chéris, coteaux que j'ai chantés ;
Souffrez que parmi vous ce monument repose ;
Qu'un peuplier le couvre et qu'un ruisseau l'arrose !
En 1785, Balbina von Andlau-von Staal, l'épouse du Landvogt de Birseck Franz, et son neveu, Heinrich von Ligertz admirent Rousseau, Thomson, Gessner et surtout Jacques Delille (1738 - 1823) qui vient de publier l'année précédente Les Jardins ou l'art d'embellir les paysages, un ouvrage qui lui ouvrit (enfin) les portes de l'Académie française. Ce long poème didactique connut en effet un succès extraordinaire dans toute l'Europe francophone ou qui se piquait de l'être. Il était composé de 4 chants et de 1000 alexandrins dont la plupart sont d'une belle facture, car Delille était un versificateur de talent, l'ami et l'héritier d'un autre maître du vers Louis Racine (ce qui ne veut pas tout à fait dire poète !) Il y décrit entre autres les différences entre les jardins à la française et à l'anglaise et se place ainsi dans la droite ligne de l'atmosphère rousseauiste. Son poème enterine un changement de paradigme. Pour lui le jardinier (paysagiste, ajouterions-nous aujourd'hui) est un artiste comparable au peintre mais peignant en trois dimensions et, annonciateur de Lamartine, la nature des jardins tels qu'il les imagine appelle à la transcendance, à la méditation sur le temps, la vie et la mort.
La nature autour du vieux château de Birseck émeut Balbina et Franz. Ces âmes esthétiquement sensibles ont alors l'idée de créer un jardin paysager autour de la colline couronnée par l'antique burg en suivant, comme bien d'autres en Europe, les recommandations du poète français. En 1785, ce qu'ils baptisent "Solitude romantique près d'Arlesheim" ouvre ses portes et le Livre des visiteurs montre que cet Hermitage reçut l'hommage de quantité de touristes venus de tous les coins de l'Europe.
Hélas ! Hélas ! ce monument de la nature tant prisé ne résista pas à la fureur des troupes révolutionnaires : les statues, le chalet suisse, le parasol chinois, le Repos de Sophie, les Cabanes de charbonniers... disparurent et il fallut attendre une vingtaine d'années pour que
Conrad von Andlau, le fils de Franz et Balbina, rachète les lieux et reconstruisent un jardin, mais cette fois suivant l'inspiration des temps nouveaux, décidément romantique : ruines du château que l'on arrange pour les rendre plus angoissantes et nostalgiques, chapelle décorée de fresques, salle des chevaliers, sentiers qui se perdent, plantations étonnantes, points de vue sur les collines...
Conrad conserve bien entendu quelques éléments du premier jardin prônés par Delille comme des stèles et des inscriptions favorisant l'introspection et la réflexion philosophique. Il a aussi l'idée d'ajouter un hommage à ce poète qui vient donc de disparaître en 1814, soucieux aussi de bien montrer la continuité entre les temps d'avant la Révolution et d'après l'Empire.
Le choix de ce monument à la mémoire du Virgile français vient aussi du fait que chacun sait que pendant une année, le poète s'était réfugié non loin de Bâle, dans le Sundgau, à Luppach et que malgré le retirement dans lequel il voulait vivre (en premier lieu pour des raisons existentielles en ces périodes troublées), il n'avait pas manqué d'être reçu ici et là par les familles patriciennes de la Suisse du nord, du Jura et du sud de l'Alsace. Il était en quelque sorte "du pays" !
Tout commence en effet avec la fête de l'Être suprême du 20 prairial an II (8 juin 1794), voulue par Robespierre et orchestrée par J.-L. David : aux Tuileries, le peuple doit d'abord solennellement rejeter l'athéisme puis, au Champ-de-Mars, reconnaître l'Être suprême.
Pour l'Incorruptible, la "déchristianisation" entreprise à partir de brumaire an II (novembre 1793) ne doit conduire ni à l'athéisme ni à la laïcité comme le voulaient Cloots ou Chaumette. Le 18 floréal (7 mai), Robespierre a fait prendre par la Convention le décret par lequel "le peuple français reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de l'âme".
Quelques jours après la fête, en exécution de l'article 9 de ce décret, il faisait appel
"à tous les talens dignes de servir la cause de l'humanité" susceptibles de fournir "des hymnes et des chants civiques" pour soutenir cette nouvelle politique. Nombreuses furent les propositions, mais Robespierre ne voulait pas se contenter des plumitifs faméliques qui souvent ne cherchaient qu'à gagner quelques sous, il souhaitait qu'un grand nom soutienne aussi son projet.
Or, un des plus grands poètes de l'époque était Jacques Delille. Celui-ci, après de bonnes études au collège de Lisieux puis à Paris était devenu un latiniste réputé et Professeur d'humanités dans divers collèges tout en publiant des odes, des épîtres et des traductions en vers d'auteurs anciens. En particulier, sa traduction des Géorgiques de Virgile, avec un Discours préliminaire remarqué (1769) lui valut une véritable célébrité. Voltaire engagea le "Virgile français" à se présenter à l'Académie, qui l'élit en 1772, mais cette action ne fut pas entérinée par le roi qui le jugeait trop jeune. Ce ne fut que partie remise et Delille se représenta deux ans plus tard avec succès au fauteuil de La Condamine. Depuis son poème Les Jardins (1780), considéré comme un chef-d'uvre du genre descriptif et didactique, les salons se disputaient sa présence. Le comte d'Artois, frère du roi Louis XVI, lui donna l'abbaye de Saint-Séverin (diocèse de Poitiers) dont il était collateur, bénéfice simple qui n'exigeait pas l'engagement dans les ordres sacrés : mais Delille prit le titre d'abbé. Familier des grands, en 1786, il partit pour l'Orient avec le comte de Choiseul-Gouffier, un voyage qui ne fut pas sans influence sur sa poésie. À son retour à Paris, il occupa la chaire de poésie latine au Collège de France et attira quantité d'auditeurs par ses talents de lecteur et de déclamateur. Il fréquentait entre autres les salons de Mademoiselle de Lespinasse et de Madame Geoffrin et fut même de la petite cour de Marie-Antoinette.
En bref, l'abbé Delille, poète consacré, avait jusqu'alors traversé la Révolution sans grands dommages, encore qu'on lui ait supprimé les privilèges et pensions que son talent, ses amitiés et son entregent lui avaient procuré sous l'ancien régime. Cependant, sa situation matérielle n'était alors pas brillante.
Robespierre en personne décida alors de solliciter ce grand poète pour donner plus d'éclat à ses projets.
Delille qui se sentait spolié par une Révolution qui s'était radicalisée depuis 1792, se croyant toutefois protégé par son aura de grand poète, ne cachait pas son mécontentement, pour ne pas dire plus. La Terreur le révolta sincèrement même et il ne dissimula pas trop le mépris qu'il ressentait pour les Sans-culottes et leurs bonnets gras ainsi que pour les Comités et les Sections hurlantes et indisciplinées. Certaines imprudences avaient d'ailleurs failli lui être néfastes. Il s'en était fallu de peu qu'il ne soit incarcéré et l'on sait ce que cette situation avait le plus souvent pour conséquences. Il avait abhorré le ridicule de la Déesse Raison trônant à Notre-Dame; cette fois, même si les athées avaient disparu, même si Robespierre et ses amis voulaient rétablir un culte et restauraient des dogmes dont certains ressemblaient à ceux de l'Église, l'aspect sacrilège de ces manifestations le révulsait. En même temps, il n'était pas sans ignorer que sa situation était sans issue: accepter, c'était se déshonorer; refuser, c'était choisir la guillotine!
Delille essaya de transiger, de faire comprendre prudemment qu'il n'acceptait pas: la honte, le déshonneur lui paraissant pires que le supplice! Comme on le pressait de partout de prendre publiquement position, il joua son va-tout en composant un dithyrambe dont certains vers eurent une réelle célébrité. S'il osa, c'est aussi probablement parce que Robespierre et sa clique étaient de plus en plus l'objet de la rumeur publique et que des voix de plus en plus nombreuses murmuraient contre la Terreur:
Oui, vous qui de l'Olympe usurpant le tonnerre,
Des éternelles lois renversez les autels,
Lâches oppresseurs de la terre,
Tremblez, vous êtes immortels!
Et vous, vous du malheur victimes passagères,
Sur qui veillent d'un Dieu les regards paternels;
Voyageurs d'un moment aux terres étrangères,
Consolez-vous, vous êtes immortels!
Chateaubriand mettra ces événements en exergue dans ses Mémoires :
"Si je voulais, Messieurs, vous entretenir du poète célèbre qui chanta la nature d'une voix si brillante, pensez-vous que je me bornerais à vous faire remarquer l'admirable flexibilité d'un talent qui sut rendre avec un mérite égal les beautés régulières de Virgile et les beautés incorrectes de Milton ? Non : je vous montrerais aussi ce poète ne voulant pas se séparer de ses infortunés compatriotes, les suivant avec sa lyre aux rives étrangères, chantant leurs douleurs pour les consoler ; illustre banni au milieu de cette foule d'exilés dont j'augmentais le nombre. Il est vrai que son âge et ses infirmités, ses talents et sa gloire, ne l'avaient pas mis dans sa patrie à l'abri des persécutions. On voulait lui faire acheter la paix par des vers indignes de sa muse, et sa muse ne put chanter que la redoutable immortalité du crime et la rassurante immortalité de la vertu : Rassurez-vous, vous êtes immortels.
Évidemment, on sut vite que les hommes au pouvoir n'avaient pas apprécié. Ses amis le supplièrent alors de fuir et il accepta de prendre, discrètement la route de l'Est s'installant à pour peu de temps à St.-Dié, la ville de naissance de sa compagne, Mademoiselle Vaudchamp, qu'il devait épouser plus tard, en Angleterre.
Ce n'est là qu'une halte : dès l'été 1794, il projette de passer en Suisse mais sans pour cela être inscrit sur la liste des émigrés. Si le passeport nécessaire lui est refusé à Épinal, à Colmar avec l'appui d'un ami, le comte de Reiset, il obtient le document et file sur Bâle où la situation ne semble pas avoir été à la hauteur de ses attentes. L'écho de la Révolution s'y faisait sentir et il décide ne pas y rester.
Il visite les alentours de la cité rhénane, se rend à Arlesheim, on lui fait voir certains endroits pittoresques du Sundgau, du Jura et il songe à s'installer dans une de ces campagnes susceptibles de nourrir sa muse et de lui permettre une existence retirée tout en restant à proximité des maisons bâloises qui s'étaient empressées de recevoir ce grand poète. On dut enfin lui parler du pays de Ferrette, de ses ruines, de son relief tourmenté, de ses vieilles forêts, de son calme et, en septembre 1794, il visite la petite cité et son énorme château mais
Épris de la campagne et l'aimant en poète,
ne lui demandait qu'un désert pour retraite,
Pour compagnons des bois, des oiseaux et des fleurs.
(Homme des champs, 1er chant)
il cherche encore plus loin, un endroit plus retiré et on lui montre,à lui qui avait chanté dans ses Jardins le charme des vieux couvents, le monastère de Luppach tapi au fond de son vallon au milieu des forêts. Ce couvent avait été occupé par des Prémontrés jusqu'à la Révolution et était en mauvais état. En 1793, il avait été prévu d'en faire un hôpital militaire, mais celui-ci ne fonctionna jamais malgré le personnel mis en place: un médecin, un intendant et un cuisinier. Le médecin n'était plus là lorsque le poète arriva mais l'intendant, Durthaller, et le cuisinier le reçurent. Il sollicite alors la municipalité et on accepte qu'il prenne logis dans le bâtiment réservé autrefois aux visiteurs et qui était en assez bon état. Delille avait enfin trouvé l'endroit idéal: la nature, le mystère des bâtiments, la quasi-solitude, la frontière peu éloignée, un cuisinier pour s'occuper de sa table et Durthaller pour secrétaire en attendant l'arrivée de Mademoiselle Vaudchamp!
Fuyant les discordes civiles,
J'échappe dans les bois au tumulte des villes,
Et content de former quelques rustiques sons,
A nos cultivateurs je dicte des leçons [ ]
De mon triste pays les troubles politiques,
M'ont laissé pour tout bien mes agrestes pipeaux.
Lorsque celle-ci arriva, il la présenta d'abord comme sa nièce car elle était bien jeune encore. Jeanne Vaudchamp, fit contre mauvaise fortune bon cur: peu décidée à vivre dans une solitude quasi totale, elle entra en contact particulièrement avec deux familles aisées de Ferrette: celle de M. Mennweg, l'ancien procureur fiscal et celle du notaire Des Grandchamps, qui avait trois filles et un fils. Delille, de son côté rencontra souvent un ancien jésuite d'une autre grande famille de la cité, les Vogelweit, le seul alors, dit-on, qui fût sensible au charme de ses beaux vers. Cet admirateur voulut éterniser, autant qu'il était en lui, le souvenir du passage d'un homme aussi illustre en faisant placer sur la principale porte d'entrée du couvent l'inscription suivante malheureusement disparue:
Immortali viro Luppaca Delilio.
Les Vogelweit étaient liés aux Schwingdenhammer, la famille de l'archigrammateus des Mazarin, François-Joseph, mort en 1790. Marie-Ursule Vogelweit avait en effet épousé ce dernier le 5 février 1757 et trois enfants étaient nés de cette union dont François-Joseph-Antoine (1758) et Jean-Henri-Ferdinand (1761).
Il est impensable qu'on n'ait pas évoqué le puîné des Schwingdenhammer, Jean-Henri- Ferdinand, qui se faisait appeler Lamartelière à Paris (comme son aîné) et dont les adaptations de Schiller avaient triomphé sur les théâtres de la capitale et de France en 1792 et 1793!
Toujours est-il que les biographes de Delille rapportent que cet ancien habitué des salons se plaisait dans l'ambiance bourgeoise de ces familles de province.
Le poète se permettait aussi quelques autres rencontres. Ses Jardins, mais aussi ses autres ouvrages l'avaient rendu célèbre partout en Europe et les admirateurs ne manquaient pas. Ainsi, il était très lié au comte de Reiset qui vivait dans la vallée de Guebwiller et qui partageait les mêmes convictions politiques que lui, qui appréciait la même littérature et la même musique. Le comte lui recommanda même son fils aîné qu'il pensait menacé et Delille le recueillit quelque temps dans son monastère. C'est par M. de Reiset qu'il rencontre aussi un marquis de Quétray exilé dans les parages en attendant des jours meilleurs. Il avait aussi des contacts suisses: la société helvétique le sollicitait et à plusieurs reprises ses uvres y furent acclamées, à Porrentruy, l'ancienne présence des ambassadeurs français avait laissé de nombreux admirateurs de littérature française.
Au bout de seize mois environ, en 1796, poussé par les excentricités de Mademoiselle Vaudchamp qui l'avaient fâchée avec la plupart de leurs relations, mais aussi parce qu'il ne voyait pas d'un bon il dans la région de Bâle l'agitation de la population rurale qui exigeait liberté et égalité, appuyée par les libéraux de la ville (Peter Ochs, Peter Vischer, Lukas Legrand). La situation n'est pas sûre.
En outre, une lettre officielle lui apprend la création d'un Institut national et le somme quasiment de rentrer à Paris en sa qualité d'ancien académicien. Un peu piqué d'être ainsi "convoqué" de façon plus qu' injonctive, il avait immédiatement répondu:
"Je me suis si bien trouvé de mon obscurité et de ma pauvreté durant le règne de la terreur, que j'y reste attaché ne fût-ce que par reconnaissance; on m'annonce que ce refus pourra m'attirer quelques persécutions: si cela arrive, je dirai comme Rousseau: Vous persécutez
mon ombre", ce qui donnera dans ses poésies:
Vous donc qui prétendiez, profanant ma retraite,
En intrigant d'état transformer un poète,
Epargnez à ma muse un regard indiscret;
De son heureux loisir respectez le secret.
Auguste triomphant pour Virgile fut juste:
J'imitai le poète, imitez donc Auguste,
Et laissez-moi, sans nom, sans fortune ci sans fers,
Rêver au bruit des eaux, de la lyre et des vers.
(L'homme des champs, Chant II)
Il était donc temps de partir comme le lui conseillent ses correspondants et amis: Mallet du Pan, Portalis et d'autres. Il quitte donc Ferrette pour la Suisse où ses contacts helvétiques lui offrent de l'héberger. Près de Neuchatel (où il avait déjà séjourné en 1782, année où la Société typographique imprimait ses Jardins), M. de Marval (1768-1839) l'accueille avec toute la vénération d'un admirateur sincère en son domaine de Voens. C'est dans le cabinet de verdure du parc que Delille récite ses vers devant une assemblée choisie. Le poète séjourne assez longtemps dans cette région qui appartient à la Prusse et offre ainsi une certaine garantie. Il est parfois à Neuchatel, parfois à Voens, parfois à Gléresse ([...] Gléresse/ beau lieu qui nourrissait ma poétique ivresse... Malheur et pitié, chant IV) ou à l'Ile Saint-Pierre, payant l'hospitalité qu'on lui offre par des vers appréciés de tous. C'est là qu'il termine ses Trois règnes et L'Homme des champs. Il est un temps à Soleure et Berne le reconnaît comme "bourgeois", mais la politique du Directoire fait que l'intégrité de certaines régions de Suisse est directement menacée de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur comme à Bâle où après la démission du syndic les patriotes ont organisé des élections pour la formation d'une assemblée constituante. Les révolutionnaires menacent d'une intervention française. Les châteaux de Waldenburg, Farnsburg et Homburg seront d'ailleurs brûlés en 1798 et la République de Mulhouse abandonnera son indépendance pour rejoindre le giron français... De l'extérieur quand le Directoire menace puis prend Berne ou quand Peter Ochs se rend à Paris pour élaborer une constitution helvétique destinée l'ensemble des territoires suisses..., toutes choses qui lui rappelaient de bien mauvais souvenirs.
La vague révolutionnaire risquant de tout emporter et l'attitude prussienne étant aussi peu fiable que l'appui des Bernois, avec des victimes du 18 Fructidor, réfugiés comme lui, il sollicite son ami et correspondant Mallet du Pan qui vient d'être autorisé à passer l'hiver 1797 à Fribourg en Brisgau, ville appartenant alors à l'Autriche antérieure, de l'aider à obtenir le même droit. Les lettres de Portalis et de Mallet prouvent combien la société du poète, sa conversation et son optimisme les aidèrent à passer cette période difficile. L'hiver passé, il se rend à Brunswick puis à Hambourg pour rejoindre l'Angleterre. Dans cette dernière ville, chez la marquise de Verthamy, il retrouve son ennemi, le caustique Rivarol, qui avait constamment critiqué ses uvres et le traitait de "rossignol qui a reçu son cerveau en gosier" !
Enfin, il s'établit à Londres. C'est là qu'avec le chevalier de Mervé, il traduit en vers le vaste poème épique de Milton, Le Paradis perdu : quinze mois de travail qui s'achevèrent par une attaque de paralysie. Il peut rentrer à Paris en 1802 quand Bonaparte devient consul à vie, annonçant par là même pour bientôt un Empire qui voudra - dans certains cas - se montrer généreux et le faire savoir! Toutefois, il ne marchande pas son retour et n'accorde pas un vers à Napoléon ! Les Mémoires d'une femme de qualité sur le Consulat montrent combien il est accueilli avec ferveur malgré cette attitude pour le moins réservée face au consul puis à l'empereur: " La meilleure compagnie s'empara de Delille ; nous nous l'arrachions : sa venue était une fête [...]".
Pour en revenir au séjour de Luppach, Delille y a certainement beaucoup écrit et probablement terminé sa traduction de L'Énéide si l'on compare les dates d'édition et les quelques témoignages de ses hôtes suisses auxquels il lit des passages. C'est surtout dans ce vieux monastère qu'il a presque entièrement conçu et rédigé L'homme des champs dont il vend le manuscrit au libraire strasbourgeois Levrault et qui paraît en 1800.
Ce poème contient bien des vers qui sont en rapport avec les lieux de son exil sundgauvien. Dans le chant premier, il évoque sa solitude heureuse:
Ainsi, seul, à l'abri de mes rochers déserts,
Tandis que la Discorde ébranlait l'univers,
Heureux, je célébrais, d'une voix libre et pure,
L'humanité, les champs, les arts et la nature.
Dans le quatrième chant, il est plus précis encore et, s'il se refuse à nommer les lieux (Luppach, le château de Ferrette voir la Landskron ), c'est parce que, fidèle à sa conception de la poésie il adapte parfaitement la mode mélancolique venue d'Angleterre à la verve élégiaque du connaisseur qu'il est de la poésie latine et veut avant tout dépasser l'événement, le transcender, c'est-à-dire partir certes du hic et nun mais pour aller vers l'universel, car Delille ne peut être réduit à ce qu'on lui a souvent reproché: être plus artiste que poète! En effet, quoiqu'on ait pu en dire, son souffle poétique est moins prisonnier de l'appareil stylistique et rhétorique habituelle qu'il maîtrise parfaitement au point de le rendre beaucoup moins visible que la plupart des poètes du XVIIIe siècle. En bref, s'il se refuse généralement à donner des précisions, c'est parce que la nature qu'il donne à voir dépasse le cas d'espèce et est à fois source d'émotions, de réflexion et de plaisir esthétique, c'est parce que ce qu'il voit, ce qu'il vit se mêle indissociablement à son expérience de lecteur. Les références à l'antiquité (il est tout de même le Cvirgile français et son Homme des champs a pour sous-titre "Georgiques françaises"), aux auteurs anglais (Pope, Denham) et français tissent avec son expérience du moment une poésie qui échappe à l'immédiat :
Dans le sein ténébreux de ce bois écarté,
Contemplez ces débris d'une abbaye antique,
Monuments oubliés du faste monastique.
Entrons. De ces vieux murs le deuil religieux,
Ce chur où résonnaient ces cantiques pieux,
Et ces autels sans culte et leurs saints sans oracles,
Jadis chargés de vux et féconds en miracles,
Et ce lieu de l'offrande où de pieux reclus
Du crime repentant recevaient les tributs,
Tout cet asyle enfin, séjour de pénitence,
D'orgueil, de piété, de savoir, d'ignorance,
Dit plus dans ses débris que ce frais Panthéon,
Enfant sans souvenirs, antique par son nom,
Où la voix du passé ne se fait pas entendre,
Et qui n'ayant rien vu n'a rien à nous apprendre,
[ ]Tantôt d'un vieux château s'offre la masse énorme,
Pompeusement bizarre et noblement informe.
Combien de souvenirs ici sont retracés!
J'aime à voir ces glacis, ces angles, ces fossés,
Ces vestiges épars des sièges, des batailles,
Ces boulets qu'arrêta l'épaisseur des murailles.
J'aime à me rappeler ces fameux différends
Des peuples et des Rois, des vassaux et des grands.
Ces spectres, ces lutins rôdant dans les ténèbres,
Vieux récits dont le charme, amusant les hameaux,
Abrège la veillée et suspend les fuseaux.
Bien sûr, partout se trouvent "bois écartés" et "abbaye antiques", "vieux châteaux" et "vieux récits" "amusant le hameau", mais il y a là une sorte de cristallisation: la réalité vécue venant se surimposer à la réalité lue, rêvée ainsi qu'aux souvenirs. Ainsi, quand il écrit "Monts où j'ai tant rêvé", évoque-t-il seulement les ondulations de la campagne sundgauvienne, les endroits où il aimait s'asseoir comme dans la forêt de Ligsdorf près de ce "chêne séculaire à l'ombre duquel [ ] (il) venait chercher ses inspirations" que l'on montrait bien après sa mort ou songeait-il à la Limagne de son enfance? Les deux sans doute: les alentours de Luppach entraînaient des réminiscences, les images et les sensations se fondaient
Depuis ses Jardins au moins, le descriptif, voir le didactique, s'appuient toujours sur un lyrisme maîtrisé et sont inséparables d'échos méditatifs, d'une résonance qui annonce Lamartine par exemple.
On pourrait multiplier les exemples de vers qui se rapportent, ou pour être plus juste, pourraient se rapporter à sa situation dans la campagne de Ferrette.
Ainsi, le séjour dans la thébaïde de Luppach n'a pas été sans laisser de traces, peut-être moins dans l'exactitude des détails que dans l'état d'âme: ce qui était en germe chez lui et encore prisonnier d'une certaine routine poétique avant Luppach cède le pas à une poésie moins démonstrative mais plus intérieure, plus sincère dont son uvre La pitié sera un peu plus tard le sommet. C'est une poésie située à la fracture entre deux époques et Delille est un des premiers à entonner cette longue plainte que reprendront les Romantiques face à ce monde qui vient de s'écrouler laissant place à un avenir bouleversé et difficile à déterminer. L'entre-deux de Luppach était la situation idéale pour exprimer ce malaise que l'on ressent à la lecture de L'homme des champs, puis, plus tard de La Pitié, une sorte de métaphore exprimant la vacuité de ces années indécises entre l'ancien régime effondré et un avenir dont il est difficile de dessiner les contours, une inquiétude qui sera plus tard reprise par le célèbre passage des Confessions d'un enfant du siècle:
Trois éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme ; devant eux l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir ; et entre ces deux mondes quelque chose de semblable à l'Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde vapeur ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris.
Mais Musset écrira quarante ans après Delille et après la tragédie de l'Empire!
Parfois, il est vrai, des allusions plus précises se lisent dans les notes qui accompagnent l'ouvrage comme l'hommage rendu au savoir faire agricole alsacien comparable à celui des Flamands, des Brabançons, des Suisses et des Anglais (note 2 du 2e chant), la mention du Jura (note 14, chant 3), le portrait de sa compagne
Il est certain que le séjour à Luppach n'a pu ne pas laisser de traces dans son inspiration, mais Delille, pressé de tous côtés, ne sait encore quelle décision prendre: Luppach est avant tout une station dans la vie de l'exilé, un entre-deux et les impressions des lieux se fondent avec les regrets du passé, les craintes de l'avenir et - heureusement - la solidité de sa culture littéraire qui lui offre la planche de salut de l'intertextualité.
Lire Jacques Delille, c'est enfin découvrir plus qu'un habile faiseur de vers: le poète est aussi philosophe et novateur. Il s'implique dans ses vers, même si son expérience quotidienne est souvent sublimée. La réflexion ironique de Rivarol rapportée plus haut paraît bien injuste.
On ne peut que se réjouir de voir que l'université de Bâle a décidé de "Reconstruire Delille" en organisant un colloque internation al: Delille hors de France, les 25-27 janvier 2018 !
Notes :
Après le Père jésuite René Rapin (1621-1687) et son Hortorum Libri IV (1665), traduit à deux reprises en anglais et qui ne fut pas inconnu ni de Thomson ni de Delille ! 20 éditions officielles en 1800 ! Traduit dans toutes les langues !
Voir "La Fête de l'Etre suprême au Champ-de-Mars" de P. A. Demachy.
Louis Audiat, Un poète abbé Jacques Delille, 1738-1813, Paris, 1905.
Sur cette famille, on se reportera à l'article de D.-J. Lougnot : " À propos de la noblesse des Reiset", in : Annuaire de la Société d'Histoire du Sundgau, 2017, p.155-168.
Second chant de L'homme des champs (P. 90, édition de 1802) et sur Delille, en tète de l'édition Michaud de ses uvres complètes de 1834, page XXXVII.
Essayez avec cette orthographe :
Ernest de Neyremand, Séjour en Alsace de quelques hommes célèbres. Erasme, Voltaire,..., 1861.
Il s'agissait de Jean-Baptiste Vogelweit ancien jésuite et Professeur au Collège de Porrentruy ayant perdu son poste lorsque Porrentruy, prise en 1792 par Custine, devint le chef-lieu du département français du Mont-Terrible de 1793 à 1800. Il sera ensuite prédicateur à Augsbourg.
Registre paroissial de Ferrette. Marie-Ursule décède en novembre 1766 à la suite de la mort en octobre de son dernier fils Jean-Baptiste-Ignace né le 30 juillet de la même année.
Souvenirs du lieutenant général vicomte de Reiset: 1775-1810.-2.1810-1814.-3.1814-1836, Paris, 1899, p. 58-63.
Adolf Lätt, Ratsherr Urs Joseph Lüthy, 1765-1837: Inaugural-Dissertation...
Universität Bern, 1926 - 200 pages.
Notice biographique (note 5).
Mémoires et correspondance de Mallet du Pan, 1851, p. 334.
Voir ses uvres complètes, 1835, tome VI, notes du 2e chant de La pitié, p. 48 sur les usurpations préparées par Directoire en 1797.
Sainte Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire, Paris, 1861
Mémoires d'une femme de qualité sur le Consulat..., Paris, 1830.
Charles Goutzwiller, Le comté de Ferrette, Altkirch, 1868, p. 6.
Voir encore de P.-J.-B. Chaussard l'Examen de l'Homme des champs. Appel aux principes, ou... etc., Paris, 1801 qui donne une critique de l'ouvrage remettant en cause tout ce qu'il peut avoir de novateur, les allitérations imitatives ou significatives passant alors pour des cacophonies, les répétitions signifiantes (dans un crescendo par exemple), pour des incorrections...
https://delille.philhist.unibas.ch/colloque.html
De Montesquieu à Merkel, les grandes migrations et le projet européen.
Si la grandeur de l'Empire perdit la République, la grandeur de la ville ne la perdit pas moins.
Rome avait soumis tout l'univers avec le secours des peuples d'Italie, auxquels elle avait donné en différents temps divers privilèges : la plupart de ces peuples ne s'étaient pas d'abord fort souciés du droit de bourgeoisie chez les Romains, et quelques-uns aimèrent mieux garder leurs usages. Mais, lorsque ce droit fut celui de la souveraineté universelle, qu'on ne fut rien dans le monde si l'on n'était citoyen romain, et qu'avec ce titre on était tout, les peuples d'Italie résolurent de périr ou d'être romains. Ne pouvant en venir à bout par leurs brigues et par leurs prières, ils prirent la voie des armes : ils se révoltèrent dans tout ce côté qui regarde la Mer Ionienne ; les autres alliés allaient les suivre. Rome, obligée de combattre contre ceux qui étaient, pour ainsi dire, les mains avec lesquelles elle enchaînait l'univers, était perdue ; elle allait être réduite à ses murailles : elle accorda ce droit tant désiré aux alliés qui n'avaient pas encore cessé d'être fidèles ; et peu à peu elle l'accorda à tous.
Pour lors, Rome ne fut plus cette ville dont le peuple n'avait eu qu'un même esprit, un même amour pour la liberté, une même haine pour la tyrannie, où cette jalousie du pouvoir du Sénat et des prérogatives des grands, toujours mêlée de respect, n'était qu'un amour de l'égalité. Les peuples d'Italie étant devenus ses citoyens, chaque ville y apporta son génie, ses intérêts particuliers et sa dépendance de quelque grand protecteur. La ville, déchirée, ne forma plus un tout ensemble, et, comme on n'en était citoyen que par une espèce de fiction, qu'on n'avait plus les mêmes magistrats, les mêmes murailles, les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes sépultures, on ne vit plus Rome des mêmes yeux, on n'eut plus le même amour pour la patrie, et les sentiments romains ne furent plus.
Et ce droit accordé à tous, selon l'auteur, est une des raisons qui ont mené à la chute de Rome.
Si l'histoire ne se répète pas, il ne coûte rien de se remémorer parfois certaines situations passées et l'histoire des vicissitudes de l'Empire romain n'est sans doute pas sans intérêt en ces périodes de mutation tous azimuts que nous vivons.
Ainsi, au printemps 376, une ambassade est reçue à la cour de l'empereur pour la partie orientale, installée à l'époque à Antioche (dans l'actuelle Syrie). Les Huns, par leur poussée, viennent de provoquer l'exode de nombreuses tribus germaniques et sarmates vers le sud et l'ouest de l'Europe. Ces ambassadeurs de différentes tribus germaniques (province de Moesia sur l'estuaire du Danube - les "Wisigoths" ou Goths de l'Ouest) demandent protection à l'empereur Valens qui tenait la partie orientale. Ils arguent du fait que ces terribles cavaliers venus d'Asie ont décimé les populations germaniques ("Ostrogoths") du nord de la Mer Noire et qu'eux-mêmes n'ont vu leur salut que dans la fuite. Ils souhaiteraient s'installer sur la rive nord du Danube, dans l'Empire, vers la Bulgarie actuelle ou la Dacie. L'empereur accepte après que son conseil a longtemps discuté : certains voient en effet dans cette arrivée massive un danger, d'autres, les plus nombreux, pensent que ces nouveaux arrivants feront de bons colons et pourront mettre en valeur des territoires encore désertiques ou qu'ils seront des militaires qui accroîtront la force de l'Empire, en tout cas tous seront des contribuables supplémentaires. En définitive, ils ne pourront que participer au bien-être de l'Empire. Depuis des siècles, des Germains se sont déjà agglomérés à l'Empire, pourquoi pas ces nouveaux migrants ? En outre, l'empereur chrétien ne peut oublier le devoir de charité en accueillant ces malheureux. On les accepte donc. Des milliers de Tervinges et autres réfugiés franchissent donc pacifiquement les frontières du limes. Tout se passe cependant dans une assez grande confusion comme le rapporte l'historien Ammien Marcellin (Res Gestae). Les autorités chargées d'organiser l'arrivée des fuyards, sont débordées et de nombreux responsables surtout intéressés à tirer un profit de la situation, comme de nombreux autres citoyens romains qui s'ingénient à déposséder les nouveaux venus des biens qu'ils ont pu préserver dans leur exode. L'argent prévu pour l'hébergement est vite dilapidé ou détourné ; les réfugiés souvent totalement démunis. Leur nombre est tel qu'il serait d'ailleurs illusoire de prétendre les enregistrer. L'historien Ammien Marcellin dit qu'ils sont plus nombreux que les étincelles sortant du sommet de l'Etna ! Les inévitables premiers soulèvements parmi cette foule miséreuse ont lieu, des bagarres sont quotidiennes, des bandes font régner une certaine insécurité et les Goth totalement démunis se révoltent au début de 377, alors que d'autres Goths, prisonniers de guerre et travaillant dans les mines, se joignent à eux. L'armée romaine intervient alors, mais doit constater que cette foule en colère ne sera pas aisée à vaincre et les troupes d'occident sollicitées ne peuvent venir à l'aide car elles ont elles-mêmes fort à faire avec les incursions des Alamans. Le 9 août, a lieu la bataille d'Andrinople (aujourd'hui Edirne en Turquie) entre les Goths et des alliés (en particulier des Huns ayant déserté) commandés par Fritigern et l'armée romaine. La défaite des troupes impériales est marquante et l'empereur Valens est même tué. Ammien, compare cette bataille d'Andrinople à la célèbre bataille de Cannes ! Le successeur de Valens, Théodose, se voit contraint en 382 d'accorder des territoires aux Goths et d'accepter qu'ils y vivent suivant leurs coutumes, ce qui n'était pas, il est vrai, une exception dans l'Empire.
Cet épisode ne marque pas la fin des grandes migrations germaniques : des fuyards continuent à franchir les frontières pour se réfugier dans un Empire peau de chagrin et, en 406, c'est la frontière du Rhin qui cède. Il faudra attendre la chute (568) des Longobardes en Italie pour que ce flux migratoire s'épuise !
Certes, sur le plan politique, Rome cultivait une tradition d'ouverture qui s'ancrait dans le mythe : Énée venait de Troie et lorsque Romulus fonde la ville, la tradition rapporte qu'il fait mettre en place sur le Mont Palatin un refuge pour les exilés de tous les pays désireux de devenir Romains et de participer à l'uvre commune. Cette tradition d'ouverture demeurera un principe de la politique romaine quel qu'ait été le régime. Les Claudien, par exemple venaient de ce refuge palatin et l'empereur Claude accordera la citoyenneté au Gaulois en se souvenant des origines de sa famille. Impossible d'ailleurs de parler de nation à Rome au sens ethnique du terme. Rome est une société de droit soudée par l'empereur, l'armée, une administration, une langue unitaire (qui conserve aux autres langues leurs droits - on a pu dire que sur le plan culturel, les Grecs ont conquis Rome) et une civilisation à la fois unitaire et multiple (ainsi sur le plan religieux au moins jusque Constantin). Tout ceci a conduit au siècle d'Auguste, au grand siècle", à une richesse et un rayonnement incomparable tout en éveillant l'envie dans les populations vivant en dehors de l'Empire, en particulier des populations germaniques aussi nombreuses que diverses. Une centaine d'années avant notre ère, les Cymbres et les Teutons venus des rivages de la mer du Nord avaient été difficiles à contenir et, depuis César, on hésitait entre l'accueil des Germains et leur rejet : ainsi cet empereur pouvait à la fois chasser le roi souabe Ariovist vers les Gaules et enrôler des cavaliers germains pour ses troupes. Sous Auguste, ce sont des peuplades entières qui seront admises dans l'empire et la tradition d'une garde impériale germanique s'établit tandis qu'un peu partout des tribus germaniques reçoivent la permission de s'installer aux limites intérieures de l'Empire. Ces nouveaux venus s'intègrent, se romanisent et, en 212, la Constitutio Antoniniana leur accorde la citoyenneté.
Parallèlement, la tentation de sécuriser les territoires au moins jusqu'à l'Elbe et d'asservir la Germanie pour prévenir et en finir avec ces éternelles incursions échoue dans la forêt de Teutobourg face à Arminius. Domitien est contraint d'élever le système des limes. Cette protection aléatoire ne devait pas durer très longtemps. Dès le 3e siècle, Alamans, Francs et Saxons la débordent et vont jusqu'en Gaule, en Italie et en Angleterre tandis qu'en Orient les Goths défont l'empereur Decius en 251 Parallèlement, les germains "intégrés" jouent un rôle de plus en plus important, dans l'armée en particulier : sous Constantin sera nommé le premier général d'origine germanique et une aristocratie militaire germano-romaine se développe En 476, Odoacre, Skire d'origine (population germanique) déposera le dernier empereur d'occident : Romulus Augustulus.
Bien entendu, l'histoire ne s'arrête jamais. La fin de l'histoire est une vue de l'esprit. Si l'empire romain - particulièrement dans sa partie occidentale s'effondre - cela ne signifie pas que ses habitants sombrent dans les ténèbres que l'historiographie du XIXe siècle se plaira à imaginer. La situation sera certes difficile et les conflits nombreux sans cette force unificatrice qu'était l'empire mais, très vite, les Mérovingiens par exemple témoignent d'une civilisation qui, sur bien des plans, n'est pas décadente. Jusqu'au règne de Dagobert Ier, l'État créé par ces Francs saliens n'est pas fondamentalement différent de la tradition romaine. Après une période de troubles, l'état social du pays reprend son ancien caractère romain. Les terres du fisc impérial sont désormais sous contrôle royal et les grands propriétaires gallo-romains conservent généralement leurs domaines, organisés comme ils l'étaient sous l'Empire. Le commerce redémarre. Marseille, qui commerce avec l'Orient, reçoit des marchands syriens qui, avec les Juifs, sont les principaux commerçants du pays. Les villes de l'intérieur conservent une bourgeoisie d'affaires riche et influente.
Le trésor royal et ses tonlieux a des ressources importantes auxquelles s'ajoutent celles provenant des domaines royaux et du butin de guerre.
La vie intellectuelle est florissante : architecture, orfèvrerie, histoire, manuscrits
Il est vrai qu'à partir de 639 commence l'époque des souverains que l'hagiographe de Charlemagne, Eginhard, nomma les rois fainéants, (Vita Karoli /Vie de Charlemagne), mais c'est en premier lieu pour légitimer la prise de pouvoir carolingienne et n'a plus rien à voir avec les grandes migrations passées. Si une période de crise s'instaure, c'est parce que le pouvoir royal et l'aristocratie s'opposent et que l'argent commence à manquer. Mais si le pouvoir des rois diminue, celui des maires du palais ("major domus") augmente et une autorité est toujours en place.
Si on a parlé ensuite de renaissance carolingienne, c'est par esprit de schématisation, car cette "renaissance" n'est en fait que la continuation, maîtrisée, amplifiée dans le cadre d'un empire, d'une évolution, d'une progression qui, en réalité n'a pas cessé pendant les quelques siècles passés.
C'est toujours ainsi. En chimie, Lavoisier a défini la loi qui porte son nom : " car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications.", c'est-à-dire :
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme."
En histoire, il en va certainement de même et l'affirmation liminaire de Montesquieu peut paraître assez juste. Cependant ce qu'on appelait naguère et fort injustement "les invasions barbares" n'aura été qu'un élément de ce qui aura mené à la disparition de l'empire romain à côté de problèmes économiques, de dissensions politiques et religieuses intérieures profondes, d'intérêts divergents, d'une course à la fortune Les migrations auront été le révélateur d'un système qui ne savait plus se réformer ou retrouver les principes de sa vertu ancienne.
Si aujourd'hui certains poussent les hauts cris devant l'arrivée massive de tant de malheureux venus d'un peu partout et craignent pour l'avenir de l'Europe en songeant à élever de nouvelles limes, ils se trompent lourdement. Si ce mouvement migratoire se passait mal, la faute n'en reviendrait pas aux migrants, poussés par la nécessité, mais bien à une Europe qui depuis 60 ans n'arrive pas à penser, à agir de façon unitaire, une Europe qui n'est encore qu'une réunion d'égoïsmes nationaux et capitalistiques, hésitant encore entre des réflexes ethnocentristes et une ouverture sur une union sociale et politique.
En ce sens, l'étonnante fermeté de la chancelière allemande doit être saluée car elle est une des rares têtes politiques qui voit plus loin que les échéances électorales et néglige les populismes donnant un peu partout de la voix, dans ses propres rangs même. Oui, il faut accueillir ceux qui souffrent et veulent quitter des pays où leur avenir est compromis, il le faut, car de toute façon, ils viennent et viendront. On a du mal à imaginer Frontex repoussant manu militari tous les radeaux de la Méduse au-delà des frontières-Schengen au nom de quotas préétablis !
Comme la chancelière, il faut croire que "nous réussirons" ce challenge, mais aussi que nous ne le réussirons que dans le cadre européen. Il faut que chacun des pays membres accepte sa part, ce qui veut dire une remise à plat de la politique nationale des états de l'union européenne. Madame Merkel pressent que c'est là la seule chance pour l'Europe de se maintenir, de se développer, de s'imposer.
Elle sait que désormais l'Europe doit réagir en tant qu'union politique et sociale réelle. Elle est le seul chef d'état à développer une vision future pour cette Europe qui n'en finit pas de se chercher. La crise de l'immigration que nous vivons, elle la pressent comme le catalyseur nécessaire à une nouvelle Europe respectant certes les nations mais entièrement intégrée sur les plans politiques, sociaux et économiques, égalitaire et redistributive, assez semblable à un Empire romain ouvert aux bonnes volontés et pilier d'une pax romana nouvelle.
La seule question qui se pose est celle de la manière. Accueillir plus d'un million de réfugiés est le geste d'un pays fort ; demander ensuite (exiger) de partenaires frileux qu'ils fassent leur part du travail, n'est peut-être pas de la meilleure politique.
Mais bon ! Peut-être faut-il parfois forcer les choses !
Les Voyages de Cyrus du Chevalier Ramsay : aux sources de la franc-maçonnerie.
Les réfugiés : une solution pour la démographie allemande ?
Pourtant, il ne faudrait pas en conclure avec angélisme que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes germanique, surtout depuis les événements de Cologne qui ont agi comme un révélateur. La majorité silencieuse commence à considérer avec inquiétude le nombre quotidien des arrivants et le fait savoir ; des soubresauts agitent de plus en plus le gouvernement : la "culture de bienvenue" comme le proclament encore les médias, les prises de position de la chancelière et de quelques-uns de ses proches déplaisent de plus en plus aux chrétiens-démocrates bavarois en particulier (CSU) mais aussi à une part croissante des membres du propre parti de Madame Merkel, la CDU. La sociale démocratie, partie prenante de la coalition, après une valse-hésitation comme à son habitude, prend aussi ses distances
En France, l'accueil par le voisin de plus d'un million de migrants, est considéré avec un certain scepticisme et nombreux sont ceux qui font la fine bouche voulant moins y voir l'effet d'une générosité incomparable que l'expression d'un pragmatisme froid, d'un calcul.
L'Allemagne, disent-ils, vieillit inexorablement. Pour maintenir son économie et payer ses retraites, son système social, elle a besoin d'une masse énorme d'individus en âge de travailler immédiatement qui s'installeront à moindres frais, s'intégreront (peut-être) et apporteront ce sang neuf dont l'Allemagne des prochaines années ne pourra se passer. En fait, ajoute-t-on, les euros parcimonieusement investis actuellement dans cet accueil rapporteront beaucoup dans les années à venir. Il ne s'agit pas d'un élan altruiste mais simplement d'un placement
Ce raisonnement vaut ce qu'il vaut mais, à l'épreuve des faits, il se révèle n'être qu'une vue de l'esprit.
En 2015, ce sont officiellement 1,1 million de migrants qui ont été enregistrés dans le pays. On peut donc penser raisonnablement que ce nombre peut être augmenté de cent ou deux cent mille individus, car tout le monde n'a pu être inscrit au fichier des arrivants. Il est prévu qu'en 2016, ce nombre sera dépassé, d'autant plus que le pays attire aussi des habitants d'Europe ou d'autres régions du monde. Pourtant, cet afflux, si l'on en croit une récente étude démographique parue mercredi 20 janvier (Agence fédérale de la statistique), n'aura qu'un impact minimal sur la pyramide des âges, car si le nombre d'habitants augmente, la tendance au vieillissement ne sera pas pour autant stoppée. Elle sera tout juste légèrement ralentie. La diminution de population a pour cause principale le déficit des naissances depuis les années 70, c'est-à-dire depuis près de cinquante ans à l'Ouest et depuis 1990 (réunification) à l'Est ! La dynamique du vieillissement est propre à la génération du baby-boom (1950-1960) qui est entrée ou va entrer dans l'âge de la retraite.
Dans les années 90, l'Allemagne a déjà connu une importante vague d'immigration en provenance de l'ancienne Union Soviétique (3,2 millions de "Spätaussiedler") et cela n'a effectivement fait que ralentir faiblement le processus de baisse de la population et de vieillissement. Jusqu'en 2040, le nombre de personnes de plus de 67 ans sera au minimum de 21,5 millions (15 millions en 2013) et celui ses 20-66 ans (sans compter l'apport migratoire actuel) baissera d'un quart (de 51 millions en 2013 à 38 millions, soit 13 millions de moins). Selon l'Agence fédérale de la statistique, pour combler ce déficit, il faudrait une immigration annuelle de plus de 500 000 jeunes gens. Même si, jusqu'en 2040, 8,5 millions d'immigrés étaient acceptés dans le pays, la population des 20-66 ans diminuerait de 5 millions.
La ministre du travail (SPD) insiste pour sa part sur le fait que l'intégration réussie (FAZ, 20 janvier) sauvera le régime des retraites, mais elle passe peut-être un peu vite sur cette réussite de l'intégration et nous savons en France que c'est là le plus difficile ! Ces migrants ont tout à apprendre : langue, façon de vivre , ce qui était moins le cas pour la France ! On table en Allemagne sur une durée nécessaire de 5 ans pour parvenir à une intégration satisfaisante, ce qui semble vraiment très peu. Aux États-Unis, le fameux melting-pot ne fonctionne jamais dans les premières générations de néoarrivants. Ceux-ci passent presque toujours par une phase de ghettoïsation et ce n'est qu'une ou deux ou trois générations plus tard que ces gens rejoignent la société américaine, sachant que de nombreux migrants ne réussissent jamais le saut.
En outre, dans ces calculs prévisionnels, on omet que le regroupement familial (très discuté, il est vrai) fera que de nombreuses personnes âgées suivront leurs parents migrants et que ces gens diminueront d'autant l'apport net des nouveaux arrivants jeunes.
Certains économes pensent d'ailleurs qu'il sera impossible d'imaginer ce qui sera vraiment dans les années 2040, mais que de toute façon, les caisses de retraites profiteront peu de la nouvelle situation. En effet, si on suppose pour 2015 et 2016 3 millions de migrants et que les 2/3 intègrent le marché du travail (ce qui paraît bien hardi), leur apport pour les caisses de retraite compensera tout juste les dépenses engagées récemment : retraite des mères et départ possible à 63 ans.
Pour l'économiste Bernd Raffelhüschen : " Les immigrés actuels ne sont pas un élément de la solution, mais une part du problème croissant du financement du développement démographique." En admettant une intégration de seulement 5 ans et une entrée quasi-totale sur le marché du travail, ce chercheur prévoit même une explosion du coût des minima sociaux et des retraites de base. Les immigrés en général coûtent plus qu'ils ne cotisent auprès des assurances santé et le regroupement des familles va augmenter le nombre des personnes âgées et dépendantes. Selon lui, il faudra augmenter fortement pour tous les cotisations pour éviter l'effondrement.
L'IWF n'attend d'ailleurs que de modestes effets macroéconomiques de l'afflux des réfugiés en Allemagne. Pour 2017, 0,3% de croissance, qui ne sera le fait que des dépenses consenties pour venir en aide et intégrer ces populations. Pour 2020, on pense que si l'offre sur le marché du travail augmente encore et que l'intégration suit bien son cours une progression un tout petit peu plus forte pourra se faire sentir. Beaucoup de si quand certains pays européens élèvent des frontières !
À côté de ces pronostics discutables, de nombreux problèmes bien réels se profilent pour beaucoup de jeunes gens venus en fait à la recherche d'un Eldorado dans tous les domaines. Ces générations face book ne sont pas prêtes à accepter n'importe quoi ni n'importe comment alors que ce qui les attend souvent ce sont des salaires inférieurs pendant des années dans le meilleur des cas (les salaires pour les habitants de l'Ouest et de l'Est ne sont pas encore totalement égaux !) et des emplois peu valorisants. De toute façon, celui qui parle peu ou insuffisamment la langue gagne en moyenne 30% de moins ! On envisage d'accepter que les patrons puissent employer ces nouveaux arrivants, pendant la phase d'intégration, à des salaires inférieurs au SMIC (8,5 euros). Cette mesure risque de conduire à une impasse. Je parraine Mustapha, un jeune Gambien. Il a trouvé un emploi dans une pizzeria mais ni le salaire (8 euros de l'heure, ni les conditions de travail - 42 ou 44 heures ne lui conviennent. Il a rêvé d'autre chose et souhaite commencer des études Un autre migrant venu d'Albanie, peintre dans son pays a trouvé un travail chez un artisan : il gagne 900 euros nets. Difficile de vivre correctement avec un tel salaire quand on a cru qu'avec un métier et du courage on peut tout en Allemagne
En bref, le coup de poker de la chancelière ne pourra se révéler positif que si l'Europe - c'est ce qu'elle a toujours dit - fait (enfin) cause commune pour résoudre le problème de l'immigration, d'une immigration qui ne sera pas à stopper avec des frontières comme jadis les limes n'ont jamais arrêté les populations germaniques. Angela Merkel, qui garde le cap, se révèle tout à coup comme profondément européenne, mais il faut une Europe unie sur tous les plans, politique, économiques et sociaux. Il faut une nouvelle Europe si on veut qu'elle survive. Il n'est pas sûr que les égoïsmes nationaux, les frilosités d'un personnel politique qui ne cherche qu'à être réélu et se moque des grandes idées, des grands projets la suive.
En France, comme on a argué d'un froid utilitarisme pour expliquer la générosité allemande, on trouvera bien à dire qu'on ne veut pas d'une Europe unifiée par la volonté de l'Allemagne !
Un "pauvre diable" en pays allemands : l'écrivain, maître de langue et professeur royal Jean-Charles Laveaux (1749-1827)
University of Oxford, 1974, mais qui ne traite vraiment que se sa carrière (tapuscrit en langue anglaise).
En 2017 paraîtra chez Honoré Champion la monographie complète que j'ai consacrée à cet auteur : Jean-Charles Laveaux, un aventurier littéraire (650 pages).
Archives de la Creuse, H 284-521.
J. B. L. Roy-Pierrefitte, Études historiques sur les monastères du Limousin & de la Marche, op. cit., volume 1, p. 22 et suivantes.
Les moines de Bonlieu commanderont en 1786 un tableau au peintre Delaporte, peintre de Lyon !
Michelle Magdeleine, "Reisen und Irrfahrten", in : S. Beneke et H. Ottomeyer, Die Hugenotten - Zuwanderungsland Deutschland, 2005. La Suisse était la plaque tournante et il y avait 2 chemins principaux vers l'exil : Bâle-Germersheim-Francfort (puis le Brandebourg, la Hollande ou Hesse-Cassel) / Schaffhouse-Heidelberg-Bayreuth-Ansbach-Brandebourg).
Selon le journaliste berlinois August-Friedrich Cranz dans ses Bockiade (1782), il aurait d'abord erré en France, vivant de leçons, puis, à la suite d'affaires troubles, il aurait dû fuir avec son épouse en Suisse
Archives de l'Université de Bâle, Ki. Ar.g.I 13.
Archives de l'Université de Bâle, Ki. Ar.g.I 13, fol. 226-242.
Archives de Bâle, (Staatsarchiv) PA141aF1, fol. 217. Le parrain est Jean-Jacques Thurneysen "docteur en médecine" et les marraines : Marguerite Lindmeyer et Marie Judith Gueimüller (Geymüller, apparentée aux banquiers bâlois et autrichiens). Marie Judith Frey fille d'un officier au service de la France épouse en 1743 Reinhard Geimüller (ou Geymüller) dont la famille est liée aux Battier, Sarasin, Bernoull, Iselin, le patriciat financier et intellectuel de la cité
Archives de Bâle (Staatsarchiv Basel), Universitätsarchiv, Schuldsachen (1589-1795), VI, 2.
Au nord des Alpes, seules les galeries de Vienne et de Dresde pouvaient lui- être opposées.
Voir plus loin le prospectus de la pension qu'il ouvre à Berlin, où il donne sa bibliographie et la part prise dans cet ouvrage. Le contentieux qui a dû l'opposer à Mechel fait qu'il revendique exactement sa part !Voir Meusel, Das Gelehrte Teutschland, Lemgo, 1797, volume 5, p. 103, et J.-M. Quérard, La France Littéraire, Paris, 1834, volume VI, p. 11.
Thomas W. Gaehtgens et Louis Marchesano, Display & Art History: The Düsseldorf Gallery and Its Catalogue, Numéro 11, The Getty research Institute, Los Angeles, août 2011, p. 32 et suivantes. Les auteurs considèrent que les notices de Laveaux sont bien supérieures aux descriptions de Frédou de la Bretonnière et manifestent un vrai sens esthétique.
Immédiatement reproduit à Stuttgart (chez K. Wittwer).
1753-1813. Becker à Bâle a collaboré aux Ephemeriden der Menschheit d'Isaac Iselin et à plusieurs périodiques. Il a aussi traduit de nombreux ouvrages (voir : Ulrich Im Hof Isaak Iselin und die Spätaufklärung). En 1780, il publie chez Breitkopf à Leipzig la première livraison de son intéressant Magazin der neuern französischen Literatur dans lequel il évoque rapidement la traduction de Laveaux (mais d'aucun de ses livres par la suite).
Wielands Briefwechsel, Vol. 7.2, Akademie Verlag, 1997.
Dernièrement par Philippe Farget (Kindle éditions) !
Martin German, op. cit., p. 18. Les Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, septembre 1780, font une recension très positive de la traduction de Becker et trouvent 2 fautes d'impression dans le texte latin. Pas un mot de la version française.
P. 464. "Par M. Delaveau".
Voir Jacques Chomarat, "L'Éloge de la Folie et ses traducteurs français au XXe siècle", in : Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1972, Volume 1, Numéro 2, pp. 169-188. L'auteur place la traduction de Laveaux au niveau de celle, médiocre, de J. et A.-M. Yvon, Éloge de la folie, Paris, 1967.
Belle qualité de l'édition (papier, caractères Haas, frontispice gravé et dessiné par Saint-Quentin. Chaque chant est orné d'une gravure et par un cul-de-lampe ). Republié à Avignon en 1788 chez Joseph Guichard, puis l'an VII à Paris, par Laveaux lui-même.
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste - volume: 32,1, Leipzig, mars-avril 1792. Frédéric Weinmann en fait un traducteur mineur, qu'il cite simplement sans s'attarder sur lui : "Les premiers traducteurs de la littérature allemande", in : Frontières, transferts, échanges transfrontaliers et interculturels, éd. par P. Bélar et M. Grunewald, 2005, p. 326.
Article reproduit dans L'esprit des journaux français et étrangers, Paris, 1783. En 1784, sans nom d'auteur, on donne une réédition corrigée du Musarion de Laveaux (Société littéraire typographique, Kehl). Lorsque la Décade Philosophique et Littéraire consacre une série d'articles à Wieland ("Notice sur la vie de Wieland", No 17 et 19, T. 17, 1798), il n'est pas fait état de la traduction de Laveaux.
Les ouvrages bibliographiques du temps donnent une version française à Bâle en 1783, parfois 1784 à Bâle toujours mais anonyme et une version publiée à Paris en 1785 par M. Delaveau. Nous n'avons pu nous procurer que l'édition (apparemment inconnue) de Bâle, "chez Thourneisen le fils" 1784-1785 (2 tomes).
L'original, Siegwart, eine Kloster Geschichte, est paru en 1776. Impossible de savoir quand cette traduction a été réalisée. En 1784-1785, J.-J. Thurneisen donnera une contrefaçon des uvres Complètes de Voltaire qui se fait alors à Kehl, puis les uvres de Frédéric II, sur lesquelles nous reviendrons.
Parution en 1776 pour le premier tome, deux années après Werther et chez le même éditeur ! Goethe, lui-même, rapproche les deux ouvrages dans Dichtung und Wahrheit (Goethes Werke, Berliner Ausgabe, Bd 13, Berlin und Weimar, 1971, p. 890).
Werther und seine Zeit, 1896.
1er juillet, 1785, Luxembourg.
27 septembre 1785.
Rouget de Lisle, ami du maire Dietrich, et alors en poste à Huningue, excédé par les attaques de Laveaux, se fait le rapporteur de ces bruits dans la Feuille de Strasbourg en juin 1792.
Ce que rapporte entre autres Dieudonné Thiébault, Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles, et ses amis littérateurs et philosophes. 3e édition, Paris, 1813, T. IV, p. 107.
André-Pierre Le Guay de Prémontval, Préservatif contre la corruption de la langue Françoise, 1761.
Laveaux l'indiquera aussi dans le prospectus qu'il fait publier le 30 octobre 1780 dans la Gazette littéraire de Berlin pour s'annoncer.
Il s'agit du pasteur luthérien, pédagogue, et auteur Johann Siegmund Stoy (1745-1808) que le Conseil de la ville de Nuremberg blâma en 1771 par deux fois pour avoir protesté contre la cherté des grains. En 1782, en conflit avec sa hiérarchie, il quitte son pastorat de Henfenfeld et devient professeur de pédagogie à Nuremberg. On se reportera à Anke te Heesen, Der Weltkasten. Die Geschichte einer Bildenzyklopädie aus dem 18. Jhdt, Göttingen, 1997.
À partir de fin 1779-début 1780, on pouvait acquérir à Nuremberg, gravures et feuilles de texte. Laveaux n'aura eu qu'à transposer en français. L'annonce est certainement de Laveaux.
Basedow, Zur elementarischen Bibliothek. Das Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker, Altona, Bremen, Tome 1, 1770.
La Prusse Littéraire, Berlin, 1790, article "La Veaux". C'est aussi ce que dit sa lettre (voir supra) à Johann III (Jean III) Bernoulli.
Suit sa bibliographie, le nom des personnes qui l'ont recommandé, son adresse.
Il est vrai qu'une telle annonce dut être fort onéreuse.
Lettre de J.C. de la Veaux à Messieurs les Pasteurs, in : Gazette littéraire de Berlin, novembre 1784.
Des fragments de cette lettre (disparue), écrite pour faire cesser la "guerre" qui va l'opposer aux pasteurs et académiciens du Refuge attaqués en raison de leur mauvais français et de leurs responsabilités dans la dégradation du français de Berlin, sont reproduits dans la Gazette de novembre 1784 pour en discuter les termes et en souligner les fautes.
César, qui se pique de littérature, propose une souscription en 1783 pour la traduction de "sa" traduction de l'Histoire des Germains de Schmidt dans les Berichte der allgemeinen Buchhandlung der Gelehrten (10e livraison).
Préface aux Voyage, p. V-VII.
Qui ne paraîtra qu'à partir de 1785.
Un échec est programmé, échec dont Dieudonné Thiébault (Mes souvenirs , op. cit.) rapporte la genèse : "[ ] ce nouveau venu (Laveaux) forme dans Berlin, comme feu Prémontval, une pension de jeunes gens. Peu de temps après, il tire les oreilles et renvoie à coups de pied, pour cause de négligence et de paresse, un fils de son hôte, reçoit en conséquence ordre de quitter son appartement, et compose, pour s'en venger, sous la forme d'un roman, une historiette qui n'est qu'un ramassis de tout ce que la médisance ou la calomnie a pu débiter sur le compte de sa propriétaire, femme jolie ou belle, très aimable et d'une société très douce, honnête et sûre."
Élisabeth César, d'une vieille famille huguenote (Les Le Veaux !) qui aura neuf fils et sept filles, dont la très célèbre Pauline Wiesel, reçoit aussi dans ses appartements la bonne société berlinoise. On ne compte pas le nombre de ses amants réels ou supposés. Elle aurait tenté de séduire son locataire, si l'on s'en rapporte aux pamphlets !
Voir F. Labbé, Berlin, le Paris de l'Allemagne, Editions Orizons Universités,2011.
Laveaux s'est vite lié d'amitié avec Henri Le Catt, lecteur et confident de Frédéric II.
En cela, il est totalement différent de son détracteur, Claude-Étienne Le Bauld-de-Nans, le directeur de la Gazette Littéraire de Berlin, qui se contentera d'être "poète" de cour et regrettera d'avoir mis son inspiration "sous le boisseau". Voir Les écrivains et l'argent, édité par O. Larrizza, Orizons, Paris, 2013.
Gazette littéraire de Berlin du 8 novembre 1784. Laveaux a dit tout le mal qu'il pensait de Le Bauld dans plusieurs textes et celui-ci réplique avec aigreur.
Plus tard, la Gazette évoquera le "ténébreux attelier" d'où sortent ses productions (supra). Son second est décrit comme hâbleur, grand bavard. Il n'a pas été possible de l'identifier.
LI a 726, f. 115-117. Sur la pochette conservant ces lettres (écriture ancienne) : "à Jn Bi à Bn 1782. De M. de la Veaux Prof. De Lang. Fr. à Berlin à pré. À Stoutgard Et un grand partisan de la Révolution à Strasbourg et à Paris".
Il s'agit de Michel Gröll, libraire à Varsovie et éditeur des Voyages de Bernoulli. Laveaux est l'auteur de la traduction et de l'introduction (T. 1). Il fait partie des souscripteurs.
Bibliothèque universitaire de Bâle. Manuscrit Lla 702, fol 67 s.
Bernoulli, qui parle français et écrit dans cette langue, fournit un texte en allemand. Laveaux - seul ou avec d'autres - traduit. Son travail est revu par l'auteur et, dans une série de rencontres, auteur et traducteur se mettent d'accord sur la version finale de la traduction. Laveaux a peut-être aussi revu sa traduction du célèbre livre de Wilhelm von Dohm, Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, 1781-1783.
Il n'a cependant, de son temps à Bâle, jamais fréquenté - même en simple qualité de visiteur - la Société Helvétique, Cf. François de Capitani, Die Gesellschaft im Wandel ; Mitglieder und Gäste der Helvetischen Gesellschaft, Stuttgart, 1983. Il ne paraît pas non plus avoir fréquenté les sociétés berlinoises du Montagssclub ou de la Mittwochsgesellschaft (Gedike, Biester, Dohm, Mendelssohn, Nicolai ). Il ne fréquentera pas plus les loges maçonniques. Il n'a probablement pas non plus participé à la Lesegesellschaft de Feßler. Voir Max von Oesfeld, Zur Geschichte des Berlinischen Montags-Klubs", in: Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde, 16, 1879. C'est aussi un trait de caractère constant: il est un homme seul.
F. H. Meyer, "Der deutsche Buchhandel gegen das Ende des 18. Jahrhundert und Anfang des 19.", in: Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels, Leipzig, 1898, volume 7.
Cité par Martin German, op. cit., p. 11.
Voir Eckhardt Höffner, Geschichte und Wesen des Urheberrechts, München, 2010. Voir aussi L. Fertig, Buchmarkt und Pädagogik, 2003.
Réédité par F. Labbé, Presses Universitaires de St Étienne, 2010.
Viviane Rosen-Prest (L'historiographie des huguenots en Prusse au temps des Lumières. Entre mémoire, histoire et légende : J. P. Erman et P. C. F. Reclam. "Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés françois dans les Etats du Roi" (1782-1799), Paris, Champion, 2002..) rappelle que ces membres forment une oligarchie quasiment inamovible et que la Colonie, sous certains aspects, conserve le caractère d'un État dans l'État (p. 42 et suivantes).
Voir mon étude Berlin le Paris de l'Allemagne, Paris, 2011. On lira aussi les lettres au roi de Voltaire et d'Alembert sur la décadence de l'esprit français dans la Vie de Frédéric II, op. cit., 1788, tome IV, p. 234 et suivantes.
Avec son journal La Gazette littéraire de Berlin (cf. Labbé, op. cit. Berlin. Le Paris de l'Allemagne).
Ces passages sont extraits de sermons du pasteur Erman dans leur majorité et aisés à reconnaître pour les Berlinois. Dans la même veine, il distribuera dans Berlin une Lettre d'un soldat prussien malheureusement introuvable.
À Strasbourg, chez Treuttel, Avec Approbation et Privilège du Roi, 1788, tome IV, p. 79.
Op. cit., volume 4, p. 110-111.
Entretiens avec les enfans sur quelques histoires de la Bible tirées de l'ancien et du nouveau Testament, Berlin, 1782.L'original allemand est dû à un théologien, Johann Ferdinand Roth (1748-1814), un esprit philosophique et éclairé comme il n'est pas rare de le voir chez des ecclésiastiques protestants.
Quérard indique en 1830 une édition de 1808, chez Weigel et Schneider, Nürnberg, avec 25 estampes et un lexique français-allemand.
Op. cit., p. 232.
Ce dictionnaire a une longue histoire et la mention "2e édition" intrigue. L'éditeur Wever a trouvé en Laveaux l'associé susceptible de reprendre la première édition d'un ouvrage imité du Catholicon de Schmidlin et de la développer. Laveaux a accepté cette tâche susceptible d'être d'un bon rapport.
Cette amitié est probable même si les preuves définitives manquent encore. La lettre amicale de l'abbé (Collection de Froidcourt) adressée de Berlin le 28 mai 1782 lui était peut être destinée. Raynal aurait intercédé - en vain - auprès du roi pour qu'il obtienne un emploi dans un collège.
Les pasteurs Erman et Reclam sont très intéressés par cette visite. Voir V. Rosen-Prest, op. cit. On parle même, au début, d'une collaboration possible
Né à Salernes dans le Var, en 1792, le 19 novembre, il fut chassé de Berlin pour jacobinisme.
Ce bruit court en France et en Europe dès la première édition. Voir Hans-Jürgen Lüsebrink, Anthony Strugnell, L'Histoire des deux Indes : réécriture et polygraphie, Oxford, Voltaire Foundation, 1995.
C'est à cette époque qu'il compose son fulminant Essai sur les prêtres et la prédication publié en 1785 (voir plus loin).
Alors que "la France est encore quelque chose de pire qu'un pays de sauvages et d'anthropophages [ ], des ogres altérés de sang et qui font frémir la nature", p. 48.
L'image du Français, petit maître arrogant, règne en Allemagne chez les intellectuels et on évoque ces "Windbeutel", ces Français pleins de vent (F. Labbé, Berlin, le Paris , op. cit.) !
Laveaux souffre du "complexe de l'exilé" : l'image du Français dans les pays allemands n'est pas bonne et il cherche continuellement à prouver qu'il est aussi d'autres Français, dignes d'admiration : intelligents, sérieux, travailleurs, tout comme lui. Voir : Correspondances maçonniques, Honoré Champion, Paris, 2016.
Il a certainement beaucoup plus écrit. La Gazette (17 janvier 1785) ironise sur "ces pitoyables vers envoyés en gros paquets à 125 milles d'ici? Oh! La belle équipée!"
Noël et Delaplace, Leçons de littérature, 1802, t. 1, p. XXIV.
Il se situe, assez étonnamment, lui qui écrit des "tableaux", dans la lignée de Molière.
Charles Philippe César s'est aussi beaucoup intéressé à Hogarth.
Sans grand style, il écrit: "En réfléchissant à mon projet, je me suis dit [ ]". On lui reprochera constamment ce style et ses incorrections.
Il s'appuie à ce sujet sur Rousseau qu'il cite.
En revanche, ses personnages plutôt positifs ont de prénoms modernes : Louis, Julien, Thérèse , comme si l'auteur associait les défauts qu'il critique au passé et les vertus qu'il prône à l'avenir.
dans le roman, car dans la vie, son attitude sera plus ambiguë et, parfois, il laissera libre court à une réelle misogynie. Toutefois, sous la Révolution, il aura des initiatives allant dans le sens d'un réel féminisme (vote des femmes) et il associera sa fille à ses recherches lexicographiques.
Le Gascon que secourt Goutherz, le bon Allemand, vient de Châtignac en Poitou ! Le tableau "Les consolations" est la confession d'un "moi" qui usant de l'anaphore (Quand je vois ) passe en revue toutes les situations de vie pour n'y voir que violence, tracas, mépris, méfiance, fanatisme, égoïsme et conclut à chaque fois par préférer l'honnête modestie de son état.
Sur ce point de la sexualité, Laveaux considère que l'union d'un jeune homme et d'une jeune fille, leur amour étant naturel, voulu par la nature, sa condamnation est absurde. En revanche il condamne les "séducteurs" qui font le malheur des filles. Là encore, son expérience et la décision qu'il a prise d'assumer "sa faute" transparaissent !
On peut lire dans ce tableau quelques lignes qui peuvent avoir un rapport avec son expérience chez les César : ces enfants gâtés ne respectent personne et sont rétifs à tout effort : "Malheur au domestique, malheur au précepteur qui oserait les contredire ou ne pas se soumettre avec respect à tous leurs caprices."
Ce tableau (qui sous plusieurs aspects est assez parfait) se clôt par une condamnation de la légèreté française : "Nous sommes enfin parvenus à nous habiller selon notre caractère, en Arlequin".
Éphémère journal de très bonne tenue (continuation du Mercure Suisse) dirigé avec Jean-Pierre Heubach et édité à Lausanne, p. 121-133, et 161-168 (septembre 1784). Sur le personnage intéressant de Chaillet : Charly Guyot, La vie intellectuelle et religieuse en Suisse à la fin du XVIIIe siècle, 1946.
Johann-Christoph Adelung l'indique en vente dès 1782: Allgemeines Verzeichniß neuer Bücher mit kurzen Anmerkungen, 7e vol. Partie 1, Leipzig, 1782.
Annonce parue dans le livre de Johann August von Starck, Versuch einer Geschichte des Arianismus, F. Maurer, 1783.
Il est précisé qu'il s'agit d'une édition corrigée et augmentée de gravures. L'édition originale n'a pu être localisée.
Un littérateur estimable de Berlin, directeur des manufactures royales, Étienne Mayet a offert à Laveaux le quatrain qui illustre le portrait : Si l'auteur que ton il contemple/Est un critique habile et rempli d'enjouement/ Ses écrits sérieux et pleins de sentiment,/Nous prouvent qu'au précepte il sait unir l'exemple.
La préface est non seulement convenue, mais assez maladroite. Rares sont ceux qui peuvent croire en un Laveaux solitaire et retiré. En outre, la pirouette finale fera rire.
Kant n'écrira pas différemment (même s'il s'exprime métaphoriquement), on connaît sa célèbre réflexion finale (Critique de la raison pratique, 1788) : Deux choses emplissent le cur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, plus la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Je les vois devant moi, et les relie absolument à la conscience de mon existence.
Suivent des exemples historiques de cette barbarie. La référence personnelle est ici sensible.
On retrouvera toutes ces idées dans ses écrits et rapports rédigés plus tard quand il sera responsable des services hospitaliers de la Seine par exemple, mais aussi dans certains de ses discours révolutionnaires.
On s'est beaucoup intéressé au traité de Cesare Beccaria (Del deliti et delle pene) à Berlin et la Gazette littéraire en parle abondamment en janvier 1766. Voir F. Labbé, La Gazette littéraire de Berlin, Honoré Champion, 2004.
Le texte se continue bien entendu par une gradation : "Frédéric, Catherine ! Noms à jamais chers à la terre [ ]".
Volume 8, 1783. Ce portrait se trouve dans la préface aux Ländliche Nächte de Mylius.
ADB, 1784, p. 128-129.
Mais là aussi, on peut penser que décerner des couronnes à Laveaux, le pourfendeur du mauvais français d'Allemagne (mais aussi ce professeur qui pointe du doigt la médiocrité française en général !), entre dans la stratégie de la réévaluation de la culture, de la pensée et de la langue nationale.
Volume 2, no 111, p. 270-271.
Édité par Christoph Martin Wieland, Friedrich Justin Bertuch, Karl Leonhard Reinhold, Karl August Böttiger.
P. 25. Leçons destinées aux jeunes gens pour une conduite sage et heureuse de leur vie. Les Göttingische gelehrten Anzeigen et l'Erfurtische gelehrte Zeitung de 1784 sont également très positifs dans leurs commentaires.
J.C. Laveaux, Vie de Frédéric II, T. IV, Strasbourg, Treuttel, 1788 et dans le T. VII (1789).
Sur ces courriers, voir Laveaux, Vie de Frédéric II, op. cit. note XL.
Vie de Frédéric II, T. IV, Strasbourg, Treuttel, 1788 et dans le T. VII (1789).
Selon Thiébault (op.cit., p. 111) Frédéric aurait manifesté le désir de rencontrer Laveaux, mais il demanda conseil à Thiébault. Celui-ci ne s'étant pas montré très enthousiaste et lui ayant dit que "ce n'est point la crème qui sort de mon pays ; non, Sire, ce n'en est que l'écume", il renonça à son projet.
La Gazette ironise sur ce titre en février. Tous ces témoignages sont en bonne place dans la Vie de Frédéric II, roi de Prusse, op. cit.. Frédéric attend de ses auteurs une pratique raisonnée de l'autocensure !
Prusse Littéraire, T. III, p. 432. Le ministre des affaires ecclésiastiques est Abraham von Zedlitz, l'autre ministre étant Hertzberg.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, (Dahlem) I. HA Geheimer Rat, Rep. 9 Allgemeine Verwaltung D 8 Refugiertensachen Fasz. 25 u. a.: de la Veaux wird Professor, 1783.
Le Bauld-de-Nans rira de "son fief du royaume de Chypre".
Il paraît ensuite en 2 volumes, Berlin, 1784-1785. La Gazette en parle alors (1784, p. 45). Le tome III paraîtra en 1787 chez Wever, qui redonnera une édition complète en 3 volumes en 1797. En 1786 encore, Laveaux signe ses Essais philosophiques sur les prêtres et la prédication (Berlin) des initiales J.C.D.L.C.P.R.A.B (Jean-Charles de Laveaux professeur royal à Berlin).
Vie de Frédéric II, op. cit., p. 247, note 41, Strasbourg, 1787. Laveaux historien parle de lui-même à la troisième personne.
Op. cit., Treuttel, Strasbourg, édition de 1787, T.IV, p. 74.
Correcteur royal ! Un billet de Mérian adressé à Laveaux atteste de cette fonction.
Bauzée, qui a participé à l'Encyclopédie, a publié en 1767 sa Grammaire générale, dont le sous-titre est : "Pour servir de fondement à l'étude de toutes les grammaires appliquées ou particulières", ce que Laveaux fera abondamment.
L'idée d'une grammaire française n'est alors qu'en plein surgissement. André Chervel, Histoire de l'enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, 2006.
Ce genre d'approche n'est pas nouveau. En France, où la question de l'acquisition de l'orthographe est centrale dans l'enseignement du français (cf. André Chervel, Histoire de l'enseignement, op. cit.), depuis les années 1730, la cacographie est une approche (avec la dictée et la copie) très en faveur.
Il s'agit du poème didactique en 6 chants l' "Art de la Guerre", de Frédéric II, qui est loin d'avoir les qualités que lui prête flatteusement Laveaux ! Dans les cahiers suivants, il révisera d'ailleurs son opinion au sujet de cette impossibilité qu'auraient les étrangers de bien écrire le français.
Manuela Böhm, "Berliner Sprach-Querelen. Ein Ausschnitt aus der Debatte über den Style Refugié im 18. Jahrhundert", in: Ein gross vnnd narhafft haffen: Festschrift für Joachim Gessinger, publié par Elisabeth Berner, Manuela Böhm, Anja Voeste, 2005, p. 136.
Ces réflexions ne sont en effet point trop éloignées de ce qu'il pensait lui-même dans son écrit De la littérature allemande, car s'il souhaite améliorer le français à Berlin c'est bien d'abord parce que cette langue restera pour lui longtemps encore la langue universelle dont une puissance montante comme la Prusse aura besoin avant que l'allemand ne soit enfin cette langue qu'il espère pour plus tard.
Hormis, dit-il, le Journal de Paris et le Journal encyclopédique (qui ont parlé de ses uvres !)
Ces remarques sont justes mais Laveaux ne tente pas de voir si la situation française est vraiment différente.
Il n'est pas sans ignorer les origines d'Erman et Reclam ! Dans son Essai philosophique sur les Prêtres (1785), il proposera des solutions.
Les livres en français représentent 1,1% de l'offre à Leipzig entre 1701 et 1710 (130) mais 13,1% pour la période 1761-1770 (1738 livres) (cf. André Chervel, Histoire de l'enseignement, op. cit., p. 136).
Tout un champ d'activité s'ouvre à son ambition : il va fournir un dictionnaire, une grammaire ! Il utilisera pourtant Des Pépliers qui, dès 1762 - loin d'être le premier - joint à sa grammaire un "recueil de bons contes et de bons mots, tirés des plus beaux esprits de ce tems"!
"La haute noblesse adopte plus difficilement ces bruits ridicules. On peut dire en général qu'elle a beaucoup de goût et de connaissances, et qu'elle parle français avec une pureté qui ferait honte à bien des Parisiens." (p.8)
"Un grand malheur pour les États, c'est lorsque les erreurs religieuses et l'intérêt de ceux qui les enseignent sont étroitement liés avec la constitution politique. Les prêtres sont plus intolérants et plus persécuteurs que jamais."
Même si ce passage fait référence au "Droit des gens" dont on parle volontiers à Potsdam, on doit reconnaître que ce genre de réflexion n'est pas nouveau chez Laveaux et fait mieux comprendre son attitude future sous la Révolution. S'il est d'abord préoccupé de son propre bien et de celui des siens (il peut être assez "courtisan"), le fond de ses idées correspond assez à l'attitude qu'il aura après son retour en France au printemps 1791.
Les membres du Refuge, prussiens de nation, sont donc exclus !
Laveaux ne semble pas s'être rendu compte que la plupart des psaumes sont empruntés à Marot.
Il traduit deux prônes du pasteur philosophe Zollikofer (en illustration de son Essai philosophique sur les prêtres et la prédication (1785) et en fait imprimer plusieurs autres en 1799 !
Ce "meurtre" se fera en plusieurs étapes et sur de nombreuses années, retardé par la situation internationale, par la Révolution, les guerres napoléoniennes , mais il commence au moins avec Lessing, avec le Sturm und Drang
Il donne son plan d'études à partir de la p. 85. Claude Dumanoir, Maître de langue à la cour de Weimar, fera paraître ses Anecdotes parisiennes à l'usage des écoles françaises, Jena, Mauke, 1785, en les dédiant à Laveaux.
Laveaux qui est en relation avec Plomteux pour sa traduction de l'Histoire des Allemands connaît évidemment l'Encyclopédie méthodique publiée par cet éditeur. L'évolution de son savoir grammatical, stylistique voire philosophique tient beaucoup à la découverte de cet ouvrage fort bien fait.
En 1787, à Stuttgart, il oubliera avoir pris le contre-pied de Rivarol et écrira dans le Discours préliminaire de ses Leçons méthodiques de langue française pour les Allemands : "La langue française, la plus claire de toutes les langues modernes, par la nature de ses constructions ; la plus douce par la moelleuse harmonie de ses sons ; [ ]"
Malheureusement, pour développer ses idées, Laveaux ne sait pas forger une terminologie claire et il conclut ses exemples et démonstrations par un principe qui fera rire par la lourdeur de l'expression : "Présenter les parties principales sur le devant, rapprocher autant qu'il est possible de chacune de ces parties toutes les idées qui les modifient : voilà les deux grands principes de la langue française, voilà les deux véritables sources de sa clarté, de sa netteté, de sa précision." (p. 71)
On retrouve chez lui beaucoup d'expressions qui sont dans le Cours de sciences sur des principes nouveaux, etc. de Claude Buffier, l'inspirateur de Restaut et de De Wailly, dont il connaît sans doute la grammaire, à moins qu'il n'ait, là encore, utilisé certains articles de l'Encyclopédie qui se sont nourris de cet ouvrage.
Prudent, il ajoute en note : "Je ne doute point qu'il ne se trouve quelque bonne ame dévote, quelque théologien habile qui ne crie ici à l'athéisme. On est athée dans tous les pays du monde quand on ne pense pas comme les théologiens gagés. Je dis donc ici, comme je l'ai dit ailleurs, que nous ne pouvons douter de l'existence de Dieu ; c'est-à-dire d'un principe souverainement bon et souverainement sage qui gouverne le monde ; mais j'ajoute que la nature a mis devant son sanctuaire un voile impénétrable qui le cache à notre faible intelligence ; j'ajoute que la matière n'est pas si vile que l'ont faite les théologiens ; [ ]
Une des leçons de l'Émile, de Jean-Jacques Rousseau. Plus loin, il écrit : "Il ne fallait pas faire quitter à un enfant son cheval de bois ou sa poupée, pour lui apprendre ce que c'est que Dieu ; il fallait commencer par lui apprendre ce que c'est que son cheval et sa poupée, et le conduire de-là insensiblement jusqu'à l'idée de l'Etre suprême ; [ ]" (p. 39). Cependant, Laveaux réclame presque immédiatement que la sensibilité soit aiguisée le plus tôt possible par l'initiation à la religion.
Cours théorique, p. 46. Suit un passage où il s'insurge violemment contre tous ces parents qui condamnent leurs enfants à l'erreur par routine et par absence d'esprit critique.
Si ces principes laissent entrevoir leurs sources possibles (Beauzée, Condillac, l'Encyclopédie, Dumarsais ), la monographie d'Anacharsis Combes Histoire de l'école de Sorèze, 1847, prouve que les préoccupations de certains collèges bénédictins recouvrent entièrement les idées pédagogiques de Laveaux.
R. Niklaus, "L'esprit créateur de Diderot", in : Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 1968, Volume 20, numéro 20, pp. 39-54.
Il s'agit bien entendu d'un cliché littéraire. La Correspondance littéraire du 1er février 1755 écrivait déjà : "Lorsque le génie agit dans ces hommes divins (les créateurs), une vive chaleur s'empare d'eux ; travaillés par une fermentation universelle et vigoureuse, possédés par le plus fort enthousiasme, ils produisent sans volonté et nécessairement les choses qui font l'admiration de l'univers". Laveaux donne aussi des conseils personnels : "J'ai remarqué que la matinée était plus propre à la réflexion ; et que le soir l'était davantage à la composition [ ]".
Une phrase reprenant mot pour mot Madame de Genlis, reformulant Épicure dans ses Annales de la vertu ou cours d'histoire à l'usage des jeunes personnes, Paris, 1781. Mais c'est un cliché qu'on retrouve alors souvent (cf. Les mémoires d'un honnête homme de l'abbé Prévost )
p. 50.
P. 200. Il a "choisi" pour sa démonstration un passage du Premier mémoire sur l'éloquence, de l'Académicien (1774) et en souligne les défauts.
Nicolai, Briefe, die neueste Literatur betreffend. VII, Berlin,1760, p. 160. Cité par M. Böhm, Sprachen-Wechsel, Akkulturation und Mehrsprachigkeit der Brandenburger Hugenotten vom 17. Bis 19. Jahrhundert, De Gruyter, Berlin, 2010. p. 91.
Ewald von Hertzberg est parfois proche de l'Aufklärung, tout comme il est certainement francophile (sans doute moins qu'anglophile), mais il est avant tout un patriote. Anacharsis Cloots lui adressera une célèbre et ironique lettre (cf. F. Labbé, Anacharsis Cloots, le Prussien francophile, 2000)
Sur cette affaire et sa suite (Eusèbe), on se reportera à l'article du professeur Jürgen Storost, "Laveaux und sein Eusèbe", in : In Memoriam Vladimiro Macchi, Romanistischer Verlag, 2008, p. 228 et suivantes.
Dans sa Vie de Frédéric II (édition 1788, p. 86-87), Laveaux évoquera la censure en Prusse en insistant sur le fait que les (rares) interdictions n'existent que pour, par exemple, répondre aux réclamations de cours ou de grands personnages qui se sentent attaqués, mais qu'en réalité, elles sont quasiment sans suite.
Le texte se trouve dans Critique de quelques auteurs français qui écrivent en Allemagne (1787), réédition des critiques du Cours et dans le seul exemplaire complet de ce Cours. Les trois tomes se trouvent à la bibliothèque du Château d'Oron (Suisse).
Avec plus de modération que Laveaux, la Gazette ne souscrira pas entièrement aux propos de l'abbé qui, à son avis, réduit trop la part du génie français, mais elle reconnaît des exagérations dans l'article de Masson. Voir Jochen Heymann, Aufklärungsdiskussion und Aufklärungsskepsis im Werk von Carlo Denina, Erlangen-Nürnberg, 1988. L'article de J.-J.-A. Bertrand, "M. Masson", donne un résumé assez complet de cette affaire, in : Bulletin Hispanique, no 24, 1922, p. 120-124.
1er juin 1786, Lettre XIII, p. 73 à 110. "Ce Cours théorique et pratique, fameux à Berlin, et probablement ignoré ailleurs [ ]" (Lettres critiques pour servir de supplement au discours sur la question Que doit-on à l'Espagne..., Berlin, 1786, p. 115).
ALZ, 1785, vol. 1, no 54, p. 27-28 et volume 3, no 216, p. 306-307, puis 1786, vol. 1, no 14, p. 106-107.
Peut-être son Mémoire sur quelques paradoxes en éloquence (1785), mais plus certainement de l'avant-propos son Histoire sommaire et philosophique (1784) que Laveaux a raillé (voir plus haut).
S. Debonale, Cours de langue française, op. cit., t. 2, p. 256 et suivantes.
L'affaire déclenchée par la publication d'Eusèbe, que la Gazette ne mentionne jamais, et qui attaque directement Hertzberg, a été probablement décisive. Avec ironie, dans sa Vie de Frédéric II, Laveaux indique que Hertzberg fera imprimer dans les Mémoires de l'Académie son discours corrigé à partir des remarques qu'il a faites (Tome IV, p.232) !
I. Schmidt rédige les 12 premiers volumes et son continuateur, Joseph Milbiller (1753-1816) une dizaine jusqu'en 1808 (soit 22 volumes entre 1783 et 1808). L'histoire s'arrête en 1806.
Abbé Carlo Denina, La Prusse littéraire, op. cit., p. 434. Dans ses Lettres critiques pour servir de supplement au Discours sur la question : Que doit-on à l'Espagne (1786), il sera plus sévère, décrivant Laveaux traduisant, dictionnaire en mains, mot à mot et accumulant les bévues.
1786, volume 2, no 105, p. 222-225.
Les Büsten berlinischer Gelehrten und Künstler, mit Devisen, Leipziger Ostermesse, 1787, écriront par exemple : "Son Eusèbe [ ] est un pendant parfait du Candide, c'est la voix de la nature, et dans un tel ouvrage on ne peut rien dire de plus sur le despotisme des personnes distinguées [ ]".
Le contentieux avec Hertzberg dut avoir des racines plus profondes que l'affaire du seul Cours théorique. Dans le passage suivant d'Eusèbe, on reconnaît des éléments quasiment biographiques : il y parle de ce livre sur la religion qu'il aurait voulu publier et qui sera à la source de son Essai sur les Prêtres, de Vituline et Rogna Cassa, de ce journal qu'il a eu l'intention de publier, tant de projets qu'Hertzberg a peut-être ruinés
On retrouve parfois les coquilles habituelles des ouvrages de Laveaux et que la Gazette comptabilise.
Les Berlinois reconnaissent Le Bauld de Nans dans ce moine !
Auteur en particulier du Quadrige de la Porte de Brandebourg. Julius Friedländer, Gottfried Schadow, Aufsätze und Briefe nebst einem Verzeichnis seiner Werke, 1890. Lettre de la mère de G. Schadow à son fils.
Joachim Lindner, Wo die Götter wohnen: Johann Gottfried Schadows Weg zur Kunst, 2008. Schadow est aussi l'auteur du portrait de Laveaux qui orne les Nuits Champêtres.
Voir Stengel E., Chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts nebst Angabe der bisher ermittelten Fundorte derselben, Berlin, 1890 (réédité et complété par Niederehe, Hans Joseph, Amsterdam, 1976).
L'orthographe est annoncée mais aucun chapitre n'y est consacré particulièrement.
ALZ, 1785, volume 3, no 173.
Georg Joachim Zollikofer, né en 1730 à St Gall. En 1754, il est nommé pasteur en Suisse puis exerce en Allemagne. En 1758, il dirige la paroisse de Neu-Isenburg puis est en poste à Leipzig. Il meurt en 1788. Il est en relation avec les principaux représentants de l'Aufklärung. C'est à Neu-Isenburg que Laveaux s'est marié en 1775. Peut-être lui a-t-on alors parlé de l'ancien pasteur, à moins qu'il ne l'ait alors rencontré.
Mais il ne s'adresse plus au clergé en poste ; le salut, pense-t-il ironiquement, ne pourra venir que des générations futures !
Dans sa Vie de Frédéric II, op. cit., tome 4, il cite nombre de ces auteurs importants : Lessing (en dépit de son rejet des uvres françaises, dit-il), Mendelssohn, Wieland, Weiße, Ramler, Engel, Gessner, Zollikofer, Sulzer, Kant, Grave, Wezel, Bürger, Claudius, Gleim, Nicolai, Meierotto
Voir la préface de sa Vie de Frédéric II, op. cit.. Il commence en effet dans les années qui suivent son Histoire de l'Europe pendant le XVIIIe siècle, dont le manuscrit partiel se trouve à la médiathèque du Grand Troyes (Archives municipales, MS 2474) et sur lequel nous reviendrons.
Elle mourra à Charenton le 13 avril 1861. Elle épouse le 10 juin 1820, Jean-Baptiste Marty (1779-1863), comédien, régisseur et fondé de pouvoir du théâtre de la Gaîté. Dorothée-Rose Thibaut-Laveaux (1786-1861) montera aussi sur les planches, écrira des pièces et aidera son père dans ses travaux et veillera aux rééditions posthumes de ses dictionnaires.
À sa grammaire, Buffier ajoute un traité de la prononciation. L'expérience allemande de Laveaux fait qu'il accorde beaucoup d'importance à l'ouïe et à la prononciation, mais ce n'est rien de particulièrement original. André Chervel (Histoire de l'enseignement du français ( ), op. cit., rappelle que l'accent est mis sur l'apprentissage de l'oral et de la prononciation (p. 43 et suiv.).
Très exactement, il écrit : "C'est dans ce langage barbare et dans ces principes décourageants pour les élèves et pour les maîtres qu'il faut chercher la cause du peu de progrès. Les progrès dans la langue française sont plus à même d'être connus que les autres, parce que tout le monde en juge ; et lorsque cette partie de l'éducation manque, les parents souvent hors d'état de juger du reste en tirent des conclusions désavantageuses à tout l'institut. Voilà des choses qui feraient le plus grand tort à l'Académie si elles étaient connues."
Staatsarchiv Stuttgart, A 272 Bü 82, 130.
Discours préliminaire, p. XIX.
Leçons méthodiques, Discours préliminaire. Cité par Franz-Rudolf Weller, "L'enseignement du français en Allemagne à la veille de la Révolution française", in : Herbert Christ et Daniel Coste, Contributions à l'Histoire de l'enseignement du français, Tübingen, 1990. p. 103 et suivante. Weller considère d'abord, un peu vite à notre avis, que Laveaux est un "pédagogue d'une étonnante modernité" p. 113, puis il reconnaît qu'il est redevable à ses prédécesseurs.
Principes généraux et raisonnés, Bruxelles, 1756. Restaut s'appuie lui-même sur Rollin.
Cette notion de méthode naturelle est le thème de la thèse de Basedow soutenue en 1752 à Kiel. Montesquieu en parle bien avant, tout comme John Locke. J.-J. Rousseau, sur un autre plan, s'en fera l'illustrateur avec l'Émile.
Beiträge zur Geschichte des französischen Unterrichts im 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin, 1914 (Réimp. Liechtenstein, 1967). Voir les pages consacrées à Laveaux, p. 146 et suivantes.
À Berlin, le pasteur Erman uvre aussi dans ce sens dès 1782, mettant en pratique des idées qu'il a depuis un certain temps et nous avons indiqué qu'il cherche à former ses professeurs du Collège français.
Les avant-propos des grammaires le répètent au cours du siècle ! Voir E. Stengel, Chronologisches Verzeichnis, op.cit.
Discours préliminaire, p. XI et suiv. Pourtant, dans son Cours Méthodique, il utilise ce texte canonique !
ALZ, p. 456.
Leçons méthodiques de Langue française pour les Allemands, 1790, in der Buchdruckerei, Stuttgart. ALZ juin 1792, p. 591.
Laveaux s'est en effet encore une fois beaucoup servi des travaux de l'abbé Girard en particulier sur les prépositions et sur ses concepts de langues analogues (respectant l'ordre naturel, la gradation des idées, l'absence de déclinaisons), de langues transpositives (qui suivent l'ordre de l'imagination et possèdent des cas) et les langues mixtes.
Dans ses Mémoires, Heinrich Heine trace le portrait de Daulnoye, qui a été son professeur.
Streuber, op. cit., p. 105, 124 et suiv., 130.
Critique très négative dans ALZ, 1800, volume 4, no 374, p. 385-386.
Archives d'état de Stuttgart A 272 83 (doc. 12) Verzeichnis der Öffentlichen Vorlesungen welche von Ostern 1786 bis dahin 1787 in der herzoglichen hohen Carls-Schule zu Stuttgart gehalten werden.
Impossible de savoir s'il savait l'allemand avant de venir à Bâle. Toujours est-il que plusieurs documents de Stuttgart tendent à prouver que sa connaissance de cette langue est au plus très moyenne.
Archives d'état de Stuttgart A 272 11, R ad 32 pour les deux premiers titres et les poèmes.
Le document A 272 10 (Archives d'état) de Stuttgart (Festivités) indique un livret de théâtre (disparu) "pièce traduite du professeur de la Veaux" (i ad 32). Johann Rudolf Zumsteeg (1760-1802), condisciple de Schiller et musicien particulièrement doué, il fut maître des concerts de la chapelle de Wurtemberg et a produit de nombreuses uvres que les spécialistes considèrent comme étant de qualité (Lenore, la Plainte d'Agar, Colma, le Chant mélancolique, le chur des Brigands). Publié en 1806 à Leipzig chez Breitkopf und Härtel, sous le titre : Ouverture und Gesänge aus der Oper: Zalaor.
Une habitude très ancrée chez les pasteurs en particulier. En 1801, Erman publiera encore un Mémoire historique pour le jubilé centenaire de la dédicace du Temple de Werder "au profit des pauvres".
L'Allgemeine Literatur-Zeitung du 8 mars 1789 accorde ses suffrages à ce livre, tout en indiquant qu'il y a bien des passages peu utiles.
L'artillerie de campagne française pendant les guerres de la Révolution, 1956, p. 77.
Avant-propos de Nouvelle vie de Frédéric II, Amsterdam, 1789, p. 11. Une comparaison rapide avec l'uvre incriminée donne partiellement raison à l'abbé Denina.
À Berlin, l'abbé Raynal insistera sur la nécessité d'écrire une histoire intéressante, fascinant le lecteur. La qualité littéraire serait selon lui le premier critère. Un lourd appareil scientifique desservirait l'histoire.
Nicolai cite un certain nombre d'erreurs commises. Il en veut surtout à ce Français, à la réputation discutable, dit-il, d'avoir écrit, précipitamment, ce livre. Dans une lettre à Christian Friedrich von Blanckenburg du 2 novembre 1791, il en parle encore comme d' "un brouet méprisable plein de mensonges" !
ALZ, 1788, volume 2, no 84, p. 43-46.
Denkwürdigkeiten meiner Zeit, op. cit. volume 5.
Historisch-literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, vol. 2, numéro 1, p. 321, 1795.
Philippe Bourdin, "Rêves d'empire chez Bonaparte. Construction intellectuelle d'un modèle politique", in : L'Empire avant l'Empire, état d'une notion au XVIIIe siècle, Cahiers du Centre d'Histoire, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, no 17, p. 130.
Histoire secrète de la cour de Berlin, tome 2, p. 47. 1787.Wilhelm Erman: Jean Pierre Erman (1735-1814). Ein Lebensbild aus der Berliner französischen Kolonie. Berlin, E.S. Mittler und Sohn, 1914.
Madame de Genlis arrive elle-même à Berlin en 1794 (puis à Hambourg) où elle survit grâce à sa plume. Il ne semble pas qu'elle ait jamais eu de contact avec Laveaux.
Avril 1800, no 67, p. 532-534. Elle sera couramment désignée sous le titre (encore plus mensonger) qu'elle prend dès la 2e édition : Wailly's französische Grammatik für die Deutschen. Elle est en général recommandée par les grammairiens comme Ildephons Schwarz (Anleitung zur Kenntniss derjenigen Bücher, welche den Candidaten , Coburg, 1806).
L'abbé J.D. Grandmottet était un prêtre émigré à Hambourg, qui, pour survivre, se livre à de nombreux travaux littéraires (traductions de Campe). Klopstock connaissait le "brave abbé Grandmottet".
ALZ, 1793, volume 2, no 167. L'Intelligenzblatt cite son Dictionnaire (édition 1799) en 1800.
Pour bien montrer qu'il est différent de ce "méchant homme", Laveaux affirme qu'il fera passer les gains de ce livre à la famille de Jean-Jacques Rousseau en dédommagement "du tort que leur a fait l'Émile chrétien" !
Johann Valentin publie en 1783 sa Practische Französische Grammatik qui sera à la base de son succès.
Philosophe et publiciste, pédagogue, académicien que Laveaux a certainement connu à Berlin. Il publie en 1785 le premier recueil de textes autonome : Französisches Lesebuch für Anfänger nebst einer kurzen Grammatik (16e édition en 1828) complété en 1792 par une Chrestomathie française.
Un bruit invérifiable court également : plusieurs témoins colportent la rumeur qu'il aurait eu une passion pour la fille de l'intendant : il lui aurait écrit des vers, disent les uns, il serait même allé plus loin sous-entendent les autres, ce qui aurait monté l'intendant contre lui. Cette réputation de séducteur l'accompagne (cf. les écrits de Cranz à Berlin) au cours de sa vie, mais il ne s'agit peut-être que d'une extrapolation de ce qu'on sait ou suppose d'un moine ayant ravi une jeune femme.
E. Hölzle, Das alte recht und die Revolution. Eine politische Geschichte Württembergs in der Revolutionszeit 1789-1805, München und Berlin, 1931.
Nommé professeur de droit (Droit territorial impérial et wurtembergeois) le 29 avril 1788. Il est membre correspondant de la Société des Amis de la Constitution de Strasbourg depuis le 14 juillet 1790.
Rappelons que le Wurtemberg est possessionné en Alsace et à Montbéliard.
Ulrich Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preußen im Vergleich, London, 2003.
Hugh Gough, op.cit., p. 75 et suivantes.
Op. cit., p. 6.
Axel Kuhn, Revolutionsbegeisterung an der Hohen Carlsschule / e. Bericht, Stuttgart, 1989.
P. 6. Comme dernier témoignage de son influence, il indique que deux de ses étudiants rejoindront les troupes de Custine lorsqu'il entre à Spire et servent désormais dans les armées de la République. Les cris de "Vive Laveaux" étonnent car à Stuttgart, il est connu comme le professeur de la Veaux ! La particule est honnie en 1794, date de la Réponse !
Déclinisme. Vous avez dit déclinisme?
Ce phénomène du déclinisme annoncé est si important que des chercheurs étrangers comme Sudhir Hazareesingh, un professeur d'Oxford (Ce pays qui aime les idées) ou Hartmut Stenzel en Allemagne consacrent des ouvrages et articles à l'étudier. Récemment des journées d'étude ont été organisées à l'Université de Fribourg sur ce phénomène du pessimisme culturel
La plupart des auteurs français incriminés se veulent républicains et laïcs ce qui peut étonner avec leur discours "anti-moderniste" remettant en cause l'idée même de progrès et ébranlant pour ne pas dire annihilant la foi dans le principe clé de la triade républicaine, l'égalité (remarquons qu'il s'agit bien d'une "foi" que les analyses les plus rationnelles, les démonstrations les plus évidentes n'ont pas, très longtemps, entamée, car la France est en réalité un pays extrêmement inégalitaire !)
Singularité française ? Au Cogito ergo sum succéderait le Deploro ergo sum des veuves de Descartes ? Sans doute pour une part. La déploration décliniste entre aussi dans une stratégie de la communication, dans le désir d'étonner par des prises de position inattendues, dans le marketing des médias et des éditeurs. Mais, on ne peut que s'étonner de voir un philosophe "de gauche" comme Onfray évoquer récemment la fermeture nécessaire des frontières et un publiciste "de droite" comme Olivier Todd voyant dans l'esprit de "Je suis Charlie" l'expression de l'hystérie islamophobe ambiante !
La crise (bien difficile à définir, bête à sept têtes et dix cornes, n'affecte pas que la France mais son appréhension catastrophiste et philosophique est très française. Si ailleurs (en Allemagne, en Grande-Bretagne ) elle conduit à des positions populistes (euroscepticisme, refus des flux migratoires, refus d'un engagement militaire et financier hors de frontières), celles-ci sont véhiculées par des mouvements sans ambition théorique ou philosophique. En France, la discussion a justement ces prétentions.
Il est un fait sur lequel il convient peut-être de revenir. L'histoire est parcourue de mouvements de ce type, de crises des valeurs, d'un pessimisme culturel certain d'une décadence irrémédiable. Hésiode, au 7e siècle avant J.-C. parlait, dans son épopée Des travaux et des Jours, de la disparition du Siècle d'Or remplacé par un Siècle d'argent, puis, à son époque, par un siècle de fer (de guerres - ce que Voltaire loue malicieusement dans son Mondain). Platon et les auteurs de la période hellénistique y ont aussi recours. Anaximandre de Millet est à cet effet un exemple extrême. Pour ce physicien et philosophe, il n'y a pas que la culture qui un jour ne s'effondre et ou ne doive s'effondrer : c'est le sort commun de tout ce qui existe.
Plus tard, Montesquieu expliquait (et en ces époques de grandes migrations, on devrait le relire) la grandeur et la décadence de l'Empire romain sous entendant après bien d'autres que l'histoire était cyclique, passait forcément par des hauts et des bas, et Jean-Baptiste Vico se servait de métaphores "organiques", biologiques comme le vieillissement et la mort pour décrire la décadence culturelle.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que l'industrialisation progresse, l'optimisme philosophique des Lumières et les excès du positivisme ne sont pas seulement attaqués par la réaction religieuse ou les auteurs conservateurs, loin s'en faut ! S'y mêlent des accents violemment anti libéraux, socialistes, nationalistes et antisémites. Certains évoquent une prochaine apocalypse qui au prix du sang versé apportera peut-être une régénération.
En Allemagne, des auteurs comme Wilhelm Marr, en France comme Gobineau et Drumond, en Angleterre comme Matthew Arnold mêlent pessimisme culturel et racisme, peur d'un complot international qui, lié au matérialisme menacerait la culture de l'occident. D'autres comme Thoreau aux Etats-Unis, William Morris en Grande-Bretagne, Paul Lafargue en France dénoncent le productivisme ambiant, l'abrutissement des producteurs (ce que fait aussi Tocqueville), un progrès lié au capital, à des valeurs jugées comme frelatées, niant l'homme et qui marque une régression de la civilisation. Tous évoquent "la décadence".
La philosophie participe à cette critique avec des auteurs comme Schopenhauer ou Nietzsche et au XXe siècle, on peut dire que les écrits de Freud ne débordent pas d'un optimisme béat en ce qui concerne la culture occidentale. En France, vers 1930, un auteur proche du marxisme comme Georges Sorel partage ce pessimisme culturel. Inutile d'évoquer les auteurs et théoriciens fascistes ou nazis annoncés par des théoriciens comme Vollgraff ou Spengler pour qui la décadence de l'Occident est un fait.
Les beaux-arts eux-mêmes y ont pris et y prennent une part active. Comment comprendre autrement l'évolution de la peinture ou de la sculpture moderne autour et 1900 et pendant plus de la moitié du XXe siècle, comment comprendre autrement le dadaïsme, le surréalisme, les tentatives pour révolutionner le roman ? Comment comprendre l'art soviétique ou Arno Breker ?
Cependant, nous voyons aussi que si les surréalistes enterrent symboliquement Anatole France et ce qu'il représente, ils proposent autre chose : une nouvelle culture qui leur paraît plus riche, plus généreuse, plus humaine ! La dénonciation d'une prétendue décadence ne se referme pas toujours sur un nihilisme frileux.
L'histoire ne se répète pas mais tout de même. Parmi les phares de la philosophie des Lumières, des hommes comme d'Alembert et Condorcet, dans les années 1770-1780, jettent un regard sombre sur leur pays. Dans ses lettres à Frédéric II, d'Alembert se plaint amèrement de la décadence française qui n'épargnerait aucun domaine. Ainsi, le 19 septembre 1779, il lui écrit :
Vous n'avez que trop raison, Sire, sur la décadence où tout est tombé, et sur le grand vide que laisse la mort de Voltaire ; mais tel est le sort des choses humaines. Quand même notre littérature se remonterait, je soute qu'elle puisse de long-temps produire un homme aussi rare, et qui réunisse tant de talens à un aussi haut degré.[ ]
Le roi de Prusse saisit la balle au bond et en rajoute bien sûr : il n'a jamais admiré que Racine et les classiques avec l'exception de Voltaire. Il sait que dans les pays allemands, l'image du Français est dévaluée : vantard, précieux, superficiel. Un petit-maître imbu de lui-même mais en réalité une baudruche qui se dégonfle aisément. Sans son frère, le prince Henri, francophile à tous crins, on n'aurait pas décerné en 1784 le prix (ex aequo !) de l'Académie à Rivarol pour son Discours sur la langue française, discours que les intellectuels allemands, à de rares exceptions utiliseront pour démontrer la décadence française, un prix qui n'est en fait qu'un chant du cygne prévu par un souverain cynique qui pense avoir encore besoin de cette langue comme il l'explique dans sa Lettre sur la littérature allemande (1780). Un abbé de son Académie, Carlo Dénina démontrera à la même époque, soutenu par Frédéric, que dans le fond les Français n'ont rien inventé en littérature, mais qu'ils ont su profiter des autres : des Anciens, des Italiens, des Espagnols Ils ont simplement su mettre en forme ce que d'autres avaient créé tout simplement parce que leur langue unifiée, régularisée par volonté d'abord politique, était un instrument de qualité. Ce demi-compliment étant repris par deux constatations : l'histoire montre assez les vicissitudes de la littérature et des réputations, et le fait que d'autres nations (la Prusse, par exemple !) sont sur la voie d'obtenir une langue aussi policée, mais dont les qualités intrinsèques sont peut-être même supérieures à celles d'une langue figée dans une syntaxe peu plastique et peu apte à créer de nouveaux mots !
Cette décadence signalée par d'Alembert et Condorcet l'est aussi par des grammairiens comme Jean-Charles Laveaux qui en 1802 montrera à lui seul aux Académiciens comment l'on peut faire un bon dictionnaire, et bien sûr par quelques romanciers comme Laclos, dont le chef d'uvre est aussi la chronique d'une société, d'un modèle politique, social, culturel qui s'effondre !
Pas de fumée sans feu. Quelques années après la mort de d'Alembert, la Révolution pensera balayer le vieux monde, régénérer la France et une nouvelle société tentera de se mettre en place. Il est rare qu'un excès de pessimisme ne soit pas suivi d'une secousse importante. Qui sait si le pessimisme polyvalent actuel ne prépare pas des lendemains qui chantent. Selon Camus, le pessimiste est un optimiste actif. Laissons-nous surprendre !
Islamisme et littérature Houellebecq et Sansal, deux mondes
Houellebecq et Soumission : du copier-coller ?
Soumission. On en a fait tout un fromage. Les raisons éditoriales et commerciales n'ont rien épargné : en pleine tragédie de Charlie, on invente un aspect sulfureux au roman, des menaces seraient proférées, une fatwa éventuelle, fuite éperdue de l'écrivain qui se prête au jeu... L'argent n'a pas d'odeur et prospère à l'ombre de l'horreur en technicolor. Chacun sait cependant que tout cela fait simplement partie de la stratégie de lancement du nouveau produit Houellebecq. De la com', de la pub, de la stratégie commerciale. Malgré tout, en bon Français, on se dit qu'il faut le lire ce bouquin même si on n'a pas trop accroché aux autres Houellebecq. Comme on est prudent, on pense malgré tout qu'avant de foutre en l'air 21 euros, on va attendre la sortie en livre de poche. On attend, rien ne vient, les maisons d'éditions veulent faire avant tout du chiffre, l'édition à pas cher, ce sera pour plus tard. Heureusement, un ami qu'on a invité à un couscous-fait-maison, vous l'offre avec un extraordinaire à propos vu le menu proposé.
Alors, le couscous avalé avec ou sans harissa, le couscous digéré, quelques jours après, on se décide à lire son cinq ou sixième Houellebecq, se promettant au fil des pages que ce sera le dernier (mais c'était déjà la décision prise au second roman!).
Pénible lecture mais les chapitres sont minces.
Waterloo, morne plaine. Un roman (?) torché (mais c'est sans doute la marque de fabrique Houellebecq) : des phrases bancales, des répétitions pas stylistiques du tout, parfois un usage des temps et des modes à la limite de l'acceptable Liberté de l'auteur, pâle lecteur, Béotien coincé ! Tu ne vas tout de même pas t'en tenir à ces bagatelles !
Pourtant, j'ai du mal à accrocher. Un récit qui se traîne assaisonné de digressions nulles, des citations de Huysmans tirées d'internet, soi-disant revues par un maître de conférences qui aurait aidé l'auteur comme l'affirme une note, des pages de cul sans entrain ni imagination, des personnages marionnettes...
Mais tout cela, encore une fois, c'est peut-être la patte Houellebecq, un côté grunge, un humour qui peut faire plaisir à certains. Rien contre, même si ce n'est pas mon verre de pinard. Je dois avouer avoir souri de temps en temps et délaissé par instants les symboliques ciseaux d'Anastasie.
En revanche, au niveau des idées, ce n'est plus Waterloo, c'est le vide sidéral. Qu'apporte Houellebecq à une problématique bien actuelle ? Rien ! La pirouette finale n'est même pas amusante. Une brève de comptoir, au plus. On peut bien entendu réfléchir à cette perspective d'un islamisme accepté par tous et surtout par les mecs parce que, se laissant aller à leur penchant naturellement (?) macho, ceux-ci auraient dans le fond tout à y gagner. On peut certes y lire la dénonciation ironique d'une régression détestable. Il faut pour cela faire des efforts, mais un auteur digne de ce nom attend justement ces efforts de la part de ses lecteurs. Un moyen de les associer à son uvre. On peut tout justifier au royaume des lettres. Comme en peinture, comme dans tous les beaux-arts évidemment ! Tout dépend des lunettes que l'on chausse !
Ce qui me gêne davantage, c'est que Houellebecq s'est rappelé ses lectures de potache : Rhinocéros ! Mais son héros n'est pas Béranger (ce qui est tout à fait son droit).
Ionesco a donné une fable dont la richesse est justement qu'elle est inépuisable. Que la rhinocérite à laquelle succombent un à un les individus, la société qu'il met en scène, représente les religions, le fascisme, le stalinisme, le consumérisme, le prêt-à-porter intellectuel, les modes , importe peu. Cette pièce dénonce tout ce qui menace la liberté et l'individualité, tout ce qui déshumanise une société, et sa richesse réside dans le message atemporel et subtil qu'elle délivre. Quant au héros, Béranger, il entre, lui, vraiment et volontairement en résistance : "Contre tout le monde, je me défendrai ! Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout ! Je ne capitule pas !"
Houellebecq copie la démarche et en fait la caricature. Rhinocéros a une valeur paradigmatique alors que Soumission est sans épaisseur, sans portée, sans élan. La mollesse d'un abandon même si bien sûr la perspective de cet abandon peut révolter le lecteur et l'amener à réagir Mais l'uvre littéraire (question éternelle) a-t-elle pour fonction d'aiguillonner les lecteurs, de les amener à prendre position ? Est-elle simplement un moyen ? Est-elle une fin en soi ?
La pièce de Ionesco ou La Peste de Camus sont des uvres qui, si elles s'ancrent forcément dans une réalité la transcendent, continuent à vibrer bien après les événements comme un gong résonne longtemps après le choc du marteau, éternellement.
Soumission n'est qu'une longue de comptoir !
Patron, remettez une tournée.
Le second bouquin, je l'ai acheté. J'avais bien aimé deux ou trois livres de Boualem Sansal et, la pub aidant, son utopie funèbre, 2084, me semblait être une fameuse idée.
Accrochez-vous lecteur, on n'est plus dans le même registre que Soumission ! Pas étonnant qu'à ce que l'on dise, l'auteur n'ait pas trop apprécié les félicitations (collégiales? pontifiantes ? maquignonnesques ?) de Houellebecq !
L'histoire n'est pas simple. On a parfois l'impression que l'auteur se cherche et que les épisodes s'enchaînent sans avoir été vraiment prévus, ce qui n'est pas une démarche inintéressante. Mais bon, roman utopique, roman d'une quête, on n'a pas à s'embarrasser de cohérence absolue et puis on suit avec passion le parcours mi-erratique mi-merveilleux de son personnage principal. Le fait que le lecteur - et le héros - soient entraînés dans un monde imprévisible et confus a son charme et peut porter en soi sa leçon. 2084 appartient à ce genre de livres qui demandent une première lecture de "désensibilisation", de lessivage de ses habitudes littéraires, et une seconde (au moins !) qui permet de mieux profiter d'un ouvrage poétique malgré son sujet, et souvent fascinant.
L'histoire se passe donc en Abistan, un pays qui a vocation d'être désormais le monde. Il est l'aboutissement de conflits et de guerres qui ont permis au culte de Yölah de s'implanter sur la planète. La dictature religieuse, la théocratie, impose ses lois : le peuple vénère Yölah et son prophète Abi. On prie neuf fois par jour ; la femme est évidemment un être inférieur. Les exécutions publiques, les pèlerinages entretiennent pour ainsi dire la foi des masses. Pourtant, avec le personnage central, Ati, on découvre que ce monde qui se veut parfait dans sa croyance et ses pratiques est parcouru de failles : d'abord, d'où viennent ces gens qu'on exécute pour l'amusement et l'édification des foules ? Et pourquoi ? Les croyants qui se refusent pour leur quasi-totalité à se poser des questions (qui ne le peuvent), se précipitent à ces exécutions horribles données dans des stades, à ces nouveaux jeux du cirque. Panem et circenses. Le peuple vit dans la misère mais en contrepartie, il a droit à ces spectacles, il prie, il part en pèlerinage et mange à sa faim le plat national, une bouillie infâme mais nourrissante que, par habitude, il trouve délicieuse.
Nous sommes plongés dans un monde ayant apparemment réalisé les promesses du prétendu prophète. L'histoire n'a plus de signification pour les générations de ce temps, le présent est décrété éternel. Le vieux monde s'est effondré à la suite de la grande guerre sainte (grâce à "[ ] l'arme absolue qu'il n'est besoin ni d'acheter ni de fabriquer, l'embrasement de peuples entiers chargés d'une violence d'épouvante") et avec lui ont disparu tout ce qui le structurait : les langues, les livres, les musées, les meubles, les habits, une nourriture variée en un mot ce qui était culture avant le grand bouleversement. L'Abistan est désormais le royaume de Yölah et Abi est son délégué, son représentant sur terre. Le Gkabul, venant "du dérèglement interne d'une religion ancienne qui jadis avait pu faire les honneurs et les bonheurs de maintes grandes tribus des déserts et des plaines" est le livre saint qui n' "était pas pour éveiller le malheureux", mais "un lest pour le couler par le fond". En Abistan, on parle une langue particulière, l'abilang, langue nouvelle conçue pour éviter la réflexion, les pensées trop profondes, l'esprit critique. Pourtant, dans ce monde réglé au millimètre, des bruits courent, des on-dit invérifiables ou subtilement véhiculés par le pouvoir : Abi vivrait dans d'innombrables palais, la grande guerre n'aurait pas exterminé tous les "ennemis", les mécréants, bien que la langue même ne connaisse pas le mot En revanche, des mots sont inventés : on évoque "l'étranger", certains osent affubler Abi du nom de Bigaye = Big Eyes. (La dette envers Orwell est malicieusement soulignée.) Là commence le doute par rapport à la doxa officielle. Le héros du roman, Abi, Candide inquiet mais curieux et opiniâtre, est amené au cours de pérégrinations forcées puis plus ou moins volontaires, à entrevoir derrière cette doxa un ensemble de faits qui démentent tout ce que les foules croient : une ville de l'ancien temps aurait été découverte, il existerait encore des territoires qui échapperaient à l'autorité et certains d'entre eux seraient même tolérés voire suscités pour permettre les trafics de toutes sortes. D'ailleurs, tout en affirmant la fin des temps et la toute-puissance de Yölah et d'Abi son représentant, le système fait courir le bruit de la nécessaire poursuite de guerres contre des ennemis possédés par le mal, ce qui justifie les exécutions massives et maintient une pression nécessaire. Parfois, l'idée d'une "frontière" au-delà de laquelle se trouveraient ces ennemis est évoquée. Réalité ? Fiction ? Mensonge délibérément propagé pour alimenter les exécutions ? Abi découvre naïvement toutes ces manipulations, les tricheries par rapport aux anciens temps, l'existence d'une histoire falsifiée, un univers kafkaïen peuplé d'êtres faux et pervers. Il découvre ainsi qu'une élite sans scrupule profite du système et vit dans l'abondance tandis que le peuple est cantonné dans une pauvreté et une ignorance extrêmes.
Il rencontre un personnage étrange nostalgique des temps passés appartenant à l'appareil, qui a réussi à monter un extraordinaire musée qu'il visite et qui lui montre qu'une autre vie est ou a été possible. Mais ce n'est qu'un musée et quasiment personne n'y a accès. Abi décide alors de chercher cette frontière et de tenter de renouer avec "l'autre monde", s'il existe
Les thèses de Boualem Sansal sont claires : son essai Gouverner au nom d'Allah montrait comment l'Islam radical conquiert le monde et il n'excluait pas que la France puisse devenir pays islamique. Pour lui, l'Islam est la seule force montante capable de prendre le pouvoir et de l'assumer partout dans le monde parce qu'il dispose de l'énergie nécessaire et d'un potentiel de violence suffisant. Il considère comme particulièrement dangereuses les situations en France, en Grande-Bretagne, en Russie, aux États-Unis ou un islamisme occidental particulièrement habile prend de l'importance sous le regard désemparé et impuissant des démocraties. Dans 2084, les prévisions de l'essai et la vision pessimiste de son auteur, nouveau Cassandre, se sont en quelque sorte réalisées : désormais plus besoin de djihad ou d'attentats meurtriers, les individus réifiés se soumettent volontairement, obéissent mécaniquement aux lois et à la règle imposées par Abi et ses sicaires. Pourtant, l'itinéraire d'Ati le montre, il reste une étincelle d'espoir : les individus ne sont pas totalement soumis, il demeure en eux une potentialité de révolte, que ce soit par les trafics illicites auxquels beaucoup d'entre eux se livrent, par la remise en question des dogmes imposés à la suite de découvertes fortuites et du resurgissement du vieux temps, par la persistance souterraine dans l'esprit de certains d'un personnage fabuleux : " Pour la première fois, on parlait d'un être mythique sorti d'on ne sait quel monde, qui ne serait ni un dieu comme Yölah ni un contre-dieu comme Balis, mais un être solaire déroutant, tout de lumière et de raison, d'intelligence et de sagesse, qui enseignerait une chose inconnue au pays de la Sainte Soumission : la révolution dans l'harmonie et la liberté. [ ] Un nom avait circulé de foule en foule mais il avait été mal entendu : Démoc Dimouc Dmoc." !
Sansal peut être certes aussi difficile à lire que l'est Assia Djébar, ce qui n'est pas peu dire : un esthète verra dans cette écriture une performance, une maîtrise incomparable, une richesse formidable, une flamboyance exceptionnelle. Il aura probablement raison, mais à suivre le parcours d'Ati, je dois avouer, moi qui ne suis justement pas un esthète mais un liseur lambda, que j'étais parfois à la limite, pas loin de l'AVC. Heureusement, les chapitres sont en général courts et on peut reprendre souffle ! Que le roman ait été interdit en Algérie était prévisible de la part de Bouteflika et de sa clique (pas absents du livre qui se lit parfois comme un roman à clefs) mais il y a peu à croire (hélas ! quand on songe à l'Algérie d'après celui-ci) que ce texte complexe aurait été dévoré par les masses.
Dans l'ensemble donc, un livre important, incomparablement plus riche sur tous les plans que celui de Houellebecq et qui vient compléter les avertissements que nous donne Sansal depuis longtemps. J'ai simplement regretté que cette uchronie n'ait pas été parfois traitée avec un peu plus de légèreté. J'ai parlé d'Ati comme d'un nouveau Candide (mais qui se refuse à cultiver son jardin). J'aurais aimé que Boualem Sansal fasse couler dans sa plume un peu de l'encre de Voltaire. Sa leçon n'en aurait certainement pas perdu de sa force.
Ces dernières remarques concernent d'ailleurs surtout les trois premiers livres du roman ; le quatrième et dernier est une extraordinaire réflexion sur les dérives d'une religion qui, par ses excès, n'a rien à voir avec ce qu'elle était à l'origine. De trahison en trahison, on en est arrivé à un totalitarisme abject négation de tout ce qu'est l'homme. Dans une langue extraordinaire, cristalline et puissante, Boualem Sansal fait le procès sans excès ni pathos des tenants et des aboutissants d'une situation intolérable, inhumaine. En même temps, une nouvelle fois, il prévient
L'épilogue est un régal d'imagination et d'ironie. Il se termine par ces phrases qui balaient tout manichéisme et qui ne peuvent que faire réfléchir :
"Cette histoire des frontières est des plus étranges. Si la frontière n'existe pas, et cela est sûr, sa légende, elle, existe et court toujours. Les ancêtres de nos lointains ancêtres en parlaient déjà, mais dans nos montagnes au sommet du monde la frontière est ce qui sépare le bien du mal. Les nomades et les contrebandiers, eux, savent bien qu'aucune frontière ne sépare une montagne d'une autre, un col d'un autre, un nomade ou un contrebandier d'un autre. La frontière est leur lien. Si parfois des caravanes disparaissent et d'autres sont attaquées et décimées, ils savent qui sont les responsables, ce sont les caravaniers eux-mêmes, ceux qui ont rompu avec les lois divines pour s'adonner au vol et au crime."
Ce sont les caravaniers eux-mêmes
Merci Monsieur Sansal.
Soumission<em></em> Houellebecq et le copié-collé
Soumission. On en a fait tout un fromage. Les raisons éditoriales et commerciales n'ont rien épargné : on invente un aspect sulfureux au roman, des menaces seraient proférées, une fatwa éventuelle, fuite éperdue de l'écrivain qui se prête au jeu... L'argent n'a pas d'odeur. Chacun sait que tout cela fait simplement partie de la stratégie de lancement du nouveau produit Houellebecq. Malgré tout, en bon Français, on se dit qu'il faut le lire ce bouquin même si on n'a pas trop accroché aux autres Houellebecq. Comme on est prudent, on pense malgré tout qu'avant de foutre en l'air 21 euros, on va attendre la sortie en livre de poche. On attend, rien ne vient, les maisons d'éditions veulent faire avant tout du chiffre, l'édition à pas cher, ce sera pour plus tard. Heureusement, un ami qu'on a invité à un couscous-fait-maison, vous l'offre avec un extraordinaire à propos vu le menu proposé.
Alors, le couscous avalé avec ou sans harissa, le couscous digéré, quelques jours après, on se décide à lire son cinq ou sixième Houellebecq, se promettant au fil des pages que ce sera le dernier (mais c'était déjà la décision prise au second roman!).
Pénible lecture mais les chapitres sont minces.
Waterloo, morne plaine. Un roman (?) torché (mais c'est sans doute la marque de fabrique Houellebecq) : des phrases bancales, des répétitions pas stylistiques du tout, parfois un usage des temps et des modes à la limite de l'acceptable
Un récit qui se traîne assaisonné des digressions nulles, du coupé-collé sur Huysmans tiré d'internet peut-être revu par un maître de conférences qui aurait aidé l'auteur, des pages de cul sans entrain ni imagination, des personnages marionnettes...
Mais tout cela, encore une fois, c'est peut-être la patte Houellebecq, un côté grunge, un humour qui peut faire plaisir à certains. Rien contre, même si ce n'est pas mon verre de pinard.
En revanche, au niveau des idées, ce n'est plus Waterloo, c'est le vide sidéral. Qu'apporte Houellebecq à une problématique bien actuelle ? Rien ! La pirouette finale n'est même pas amusante. Une brève de comptoir, au plus. On peut bien entendu réfléchir à cette perspective d'un islamisme accepté par tous et surtout par les mecs parce que, se laissant aller à leur penchant naturellement macho, ceux-ci auraient dans le fond tout à y gagner. On peut y lire la dénonciation d'une régression détestable. Il faut certes pour cela faire des efforts, mais un auteur digne de ce nom attend justement cet effort de la part de ses lecteurs. Un moyen de les associer à son uvre.
Ce qui me gêne davantage, c'est que Houellebecq s'est rappelé ses lectures de potache : Rhinocéros, mais son héros n'est pas Béranger (ce qui est tout à fait don droit).
Ionesco a donné une fable dont la richesse est justement qu'elle est inépuisable. Que la rhinocérite à laquelle succombent un à un les individus, la société qu'il met en scène, représente les religions, le fascisme, le stalinisme, le consumérisme, le prêt-à-porter intellectuel, les modes , importe peu. Cette pièce dénonce tout ce qui menace la liberté et l'individualité, tout ce qui déshumanise une société, et sa richesse réside dans le message atemporel et subtil qu'elle délivre.
Houellebecq copie la démarche et en fait la caricature. Rhinocéros a une valeur paradigmatique alors que Soumission est sans épaisseur, sans portée, sans élan.
Une longue de comptoir !
Patron, remettez une tournée.
Littérature latine de Bretagne
La conversion au christianisme (milieu du IIIe siècle et débuts du IVe) ainsi que la perte d'importance des langues vernaculaires ont été les conséquences les plus évidentes de cet événement, particulièrement en Haute-Bretagne où la toponymie renseigne sur les domaines gallo-romains qui se développèrent et donnèrent souvent naissance par la suite à une localité. Les trois premiers évêchés de Nantes, Rennes et Vannes - peut-être Quimper - datent aussi du IVe siècle, mais il faut attendre le Ve siècle pour connaître les premiers évêques : Desiderius, Anthemius et Patern.
Avec la lente pénétration chrétienne, l'arrivée et la formation de clercs, une littérature latine (d'Armorique) prend son essor comme partout ailleurs, un essor toutefois ralenti par les invasions de ceux qu'on appelle les "barbares" dès le milieu du IIIe siècle, mais qui s'accentue au Ve avec la désorganisation de l'empire romain. Il faudra attendre le milieu du Ve siècle et le VIe pour voir arriver des bandes de Bretons fuyant les Saxons et les Angles qui les avaient refoulés vers l'ouest de la Grande-Bretagne lorsqu'ils avaient envahi le sud de l'île (mais avant cette époque, des contacts et des échanges existaient naturellement entre la Cornouaille et la Bretagne). Ces vagues d'immigration n'allaient pas sans inquiéter les autorités religieuses qui voyaient d'un mauvais il les pratiques religieuses importées comme en témoignent les deux lettres adressées à deux prêtres bretons Lovocatus et Catihernus par les évêques Licinius Melanius et Eustochius leur reprochant de propager l'hérésie de Pepodius, acceptant en particulier des femmes (conhospitae) à la célébration liturgique. Ces Bretons, déjà christianisés, mais moins romanisés que les populations d'Armorique, qui émigrent progressivement sur 150 ans, receltisent en effet les territoires clairsemés de l'ouest de la Bretagne où les dialectes celtiques n'avaient de toute façon pas disparu. A l'est, ils s'intègrent aux populations gallo-romaines plus nombreuses qui restent plus qu'à l'ouest sous la domination de comtes dépendants des rois mérovingiens. Les évêques - qui représentaient l'autorité la mieux acceptée depuis la chute de l'empire romain - virent d'ailleurs dans Clovis et ses successeurs le meilleur rempart pour assurer leur défense et les prérogatives de la religion : Melaine, l'évêque de Rennes fut ainsi le principal négociateur de la soumission à Clovis. C'est d'abord en Basse-Bretagne que s'installèrent des moines venus du Pays de Galles ou d'Irlande. Fidèles à leurs coutumes, ils vivaient au milieu des populations et desservaient les paroisses. Ils jouent alors un rôle essentiel dans le développement et l'organisation du pays. L'Église est ainsi omniprésente et un pouvoir laïc n'apparaît que sporadiquement ou sous une forme particulière, celle des machtierns, sortes de grands propriétaires, de puissances locales, avec parfois des chefs plus puissants que certaines vies de saints qualifient de rois, un pouvoir insuffisant pour permettre l'épanouissement de ce qui verra le jour en Irlande ou au pays de Galles, une vie intellectuelle et littérature indépendantes du clergé même si certains témoignages laissent à penser que ces personnages puissants avaient auprès d'eux des bardes : saint Turiau aurait été savant et chanteur d'histoire ; saint Hervé était le fils d'un harpeur de renom ; le célèbre et probablement légendaire barde Taliésin serait venu d'Outre-Manche pour séjourner à la fin du VIe siècle en Bretagne...
Il semble que ces chefs aient souvent été en guerre les uns contre les autres ou contre les comtes francs des marches. Ils étaient en tout cas redoutés des populations de Haute-Bretagne et de leurs évêques. Certains d'entre eux ont cependant laissé le souvenir - ou la légende - de princes pieux et pacifiques : Gradlon, Withur, Judicaël, roi de Domnonée mort vers 650, qui reconnut l'autorité de Dagobert.
L'hégémonisme carolingien entraîne de nombreux conflits et Roland est le premier chef des marches de Bretagne (marca Britanniae). Une réforme ecclésiastique fait rentrer dans le giron commun l'Église bretonne, et tous les diocèses bretons sont placés sous l'obédience de l'archevêque de Tours, alors que la plupart des évêques seront d'origine gallo-franque. Ces réformes ne se font pas sans difficultés ni guerres, mais Louis le Pieux sait se concilier un chef breton du sud de la province : Nominoë. À la mort de l'empereur d'Occident (840), celui-ci s'opposera toutefois à son successeur Charles le Chauve et poussera ses troupes jusque dans le Poitou. Disposant d'une cavalerie de qualité, ayant avec lui d'autres chefs bretons et francs, il défait le roi des Francs à Ballon, s'empare de Rennes et de Nantes en 850.
Sur le plan intérieur, il s'assure le soutien de l'Église et aide Conwoïon, le fondateur de l'abbaye de Redon, à obtenir de larges donations de Louis le Pieux. Conwoïon aidera en retour Nominoë à faire remplacer la plupart des évêques gallo-francs par des évêques bretons. En même temps, en contrepartie, Nominoë cherche à faire supprimer les vieux usages celtiques, à ramener l'Église bretonne à la discipline romaine et il fait donner leur physionomie définitive aux neuf évêchés bretons.
Ses missi - sur le modèle carolingien - représentent alors son autorité auprès des machtierns.
L'expansion bretonne commencée par Nominoë se poursuivra jusqu'en 920 mais les populations romanes du Cotentin, du Maine occidental bien que soumises ne sont pas "bretonnisées".
Les Normands arrêteront cet expansionnisme poursuivi par Erispoë (851-857) et Salomon (857-875). Ils domineront même la Bretagne quelques années (907-937). Les abbayes et monastères du pays sont saccagés : Landévennec, Plélan, Redon en particulier, Nantes détruites, la cathédrale de Vannes L'intelligentsia des évêques, abbés, nobles et clercs quitte en grande partie la Bretagne et ce qui peut être sauvé des bibliothèques est dispersé aux quatre vents de l'Europe. Grâce à l'alliance anglo-saxonne, les Bretons avec Alain Barbetorte, petit fils d'Alain le Grand (duc de 936 à 952, sous la suzeraineté du roi de France) vivant en Angleterre à la cour du roi Athelstan, reprennent le contrôle de leurs territoires en 939, territoires dévastés par les mises à sac répétées des envahisseurs.
La Bretagne d'après 940, étendue jusqu'au sud de la Loire est d'abord marquée par la rivalité des maisons de Rennes et de Nantes jusqu'au XIe siècle, sorte de siècle d'or avec Alain III et Alain Fergent mort en 1119. Des alliances difficiles avec les Normands, la participation importante à la conquête de l'Angleterre et aux expéditions en Italie du sud marquent cette époque. Ensuite, la Bretagne entre sous la coupe des Plantagenets puis des Capétiens. La Haute-Bretagne voit très tôt le breton s'éteindre complètement, mais représente définitivement le centre politique et religieux.
*
Sur le plan linguistique des pays celtes, du IVe au XIIIe siècle, la lingua britannicae s'est différenciée en parlers, en dialectes et en trois langues principales: le breton, le cornique et le gallois.
Le vieux breton (IVe-XIe siècle) avec ses deux dialectes principaux, celui des immigrants venus du sud de la Grande-Bretagne, et celui des habitants de l'Armorique, est, à côté du latin, pour une période assez longue la langue véhiculaire. La lingua britannicae reste le vecteur d'une tradition littéraire commune aux pays celtes jusqu'au Xe siècle pour laisser place à de nouvelles normes correspondant aux langues nées des dialectes. Alors que la Basse-Bretagne conservera jusqu'au XVIIe siècle la culture celtique et une langue bretonne différenciée régionalement, la Haute-Bretagne voit se développer le (les) parler(s) gallo(s). La langue bretonne, quant à elle, est une langue en évolution constante: les termes français y sont de plus en plus présents à partir du XIIe siècle.
Léon Fleuriot évoquait une Bretagne à trois voix lorsqu'il parlait de cette Bretagne ancienne: le breton, le latin et le français sont en effet les trois langues qui se parlent alors, avec bien entendu toutes les variantes (dialectales) qui se déclinaient à partir d'elles, tous les sabirs résultats des échanges, des contaminations linguistiques et des influences respectives.
Il ressort de ce rapide tour d'horizon historique que la langue des clercs possède tout au long des aléas de ces périodes troublées l'avantage de la stabilité et d'origines prestigieuses, celui d'être la langue de la seule force existante et structurante du pays, l'Église. En outre, le mythe de l'origine troyenne commune renforce chez les intellectuels bretons le sentiment de parenté avec Rome et confère au latin un prestige indéniable. C'est aussi ce qui explique l'existence jusqu'au XIIe, voire XIIIe siècle d'une véritable littérature latine de Bretagne, même si les sources dont on dispose sont relativement rares, et surtout insuffisamment inventoriées et exploitées.
*
La place du latin est en effet remarquable, quelle qu'ait pu être sa qualité, puisqu'en ces temps reculés, il est en Bretagne très probablement la seule langue écrite, en tout cas celle dont on ait quelques preuves, les manuscrits en langue bretonne, qui n'ont pu manquer d'exister, ayant quasiment totalement disparu. Contrairement à ce qui est avéré pour le pays de Galles ou l'Irlande, à l'heure actuelle, on n'a pas la preuve matérielle d'une littérature écrite en langue vernaculaire avant le XVe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu par écrit ou plus certainement oralement l'expression de l'individualité culturelle bretonne. La puissance de l'Église et la faiblesse des pouvoirs laïcs expliquent cette importance. Le Cartulaire de Redon (IXe) prouve qu'au moins dans la Bretagne du sud-est, le latin était tellement implanté que même les pièces comptables les plus courantes étaient rédigées dans cette langue !
Il est donc certain qu'il y a eu au moins coexistence d'une littérature vernaculaire orale et d'une littérature latine. On possède des fragments d'une vie de saint Malo en vieil anglais ; la Vie de Brieuc précise que le texte en a été d'abord traduit du vieux breton par un latinier. La vie de saint Tudual vient aussi du vieux breton et il subsiste des traces de cette langue dans les vies de Turiau, Méloir, Goulven Le bifolio du Manuscrit de Leyde (VIIIe ou IXe siècle) comporte une trentaine de mots en vieux breton dans le texte principal. Si cette langue n'est pas réduite à un emploi secondaire comme dans les gloses, il ne s'agit pas d'un texte littéraire mais de quelques pages d'un traité de médecine latin.
Les tournures bretonnes modèlent parfois le latin qui adopte une syntaxe souvent plaquée sur celle du vieux breton (vies de Judicaël, de Guthiern, de Guénolée). Des textes comme ceux de Gérald de Galles (1146-1223), certaines vies de saints, font aussi référence aux "chanteurs d'histoire", les "cantores historici" du XIIe siècle, qui gardaient en mémoire des événements anciens et les célébraient dans leurs chants et on a pu démontrer la transmission orale de faits historiques sur neuf siècles, comme les invasions vikings sur le Yaudet (836) chantées encore au XIXe siècle! Ces cantores historici qui ont aussi véhiculé la matière de Bretagne à travers l'Europe, ne sont pas "nés" spontanément, ils ont certainement eu des prédécesseurs dont on n'a plus (pas encore) la trace ! C'est aussi dans les textes hagiographiques qu'on retrouve des références à des ouvrages très anciens, comme au Brittanicum, cette possible et ancienne compilation de la protohistoire bretonne.
Ces témoignages auxquels il faut joindre des annales, des chartes et des chroniques qui racontent plus spécifiquement les guerres entre les chefs bretons ou contre les comtes des marches, se retrouvent en particulier comme en d'autres lieux de l'ancienne Gaule, dans les cartulaires (Cartulaire de Redon, le cartulaire de Landévennec, le Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé ) qui composent une grande partie de la mémoire bretonne.
Le cartulaire de Redon, par exemple, contient les copies collationnées des titres de propriété foncière de l'abbaye de Saint-Sauveur, établissement monastique fondé à Redon en 832 par Conwoїon sous la protection du roi breton Nominoë. La collation a débuté dans la seconde moitié du XIe siècle, sous l'abbatiat d'Aumod (1062-1083). On possède d'ailleurs le nom de deux des copistes : Judicaël et Gwegon.
Ce cartulaire rassemble 391 actes en latin, sur 147 parchemins. Les noms propres sont en vieux breton, principalement ceux des témoins figurant au bas de chaque acte.
Les chartes concernent des domaines ou des terres situés un peu partout en Bretagne. Un bon nombre d'entre elles correspond à des biens qui se concentrent cependant dans la vallée de la Vilaine, à l'est du Morbihan actuel et à l'ouest du pays nantais.
Ces documents sont une source majeure d'informations pour la connaissance de l'histoire de la Bretagne à l'époque médiévale, en particulier au Haut moyen âge, ainsi que pour la toponymie et l'anthroponymie bretonnes comme en témoigne l'index du Cartulaire de Redon établi par le linguiste Bernard Tanguy qui regroupe 2100 noms de personnes et 800 noms de lieux. Ce cartulaire contient enfin des textes plus proprement littéraires.
Le Cartulaire de Landévennec provient pour sa part de l'ancienne abbaye de Landévennec. Il consiste en un volume de 164 feuillets de parchemin en deux parties :
- la première écrite au IXe siècle est composée exclusivement de documents hagiographiques, presque tous relatifs à Saint-Guénolé, le fondateur de l'abbaye.
- la seconde date des Xe et XIe siècle et contient des titres et documents diplomatiques relatifs aux droits et possessions de l'abbaye. Le texte latin intègre lui aussi de nombreux noms de lieux et de noms d'hommes en vieux breton.
Quant au Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé (XIe-XIIe siècle), il renferme également les documents se rapportant au fonctionnement de l'établissement (ventes, achats, donations, relations avec les autorités civiles et ducales) et une série de chartes remontant à la période de la fondation de l'abbaye (1026). Il contient des vies de saints comme la Vie de Saint Gurthiern (Goujarne) prétendue authentique et historique (1ère moitié du XIIe s.) ou la Vie de Saint Ninnoc (plus ouvertement légendaire), mais aussi des documents d'intérêt historique et littéraire tels qu'une Chronologie universelle de la création à 1314, des fragments de chronique et la préface de Gurheden, le moine auteur du cartulaire (jusqu'en 1128).
Les textes comptables, diplomatiques, ne concernent pas à proprement parler la littérature latine de Bretagne, même s'ils ont une haute valeur historique.
Tous les autres écrits subissent en revanche - comme les vies de saints ou les annales - un traitement littéraire. Leurs auteurs, leurs copistes connaissent plus ou moins la littérature antique, les exploits des héros romains ou grecs et le même phénomène d'intertextualité relie leurs ouvrages au bien commun culturel. Ils sont aussi au courant des légendes et des chants, des complaintes parcourant le pays et évoquant les grands moments de l'histoire. Là également, si leur but principal est de retenir par l'écriture la suite des événements, ils ne peuvent s'empêcher d'y mêler un style, une façon de faire influencée par ces derniers. Ils n'ont pu ne pas être marqués par les chants des bardes qui célèbrent (en breton et en latin) les exploits des chefs auprès desquels ils se trouvent. La réputation de certains d'entre eux a traversé les siècles : Turiau, à la fois savant et poète, Hoarvian, le père de Saint Hervé, harpeur et chanteur, le harpeur du duc Hoël Cadiou
La littérature latine de Bretagne n'existe en soi que dans la mesure où elle rend compte à la fois d'un "travail littéraire" et où elle s'imprègne de son milieu et de la culture vernaculaire ou pour le moins qu'elle est influencée par elle ou le substrat culturel qui la fonde, ce qui la distingue des autres littératures latines d'Europe. Son intérêt particulier consiste en ce qu'elle parle de la Bretagne ou/et est porteuse de caractères communs avec les cultures du Pays de Galles ou d'Irlande. C'est le cas par exemple lorsqu'on remarque la préservation dans les textes latins de noms bretons à formes archaïques (personnages, lieux ), de celticismes, d'une syntaxe calquée sur la syntaxe bretonne, l'utilisation dans la poésie et la prose d'une imagerie rappelant le matériel mis en uvre dans les vers héroïques gallois ou irlandais, des fragments de légendes, des rappels historiques, les gloses
Il est moins essentiel de souligner ce que les clercs bretons utilisent les mêmes techniques que leurs confrères de France ou d'Europe pour "orner" les textes, comme l'utilisation de références bibliques, ajout de commentaires, techniques qui n'ont rien de spécifiquement bretonnes.
Ainsi, la Bible et les commentaires de l'écriture sainte sont évidemment omniprésents par les citations qui égrènent les vies de saints par exemple, amenant une réflexion, illustrant un destin "ut ait propheta". La Vie de Malo contient ainsi 39 références bibliques. Des descriptions savantes donnent une coloration sacrée, car on reprend des images traditionnelles, des textes de prière comme l'antiphonaire de saint Grégoire (antienne chantée par les prêtres dans cette même Vie de Malo - L'Exultet inspirant la description des abeilles dans la Vie de Guénolé), le Bréviaire ou le Missel romain. Certaines vies (ou chapitres de vies) se closent sur des formules de louanges plaquées sur les doxologies (Vies de Guénael, Guénolé, Malo, Paul, Samson )
Comme dans toute la chrétienté, les Pères de l'Église sont souvent sollicités, de même que les uvres ascétiques et les historiens comme Bède (Historia Ecclesiastica) voire Gildas (De Excidio Brittaniae).
La culture des scribes et des clercs leur fait également avoir recours certes aux auteurs chrétiens comme Prudence (Uurmonoc, Vita Pauli Aureliani), Juvencus (Liosmonoc Libellulus sacerdotalis), Cassiodore (ses Institutiones dans la première Vie de Samson), Isidore de Séville (ses Sentenses chez Uurdisten, Vie de Guénolé), Caelius Sedulius, Cyprianus Gallus, , mais également aux auteurs profanes de l'Antiquité, bien entendu Virgile (Vie de Conwoïon, de Guénolé, de Magloire ), mais aussi Ovide (Vie de Magloire), Lucain (Vie de Guénolé et de Conwoïon ), Horace (Vie de Magloire ), Tertullien (Uurdisten, Guénolé).
Ratuili, l'évêque d'Aleth, décrit dans sa Gesta une tempête et se sert pour cela d'un passage de l'Énéide. Enfin, à côté de ces poètes, on trouve trace d'emprunts à quelques prosateurs comme Sallustre (première vie de Samson), Cicéron voire Homère.
Ces références sont d'ailleurs pensées comme toutes à l'honneur du saint dont il va être question : en commençant sa vie de Guénolé, Uurdisten énumère les noms prestigieux des auteurs sur lesquels il s'est appuyé, Augustin, Cassiodore, Grégoire, Jean Chrysostome , autant de gages de sérieux et de sacralité.
Ces enrichissements - qui sont d'ailleurs plus souvent des réminiscences que des citations -, ces ornements des textes et particulièrement des Vies - souvenirs de lectures profanes ou sacrées - forment une véritable intertextualité difficile à apprécier aujourd'hui, mais qui, à l'époque, établissait entre le créateur et ses lecteurs forcément cultivés une connivence source d'un probable plaisir littéraire.
*
Si l'on procède chronologiquement, cette littérature latine de Bretagne n'est elle-même avérée par des documents qu'à partir de la fin du VIIIe siècle, c'est-à-dire avec les débuts de la période carolingienne (la première Vie de Guénaël dont quelques passages subsistent, la première Vie de Samson, le fondateur de l'abbaye épiscopale de Dol - qui est peut-être du VIIe s. -, les fragments d'un poème en l'honneur de saint Tudval ou la Vita S. Ermenlandi ; quelques bréviaires). Ces indices témoignent d'une littérature hagiographique bien avant la période des exactions normandes. On sait que dès le IVe siècle des groupes d'insulaires traversent la mer avec des intellectuels comme Pelage (le premier écrivain latin d'Angleterre). Avec les colons des Ve et VIe s. se sont installés à l'évidence quelques lettrés dont on ne sait rien de tangible. La légende de Gildas, rapporte ainsi que l'auteur du De Excidio Britanniae (540-547) passa une partie de sa vie dans le Morbihan, voire qu'il y mourut. Mentionné par Colomban et Alcuin, il est lu avec un respect particulier au IXe siècle, admiré par Uurmonoc par exemple et un manuscrit de son ouvrage se trouve alors au Mont Saint-Michel. La Vie de Samson évoque aussi un prototexte : l'auteur rapporte avoir entendu un vieux moine lui lire le récit que le diacre Hénoc, cousin de Samson, avait fait de sa vie Ces lettrés ont été les précurseurs de la littérature latine de Bretagne.
Il existe certes de nombreux écrits latins plus anciens, mais qui ne se rattachent pas à ce que nous considérons être la littérature latine de Bretagne.
Pour les IXe et Xe siècles, un important corpus de manuscrits latins d'origine bretonne contenant parfois des gloses en ancien breton est en voie d'évaluation, mais les recherches sont encore insuffisantes. Il s'agit, comme on pouvait s'y attendre d'une majorité écrasante de textes religieux (écriture carolingienne - minuscule caroline - combinée à des abréviations et caractéristiques insulaires). Paul Fleuriot chiffrait naguère leur nombre à environ 150, mais les manuscrits ayant été dispersés, recopiés, intégrés à des textes plus tardifs, ce nombre devrait être beaucoup plus élevé. Ce corpus permet cependant d'avoir une bonne idée de ce qui était copié, étudié et composé dans la Bretagne carolingienne même si la plupart de ces textes (hormis le code de lois Excerpta de Libris Romanorum et Francorum) n'existent pas à l'état original et ne se trouve souvent que comme fragments intégrés à des manuscrits plus tardifs.
Ces témoignages du IXe et Xe siècle ont survécu dans des bibliothèques monacales le plus souvent hors Bretagne (à Fleury, par exemple, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ) où ils ont été transportés lors des invasions normandes, rappelons le sac de Landévennec en 913 et l'exil des clergés de Dol, Léhon, Redon, les moines sauvant les reliques de leurs saints et leurs manuscrits les plus précieux. Ces moines bretons poursuivront d'ailleurs quelque temps la tradition de la glose bretonne dans les nouveaux centres où ils s'installeront, mais guère plus tard qu'au début du XIe siècle.
Ce corpus comprend un grand nombre de livres, de chants religieux, de grammaires, de computus ou comput (le calcul des dates de fêtes mobiles, avec ses spécificités bretonnes), de canons ainsi que des textes d'auteurs chrétiens comme Isidore de Séville, Paulus Orosius, Grégoire le Grand, Johannes Cassianus, l'élève d'Alcuin, Amalarius de Metz voire des écrivains de l'Antiquité comme Virgile ou Boèce. On trouve aussi une série d'ouvrages d'éducation chrétienne et de droit (Collectio Canonum Hibernensis), et le De Excidio et Conquestu Britanniae de Gildas.
Les compositions littéraires originales concernent :
quelques chants comme L'Hymne à Saint Guénolé (857/884) de Clément de Landévennec (Cartulaire de Landévennec) qui fera qu'on attribuera aussi à ce même moine Clément la Vita Winwaloei (Vie de Saint Guénolé, important témoignage sur la vie quotidienne), les bréviaires de Saint-Gatien et de Marmoutier (débuts IXe s.), le bréviaire de Landévennec (IXe s.), celui de Berne (Xe s.) ainsi que le Bradfer-Lawrence gospels (Cambridge, IXe s.), le Bréviaire breton (probablement originaire de Landévennec, se trouvant à Oxford, Xe s.)
les vies de saints avec leur déroulement traditionnel : une préface précisant les intentions du narrateur, la présentation du saint (origines familiales, naissance, enfance, éducation, activités sacerdotales, voyages, miracles, la mort et les merveilles qui suivent.
La Vita Machutis (évêque d'Aleth) de Bili, le disciple de Ratuili (Vie de Saint-Malo, 866/872), la Gesta Conwoionis et aliorum sanctorum Rotonensium, 866/872 de l'évêque d'Aleth, Ratuili, la Vita Winwaloei (Guénolé, fondateur de Landévennec - 880) de l'abbé de Landévénec Uurdisten, la Vita Pauli Aureliani (Saint Paul évêque du Léon), de Uurmonoc (884)..., la Vita Conwoionis, Xe s. probablement, la Vita Corentini, IXe, mais peut-être plus tardive, la Vita Budoci (Budoc, Xe), la Vita Guenaili (Guénael, successeur de Guénolé à Landévennec, IXe voire plus tôt), la Vita et translatio S. Guenaili (Xe s.), la Vita Idiuneti alias dicti Ethbini (Saint Idunet, Xe, voire plus tôt, ou XIe), la Vita Iudoci (Judoce, IXe s.), la Vita I S. Machutis (première Vie de Malo, débuts du IXe s.), la Vita et translatio S. Machutis (Xe s.), la Vita I S. Melanii (première vie de Melaine, début IXe s.), Vita, translatio et miracula S. Maglorii (Magloire, l'ascète de Sercq, IXe/Xe s.), Vita et miracula S. Martini Vertauensis (Martin de Vertou, IXe s.), la Vita S. Osmannae (Osmanne, IXe s.), la Vita Petroci (Petroc, Xe s.), la Vita Ronani (Ronan, Xe s.), la Vita II S. Samsonis (2e vie de Samson, IXe/Xe s.), la Vita I Turiaui (1ère vie de Turiau, évêque de Dol, IXe s.), la Vita II Turiaui (2e vie de Turiau, Xe s.), la Vita I S. Tutguali (1ère vie de Tudval, IXe), la Vita II Tutguali (2e vie de Tudval, moine de Tréguier, IXe/Xe s.), la Vita I S. Winwaloei (1ère vie de Guénolé, IXe s.), la Vita S. Wohednouii (Gueznou, Xe s.).
des textes poétiques comme le Libellulus sacerdotalis attribué à Lios Monocus (Liosmonoc) dans la tradition de la poésie hispérique (le "latin hispérique" était une sorte de littérature latine où se joignaient le jeu et l'érudition, l'adjonction de mots grecs et hébreux, créé par des moines irlandais entre les VIe et Xe siècles).
un petit ensemble d'annales fragmentaire (Annales Rotonenses, par exemple, récemment découvertes et rééditées) et de textes historiques disséminés.
Ajoutons quelques lettres comme la "Lettre à Athelstan, roi d'Angleterre" par Radbod de Dol (vers 927) et les textes liturgiques des missels comme le Sacramentaire d'Angers (Xe).
Les vies de saints sont donc essentielles par le nombre et la qualité, comme dans les périodes suivantes. L'hagiographie avait un but évident : édifier, ce qui autorisait en particulier les rapprochements, voire les emprunts avec les textes les plus connus de la tradition chrétienne, comme nous l'avons indiqué plus haut. Ceci n'est d'ailleurs en rien une spécialité bretonne, mais bien un phénomène qui se prolongera longtemps encore en tout bien tout honneur, la notion de "plagiat" étant une notion moderne. Quelques auteurs des vies sont connus : nous les avons cités : Matmonoc, Bili, Uurmonoc, Uurdisten, Liosmonoc, dont on sait encore qu'il se fixa à Fleury et y composa probablement son Libellus sacerdotallis (dont il reste 500 hexamètres), Clément de Landévennec , nombreux sont les anonymes, ce qui tend à faire penser que ces vies sont des objets de diffusion courants.
Ces récits - examinés et critiqués par Dom Lobineau au XVIIIe siècle - qui courent sur des légendes et des faits fabuleux imprégneront l'imaginaire breton après avoir donné au peuple des campagnes son organisation en paroisse (Plou) avec ses subdivisions (Tre et Lan) et ses traditions, car des versions racontées en langue vernaculaire circulent bien avant les traductions en français au XVIIe siècle par le dominicain de Morlaix Albert Legrand. Ils mettent en scène des personnages aussi fameux que le roi Gradlon et sa fille, la ville d'Is, les moines traversant la mer dans des auges de pierre, appelant la colère des cieux sur les chefs impies, combattant monstres et animaux merveilleux, faisant des miracles, conseillant les princes, fondant des évêchés nouveaux (Vita Melanii ). En même temps, les vies sont le recueil d'une histoire, nécessaire, car elle donne ses racines à la société, et fournit la justification, par exemple, de la richesse de certaines abbayes, du pouvoir de certains abbés et des princes
Aux XIe-XIIe siècle, cette période noire pour la culture latine de Bretagne (et probablement pour d'autres documents en langue bretonne, que les clercs jugèrent inutiles d'emporter avec eux dans leur exil) est terminée et l'emprise de l'Église sur la vie intellectuelle est plus forte que jamais. De nouvelles vies de saints sont écrites, les plus anciennes sont recopiées et parfois réécrites, améliorées, ornées, versifiées. De nouveaux cartulaires sont commencés et on compose des manuscrits liturgiques.
C'est une époque qui voit apparaître des annales (Annales de Redon, XIe s.), quelques textes historiques, des récits qui sont souvent intégrés à des vies de saints recopiées comme dans les vies de Guénolé, de Gueznou, de Samson, de Gildas ou la Vita Iudicaeli d'Ingomar de Saint-Méen. Ces passages historiques sont cependant d'une transmission tardive et parfois problématique pour leur datation. Ainsi, la Chronique de Nantes (Chronicon Namnetense dont la rédaction se situe entre 1050 et 1060 - histoire épiscopale basée sur les archives de la cathédrale, peu favorable aux Bretons) se trouve en partie dans la Chronique de Saint-Brieuc (fin XIVe siècle) et en partie dans l'Histoire de Bretagne de Pierre Le Baud (1480). La Chronique de Dol (XIe s.) et celle de Quimperlé sont à l'état de fragments.
Le Livre des faits d'Arthur (Xe), qui est d'abord un texte poétique (incomplet), dans lequel est donnée une vision historico-légendaire du Léon est connu à partir d'un manuscrit déposé aux Archives Départementales de Rennes et qui devait faire partie des matériaux collectés par Le Baud pour son histoire. Il est possible qu'il soit originaire du XIe siècle, bien que des travaux récents aient tendance à lui donner une date de composition plus tardive
Les Vies sont très nombreuses.
À côté d'Ingomar de Saint-Méen, probablement, en plus de sa célèbre et très historique Vie de Judicaël, au moins l'auteur de la Vita Mevenni (Vie de Méen), plus encore de textes anonymes, forgés dans les scriptoria : les vies de Brieuc (Vita Briocii - XIe s.), de Budoc (Vita Budoci, XIe-XIIe), Conwoion (Vita Conwoionis, X/XIe s.), de Corentin (Vita Corentini, IXe ?, XIe ?, XIIIe ?), de Cunwal (Vita Cunwali), la Vita et miracula Lauri (Laurent, XIe voire plus tôt) la Vita II S. Melanii (XIe s.), l'Altera translatio S. Maglorii (XIe s.), la Vita S. Euflami (Efflam, XIIe s.), la Vita I S. Gildae (1ère vie de Gildas, XIe s.), la Vita II S. Gildae (2e vie de Gildas, XIe s.), la Vita et historia inuentionis et miraculorum S. Gilduini (Gilduin de Combeur, XIIe s.), la Vita S. Golueni (Goulven, XIIe s.), la Vita S. Goneri (Gonéri, XIIe s.), la Vita S. Gulstani (Goustan, XIe s.), la Vita Gurthierni (Goujarne, XIIe s.), la Vita S. Hamonis (Hamon, fin XIIe s.), la Vita I S. Leonari (1ère vie de Léonor), la Vita I S. Maudeti (1 ère vie de Maudez, XIe s.), la Vita II S. Maudeti (2e vie de Maudez, fin XIIe s.), l' Altera translatio S. Maglorii (Magloire, XIe s.), la Translatio S. Matthaei (Matthieu, XIe s.), la Vita II S. Melanii (Melaine, XIe s.), le Miracula S. Melanii (Miracle de Melaine, XI/XIIe s.), la Vita I Melori (1ère vie de Méloir, XIe s.), la Vita II Melori (2ème vie de Méloir, XIIe s.), la Vita III Melori (3ème vie de Méloir, fin XIIe s.), la Vita Mereaduci (Mériadec, XIIe s.), la Vita Meuenni (Méen, XIe s.), la Vita S. Ninnocae (Ninnoc, XIe s.), la Vita III S. Tutguali (3e vie de Tudval, XIe s.), la Vita de S. Wohednouii (Goueznou, 1019) À ces vitae, souvent doublées de versions métriques, ajoutons les Litanies des saints bretons disséminés dans plusieurs bibliothèques.
Des missels et bréviaires comme celui de Saint-Georges de Rennes (XIe s.) ou de l'abbaye Saint-Melaine de la même ville (XIIe s.), le Sacramentaire breton (XIe s.), celui de Saint-Méen (XIe s.), le calendrier de Landévennec (XIe s.), contiennent bien entendu prières, homélies, calendriers, hymnes et chants pour la période envisagée.
En cette époque favorable, que l'on a qualifiée de renaissance du XIIe siècle, où partout en Europe commencent à fleurir des littératures en langues vernaculaires, on assiste au début de l'effacement de cette littérature latine de Bretagne.
En effet, le latin conserve et développe son rang de langue internationale, soutenu par le mouvement des écoles de cathédrale et par les créations d'universités. Les intellectuels se déplacent et correspondent davantage. Cet aspect cosmopolite, qui touche forcément la littérature latine de Bretagne fait que d'une part cette littérature - en dépit de sujets touchant à la Bretagne comme la Lamentation sur la mort de Geoffroy II, comte de Rennes (1186) - n'est évidemment plus en rien différente de tout ce qui se compose alors ailleurs.
D'autre part, des auteurs réputés sur le plan européen, nés en Bretagne ou y ayant passé une grande partie de leur vie produisent des uvres latines qui ne sont pas toujours liées à la Bretagne par leurs contenus, styles ou provenance, mais qui partagent cette vocation cosmopolite : Baudry de Bourgueil (1107-1130), Pierre Abélard (1079-1142), Jean de Châtillon, Marbode, l'évêque de Rennes, Robert d'Arbrissel, Anselm ou Bernard et Théodoric de Chartres...
Le premier, archevêque de Dol (né à Meung-sur-Loire en 1060, mort en 1130), est l'auteur de vies de saints comme l'Historia translationis capitis S. Valentini martyris (1153-1164), la Vita S. Hugonis Archiespiscopi Rothomagensis (1163-1172), la Vita S. Roberti de Abrisello (1043-1058) pleine d'enseignements historiques, culturels et religieux, la Vita S. Samsonis, de textes historiques (Hierosolymitae historiae, sur la première croisade), de poésies religieuses comme les Carmina. Il écrit une longue lettre Itinerarium sive epistola ad fiscannenses aux moines de Fécamp pour les remercier de l'avoir reçu plusieurs fois dans laquelle il donne une description enthousiaste de Fécamp et de son monastère. Son De scuto et gladio S. Michaelis tente d'expliquer les sources du culte de Saint-Michel en Bretagne et l'auteur s'interroge sur les reliques déposées au Mont Saint-Michel.
Le célèbre Abélard, né près de Nantes, qui fut un temps abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys, est l'auteur d'une uvre qui dépasse le cadre de cet article et qui a eu une célébrité universelle. On ne retiendra que son Historia calamitum et les passages se rapportant au malaise éprouvé par cet intellectuel naguère fêté à Paris incapable de s'adapter aux usages rustres pour ne pas dire plus des moines bretons. Abélard raconte à un de ses amis ses difficultés à s'intégrer à cette abbaye de Saint-Gildas où il a choisi de s'exiler pour échapper à "la malveillance des Francs", lui qui était une sommité des écoles de Paris et qui devait subir l'implacable vengeance de Fulbert. Ce texte littéraire, autobiographique, donne une image peu favorable des Bretons, de la Bretagne : "une terre barbare, une langue inconnue, une population brutale et sauvage" et des moines aux "habitudes de vie notoirement rebelles à tout frein".
Jean de Chatillon, évêque de Saint Malo, est pour sa part l'auteur de lettres à Saint-Bernard et probablement, si l'on suit Ferdinand Lot d'une Vita de saint Malo, comme son prédécesseur à Aleth, Donoald, abbé de Saint-Melaine, qui aurait écrit une vie perdue de saint Suliau, dont quelques fragments se retrouvent dans des légendaires et bréviaires du XVe s.
On relira encore la célèbre Lettre de Robert d'Arbrissel (1047-1117) à la comtesse Ermengarde, l'épouse d'Alain Fergent, qui forment un ensemble de préceptes pour mener une vie conforme à la religion.
Marbode (1035-1123), évêque de Rennes, était originaire d'Anjou. Nommé évêque en 1096, il reste à Rennes jusque vers 1120. Ses démêlés avec Robert d'Arbrissel sont restés célèbres. Il est l'hagiographe de Licinius, l'évêque d'Angers, de Gualterius, de Robert, abbé de La-Chaise-Dieu, de Magnobod, de Florentius de Glonne. Il a aussi composé de très nombreuses poésies : religieuses inspirées de l'Ancien Testament et de martyres ou passions de saints en hexamètres, didactiques et grammaticales, autobiographiques (Liber decem capitulorum) ses Carmina varia (poèmes de circonstances), épigrammes et épitaphes. Son fabliau Le loup qui s'est fait moine (Parabola de fraude a lupo opilioni facta) donne des Rennais et de leurs murs une image satirique.
Enfin, on a de lui six lettres "administratives", dont une à Robert d'Arbrissel et une à Rainald de Martigné.
Si l'on considère les noms qui viennent d'être cité, on constate à cette époque une volonté d'appropriation de l'Hagiographie par l'épiscopat, qui correspond à une reprise en main par le dogme romain et aussi au désir de suppléer à un déficit causé principalement par le faible encadrement monastique en Basse-Bretagne qui bien que compensé graduellement sera encore longtemps insuffisant. En Haute-Bretagne, les évêques se méfiant des scriptoria se sont plus volontiers tournés vers leurs chapitres cathédraux, mieux aptes à défendre leurs intérêts et à donner des saints une vision moins populaire pour ne pas dire entachée de paganisme. Ils ont alors écrit eux-mêmes ou proposé des canevas à leurs scribes. L'uvre hagiographique de Marbode comprend une douzaine de vies (mais de saints non liés à la Bretagne hormis la possible relation d'un miracle posthume de saint Melaine). Baudri de Bourgueil serait, en plus des ouvrages indiqués à l'origine de la vita de saint Gobrien.
Évêque d'Aleth, Judicaël est l'auteur des vies de son patron Judicaël, de Méen et de Léry. Donoald qui siégeait à Aleth vers 1120-1142, écrit sans doute la vita de saint Suliau. Jean de Châtillon, évêque de Saint-Malo rédige une vita du saint patron de la cité. A Tréguier, on doit certainement à Martin, chapelain du comte d'Anjou puis chanoine du chapitre cathédral d'Angers, évêque de la ville entre 1049 et 1052-1054, l'initiative de la composition de la vita moyenne de saint Tugdual. Son successeur Hugues, évêque de Tréguier vers 1086, est probablement l'auteur de la première vita de saint Maudez et de la vita de saint Efflam. La vita longue et la vita brève de saint Tugdual, continuent au XIIe siècle la production hagiographique de Tréguier alors qu'à Saint-Pol-de-Léon, Omnès, évêque du Léon vers 1047-1055 aurait écrit la première vita de saint Mélar. A Quimper, l'évêque Robert (1113-1130), est auteur de la vita de saint Ronan et d'un ouvrage sur les miracles de saint Corentin. À Vannes, Morvan, qui successeur de l'évêque Mengui pourrait avoir été à l'origine d'une vita de saint Patern
Cet accaparement par l'épiscopat de la matière hagiographique s'accroît vers le milieu du XIIe s. et les saints, même les plus "locaux", sont désormais le plus souvent revêtus des dignités épiscopales comme saint Gobrien, présenté en qualité d'évêque de Vannes, Goëznou, Goulven, Jaoua et Ténénan, dont les vitae respectives ont été composées à l'occasion de l'établissement du catalogue épiscopal par un certain Guillaume, membre du chapitre cathédral de Saint-Pol-de Léon. Ces habiles "récupérations" sont destinées à donner tout son éclat aux évêchés et par là-même à renforcer leur puissance séculaire et spirituelle, l'aspect littéraire étant secondaire.
Notons encore ces écrivains plus tardifs qui, le plus souvent hors de Bretagne poursuivent leur uvre comme au XIIIe siècle Guillaume Le Breton qui, à la cour de Philippe-Auguste est l'auteur d'une geste et d'un poème épique latins en l'honneur du souverain, la Gesta Phillipi Augusti et le Philippidos, ou ces auteurs très fortement soupçonnés d'avoir des attaches bretonnes comme Alain de Lille (ou de l'Île = Ouessant ?) (1128-1202), Adam de Saint-Victor (1070-1146), Alfred de Beverley (autour de 1145), dont l'uvre n'a pas encore été suffisamment étudiée dans le sens des "bretonismes", d'une couleur locale celtique qu'elles pourraient renfermer. Etienne de Fougères, évêque de Rennes de 1168 à 1178, chapelain du roi Henri II Plantagenêt, poète à ses heures, à la suite d'une illumination, écrit les vitae de Guillaume Firmat, l'ermite ayant séjourné un temps près de Vitré et de Vital de Tierceville, dit de Mortain voire celle de Hamon de Landécot, originaire de Saint-Etienne-en-Coglès
*
L'Historia Regum Brittaniae de Geoffroy de Monmouth (vers 1135) est paradoxalement le signe le plus évident de cet effacement de la culture latine de Bretagne au profit d'un courant cosmopolite : son succès est tel qu'il véhicule la "matière de Bretagne" dans toute l'Europe occidentale et que les sources dont il s'est servi sembleront longtemps être des imitations de l'imitateur ! En France particulièrement, il inspire les romances et les lais, ceux de Marie de France par exemple.
Pour notre propos, il est peu intéressant de savoir si Geoffroy de Monmouth est d'ascendance bretonne ou originaire de Cornouailles. Nous savons que les relations entre cette région et la Bretagne sont étroites tout au long des siècles et il est certain que l'Historia appartient pour une part à cette littérature latine de Bretagne dans la mesure où Geoffroy donne bien des aspects des traditions et mentalités bretonnes même s'il visait une audience large, dépassant les limites de la France de l'Ouest. On peut dire la même chose du commentaire de Jean de Cornouaille sur les Prophéties de Merlin (Prophetia Merlini - vers 1155). Ces ouvrages et les imitations, développements auxquels ils donneront lieu ont le mérite d'avoir suscité un grand intérêt chez les intellectuels pour les traditions celtiques, ce qui aura d'ailleurs pour conséquence de pousser ensuite certains auteurs bretons à reprendre à leur compte et dans leur langue vernaculaire des aspects de cette "matière bretonne".
L'Historia regum Brittaniae et la Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth situent un certain nombre des aventures d'Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde dans les forêts de l'Armorique, à Brocéliande et il intègre à ses uvres certaines des légendes de ces régions, tant le sentiment de la parenté entre les Bretons des deux côtés de la Manche restait encore vif au XIIe siècle ! La vie d'Arthur se déroule à Caerlleon et s'achèvera à Glastonbury, près du tombeau de Joseph d'Arimathie. A Penmarc'h, à Carhaix vivait Yseult aux mains blanches
Bien entendu, Geoffroy n'est pas l'inventeur d'Arthur pas plus que les clercs ayant rédigé et apprêté les vies de saints n'en sont les auteurs au sens propre, en des temps où l'écriture recueille surtout la tradition orale et la met en forme. On peut évoquer en amont de ces créations écrites, une matière que le souvenir et l'imagination du peuple et des bardes n'ont cessé de remanier, d'élaborer.
Geoffroy de Monmouth est aussi l'auteur ou le vulgarisateur de la légende de Conan Meriadec, le fondateur imaginaire d'un royaume breton d'Armorique dès la fin du IVe siècle, mais là encore la mémoire et l'imaginaire ont certainement précédé la rédaction (on parle d'un très ancien manuscrit gallois), ce qui fait que ces textes, même écrits en langue savante, viennent corroborer, fixer, revivifier des légendes sans doute encore assez répandues, prêtes à leur tour à les transmettre à d'autres écrivains en langues vernaculaires.
L'écriture comme les traditions subissent ainsi un continuel va-et-vient entre la réalité, la légende colportée oralement, les traditions et l'écriture, une sorte d'association à bénéfices réciproques.
Évoquer la qualité de cette littérature est impossible d'une façon globale et conduirait à des jugements de valeur dénués de sens. Pourtant, F. Kerlouégan, sur le plan formel, tout comme le professeur Fleuriot, ont souligné la bonne tenue des textes et en conséquence le bon niveau de culture des auteurs : la langue est exacte même si le bilinguisme des écrivains affleure parfois, la morphologie et la syntaxe sont également correctes. Si les néologismes et des traits de langue vulgaire ne sont pas rares, il faut peut-être davantage y voir une volonté stylistique, une recherche de couleur locale qu'un signe de médiocrité. On peut être plus sévère pour les vies versifiées ou les passages de poésies intégrées aux vies de saints.
La culture des clercs est également assez diverse, comme nous l'avons rapidement évoqué, culture religieuse bien entendu, mais aussi culture profane. Il est vrai que la quasi-totalité des documents dont nous disposons se situent après les réformes carolingiennes et il serait intéressant de pouvoir déterminer si les moines bretons ont bénéficié de ces réformes ou si déjà, bien avant elles, ils avaient su conserver un certain niveau.
Ce qui est certain, c'est que tous ces textes, en particulier les vies de saints, ont très longtemps modelé les consciences en Bretagne et au-delà.
Éléments de bibliographie
* On se reportera au site de la Royal Irish Academy présentant les Archives of Celtic Latin Literature (400-1200) qui offre la possibilité de consulter en ligne plus de 400 textes dont de nombreux manuscrits appartenant à la littérature latine de Bretagne.
Balcou, Jean, Le Gallo, Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, Honoré Champion, Paris, 1997 (particulièrement les articles de Léon Fleuriot et de François Kerlouéarn),
Bourges, André-Yves, La production hagiographique et l'atmosphère religieuse en Bretagne aux XIe et XIIe siècles, 2006.
Lapidge, Michael, Sharpe, Richard, A bibliography of celtic-latin literature 400-1200, Dublin, 1985.
Brett, Caroline, "Breton latin literature as evidence for literature in the venacular, A.D. 800-1300", in : Cambridge medieval celtic studies, nr 18, p. 1-25, 1989.
La Borderie, Arthur de, Histoire de la Bretagne, Paris, 1896-1906.
Fleuriot, Paul
Manitius, Max, Geschichte der lateinischen literatur des Mittelalters, Munich, 1911-1931.
Celtomanie, celtophilie, celtologie, celtomanie, teutomanie...
L'image du Breton: de la satire à la quête anthropologique
Dom Deschamps, le philosophe sous la bure.
Léger-Marie Deschamps voit le jour le 10 janvier 1716 à Rennes, cinquième de neuf enfants. Ses parents appartiennent à la toute petite bourgeoisie de la ville. Son père Claude Deschamps a acquis la charge de sergent royal, c'est-à-dire d'huissier au présidial de Rennes (mais sa signature dénote un homme instruit), et sa mère, Élisabeth Le Bail, exerce le métier de mercière dans une échoppe du centre-ville. Léger-Marie est inscrit au célèbre collège des jésuites où il poursuit une scolarité sans histoire apparemment. Le 8 septembre 1733, il entre chez les bénédictins mauristes en l'abbaye Saint-Melaine, et un an plus tard, il quitte la Bretagne. On a pu penser que l'enfant de quatre ans avait été marqué par l'incendie qui ravagea le centre de la ville, mais cela suffit-il pour faire de lui un nouvel Érostrate qui, sa vie durant mettra le feu aux temples des idées reçues ? Il est un fait que la métaphore du feu, le verbe même "brûler" reviennent souvent dans ses écrits : "Jetons au feu nos vains fatras de lois", écrit-il ainsi dans ses Observations morales.
Dom Deschamps poursuit sa formation intellectuelle dans plusieurs maisons de la congrégation de Saint-Maur, en Touraine et en Anjou. De 1743 à 1747, sa présence est attestée à l'abbaye de Marmoutier et à celle Saint-Julien de Tours, où il collabore aux travaux d'historiographie de la Touraine, mais on sait qu'au cours de ces années il mettait à profit la belle saison pour poursuivre ses recherches dans différents couvents et prieurés de la région. Ses travaux sont conservés dans les treize premiers tomes de la Collection de Touraine consacrés à l'histoire de la province : copies de chartres, extraits de cartulaires et de chartriers seigneuriaux. Les trois tomes réservés à l'Histoire littéraire de Touraine renferment des notices originales - toutes de sa main - et particulièrement travaillées sur les auteurs tourangeaux. Leur lecture indique un intérêt particulier pour la littérature et une finesse de jugement peu commune.
Cette période de sa vie est importante, car il est confronté à l'histoire des lois et il consigne les excès de cette société, les ignominies commises et autorisées ces hommes qui vendent leur frère ou leur sur par exemple, les corvées exorbitantes, le système punitif des règles cénobitiques auxquelles il accorde une attention particulière. Il est également archiviste, généalogiste, juriste et sa réputation devait être grande puisque les personnes en quêtes de leurs origines s'adressaient régulièrement à lui comme en témoigne sa correspondance. On sait en outre combien, sous l'Ancien régime, l'historiographie, la généalogie servent à établir et authentifier les droits dans les conflits d'intérêts que suscite la jungle des privilèges, des usements et des coutumes. L' "état de murs" dont rêvera toute sa vie Dom Deschamps, sera en effet pour une part l'accomplissement du refus de ces lois privées sur lesquelles reposent les sociétés et du système inégalitaire en droits et en biens qu'elles sous tendent.
Cet érudit aurait commencé à s'intéresser à la philosophie au cours des années 1740. Il semble d'ailleurs qu'il ait rompu assez vite avec l'historiographie. Alors qu'il est revenu en Bretagne pour occuper les fonctions de procureur de l'abbaye de Quimperlé, il écrit à un missionnaire capucin, correspondant de Dom Morice, le père François-Marie Le Gallen : "Dans le temps que je faisais le métier d'historien ( )", comme si cette activité remontait à des années.
En 1747, en effet, il est rentré en Bretagne et passe par plusieurs monastères pour y effectuer des périodes de retraite à sa demande. Á partir de 1749, il est en poste à Quimperlé où il restera huit années. Cette période bretonne de réflexion a été celle où il a élaboré les grands traits de son système philosophique avec deux uvres principales : les Observations métaphysiques et les Observations morales, système qu'il mettra au clair à son retour en Touraine. Il écrira à Rousseau en 1761 avec une grande confiance en soi : "La vérité est la chose du monde la plus simple, mais comme nous sommes des êtres fort éloignés du simple, par la mauvaise tournure qu'a prise notre état social, sa découverte m'a coûté bien des années de réflexion, et j'ai noirci plus de deux rames de papier pour parvenir à faire un ouvrage peu volumineux. Je jouis aujourd'hui de mon travail, car je vois que ce qui m'a coûté beaucoup est si bien démontré, et rendu d'une façon si convaincante, qu'il coûtera peu aux autres", ce qui montrerait qu'il considère à cette date l'essentiel de son travail comme accompli, mais ses textes seront constamment remaniés au cours de sa vie. Deschamps est une réflexion qui se construit continuellement et, comme il veut convaincre, il est amené à prendre la mesure de ses interlocuteurs et à modifier ce qu'il a écrit pour en rendre l'accès plus aisé, car ses idées ne sont pas aussi simples qu'il le prétend.
Les seules publications qu'il s'autorisera - sous le couvert de l'anonymat - seront les Lettres sur l'esprit du siècle (1769) et La voix de la raison contre la raison du temps (1770) qui permettent de dater deux moments de sa pensée.
En 1757 donc, il est nommé secrétaire du chapitre et procureur du prieuré Saint-Pierre de Montreuil-Bellay dans le Saumurois où il est chargé de l'intendance et de la gestion des biens. Cet établissement de petite dimension (son "petit moutier"), qui ne comptait que quatre religieux, sera une retraite idéale puisqu'il disposera de suffisamment de temps pour poursuivre son uvre philosophique sans toutefois négliger ses fonctions : les archives du Maine-et-Loire conservent de nombreux mémoires et procédures témoignant de son engagement pour défendre sa communauté. À sa mort, ses confrères regretteront aussi en lui le sauveur du moutier, que des inondations avaient ruiné et qu'il remontera. C'est dans ces années qu'il fera la rencontre décisive de sa vie, celle du marquis Marc-René de Voyer d'Argenson (1722-1782), héros de Fontenoy, lieutenant général, personnage non-conformiste et philosophe dans l'âme.
D'Argenson reconnaîtra immédiatement dans ce moine un esprit frère, une intelligence prodigieuse et un manieur d'idées incomparable. Il lui offrira son amitié, son admiration et sa protection : c'est grâce à lui que le modeste bénédictin commencera à sortir de l'ombre et aura les contacts qu'il mérite.
Les deux hommes se sont vraisemblablement rencontrés en 1759 au château des Ormes, résidence des d'Argenson, non loin de Montreuil-Bellay, sur les terres duquel se trouvait l'abbaye de Noyers que fréquentait régulièrement Dom Deschamps. Au cours des dix dernières années de sa vie, il passe une bonne partie de son temps aux Ormes, s'occupant même de la gestion du domaine quand le marquis est en déplacements. La petite société qu'à la suite de son père ce dernier y accueille a été appelée "l'Académie des Ormes" : des académiciens, de philosophes, Moncrif, Voltaire y séjournent même si les Ormes doivent être aussi considérés comme un lieu d'exil pour un marquis dont le scepticisme, les fréquentations et les options sociales ne vont pas sans agacer le pouvoir. En outre, l'époque est difficile. La guerre de Sept ans d'abord et puis l'attitude du pouvoir qui est moins bienveillante vis-à-vis des philosophes. L'attentat de Damiens en 1757, les renvois de Machault et de d'Argenson, le père du marquis, la même année ; l'édit d'avril 1757 prononce la peine de mort contre auteurs et imprimeurs de livres non autorisés ; Palissot attaque les philosophes avec ses Petites lettres sur les grands philosophes ; en 1758, Helvétius se rétracte dans l'affaire soulevée par son De l'Esprit. Après sa brouille avec Diderot, Rousseau va rompre avec la "coterie holbachique", avec les encyclopédistes, que d'Alembert abandonne également comme Duclos et Marmontel. En 1759, l'Encyclopédie est interdite par arrêt du conseil d'État. Diderot s'accroche à l'uvre de sa vie, mais renonce à rendre publics certains de ses travaux. Si d'Holbach traduit et publie, c'est sans se faire connaître et la réaction chrétienne prend de l'ampleur dans les années soixante. Voltaire s'installe à Ferney ; L'Émile est brûlé à Paris et à Genève où on voue également au feu Le Contrat Social
Pendant ses séjours en son prieuré ou aux Ormes, Deschamps ne reste pas tout à fait en dehors de cette agitation. D'abord, il circule continuellement : Poitiers, Angoulême, Saumur, Le Mans, Paris Ensuite, grâce à d'Argenson, il est entré en contact avec certains grands philosophes, mais sur le plan de la pensée, comme de nombreux auteurs bretons de son époque (Kéranflec'h, André ), il est resté marqué par Malebranche et demeure un métaphysicien convaincu (même si sa métaphysique est très particulière) tandis que la philosophie se veut alors avant tout empiriste, pratique et que les spéculations pures paraissent appartenir à un autre temps. Un maître mot de la philosophie est celui de progrès. On pense que l'avenir, à condition d'y travailler, verra la vie s'améliorer : progrès scientifique, progrès des savoirs, progrès moral, parfois progrès social , les Lumières chasseront petit à petit les ténèbres et le philosophe travaille à leur propagation. Dom Deschamps songe, lui, à un "état de murs" qui sera aussi un monde parfait, mais pour y parvenir, il ne voit qu'une solution aussi radicale que lorsque l'incendie de Rennes détruisit le labyrinthe de ruelles sinueuses et de bicoques du centre-ville pour laisser place à une cité tirée au cordeau par les soins de l'architecte Gabriel. L'"état de murs" doit naître d'une révolution complète et cartésienne au sens de la tabula rasa : "Il faudrait, pour y entrer, écrit-il dans ses Observations morales, brûler non seulement nos livres, nos titres et nos papiers quelconques, mais détruire tout ce que nous appelons les belles productions de l'art".
Pour cela, si Deschamps ne paraît pas avoir tenu à la gloire littéraire (encore que ses lettres témoignent de son désir de publier son grand uvre), il entend faire des adeptes et délivrer selon son expression "le mot de l'énigme métaphysique et morale". Il ne se conçoit ni comme un songe-creux ni comme un utopiste et croit dur comme fer à la réalisation de son projet. Dès 1761, Deschamps peut, grâce à l'appui de son protecteur, commencer ses Tentatives sur quelques-uns de nos philosophes, au sujet de la vérité (suivant le titre du dossier dans lequel il rassemble ces expériences), tentatives qui n'ont pas pour but un simple échange philosophique, mais la conversion de ces philosophes à la Vérité pour démultiplier et renforcer son message ! Les remarques qu'il consigne dans ce dossier attestent à la fois de son amertume et d'une confiance en soi qui touche à l'impudence pour ne pas dire à une certaine mégalomanie. Mais cette "Vérité même", comme il intitule aussi sa doctrine, rebute la plupart des contemporains auxquels il a tenté de la dévoiler, parce qu'elle est trop inouïe, trop complexe dans ses formulations, trop radicale. Il surpasse de beaucoup le curé Meslier, dont Voltaire donne en 1762 des extraits choisis, édulcorés, dans cette radicalité.
L'incendie purificateur dont il rêve doit tout effacer : le dieu personnel, la création, la famille, la société, la propriété, les préjugés sexuels... Pour convaincre, Deschamps s'appuie presque uniquement sur une suite d'enchaînements logiques structurant le Vrai système parce qu'il veut amener le lecteur à formuler les mêmes conclusions que lui !
Assez tôt, sa personnalité et ses idées sont assez fortes pour qu'il se présente comme le mentor du marquis. Dans ses lettres, il l'initie à son texte La Vérité ou le Vrai système et lui donne les conseils nécessaires pour bien comprendre sa philosophie. Ainsi, le 21 mars 1763, il lui écrit : "Je vous engage, ( ) à faire attention à l'accord ( ) entre le métaphysique et le moral ; à réfléchir à la preuve que je donne, dans mes Observations préliminaires, que la vérité est nécessairement faite pour l'homme et à bien voir, dans la démonstration que je donne de cette vérité, qu'elle ne nie aucun système, qu'elle les épure tous, et (ce qu'on ne s'était jamais imaginé) qu'elle consiste non seulement dans les contraires, mais dans les contradictoires ; qu'elle réunit non seulement ce qui est opposé, mais ce qui se nie dans toute la rigueur du terme ; et, conséquemment, qu'il répugne de toute répugnance qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas elle, qu'elle ne soit pas tout ce qui est". L'approche est complexe ! Un antiquaire anglais que le marquis tentera plus tard de gagner à "la" cause, M. Callander, lui rappellera qu'il doit d'abord longtemps réfléchir : "( ) il vous a coûté quinze ans et une lecture apparemment réitérée pour vous disposer à la recevoir" !
Le terme de prosélyte revient souvent sous la plume de Dom Deschamps ou celle de ses amis. En effet, les amis des Ormes cherchent à convaincre les esprits qui leur semblent aptes à faire fructifier les germes de ce nouveau savoir et à le porter à l'extérieur, car Deschamps pense qu'il faut toucher les grands esprits pour que ceux-ci entraînent ensuite les masses. Il s'ensuit une approche plus initiatique et confidentielle que didactique de la transmission de sa doctrine et la Société des Ormes - sur le plan de l'organisation, mais aussi de certaines idées - n'est pas sans faire penser à l'Illuminisme mis en place par Adam Weißhaupt en Bavière, jusque dans les surnoms dont s'affublent les membres comme le Breton Toussaint-Marie de Guéhéneuc qui porte le pseudonyme de Nazidore. Les disciples de Dom Deschamps évoquent d'ailleurs l'Ordre des voyants et cet ordre est structuré en trois grades : les initiés (l'apprenti des loges) qui sont les lecteurs des manuscrits et des lettres de Dom Deschamps, les prosélytes (le compagnon maçonnique) qui ont pour mission de répandre la parole du maître et de rechercher les êtres susceptibles de les rejoindre et enfin les Omars (le maître) qui sont au plus près de la vérité et qui sont en même temps les copistes de l'uvre, la copie étant le moyen de mieux pénétrer la pensée ardue de Dom Deschamps ("un Omar qui me copie à son profit", note-t-il). D'ailleurs, les liens avec la franc-maçonnerie institutionnelle ont existé si l'on s'en rapporte à des courriers de l'Orient de Poitiers saluant l'Orient des Ormes !
En 1761-1762, il adresse une préface de son grand uvre à Jean-Jacques Rousseau. Dans l'esprit de Dom Deschamps, ce premier envoi doit en quelque sorte appâter, séduire l'auteur du Discours sur l'origine de l'inégalité, avec lequel il montre certaines convergences d'idées : "Si vous étiez certain, Monsieur, que cette vérité métaphysique tant cherchée jusqu'à présent, que cette vérité, qui explique tout, et sans laquelle point de morale incontestable, existe enfin, développée dans un manuscrit de peu d'heures de lecture, et que les murs qui en découlent nécessairement sont à peu près les murs auxquelles vous nous rappelez dans vos ouvrages, vous seriez vraisemblablement aussi envieux d'en prendre lecture que vous êtes digne de la connaître, lui écrit-il." Mais Rousseau ne manifeste aucun empressement et se contente malignement de donner un avis d'esthète sur l'écriture de la préface, ce qui ne manque pas de l'exaspérer. Il presse alors son correspondant non sans une certaine morgue pour le réduire "au point, où je vous veux, de désirer me lire". Rousseau lui conseille de bien réfléchir avant de publier. Pour sa part, il attendra l'uvre imprimée ! À la suite de lettres encore plus injonctives, et de nouveaux documents qu'il reçoit, après la demande que lui fait Dom Deschamps de placer leur échange épistolaire en tête de son Vrai système, ce qui le mettrait en cause, il esquivera une nouvelle fois en déplaçant l'échange sur le plan des conversations convenues en rendant un plat hommage "au mérite et au talent" et en arguant de sa mauvaise santé. Puis, excédé sans doute : "J'aurais bien des choses à dire sur vos Observations ; je trouve en général que vous visez trop haut, et qu'il se mêle du chimérique, non dans votre système dont ma stupidité est telle que je n'ai pas plus d'idée qu'à votre premier mot, mais dans vos projets de publication. Je vous dirai donc, mon avis en temps et lieu, mais je ne vous en aimerai que davantage, voyant que toute votre grave philosophie ne vous garantit pas de quelques-unes des idées romanesques dont je me suis toujours bercé. Je suis persuadé de plus en plus que je ne serai point votre prosélyte."
La correspondance n'ira pas plus loin puisque Rousseau a d'autres chats à fouetter : l'Émile est proscrit, son auteur est décrété de prise de corps par le Parlement Il ne lui reste que la fuite, Môtiers et d'autres menaces puis Bienne puis l'Angleterre et ce sera l'affaire Hume
Dom Deschamps correspond ensuite avec Helvétius (fin 1764). Celui-ci a lu des parties du manuscrit qu'il cherche à publier. L'auteur de l'Esprit le conjure de garder l'anonymat, et montre un intérêt prudent.
" N'oubliez pas que je veux tâter du Diderot, après avoir tâté du Rousseau et de l'Helvétius" écrit-il au marquis de Voyer le 11 avril 1766 et, en effet, après avoir contacté en 1766-1767 d'Alembert, qui ne veut voir en lui qu'un "scotiste", ou un "spinoziste", c'est-à-dire un moine archaïque, dans la lignée du doctor subtilis, Jean Duns Scot (1266-1308), avec sa métaphysique ou un sceptique, il s'adresse à Diderot. Au début de l'été 1769, il se rend à Paris entre autres pour la publication de ses Lettres sur l'esprit du siècle. Il l'y rencontre : "J'ai passé deux jours entiers avec le philosophe Diderot, l'un à Paris, l'autre à Saint-Cloud, et nous nous sommes quittés contents l'un de l'autre. Il m'appelait d'abord homme de bien, mais il a fini par m'appeler son maître. Il n'avait, comme bien d'autres, que des conséquences, mais il a actuellement des principes. D'Alembert, selon lui, est incapable de me saisir ; ainsi, laissons-là d'Alembert ", confie-t-il au marquis de Voyer.
Au mois d'août, les deux hommes se verront plusieurs fois. Diderot semble avoir été attiré par la pensée de Deschamps et il clame son enthousiasme à la dame actuelle de ses pensées, madame de Meaux : " C'est l'idée d'un état social où l'on arriverait en partant de l'état sauvage, en passant par l'état policé, au sortir duquel on a l'expérience de la vanité des choses les plus importantes, et où l'on conçoit enfin que l'espèce humaine sera malheureuse tant qu'il y aura des rois, des prêtres, des magistrats, des lois, un tien, un mien, les mots de vices et de vertus. Jugez combien cet ouvrage, tout mal écrit qu'il est, a dû me faire plaisir, puisque je me suis retrouvé tout à coup dans le monde pour lequel j'étais né. "
Aussitôt après cette rencontre, Diderot se met d'ailleurs à écrire le Rêve de d'Alembert !
La publication des Lettres sur l'esprit du siècle (août 1769), provoquera toutefois une réaction de colère de Diderot puisque ce " gros bénédictin qui a tout à fait l'air et le ton d'un vieux philosophe" dont il parle d'abord avec une certaine tendresse, semble s'être métamorphosé en un ennemi. En effet, il y attaque vivement le "parti philosophique" et l'Encyclopédie. Diderot est prêt à demander à M. de Sartine de faire condamner l'ouvrage, mais Dom Deschamps, qu'il reçoit, lui explique qu'il ne s'agit là que de la première étape d'une tactique devant amener progressivement le lecteur à son vrai propos, une sorte de propédeutique dans laquelle il prêche le faux pour en faire ressortir le vrai : l'adoption de son système philosophique. Il combat les Lumières pour couper l'herbe sous le pied des apologistes en les privant des arguments qu'ils utilisent contre les Encyclopédistes ! En réalité, s'il les attaque, c'est parce qu'elles ne sont pour lui que des demi-lumières et que son système n'admet pas les demi-mesures !
Convaincu ou non, Diderot ne transmettra pas sa requête au directeur de la librairie, mais leurs relations ne se poursuivront quasiment plus. Il est vrai que Diderot est également confronté à quantité de problèmes qui ne le rendent guère disponible et certains aspects de la pensée du bénédictin, ces besoins réduits aux nécessités d'une société de subsistance dont il l'a entretenu, cette harmonie entre les êtres rendant quasiment inutile le langage, ont peu de chance de l'intéresser dans l'état.
En 1770, Deschamps publie donc le second volet de son approche tactique : La voix de la raison contre la raison du temps dans lequel il s'oppose à la fois à la religion instituée et au Système de la nature du baron d'Holbach, publié sous le pseudonyme de Mirabaud. Si, dans le premier pamphlet, il a pris le contre-pied de l'athéisme prêté aux encyclopédistes et s'est donné pour un défenseur de la religion, dans ce second ouvrage il cherche à réduire à rien athéisme et religion par la référence à l' "athéisme éclairé" qu'il prône dans le Vrai système. Avec ces deux écrits, Dom Deschamps veut créer une attente de son lecteur pour combler le vide qu'il vient d'établir. C'est dans cette situation d'attente qu'il pense lui présenter son système, qui devrait dépasser toutes les contradictions et s'imposer.
D'Alembert l'avait dit, ce qu'on lui reproche surtout, c'est son scepticisme parce que, en ce siècle des Lumières, le sceptique est celui qui refuse de donner de la consistance aux "idées". Dom Deschamps semble vouloir en rester à une conception métaphysique de la philosophie en un temps ou on cherche surtout à donner des conséquences pratiques aux idées. En ce qui concerne les conséquences morales, c'est-à-dire au passage à "l'état de murs" qu'il évoque tant, ses correspondants font comme J.-B. Robinet qui écrit à d'Argenson : "Son état de murs me plaît infiniment, mais j'en trouve sa venue difficile ; non pas pour vous, non pas pour moi ; mais parce qu'il faut pour l'établir un concours de personnes qu'il sera fort difficile de convaincre. Qui attachera le grelot ?".
On dirait aujourd'hui qu'on lui reproche son idéalisme ou son "utopisme" et cela ne manquera pas de l'exaspérer.
Dom Deschamps a bien compris qu'en matière de métaphysique, il doit veiller à ne pas heurter, c'est ce qui a motivé ses tentatives de tactique et d'approches progressives des personnages qu'il désire séduire. D'Argenson lui conseillera dans le même sens d'écrire une Réfutation courte et simple du système de Spinoza, puisqu'on l'attaque sur son scepticisme, ce qu'il fera en rédigeant quatre versions différentes entre mars et juillet 1766 " ( ) pour faire tomber les armes des mains de tout croyant, et pour donner aux mécréants ce qui leur manquait, la vraie raison de l'être, ou, plutôt, pour les préparer à cette raison".
En 1770, il fait envoyer par son protecteur un exemplaire de la Voix de la Raison à Voltaire. A d'Alembert, ce dernier confie qu' "un grand courtisan" lui a apporté un écrit antiphilosophique de plus et il conclut, ironique : " Tous ces cris s'évanouiront et la philosophie restera". Dans sa lettre du lendemain adressée à Voyer, il est plein de politesses et remercie : "L'ouvrage dont vous m'avez honoré, Monsieur, me donne une grande estime pour son auteur, et un regret bien vif d'être si loin de lui ( )" et il prétexte de son âge, de sa santé pour éviter un débat, débat que Deschamps ne cherche pas lui-même puisqu'il marquera dans son dossier : "il ne s'agissait pas de [...] demander ce qu'il pensait, mais de lui dire ce qu'il fallait penser" ! L'Anglais Callander notera d'ailleurs : " Il y a une chose qui m'indigne et me révolte dans l'ouvrage de D.D., c'est le ton dogmatique, imposant et dédaigneux, qu'il prend pour ceux qui diffèrent d'opinion avec lui" ! Plus tard, alors que Dom Deschamps est mort, son copiste et ami le plus proche, Dom Patert, un des Omars, écrira au marquis : "Que dirait donc le très pacifique Mr. Callander, s'il avait sous les yeux la correspondance de MM. Yvon et Robinet, où D.D. s'échappe à chaque instant de la manière la plus incivile et la plus piquante, s'il voyait les mercuriales très vives que j'ai reçues moi-même, quoique son ami, et qui m'ont interdit de lui jamais parler ni écrire sur son ouvrage ? Il faut que je soulage un jour mon cur là-dessus avec vous, que je vous fasse une confession générale sur toutes les tracasseries qui m'ont été faites par l'auteur, au sujet de sa métaphysique. ( )"
Deschamps tentera en effet - en vain - de gagner à sa doctrine d'autres penseurs comme l'abbé Yvon, l'un des protagonistes du Colloque, connu comme le métaphysicien de l'Encyclopédie, et Jean-Baptiste Robinet qui a la réputation de ne pas répugner totalement à la métaphysique. Il sera amené à préciser ses idées, car ceux-ci discuteront et il acceptera la discussion. Il rédige ainsi le Précis en quatre thèses, pour l'abbé Yvon qui est devenu bibliothécaire des Ormes, qu'il côtoie désormais et qui restera son principal contradicteur. Dans les années qui précèdent sa mort, Dom Deschamps s'est fait un nouveau "disciple", un nouvel "Omar" comme il dit affectueusement : Dom Mazet, par qui ses uvres recopiées nous sont parvenues.
Il faut replacer l'uvre de Dom Deschamps dans la perspective d'un XVIIIe siècle "inquiet", d'une société à la croisée des chemins, bloquée, marquée par une disjonction importante entre les forces en présence comme entre les individus, une société des contradictions dans laquelle les privilégiés, les riches, voire les moins riches savent pertinemment qu'il faut "abandonner" plus qu'une part du soi actuel pour progresser, mourir pour renaître autrement (ce qui explique pour une part le succès des initiations maçonniques reposant sur un rituel mort/renaissance), mais ne parviennent pas à s'y résoudre.
On est certes à la recherche du bonheur (The pursuit of happiness, de Jefferson), mais seul un mieux possible paraît envisageable, la médiocrité au sens étymologique, le moyen terme entre "trop et trop peu", encore que la conscience d'être livré à la contingence vienne modérer même ce tiède espoir - le désastre de Lisbonne, les catastrophes qui s'abattent sur l'Europe sont là pour le rappeler.
Alors, que faire ? Maintenir le cap comme le fait Voltaire quand il publie son Essai sur les murs et l'esprit des nations (1756) non plus en cherchant à clamer sa foi en ce "progrès" mis en exergue par les philosophes depuis au moins Bacon, mais en montrant plus humblement les progrès de l'humanité à travers les inventions utiles qui l'ont soustraite aux ténèbres des époques anciennes. Choisir l'univers des loges, ces sociétés en creux, virtuelles où se réinventent (parfois) en vase clos une autre sociabilité et une autre conception du monde ? Choisir l'utopie, l'invention d'une vie sociale fictive radicalement autre (la purgation par l'écriture : près d'une centaine de textes de ce genre au XVIIIe siècle !), mais ensuite ? Choisir le repli sur soi, l'exil intérieur, le désert ? Se rallier au pessimisme janséniste ?
Dom Deschamps - qui vit dans sa retraite, mais se déplace, va à Paris (un moment il pense obtenir un changement pour la capitale), qui possède "ses adhérents (se croyant) comme les prêtres, des personnages privilégiés, des personnes favorisées des lumières"), Dom Deschamps, malgré les apparences, semble avoir choisi une autre voie : un peu comme Morelly ou Mably, il associe une critique de la religion dans ses structures institutionnelles et dans sa pratique à une refondation de la société humaine à partir d'une recherche de l'unité perdue, du retour à la vraie nature seul susceptible de marquer la fin de l' "inquiétude". Dom Deschamps développe une sociogenèse de cette inquiétude en s'appuyant sur la doctrine chrétienne de la "désappropriation" (de François de Sales à Fénelon, l'âme qui est "propriétaire" au sens mystique de "possessif" est inquiète) et attaque en particulier la propriété au sens plein du terme.
Son communisme métaphysique suppose que l' "état de murs" qu'il poursuit de ses vux se distingue de l'état sauvage et de l'état de lois "les deux seuls états où l'on puisse s'égorger" et qu'il corresponde, selon ses paroles, à "l'état d'égalité morale où nous tendons tous, où les hommes remplis entièrement de cet esprit de désappropriation qui a été jusques à un certain point celui des premiers Chrétiens et des fondateurs n'auraient rien en propre et où tout serait commun entre eux". S'il s'attache à la vérité métaphysique, c'est parce qu'il la voit comme détachée de tout, indépendante, libre de toute préoccupation, de tout utilitarisme, de toute finalité. Elle seule peut conduire à la vérité morale, qui ne serait pas comme toutes les vérités morales conditionnelles, factuelle, partielle. Dom Deschamps vise la vérité et la vérité ne se fractionne pas : il faut tendre à sa totalité, immédiatement, par une sorte de révélation, d'illumination qui doit être le résultat de l'assimilation de sa doctrine.
Quand un Bergier, "athlète" de l'apologétique, tonne contre les mécréants qui sapent l'État et la religion, Deschamps démontre, lui, l'existence du "bonheur chrétien" et transforme la spiritualité théocentrique en un outil de laïcisation d'une société qui, retrouvant sa naïveté native, réintégrera une religiosité débarrassée des scories institutionnelles, des absurdités de la pratique et de la référence en un dieu personnel.
.
En 1773 et au début de 1774, Dom Deschamps souffre de cirrhose. Il est alité mais continue à disputer avec l'abbé Yvon, à lire l'ouvrage posthume d'Helvétius De l'Homme (1772) et il meurt à Montreuil-Bellay dans la nuit du 18 au 19 avril 1774.
Les lettres de ses amis qui précèdent et qui suivent sa disparition tracent le portrait d'un homme autoritaire et sûr de lui, de son génie, tout en étant un bon vivant, truculent, libertin parfois, amateur de bon vin et gros mangeur, ce qui lui sera d'ailleurs fatal. Un gourou à la fois aimé et craint, que ses adeptes qualifient mi-rieurs mi-sérieux de "notre chef en Dieu et en philosophie", "notre protophilosophe", "père en Dieu et en ontologie", "patriarche la vérité", le "protométaphysicien" . On lui reconnaît une grande supériorité intellectuelle et des capacités éminentes dans tous les domaines, tout en protestant parfois contre un système abscons. Il peut avoir le cur sur la main comme il peut être cassant.
Il semble avoir conservé des liens avec la Bretagne. Il sollicite le marquis pour venir à l'aide d'un militaire Rennais dont on lui a signalé les difficultés. Il fera venir à Montreuil Bellay un ami breton, le père Le Hoult. Un parent, Dom François-Pierre Le Peigné, lui succédera au prieuré. L' "ami Guéhéneuc" en parle comme de son "pauvre compatriote" alors qu'il vient de disparaître.
Après sa mort, aucun de ses "Omars" ne poursuivra longtemps ses spéculations et ses uvres philosophiques transcrites par plusieurs d'entre eux resteront dans l'ombre deux siècles durant même si, dans la seconde moitié du XIXe siècle un érudit, Émile Beaussire, découvre certains de ses écrits et en fasse un Antécédent du hégélianisme, ce qui éveillera par la suite les curiosités en Allemagne, en Italie et en Union Soviétique.
En France bien plus tard.
Bibliographie indicative
Chubilleau, Emmanuel, "Léger Marie Deschamps (1716-1774). Quelques éléments de biographie.", Société internationale Dom Deschamps, http://www.philosophie-chauvigny.org/spip.php ?article 8.
Delhaume, Bernard, Léger Marie Deschamps, uvres philosophiques, Vrin, Paris, 1993.
Delhaume, Bernard, Léger Marie Deschamps, Correspondance générale, Champion, Paris, 2006
Mathais, Pierre, Dom Deschamps, métaphysique et révolution, Thèse de doctorat, Poitiers, 1989.
Puisais, Éric, Léger Marie Deschamps, un philosophe entre Lumières et oubli, l'Harmattan, Paris, 2001.
Wahl, Jean, "Lettres et fragments inédits de Dom Deschamps et de quelques correspondants", in : Revue de Métaphysique et de Morale, no 3, p. 257, Paris, 1964.
Les francs-maçons sur les planches. Pelletier Volmérange et ses Deux Francs-Maçons<em></em>
Pourtant, si l'on met en perspective l'univers des loges (si tant est que l'on puisse parler d'UN univers!) et le monde de Thalie et Melpomène, on ne peut qu'être frappé par les analogies.
D'abord, la loge représente, particulièrement au XVIIIe siècle et dans les premières décades du XIXe, un univers en soi, un "ailleurs" avec son ordre, ses offices, son décorum, sa rituélie, sa philosophie, tout comme le théâtre qui est aussi un lieu particulier avec ses usages, ses rites, ses personnages de comédie ou de tragédie fixés dans leurs rôles: l'amoureux, l'amant, le vieillard... et leurs fonctions d'actants. Ce qui se passe au cours de la loge (discours, relations entre les frères, initiations, réceptions, votes, chants...) existe à un autre niveau - malgré les ressemblances - ou diffère de ce qui se fait dans la réalité tout comme au théâtre où l'action - bien qu'en prise avec cette réalité - s'en distingue par le fait qu'elle la transcende ou s'en distancie, apporte des solutions étonnantes, permet de voir plus loin et plus clairement que dans le réel.
La loge en soi est sinon une sorte d'envers de la réalité, au moins une re-présentation de cette réalité. L'ordre social y est bouleversé (Travenol se moquera de ces frères qui en loge se qualifient de gentilshommes, portent dague et se croient de niveau avec tel ou tel prince alors qu'ils n'auraient à faire valoir que leurs quartiers de roture!), les valeurs censées y régner forment des harmoniques que les "révélations" s'ingénient à propager : égalité et fraternité, liberté et vertu, amour du savoir et modestie, charité et altruisme... Les planches à tracer, les morceaux d'architecture témoignent (le plus souvent) d'un "ailleurs" où la vertu, le goût du travail bien fait, l'entraide, l'égalité bien comprise, la curiosité intellectuelle dominent: là encore une revanche sur la réalité ou l'apprentissage d'une autre réalité.
Les règles de conduite, les votes, la présence de constitutions ou de règlements valables pour tous marquent sans doute davantage encore la rupture d'avec le réel. Et puis le maçon revêt ses bijoux, ses insignes, son tablier. Parfois, il utilise un nom de guerre, il possède tel ou tel grade, a été élu à telle ou telle fonction...
Est-on très loin de tout cela au théâtre? La comédie par exemple ressemble elle aussi assez souvent à une revanche sur les exigences de la réalité. Le spectateur voit le monde s'expliquer, se refaire. La fameuse catharsis n'a pas qu'une fonction psychologique ou morale, elle possède des prolongements sociaux et ce sera tellement vrai que les gouvernements révolutionnaires feront du théâtre l'école de la liberté et que de nombreuses pièces (écrites à dessein) seront jouées pour l'édification des foules civiles et militaires. Une école! Comme la maçonnerie était souvent prônée comme l'école des vertus et des talents! Dans une sorte de vitalisme triomphant, Molière, Quinault, Regnard, Lesage, Gresset, Beaumarchais..., s'arrangent pour que leurs vieillards ne soient jamais vainqueurs, que la richesse n'ait presque jamais le dernier mot ou alors dans une perspective caritative, vertueuse et que le méchant serve généralement de faire valoir au personnage vertueux. Marivaux pour sa part réussissant, dans ses "études" dramaturgiques, dans ses expérimentations mises en scène, le tour de force de réconcilier l'ordre des sentiments et de la Nature avec l'ordre social, de manière plus systématique encore que ne l'avait donné à voir Molière dans Tartuffe par exemple, quand le roi, Deus ex machina, mettait fin au scandale et aux mensonges.
Dans la tragédie, la distance avec le monde est plus grande encore puisque le "Dieu caché" fait régner sa volonté et que les sentiments prêtés aux grands mis en scène transcendent, stylisent la réalité sans le dire vraiment mais en l'indiquant tout de même.
L'univers de la loge est une scène où l'on s'exerce à un autre monde, à d'autres rapports humains, à d'autres valeurs que celles qui règnent dans la société et chaque frère est en représentation, une sorte de "théâtre total" assez proche de ce que souhaitait naguère Antonin Artaud. Dans son livre Diagonales de la Danse (L'Harmattan, 1997), Olivier Marmin, rapporte combien le maître à danser Antoine Lacorne introduisait son savoir professionnel dans la rituélie: une exactitude des gestes et des marches à la Grande Loge de France, "une mémoire rigoureuse des pas et des mouvements" et l'on trouve les mêmes soucis d'une "représentation" parfaite dans la correspondance entre Claude-Étienne Le Bauld-de-Nans (Régisseur de Théâtre à Berlin en particulier et maçon zélé et son ami le dentiste Jacques Drouin (comédien amateur et non moins zélé maçon).
Les cérémonies deviennent d'ailleurs parfois spectacles : la loge "des Chevaliers et Nymphes de la Rose" créée par le duc de Chartres dans sa petite maison de la Folie Triton, rue de Montreuil, organisait des cérémonies chantées et dansées au son d'un orchestre, mises en place par un hiérophante, véritable maître de ballet, et s'apparentaient à un mystère. De nombreuses loges s'ouvraient parfois au public, à l'occasion de tel ou tel événement, et donnaient de la loge, de ses usages, une image avantageuse et ciselée, des visites et des redoutes étaient organisées, des concerts offerts au public où l'on donnait des uvres maçonniques et profanes...
On aurait donc pu s'attendre à ce que le théâtre s'intéresse davantage à la loge, tant il y a de convergences, d'analogie, mais c'est peut-être cette analogie qui explique la frilosité des auteurs à mettre les francs-maçons sur les planches...
D'ailleurs, quand ils le font, c'est malheureusement sans imagination. Nous connaissons tous les quelques pièces du XVIIIe siècle, qui ne sont que des révélations ou de pamphlets mis en scène du type La franc-maçonne de 1744.
Au XIXe siècle, ces ouvrages sont encore plus rares.
J'avais donné, il y a quelques années un article sur Itanoko, une pièce de Etienne-Charles Rey qui essayait de marcher sur les brisées du succès du roman puis du mélodrame de Joseph La Vallée, Le nègre comme il y a peu de blancs (Paris, 1789), ouvrage qui aura un grand succès aux États-Unis dans les milieux esclavagistes.
Je viens de relire un texte de Pelletier-Volmérange, Les deux francs-maçons, un drame donné pour la première fois à Paris au Théâtre de S.M. l'Impératrice et reine (l'Odéon) le 28 mai 1808 et qui poursuivra sa carrière en province puis à l'étranger. On pourra le voir encore le 18 mai 1827 à Londres dans le cadre des Soirées françaises au Royal West London Theatre, à Bruxelles, en Allemagne, en Autriche. Il sera traduit en plusieurs langues et, selon l'Almanach des Muses (1809), il a bénéficié de " représentations assez suivies."
Ce n'est cependant ni un succès ni un chef-d'uvre et Pierre-Simon Ballanche, l'auteur des Palingénésies, le disciple de Willermoz, franc-maçon lui-même, le trouve même franchement détestable.
Dans le Bulletin de Lyon du 13 juillet 1808, à propos de la représentation qui vient d'avoir lieu au Théâtre des Célestins, il commence par dauber sur ce qu'il considère être les errements du théâtre de son temps: "Le comique larmoyant sera toujours, quoi qu'en puissent dire les dramaturges, un genre détestable. C'est un bâtard de Thalie, qui fait honte à sa famille (...)", avant d'en venir à l'uvre de Pelletier-Volmérange et de la réduire à ce qu'elle est: un drame sans imagination, mal écrit, parcouru d'invraisemblances et de longueurs, avec des caractères insuffisamment dessinés, des allées et venues non motivées.
Il trouve enfin la pièce mal jouée : Francisque par exemple force trop son rôle de vieillard méchant et avare, il en fait une caricature.
Le critique et philosophe lyonnais a certainement raison, la lecture de ce drame au titre ronflant (Les Deux Francs-Maçons ou les coups de hasard, fait historique) est décevante. Le ressort de la pièce appartient au magasin des drames les plus usés : un acte de reconnaissance.
L'anecdote convenue - suffisamment résumée par Ballanche ("Un franc-maçon ayant contracté en Amérique dans un moment de détresse, une obligation importante a le bonheur, en France de pouvoir s'en acquitter et d'y rendre les plus grands services à son bienfaiteur auquel il donne sa fille en mariage."), n'est qu'une plate resucée de ces uvrettes qui pullulent alors sur les planches, hésitant entre la comédie, le drame et le mélodrame: une fille à marier, deux prétendants, un amoureux ridicule et ignoble, mais que la situation familiale calamiteuse favorise parce qu'il a de l'argent; un amant sans le sou qui prouvera qu'il possède, en dépit des apparences, des qualités de cur indiscutables.
La décision prise par la mère - aux abois - de faire épouser un vieillard copié sur Harpagon, sera récusée grâce au retour inopiné d'un père "prodigue" qui avait jadis quitté sa famille et qui revient maintenant, chargé de remords, vers celle-ci afin de faire profiter de la richesse qu'il a acquise en Amérique sa femme et sa fille. Ce deus ex machina en quelque sorte permettra de faire converger le choix de la fille (elle aime un homme pauvre) et celui de la mère, le langage du cur et celui de la raison. Le vieillard avaricieux sera le perdant. L'ordre social, la vertu et les sentiments, les vainqueurs.
Dans cette histoire banale (et tout de même tortueuse: l'amant, en dépit de son impéritie - il a perdu sa fortune au jeu - a été comme un père pour la jeune fille depuis sa petite enfance et celle-ci n'envisage que lui comme époux!), cet amant, jadis riche colon américain, franc-maçon, a alors sauvé de la mort le père prodigue dont les débuts en Amérique ont été catastrophiques. Il lui a en effet donné l'argent qui lui permettra de survivre et de faire à son tour fortune, parce qu'il a reconnu - grâce aux fameux signes (" (...) il vous prit la main, et, par le signe sacré, vous le reconnûtes pour frère.") - un frère dans le malheureux qu'il avait décidé de secourir... C'est d'ailleurs le seul rôle que joue la franc-maçonnerie dans cette histoire assez abracadabrante.
Fortune établie, le père revient donc à Paris et surprend les siens.
On apprend qu'il a quitté son foyer moins pour faire fortune que pour échapper aux reproches de son épouse n'acceptant pas qu'il soit franc-maçon. Cette aversion était commandée par les médisances colportées sur les loges: la mère, prisonnière de ces clichés, n'a eu de cesse de réclamer de son mari qu'il abandonne cette Société dès qu'elle a su, après le mariage, que son époux en était ("Car enfin, là, soyons justes: quel fut le motif de votre dernière dispute? N'était-ce pas parce qu'il s'était fait recevoir Franc-Maçon? Quel mal trouvez-vous à cela? Ne valait-il pas mieux qu'il fût parmi d'honnêtes gens, que de se livrer à la dissipation? Quand il fut admis dans cette société, ne l'accusâtes-vous pas de vouloir être sorcier? Ne lui défendîtes-vous pas de revenir à la maison?")
Celui-ci, fidèle à ses convictions maçonniques, n'avait alors vu d'échappatoire que dans la fuite et la quête en Amérique d'une richesse aléatoire qui aiderait à son pardon quand il reviendrait.
La mère reconnaît ses torts; l'amant qui, rongé par le démon du jeu, était venu en Europe et y avait perdu ses biens, est reconnu par le père qui paye la dette qu'il a envers lui en le sauvant de la ruine en lui achetant généreusement, bien au-dessus de sa valeur, le dernier château (!) qu'il possède. L'amant désormais est riche, la fille l'aime : la mère donne son consentement au mariage, et l'amoureux, ce vieillard avare, copie sans imagination d'Harpagon, se révèle avoir été à la source des malheurs qui se sont abattus sur ce malheureux (désormais heureux) amant: il avait subtilisé l'argent que le père lui avait fait passer d'Amérique pour le remercier de son bienfait!
On apprend que le vieillard, qui est aussi le propriétaire de l'appartement où loge l'amant, a tout fait pour aider à la ruine de celui-ci. Il donne même ses raisons à la mère qui lui demande la cause de cette haine:
- Que vous a-t-il donc fait?
- Un affront qui me pèse sur le cur. Je voulais être reçu Franc-Maçon, je savais qu'il était grand maître, il pouvait me recevoir pour rien, et, loin d'appuyer ma demande, il s'est opposé à ma réception.(...)
- Mais pourquoi vouliez-vous entrer là-dedans?
- Par curiosité et par intérêt. On dit que ces messieurs obligent tout le monde; dans mon état, j'ai souvent besoin d'argent, et la caisse des frères eût été à mon service.
C'est à peu près tout. On célèbre la solidarité maçonnique, la vertu foncière des frères: le père prodigue est revenu; l'amant se guérit de sa passion du jeu. La mère hésite encore au sujet des francs-maçons, mais l'éloquence de son mari commence à ébranler ses convictions:
"Si tu savais combien je dois bénir l'heureux jour où je fus admis dans cet ordre respectable!... Si tu savais combien je dois... Ah! Je ne puis m'en rappeler sans verser des larmes de joie et de reconnaissance. Quand pourrai-je m'acquitter?... jamais, peut-être, et voilà mon tourment. J'ai trouvé dans cette noble réunion, des consolateurs, de protections, des bienfaiteurs; en me nommant, je ne fus étranger sur aucun des points du globe; la différence des pays, des murs, des religions, ne pouvait me faire méconnaître; partout j'ai trouvé des amis, des frères, qui m'offraient leurs secours, qui auraient répandu leur sang pour me défendre et m'arracher à la mort. Dans tous, j'ai trouvé la vertu, la bienfaisance, l'humanité, et c'est dans mon cur, comme dans ceux de tous les vrais maçons que sont écrits en traits ineffaçables ces principes sacrés. Lorsque j'étais pauvre, je fus généreusement obligé, aujourd'hui, je suis riche, qu'il se présente un frère indigent, tu me verras le supplier d'accepter mes secours, et l'en remercier. (...)"
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes maçonniques et bourgeois. La fille épouse celui quelle aime, le père retrouve sa place et l'amant sa situation. Le méchant est puni, la mère comprend enfin ce qu'est la vertu maçonnique. Tout le monde baigne dans les bons sentiments et la richesse.
La vision étroite de la franc-maçonnerie que colporte la pièce est résumée par une réplique de la dernière scène mise en exergue de l'édition imprimée:
Obliger son semblable est de l'argent bien placé et le plus grand parmi nous est celui qui fait le plus d'heureux.
Ballanche - on pouvait s'y attendre - grince des dents : selon lui, Pelletier-Volmérange n'a choisi ce sujet que pour s'assurer un minimum de succès puisqu'il pense pouvoir s'appuyer sur un public favorable de frères, un réservoir suffisant pour s'assurer des rentrées confortables :
" C'est sur le grand nombre des élus que M. Volmérange a compté pour le succès de son ouvrage."
Et il explique pourquoi, à son avis, ce détestable drame se maintient et se maintiendra : la claque maçonnique
"Cette dernière pièce (...) n'est pas tombée grâce aux applaudissements officieux des jeunes apprentis en franc-maçonnerie qui peuplaient le parterre."
Notons bien: de " jeunes apprentis en franc-maçonnerie"!
Et il ajoute, non sans dépit:
" Les sentiments de gratitude, quoique toujours trop rares appartiennent à la nature humaine et sont indépendants de toute institution fondée par les hommes. L'ordre social serait bien malheureux si, pour être bon, généreux, bienfaisant, il fallait tenir à telle ou telle caste, et si l'on ne pouvait se livrer aux douces impulsions de son cur que par suite d'initiations mystérieuses, ou qu'en vertu d'une patente ou d'un diplôme en bonne forme."
C'est peut-être là également l'explication du peu d'attrait exercé par la franc-maçonnerie sur les dramaturges : le théâtre dépasse le détail social; son sujet est d'abord l'homme dans toute sa profondeur. Jean Genêt écrivait : "Je vais au théâtre afin de me voir, sur la scène, tel que je ne saurais - ou n'oserais - me voir ou me rêver, tel pourtant que je me sais être".
D'aucuns pourraient cependant répliquer: "Je vais en loge afin de me voir ou de me découvrir tel que je ne saurais - ou n'oserais - me voir ou me rêver, tel pourtant que je me sais être"!
Notes :
Les Francs-Maçons au Théâtre avec un essai de bibliographie du théâtre maçonnique, Paris, 1919. Voir aussi mon article paru dans les Cahiers d'Histoire des Littératures romanes, Heidelberg, 1995 : "Entre les modèles français et anglais, théâtre et franc-maçonnerie en Allemagne au XVIIIe siècle; deux structures mimétiques et inductives d'une identité allemande."
Almanach pittoresque de la Franc-maçonnerie, pour l'année 5846
Par François-Timoléon Bègue Clavel (Bibliographie du théâtre maçonnique p. 94).
Cette correspondance fera l'objet d'une publication en 2015 chez Honoré Champion. Voir la description des fêtes offertes par la Royale Yorck de l'Amitié à l'Orient de Berlin par exemple (F. Labbé, La gazette Littéraire de Berlin, Champion, Paris, 2006).
Certains auteurs voient dans des mélodrames comme Le tribunal redoutable (1793), de J.-H.-F. Lamartelière, des pièces maçonniques. C'est là une extrapolation "hardie". En effet, dans ce dernier cas, l'auteur, spécialiste du théâtre allemand et de la littérature allemande, se sert de textes allemands consacrés particulièrement à la Sainte Vehme pour prolonger sous une forme plus spectaculaire encore le succès de son drame Robert, chef de brigands (adaptation des Räuber de Schiller) et cela à l'instigation de Beaumarchais (F. Labbé, J.-H.-F. Lamartelière (1761-1830), Peter Lang, Berne-Paris, 1990, publié dans le cadre de l'URA 1282 (CNRS, Paris IV). Ses Francs-Juges n'auront non plus rien à voir avec les loges et ne seront qu'une variation de ce même thème, avec un peu plus d'horreur pour faire frissonner le spectateur!
Chroniques d'histoire maçonnique, no 42, 1989.
Pelletier-Volmérange (ou Volméranges), Benoit, auteur dramatique et professeur de déclamation, totalement oublié des biographies. Il est né à Orléans, en 1756, mort à Paris, le 24 février 1824. Il est l'auteur d'une quantité prodigieuse de pièces dont certaines eurent un vrai succès et a beaucoup travaillé en collaboration. Partisan de la Révolution, il reste longtemps fidèle à ses idéaux et, le 10 août 1799, pour marquer cet anniversaire très révolutionnaire et montrer son refus du "tribun" qui va s'imposer à la France, il fait don à la municipalité d'Orléans de deux de ses pièces: Le mariage du capucin, et Le devoir et la nature. Une telle attitude n'a pas facilité sa carrière, ce qui explique le silence à son propos.
Jean Arthur Rimbaud ou Alceste au désert
"Tu en es encore à la tentation d'Antoine. L'ébat du zèle écourté, les tics d'orgueil puéril, l'affaissement et l'effroi. "
"Jeunesse", Illuminations
"Allons! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère."
Une Saison en enfer
*
On sait l'étrange défi qu'Alceste lance à Célimène dans la dernière scène de la "comédie" du Misanthrope:
Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits ;
j'en saurai, dans mon âme, excuser tous les traits,
et me les couvrirai du nom d'une foiblesse
où le vice du temps porte votre jeunesse,
pourvu que votre cur veuille donner les mains
au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains,
et que dans mon désert, où j'ai fait vu de vivre,
vous soyez, sans tarder, résolue à me suivre :(...)
Le suivre au désert... Bien sûr, plus qu'une proposition ou une demande, il s'agit là d'une dernière mise à l'épreuve ou, plutôt, de la volonté du Misanthrope de s'affranchir de la dernière illusion possible, d'être conforté dans un pessimisme essentiel. En effet, les jeux sont faits et il le sait bien. Jamais, la légère Célimène ne le suivra "au désert". Sa question est amèrement rhétorique et n'attend pas de réponse.
D'ailleurs, cette Célimène qu'il aime, c'est celle qui l'a séduit dans la société, celle qui est marquée par cette société qu'il déteste. Que serait-elle "au désert"? Que serait son amour?
La solitude effraye une âme de vingt ans, répond de toute façon l'ingénue, comme si elle n'avait pas compris le désespoir de son interlocuteur... ou le piège qu'il lui tendait.
On n'est pas sérieux quand on a vingt ans; Rimbaud, lui, l'était et dès seize ou dix-sept ans!
Vingt ans donc ou à peu de choses près l'âge de Rimbaud quand il songe à partir au désert! Lui aussi a rêvé d'une Célimène qui serait la Poésie vécue, la création poétique, la Voyance intégrale, l'Ailleurs que l'acte poétique laisse entrevoir et qui serait tellement plus riche que la plate réalité. Lui aussi, si l'on s'en rapporte au témoignage de ceux qui l'ont côtoyé, a été ce jeune homme farouche qui ne mâchait pas ses mots, quand il consentait à desserrer les dents. Lui aussi a tenté de tout dire, comme Alceste, mais autrement : ni sentences de moraliste, ni condamnations lapidaires mais la liberté totale.
Pourtant, lui aussi est en définitive acculé "au désert", car rien de ce qu'il a espéré du plus profond de lui-même ne paraît plus possible. Il n'essaiera pas, lui, de convaincre cette Célimène-là de le suivre.
Si l'on accorde une lecture métaphorique à la comédie de Molière, la quête d'Alceste et celle d'Arthur Rimbaud sont assez semblables: le besoin d'un idéal qui ne soit entaché d'aucun compromis, d'aucune compromission, la quête d'un absolu, voire de l'Absolu.
Dans les deux cas, cette quête se clôt sur la même constatation (désespérante?): le désert.
Quand l'adolescent de 17 ans écrit Le Bateau Ivre, sa fièvre créatrice est parcourue de prémonitions qui seront toujours au cur de sa poésie. Il sait ce que sera son existence. Le Voyant (" Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant - À Paul Demeny, 15 mai 1871), ce poète qui voit plus loin, va vers l'inconnu, l'inouï, dépasse les apparences, les perceptions premières, ce voyant donc est aussi le prophète, l'annonciateur, le proclamateur de sa destinée.
Le long poème du Bateau ivre est trop connu pour qu'il soit utile d'en rappeler la substance. Il suffit d'insister sur sa structure particulièrement évidente de drame en trois actes, une structure que l'on retrouvera souvent dans ses uvres en particulier dans Une saison en enfer: une montée en puissance suivie d'une période glorieuse et effervescente qui se clôt par une chute, une défaite.
D'abord, ce que tout le monde s'accorde pour appeler "la libération", les cinq premières strophes. Libération de toutes les contingences par l'imaginaire: tous les surmoi et les règles de conduite, les contraintes morales, sociales et économiques, les chemins tout tracés, les diktats de la raison... Cette libération, qui fait accéder dans la jubilation et la joie ce bateau encore contraint par les rives des fleuves, à la mer infinie et puissante, culmine dans le baptême païen de la 5e strophe, qui est à la fois mort au passé répugnant et renaissance à l'ailleurs convoité après la purification nécessaire:
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, (...)
Le second acte est constitué par l'odyssée poétique. Rimbaud, multipliant les images, bousculant les rythmes et les sonorités, cherchant les équivalents susceptibles d'approcher les terrae incognitae qu'il découvre, livre son regard halluciné au lecteur. Il s'efforce d'approcher les contours de ces territoires inconnus par des comparaisons ou des références susceptibles d'aider ce lecteur sinon à comprendre au moins à pressentir, à imaginer, à accompagner.
Rimbaud se fait voyant et s'exprime comme un auspice, un vaticinateur : Je sais des cieux.../J'ai vu/j'ai rêvé/ J'ai suivi/ J'ai heurté... Cependant l'utilisation presqu'exclusive du passé composé introduit d'emblée un élément dramatique et relègue dans le passé, le révolu l'expérience du poète, opposant d'ailleurs le présent de la vérité profonde, intérieure (Je sais) à l'éphémère de cette expérience.
Les images se bousculent, souvent antithétiques, étonnantes, échappant aux clichés habituels, parfois à la limite de l'oxymore: rousseurs amères de l'amour/ horreurs mystiques/ nuit verte/ vacheries hystériques/ Océans poussifs..., mais leur valence négative est toujours présente et s'accroît même.
Le discours poétique est volontairement surchargé pour donner une idée des territoires entrevus: abondance de pluriels, comparatifs à valeur superlative, adjectifs d'intensité (inouïes, incroyables/énormes/ineffables...), ponctuation exclamative, accumulations, asyndètes, et en même temps, cette abondance désoriente, affole, "dérègle".
Les rythmes sont marqués par la richesse de la rime toujours étonnante sur le plan sémantique (délires/lyres - tombes/colombes- vacheries/Maries- punaises/braises...), la ponctuation favorisant les rejets, contre-rejets et enjambements, permettant au vers d'obtenir l'ampleur nécessaire, soulignant le mouvement en vagues de cet "acte" puisque quasiment toutes les strophes sont en crescendo...
Et puis, les affirmations du visionnaire cèdent le pas à ce conditionnel passé qui annonce une défaite ou qui, plutôt, donne libre court au pessimisme en germe dans tous les vers précédents: "J'aurais voulu...". Les exclamations diminuent ou disparaissent. Le crescendo cède au decrescendo ; à la structure mélodique linéaire succède une structure en "accent circonflexe". Asthénie! Lassitude de celui qui ne croit plus: Martyr / Je restais, ainsi qu'une femme à genoux/ Des noyés descendaient dormir, à reculons!/ bateau perdu/carcasse ivre d'eau...
Ce second acte se termine d'ailleurs par une rétrospection rapide de ce qui a été rapporté: la vision du voyage, mais inversée, partant de cette situation morne pour remonter aux espoirs du départ, rétrospection qui confère à l'ensemble des strophes de ce passage cette même structure en "accent circonflexe": l'espoir, la violence et la course (9 strophes - crescendo), un constat amer (3 strophes) et une rétrospection (decrescendo sur 5 strophes).
Enfin, dernier acte, les trois strophes finales qui commencent par un double aveu: J'ai trop pleuré et Les Aubes sont navrantes. Constat d'échec, d'impossibilité, la poésie ne permet d'échapper ni à l'horrible réalité ni au temps: Toute lune est atroce et tout soleil amer. Et le "je" du poète-narrateur se taisant, l'enfant insoucieux du départ entraîné par la puissance de l'imagination dans un extraordinaire périple, laisse place à Un enfant accroupi plein de tristesse rêvassant au bord d'une mare avec un bateau frêle comme un papillon de mai succédané dévalué de ce Bateau ivre, conquérant et merveilleux.
La dernière strophe est presque une confession prémonitoire, l'aveu de l'échec, de l'impuissance de celui pour qui l'illusion poétique ne fonctionne plus:
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, (...)
Bientôt Arthur Rimbaud abandonnera les rivages qu'il qualifiera de fallacieux de la poésie pour être comme ces porteurs de cotons, symboles détestables mais inévitables, seules réalité, même si "au désert" où il se rendra, il fera le commerce d'autre chose que de coton. Le bateau ivre devenu navire de commerce!
Ainsi Rimbaud sait très vite, pressent bien avant les échéances qu'il ne pourra faire autrement que de renoncer à son rêve poétique, car il y a trop de distance entre l'idéal entrevu et le résultat obtenu, trop de distance de la coupe aux lèvres.
Sa fuite au désert ressemble à celle d'Alceste: puisque l'idéal est impossible à atteindre, il ne reste plus qu'à s'enfoncer dans le plus désespérant, dans ce qui constitue le degré zéro de l'espérance et du respect de soi: la plus plate, la plus basse réalité.
Alceste suivra peut-être la voie des anachorètes; Rimbaud deviendra un trafiquant.
Le Bateau Ivre est écrit pendant l'été 1871. Avec ce texte, il s'agit moins d'un voyage extraordinaire, que d'une vision désenchantée, d'une prémonition de l'avenir du poète, voire de la poésie, qui le hante déjà. L'angoisse d'un échec prévisible, de limites impossibles à dépasser. La poésie reste un jeu de mots, un bel effort verbal, mais qui ne change rien à l'ordre écrasant du monde, c'est ce qu'on lit en fin de compte dans Le Bateau ivre. L'impossibilité de peindre ce monde aux couleurs d'une poésie totale, vraie et libre s'impose après l'élan et l'enthousiasme d'une liberté apparemment conquise, puis l'excitation poétique suit immanquablement le retour à la froide réalité. Révolte prométhéenne d'abord puis acceptation - sans résignation - de la condition humaine.
Déjà dans ce poème railleur et d'une extraordinaire maturité que sont Les réparties de Nina, - Dix-sept ans! Tu seras heureuse! - après tout un parcours poétique qui hésite entre une préciosité feinte et un humour décapant et pittoresque, la "chute" du poème est formée d'un vers, LA répartie de Nina:
Elle: Et mon bureau!
Les Aubes sont (toujours) navrantes
On se remémorera également cette courte et terrible phrase d'Une saison en enfer qui résume tout : On ne part pas.
Rimbaud sera toujours obsédé par l'inéluctabilité de l'échec, par le poids de la vie, par la trivialité toujours victorieuse.
Dans une interview radiophonique, Louis-Ferdinand Céline confiait au reporter ce qu'il reprochait à l'humanité: Les hommes sont lourds, répéta-t-il à maintes reprises, et c'est cette même lourdeur, le poids de la vie et de ses contingences qui pèse à Rimbaud. L'alternative est simple: accepter ou renoncer. C'est encore une fois la réaction d'Alceste.
Les Aubes sont navrantes... Pourtant, malgré ces avertissements, ces prémonitions, le poète veut encore croire et continue à écrire, cherche à poursuivre le voyage commencé. Il en est encore au second acte de son Bateau.
Peu d'années plus tard, Arthur Rimbaud compose Une saison en enfer puis ses Illuminations.
Dans ces dernières, on retrouve cette aube enchanteresse et navrante à la fois. Le poème "Aube" est en effet une nouvelle version (courte) de ce qu'à été Le Bateau, une version terrestre tournée vers les sommets quand Le Bateau plongeait au cur des abysses! Complémentarité: aucune échappatoire, ni par le haut, ni par le bas.
En effet, dès la première phrase, il dresse un constat et le passé composé du verbe introduit une ambigüité qui ne sera résolue qu'à la fin du poème:
J'ai embrassé l'aube d'été.
L'action est-elle terminée, dépassée à l'été de la vie ou bien a-t-elle encore une influence sur le présent?
Commence alors une narration écrite à la première personne, celle d'un personnage, dont l'identité - Arthur Rimbaud, probablement - importe assez peu, celle d'un être aux pouvoirs singuliers, une sorte d'enchanteur - de poète, de Voyant -, capable d'éveiller le monde au rythme de ses pas, marchant dans une forêt, puis dans la plaine, puis dans une ville imprécise et étrange, allant de l'aube au midi, pour parvenir en un lieu isolé, surélevé et sacré, un téménos faisant songer à l'Île des morts du peintre Böcklin (1880) où prendra place le dénouement, la fin de la quête, car cette déambulation est aussi une quête de l'absolu, les merveilles rencontrées, suscitées en route n'étant qu'une propédeutique.
"Pouvoirs singuliers" avons-nous dit, puisque si la nature s'éveille au fur et à mesure de la progression du narrateur, celui-ci s'affirme être le responsable de cet éveil quasiment magique et cette nature s'anime, entre en correspondance avec lui.
En comparaison avec Le Bateau Ivre, ce texte est certes d'une grande simplicité accentuée par le choix de la prose, d'une fluidité extrême - le mouvement (fuite ou quête) - est essentiel et place l'expérience contée sous le signe de l'éphémère.
Cependant on retrouve sans difficulté, sous une forme ramassée, la structure du bateau, les trois actes que j'ai évoqués auparavant:
Aube Le bateau Ivre
I Départ à l'aube (1ère phrase) Libération
II La pérégrination d'un enchanteur sortant de l'ombre crépusculaire, et traversant une forêt qui s'éveille, découvrant la déesse - la poésie -, qu'il poursuit par une plaine, une ville jusqu'à un "bois de lauriers" situé sur un promontoire. Longue quête fantastique au plus profond des mers, au pays de l'imaginaire
III Une "chute" et un échec: retour à la réalité, à la pleine lumière de midi. Échec du voyage fantastique le rêve se brise dans la médiocrité des jours.
La même quête, le voyage poétique et l'inévitable échec.
Dans Bateau Ivre, avant l'affirmation d'impuissance finale face au "haut chant" poétique inaccessible ou illusoire ("Je ne puis plus..."), l'ivresse n'étant possible que par le truchement frelaté de "la flache", "l'eau d'Europe", cette quête se clôt sur l'image nostalgique et fragile d'
Un enfant accroupi plein de tristesse (...),
dans Aube, par cette phrase (ou ce décasyllabe)
L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois.
L'Aube, dans sa fragilité, sa pureté et ses demi-tons (rien n'est précis dans le poème: la forêt est une forêt emblématique, la plaine n'existe que par le mot même, la ville évoque peut-être une ville italienne avec ses "clochers et les dômes", "les quais de marbre"...) accompagne la quête du poète-enchanteur, la nature qu'il "éveille" poétiquement à chacun de ses pas et, au sommet des arbres de cette forêt, la certitude d'avoir découvert la poésie: "à la cime argentée, je reconnus la déesse". Malheureusement le signes avant-coureurs de l'échec se multiplient: l'atmosphère oppressante du début (le "front des palais", les "camps d'ombre", l'eau morte, rappellent l'impassibilité des Fleuves, les "haleurs" et "les équipages porteurs de blés flamands" des premières strophes du Bateau Ivre), cette déesse poursuivie qui se refuse dès qu'elle est entrevue, l'annonce voilée de la fatalité par l'image du coq (Par la plaine où je l'ai dénoncée au coq) la maladresse du poète déjà sensible dans sa "dénonciation", son empressement: "courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais".
L'enchanteur-poète impatient d'atteindre son but, la Poésie, la déesse, s'il parvient à certains résultats (Alors je levais un à un les voiles), s'il pense encore pouvoir revêtir celle-ci de "ses voiles amassés" dans ce bois sacré, ce téménos qu'il a péniblement atteint et gravi, par son impatience désordonnée même, rend la rencontre impossible et doit se contenter d'impressions fugaces: et j'ai senti un peu son immense corps.
Tout le tragique de l'expérience rimbaldienne est contenue dans ces deux mots : "un peu"! un peu quand on a soif d'absolu!
Le point de vue de la narration change alors comme si la voix du poète malheureux s'était tue. Le "je" omniprésent jusqu'alors laisse place à un regard extérieur, étranger, détaché, terriblement objectif : L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois.
L'échec est consommé et l'allitération renvoie brutalement "au monde" désacralisé, prosaïque où il n'y a plus rien à dire.
Enfin, le poème se clôt sur une constatation (un octosyllabe) qui fait écho aux dernières strophes de Bateau Ivre:
Au réveil il était midi.
Cette quête, comme celle du Bateau, n'a été que rêve et la lumière crue de midi (le moment certes, mais aussi l'âge, l'expérience de celui qui n'est plus un enfant) ne laissent plus aucune place au rêve, à la poésie vraie. Elle n'est propice qu'à la vue et non plus à la voyance, qu'au silence et au désert.
Aube apparaît ainsi une nouvelle fois comme la narration d'une tentative désespérée de parvenir à la poésie. La leçon est la même que dans Le Bateau Ivre: la quête est louable mais les dés sont pipés et l'image du coq dans Aube est comme un écho ironique du Nouveau Testament : Pierre n'échappera pas à son destin d'homme! Seul l'enfant peut approcher la poésie. Les peaux-rouges du Bateau Ivre, comme l'aube (l'aube de la vie et l'habit des communiants) incarnent cet instant où tout paraît encore possible, mais ce n'est qu'un instant.
Il arrive forcément un moment où la spontanéité (enfantine?) n'échappe plus aux haleurs dans toute la polysémie qu'on peut accorder à ce terme.
Comme pour Alceste qui voit disparaître ses dernières illusions, le poète ne croit plus en la poésie.
Il ne reste alors que le Désert...
Si faible, je ne me crus plus supportable dans la société, qu'à force de (pitié?). Quel malheur Quel cloître possible pour ce beau dégoût?
Cela s'est passé peu à peu.
Je hais maintenant les élans mystiques et les bizarreries de style.
Maintenant je puis dire que l'art est une sottise.
(Brouillons d'Une saison en enfer, uvres Complètes, La Pléiade, paris, 1972, p. 171.)
Le métier de poète désormais? "Absurde, ridicule, dégoûtant", aurait-il dit.
Le désert, donc.
Aden est un roc affreux, sans un seul brin d'herbe nu une goutte d'eau bonne: on boit l'eau de mer distillée. La chaleur y est excessive, surtout en juin et septembre qui sont les deux canicules. La température constante, nuit et jour, d'un bureau très frais et très ventilé est de 35 degrés. Tout est très cher et ainsi de suite. (...)
Aden, 25 août 1880, Rimbaud à sa famille.
Ces Allemands qui en veulent aux Grecs
L'opinion de pas mal d'Allemands quant aux déficits des "pays du sud" peut paraître sévère, voire arrogante ou méprisante.
Avant de s'en offusquer, on doit songer que depuis plus de dix ans, la classe moyenne et la population la moins favorisée de ce pays vivent sous le régime d'une véritable cure de cheval. Bien sûr, le patronat accorde quelques augmentations qui peuvent paraître substantielles, bien sûr dans beaucoup de secteurs les salaires sont plus élevés qu'en France (les médecins - 12000 euros en moyenne; les pharmaciens : 15 000; le personnel cabine de la Lufthansa: 5000, sont actuellement en grève et exigent une revalorisation solide!), mais les retenues sont importantes, augmentent d'année en année et le nombre des laissés-pour-compte s'accroît et s'accroîtra davantage encore dans les années à venir.
Comme partout dans le monde, les riches s'enrichissent et les pauvres le sont davantage. Une fatalité?
On vient de calculer qu'un employé gagnant 2500 euros de salaire brut ne pourrait espérer en 2030 qu'une retraite minimale de 688 euros s'il a travaillé les 35 années réglementaires et 723 s'il a fait 40 ans ou plus (sachant que la retraite ne peut être perçue avant l'âge légal : 65 ans actuellement, 67 puis 69 bientôt) ! La cause est connue : le taux de retraite baisse, il est actuellement de 51% du salaire net moyen et il va progressivement passer à 43%! (Les fonctionnaires ne sont pas touchés par ces mesures: ils perçoivent quasiment 100% de leur dernier salaire pour des retenues minimales). Le gouvernement conjure ces gens de cotiser à une caisse privée, de préparer leur retraite par leurs économies pour éviter la catastrophe et une aide sociale qui ne réussira probablement plus à subvenir à toutes les demandes. Et pourtant, cet employé ne bénéficie pas d'une grande marge de manuvre durant sa vie professionnelle: net après impôt, cotisations et retenues diverses, de ses 2500 euros brut, il lui reste environ 1200 ou au mieux 1300 euros pour vivre. Cotiser en plus pour une assurance qui rapportera 3 ou 400 euros à l'heure de la retraite (comme si on pouvait préjuger de ce qui sera, d'ailleurs!) ne peut se faire sérieusement à moins de 200 euros par mois (et encore, si on commence jeune)! Citoyen obéissant, convaincu qu'il faut faire des sacrifices pour sortir le pays, l'Europe des difficultés actuelles, difficultés auxquelles il ne comprend pas grand chose car lui, il n'a jamais vécu au-dessus de ses moyens, notre employé disposera donc d'environ 1000 euros (et dans de nombreux secteurs d'activité 20% de moins dans l'ancienne RDA). Bien sûr, les loyers en Allemagne sont comparativement meilleur marché qu'en France (mais cela va changer car les propriétaires sont obligés d'investir des sommes importantes pour isoler, pour rendre leurs maisons énergétiquement économes), bien sûr, l'Allemand des classes moyennes et inférieures n'a pas les habitudes culinaires du Français (?) et se contente davantage de repas souvent très simples, bien sûr les discounts font des prix imbattables..., il n'en reste pas moins qu'il lui faudra retourner deux fois chaque cent dans son porte-monnaie avant de le dépenser.
Et puis, il vient d'apprendre que le départ en retraite à 67 ans serait avancé: on parle désormais de 2015; certains affirment déjà que cela ne suffit pas et qu'il faut s'attendre à un départ à 69 ans à l'horizon de 2020! Il travaille déjà 42 heures en moyenne et ses 25 jours ouvrables de congés sont menacés. Déjà, plus de 100 000 Allemands de plus de 74 ans exercent une activité rémunérée, un de ces "mini jobs" qui se sont multipliés, pour disposer de ce petit plus nécessaire à assurer simplement leur survie ou pour avoir l'impression de vivre moins mal dans ce monde où la consommation est la seule valeur (760 000 séniors travaillent dont 80 000 à plein temps!).
Que dirait-on en France si le KWh coûtait 22 cents et allait doubler dans les années qui viennent officiellement en raison du passage à une part croissante de sources d'énergie renouvelables (passage qui recueille il est vrai un consensus national), mutation sans doute souhaitable mais exploitée par les anciens magnats de l'énergie : les malins d'hier se révèlent être les malins d'aujourd'hui, qui en profitent pour augmenter leurs profits? Que dirait-on si la taxe sur les eaux usées doublait le prix de l'eau, si l'assurance automobile coûtait comparativement le double de ce qu'elle est en France, si le coût de ce qui correspond à notre ancienne vignette était par exemple de 700 euros par an pour une golf diesel? Que dirait-on si tous les Français devaient acquitter une taxe sur les chats, les chiens, les chevaux, régler une redevance audiovisuelle double de celle pratiquée dans l'hexagone? etc., etc.
La vie en Allemagne est parfaite, comme partout, pour ceux qui ont de l'argent!
Alors on peut comprendre que tous ces gens qui tirent le diable par la queue particulièrement depuis les réformes du socialiste Schroeder (les vieux, les chômeurs, les Hartz IV (RMI)...), toutes ces personnes à revenus modestes - un enfant sur 3 vit dans une famille en difficulté - ou à situation menacée se demandent s'il faut accepter plus de sacrifices pour donner des milliards à des pays où l'on ne s'est jamais privé de rien et où l'on ne fait aucun effort, car c'est ainsi que grossièrement on leur présente les choses, les hommes politiques comme les médias.
Facile ensuite d'instrumentaliser cette misère, facile, mais pas spécifiquement allemand. Les techniques d'intoxication varient, mais le but est le même: faire prendre à la majorité des vessies pour des lanternes, manipuler et manipuler encore.
François Hollande nous refait le coup des socialistes qui n'ont jamais été au pouvoir que pour mettre en place ce que la droite ne peut faire. Simpliste à pleurer, sans doute mais à chaque fois la même chose et ça marche.
Éternité de la dette <em>Le poker des banquiers</em>
Le passage suivant n'est pas sans écho aujourd'hui: la question des déficits, l'opposition des partisans de l'austérité et des tenants de la dette élastique n'est pas d'hier. C'est en fait un des paramètres essentiels de l'Histoire (qui, on le sait bien, ne se répète pas!). Signalons encore quelques années plus tard les trois contributions brillantes d'un collaborateur de la Gazette Littéraire de Berlin, A.-P. Julienne de Bélair, dont les avis sont d'une modernité renversante : d'abord sur les institutions françaises et anglaises, une comparaison entre les Etats-Généraux et le Parlement, puis sur la dette nationale de l'Angleterre et, avec en référence le livre de Necker, cette question générale : "Qui a la plus forte dette nationale ?"
(...) Depuis cinquante ans on écrit et l'on dispute en Angleterre sur la nature des emprunts publics, mais il ne paraît pas que toute cette controverse ait fait connaitre encore le véritable point de vue sous lequel il faut envisager cet important objet. Quelques écrivains ont prétendu que la dette nationale, loin d'être à charge à l'Angleterre, lui était au contraire très avantageuse, parce qu'elle augmentait la masse des richesses et par là facilitait la circulation et favorisait le commerce: on a même été jusqu'à dire qu'elle procurait un grand bien en ce que la crainte d'une banqueroute publique était un lien qui attachait au gouvernement une grande partie de la nation. Mais quels que puissent être ces avantages, il est bien aisé de faire voir qu'ils sont balancés par les inconvénients plus nombreux et plus essentiels, et l'on ne peut guère se dissimuler que la dette de l'Angleterre n'ait étrangement multiplié les taxes et épuisé les ressources de finance. Le crédit public a un terme, et les ressorts de cette belle machine tendus à un certain point seront alors forcés de se rompre à la première secousse d'une guerre malheureuse ou d'une calamité imprévue; mais quel est le terme où ce crédit public doit s'arrêter? Mylord Bolingbroke, qui ne pouvait se consoler de vivre dans la retraite et de voir ses ennemis gouverner sa patrie, écrivait en 1749 que tout était perdu en Angleterre parce que la dette nationale montait à 80 millions sterlings; cette même dette est montée aujourd'hui à plus de cent trente millions, et l'Angleterre n'en est pas moins florissante; quelques politiques prétendent même qu'on peut la porter sans danger jusqu'à deux cents millions. (...) Les sommes empruntés par le gouvernement britannique ne sont qu'un trésor imaginaire; qu'une dette nationale est toujours à charge à un État, et qu'elle l'est d'autant plus qu'il se trouve plus d'étrangers parmi les créanciers. (...)
Suard concluait prudemment: "Il paraît que c'est un problème dont on n'a pas encore les éléments."
Est-on plus avancé aujourd'hui? Au XVIIIe siècle Mayer Amschel Rothschild disait :
"Donnez moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une Nation, et alors peu m'importe qui fait ses lois."
NB. Le créateur de la Gazette Littéraire de Berlin, Joseph Dufresne de Francheville, avait entrepris une monumentale Histoire générale et particulière des finances où l'on voit l'origine, l'établissement des impositions, très détaillée, une uvre immense devant couvrir 40 volumes dont le cardinal ministre Fleuri fit arrêter l'impression au troisième tome, qui parut en 1738, à la suite des plaintes des milieux de la finance qui s'y voyaient démasqués. Il ne put de toute façon continuer ses recherches, les fermiers généraux lui ayant interdit l'entrée de leurs dépôts d'archives. Dufresne y démontrait en effet la puissance néfaste de la finance, seul pouvoir réel dans tous les pays et totalement opposée à l'idéal des Lumières qu'il défendait. Dégoûté par ces pratiques, il alla chercher fortune sous d'autres cieux, croyant naïvement que le philosophe de Berlin, l'auteur de l'Anti-Machiavel, était le même que le nouveau roi... (Voir F. Labbé, La gazette Littéraire de Berlin, Champion, Paris, 2004)
Français, encore un effort...
"L'insurrection doit être l'état permanent de la République", Sade, Français encore un effort pour être Républicains, 1793.
Français, encore un effort...
Sade est l'auteur bien connu de ce pamphlet qui n'a pas perdu de son actualité: Français encore un effort pour être républicains. Les vux du divin marquis sont en effet restés pieux, si j'ose dire. La dernière campagne l'a démontré à l'envie : nous sommes engoncés dans nos vieilles habitudes, sclérosés comme le rictus momifié de sarko et comme le moulin à paroles vides de Hollande. Entre deux maux, fallait-il vraiment choisir le moindre, et le moindre jusqu'à quel point? L'avenir le dira.
En fait, les faux débats, le suspense entretenu par les radios, la presse, les sondages, le lavage de cerveau auquel les Français ont été soumis, le gavage de chiffre, de pronostics..., rien de tout cela n'est allé au fond des choses. La question essentielle n'est pas de savoir s'il faut de l'austérité ou de la relance, de savoir même si c'est l'ancien qui a les meilleures idées ou le nouveau qui va permettre des lendemains qui chantent. La question est d'avoir enfin une attitude républicaine, c'est-à-dire, de prendre en main - chacun d'entre nous - la chose publique et de cesser de déléguer nos pouvoirs aux avatars de nos rois. Il faudrait que le Français apprenne à démonarchiser sa pensée, ses réflexes, qu'au pays de l'existentialisme, il s'empare enfin, personnellement, de son destin et ne laisse à personne le soin, pendant des années, de penser et d'agir pour lui, en son nom. Sinon, il est évident que, comme toujours, parmi les 52% de "victorieux" il y en aura pas mal qui se sentiront floués à un moment ou à un autre. Quant au 48%...
"Démonarchiser", arrêter d'élire des rois et des princes pour nous gouverner : tout un programme et on en est encore loin: le poids de l'histoire!
Au début de son règne, la foule adulait Louis XV, le bien aimé, si beau, si moderne alors et sa Pompadour, en odeur de sainteté parmi les philosophes. Ça n'a pas duré aussi longtemps que la gabelle et le précieux souverain, panier percé, va-t-en guerre de pacotille, érotomane gangrené est vite devenu le mal-aimé.
On s'était aussi attaché au jeune Louis XVI, un roi si simple, qui avait des plaisirs si naturels! Quelques mois avant son procès, on le voyait à son balcon portant le bonnet gras des gens du peuple et promettant tout plein de choses gentilles à la foule en délire. Un bon gros! Comme nous! Pas fier! Ah! s'il n'y avait pas eu cette garce d'étrangère. Et puis cette maudite armoire de fer qui révélait quelques vérités sur la bonhomie du prince...!
Le soir, après avoir fait tout plein de promesses en serrant les mains, François et son petit costume étriqué, il va certainement, tout comme le gros Louis, réparer les serrures, ces serrures que Sarko a fracturées. Voilà pourquoi le bon peuple l'aime.
Encore!
Une fois par an, le roi avait l'habitude de tâter les écrouelles de quelques malades triés sur le volet et censés représenter le bon peuple, mais attention, un peuple mis sur son 31 et qui aurait pu loger dans la fermette d'Antoinette avec ses moutons enrubannés et parfumés, le peuple tout de même, ou son symbole. Louis XV, qui avait d'autres chattes à fouetter, a voulu faire le malin: il a refusé de poursuivre cette tradition. On sait ce qui lui en a coûté : haine, tentatives de régicide. L'âge lui venant, on le trouvait arrogant, hautain, loin du peuple, sans pitié pour le malheureux. Au lieu de prendre des bains de foule, il travaillait pour le roi de Prusse et se noyait dans le stupre! M'enfin!
On dit que Louis XVI aurait bien voulu renouer avec cette coutume de thaumaturge populaire dédaignée de son aïeul et qui l'aurait rapproché du bon peuple. Hélas! Il n'a pas eu le temps avec le sacré rasoir qu'on lui a imposé. Et savez-vous qui il a fallu attendre pour voir réapparaître ce toucher prolétaire? Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille, comme disait la marquise: le petit frère du gros Louis le Raccourci, Charles le Dixième! Mais il était trop tard, les Trois-Glorieuses arrivaient au galop et un autre roi - roi des Français, cette fois - allait s'imposer en attendant quelque chose de mieux, un bon bourgeois celui-là, balzacien au possible, rouflaquettes et triple menton. Une poire pour la soif en quelque sorte, car ça n'allait pas durer longtemps non plus!
Les amours pour le Grand Délégué tournent toujours au vinaigre. Une fatalité.
Voilà pourquoi rien ne changera jamais tant que les Français continueront à élire un roi. Qu'il se dise près du peuple ou menace de manier le Karcher, l'histoire finit toujours mal pour lui. Oignez le vilain, il vous poindra, poignez le vilain il vous oindra, disait-on jadis, il faudrait corriger la deuxième partie de l'adage: poignez le vilain il vous poindra à son tour. Pas d'alternative!
La seule solution se trouve dans une révolution des mentalités car il faudra bien en finir un jour avec un scénario qui se répète depuis trop longtemps, cette élection du roi président, un président roi qui cherche à caresser dans le sens du poil son électorat dans ses ébats publics, qui n'a qu'une préoccupation: entretenir l'illusion, préparer sa réélection. Sarko jouait les gros bras face aux petits et avait beaucoup de compréhension pour les privilégiés ; Hollande inverse en paroles la vapeur. Le premier aimait à se déguiser en père Fouettard pour impressionner les foules en mal d'autorité ; les second fait un peu comme Waldeck qui enfilait mine de rien une salopette sur son costume avant d'aller adresser un discours aux "camarades" soucieux d'égalité.
Symétries.
Sarko et sa chère Carla appartiennent à la jet society des heureux de ce monde, pas la peine de le démontrer, mais on ne fera tout de même pas croire que le petit François Gérard Georges, fils d'un médecin spécialiste ORL (de sensibilité (?) droitière), élève du lycée de Neuilly, étudiant en droit à Paris II, passé par Sciences Po, HEC et l'ENA, qu'un conseiller à la Cour des comptes soit un enfant du peuple! Non, François Hollande n'a rien de commun avec 99% des Français!
Caresser dans le sens du poil, c'est aussi s'en tenir à ce qui existe, faire comme si on change en ne changeant rien. Gardons l'atome, misons sur la consommation, sur le "toujours plus", sur la voiture, sur le peu de cas pour l'environnement. Restons-en aux certitudes faciles : plus il y aura de profs, meilleure sera l'école, plus il y aura de fonctionnaires mieux fonctionnera le "service public", plus il y aura de bacheliers mieux s'en portera le pays, plus EDF sera puissant, mieux cela sera pour nos budgets, plus il y aura d'argent en circulation mieux on vivra... Trois paquets pour le prix de deux: la formule magique du bonheur...
Et tant pis si l'addition atomique laissée aux générations futures sera salée, et tant pis si les prix augmentent avec les salaires et font de la France un pays horriblement cher, et tant pis si les rivières du pays sont toutes quasiment mortes, si les marées vertes défigurent les côtes, si le gavage des oies est un des summums de notre culture, si nous pillons les réserves d'uranium de pays africains, si...
On s'en fiche : nous avons le TGV (invendable hors de France), Airbus (qui n'est pas seulement français mais on veut l'oublier: fierté nationale oblige), Ariane, Areva, EDF, la mode, la Kulture. On nous envie partout dans le monde, je vous dis! La meilleure école, la meilleure cuisine, les meilleurs vignobles, les plus beaux paysages...
Douce France, cher pays de mon enfance, qu'il fait bon vivre au pays des Droits de l'homme...
Pourtant, en faisant un effort, on pourrait peut-être penser autrement et autrement utiliser les exemples, les modèles qu'on taille et qu'on retaille pour les besoins de la cause.
Pendant la "campagne" l'Allemagne a justement servi à la fois de référence ou de repoussoir : "les Allemands, ils...", entendait-on partout et les spécialistes en germanologie en remettaient chaque jour une louche sur les écrans, à la radio, dans les journaux.
Chacun ressortait doctement les chiffres et les exemples les plus fous et les plus contradictoire pour illustrer sa thèse.
Docile, l'Allemagne vue à travers des lunettes françaises, s'accommode à toutes les sauces. Le problème, c'est que je crois que jamais on a, en France, aussi mal compris ce pays, car on ne sait pas ce qui s'y passe et nos journalistes géniaux capables de parler avec aplomb de ce qu'ils ne connaissent pas s'ingénient à projeter de manière plus ou moins heureuse nos fantasmes nationaux, leurs fantasmes sur une Allemagne transformée en auberge espagnole (Qui a dit que parler de l'autre, c'est d'abord parler de soi?).
Et des fantasmes, à propos de l'Allemagne, il y en a! Inutile de chercher à les dénombrer.
Pourtant, une chose est certaine: il est impossible de ramener ce pays à notre système. Rien ne correspond.
La chancelière n'a rien à voir avec le président. Elle rend compte régulièrement au parlement de sa politique, un parlement qui a le dernier mot et qui ne tolère pas qu'on décide sans sa consultation et son aval.
Et puis, chaque Land a sa part d'autonomie, sa politique, dans le système allemand, rien qui ressemble à notre soi-disant régionalisation.
La société civile, enfin, joue un rôle essentiel incomparable à la place qu'elle tient dans l'hexagone...
Inutile donc d'entrer dans un débat sur les mérites comparés des institutions. Comparaison n'est pas raison en l'occurrence. Remarquons seulement qu'étrangement les Allemands paraissent, eux, autrement républicains - au sens prôné par notre sulfureux marquis - que les enfants de 1789,1830 et 1848 paradoxalement prisonniers de leurs réflexes monarchiens. En Allemagne, on a l'impression que la Res Publica existe: bien sûr, il y a les "politiques", les élus, mais ils sont là pour indiquer des directions, fournir des cadres aux idées. Au citoyen de s'approprier ces vastes domaines et d'aller plus loin ou ailleurs s'il le juge bon. Inutile d'attendre que les "politiques" décident, c'est à la base de se lancer, d'être capable d'avoir des projets, de les développer et de montrer aux professionnels de la politique qu'il existe parfois de voies auxquelles ils n'ont pas pensé.
J'habite le Bade-Wurtemberg depuis des années. Dans la petite commune où je demeure, on n'a pas attendu que les ordres viennent d'en haut en matière, par exemple d'énergie et d'environnement. Dans les cadre des lois, bien entendu, des groupes de travail se sont constitué, des bénévoles et des élus, qui travaillent depuis longtemps sur ce qui intéresse notre vie de tous les jours: les économies d'énergie, l'environnement, la santé, l'éducation, la solidarité, les transports...
Bien avant que l'État ne décide de sortir du nucléaire, par exemple, la société civile avait mis en place les jalons menant à une nouvelle politique énergétique. Des expériences sont devenues réalité comme dans une petite ville voisine où par un travail de 20 ans auquel l'ensemble de la population a participé, on est parvenu à une indépendance énergétique complète (il est vrai que l'Allemagne n'a pas d'ogre EDF!). Chaque citoyen peut depuis longtemps décider de refuser l'électricité d'origine nucléaire et choisir de payer un tout petit peu plus cher pour bénéficier d'une énergie "propre", les coûts supplémentaires pouvant (devant) être absorbés par une attitude responsable en matière de consommation.
J'étais hier soir à la réunion de l'"Agenda local, énergie durable et protection du climat" (il existe bien entendu d'autres projets: environnement, travail, justice sociale,...). Le but de l'action est parfaitement défini : il s'agit en l'occurrence de tout mettre en uvre pour accompagner de façon précise le "tournant énergétique" décidé dès l'époque Schroeder et de toute façon à plus ou moins long terme rendu indispensable par la situation mondiale (ressources, pays dits "émergeants"...), et pour soutenir à l'avantage des citoyens et de la commune, les potentialités qu'offre ce défi. Différents groupes "citoyens", toujours ouverts et regroupant toutes les sensibilités politiques comme toutes les origines, ont commencé à mettre mis sur pied un "agenda" qui expose concrètement les perspectives et les stratégies d'une politique énergétique et d'une protection du climat sur le plan local qui reste attentive aux nécessités du développement communal.
Le but est de parvenir avant 2020:
- à permettre aux générations futures de bénéficier d'un environnement le moins pollué possible dans des conditions climatiques stables.
- de parvenir à une autonomie énergétique gérable, équitable et à faire en sorte que les concitoyens puissent avoir à leur disposition des ressources énergétiques suffisantes, propres et renouvelables à des tarifs raisonnables.
Parvenir à mettre en place une commune autonome sur le plan énergétique et totalement respectueuse du climat signifie en quelques mots:
- 100% de ressources renouvelables à l'horizon 2016-2030 (base 1990)
- Réduction de la consommation électrique de 30% pour les particuliers jusqu'en 2020 et de 20% pour les entreprise et bâtiments publics (base 2012)
- Production autonome de 50% de nos besoins en chauffage à l'horizon de 2030
- Réduction de 60% des émissions de CO2 jusqu'en 2030 (base 1990)
- Innovations en matière de transports: alternatives à la voiture individuelle, car-sharing, développement des transports publics, bornes de recharges solaires des véhicules électriques...
Il s'agit d'un projet qui est en cours et qui concerne tout le monde. Une dynamique a été créée et chacun se sent "responsable". Les écoles et jardins d'enfants sont bien entendu partie-prenante du projet. Celui-ci ne se réalise bien entendu pas en autarcie, les échanges intercommunaux, le soutien logistique d'organisations mises en place par le Land et la République sont à la fois les interlocuteurs et les partenaires privilégiés. Les entreprises elles-mêmes ont compris qu'elles ont tout à gagner dans cette conception d'un développement durable et propre, elles ne sont pas les dernières à faire profiter de leur aide. Des séminaires sont prévus ou ont déjà eu lieu (isolation des habitations, conduite des voitures, panneaux solaires, biomasse...) et cinq groupes de travail se réunissent régulièrement, rendent compte publiquement de l'avancée de leurs travaux: Développement, conseil et installation des ressources d'énergie renouvelables, Construire et vivre avec un bilan climatique et énergétique neutre, Économies d'énergie, Communication, Mobilité.
Si on regarde d'un peu plus près ce dernier point, le groupe de travail s'est penché sur les "causes" d'une utilisation exagérée de la voiture (fermeture de magasins dans la ville, de services privés et publics dans les quartiers, secteur culturel à développer...), ce qui interpelle la municipalité sur son rôle et les aides qu'elle peut consentir pour assurer le maintien de ces infrastructures). Il a aussi contacté les entreprises de transport privées et de service public pour adapter à la demande (étudiée par enquêtes), réfléchi sur les modalités de mise en place d'un véritable car-sharing, de constituer des bourses de transport, de développer l'accès et l'utilisation du vélo électrique et de la bicyclette, d'entretenir et de multiplier les voies cyclables..., de développer tout ce qui peut soutenir les véhicules non ou peu polluants (stations de recharge électrique...), de limiter la vitesse...
Inutile d'aller plus loin (qui le désire pourra obtenir le site de la commune et voir ce qu'il en est exactement).
En France, on parle beaucoup de citoyenneté - à l'école, pour les élections... - mais dans la pratique... Ici, on en parle peut-être moins mais on agit vraiment de façon citoyenne. En France on discute avec raison des questions de racisme, de l'exclusion des étrangers, d'une politique contraire à l'esprit des Droits de l'homme. On manifeste, on proteste... Ici, on préfère intégrer par l'action car on sait que c'est en associant les individus à l'élaboration de projets ressentis comme importants qu'on obtient une véritable cohésion et que les problèmes nés de la rencontre de populations d'origines différentes s'estompent. La mondialisation, c'est aussi cela: comprendre que nous sommes tous "dans le même bateau"!
J'ai eu la chance de diriger plusieurs années un lycée franco-allemand. Malgré la méfiance des autorités (particulièrement françaises), nous avons réussi à intégrer parfaitement les deux populations françaises et allemandes de nos élèves : tous les cours sont communs, le baccalauréat et l'Abitur couronnent la fin des études, le secteur culturel (théâtre, musique, beaux-arts) est particulièrement développé. Les élèves apprennent à se gérer par eux-mêmes: ils sont responsables de l'état des locaux, de la discipline, des la pluparts des actions organisées. Ils sont des partenaires à part entière. Le lycée n'a ni "pions", ni conseillers d'éducations, ni agents de service et tout marche. Les professeurs considèrent que leur service ne s'arrête pas à la porte de leur salle de cours.
Lorsque nous avons mis en place toutes ces innovations, on m'avait assuré que cela ne marcherait pas et que c'était contraire à la "mentalité française". Nous avons prouvé que quand un concept est clair et qu'il s'impose par son évidence, quand tous les partenaires sont pris au sérieux, on arrive à faire taire les "mentalités", à éduquer au sens noble du terme, à déplacer des montagnes.
Au lieu donc de discuter chiffres, de manier l'invective, de répéter les vieilles recettes du passé, de faire dans la démago facile en refusant de dire aux gens qu'il y a des défis à relever, que rien n'est impossible, qu'il faut savoir rompre avec le passé, il aurait été préférable de faire comprendre qu'il faudra retrousser ses manches, imaginer, refuser les vieilles certitudes, inventer l'avenir, comprendre que rien ne sera plus comme hier et que "trois paquets pour le prix d'un" est une formule désuète.
Français, encore une effort...
Au diable l'École? Les cahiers au feu et les maîtres...
ÉCOLES : Polytechnique, rêve de toutes les mères (vieux). Terreur du bourgeois dans les émeutes quand il apprend que l'École Polytechnique sympathise avec les ouvriers (vieux). Dire simplement "l'École" fait accroire qu'on y a été. A Saint-Cyr : jeunes gens nobles. A l'École de Médecine : tous exaltés. A l'École de Droit : jeunes gens de bonne famille.
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues
Au secours! L'Ecole! La fin d'un service public?
Changeons l'école (une fois de plus)
"(...) les cahiers au feu et le Maître dans le milieu!"
Si l'éducation est un préalable indispensable à l'épanouissement des individus et à leur intégration dans la communauté humaine, l'institution scolaire, telle qu'elle existe, même avec toutes les inventions cosmétiques et démagogiques possibles, est-elle l'instrument adéquate, est-elle à la hauteur des attentes qu'on pourrait légitimement placer en elle ?
Le fameux mythe platonicien de la caverne nous montre certes que l'humanité a besoin de guides, mais le problème est la qualité de ces guides, leurs motivations, car si le philosophe dans la perspective platonicienne peut, doit indiquer la voie du bien et de ces félicités supérieures dont les réalités humaines ne fournissent qu'une imparfaite image, ceux qui s'érigent en maîtres, ceux qui se réclament de cette fonction, de cette vocation, ne le font jamais librement ni avec un désintéressement entier : comme l'histoire nous le montre, ils sont toujours dépendants, directement ou indirectement, volontairement ou non d'idéologies et d'intérêts qui les dépassent.
L'enseignant pourrait être idéalement un de ces guides qui montrent aux hommes engoncés dans les ténèbres le "chemin supérieur". L'institution scolaire pourrait être ce lieu où l'individu serait révélé à lui-même et à sa vérité tout en favorisant son entrée dans une communauté humaine régénérée, car une éducation digne de ce nom devrait d'abord avoir pour but de permettre à chacun de s'épanouir. Ce n'est qu'après, par une sorte de conséquence, de suite nécessaire que l'individu équilibré, harmonieux entrerait dans la société, sachant que la confrontation des individualités, le frottement des personnalités diverses, loin d'être un frein à l'esprit communautaire, en serait la vraie force. Une éducation qui vise seulement à formater les individus pour les faire entrer dans le schéma préexistant des sociétés ne mérite pas ce nom. Il s'agit alors d'un dressage, d'une aliénation progressive et l'histoire encore fournit à ce propos une abondance d'exemples. Il ne s'agit donc pas de presser des individus dans des moules préétablis en invoquant les traditions, l'autorité, les nécessités sociales et politiques, économiques, l'idéologie ou les religions, mais de permettre à de jeunes femmes et de jeunes hommes épanouis par une éducation ayant su transformer des potentialités en réalités de créer une société, de faire évoluer une société correspondant à leur singularité et à leur pluralité. Le rôle d'une école bien comprise - mais c'est une évidence - ne peut être autre que de permettre à chacun et à tous le plus grand bonheur possible, l'harmonie la plus parfaite. A chacun de gloser voire d'ironiser sur la signification de ces termes.
Conçue de cette façon, l'éducation ne peut d'ailleurs se limiter au temps de la scolarité et doit accompagner l'individu sa vie durant, car rien n'est jamais définitif, parfait au sens grammatical du terme, d'autant plus que la société elle-même, de par l'arrivée constante de nouveaux membres sera amenée à constamment évoluer.
Pourtant, face à une telle ambition partagée par tous ceux qui se sont appelés pédagogues, la réalité de l'école a toujours été décevante parce qu'elle ne forme par ces individus libres : les enquêtes d'opinion, les faits-divers, le goût actuel pour l'autobiographie, le succès des psychothérapeutes, des gourous, le retour des formes les plus sectaires des religions,..., montrent que l'homme moderne souffre. En quête des fragments d'un moi riche et ouvert, libre, l'individu se sent à l'étroit, simplifié, schématisé, réifié : il est fait par le système dans lequel il vit ! En revanche, à côté de ces réalités, le discours sur l'école raconte une toute autre histoire faite d'altruisme, d'humanisme et de bons sentiments !
Mais derrière l'affichage de ces bons sentiments, l'école n'a jamais rien fait d'autre que de soutenir les intérêts des castes ou des es dirigeantes, tout en assurant la paix sociale puisqu'il ne convient pas de laisser trop d'indépendance aux es défavorisées qui pourraient devenir des es dangereuses ! Quand les politiciens du XIXe s. s'emparent progressivement de l'école et réduisent ainsi quasiment au silence le premier grand prédateur en matière scolaire, l'Église, l'ancien allié de tous les régimes, le compère avec lequel on s'entendait comme larrons en foire pour faire haro sur le baudet-peuple, l'Église qui dans un monde désormais livré aux forces du capital et de la productivité avait tendance à devenir un chétif adversaire et un empêcheur de tourner en rond, cette main basse sur l'école se fait au nom des plus grands principes, bien sûr, des plus honorables, au nom de l'homme, de la démocratie, de la philosophie, en se drapant dans les plis du drapeau de la République, une Res Publica qui n'appartient en réalité qu'aux nantis, aux nouveaux aristocrates ou ploutocrates nés des nouvelles institutions. Les discours des ministres de la Troisième République, Jules Ferry en tête, sont les exemples les plus parfaits de ce double langage, de cette duplicité. Aujourd'hui, on ne fait pas autrement, mais d'une manière un peu plus fine sans doute : on proclame comme une grande découverte qu'on veut à tout prix placer l'enfant au centre du système scolaire (!) quand on fait tout pour satisfaire essentiellement la demande du capitalisme libéral.
L'école n'est pas à la hauteur des attentes que les esprits naïfs placent en elle : ni émancipatrice, ni libératrice, ni formatrice d'individus libres. L'école est et a toujours été au service de... Les hussards de la République sont bien forcés de faire - s'ils y réfléchissent un peu - autre chose que l'éducation dont il est à espérer qu'ils ont rêvé, un rêve d'ailleurs à peine possible puisqu'ils sont eux-mêmes les meilleurs produits d'un système qui s'est donné d'autres valeurs que les valeurs humanistes et parce que la force de l'habitude fait trouver juste ce qui ne l'est pas forcément...
Jadis l'Église a développé un enseignement à son profit parce qu'elle avait besoin d'un clergé assurant son emprise sur tous les rouages de la vie et parce qu'elle cherchait constamment à développer sa puissance. Sa finalité pouvait certes être d'établir le royaume de cieux sur terre, mais la confusion entre la puissance temporelle et l'idéal proclamé a vite fait que les moyens ont vite supplanté les finalités et que celles-ci ont été repoussées dans une eschatologie bien arrangeante, d'autant plus que les puissances laïques qui se reconstituent après la période de trouble qui suit la chute de l'Empire romain lui proposent complaisamment leur glaive tout en s'appuyant sur cette Église, la seule force constituée. De cette union à bénéfices réciproques naît une école ou le concept d'une école au service des puissants, une école réservée à quelques élus bien entendu. Une école qui fera école !
Une démocratisation de l'institution scolaire n'est pas envisageable jusqu'à la Révolution parce que les conditions ne la permettent pas, même si de nombreux esprits, au cours des siècles, critiquent l'école telle qu'elle est et proposent d'autres modèles.
Sous la Révolution, on pourrait s'attendre à un nouveau départ, mais la situation du pays, les conflits internes et extérieurs ne permettent pas d'avancées notables malgré l'abondance de projets généreux, mais aussi, déjà, d'idées qui préfigurent ce que deviendra l'institution scolaire dans l'état bourgeois engagé dans la révolution industrielle. Ces idées germent avec l'Empire qui met en place les jalons définissant une institution consacrée à une nouvelle France désireuse d'entrer dans la compétition internationale. L'Empire, pour de simple raison d'économie et d'ordre public, concède à l'Eglise, rehaussée, après ses déboires révolutionnaires, au grade d'alliée de circonstance, l'enseignement primaire car les principes moraux prêchés peuvent servir à contenter les masses. Cet enseignement paraît se démocratiser au cours du siècle moins par humanisme que par nécessité économique : il faut fournir à l'industrie naissante la main d'uvre susceptible de répondre à ses exigences, l'Église transmettant à ce prolétariat taillable et corvéable contre quelques rudiments d'éducation les consolations nécessaires et les règles morales qui éviteront, pense-t-on, révoltes et troubles. Le secondaire poursuit de son côté assez imperturbablement la tradition de l'Ancien Régime : former une caste de dirigeants qui possèdent un savoir certes nécessaires (ouverture aux sciences) mais aussi unie par une même culture (la place du latin, certains auteurs iques, la rhétorique...), les mêmes mythes littéraires et historiques : en un mot, une culture de e qui contraste avec la maigre culture de masse dispensée aux petites gens.
Avec la République le mouvement s'accélère sous la pression du concurrent allemand particulièrement. 1870-1871 est instrumentalisé comme essayera de le faire plus tard avec la défaite de 1940 l' "État français" de Vichy : provoquer une sorte de sursaut national en faisant passer des vessies pour des lanternes. Pour Jules Ferry et ses successeurs, il s'agit avant tout de permettre à la France des De Dietrich et autres magnats de rattraper le retard économique et industriel pris par rapport à l'arrogante Allemagne et ses Krupp, d'adapter les ressources disponibles à la demande des forces du capital de l'état bourgeois. L'école, presque entièrement laïcisée prend certes en charge la formation de quasiment tous les enfants, mais les perspectives demeurent structurellement semblables. Il ne s'agit pas de former des citoyens libres et indépendants dans leurs décisions mais seulement aptes à s'intégrer dans un monde dominé par la lutte économique. La morale chrétienne est simplement sécularisée (comme les premiers chrétiens christianisaient les temples et monuments païens) : le patriotisme, la morale dite républicaine (Travail, famille, Patrie ! déjà !), le culte des grands hommes et les mythes nationaux...
Cet état de fait se poursuit de nos jours sans grands changements en profondeur. On peut seulement observer que la démocratisation apparemment complète de l'institution scolaire, l'accès généralisé au bac et aux études supérieures ne se fait qu'en raison de la demande en compétences de la société productive tout en laissant accroire au vulgum pecus qu'un bâton de maréchal se trouve au fond de la besace qu'il traîne après lui.
Et le libéralisme triomphant impose ses diktats. Tout cela est dissimulé derrière un rideau de belles paroles, un discours altruiste en apparence et uniquement préoccupé du bien de l'enfant ! On se réjouit de l'accès de 90 ou 98% d'une e d'âge au baccalauréat, alors qu'il ne s'est agi que de se mettre en adéquation avec les recommandations de l'OCDE, l'agence de notation pédagogique qui distribue satisfecit et blâmes comme Mooding and Co à l'égard de la Grèce ou du Portugal, de la France : le mot d'ordre est clair, l'économie mondiale a besoin de diplômés, de plus en plus de diplômés. Formons donc des diplômés... Il ne s'agit que de réguler les flux de travailleurs, de garder au parking scolaire le trop plein qui gonflerait les chiffres du chômage, d'orienter vers les métiers qui ont de l'avenir les jeunes, de faire croire à tout le monde qu'aujourd'hui tout est mieux qu'hier et que nos chères têtes blondes bénéficient d'une meilleure et plus complète éducation, qu'ils seront mieux armés à affronter la vie et les défis d'un monde qui change si vite ! Ces examens sont toujours présentés comme l'ascenseur social par excellence, alors que toutes les études sérieuses montrent que rien ne change dans une société figée dans ses structures. On paye en monnaie de singe ! Et cette société est d'autant plus figée que l'ouverture de l'école sur le monde, ce maître mot tant proclamé de la pédagogie des années 80-90 ne contribue qu'à servir cet impératif d'adéquation entre ce qui est appris et ce qui est exigé par l'industrie, la finance, les marchés : former un exécutant et un consommateur puisque les deux fonctions essentielles de l'homo sapiens moderne, de l'homo oeconomicus sont désormais l'inscription dans le processus de production au sens large du terme et la consommation, aucune e, aucun âge, aucun sexe, aucune confession ne devant échapper à cette double dépersonnalisation des individus.
La part qui reste à l'être en soi est devenue peau de chagrin, détail de l'histoire.
Pourtant des craquements se font entendre, ce système bien établi se fissure en apparence. Du côté des "usagers" (des usagés !) d'abord puisque les jeunes gens comprennent qu'on se moque d'eux et ne sont plus prêts à accepter pour argent comptant la monnaie de singe qu'on leur donne. Tous ces jeunes Français de la troisième ou quatrième génération sont moins prêts à révérer un système scolaire et ses valeurs, qui ne fait pas totalement partie de leur bi culturalité ; toutes ces jeunes filles qui désormais ne veulent plus qu'on les enferme dans ce qu'il y a quelques lustres encore on considérait être un destin de femme.
Les jeunes sont mûrs plus tôt et ne sont plus les gogos obéissants d'hier. Ils exigent désormais d'avoir réellement leur mot à dire et faire entrer dans l'école des concepts comme ceux de bonheur, de créativité réelle, d'autonomie, d'écologie, de politique, de culture vivante, du droit à ne rien faire...
Fissures encore du côté des enseignants qui se résolvent de moins en moins à accepter leur destin de prolétariat intellectuel, de rouage d'un système qui les dépasse. Ils ne veulent plus qu'on exige d'eux tout et n'importe quoi : dispensateurs "du" savoir, éducateurs, animateurs, matons, gardiens d'enfants, boucs émissaires de tous les maux de la société, mal payés, mal traités, réduits à exercer leur métier dans des conditions précaires (es surchargées, formation réduite à rien...).
Craquements aussi du côté de la structure : des coûts exorbitants et pourtant des budgets insuffisants pour parvenir à un véritable enseignement de masse de qualité ; le poids de plus en plus important du politique et de l'économique qui en vient même à dicter par exemple le calendrier des vacances.
Craquements enfin du côté des donneurs d'ordre, des mandants masqués : si les statistiques sont excellentes, les résultats de la formation déplaisent, ne correspondent pas aux attentes. On déplore les "niveaux", on considère avec inquiétude cette jeunesse qui commence à revendiquer de façon sauvage, inorganisée et qui n'admet pas que la monnaie de singe qu'on leur donne ne serve quasiment à rien d'essentiel... Alors les formations d'entreprise se multiplient, on préfère dresser soi-même ses esclaves, des BTS spécifiques par exemple échappent quasiment à l'éducation nationale comme ce BTS FNAC d'il y a quelques années ! Les écoles privées se multiplient, l'état dépense des sommes folles pour soutenir, au détriment du secteur public, des universités privées, des grandes écoles dont le but premier est de fournir les cadres du système...
La vieille institution scolaire se meurt, la vieille institution scolaire est morte : sous différents avatars elle est fondamentalement restée semblable à elle-même : aux ordres des puissants. Personne de sensé n'en veut plus désormais et ce n'est ni une question de pédagogie ni de didactique, mais une question de transformation totale de l'organisation et des contenus. Pas de révolution sans que cette institution ne devienne un véritable pouvoir indépendant tout en demeurant un service public, le plus important sans doute. Traditionnellement, on distingue les trois pouvoirs et la constitution garantit l'indépendance de l'exécutif, du législatif et de la justice. L'éducation nationale devrait devenir le quatrième pouvoir, indépendant des instances politiques et économiques, avec son propre budget et une organisation ouverte réfléchissant non seulement la structure de la communauté enseignante : enseignants, élèves, parents, personnel non enseignant, mais aussi celle de la société civile dans sa diversité.
Sur le plan des contenus et de la transmission des contenus, tout est à revoir : le rôle du professeur, celui des élèves, la gestion démocratique des établissements, l'auto discipline, l'organisation et la chronologie des études, les apprentissages, l'ouverture aux professionnels, la participation parentale, la fin des es fermées sur elles-mêmes à partir d'un certain âge...
Quant à son organisation matérielle, il faut en finir avec cette structure carcérale, l'obligation de tenir les corps assis 6 ou 7 heures par jour sur une chaise, l'absence de cogestion véritable pour ne pas dire de démocratie, l'idée qu'il existe des adultes et des jeunes, les premiers détenteurs de tous les savoirs, les seconds cantonnés dans un rôle passif. Cette nouvelle institution réaliserait enfin le vu d'Illich, "déscolariser l'école" tout en devenant libre, indépendante, avec pour principale finalité : l'enfant, sa personnalité, son développement. Qu'enfin les paroles ("placer l'enfant au centre du système") rejoignent les faits.
Un défi à relever certes, mais à l'horizon une société où les hommes seront moins malheureux et où l'environnement sera mieux pris en compte car tout se tient.
Dans cette optique, la question des 60000 enseignants en plus est une fausse fenêtre, une échappatoire. Une fois de plus, la politique shoote en touche et la démagogie de gauche fraternise avec l'hypocrisie de droite.
(Résumé, si l'on veut, d'un essai à paraître (si éditeur lui prête vie): Au diable l'école.)
Au diable l'école ?
Si une éducation est un préalable indispensable à l'épanouissement des individus et à leur intégration dans la communauté humaine, l'institution scolaire, telle qu'elle existe, est-elle l'instrument adéquate, est-elle à la hauteur des attentes que d'aucuns placent en elle ?
Le fameux mythe platonicien de la caverne nous montre certes que l'humanité a besoin de guides, mais le problème est la qualité de ces guides, leurs motivations, car si le philosophe dans la perspective platonicienne peut, doit indiquer la voie des biens et de ces félicités supérieures dont les réalités humaines ne fournissent qu'une imparfaite image, ceux qui s'érigent en maîtres, ceux qui se réclament de cette fonction, de cette vocation, ne le font jamais librement ni avec un désintéressement entier : comme l'histoire nous le prouve, ils sont toujours dépendants, directement ou indirectement, volontairement ou non d'idéologies et d'intérêts qui les dépassent.
L'enseignant pourrait être idéalement un de ces guides qui montrent aux hommes engoncés dans les ténèbres le "chemin supérieur". L'institution scolaire pourrait être ce lieu où l'individu serait révélé à lui-même et à sa vérité tout en favorisant son entrée dans une communauté humaine régénérée, car une éducation digne de ce nom devrait d'abord avoir pour but de permettre à chacun de s'épanouir. Ce n'est qu'après, par une sorte de conséquence, de suite nécessaire que l'individu équilibré, harmonieux entrerait dans la société, sachant que la confrontation des individualités, le frottement des personnalités diverses, loin d'être un frein à l'esprit communautaire, en serait la vraie force. Une éducation qui vise seulement à formater les individus pour les faire cadrer avec le schéma préexistant des sociétés ne mérite pas ce nom. Ce n'est qu'un dressage, une aliénation progressive et l'histoire encore fournit à ce propos une abondance d'exemples. Il ne s'agit donc pas de presser des individus dans des moules préétablis en invoquant les traditions, l'autorité, les nécessités sociales et politiques, économiques, l'idéologie ou les religions, mais de permettre à de jeunes femmes et de jeunes hommes épanouis par une éducation ayant su transformer leurs potentialités en réalités de créer une société, de faire évoluer une société correspondant à la fois à leur singularité et à leur pluralité. Le rôle d'une école bien comprise - mais c'est une évidence - ne peut être autre que de permettre à chacun et à tous le plus grand bonheur possible, l'harmonie la plus parfaite. A chacun de gloser voire d'ironiser sur la signification de ces termes.
Conçue de cette façon, l'éducation ne peut d'ailleurs se limiter au temps de la scolarité et doit accompagner l'individu sa vie durant, car rien n'est jamais définitif, parfait au sens grammatical du terme, d'autant plus que la société elle-même, de par l'arrivée constante de nouveaux membres sera amenée à constamment évoluer.
Pourtant, face à une telle ambition partagée par tous ceux qui se sont appelés pédagogues, la réalité de l'école a toujours été décevante parce qu'elle ne forme par ces individus libres : les enquêtes d'opinion, les faits-divers, le goût actuel pour l'autobiographie, le succès des psychothérapeutes, des gourous, le retour des formes les plus sectaires des religions , montrent que l'homme moderne souffre. En quête des fragments d'un moi riche et ouvert, libre, l'individu se sent à l'étroit, simplifié, schématisé, réifié : il est fait par le système dans lequel il vit ! En revanche, à côté de ces réalités, le discours sur l'école raconte une toute autre histoire faite d'altruisme, d'humanisme et de bons sentiments !
Mais derrière l'affichage de ces bons sentiments, l'école n'a jamais rien fait d'autre que de soutenir les intérêts des castes ou des classes dirigeantes, tout en assurant la paix sociale puisqu'il ne convient pas de laisser trop d'indépendance aux classes défavorisées qui pourraient devenir des classes dangereuses ! Quand les politiciens du XIXe s. s'emparent progressivement de l'école et réduisent ainsi quasiment au silence le premier grand prédateur en matière scolaire, l'Église, l'ancien allié de tous les régimes, le compère avec lequel on s'entendait comme larrons en foire pour faire haro sur le baudet-peuple, l'Église qui dans un monde désormais livré aux forces du capital et de la productivité avait tendance à devenir un chétif adversaire et un empêcheur de tourner en rond, cette main basse sur l'école se fait au nom des plus grands principes, bien sûr, des plus honorables, au nom de l'homme, de la démocratie, de la philosophie, en se drapant dans les plis du drapeau de la République, une Res Publica qui n'appartient en réalité qu'aux nantis, aux nouveaux aristocrates ou ploutocrates nés des nouvelles institutions. Les discours des ministres de la Troisième République, Jules Ferry en tête, sont les exemples les plus parfaits de ce double langage, de cette duplicité. Aujourd'hui, on ne fait pas autrement, mais d'une manière un peu plus fine sans doute : on proclame comme une grande découverte qu'on veut à tout prix placer l'enfant au centre du système scolaire (!) quand on fait tout pour satisfaire essentiellement la demande du capitalisme libéral.
L'école n'est pas à la hauteur des attentes que les esprits naïfs placent en elle : ni émancipatrice, ni libératrice, ni formatrice d'individus libres. L'école est et a toujours été au service de Les hussards de la République sont bien forcés de faire - s'ils y réfléchissent un peu - autre chose que le métier dont il est à espérer qu'ils ont rêvé, un rêve d'ailleurs à peine possible puisqu'ils sont eux-mêmes les meilleurs produits d'un système qui s'est donné d'autres valeurs que les valeurs humanistes et parce que la force de l'habitude fait trouver juste ce qui ne l'est pas forcément
Jadis l'Église a développé un enseignement à son profit parce qu'elle avait besoin d'un clergé assurant son emprise sur tous les rouages de la vie et parce qu'elle cherchait constamment à développer sa puissance. Sa finalité pouvait certes être d'établir le royaume de cieux sur terre, mais la confusion entre la puissance temporelle et l'idéal proclamé a vite fait que les moyens ont vite supplanté les finalités et que celles-ci ont été repoussées dans une eschatologie bien arrangeante, d'autant plus que les puissances laïques qui se reconstituent après la période de trouble suivant la chute de l'Empire romain lui proposent complaisamment leur glaive tout en s'appuyant sur cette Église, la seule force constituée. De cette union à bénéfices réciproques naît une école ou le concept d'une école au service des puissants, une école réservée à quelques élus bien entendu. Mais une école qui fera école !
Une démocratisation de l'institution scolaire n'est pas envisageable jusqu'à la Révolution parce que les conditions ne la permettent pas, même si de nombreux esprits, au cours des siècles, critiquent l'école telle qu'elle est et proposent d'autres modèles.
Sous la Révolution, on pourrait s'attendre à un nouveau départ, mais la situation du pays, les conflits internes et extérieurs ne permettent pas d'avancées notables malgré l'abondance de projets généreux, et aussi, déjà, d'idées qui préfigurent ce que deviendra l'institution scolaire dans l'état bourgeois engagé dans la révolution industrielle. Ces idées germent avec l'Empire qui met en place les jalons définissant une institution consacrée à une nouvelle France désireuse d'entrer dans la compétition internationale. L'Empire, pour de simple raison d'économie et d'ordre public, concède à l'Eglise, rehaussée, après ses déboires révolutionnaires, au grade d'alliée de circonstance, l'enseignement primaire car les principes moraux prêchés peuvent servir à contenter les masses. Cet enseignement paraît se démocratiser au cours du siècle moins par humanisme que par nécessité économique : il faut fournir à l'industrie naissante la main d'uvre susceptible de répondre à ses exigences, l'Église transmettant à ce prolétariat taillable et corvéable contre quelques rudiments d'éducation les consolations nécessaires et les règles morales qui éviteront, pense-t-on, révoltes et troubles. Le secondaire poursuit de son côté assez imperturbablement la tradition de l'Ancien Régime : former une caste de dirigeants qui possèdent un savoir certes nécessaires (ouverture aux sciences) mais aussi unie par une même culture (la place du latin, certains auteurs classiques, la rhétorique, ), les mêmes mythes littéraires et historiques : en un mot, une culture de classe qui contraste avec la maigre culture de masse dispensée aux petites gens.
Avec la République le mouvement s'accélère sous la pression du concurrent allemand particulièrement. 1870-1871 est instrumentalisé comme essayera de le faire plus tard avec la défaite de 1940 l' "État français" de Vichy : provoquer une sorte de sursaut national en faisant passer des vessies pour des lanternes. Pour Jules Ferry et ses successeurs, il faut avant tout de permettre à la France des De Dietrich, De Wendel et autres magnats de rattraper le retard économique et industriel pris par rapport à l'arrogante Allemagne ses Krupp et autres Thyssen, d'adapter les ressources disponibles à la demande des forces du capital de l'état bourgeois. L'école, presque entièrement laïcisée prend certes en charge la formation de quasiment tous les enfants, mais les perspectives demeurent structurellement semblables. Il ne s'agit pas de former des citoyens libres et indépendants dans leurs décisions mais seulement aptes à s'intégrer dans un monde dominé par la lutte économique. La morale chrétienne est simplement sécularisée (comme les premiers chrétiens christianisaient les temples et monuments païens) : le patriotisme, la morale dite républicaine (Travail, famille, Patrie !), le culte des grands hommes et les mythes nationaux
Cet état de fait se poursuit de nos jours sans grands changements en profondeur. On peut seulement observer que la démocratisation apparemment complète de l'institution scolaire, l'accès généralisé au bac et aux études supérieures ne se fait qu'en raison de la demande en compétences de la société productive tout en laissant accroire au servum pecus qu'un bâton de maréchal se trouve au fond de la besace qu'il traîne après lui.
Et le libéralisme triomphant impose ses diktats. Tout cela est dissimulé derrière un rideau de belles paroles, un discours altruiste en apparence et uniquement préoccupé du bien de l'enfant ! On se réjouit de l'accès de 90 ou 98% d'une classe d'âge au baccalauréat, alors qu'il ne s'est agi que de se mettre en adéquation avec les recommandations de l'OCDE, l'agence de notation pédagogique qui distribue satisfecit et blâmes comme Moody's ou Standard and Poors à l'égard de la Grèce ou du Portugal, de la France : le mot d'ordre est clair, l'économie mondiale a besoin de diplômés, de plus en plus de diplômés. Formons donc des diplômés Il ne s'agit que de réguler les flux de travailleurs, de garder au parking scolaire le trop plein qui gonflerait les chiffres du chômage, d'orienter vers les métiers qui ont de l'avenir les jeunes, de faire croire à tout le monde qu'aujourd'hui tout est mieux qu'hier et que nos chères têtes blondes bénéficient d'une meilleure et plus complète éducation, qu'ils seront mieux armés à affronter la vie et les défis d'un monde qui change si vite ! Ces examens sont toujours présentés comme l'ascenseur social par excellence, alors que toutes les études sérieuses montrent que rien ne change dans une société figée dans ses structures. On paye en monnaie de singe ! Et cette société est d'autant plus figée que l'ouverture de l'école sur le monde, ce maître mot tant proclamé de la pédagogie des années 80-90 ne contribue qu'à servir cet impératif d'adéquation entre ce qui est appris et ce qui est exigé par l'industrie, la finance, les marchés : former un exécutant et un consommateur puisque les deux fonctions essentielles de l'homo oeconomicus moderne sont désormais l'inscription dans le processus de production au sens large du terme et la consommation, aucune classe, aucun âge, aucun sexe, aucune confession ne devant échapper à ce double racket, à cette double dépersonnalisation des individus.
La part qui reste à l'être en soi est devenue peau de chagrin, détail de l'histoire.
Pourtant des craquements se font entendre, ce système bien établi se fissure en apparence. Du côté des "usagers" (des usagés !) d'abord puisque les jeunes gens, qui apprennent plus hors de l'école que dans l'école (comment comprendre autrement les révolutions arabes ?) comprennent qu'on se moque d'eux et ne sont plus prêts à accepter pour argent comptant la monnaie de singe qu'on leur donne. Tous ces petits-enfants et arrières petits-enfants d'immigrés, ces jeunes Français de la troisième ou quatrième génération sont moins prêts à révérer un système scolaire et ses valeurs, système qui ne fait pas totalement partie de leur bi culturalité ; toutes ces jeunes filles qui désormais ne veulent plus qu'on les enferme dans ce qu'il y a quelques lustres encore on considérait être un destin de femme. Les jeunes sont mûrs plus tôt et ne sont plus les gogos obéissants d'hier. Ils veulent désormais avoir réellement leur mot à dire et faire entrer dans l'école des concepts comme ceux de bonheur, de créativité réelle, d'autonomie, d'écologie, de politique, de culture vivante, de droit à ne rien faire
Fissures encore du côté des enseignants qui se résolvent de moins en moins à accepter leur destin de prolétariat intellectuel, de rouage d'un système qui les dépasse. Ils ne veulent plus qu'on exige d'eux tout et n'importe quoi : dispensateurs du savoir, éducateurs, animateurs, matons, gardiens d'enfants, boucs émissaires de tous les maux de la société, mal payés, mal traités, réduits à exercer leur métier dans des conditions précaires (classes surchargées, formation réduite à rien, études inutiles ou presque )
Craquements aussi du côté de la structure : des coûts exorbitants et pourtant des budgets insuffisants pour parvenir à un véritable enseignement de masse de qualité ; le poids de plus en plus important du politique et de l'économique qui s'immisce partout en vient même à dicter par exemple le calendrier des vacances.
Craquements enfin du côté des donneurs d'ordre, des mandants masqués : si les statistiques sont excellentes, les résultats de la formation déplaisent, ne correspondent pas aux attentes. On déplore les "niveaux", on considère avec inquiétude cette jeunesse qui commence à revendiquer de façon sauvage, inorganisée et qui n'admet pas que la monnaie de singe qu'on leur donne ne serve quasiment à rien d'essentiel Alors les formations d'entreprise se multiplient, on préfère former soi-même ses esclaves, des BTS spécifiques par exemple échappent quasiment à l'éducation nationale comme ce BTS FNAC d'il y a quelques années ! Les écoles privées se multiplient, on dépense des sommes folles pour mettre en place des universités privées, les grandes écoles. Dans différents pays on privatise l'enseignement abandonnant à ce qui reste du public les cas considérés comme inintéressants, comme le fit le Chili dès l'arrivée de Pinochet
Enfin, il convient désormais de prendre au sérieux la révolution informatique et l'importance des médias dont le poids, dans la formation et l'éducation des individus, est supérieur à celui de l'école.
La vieille institution scolaire se meurt, la vieille institution scolaire est morte : sous différents avatars elle est fondamentalement restée semblable à elle-même : aux ordres des puissants ; personne de sensé n'en veut plus désormais et ce n'est ni une question de pédagogie ni de didactique, mais une question de transformation totale de l'organisation et des contenus. Pas de révolution sans que cette institution ne devienne un véritable pouvoir indépendant tout en demeurant un service public, le plus important sans doute. Traditionnellement, on distingue les trois pouvoirs et la constitution garantit l'indépendance de l'exécutif, du législatif et de la justice. L'éducation nationale devrait devenir le quatrième pouvoir, indépendant des instances politiques et économiques, avec son propre budget et sa hiérarchie réfléchissant la structure de la communauté enseignante : enseignants, élèves, parents, personnel non enseignant.
Sur le plan des contenus et de la transmission des contenus, tout est à revoir : le rôle du professeur, celui des élèves, la gestion démocratique des établissements, l'auto discipline, l'organisation et la chronologie des études, les apprentissages, l'ouverture aux professionnels, la participation parentale, la fin des classes fermées sur elles-mêmes à partir d'un certain âge, la création d'une véritable communauté éducative, ouverte, diverse, mutualiste Cette nouvelle institution réaliserait enfin le vu d'Illich, "déscolariser l'école" tout en devenant libre, indépendante, avec pour principale finalité : l'enfant, sa personnalité, son développement. Qu'enfin les paroles ("placer l'enfant au centre du système") rejoignent les faits.
Un défi à relever certes, mais à l'horizon une société où les hommes seront moins malheureux et où l'environnement sera mieux pris en compte car tout se tient.
François Labbé
Signature :
F. Labbé
Une vocation Extrait d'un livre à paraître: <em>Au diable l'école</em>
"Ils étaient dans ce lycée pour toute leur vie et cette machine d'enseignement, d'espionnage les rabotait. Ils avaient une belle vieillesse de professeurs retraités devant eux et une triste jeunesse de futurs professeurs derrière eux. Ils n'étaient pas courageux, ils n'étaient pas gais. Il y avait trop de puissances sur leurs têtes, trop de fausse sagesse dans leurs coeurs. Ils avaient des femmes, des enfants. Leurs femmes se faisaient des visites. Leurs enfants avaient un avenir et ils se demandaient ce qu'ils feraient de l'avenir de leurs enfants. La vie s'allongeait devant eux comme une allée glacée, elle ne faisait pas un détour, ils ne s'y perdaient pas. (...)Paul Nizan, Le cheval de Troie
Le jeune Renan disait être entré en Allemagne et avoir cru pénétrer en un temple, le Temple du savoir et de la philosophie. Mon émotion devait être à peu près la même que la sienne lorsque, bachelier tout frais émoulu, échappant enfin au ronron des cours du lycée, je fis mes premiers pas dans le hall de la Faculté des lettres de Rennes. Mai soixante-huit venait de passer et l'Université avait jeté au feu la toge ou le costume trois pièces pour enfiler des jeans : elle se voulait désormais au moins en surface foncièrement irrespectueuse et libertaire. La vieille dame coincée s'était transformée en une pétroleuse irrésistible.
Disait-on.
Les Premières années, les bleus comme moi, avaient en apparence tous les droits, rien n'était plus imposé. Le carcan des siècles passés avait été remplacé par la bride sur le cou ! Alors que les "libre-service" commençaient à se développer dans le pays, il était tout naturel que ce monument de la tradition qu'était l'université évolue aussi dans ce même sens d'une inimaginable liberté. Nous avions le droit de choisir nos enseignements, de faire nos emplettes en quelque sorte, le panier à la main, dans un gigantesque marché des idées. Les murs de l'amphithéâtre où avaient lieu les inscriptions étaient couverts d'immenses listes bariolées qui proposaient aux futurs étudiants un nombre incroyable de cours et de combinaisons de matières possibles. On pouvait s'inscrire en lettres, mais en même temps en philo et en psycho, en dramaturgie, en arts plastiques... Si l'envie vous en prenait, vous pouviez ajouter à votre sélection d'autres "valences" : de l'anthropologie, de la musicologie, de l'histoire de l'art voire des mathématiques "modernes", du breton ou des langues anciennes grâce à des cours pour grands débutants dont certains étaient programmés le soir afin de permettre aux étudiants travailleurs de profiter des même chances que leurs camarades plus favorisés par la fortune. Nous applaudissions à de telles débauches de générosité, à de telles avancées sociales, ne cherchant d'ailleurs pas à imaginer la fraîcheur du malheureux étudiant-travailleur à la fin de sa journée !
La seule inscription en lettres vous amenait donc à vous décider pour un certain nombre de cours ou d'unités de valeur (!) parmi une offre aussi diverse que variée. Ainsi, chacun faisait-il ses choix attiré par les intitulés les plus flamboyants, les plus étranges, les plus baroques. Comme dans les halles de la place des lices, le marché hebdomadaire de Rennes, on pesait et repesait les offres, on les flairait, les tâtait, les plaçait précautionneusement au fond de son porte-documents, on y renonçait ensuite parce que l'étal suivant proposait quelque chose d'encore plus alléchant, de plus surprenant, de plus inattendu, d'absolument inconnu mais si riche en potentialités : la littérature comparée, la linguistique, la sémiotique, le structuralisme, des auteurs du second rayon appelés à un nouvel avenir, "Les petits Romantiques", "Le roman policier", "Romans de gare et romans photos", "Le théâtre de l'absurde", "Le nouveau roman", "L'OULIPO" Les héros du moment s'appelaient Goldman, Lefebvre, Barthes, Richard, Jakobson, Foucault, Deleuze, Deridda, Lévi-Strauss, Saussure, Piaget, Chomsky, Greimas, Kristeva, Georges Bataille, Gilbert Lely Ils rejoignaient leurs grands aînés dont on avait entendu vaguement parler en classe : Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Freud, Marx et son copain Engel
Je restai en équilibre sur un pied devant une grande affiche qui faisait ainsi la retape :
"La clef du structuralisme analysé dans ce cours est le primat de l'opération, avec tout ce qu'il comporte en épistémologie mathématique ou physique, en psychologie de l'intelligence et dans les relations sociales entre la praxis et la théorie. C'est en les coupant de leurs sources que nous tenterons d'aboutir à faire des structures des essences formelles lorsqu'elles ne demeurent pas verbales : c'est en les y replongeant qu'on rétablira leur solidarité indissociable avec le constructivisme génétique ou historique et avec les activités du sujet. Le cours aura lieu le mardi de 13 heures à 15 heures. En raison des TP, le nombre de participants sera limité à 30."
Tout cela me paraissait tout de même fort compliqué et, reprenant ma déambulation, je passais au stand suivant où un grand maigre barbu promettait une nouvelle lecture parallèle de Rimbaud et de Corbière à partir des écrits de Wilhelm Reich Les Amours Jaunes me tentaient (un titre pareil !) ; on disait que ce Reich allait bien plus loin que Freud, mais le Dormeur-du-Val qui n'était pas-sérieux-quand-on-a-seize-ans entrevu au lycée ne m'attirait plus trop
En définitive, j'avais choisi de faire un peu de philo, un rien de psycho et d'ajouter une pincée d'histoire de l'art au plat de résistance constitué par la littérature, ne me décidant, par curiosité ou par conformisme moderniste, que pour une initiation à la linguistique. La grammaire - qu'elle soit structurale ou générative - ne m'intéressait pas. Je n'en avais plus fait depuis la quatrième et tout le monde s'accordait pour affirmer qu'avec toutes ses règles arbitraires, elle était parfaitement ringarde et inutile. Un instrument de classe par excellence auquel nous, les enfants de Mai et d'un Marx jamais lu mais toujours revendiqué, n'allions tout de même pas accorder nos faveurs. D'ailleurs les deux profs qui proposaient ce cours, avec leurs cheveux coupés en brosse et leurs costumes étriqués façon IVe République, leur collier de barbe façon MGEN avaient l'air particulièrement réacs, ce qui était une preuve supplémentaire du bien fondé de notre refus, une caution de notre mépris.
En littérature je jetais mon dévolu sur les Petits Romantiques, Auguste Barbier, Claude Tillier, Louis Ménard, Pétrus Borel, Célestin Nanteuil, Philothée O`Neddy, Xavier Forneret, Aloysius Bertrand, Aloysius Block , tous ces jeunes gens pétris d'idées ardentes et généreuses, ces génies maltraités et qu'il convenait de ressusciter, ces mal-aimés honteusement oubliés de Lagarde et Michard. Je trouvais scandaleux que ces malheureux aient dû attendre 1968 pour que les gardiens de l'establishment, les chiens de garde de la bourgeoisie, soient contraints de leur concéder une petite place dans le Panthéon littéraire occupé par les gloires établies. Un impératif moral catégorique guidait mes choix, un sentiment de justice me poussait donc vers eux. Puis, je m'inscris à un cours sur L'Idiot de la famille, parce que ce titre me plaisait et que j'allais enfin faire du Sartre. Je m'inscrivis aussi à un cours sur la Pornographie au siècle des Lumières, à une étude du roman prolétarien : Poulaille, Dabit, Constant Marva, sur lequel, d'emblée, je choisis de faire un exposé bien que n'ayant ni lu une seule ligne de cet auteur ni même jamais entendu parler de lui ! Sa qualité de "mineur du borinage" suffisait à le rendre attirant ! Mon voisin de table choisit - sur les mêmes critères sans doute - de travailler sur Rose Combe, garde-barrière auvergnate... Je décidai aussi de prendre part à une série de conférence sur le Théâtre de l'absurde. Bien que n'ayant jamais de ma vie mis les pieds dans une salle de théâtre, je préférais négliger les Classiques parce qu'ils ne pouvaient être que dégouttant d'une arrogance insupportable. L'absurde me paraissait être plus près des réalités et plus caustique, plus décapant, plus dans l'air du temps. Beckett, Adamov ou Ionesco, cela changeait des Molière, Racine et Corneille vaguement rencontrés au lycée et synonymes d'ennui.
Voilà. Ma première année s'est d'ailleurs bien terminée.
Les autres aussi. Je me suis passionné pour l'Imagologie, le roman policier, le roman noir, le mélodrame, le roman initiatique au XVIIIe siècle J'ai glosé comme je pouvais sur le nouveau roman alors que j'avais à peine feuilleté Balzac ou Zola. Je me suis pris de passion pour Pédro Arrabal et Ariane Mnouchkine quand je n'avais lu que Le Cid, Phèdre et Le médecin malgré lui en termes de classiques. Je fis ma maîtrise sur Léo Malet et passai un certificat sur La Maison du peuple de Louis Guilloux mais j'ignorai les ouvrages de Proust, Gide, ou Mauriac. J'ai fait semblant d'adorer les surréalistes parce que cela se faisait, mais je n'avais plus vu une ligne de Hugo depuis l'école primaire
J'ai passé mes concours avec succès puisque j'étais devenu maître dans l'art de composer une dissertation selon les règles et que je savais mettre en application cet aphorisme qui fleurissait sur les murs de la Sorbonne : La culture, c'est comme la confiture : moins on en a plus on l'étale. Et moi, j'étalai avec assez de doigté ce que je m'étais mis à apprendre à marches forcées dans le Lagarde et Michard exécré quelques années plus tôt, pour faire bonne figure lors de ces concours : un peu de chacun. De quoi faire illusion, le digest d'un digest. Pauvre nourriture !
Je me suis donc retrouvé devant mes élèves, prêt à leur resservir ce que j'avais appris pour qu'ils en prennent de la graine.
Pendant des années donc j'ai bravement fait mon travail d'enseignant et de fonctionnaire respectueux, comblant mon indigence intellectuelle par des préparations intensives et rébarbatives faisant la part belle à la compilation. J'ai fonctionné comme on le voulait. Petit engrenage au cur de la grande machine Education Nationale. Cependant, fonctionner avant et après 68 n'avait pas tout à fait la même signification. Avant, l'éducation nationale, c'était la grande muette ; après il fallait en plus donner l'impression d'avoir l'esprit critique, d'être capable de s'encanailler en entraînant les élèves hors des sentiers battus de Lagarde, Michard, Castex tout en respectant cependant les programmes. Alors, il convenait de reprendre - à dose homéopathique - ce qu'on avait fait en fac : accueillir quelques minores, s'intéresser au roman feuilleton, aux journaux, aux revues, à la littérature de "kiosques de gare", à la pub Il fallait introduire prudemment de nouvelles techniques : les exposés à plusieurs pour favoriser l'esprit de recherche et le travail de groupe, les panneaux expositions, les discussions chaises en rond, les incursions au CDI, les invitations d'auteurs, les projets culturels, le théâtre, la vidéo Il fallait en finir avec les manuels et faire marcher la ronéo à alcool puis la photocopieuse car un-bon-prof-fait-tout-du- début-à-la-fin : recherche de textes abordables par ses élèves, préparation des activités, recherche des aides pédagogiques, sans oublier le "ludique" car on n'apprend que par le plaisir et le plaisir, c'est bien connu, ça se trouve dans le jeu !
C'était donc cette époque inénarrable où quatre malheureux élèves serrés sur une estrade, une feuille en main, se poussaient du coude pour se donner la parole, adressaient des petits signes aux copains du fond de la salle, éclataient de fou-rire ou, écrasés de timidité, n'arrivaient pas à sortir une parole audible, ânonnaient ce qu'ils avaient gribouillé sur leur pense-bête. Le prof faisait semblant d'écouter l'air inspiré, de prendre des notes, surveillait sa montre. Huit minutes l'exposé, sinon, on ne s'en sort pas ! Allez, aux suivants. On fera le bilan demain. Une note de groupe, un corrigé distribué-à-lire-pour-la-semaine-prochaine-et-à-coller-dans-le-cahier et on passe à la suite. Dépêchez-vous s'il vous plaît : on n'a pas que ça à faire !
C'était cette époque joyeuse où des profs de lettres (mais aussi de mathématiques ou d'histoire) écrivaient avec leurs élèves des livres policiers ou des recueils de poèmes, des contes illustrés et des romans-photos. Ils faisaient semblant de croire qu'ils ne servaient que de guide et que le génie de leurs chères têtes blondes était entièrement responsable du résultat final, tiré à trente exemplaires, distribué aux parents ravis, à la bibliothèque du CDI et à monsieur ou madame le proviseur qui y allait d'un petit discours ému flattant l'imagination des jeunes, le dévouement de l'enseignant et les lendemains heureux qui attendaient ces vingt-cinq jeunes gens si créatifs, si bien préparés à affronter les difficultés de la vie.
C'était cette époque joyeuse où des profs montaient de pièces de théâtre en transformant les jeunes en marionnettes, emplacements marqués à la craie sur le plancher de la scène et costumes cousus par une maman dévouée.
C'était cette époque joyeuse où des profs organisaient des cafés littéraires, des expositions en faisant comme si l'idée, la réalisation venaient de l'enthousiasme juvénile des élèves. Les "jeunes" sont formidables et moi je suis l'éveilleur celui qui permet ces opérations hautement culturelles et susceptibles d'un grand retentissement sur l'épanouissement de chacun . Le journaliste de la rédaction locale passait parfois et la documentaliste recueillait précieusement les découpures de journaux dans un press-book qu'on ressortait aux grandes occasions.
Tours de passe-passe, illusions, illusionnisme, encensés par la presse, les revues pédagogiques, les inspecteurs pédagogiques régionaux, les missions culturelles académiques, les inspecteurs d'Académie, les recteurs, le ministre, les concours, les sponsors divers et variés : Crédits Mutuels, Caisses d'Epargne, BNP...
Nos jeunes sont formidables, notre système scolaire fait l'envie de tous les pays du monde.
La parole de Madame ou de Monsieur l'Inspecteur Pédagogique avait alors valeur d'oracle. Lorsque Son Autorité prenait la peine de se déranger pour assister à un de mes cours et vérifier l'orthodoxie de mon enseignement, c'était comme une apparition : Sa Bonhomie soulignait l'excellence de mon travail, la valeur de mon engagement, insistait sur mon avenir de professeur tout en relevant, ça et là quelques petites incongruités, vénielles bien entendu, qui n'entachaient pas la vision d'ensemble mais prouvaient que Son Autorité ne s'était pas déplacée pour rien. Avec l'onction d'un prélat aux doigts boudinés, Sa Grandeur m'indiquait alors d'une façon artiste, les quelques voies que je pourrais emprunter pour améliorer encore ma pratique. Nous nous quittions émus jusqu'aux larmes, lui ou elle devant ce brave fantassin de l'éducation, devant ce Poilu qui en redemandait, et moi face à cette Autorité si simple, si disponible, si républicaine, si satisfaite de moi, si satisfaite d'elle-même. D'ailleurs, preuve indubitable de cette collégialité, au moment de se serrer la main, Son Abnégation daignait descendre de son nuage et prouver à l'inspecté qu'on le considérait comme un collègue, comme un pair en s'intéressant même à ses affaires intimes :
On m'a dit que vous effectuiez des recherches personnelles. Elles avancent, ces recherches, cher collègue ?
Bien sûr monsieur l'inspecteur, et
C'est bien mon cher. Continuez. Il n'y a rien de tel pour son équilibre que de cultiver son jardin secret. Moi aussi je publie, pas autant que je le voudrais, hélas ! mais notre métier est tellement passionnant ! Au revoir et à bientôt. Dans deux ou trois ans peut-être. J'aimerais vous retrouver plus régulièrement mais nous sommes si peu nombreux !...
Napoléon pinçait bien l'oreille de ses grognards lors des revues.
Bien entendu, comme je mettais en pratique les conseils citoyens qu'on me dispensait, ma carrière se déroulait au grand choix : je franchissais les échelons rapidement et allègrement, le salaire augmentait, les heures sup étaient majorées. Les inspecteurs m'appelaient parfois - distinction insigne - pour préparer les sujets de bacs, ceux de BTS et nous passions d'extraordinaires après-midi dans le Parnasse d'une inspection académique (car l'inspecteur aimer à sonder la profondeur des provinces) à discuter sur les textes et les sujets de dissertation que nous devions imposer. C'était l'occasion de longs débats où chacun des élus à ces aréopages délicieux mettait son point d'honneur à lancer des propositions irréalistes mais au combien dignes de témoigner de sa propre valeur intellectuelle, de son imagination, de son originalité, de son modernisme érudit voire de son anticonformisme Une discussion de bas-bleus, une agréable conversation de salon. Allions-nous proposer une phrase de Wittgenstein ou un jeu de mots de Lacan pour ce bac ? Comment, vous trouvez Lacan trop difficile pour nos élèves ? Mais l'humour voyons, et la profondeur ! Nos jeunes s'y retrouveront plus vite que vous ne croyez, cher collègue. Je puis vous assurer que Moi, dès la seconde, j'ai D'ailleurs, l'interrompait un autre d'un geste péremptoire, la subversion du sujet et la dialectique du désir touchent particulièrement l'adolescent. A ce moment-là ajoutait narquoisement une sceptique, on pourrait s'interroger sur la signification du phallus lors de l'érection du phare d'Ar Men ! Na, na, na, mesdames et messieurs ! Pas de débat universitaire, disait avec un bon sourire madame l'Inspectrice enchanté du brain-storming que provoquait sa présence. Nous préparons les sujets du bac ! Nous ne sommes pas en faculté, en licence, même si vos propos se permettent quelques licences, voire licence ! Rires, gloussements, rougissements, trémoussements de plaisir de la basse-cour professorale Vos intentions sont excellentes mais appuyons-nous davantage sur l'actualité, sur l'événementiel. J'ai songé pour le bac G à un sujet dans le genre : Que pensez-vous des nouvelles mères ? Nous utiliserions comme texte d'appui, un article d'Evelyne Sullerot que j'ai apporté, là
Tous sourires avalés, le collège des concepteurs de sujets se penchait alors sur le projet de madame l'inspectrice. Il convenait de le trouver globalement bon et intéressant mais d'exprimer tout de même quelques réserves assez solides pour montrer qu'on savait réfléchir, mais pas décisives au point de vexer madame l'IPR !
L'idée me paraît splendide, mais Evelyne Sullerot, je ne sais pas, un peu trop catho sans doute Mais mon cher, vous confondez sans doute ! Sullerot catho ! Non ! Elle est socialiste, je vous assure.
Et si on prenait un texte de la femme du ministre, ah ! comment s'appelle-t-elle ? Oui, la femme du ministre de la justice Vous voulez dire Élisabeth Badinter, intervient un collègue charitable et condescendante ? Oui, c'est cela, un texte de son histoire de l'amour maternel par exemple Et pourquoi pas l'incipit d'Ainsi soit-elle alors, répliquait une bonne élève entre deux âges ? Moi, je ne suis pas d'accord, ajoutait un autre voulant se signaler à madame l'Inspectrice car il n'avait encore rien dit. Benoîte Groult, c'est tout de même un peu léger pour le bac et Badinter, c'est toujours tellement tarabiscoté. Sans son ministre de mari, son livre !... Je pense comme madame l'inspectrice : Sullerot me convient mieux, et puis nous avons le texte sous les yeux !...
Le temps passait et la proposition de madame l'inspectrice était adoptée à l'unanimité. Quelle belle idée dans le fond ; quelle belle journée avec son point d'orgue dans cet accord unanime sur le texte choisi par Madame l'Inspectrice.
Et si nous allions prendre un café au coin de la rue du Rectorat, proposait l'inspectrice ? En toute simplicité ! Il y a là-bas un petit troquet pas mal du tout et nous l'avons bien gagné ce café. "Un troquet" ! Madame l'inspectrice est délicieuse !
Les ordres de mission signés sur un coin de table pour obtenir le remboursement des frais de déplacement, la garde rapprochée des valeurs de la République, ses prétoriens respectueux emboîtaient le pas à madame l'inspectrice et le petit groupe se dirigeaient alors dans un joyeux brouhaha vers le caboulot fraternellement proposé.
On évoquait les spectacles vus, les derniers livres lus. Chacun attendait poliment son tour, se creusant la cervelle pour ne pas paraître le nigaud de la bande.
Chacun payait sa tasse, bien entendu.
Ces années soixante-dix, c'était encore une époque calme, tranquille. Les lycées ronronnaient. Une association à bénéfices réciproques. Le Ministère avait su intégrer quelques revendications soixante-huitardes et nous avions l'impression - à condition de ne pas trop se poser de questions - que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le nombre de bacheliers croissait, l'objectif des 80% d'une classe d'âge au bac ne semblait plus utopique. Les mauvais esprits qui se plaignaient d'une baisse des exigences ne disaient plus rien. Tout semblait s'être normalisé. D'ailleurs, la généralisation des jurys de bac ou de brevet, les ajustements académiques et nationaux dans une perspective d'égalité des chances, tout allait dans le sens d'une amélioration des résultats.
Tiens, à propos, vous avez participé à un jury de bac ? Je parie que non ! Eh bien, voilà !
Après péréquation nationale et académique, voire départementale, dans un souci d'égalité, des profs correcteurs sont convoqués. On va expédier mettons 100 candidats notés entre 8 et 9,9 à l'issue des épreuves du bac (ça peut être entre 7, et 9,9, voire ). Au maximum, deux ou trois heures de jury sont prévues. Après, signature des ordres de mission pour le remboursement des frais de déplacement éventuels.
Un universitaire (qui n'a plus jamais mis les pieds dans un établissement du second degré depuis son propre bac) préside l'absence de débats. Un professeur par matière est présent. Volontaire désigné d'office, comme l'écrivait spirituellement l'Almanach Vermot.
Le président, après une courte allocution prouvant qu'il vient bien de Sirius et faisant sourire (poliment) la piétaille qu'il a face à lui, passe les dossiers à la chaîne : "Tel candidat a obtenu 8,1 de moyenne ; il a eu 2 en philosophie et avait un 6 aux épreuves anticipées de français. Si le professeur de philosophie et le professeur de français sont d'accord, on peut proposer de majorer les notes dans ces deux matières afin qu'il arrive à 10 de moyenne générale, condition sine qua non de l'attribution du bac. J'ajouterai que son carnet scolaire ne me semble pas trop mauvais, précise le président après avoir jeté un coup d'il sur le dit carnet."
Les deux professeurs incriminés pensent qu'il reste encore 90 dossiers, qu'on voudrait bien partir avant 17 heures. Ils n'ont rien contre. Comment pourrait-il d'ailleurs en aller autrement ? On majore donc. Candidat reçu ! Les statistiques prévisionnelles et les résultats vont bientôt coïncider
C'est comme cela qu'on établissait les statistiques économiques dans la défunte Union Soviétique ; on est resté très politburo dans notre France du XXIe siècle !
Lorsque l'élève recevra sa collante, il s'émerveillera d'avoir eu un 10 en philo alors que son prof, cette carne, ne l'a jamais gratifié d'une note supérieure à 5. Dans le fond, il le savait, il n'est pas si nul que cela et les profs jugent vraiment à la tête du client. Ce salopard de pseudo- philosophe, y pouvait pas m' blairer ! Ce 10, c'est une sacrée baffe qu'il reçoit : il faut que je le voie pour le lui dire et lui mettre les poin(g)(t)s sur les i !
Rien n'est parfait hélas !
Jusqu'alors, l'élève était docile. Le prof respectait son chef d'établissement et son inspecteur, le chef d'établissement respectait le Recteur Tout ce monde appartenait encore en grande partie à la même famille. Une société des connivences : on partageait peu ou prou les mêmes "valeurs", les mêmes idées fondamentales, ce qui était loin de vouloir dire qu'il n'y avait pas diversité d'opinions. Sinon, il n'y aurait jamais eu ces soubresauts de l'histoire qui, d'une manière ou d'une autre, un peu comme les modifications génétiques, font évoluer les choses. Comme dans les meilleures familles, les disputes, les querelles et les répudiations existent. Il y a toujours quelque part un fils prodigue mais le retour de ce fils prodigue est de toute façon prévu et source de tant de joies ! Il est d'ailleurs tout à fait pertinent de se demander si ces soubresauts justement ne sont pas eux aussi inscrits, programmé dans ce grand tout dont fait partie le monde de l'école. Cela ne signifiait donc pas que cet élève (comme le prof, comme le chef d'établissement, comme le Recteur, comme ) n'avait aucune réflexion personnelle, qu'il était fait d'une pâte essentiellement malléable ! Il avait pour sa part simplement enregistré les règles d'un système qui réclame l'impersonnalité, la répétition, le rabâchage. Son véritable moi se développait comme en retrait, à un autre niveau : en classe, dans l'amphithéâtre, il parlait la langue du prof, la langue qu'on attendait de lui avec les quelques variantes plus ou moins autorisées, mais il avait, lorsqu'il était seul, avec ses amis, quand il était en confiance, son propre idiome, son jardin secret. Derrière les apparences lisses et standardisées qu'imposaient notre enseignement, notre éducation, se développait une autre personnalité, riche, rugueuse, insaisissable, désireuse d'originalité mais dissimulée. Sans aller jusqu'à dire que notre enseignement favorisait (ou favorise car rien ne change radicalement) les psychoses, voire une sorte de schizophrénie particulière, il est clair qu'il poussait à la sournoiserie, aux faux-semblants, à une certaine hypocrisie prudente et surtout, en profondeur, à une distance prise avec ce qui était enseigné.
Tant que le modèle scolaire prolongeait, accompagnait le modèle patriarcal en vigueur dans les familles, les choses sont allées leur train de sénateur, leur petit bonhomme de chemin, assez confortablement. Petites filles modèles et garçonnets respectueux devant un papa façon Robert Gérane et une maman Folcoche, élèves attentifs et silencieux devant un Maître impérieux : mais on n'en pense et on n'en réagit pas moins.
Le petit Français a appris à vivre à deux vitesses, à avoir deux vies, deux langues, deux mimiques.
Une richesse dans un sens !
En revanche, depuis que les certitudes d'une certaine tradition commencent à chanceler, depuis que tout fout le camp comme on s'est amusé à le dire et à le répéter, depuis que les nouvelles classes dangereuses ont accès aux études, avec stupeur, ni les parents ni les maîtres ne reconnaissent leurs chères têtes blondes et ces dernières sont moins enclines que jamais à danser, disons, pour faire image, une vie durant, le ballet Jekill/Hyde ! Les problèmes commencent alors ! Révolution culturelle ! Bouleversements ! Rien de sûr désormais La chienlit du Général et les solutions à la Sarkozy. On a déjà connu ça lors de la Révolution, la Grande : à la base un refus des pères ! Anacharsis Cloots écrivait bien avant les événements de 1789 :
Le respect craintif, la vénération profonde pour les vieillards, tant recommandée par les moralistes, est la source de mille maux en politique. L'Orient est engourdi par l'ascendant de la vieillesse ; on a cherché la cause de la stagnation des sciences et de la durée du despotisme dans ces contrées immenses ; je la trouve dans l'autorité des vieillards, pendant que le savant Bailli la cherche en vain chez un peuple primitif, inconnu à lui et à nous. Les républiques anciennes qui donnaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants devaient par cela seul marcher vers la décadence : l'ignorance des pères accumula les erreurs des enfants ; les préjugés se multiplièrent avec les générations.
Et, en 1793, à quelques jours de sa propre et fatale arrestation, il notait avec satisfaction :
Les fils, malgré leurs pères, ont sauvé la patrie dans notre mémorable révolution. L'obéissance des enfants eût bouleversé toutes nos villes à parlements et à sièges royaux. Nous étions perdus, si la verte jeunesse avait sanctionné les erreurs des faibles vieillards.( ) Notre révolution est l'uvre des jeunes gens. Il y a plus de nerf et de civisme dans un écolier de 4e que dans les quatre ou cinq académies du Louvre.
Il est vrai qu'Anacharsis (que certains s'obstinent à orthographier d'une façon intéressante Anarchasis) approchait la quarantaine !
Il suffit d'ailleurs de regarder l'âge des hommes de la Révolution pour nous en convaincre, nous qui attribuons des brevets de jeunesse aux quinquas qui nous gouvernent !
Bref, la fameuse connivence culturelle qui cimentait le tout s'effrite de plus en plus. Certains rejettent la faute sur les soixante-huitards qui auraient sapé les fondements de l'ordre traditionnel. Dans ce cas, hommage leur soit rendu, mais regret que leur action ait été récupérée ou plutôt qu'ils aient été les très probables instruments d'une évolution qui devait se passer au bénéfice d'un système peu enclin aux cadeaux et aux explosions libertaires.
Il faut probablement y ajouter d'autres causes.
Des cultures ou des façons de vivre concurrentes, autres, se sont établies dans le pays même et le profil d'une classe d'aujourd'hui est totalement différent sur les plans socioculturels de ce qu'il était vingt ou trente ans auparavant, d'autant plus que la place du lycée et des études longues ont changé du tout au tout, l'économie ayant besoin de davantage de diplômés, même si ces diplômes, en dépit de dénominations quasiment immuables veulent dire tout à fait autre chose. Enfin, le monde s'est ouvert, les techniques de communication ont évolué, le livre n'est plus la forteresse culturelle par excellence et la finalité des études est tout de même pour chacun d'avoir si possible une bonne place et un gros revenu.
Toujours est-il que le jeune prof des années 70 a vite commencé à se poser des questions et à se demander si ce qu'il avait totalement pris pour argent comptant n'était pas une vaste fumisterie et que lui, pauvre innocent, n'était que l'instrument d'un système inacceptable.
Alors il a compris qu'il ne suffisait plus de quelques photocopies tirées de Libé pour faire un cours, que composer des poèmes surréalistes pour apprendre à écrire était une vue de l'esprit quand on ne possède pas les bases de la langue, qu'imaginer une mise en scène novatrice de telle pièce de théâtre classique en transformant par exemple Le Cid en un western-écrit-en-français-de-tous-les-jours n'améliorait ni la culture littéraire ni les compétences rédactionnelles. Il a compris devant le désastre qui s'annonçait que le Bled, Lagarde et Michard, aussi honnis les uns que les autres n'avaient pas que de mauvais côtés et qu'avant de jongler avec les notions, les savoirs et les savoir-faire, il convenait d'assurer des bases solides sans lesquelles il n'est pas de pensée sérieuse ni de liberté des individus.
Imbécile!
Car le passé est le passé et la Bretagne de ton enfance n'existe plus. Tu peux rouler à travers la campagne, te réjouir des petits tronçons subsistant de la vieille route de Saint-Malo, croire reconnaître un chemin bordé de chênes émondés se perdant dans un fragment de campagne que tu veux croire préservée, être ému à la vue de telle bâtisse de terre qui te ramène cinquante ans en arrière , ces navrantes madeleines que tu t'inventes. La route de Saint-Malo est devenue la Route du Meuble avec ses vitrines proposant salons et cuisines, ses entrepôts de tôle et de verre, la cacophonie criarde de ses énormes panneaux publicitaires, ses parkings goudronnés, ses hypermarchés clinquants, le flot continuels des voitures, de ci, de là, la campagne défoncée, métamorphosée en une gale de terrains vagues ; et ce petit chemin aux chênes émondés entr'aperçu à l'instant n'est plus qu'une impasse débouchant sur des tas de gravats.
Les gravats de ta mémoire eux aussi repoussés en des culs-de-sac inaccessibles.
Le temps, le temps, rouleau compresseur, ne connaît qu'une direction, qu'un rythme, qu'une vitesse, toujours la même, seule constante de l'existence, le temps s'écoule à la même allure depuis toujours et le sablier égrène les mêmes secondes que la montre électronique. Sans fin. Loin de tout rivage, tu erres comme un navire sur son erre, sans repère, sans repaire possible. Emporté. Il n'y a que le vent de la course qui te fouette parfois le visage et fait pleurer tes yeux qui fixent un horizon invisible.
Hélas ! Héraclite avait tout dit en constatant qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et toute la littérature postérieure n'a jamais pu que ressasser, décliner sous toutes les formes possibles ces paroles simples en les affublant de tous les colifichets imaginables. Toute la musique, toutes les danses, tous les beaux-arts, toutes les religions, tout l'amour du monde n'ont jamais tenté que de masquer, que de draper dans des atours faussement splendides cette banale et insipide vérité.
Et ta Bretagne, vieille de plus de mille ans, ta Bretagne est malheureusement toujours jeune, chaque jour nouvelle, chaque jour le jouet des passions, des modes, des intérêts nouveaux et éphémères.
Vieil homme qui s'approche de la grève grise sous un ciel gris, tu crois encore renouer avec les jours évanouis, tu te révoltes contre ce qui a changé, tu racontes hier à des gens qui ne t'écoutent même pas, qui te montrent les dents en riant follement. Hier à jamais disparu.
Assieds-toi sur cette borne oubliée au bord de ce morceau de chemin abandonné aux ronces, assieds-toi et attends.
Signature :
Francois Labbé
Ceci n'est pas un homme...
Chacun sait aussi que la patine des ans et l'inutilité transforment l'objet usuel sinon en un objet d'art au moins en un objet qu'on expose pour ses vertus désormais décoratives et émotionnelles : la charrue repeinte en noir (à défaut d'araire, devenue si rare - et puis "on" la volerait !) sur la pelouse verte, le rouet couleur miel et sa laine blanche dans un coin du salon, les vieilles clés passées à la brosse métallique artistement déposées sur la dentelle d'un napperon immaculée, la varlope vernie accrochée près d'une poutre, le poteau sculpté mélanésien planté devant sa maison de la Baie des Citrons ou de Tina Kitch sans doute, mais détournement esthétique de l'objet dont la fonction pour laquelle il a été créé est désormais niée.
Et bien voilà, je serais donc enfin une uvre d'art ! Moi qui, toute ma vie, aurais tant voulu produire un beau livre, un beau tableau, sans y parvenir, moi qui aurais en vain tant désiré que mes contemporains voient en moi un artiste, par un étonnant retour des choses, l'Art s'est emparé de moi comme si une loi secrète disait : Si tu ne vas pas à l'art, l'art viendra à toi !
"uvre d'art", entendons-nous ! Ma carcasse ne fait pas partie des cadavres plastifiés qu'un bateleur inspiré et vénal promène aux quatre coins de la planète. On ne m'expose pas encore, mais qui sait !
Qu'en est-il alors ?
Pendant 25 années environ, j'ai été, comme tous, plus ou moins, une fonction en devenir : naissance, croissance, études , puis, j'ai intégré la société, où j'ai joué (ou cru jouer - j'ai plus certainement été joué) le rôle que des circonstances bien difficiles à démêler m'ont attribué. En tout cas, j'ai assumé quarante années une fonction et souvent cette fonction a servi à me distinguer d'autres individus ou à m'en rapprocher, voire à me caractériser. Disparu l'être profond au profit du paraître social, de l'étiquette. Un peu comme dans le cas d'une chaise par exemple : celle-ci est simplement un produit de l'ingéniosité humaine pour le repos des jambes fatiguées. Ce à quoi elle a été destiné compte d'abord et on en oublie l'arbre dont on a tiré son bois (à supposer qu'elle soit en bois, le problème est encore plus simple pour les matières synthétiques). Ainsi, pour mes voisins, pour les parents de mes élèves, pour mes collègues, pour moi-même, j'étais d'abord un enseignant, un professeur, un collègue. Parfois on allait jusqu'à dire : Ce monsieur est dans l'Éducation Nationale, sans doute pour insister sur l'aspect carcéral de mon existence! Un petit élément d'une grande machine, voilà ce que j'étais. En bref, une fonction. Ce phénomène ne m'était bien entendu par particulier et il ne concerne pas seulement les fonctions inférieures : dans les journaux, le titre, la désignation des fonctions les plus élevées précède souvent le nom. Le prénom disparaissant quasiment toujours.
Minuscule rouage de la machine sociale, j'ai d'autant plus fonctionné pendant quarante années que c'était même ma définition : fonctionnaire !
Et puis voilà, la retraite après quarante ans de bons et loyaux services.
La RATP change ses bus, la SNCF ses locomotives, le fumeur sa pipe quand ils sont obsolètes, incapables de continuer à remplir la fonction pour laquelle ils ont été créés. Les bus vont à la casse, les locomotives aussi et la vieille pipe disparaît au fond d'un tiroir, purgatoire d'avant poubelle un jour de grand nettoyage, car il n'est pas de 2e Margritte possible. Ça ne marche qu'une fois ou alors il faudrait attendre longtemps, un siècle ou deux : comme dit plus haut, la patine Cependant, un bus sera peut-être sauvé du rebut et rapetassé pour emmener des touristes dans une excursion à l'ancienne comme le font quelques vieux autobus parisiens ; une loc sera rénovée par un groupe de passionnés et fera les délices d'un parc d'attraction Le reste disparaît, sans rémission.
Mais l'homme ? Qu'en faire lorsque sa fonction cesse ? Ses fonctions devrais-je dire puisque la fonction reproductrice est en général en voie d'extinction à l'âge de la retraite et que la fonction consommatrice en prend forcément un coup (compensée il est vrai par les tours-operators, les cures et la pharmacie) ?
L'homme sans fonction, est-il encore un homme? Voilà la question !
La société hésite. Un vieux président reste bien sûr "monsieur le président" même s'il est gâteux, un ministre aussi, un médecin, un avocat Ce n'est pas le cas pour le vulgum pecus. Sans fonction, il devient un retraité aux loisirs éternels, blouson beige, casquette et chaussures de santé.
Pourtant cet homme sans fonction devrait être enfin pleinement, seulement homme !
Jadis, aux heures chaudes de mai 68, j'avais entonné mon refrain contre l'aliénation par le travail, je m'étais indigné à la pensée d'une humanité quasiment réifiée par le matérialisme capitaliste. Maintenant, je suis libre, totalement libre.
A ne pas trop savoir que faire de tant liberté. Car c'est là un second problème. Lors d'un séjour à Bath dans ma jeunesse, on m'avait raconté une anecdote qui m'avait beaucoup impressionné. Une dame de la gentry galloise avait eu pitié du sort réservé aux petits chevaux qu'on descendait au fond des puits pour traîner les wagonnets et qui y demeuraient à vie. Condamnés à l'horreur de l'obscurité des abysses miniers. Shocking my dear ! Cette bonne âme avait réussit à obtenir de la direction des houillères que l'on offre à ces malheureux quadrupèdes une pause en les faisant remonter à la surface. Des vacances en quelque sorte, une villégiature charitable. Tout était près : une immense prairie à l'herbe bien grasse, quelques seaux d'avoine, de l'eau de source Les premiers chevaux furent remontés et, saisis par tant d'odeurs nouvelles, par la caresse du vent, l'ardeur du soleil, aveuglés par la lumière, enivrés par la richesse du picotin qui les attendait, ils devinrent fous. Ils partirent au grand galop, ventre à terre dans une ronde infernale. Ce qui devait arriver arriva : le cur de quelques canassons ne supporta pas cette course effrénée et les autres succombèrent à la richesse inhabituelle de la nourriture ! Au fond de la mine, ils auraient sans doute vécu encore des années ! Le chemin de l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions ! Cette version zoologique de la caverne de Platon m'avait beaucoup marqué d'autant plus qu'en ces années de forte cogitation, on s'intéressait à la dialectique du maître et de l'esclave !
Pour le retraité, privé de fonction, ce pourrait être un peu la même chose. Attention à cette nouvelle liberté ! Danger ! Cet individu habitué plus de la moitié de sa vie à un certain rythme pour ne pas dire à une routine dépersonnalisante, à n'être que le rouage évoqué précédemment, risque de tourner à vide avec autant de danger que les chevaux dans leur pré car rien de plus néfaste pour les mécanismes que de tourner à vide !
Il va pourtant bien falloir remplir ces loisirs vertigineux !
En ce qui me concerne, une chose est certaine, "défonctionnarisé", je ne sers plus à rien : un fusil dont on a limé le percuteur, une serrure soudée, un couteau sans lame, un pneu crevé ou déjanté, voilà ce que je suis ou à peu près.
D'ailleurs, peu de jours après avoir été mis officiellement en retraite, une gestionnaire du personnel de l'éducation nationale m'a appelé de Paris (les agrégés ont ce privilège d'être gérés nationalement et non pas rectoralement !) pour me demander si j'étais d'accord pour que l'on détruise mon dossier professionnel. La question m'a bien entendu choqué sur le moment : détruire mon dossier, c'était effacer les traces d'une activité de près d'un demi-siècle, c'était aussi supprimer les preuves de mon existence passée, de mon fonctionnement, une mort sociale quasiment ! Cette gentille personne m'a alors expliqué que la suppression de tous les dossiers se ferait de toute façon à plus ou moins court terme. Cela faisait partie des modalités de la modernisation de la fonction publique : à quoi bon conserver ces papiers inutiles qui prennent tant de place, nécessitent des soins constants, du personnel et ne sont consultés par personne ?
J'avais fait des recherches quelque temps auparavant sur un dramaturge du début du 19e siècle qui avait travaillé dans l'administration des octrois. J'avais retrouvé son dossier et cela m'avait grandement aidé à le connaître et á mieux apprécier ses uvres, son inspiration. J'avais eu entre les mains, par le truchement de ce dossier volumineux une part de son existence : son cursus, ses maladies, ses demandes, ses joies, ses attentes , tout y était.
Cela ne sera donc bientôt plus possible Mais bon, à l'heure du tout électronique, il n'y a déjà plus de lettres, plus de brouillons d'écrivains, les Proust d'aujourd'hui n'utilisent plus de paperoles ou de becquets On dit de toute façon que ces dates électroniques sont bien fragiles, sujettes aux orages, aux chocs, au temps.
Demain sera sans mémoire.
J'ai accepté en fin de compte que les services du ministère jettent mon dossier aux vieux papiers. Ils l'auraient fait tôt ou tard et j'ai au moins eu la satisfaction masochiste d'avoir décidé de ce petit suicide.
Je ne sers donc plus à rien et mon passé professionnel n'a peut-être été qu'un songe. Pourtant, je suis encore. Cogito ergo sum. Objet ou être gratuit, ne dépendant d'aucune nécessité, n'impliquant plus rien, sans responsabilité. Électron libre, uvre d'art pourquoi pas.
uvre d'art car, d'après ce qu'on dit, non seulement je suis sans utilité aucune mais je coûte cher, un peu comme ces tableaux qui valent des sommes inimaginables. Je suis un objet de luxe que les générations futures ne pourront plus se permettre, moi qui vais jusqu'à manger à l'avance le pain de mes arrières petits enfants putatifs avec ma pension, cette pension qui a fait que mon nom est désormais "inscrit sur le grand livre de la dette publique", comme on me l'a spécifié le jour de mon départ ! Que voulez-vous, les fonctionnaires qui ne fonctionnent plus ruinent les États.
Objet de luxe dénué de toute fonction, qu'on me mette au musée, qu'on m'expose :
"Ceci n'est pas un homme"!
Signature :
Francois Labbé
Racine et Shakespeare; Beaumarchais et Lamartelière
On a sans doute donné de cette longue dispute une vision trop manichéenne, comme si les positions des partisans de Racine et celles des tenants de Shakespeare étaient absolument opposées, irréductibles. Or, Stendhal, dont le romantisme est apparu au théâtre, réclame en fait avant tout une réforme qui n'a pour but que de rétablir le plaisir dramatique en remontant aux sources, aux principes du genre (à Aristote donc). Il esquisse toute une esthétique du spectacle (actions, langue, relations entre la scène et la salle). Il partage certes le désir de nouveauté de certains de ses contemporains, mais il s'éloigne de Hugo en ce sens qu'il songe surtout à une réinvention du comique, victime d'une société qui se prive du rire et il privilégie le'sac de Scapin aux finesses d'Alceste ; il met en question le ridicule et va jusqu'à préférer Regnard à Molière, la plaisanterie au comique, le rire franc et gai au rire grinçant et satirique. Il se prononce en un mot pour la puissance de la vis comica. Avec ses deux Racine et Shakespeare, (1823, 1825) qui encadrent le réquisitoire de l'académicien Auger contre le romantisme, il s'agit moins en fait de théâtre, que de l'élaboration par Stendhal, sous couvert de "romanticisme", du concept de "modernité", de l'essai de mettre en place les bases permettant à la littérature qu'il croit nécessaire à ses contemporains d'avoir des appuis solides.
Le titre de ses essais peut tromper sur ses intentions. En revanche, en France, pendant toute une époque, on a bien opposé Racine et Shakespeare, pour les symboles qu'ils représentent : la supériorité française et les prétentions anglaises, toutes deux ayant vocation ou prétention à s'ériger en règles universelles. Une sorte de prolongation, sur le plan du théâtre - dont on sait l'importance alors - du Discours de Rivarol ayant remporté ex-æquo (mais de justesse !) le prix mis au concours par l'Académie de Berlin en 1784 et qui, sous de nombreux aspects représente le chant du cygne de la foi en l'influence culturelle universelle et pérenne de la France. Une rivalité dont le substrat politico-économique est évident : une sorte de meurtre du père puisque le modèle français partout prisé, celui du Siècle de Louis XIV, qui se prolonge dans le premier tiers du XVIIIe siècle, provoque d'évidentes formes de rejet quand les nations modernes se mettent en place, quand la Prusse commence à imaginer une autre organisation des pays allemands que celle - délétère - du Saint-Empire, quand l'Angleterre a la maîtrise des mers et se met à développer une réelle supériorité industrielle et stratégique, quand les puissances du sud, l'Italie et l'Espagne ont quasiment perdu de leur importance alors que la Russie devient un immense empire et que la menace (unifiante) de la Porte s'efface , opposer Racine à Shakespeare, c'est opposer deux mondes, deux façons de penser.
Ainsi, la Dramaturgie de Hambourg peut certes apparaître comme le paradigme des textes prônant dans les pays allemands l'auteur anglais en renvoyant à ses insuffisances le théâtre français, mais c'est aussi un texte éminemment politique qui réclame en fait la fin d'une "colonisation" intellectuelle imposée par un pays qui, désormais, serait entré en décadence après une réelle période de grandeur. La charge polémique de la Dramaturgie est essentielle et sa portée plus idéologique qu'esthétique quand elle aborde le théâtre français, ce qui explique ses apparentes et nombreuses inconséquences si on tente d'y lire un "système" dramatique. On omet aussi chez le dramaturge Lessing la condamnation des excès de la dramaturgie shakespearienne et la reconnaissance d'un Aristote qui, s'il n'est pas celui des français, lui ressemble tout de même beaucoup. Stendhal n'ignorait pas les articles de Lessing.
D'un autre côté, quand on évoque Voltaire et Shakespeare, on n'insiste pas assez sur l'admiration du premier pour le "génie" anglais, pour sa puissance. On oublie ses propres adaptations, sa volonté de sortir de l'alternative Racine-Shakespeare, sa recherche constante d'une synthèse intellectuellement satisfaisante en montrant que ce génie naturel et l'existence de règles ne sont pas incompatibles et qu'il est capable d'en donner les preuves. Comme Stendhal le proposera, il songe à rendre plus actuel, plus contemporain le théâtre, sans sacrifier les exigences classiques fondamentales...
En 1789, le débat est encore loin d'être clos. La volonté de "régénération" qui jusqu'alors était moins souterraine qu'on s'est complu à le dire peut s'épanouir désormais. Les dramaturges sont partagés entre les exigences du temps, le concept intangible de nation avec son pendant le génie national et leur désir de renouvellement. La tragédie racinienne et les règles représentent certes l'esprit français, mais elles sont entachées du péché d'aristocratisme. Il faudra donc pour le moins rendre "civique" cet esprit... Retourner aux sources, c'est d'une part redécouvrir le vrai classicisme, le théâtre grec, des sources qui n'ont pas été polluées par la décadence aristocratique.
D'une autre c'est rechercher ce modèle anglais dont on dit tant de bien et tant de mal. Il a été certes revu et corrigé par Voltaire, "amendé" pour la scène par Ducis par exemple dont tout le mérite revient, pour les observateurs de l'époque à avoir su régulariser ce qui est de prime abord monstrueux, à faire du dragon shakespearien, un mouton du Petit-Trianon ! Pourtant, Le Tourneur a fourni des traductions qu'on juge assez exactes pour donner une idée du vrai Shakespeare, un Shakespeare qu'on voudrait emblème de cette littérature universelle dont Goethe élaborera la théorie, un Shakespeare qui échapperait ainsi à l'Angleterre, car l'Angleterre et Pitt sont tout de même les ennemis ! Pourtant, au fur et à mesure que la Révolution avance et se radicalise, Shakespeare se révèle être un modèle politiquement plus que littérairement inacceptable, "incorrect", tout comme Racine ne pouvait que déplaire à Lessing puis aux auteurs du Sturm und Drang à une époque où une Allemagne moderne était sur le point de se définir, au moins intellectuellement. On reverra donc en France un Shakespeare plus vrai, plus vivifiant plus tard, après la Révolution, après l'Empire
En revanche, la lecture des uvres d'un auteur du second ou troisième rayon : J.-H.-F. Lamartelière (1761-1830), une hypothèse intéressante est apparue.
Lamartelière est le premier auteur à avoir adapté un ouvrage de Schiller pour la scène : Die Räuber. En dépit des turbulences du temps (la pièce est jouée en 1792 mais prête en 1787), c'est un succès qui traduit chez l'adaptateur une assez grande maîtrise de l'art dramatique, un métier certain...
Tout ceci pousserait à crier au coup de génie : un jeune homme arrive de sa province alsacienne, après quelques publications sans grande valeur, il fait jouer son arrangement sans difficultés et, du jour au lendemain, il connaît justement une vraie célébrité : son adaptation, Robert, chef de Brigands (notons le jeu sur Räuber/Robert !) portée par le métier de Baptiste, un des plus grands comédiens de l'époque, connaît un succès énorme. Elle est jouée partout en France, elle est offerte gratuitement aux armées. On y voit une pièce éminemment civique en ces temps où le théâtre est considéré comme l'école du citoyen. Son succès se poursuivra après la Terreur jusque sous la Restauration, avec une évolution toutefois : si en 1792 et 1793 on admire un texte revendicatif clamant le feu aux châteaux et la paix aux chaumières, cet aspect passera au second plan et on s'intéressera surtout à une trame "énergique" mettant en scène des personnages entiers et volontaires, shakespearien en quelque sorte. Robert, Chef de Brigands sera aussi l'objet de mises en scènes "enrichies" : des régiments défilent pendant la représentation ou pendant les entractes, la musique est omniprésente, en bref, le spectacle devient aussi important que l'action et les répliques. Les caractères sont exagérés, ont introduit des ruines, des forêts, des meurtres... Robert devient ainsi un des premiers mélodrames, sans doute en dépit de la volonté de son auteur puis avec son consentement actif : Lamartelière écrira d'autres mélodrames à succès. Le texte de 1787 est d'ailleurs remanié : on y introduit des motions, des sentences républicaines, on l'actualise.
Quand on est un peu au courant des murs littéraire du XVIIIe siècle, une telle réussite paraît bien improbable : sans appuis, sans caution, sans introduction dans le milieu des Aristarques de profession. La part du miracle est trop importante même si les circonstances peuvent servir d'explication. Ou bien alors Lamartelière serait un vrai génie, une comète traversant comme on dit le ciel du Parnasse, ou bien il faut chercher la raison de ce succès ailleurs.
Lamartelière - en réalité Jean-Henri-Ferdinand Schwingdenhammer - arrive à Paris en 1785 ou 86 sans doute. Il a quitté l'Alsace pour d'obscures raisons familiales et, à Paris, il retrouve son frère aîné qui est vérificateur aux bureaux de la marée pour les droits d'entrée dans Paris. Ce frère lui procure une place dans l'administration de la Ferme, emploi qu'il conservera jusqu'à la suppression de cette administration. Un mémoire sur les relations commerciales avec l'étranger le fait remarquer du ministre Vergennes qui le nomme agent de commerce à Hambourg, une nomination confirmée par le successeur du ministre Montmorin et qui devait entrer dans les faits le quatorze juillet 1789 mais qui, en raison des événements, ne s'accomplira pas.
Son père est l'intendant des Mazarin dans leur fief de Ferrette, près d'Altkirch, entre Bâle et Mulhouse. Après avoir fréquenté les Jésuites de Soleure en Suisse, à Strasbourg, il a fait en particulier des études de droit, sans qu'on connaisse vraiment l'aboutissement de ces études. Il affirme aussi avoir étudié en Allemagne, ce qui est probablement inexact et paraît bien connaître les cantons suisses. Il se passionne très tôt pour la littérature.
Ce sont là bien peu de titres pour se faire ouvrir les portes des théâtres et des salons, des sociétés littéraires, dont il se réclamera très vite. Bien sûr, il parle allemand, mais la colonie allemande de Paris est déjà assez nombreuse et depuis 1760 environ, les traductions de la littérature germanique se multiplient, les traducteurs pullulent.
Ce succès de Robert chef de brigands s'explique en fait par la protection de Beaumarchais sur laquelle tous les critiques du temps s'accordent. On va même jusqu'à affirmer que la réussite de l'adaptation doit beaucoup au crayon du père de Figaro et Charles Nodier, toujours bien renseigné, rapprochera ces deux pièces pour y voir "la dilogie de la Révolution"! Lamartelière, lui-même, confirme en partie ces affirmations : Beaumarchais aurait apprécié ses premières traductions.
Ces constatations ne font en fait que repousser le problème: comment ce jeune inconnu a-t-il pu se faire admettre dans le cercle des proches de Beaumarchais ?
A cette question, deux hypothèses encore :
Lamartelière est employé à la Ferme et Beaumarchais est lié à plusieurs membres influents de cette administration, par amitié et aussi du fait de ses nombreuses activités.
D'autre part, il est possible que Lamartelière, lors de ses études à Strasbourg ait travaillé à la publication des uvres de Voltaire, à la fameuse édition de Kehl commanditée par Beaumarchais : certains passages de son roman Les Trois Gil Blas semblent en effet y faire allusion.
Enfin, il est remarquable de voir combien la carrière de Lamartelière suit les aléas de celle de Beaumarchais.
Après les années heureuses qui ont vu le succès de Tarare (juin 1787), l'achat du terrain près de la Bastille et la construction de sa superbe maison, la condamnation de ses adversaires Bergasse et Kornmann (avril 1789), son élection à la présidence du district des Blancs-Manteaux puis à la Commune de Paris (août 1789), l'épilogue de l'affaire des Auteurs (janvier 1791), Beaumarchais traverse une période difficile sur les plans pécuniaires et créatifs. Son théâtre du Marais ne s'avère pas avoir le succès espéré, ni au niveau de sa production personnelle (La mère coupable n'a pas d'abord la réussite escomptée) ni sur le plan financier (la concurrence est forte ; une cinquantaine de salles fonctionnent alors sur Paris). Beaumarchais qui a lui-même cherché à définir une voie nouvelle à la comédie voire au théâtre en général, a cette idée (peut-être suggérée par le jeune Lamartelière) que le renouvellement des muses dramatiques, s'il ne peut passer par un désormais impossible Shakespeare, peut en revanche trouver dans un auteur allemand (la Prusse fait encore figure d'alliée en puissance ; l'orateur du Genre humain, Anacharsis Cloots, lance plusieurs appels en ce sens) une manière de jouvence. Or, un auteur connaît une vogue sans précédent Outre-Rhin : il s'agit de Schiller. Certes, en 1791-1792, Schiller a évolué et il a pris une certaine distance d'avec ses uvres de jeunesse (Die Räuber datent de 1781 et la première de 1782), mais Lamartelière voit en lui rien moins qu'un génie, un auteur puissant, novateur, allant dans le sens des idées du temps, un Shakespeare moderne et acceptable par les Français puisqu'il ne choquerait en rien les prévenances nationales, le patriotisme ! Il propose à l'auteur de Figaro ce texte qu'il a en poche, texte assez fidèle au modèle, mais qui prend tout de même en compte certains aspects de la sensibilité esthétique française.
Beaumarchais revoit donc avec ce jeune homme son texte, le travaille et le prépare pour la scène de son théâtre du Marais qu'il possède depuis 1791. Son calcul se révèle assez exact, l'idée de jouer Schiller contre Shakespeare était une bonne idée ! La pièce, donnée en mars 1792, est un vrai succès, sur le plan financier d'abord comme sur le plan littéraire même si la "nouveauté" fait hésiter. Certains critiques sont partagés, d'autres condamnent, mais en général on est étonné par "ce drame ( ) écrit d'une manière gigantesque" (Chronique de Paris) et le Moniteur résume bien l'attrait-répulsion qu'il produit : " La pièce des Voleurs, composée en allemand par M. Schiller, est un ouvrage monstrueux, sans unité, sans vraisemblance, sans intérêt. Le génie et le talent y brillent par intervalle, la raison et le goût en sont presque entièrement exclus.
L'auteur français de la pièce Robert, chef de Brigands, a corrigé heureusement beaucoup des fautes de son original ; il fait un plan, distribue son action de manière à produire de l'intérêt. ( )".
La réaction du public est unanime : pendant près de deux ans, on se presse aux représentations et plus tard Stendhal recommandera la lecture de Lamartelière à sa sur en 1805 (lettres du 1er octobre). George Sand se souvient dans ses Mémoires des représentations de Robert données à La Châtre en 1798, de ce drame en vogue dont "la lecture (l')a beaucoup frappée" ; Barbier et Desessarts le louent dans leur Bibliothèque d'un homme de goût
En revanche, même si Lamartelière (et peut-être Beaumarchais) s'empresse de concocter un second drame, Le Tribunal redoutable, une suite de Robert, selon une recette simple : des caractères copiés sur ceux de ce dernier, un fond historique allemand et mystérieux, une situation aisée à mettre en parallèle avec la situation politique ambiante, du spectacle, des séquences faciles à mémoriser dans leurs simplicité populiste, les événements se précipitent. La guerre est déclarée, la Prusse compte désormais au nombre des ennemis, le Tribunal révolutionnaire et des lois d'exception règlent la vie des citoyens, la Terreur s'annonce, le Canon d'alarme retentit et la traduction du théâtre de Schiller (qui vient d'être nommé citoyen français, mais ne recevra son certificat que bien plus tard et n'y accordera pas un grand intérêt), cette traduction donc dans laquelle s'est lancée le jeune Lamartelière ne verra le jour qu'en la toute fin du siècle. Pour l'instant, on se préoccupe davantage d'une fantasmagorique Cinquième colonne qui menacerait les acquis révolutionnaires que d'emprunter à des auteurs allemands des recettes qui amélioreraient le théâtre national. L'étranger n'a pas bonne presse. Fin 1793, Anacharsis Cloots sera d'abord condamné en sa qualité de Prussien ! En outre, le 4 juin 1792, Beaumarchais, qui, comme toujours, a plusieurs fers sur le feu et achète soixante mille fusils destinés à l'armée française mais ne parvient pas à les obtenir, est dénoncé à l'Assemblée comme accapareur d'armes. Fin août, il est enfermé à l'Abbaye et, sur intervention, il part pour la Hollande le 22 septembre alors que son ancien adversaire dans la Compagnie des Eaux, Clavière, complote contre lui avec un autre ministre Lebrun. Réfugié en Angleterre depuis l'automne, il est accusé devant la Convention mais peut rentrer en février 1793. En 1794, le 14 mars, Beaumarchais est placé sur la liste des émigrés alors qu'il a dû se rendre à nouveau en Hollande fin juin 1793 pour cette lamentable affaire des fusils. Il erre depuis à l'étranger ne pouvant retourner en France. Ses appels au Congrès américain restent vains. Dans la misère, il s'installe à Hambourg, là où Lamartelière devait se rendre comme chargé d'affaires en 1789, là où il sollicite à nouveau un poste en 1795. Le 5 juillet 1796, son exil prend fin et il assiste à la reprise triomphale cette fois de La mère coupable en mai 1797
La préface du Théâtre de Schiller qui paraît chez Renouard en 1799 va dans le sens de notre hypothèse de départ : Lamartelière voit dans la muse allemande de son auteur préféré une direction qu'il faudrait prendre pour sortir un théâtre français de l'ornière d'une tradition qui en a fait un spectacle artificiel, suranné. Il cherche par cette traduction à donner des modèles d'une langue vigoureuse et débarrassée d'a priori, de situations réalistes, de caractères naturels, d'un théâtre plus contemporain. Cette préface est aussi une défense et illustration de la langue allemande, selon l'auteur, injustement jugée en France Mais l'époque n'est pas à ce genre de réflexions.
Lamartelière a chanté les débuts de la Révolution avec son Ode à la Nation et son adaptation des Räuber se ressent de cet enthousiasme qui le fait clamer "Despotes assis sur le trône, tremblez", mais en 1792, la tournure des événements lui déplaît. Il rejettera la Terreur, accueille avec soulagement Thermidor, mais souffrira de Fructidor puisqu'il sera incarcéré. Robert, Chef de Brigands sera interdit à partir de mars 1794 et pour une longue période. Il s'est marié à la fille d'un petit artisan, a des enfants et doit subvenir à leurs besoins. Il ne semble pas que Beaumarchais ait pu lui venir en aide. En 1794, il sera nommé commis à la bibliographie le mois même où le Comité de Salut Public mettra "au carton de réserve" son Ode relative à l'héroïsme des marins du Vengeur. Le 4 janvier 1795, sur intervention de l'abbé Grégoire, il est nommé membre de l'administration centrale sise à Aix-la-Chapelle où il est chargé d'enquêter sur les spoliations, les dégradations et le vandalisme en pays occupé. Les administrations centrales seront toutefois supprimées en mai 1796. Il sollicitera des postes à Hambourg, en Suisse mais en vain apparemment. Il renouera alors avec les belles-lettres et aura quelques succès.
Hélas, lorsque le Théâtre de Schiller paraîtra en deux volumes, Beaumarchais aura disparu le 18 mai, l'Empire s'annonce et avec lui le retour à un nouveau classicisme français.
Les critiques auront longtemps la dent dure pour un homme qui, toute sa vie, se voudra un vulgarisateur éclairé des lettres germaniques, pour "ces auteurs français (qui ont) la manie de transposer sur notre scène les conceptions irrégulières des poètes allemands. ( ) Elles ont toute une teinte locale qui nous est étrangère ; elles représentent toutes des murs qui nous sont inconnues, et qui, à nos yeux, ne peuvent avoir aucun caractère de vérité, par conséquent aucun intérêt." (Année Théâtrale de 1801).
Racine ou Shakespeare, puis Racine ou Schiller ?
Racine seul.
En attendant Hugo, Musset et Vigny
Notes :
On se reportera à F. Labbé, Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière, Peter Lang, Paris, Berne, 1990.
Un stage de profs à Maré en Nouvelle Calédonie L'anthropologie au jour le jour (1)
Gueules blafarde à l'aéroport sous les néons couverts de toiles d'araignées. Bâillements. Bonjour ! Bonjour ! Dur dur, si tôt !
La cafétéria est ouverte, un deuxième petit déjeuner ne sera pas de trop après l'enregistrement des bagages. W , notre collègue prof de culture kanak est déjà attablé : il nous présente un géant rasta, chemise blanche, lunettes Sarkozy dans les cheveux et sourire très océanien. Beau gosse malgré ses gourmettes et montre chrono plaqué (?) or... Son cousin. Le premier pilote kanak ! C'est lui qui va tenir le manche à balai. On plaisante : un kanak aux commandes ! Au secours ! Remboursez les billets. On veut pas mourir ! Le cousin en rajoute : il va nous faire un ou deux loopings ! Cris d'horreur ! Ça rigole ferme ! Ambiance colonie de vacances. Un étudiant de Wallis a sorti son jukulele, d'autres consommateurs tapent dans les mains en cadence. Chant en l'honneur des accompagnateurs, du pilote, du stage à venir. Dans le hall, les voyageurs transportent quantité de bagages de fortune : cartons, congélateurs portables pleins de produits inexistants sur les îles, caisses de bois contenant des poulets, un cochonnet...
Nous atterrissons à Maré après 35 minutes de vol sans problème. Le pilote est venu s'asseoir quelques minutes à côté de son cousin. Une stagiaire est invitée à venir s'installer dans le cockpit. Sous ce soleil levant le lagon est magnifique, un chromo pour pub. Au creux de sa couronne corallienne, frangée d'une mer émeraude, l'île est plate comme une galette, mais assez grande : 1/3 plus étendue que la Martinique, pour moins de 6000 résidents !
Le stage en immersion commence. Un car affrété par la municipalité nous attend (sur le plan administratif, l'île ne constitue qu'une commune). Nous logerons en tribu. Ce stage est important pour ces jeunes gens qui sont appelés à passer leurs premières années d'enseignants en brousse, c'est-à-dire dans des agglomérations qui ressemblent davantage à des hameaux, situées à des heures de voiture de Nouméa, au milieu des forêts tropicales ou sur des montagnes difficilement accessibles, voire sur des îles comme Maré. Ces jeunes gens, donc, ont rarement quitté Nouméa ou viennent de France, d'autres TOM/DOM, de l'étranger. Ils auront à se faire à la "coutume", à des habitudes nouvelles, à des élèves particuliers, à des structures socioculturelles inconnues, à des milieux souvent très pauvres économiquement mais riches d'autres trésors qui leurs sont encore inconnus : c'est le moyen de leur faire prendre conscience de leur situation en Nouvelle-Calédonie et d'aller au devant d'impairs qui pourraient être regrettables.
Pour moi, c'est une expérience extraordinaire, la découverte d'un monde totalement ignoré.
Avant de prendre le bus, W nous présente le Grand Chef de l'île, un quinquagénaire bien mis, très clair de peau, les traits fins et une abondante chevelure blanche qui lui donne un air de poète romantique, Leconte de Lisle ou Hugo, d'aristocrate en vacances. Il se rend dans la "capitale" pour participer aux réunions du Sénat Coutumier, une instance créée après les Accords de Nouméa. Il nous souhaite bonne chance.
Le bus nous amène vers notre tribu. Nous faisons quasiment le tour de l'île: des côtes idylliques bordées de cocotiers mais peu de plages, des formations rocheuses étonnante et une petite route qui serpente entre d'interminables forêts basses, un maquis en mal de gigantisme, laissant derrière soi de nombreux petits villages aux maisons de parpaings ou de tôle éparpillées sur de vastes espaces, des villages dont le centre est souvent occupé par le temple seul bâtiment en dur. Impression de grande pauvreté. On nous salue partout à grands renfort de gesticulations et de rires. Le bord des routes est par endroit jonché de détritus : plastiques, emballages, boites de bière. Ça et là des dépotoirs...
Nous arrivons à la tribu.
Le bus s'arrête auprès de ce qui peut être le centre, devant un ensemble de maisons en tôle reliées entre elles. Il n'y a ni temple ni église. Le village semble vide. Sous le soleil déjà très fort, une grosse impression de tristesse. Nous déchargeons nos volumineux bagages. De la maison principale proviennent des chants. Des femmes apparemment, ou des enfants. Y aurait-il une école ? W , qui est originaire d'une tribu voisine, assure que non : on prépare simplement notre accueil et on nous laisse d'abord souffler.
Puis, la porte de cette maison s'ouvre et un groupe d'une cinquantaine de femmes et d'hommes en sort. Un vieillard, le président de l'Association villageoise qui nous accueille, accompagné d'un quadragénaire musclé, le pasteur ou diacre, se dirige vers nous avec beaucoup de solennité.
Un chemin de bienvenue a été préparé : nous devons passer sous un portique de feuilles de palmes qui a été fleuri pour rejoindre le terre-plein situé devant cette maison.
Pendant notre déambulation, nos hôtes chantent. Nous nous arrêtons et battons la cadence avec nos mains. Un stagiaire wallisien a sorti son ukulélé et accompagne les chants. Tous les âges sont représentés hormis les enfants qui sont à l'école. Les robes mission multicolores se balancent harmonieusement au rythme du chant. La cérémonie est très solennelle.
L'homme âgé déroule sur le sol le tapis de la coutume, lentement, mesurant chaque geste qui doit avoir sa signification.
Le directeur de l'IUFM, P , dépose nos présents sur ce tapis (robes mission, tissu, argent, cahiers, livres, jeux éducatifs ) et fait un court discours de remerciement (on dit qu'on s'humilie devant celui qui reçoit, mais c'est une traduction très imparfaite des termes originaux). Le représentant du village apporte ses propres dons et répond au discours en évoquant le plaisir de nous recevoir, le sens profond de la coutume, de ces échanges de cadeaux. Nous remercions à notre tour par la voix d'un stagiaire.
Une courte prière (les Maréens sont très croyants ; l'ancrage religieux - comme sur le "Caillou" - est énorme. Ce sont surtout des pasteurs protestants qui ont christianisé au 19e puis au début du 20e siècle, comme le pasteur Leenhardt, par ailleurs un des principaux ethnologues de Mélanésie- mille excuses pour cette remarque "bas-bleus") et nous rejoignons le groupe des villageois. Les barrières tombent : nous nous embrassons, échangeons des paroles plus personnelles. Nous faisons désormais partie du village : nous pouvons nous déplacer où bon nous semble sur le territoire de la tribu.
Nous rejoignons d'abord nos quartiers. Une cousine de W a préparé les bungalows réservés aux accompagnateurs, de simples maisonnettes à toits de tôle, un lit, une armoire. Depuis une année, le village a l'eau courante. Le groupe disposera d'une douche et d'un WC. Nous n'aurons pas à retrancher sur le confort auquel nous sommes habitués. Il faudra seulement s'organiser. Les stagiaires logeront dans de superbes cases traditionnelles. Bien sûr, les représentations de l'hygiène ne sont pas celles de l'Européen moyen, mais cela a peu d'importance et ne gênera personne. Dans ma jeunesse, il n'y a tout de même pas si longtemps, nous vivions à quatre dans deux pièces mesurant à peine quarante mètres carrés et nous ne connaissions ni l'eau courante sur place ni les WC ! Nous n'étions pas malheureux !
A peine installés, il convient d'aller présenter la coutume au chef du village et à sa femme qui nous attendent assis sous leur véranda.
Nous déroulons le tapis des offrandes devant leur petite maison, nous échangeons cadeaux et paroles. Le chef souligne la nécessité selon lui de voir son village s'ouvrir au monde extérieur. Il a encouragé la création d'une Association au village dont le but est de fravoriser ces opérations d'ouverture : des groupes du Vanuatu et du Caillou ont déjà été reçus ; un groupe de gamins de la tribu ira en retour passer les vacances de Pâques à Port Villa. Lui qui a ses enfants en France est persuadé des bienfaits de ces opérations qui doivent toutefois s'inscrire dans le cadre de la coutume, cette coutume qui relie les vivants aux générations passées et prépare l'existence des générations futures. Il est particulièrement fier d'accueillir cette fois de jeunes professeurs
Un somptueux petit déjeuner nous attend : une grande table a été dressée et décorée. On nous sert le café, des gâteaux, dont le fameux pudding de Maré hérité des pasteurs anglo-saxons venus des Fidji, des fruits, mangues, ananas, bananes, oranges, avocats... Nos hôtes n'ont pas pris place à la table. Cela ne se fait pas. Ils se tiennent debout, autour de nous, prêts à nous rendre le moindre service. Une majorité de femmes d'ailleurs. Les hommes sont allés boire leur café arrosé autour du feu, derrière la cuisine. Un foyer y est installé et les immenses marmites cuisent posées sur deux rails d'acier qui traversent flammes et braises.
Pas d'enfant, sinon des bambins qui nous grimpent sur les genoux, pas intimidés pour un sou : les plus grands sont à l'école pour la journée. Les collégiens sont en général pensionnaires car l'établissement est assez loin et ils ont, le soir, de meilleures conditions pour travailler. Dans les maisons composées en général (il y a quelques exceptions) d'une petite salle-cuisine et d'une chambre commune, il n'y a pas la place pour une table qui permette les devoirs. Le seul endroit possible est la maison commune mais comment alors se concentrer ? Ces enfants sont joyeux, en bonne santé, très sales pour un regard européen : les parents accordent peu d'intérêt à la propreté extérieure. Les nez sont morveux, les mains crasseuses, les habits dans un état impossible, mais tout cela est secondaire, le sourire des enfants, le plaisir qu'ils ont à nous grimper dessus, à nous embrasser, à nous prendre dans leurs petits bras est bien plus important même si je ne puis m'empêcher (réflexe d'Européen, et qui plus est d'Européen passé par la Suisse et l'Allemagne !) de moucher le petit Denis qui ne peut plus respirer que par la bouche tant son nez est bouché par un opercule récalcitrant et fuligineux du plus beau vert.
Nos hôtesses chantent également. Nous interrompons nos libations pour reprendre en chur quelques strophes dans la langue de la tribu, strophes que notre collègue mélanésien nous a apprises et qui ont beaucoup de succès.
Wacucu ni adraie
Sere ma kaka waon
Wadrongo be ci thaet
Sere ma iq watitew wapunie
Popo koa koa
De vieilles dames se rappellent avec émotion qu'on les chantait à l'époque de leur enfance et, tout au long du séjour, nous croiserons des hommes et des femmes, qui, l'oeil complice, fredonnent les couplets que nous avons rapportés.
Puis, nous nous installons dans nos quartiers, visitons le village et les alentours. Un habitant me montre le chemin d'une petite plage. Il propose de m'accompagner. Tout au long du chemin, il m'indique les plantes, les événements qui se sont passés en tel ou tel endroit... Ce chemin est un livre d'histoire et une leçon d'ethnologie. Nous longeons une falaise percée de cavernes situées en aplomb de notre sentier. Ces grottes sont tabou et contiennent les ossements des anciens. Le silence est de rigueur. Nous nous recueillons un moment.
La plage est un vrai bonheur : un mouchoir de poche mais un sable blanc, une eau absolument transparente et une grotte fraîche pour s'abriter. Calypso où es-tu ? A quelques dizaines de mètres de la rive, une île carte postale couverte de pins colonnaires et de cocotiers : c'est l'île aux crabes, me dit mon guide ; il suffit de se baisser pour les cueillir. Ils pullulent et sont délicieux ces crabes de cocotiers m'assure-t-il. Le repas du lendemain lui donnera d'ailleurs raison car leur chair a tout à fait le goût de la langouste, mais d'une langouste onctueuse.
Nous retournons à la tribu où un repas gargantuesque nous attend : du poisson du lagon, de la viande, ignames, taros, patates douces, patates carry, salade, mangues...
Nos stagiaires se méfient un peu de ce poisson car la "gratte" menacerait et ces poissons comme le perroquet ou le napoléon sont en général réputés gratteux. Le poisson s'empoisonne avec des micro-organismes qui attaquent les coraux souvent mal en point (en raison de la pollution locale voire mondiale) et ces micro-organismes provoquent des maladies allergiques longues, douloureuses et parfois mortelles ! Mais bon, on prend le risque... Il faut dire qu'on a tous commencé à manger sans savoir et nos hôtes nous rassurent d'ailleurs...
Après le repas, je rejoins les hommes, autour du foyer, pour le nescafé. Ils me racontent leur vie, leur travail, leurs champs où tout pousse, leur fierté de connaître Nouméa ou d'avoir fait le service en France, leur regret aussi qu'il n'y ait pas assez de travail sur Maré et que l'argent soit si rare. Leurs inquiétudes enfin quant à l'avenir des enfants. Ils veulent aussi savoir d'où je viens, comment je trouve l'île, si le village ne me paraît pas trop sale. La bouteille de Johnny Walker, la bouteille carrée, circule suivie d'une boite de Schweppes tiède...
L'après-midi est réservée à des activités en atelier : certains étudiants iront travailler dans les champs, d'autres pêcher, d'autres organisent une maternelle avec les petits et les mamans. Je me joins à un atelier de tressage où des dames d'un certain âge m'apprennent à confectionner de petits paniers, des chapeaux, des plats en feuilles de palmier. Ces dames sont assises à même le sol dans leurs robes mission multicolores, ou allongées. Certaines s'endorment... Nous discutons de tout et de rien. Notre atelier attire d'ailleurs beaucoup de stagiaires. Nous sommes dans un autre monde ; le temps n'a plus d'importance ; les produits de notre artisanat serviront une fois ou deux, pas besoin de thésauriser. L'éphémère, l'absence de calcul ; nous vivons l'instant. Des femmes chantonnent. L'après-midi se termine. Les stagiaires rentrent fourbus, coups de soleil, enchantés. Chacun raconte à l'autre ce qu'il a fait, ce qu'il a vu. Nous sommes tous un peu désorientés par cet univers où chacun vit de ses produits, où l'on ne manque de rien mais où - comparé à nos standards de vie - règne un certain ascétisme. 4% de la population de l'île dispose d'un travail salarié. Heureusement que 20% des Maréens travaillent à Nouméa... D'ailleurs, les habitants s'excusent constamment de leur dénuement, de ce village où rien ne se passe. Bien entendu, ils attendent nos démentis, nos dénégations mais ils savent qu'ils ne disposent pas de ce qu'on a ailleurs...Nous sommes désorientés mais aussi un peu honteux, nous les riches, nous les pollueurs du monde, nous les exploiteurs de toutes les richesses face à ces hommes et à ces femmes qui prennent le temps, sans doute moins par goût que par nécessité ou obligation, nous qui ferons des leçons à leurs enfants....
J'ai rencontré le lendemain, en allant téléphoner, une jeune femme, S . Nous avons échangé, avec la complicité de l'obscurité quelques paroles. Elle avait proposé avec un jeune homme qui l'accompagnait de me montrer le chemin de la cabine difficile à trouver dans l'obscurité totale. Ce qui ressortait de cette conversation, c'était le mal-être de ces jeunes gens qui avaient fréquenté l'école jusqu'en première et se retrouvaient sans perspectives dans leur tribu avec un regard nouveau sur les pratiques autoritaires des chefs et des petits chefs, sur les règles de la tradition, sur les interdits liés à la coutume. Ils se sentaient prisonniers, paralysés, incapables d'agir.
S est une jolie jeune femme que j'ai revue à plusieurs reprises. Elle se refuse à porter la robe mission et se promène en jeans et T-shirt, avec ostentation, provocation. Toujours fuyante, elle était rarement présente lors de nos repas. J'avais remarqué lors de notre fête d'adieu qu'elle était absente. Le lendemain, je la rencontrai près de la mer. Elle revenait de son champ avec deux ignames dans un panier. Elle me proposa de partager avec elle une noix de coco, ce que j'acceptai. Nous nous assîmes à l'ombre et je lui demandai pourquoi elle nous avait boudés : "Je n'aime pas les profs", me dit-elle en guise de réponse. "J'ai quitté le lycée à cause d'une prof, d'une blanche qui m'a humiliée toute l'année. Une méchante femme." Elle ne voulut pas m'en dire plus mais tout d'un coup, elle se mit à pleurer : elle ne supportait plus la vie dans la tribu, les autres femmes, l'alcoolisme des hommes, leur brutalité parfois, l'autorité sans partage des chefs et pourtant, elle devait y rester car elle n'avait pas le choix. Elle n'avait que son champ et ce qui y poussait pour se nourrir et nourrir son fils âgé de 14 ans. Le père vivait dans un squat de Nouméa et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs années. Elle avait essayé d'obtenir de son clan qu'on l'aide à bâtir deux cases et un bloc sanitaire sur son terrain pour y recevoir des hôtes payants et améliorer sa condition matérielle : parlant un peu anglais et évidemment parfaitement le français, elle pensait pouvoir accueillir des touristes d'Australie ou de Calédonie ; elle voulait semer une pelouse, installer un banc, un barbecue.... Le chef de son clan s'y était opposé jugeant que son champ devait suffire à cette fille-mère peu honorable ! Le grand chef aurait même été indigné de sa demande. La banque de Maré à laquelle elle s'était adressée avait pris conseil auprès du grand chef de l'île qui venait de décliner la demande... A force d'insister, elle avait obtenu du maire de la commune, qu'il convainque son chef de clan et la laisse libre de construire ce que bon lui semblait. Elle eut ainsi l'autorisation de faire une demande de devis pour ses deux cases et son bloc sanitaire auprès de la seule entreprise de l'île, appartenant à un fils du grand chef. Le coût était de 1500 euros, une somme énorme pour elle et que la banque lui avait refusé parce que - officiellement - elle n'avait pas de garant et qu'elle risquait de ne jamais en trouver...
Voilà sa situation... Que dire ? Assis à côté de cette femme en pleurs face à cette mer si bleue sous ce ciel pur, dans ce paysage magnifique ?
Je l'ai raccompagnée au village. En silence. Je lui proposerai d'être ce garant. Etait-ce une bonne chose ? Nous avons échangé nos coordonnées. Elle ne s'est jamais plus manifestée. La carte que je lui ai écrite une année plus tard lui est-elle seulement parvenue ?
Le lendemain donc de cette arrivée en fanfare, nous avons passé la matinée au lycée professionnel de Maré, rencontré la proviseur, une dame de choc qui a impressionné les stagiaires, mais en mal car elle s'est obstinée à ne pas répondre à leurs questions. Son côté autoritaire et vieux grognard à-qui-l'on- n'en remontre-pas n'a guère convaincu. Son établissement paraissait être dans un assez mauvais état. Impossible de rencontrer professeurs ou élèves. Nous n'aurons droit qu'à madame le proviseur (qui était auparavant en poste - adjointe - en Alsace), à ses cigarettes, à sa voix rauque et à son maquillage exagéré.
Le repas à la cantine était en revanche parfait avec ses élèves transformés en serveurs stylés !
L'après-midi nous avons rendu la coutume à la femme du Grand chef, visité le centre culturel Yéwéné-Yéwéné, un magnifique bâtiment mais en mauvais état : le nouvel administrateur, nommé par le grand chef, serait sans qualification et ne s'intéresserait au centre que comme source de prébendes et en raison de la villa de fonction. La maison des femmes, que nous souhaitions visiter est fermée, mais nous rencontrons les responsables de la médiathèque.
Nous visitons le mur de Maré, une construction en carré de 50m de côtés faite d'immenses blocs de pierre assez bien appareillés qui font penser aux murs de Machu-Pichu. Une forteresse ? Un monument ? On ne sait pas. Il aurait au moins un millénaire et de telles constructions ne sont pas rares dans le Pacifique
Le soir, nos hôtes nous attendent avec un repas somptueux et de la musique. Nous prenons en charge les enfants pour les aider dans leurs devoirs.
Et puis il y aura la découverte du collège, d'un principal très réaliste, celle d'une école primaire et une rencontre passionnante avec des instituteurs tous kanaks, sur le bien fondé du français, sur l'enseignement des langues kanaks, la nécessité de les normaliser et le non sens de cette grammatisation pour des langues orales très "évolutives" par essence. Amusant de voir que les quatre langues vernaculaires principales sont passées à l'écrit - comme l'allemand - à partir de la traduction de la Bible ! O Luther ! O Leenhardt ! Nous assisterons au conseil municipal de l'île, rencontrerons le directeur du marché, un géant barbu et chevelu qui élève trois cent ruches et se débat comme un diable pour valoriser les produits de l'île, nous discuterons avec les marchandes (essai de vente jusqu'à 10 h. puis troc car la clientèle "acheteuse" est rare). Nous visiterons avec intérêt le chantier de la future décharge publique prévue pour toute l'île mais exclusivement construite par des firmes métropolitaines. On nous explique les difficultés de l'installation de l'eau : les robinets cassés, le refus de payer cette eau car provenant d'un sol qui appartient aux ancêtres, le casse-tête pour mettre en place une éducation à l'environnement, tracer une piste, installer un poteau car les terres sont coutumières. On veut peut-être aller trop vite. Des intérêts sont en jeu Mais nous nous taisons. Nous sommes des invités respectueux
Une cuisine scolaire va être construite. Elle offrira quelques postes de travail (mais à qui? Les Kanaks de base sourient quand on pose la question...) et surtout n'achètera que les produits locaux (mais à qui? Les Kanaks....). Elle permettra aussi d'assurer - pense-t-on -un repas équilibré à chaque enfant, car on nous dit que de l'igname à tous les repas ou des patates douces pour changer, ce n'est pas forcément diététique. Chacun sait que l'enfant a besoin de viande, de frites et de yaourts Danone
La voie du modernisme est tracée par par les seuls qui ont la distance (et l'argent) pour juger : les membres de la famille du chef et leur vassaux... Mais il faut bien commencer quelque part. Notre Révolution a aussi été menée par des bourgeois qui assuraient en premier lieu leurs avantages...Les errances du progrès, sa dialectique... Progrès ?
Nous avons donc beaucoup vu, beaucoup appris et nos stagiaires ont matière à développer les projets interdisciplinaires sur lesquels ils travaillent. Nous rentrerons plein d'usage et raison.
Une fête nous réunira un midi au bord de la mer chez un neveu de notre collègue W , qui essaye de lancer un petit village de vacances. Ambiance sympa, buffet fabuleux, danses et musiques. Cette fois, nous sommes tous mêlés, hommes et femmes. C'est l'IUFM qui invite. Le patron de ce camping-restaurant tient un discours de jeune homme d'affaires et explique que si on veut s'en sortir, il faut bosser, "Il faut en chier ; aller tirer les arbres de la forêt, les traîner, les tailler, se défoncer, moderniser, aller à l'école le plus longtemps possible pour avoir de bonnes idées..." C'est le message qu'il cherche à faire entendre à ses compatriotes. S'il a réussi, lui, c'est à force de travail !
J'ai l'honneur de pouvoir me servir parmi les premiers car j'appartiens aux "vieux". L'âge est ici sacré. Une brave dame m'a pris par la main et m'a dit de me lever, d'y aller : "T'es un vieux, comme moi et en plus t'es un homme. Vas-y, les derniers servi n'auront pas tant que toi !".
Il y aura encore une soirée avec danses et chants à laquelle nous participons activement, les stagiaires, les formateurs. Les villageois ont de très belles voix. Ils ont du style, de la solennité même dans leurs divertissements. Nous faisons un peu bande de fêtards avec nos voix fêlées et nos chansons pas très édifiantes. Mais bon, le Gaulois face au Kanak... Nous dansons Raides et compassés à côté de ces corps déliés et de tous les âges... Mais j'en rajoute sans doute. Avant de repartir vers le confort de nos vies, il faut bien laisser éclater sa mauvaise conscience et battre sa coulpe de maso occidental.
Le vendredi après-midi a été consacré aux devoirs à faire avec les enfants. Une immense école sous les palmes ; un idéal scolaire et un vrai travail. Emile océanien.
Les mamans passent et regardent. Les papas interrogent timidement.
Pendant une pause, un homme avec qui j'ai pas mal discuté m'emmène visiter une grotte où sont enterrés les ancêtres : il a le droit, c'est une prérogative de famille ; trente minutes d'errance en forêt et d'escalade. Je fais celui qui est habitué, que rien n'effraye, d'autant plus qu'une stagiaire est aussi venue. Pour la première fois de ma vie j'ai gravi une pente à pic sur 5 m au milieu des fougères arborescentes et des manguiers, le tout en claquettes ! Le spectacle est grandiose. Cette grotte est une cathédrale. Il me montre les ossements. Une dizaine d'alcôves. Des restes d'adultes et d'enfants. Il me montre le squelette d'un grand guerrier, prend le crâne et m'indique les dents : toutes en bon état. Il me montre les siennes ! Horreur ! La civilisation ! Conclut-il en souriant !
Le dimanche, jour du départ, nous refaisons la coutume et il y a bien des sanglots dans les gorges. J'ai l'honneur de parler. Pas facile de finir mes phrases.Tout le monde pleure en échangeant adresses et numéros de téléphone.
Mes deux amis, Wakine et Francis me font leurs adieux. Nous nous verrons à Nouméa. Ils viennent dans trois semaines et ils mangeront à la maison.
Wakine est pasteur et sculpteur. Avec sa femme, dans le respect de la religion et de la coutume, Wakine essaye de former quelques jeunes. Sa femme a acheté une machine à coudre et fabrique des robes mission. Elle a une apprentie qui va bientôt travailler seule. Wakine a formé Francis à la sculpture. Tous deux constituent un petit pôle de dynamisme dans le village.
Francis était pêcheur. Il avait acheté un bateau et se débrouillait bien. Il avait aussi acquis un congélateur pour son poisson. Mais, dans la société mélanésienne traditionnelle, ce qui est à toi est à moi et inversement : son congélateur était régulièrement vidé et il n'y avait pas toujours assez d'ignames pour compenser... Alors, il a arrêté et a appris la sculpture : on ne lui prend pas ses uvres au moins et il va les vendre de temps en temps à Nouméa où sa femme demeure et fait les ménages. Il fallait bien payer le bateau. Son vu le plus cher est que ses enfants aillent en France. Pour cela, ils doivent aller au lycée et il lui faut de l'argent. Pourtant, il est chef de clan... Il ne sait plus trop si son fils doit lui succéder. Quand son père est mort, il serait bien resté au service, lui, en France, mais il avait fallu rentrer...
Wakine m'offre une sculpture et ici, un cadeau, c'est quelque chose de sérieux, un morceau de soi ; Francis m'entraîne par la main jusque devant la cocoteraie : il me photographie et demande que je le photographie à mon tour. Souvenirs, dit-il.
Quand on part, c'est moi qui pleure. Francis me réconforte ; on ne voit pas ses yeux derrières ses lunettes de soleil à la Ray Charles : "Comme toutes les fins, ce départ est un début. A bientôt Swa", me dit-il pour me consoler
Question totale? Question partielle? Pensée unique! Du bon usage de l'interrogation et de ses conséquences psychologiques, éducatives...citoyennes!
L'art de poser les questions serait-il révélateur des mentalités ou, pour remonter encore plus en amont, ne serait-il pas formateur même de ces mentalités ? Sans aller jusqu'à prétendre que questionner, c'est structurer, au cours de plusieurs séjours professionnels en Allemagne, au Danemark ou en Australie, j'ai pu remarquer à ce sujet que les différences avec la France sont éclatantes.
Ainsi, j'ai souvent assisté à des leçons de jeunes professeurs étrangers et, lors du bilan à l'issue du cours, le conseiller pédagogique faisait le compte rendu exact des questions posées, reprochant quelquefois à ces jeunes gens d'avoir laissé échapper, de s'être laissé aller à la facilité d'une ou deux questions totales, condamnant ainsi l'élève à ne répondre que par " oui " ou par " non ".
En revanche, dans des situations parallèles en classe française, lors de la venue d'un inspecteur pédagogique par exemple, ces questions totales sont les plus nombreuses ! Mme l'Inspectrice, ou M. l'Inspecteur, au cours du traditionnel " confessionnal ", ne reviennent jamais sur cet aspect du questionnement. Ils s'intéressent davantage à l'exactitude technique des termes employés par le professeur, au jargon pseudo savant, à son savoir, au sacro-saint programme, à l'impérieuse contrainte temporelle : une leçon doit tenir dans les 55' d'une séquence. Mme ou M. l'Inspecteur cherche au mieux à établir une connivence d'érudit sur tel ou tel point et ne condescend qu'à un regard artiste, attristé ou exagérément enthousiaste, sur les " performances " des élèves.
Or, ce problème de l'interrogation est essentiel pour le professeur, parce que c'est avec lui que l'enfant affûte et met au point le matériel discursif dont il aura besoin dans sa vie de citoyen responsable. Montaigne exigeait du maître, après Rabelais et d'autres, qu'il fasse trotter l'élève devant lui, qu'il le mette sur la montre au lieu d'en régenter l'esprit. Or, on est loin de suivre ces préceptes à l'école comme ailleurs, lorsqu'on demande par exemple, à une gamine de dix-douze ans comme ce fut le cas récemment, lors d'une émission de France-Culture consacrée aux bibliothèques : " Es-tu contente de la bibliothèque de rue ? " ou bien " Depuis que tu fréquentes la bibliothèque, as-tu remarqué des progrès à l'école ? ". On s'attire au mieux un oui franc pour la première question et un oooui hésitant pour la seconde. Le contrat est certes rempli : la question a eu sa réponse, l'enfant s'est exprimé, mais le questionneur s'impose au questionné puisque cette manière, dans le fond, conditionne totalement la réponse et que répondre non aurait signifié chercher un conflit impossible dans le contexte : face à une dame aussi gentille et auréolée de prestige que la journaliste menant l'interview. A dix ans, on a déjà le sens du politiquement correct et c'est aussi le bénéfice de ce genre de question.
Il suffit d'écouter les médias pour comprendre que cette façon d'interroger est habituelle dans notre pays : la question totale, c'est en quelque sorte la maîtrise de la réponse : je veux un oui, j'aurai un oui, je sais où je vais. Il y a du plébiscite recherché dans cette façon de poser les questions qui ne permet apparemment en rien l'expression libre de l'individu. Chaque question totale induit sa réponse et n'est dépassée en coercition que par la question rhétorique (souvent sous forme interro-négative, le nec plus ultra), que le brillant professeur prépare en fin de période, pour obtenir l'assentiment muet et moutonnier de son public blasé.
Bien sûr, ces habitudes n'ont pas fait que nos élèves et professeurs soient condamnés définitivement à cette funeste alternative. Le pays regorge d'excellents orateurs, de fins discoureurs. D'ailleurs, chaque bon élève sait qu'après avoir dit oui ou non, il faut expliquer sa pensée, donner des exemples, illustrer ses propos. Chaque interviewé devrait savoir que la question est plus prétexte que texte et qu'on est libre alors de se laisser aller au gré de sa fantaisie sans se préoccuper du sens profond de cette ennuyeuse question. Les hommes politiques sont maîtres en ce domaine, la question n'étant qu'un embrayeur plus ou moins direct permettant de servir des vérités préparées de longue date. Plats réchauffés, journaliste micro-ondes
Chaque bon élève, certes, chaque élève provenant d'une famille où le oui et non ne sont pas les seuls éléments d'une communication binaire (trinaire devrais-je dire puisqu'il existe le match nul du " cheu pas "), malheureusement, ces familles sont de moins en moins nombreuses et pour quantité de raisons ; même dans ces milieux, cantonnés dans les beaux quartiers, une telle gymnastique est de moins en moins habituelle. Que dire alors des classes nombreuses où il faut vite avaler sa réponse pour laisser le temps au voisin de dire son oui ou non (et leurs variantes stylistiques : ouais, OK, ben, c'est ouf ), ces classes qui s'habituent au laconisme avec un professeur submergé par la masse et qui se contente trop souvent (mais peut-on lui en vouloir ?) du hochement de tête dans un sens ou dans l'autre.
Il est bien de voir que l'enseignement du français accorde, à l'écrit, une large place à l'argumentation, à ses techniques, à ses méthodes. (La technique, les serrureries avant les idées !)
Il serait bon qu'à l'oral aussi, soient données à celui qui est interrogé toutes les possibilités de sortir d'un mutisme auquel il est quasiment condamné par un interrogateur manichéen et peu enclin à le faire trotter devant lui.
De peur qu'il ne lui échappe ?
Signature :
Francois Labbé
Calédonie 2 Amertume et nostalgie d'un Zoreille
Quand je suis arrivé en Calédonie, j'étais plein d'espoir. Ce qui restait de l'idéalisme soixante-huitard, braise froide sous la cendre d'années de conformisme, venait de reprendre flamme. Les alizés sans doute !
Je savais le pays en pleine redéfinition. Moi qui avais vécu dans mon adolescence les dramatiques remous de l'Algérie en travail d'indépendance, je croyais comprendre que la France, enfin, était fidèle à la mission qu'elle avait inscrite dans ses Droits de l'Homme: être une puissance émancipatrice et généreuse. Je venais de publier un essai sur Anacharsis Cloots, apôtre de la République universelle et malheureuse victime d'un Robespierre, expression directe, lui, d'une autre France, égoïste et exécrable, méprisante, j'avais envie d'apporter ma pierre à la construction de ce nouveau pays. J'avais donc postulé et obtenu un emploi de formateur de professeur de lettres à l'IUFM de Nouméa. On m'avait choisi, de l'aveu même du directeur de cet établissement, parce que j'avais dirigé pendant des années, avec un collègue allemand, le lycée franco-allemand de Fribourg et possédais ainsi une bonne expérience du bilinguisme. Décisifs auraient aussi été une thèse et des articles sur les sociétés traditionnelles, divers travaux sur le phénomène initiatique, ainsi que des " missions " exercées dans le cadre des services culturels de l'Académie de Strasbourg.
Passons sur les détails : j'ai dû déchanter.
D'abord ce que j'apportais dans mes bagages était inutile. Le bilinguisme ? on n'y touche pas, il y a des gens sur le territoire qui s'en occupent, chasse gardée...
L'osmose des sociétés traditionnelles et du monde moderne, les questions d'acculturation ? déjà pris. Rompez, il n'y a rien à voir.
Votre idéalisme cosmopolite ? Vade retro
Trêve d'explications : je devais me contenter de préparer les étudiants au concours de recrutement comme je l'aurais fait en France. On ne veut pas voir de tête qui dépasse. Ronronnons tranquillement. Contentez-vous de faire de vos ouailles des professeurs certifiés, certifiés conformes au modèle métropolitain, estampillés, sécurisés. Qualité France comme le beuglent les slogans.
A Oran, en 1960, des exaltés de l'OAS avaient peint en lettres géantes " Ici la France " sur la jetée principale du port, en Calédonie, malgré les apparences et les accords de Nouméa, on ne fait rien d'autre mais plus discrètement. C'est ce qu'on appelle l'évolution des mentalités. La main de fer s'est glissée dans un gant de velours. On sait aujourd'hui qu'il faut surtout éviter la confrontation. Alors on travaille l'esquive et la manipulation. Comme partout. Rien de plus. Ce qui ne veut surtout pas dire que les finalités changent ! Que non mon bon monsieur !
On ne voulait pas, mais alors pas du tout de mes idées, de ce que j'avais la vanité de croire être un savoir faire, une expérience, des compétences. Un répétiteur, voilà ce qu'on souhaitait, rien d'autre. Du psittacisme en veux-tu en voilà ! La voix de son maître, salaire indexé et obligation de réserve ! Pour le reste, va t'ébattre sur la plage, va contempler le lagon, va partager le bougna avec les accueillantes populations de la côte est qui n'attendent que ta venue
Même à l'université, on me fit savoir que j'avais beau être dix-huitièmiste de formation et de passion, c'était encore là un fief inaliénable; en revanche, on me refilait les cours sur le dix-septième siècle, pour lesquels j'étais moins compétent, mais qui n'intéressaient personne!
Une idée comme une autre de l'emploi local, de l'adéquation entre les ressources humaines et les tâches à assumer. La conception étonnante d'un territoire présumé définir son avenir (commun) et qui ne recycle que les poncifs les plus usés et les plus délétères !
Comment se fait-il qu'un pays qui, un jour, va accéder à une indépendance, que je lui souhaite (j'ai sans doute le tort de croire encore au nécessaire meurtre du père) ait recours, dans un consensus à peu près total, même si les paroles semblent changer avec la couleur de peau de celui qui les profère, à de vieilles recettes qui ont fait la preuve sinon de leur échec au moins de leur nocivité globale ?
On sait que les problèmes écologiques seront cruciaux dans les décades à venir et les élus de ce pays refusent de voir les réalités en face, de penser aux générations de demain en recourant à ce vieux modèle de l'industrialisation à tout crin !
On fait croire aux habitants qu'ils sont les propriétaires des richesses du sous-sol de leur territoire alors que les multinationales ne leur laisseront que des miettes tout en hypothéquant lourdement l'avenir comme elles l'ont toujours fait et comme elle le feront toujours et partout au nom du seul article de leur code moral : Tu feras tout le profit que tu pourras sans considérations adventices.
Le destin de Naurou est exemplaire à cet égard !
Au lieu d'employer les chômeurs du pays, on pense à faire venir une main d'uvre taillable et corvéable à merci : les nouveaux négriers rameutent plus pauvres que les pauvres, et on s'emploie à faire passer des vessies pour des lanternes en affirmant qu'il n'est pas possible de faire autrement et que les travaux finis, on renverra gentiment tous ces gens-là. Le citron pressé, on jette l'écorce disait Frédéric ! La République des Droits de l'Homme couvre pudiquement de ses trois couleurs des agissements qui feraient bondir en Europe !
On produit une énergie coûteuse et malsaine, avec des méthodes obsolètes alors que d'autres solutions existent dans un pays qui a tout à gagner à une gestion décentralisée des ressources renouvelables, abondantes sur le Caillou.
On chante la beauté (éblouissante il est vrai) du lagon, son inscription au patrimoine mondial , et on continue à noyer ses profondeurs de tonnes de poussières crachées par Doniambo-SLN, de tonnes de résidus des moteurs à explosion mal réglés et fonctionnant avec un diesel de basse qualité, de l'hypothéquer par une gestion aberrante des eaux usées, des eaux d'infiltration et des décharges d'ordures A coté de tout ce gâchis, connu, vérifiable, patent, on ergote sur l'inocivité des futures ( ?) usines du sud et du nord ! On se gargarise de Goro et de Koniambo alors que Xstrata, Inco et autres Falconbridge se livrent une partie de monopoly bras de fer pour décider qui, en définitive, dévorera la proie, dépècera le pays quand il lui plaira, comme il lui plaira, tant qu'il lui plaira
On pense encore en termes d'" arrivages " (de France, d'Australie, de Chine ) alors que la Calédonie pourrait être autosuffisante ! On sacrifie l'agriculture, l'élevage, la pêche et on importe par tombereaux les pommes ou les kiwis insipides de Nouvelle-Zélande, les camemberts et les yaourts de France, le raisin ou les biscuits d'Australie
On ne cesse de présenter le tourisme comme la panacée alors que, dans le meilleur des cas, ce cache-misère ne profite qu'à quelques-uns et, bandit manchot par excellence, permet aux malins et aux multinationales encore de tirer le gros lot des défiscalisations aveuglément accordées par un Etat pourtant en rupture de paiement.
On continue malgré quelques réformes ponctuelles (les langues autochtones par exemple) à enseigner comme si on était au cur de l'Europe sans ne serait-ce que se poser la question de la langue française comprise non plus comme apanage de la seule France métropolitaine mais de cet ensemble qu'on désigne par le terme de " francophonie " qui demande à être définie dans la pluralité de ses cultures et la variation de son idiome!
Et puis, pour faire court, il y a toutes ces inégalités qui gâchent le plaisir du Zoreille un peu pied-tendre, Tuband, Tina Golf, Motor-pool, les Marinas , les grandes propriétés de la côte ouest pour quelques-uns et la misère pour la majorité, les squats, l'alcool et le shit. On ne distribue plus de verroteries mais quelques allocations et des flatteries. Ah ! ça, les flatteries : la coutume ! la coutume ! Le pilou ! Les sculptures mélanésiennes ! La culture ! La Kulture ! Le centre Tjibaou, matérialisation de la fierté rendue à l'autochtone! Merci Renzo Piano ! Voilà ! redonner sa fierté à ce peuple et le laisser sucer son pouce pour le reste. Mon frère, mon compatriote, je respecte l'Homme en toi, j'aime tes traditions, tes habitudes, tes façons de voir J'organise des rencontres, je distingue les talents parmi les tiens et voilà, tu dois t'en contenter : la fierté, c'est l'essentiel ! Tu es riche de cette fierté qui ne coûte rien à te la concéder. Vois ton jeune poète qui déclame ses vers à Carrefour devant une pyramide de paquets de nouilles en promotion, vois ton écrivaine consacrée et son Naufrage que tout le monde porte au pinacle avec une belle langue de bois unanime, vois tes chanteurs admirés jusqu'à La Rochelle Pousse ton caddy, dépense tes allocations : foire aux vins de France sous les Tropiques, veau de Métropole, foie gras, champagne si tu peux, le prix de la baguette n'augmentera plus, tu n'auras pas le ventre vide... Vois comme tes sénateurs-chemise-cravate, tes députés, tes représentants politiques roulent en gros 4x4, en berline de luxe, passent leurs vacances sur la Gold Coast ou vont skier près de Christchurch ! Tiens, ce petit gars de Tiga que tout le monde connaît, un modèle ! il se rend chaque mois à Paris. Classe affaire jusqu'à Tokio ; first-class ensuite. Il dîne avec Chirac, Lafleur le bichonne ! Prends exemple ! ça me rappelle ce général de 14 dont on racontait la vie dans le livre de morale de mon enfance : il était pauvre, allait pieds nus, apprenti boulanger dès 8 ans, il avait appris à lire seul, à la lumière rutilante du four devant lequel il passait 15 heures par jour: par son abnégation, son travail, sa vertu il était devenu une gloire nationale, un héros inscrit au Panthéon des réussites républicaines ! Tu vois petit, la Nation t'offre cette chance ! Tu as aussi ton bâton de maréchal au fond de ta gibecière !
Une autre façon de raconter l'apologue des talents ! Foutaise !
Car, il y a les fantômes du Caillou Bleu ou d'autres squats, qui glissent, ombres sombres le long des routes mal éclairées, les types à la démarche hésitante et aux yeux rouges, pétés comme des soufflés trop cuits, les pauvres gosses qui jouent à la roulotte russe en traversant pieds nus la voie expresse parce qu'il manque des passerelles, les gamins qui passent des examens et ne savent pas quoi en faire, les femmes battues, la violence, l'alcool encore, la drogue, les bingos, la coutume appliquée selon le bon plaisir de quelques-uns et ceux qui en souffrent
Tout cela rappelle ce que Fanon appelait le néo-colonialisme quand il fustigeait les nègres blancs, valets d'un colonialisme qui déjà se voilait la face Tout cela rappelle Saison au Congo et les réquisitoires de Lumumba! Il faut relire Césaire, Césaire d' " avant " bien entendu !
Et puis, il y a encore le poids de ces Eglises omniprésentes, cette hiérarchie des pasteurs et autres ecclésiastiques qui se sont fait une place entre les masses corvéables et les autorités coutumières et politiques : néo-colonialisme encore ! ces robes missions que les femmes portent, symbole d'une certaine aliénation et qui, par un tour de passe-passe prodigieux, sont présentées comme la marque d'une identité ! Miracle des Eglises !
Il y a encore ces ateliers de Chinatown et leur prolétariat misérable venu d'on ne sait où, ces Ni-Vanuatus, sans-papiers à la calédonienne, exploités au noir Et puis, tous ces fonctionnaires qui ne viennent pas forcément pour l'amour du pays ou l'appel de l'aventure, d'un futur à bâtir qui serait la meilleure repentance, tous ces fonctionnaires qui partent en retraite à des âges insensés, tous ces autres retraités qui ont compris qu'il vaut mieux être plus riche au soleil du Pacifique, indexation oblige, que pauvre sous la neige d'Europe !
Oui, je suis reparti déçu.
Déçu parce que je quittai un merveilleux pays, des gens souvent charmants, beaux, intéressants, une société bigarrée où, en apparence, on ne se pose pas la question de la couleur de l'autre, une société riche de toutes ces cultures qui se rencontrent, échangent ou pourraient vraiment échanger et d'autant plus déçu que la direction prise par ce pays m'horrifie, qu'on évite les débats de fond et que personne ne souhaite prendre de véritables décisions, proposer une alternative solide. Indépendantistes ou loyalistes ( ?), c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour paraphraser feu Jacques Duclos. Et la France, son représentant en tête, joue une fois de plus un drôle de jeu !
On y manque de courage sans doute. Chaque groupe ethnique a ses martyrs, leurs paroles gravées dans le bronze, paravents commodes du style on a déjà donné !
Et pourtant ! cette île pourrait devenir un paradis, Utopia réalisée ; elle en a toutes les potentialités, mais il faudrait créer une société vraiment nouvelle en se refusant à copier ce qui existe et à déléguer tous les pouvoirs aux puissances de l'argent. La Calédonie a besoin d'une vraie démocratie. Rousseau pensait que cela n'était possible que si les populations étaient réduites. C'est le cas ! Il avait d'ailleurs écrit une extraordinaire Constitution destinée aux Corses et qu'il faut relire.
La Calédonie a besoin d'imagination. Seule l'utopie est réaliste criaient les murs en 68 ! Si l'intention est restée voeu pieu en Europe, elle n'en conserve pas moins son inaliénable véracité.
Tout dans la société coutumière n'est pas bon. Il s'en faut de beaucoup ! Tout dans la société industrielle de consommation n'est sans doute pas à rejeter Mais !!!
On parle beaucoup en France, avec des trémolos dans la voix, de cette repentance plus haut évoquée et on n'a pas tort, mais au lieu de paroles, il faudrait des faits et la France pourrait profiter de pays comme la Calédonie pour redresser la barre, faire une uvre exemplaire en collaborant honnêtement à des lendemains qui chantent vraiment.
Hélas ! les habitudes sont tenaces et le portefeuille a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ou refuse de connaître.
Je suis déçu et malheureux car, en deux ans, j'ai aimé ces îles, leurs habitants et j'ai eu l'impression d'assister à un énorme gâchis. Comme il y a plus de trente ans, alors que mon pays, la Bretagne, avait, pour plein de raisons, des velléités d'autonomie, que nous étions quelques-uns à rêver d'une Celtie différente et qu'il fallut vite déchanter devant l'agressivité adroite d'un système qui imposait - de l'intérieur - une agriculture moderne et intensive mais destructrice d'une identité et de l'environnement, une industrie profiteuse établissant l'équilibre entre un chantage à l'emploi et un refus des paramètres écologiques, une industrie désertifiant les campagnes et entassant les ouvriers dans des cités immondes, les livrant impréparés à des besoins inutiles et malsains et eux s'abandonnant à la rhinocérite ambiante.
Jadis aussi on nous a consolé avec le respect de notre culture ! Le pansement sur la jambe de bois ! Région dévastée ? nous ne le nions pas : pollutions multiples, routes inutiles, hypermarchés partout, une province enbétonnée mais une province embretonnée aussi puisqu'on soutient vos Bardes, vos Glenmor, vos Servat, vos Stivell, vos cercles folkloriques, Jakez Hélias, Cheval debout, Cheval couché. Votre langue même sera une option au baccalauréat. On l'enseignera à l'université Voyez, le solde est positif !!!
Trente-cinq ans après, l'épreuve de breton existe certes au baccalauréat, il y a un capes de Breton, le Festival des Vieilles-Charrues attire les foules, les Grands Voyageurs ont choisi Saint-Malo intra-Muros pour jeter l'ancre, les Calédoniens participent au Salon du livre insulaire de Douarnenez, Citroën, bon an mal an produit près de Rennes 50% des véhicules de la marque, Lannion s'est spécialisé dans les télécommunications, le plan routier breton enserre la province dans le filet de ses rubans noirs, le tourisme
Mais la langue bretonne est morte, les plages se couvrent d'algues, les rivières tournent au cloaque, les paysages se normalisent : mêmes panneaux publicitaires, mêmes routes, mêmes temples de la consommation partout, des ZUP, des ZAC, des ZEP , et l'industrie, qui a assez profité, délocalise vers d'autres horizons plus profitables Le damier du bocage a cédé place par endroit aux déserts de l'open-field, les sols ne se régénèrent plus, les ports de pêche s'endorment dans l'inactivité...
Le désert.
Je suis déçu et j'ai peur pour toi Calédonie.
Ce texte expédié aux Nouvelles Calédoniennes n'a été que très partiellement publié: 7 lignes! On ne peut pas mieux dénaturer une expression!
Nouméa la blanche; Calédonie 1 Un si beau pays livré aux marchands du temple (de la consommation, des cons, sots, mateurs)
- Donnez-moi un pays, une région, une île, tempérée, d'une nature riche, habitée par une population respectueuse de son environnement et j'en fais un paradis écologique débarrassé de toutes les nuisances possibles!
- Monsieur le Président, ce pays existe: c'est la Calédonie!
Tu es belle Calédonie. Sans discussion. Le paradis sur terre, pour ce qui est des paysages, de la mer, du lagon, du climat.
Mais partout au bord de tes routes calamiteuses mais pittoresques ces boites de bière écrasées, défoncées, éclatées, partout ces chiffons de carton, ces haillons de papier plaqués contre les talus, comblant les fossés.
Number one, Bischoco, Riz d'ici, sachets mac-do, boites de lessive, vieilles couches...
Déchets de toutes sortes, sacs plastiques jaunis et déchiquetés collés aux épines des bougainvilliers, fûts défoncés nageant entre deux rats morts sur les eaux huileuses des canaux urbains, cloaques à ciel ouvert vomissant leur lèpre épaisse sur la mangrove étique parmi les palétuviers maladifs, rongés de boue bleue et d'effluents visqueux tandis que dans le ciel se déploie le drapeau noir de l'usine Enercal...
Des 4x4 à en faire des cauchemars et des piétons, en claquettes dans les fossés, un cabas à la main pour aller à Carrefour se jeter sur les arrivages de France, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, se précipiter sur l'illusion
Tina, son golfe et ses villas au luxe impudent, Motorboat, bien sûr mais le Caillou-bleu aussi et, un peu partout, ses petits frères les squats où s'entassent les pauvres gens.
Je rêve de ce monde d'avant, de ces hommes sombres et fiers, trapus et élégants marchant lentement pieds nus dans une nature sans tache, de ces femmes portant leurs sacs en pandanus tressé chargés des fruits de la terre, de ces sentiers d'herbe foulée et odorante serpentant à l'ombre des collines entre les niaoulis blancs et les colonnaires austères.
Je rêve
*
Hier, je suis allé au Centre Djibaou.
Le Centre", c'est, avec raison, l'orgueil de la Calédonie, le fruit culturel des accords de Nouméa, plus que le souvenir, le legs du grand homme dont la statue de pierre noire domine les magnifiques bâtiments imaginés par Renzo Piano et parfaitement intégrés au paysage dans cet environnement tropical, ce bord de mer idyllique de la presqu'île de Tina avec sa végétation exubérante, ses fougères géantes, ses pins démesurés, ses banians compliqués, ses niaoulis parfumés, ses lianes échevelées, ses fleurs de tiaré ou de frangipanier...
Le centre, c'est le signe du renouveau de la culture mélanésienne: des expositions, des artistes locaux et internationaux en résidence. Une direction kanak, un personnel kanak, mais kanak chic, intellectuelle, de gauche, coutumière et moderne, indépendantiste et francophile, profondément océanienne et universelle. Très tendance... Fonctionnarisée. Fils et filles de grands chefs, cousins et cousines de chefs, neveux et nièces de petits chefs...
Le Centre, ce sont des cases métaphoriques, le génie autochtone transcendé par le talent d'un grand architecte admiré d'un Mitterrand pharaon socialiste. Si peu socialiste. Regardez Djibaou, pensait-il François-le-Petit-qui-se-voulait-si-grand, pendant qu'au loin les cendres retombaient sur Mururoa, neige funèbre qui étouffe les cris de ceux qui souffrent encore, regardez Djibaou, continuait-il, pendant que le souvenir du Rainbow Warrior et de ce journaliste assassiné ne cesse de couler au fond du port d'Auckland.
Opération de diversion, gloriole du président bâtisseur, Motesukuo du Pacifique.
Je suis donc allé assister ce soir là à un spectacle de danse, Orphée, d'après l'oeuvre de Jean Cocteau. La Grèce aux antipodes, direz-vous? Les grands mythes sont universels, cela commence à se savoir.
Le spectacle était parfait, un peu trop hip-hop à mon avis en ce qui concerne la musique techno étourdissante, hyper (comme on dit ici aussi) forte, par contre, la performance des danseurs était extraordinaire. Un tonus, un rythme irrésistible, des exploits physiques continuels : désarticulations, robotisation des gestes, bonds gigantesques, souplesse et légèreté, le tout suivi, mis en valeur par un Paganini de l'éclairage et des couleurs.
Le texte de Jean Cocteau était peut-être assez platement dit mais des danseurs ne sont pas des comédiens et j'étais venu pour découvrir cette chorégraphie nouvelle pour moi, pour sacrifier à Terpsichore, pas pour célébrer Melpomène ou Thalie.
La salle était comble. Pas un strapontin inoccupé. Une ambiance bon enfant. On se lève, on parle, on se fait signe. Sourires entendus. Regards. On est entre connaisseurs, habitués du Centre. Bon chic, bon genre.
Un coup d'oeil autour de moi, j'en viens à penser que les Mélanésiens ne goûtent pas ce genre de spectacle - ce qui est un comble car leurs danses sont magnifiques -, pas même la progéniture bénie des chefs; la salle n'est peuplée que de visages blancs, de visages pâles, une salle comme on pouvait en voir en France il y a vingt ou trente ans. Blafarde malgré le soleil de la journée.
Quasiment pas de représentants de la population autochtone. Quelques métis, oui. Ça et là.
Tiens un kanak bon teint, là bas, au milieu d'une rangée, entre deux dames blondes. Chemise et cravate sous les tropiques. Un homme arrivé.
J'en parle à mon voisin. Il trouve que j'ai tort. Les Mélanésiens sont très discrets, dit-il. On ne les remarque pas. D'ailleurs, en regardant bien, on en verrait certainement quelques-uns mais ils sont tellement noirs de peau que dans la pénombre .
Et le spectacle, vous a-t-il plu?
En quittant le Centre, je dois admettre que mon interlocuteur n'avait pas tort : les gardiens qui indiquent la sortie, les vigiles qui surveillent le parking sont tous Mélanésiens !
L'ivrogne même qui me tend une main tremblante et me demande à voix basse une pièce.
La crise, les crises Traduction de Kurt Tucholsky!
Quand les cours de la Bourse s'effondrent
Les soucis s'emparent de presque tout le monde.
Pourtant, il en est qui s'épanouissent
Leur recette a pour nom : vente à découvert.
Avec désinvolture ces garnements dilapident
Des biens qu'ils ne possèdent même pas,
Précipitent eux-mêmes la chute verticale,
Celle qu'il leur faut ! Epatant !
E t c'est encore plus facile à faire avec les produits dérivés :
Quand les titres gonflent leur valeur
L'effet en est à la puissance quatre.
Quand en conséquence des banques s'effondrent
Les épargnants perdent leur sourire
Et l'hypothèque pesant sur le foyer
Signifie que son occupant doit partir.
Si au contraire de grandes banques sont touchées
C'est le monde entier qui est ébranlé
L'engeance des spéculateurs elle-même
Tremble alors pour ses avoirs.
Faut-il donc mettre le système en péril ?
Vite, il faut intervenir !
Les profits restent privés,
L'Etat rachète les pertes.
Mais pour cela cet Etat a besoin de crédits
Et voilà de nouveaux profits
Puisque dans ce pays le gouvernement mange dans la main.
Pour régler l'ardoise de ces impudents personnages
Ce sera au petit de cracher au bassinet
Et - c'est tout de même le fin du fin -
Pas seulement en Amérique.
Lorsque les cours regrimpent
On recommence la ronde.
Ce n'est là dans le fond que de la redistribution
Mais toujours dans la même direction.
Cependant si d'aventure les masses devaient décider
De ne plus se laisser avoir
L'échappatoire serait toute trouvée et depuis longtemps :
On fera un petit peu la guerre.
Signature :
Kurt Tucholsky