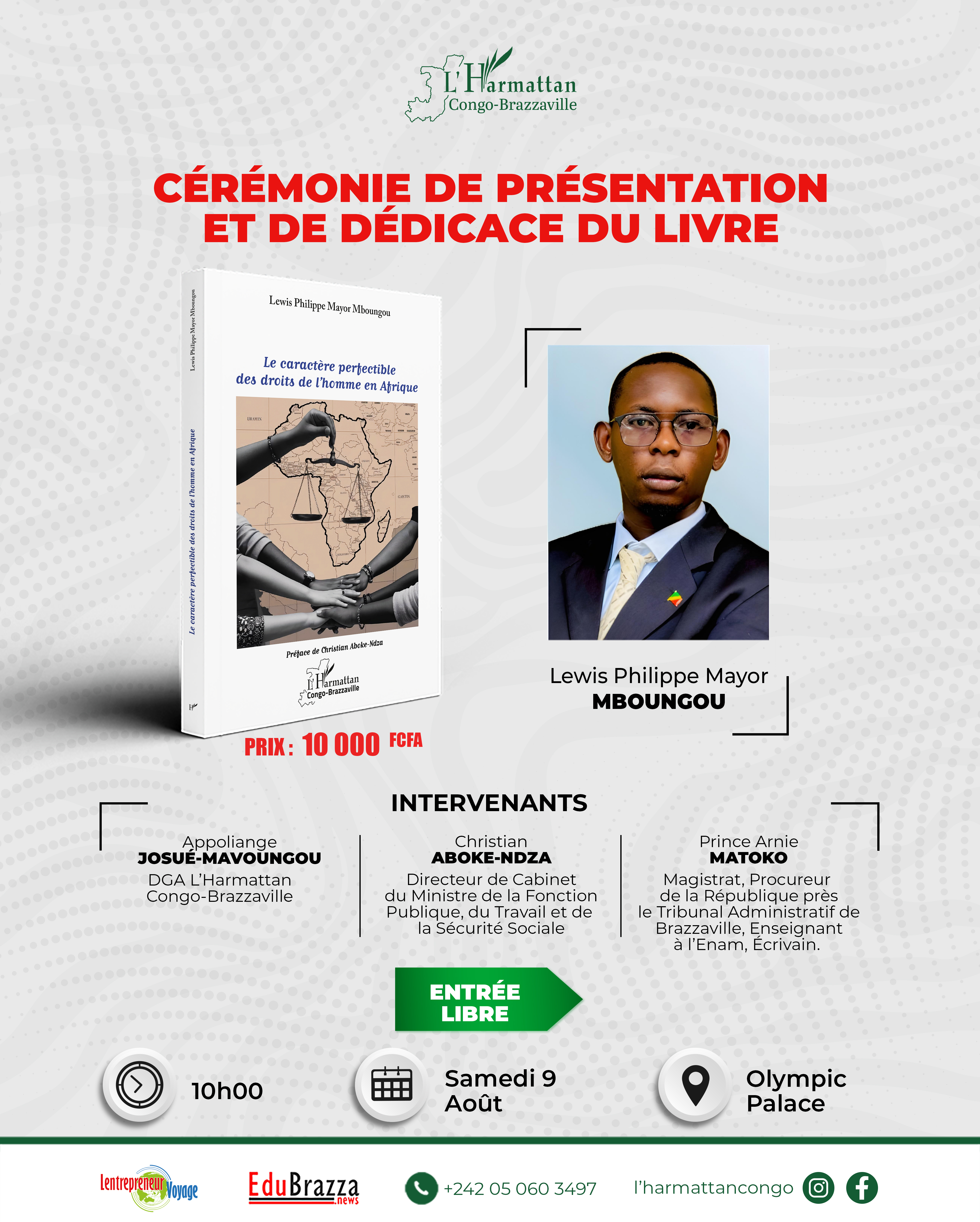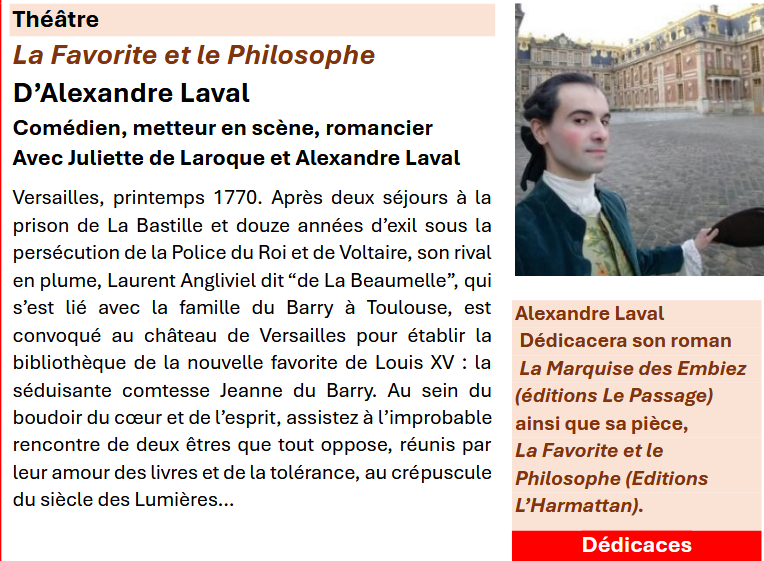1
livre
Vous avez vu 11 livre(s) sur 1
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
DIRE DES VERTIGES Effet de langage et effet de parole en psychanalyse
Citation :
"Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant"
Je voudrais mettre en exergue de mon intervention l'anecdote suivante, souvent rapportée :
Mallarmé répondit un jour ceci à son ami Edgar Degas qui, lorsqu'il ne peignait pas s'essayait en amateur à la poésie, et se plaignait des difficultés qu'il y rencontrait bien qu'il eût pourtant beaucoup d'idées : "Mais, Degas, ce n'est pas avec des idées que l'on fait de la poésie mais avec des mots !". (1)
La position discordantielle des psychologues travaillant en institution à l'endroit où leur propre théâtre d'action s'ouvre à cette "Autre scène" dont parlait Freud, s'accorde, comme nous allons le voir à la pratique de la parole qui qualifie son champ, non pas celle du bien dire comme on pourrait s'y attendre mais plutôt celle de la discordance où nous introduisent les formations de l'inconscient.
Ce qui nous conduit à intervenir sur ce sujet c'est l'usage trop souvent banalisé de la notion de parole, sans que jamais n'en soit explicité le sens utile, ni jamais interrogé véritablement ce que signifie l'acte de parler. (2)
Il y a une singularité de la parole à laquelle nous pouvons être sensibles dans l'utilisation que nous en faisons en psychanalyse, et qui concerne directement, comme nous le verrons, la question du sujet et de sa production.
C'est elle que je tenterai de souligner ici parce qu'elle est régulièrement méconnue : celle qui se qualifie de sa structure même ; celle qui est opérante dans notre pratique, malgré la vocation herméneutique dans laquelle on voudrait trop simplement, et trop souvent, la réduire.
Et vous verrez que ce que j'ai à vous dire n'est pas forcément ce qui serait le plus convenu.
Je voudrais donc vous inviter à réfléchir avec moi à quelques aspects du phénomène de la parole dans le cadre qui est le nôtre, et plus précisément :
Nous tenterons d'avancer d'abord dans le questionnement suivant :
- Que signifie parler en psychanalyse, et par extension dans toute thérapie impliquant le langage ?
- Quels effets entrainent l'acte de parler ?
- Enfin, comment qualifier la position de cette parole et par voie de conséquence la position particulière de ceux qui s'offrent à l'écouter ?
Si l'on considère le point de départ d'une cure, celui de la proposition faite à un patient d'aller parler, deux leitmotivs semblent se répéter :
- D'une part, l'idée intuitive d'un hygiénique défoulement pour celui-ci
- D'autre part, le projet de chercher à comprendre ce qui lui arrive, justifié par l'idée d'un savoir supposé, et à partir de là d'un sens à décrypter.
Or, ces motifs rebattus, qui ne soupçonnent pas la subtilité des processus en jeu, peuvent être source de malentendus dès lors qu'ils se trouvent énoncés au patient par la personne qui fait l'indication. (3)
Articulation de l'inconscient
Pour vous conduire à penser la fonction de la parole, je voudrais commencer par poser la logique du travail analytique.
Le premier registre conceptuel de notre champ opératoire c'est l'inconscient.
La psychanalyse donne en effet la parole au patient, et c'est dans cette parole qu'elle vérifie l'hypothèse de l'inconscient.
Or, comment définir rapidement l'inconscient ?
En ces temps où l'on utilise cette notion dans des domaines très différents (et depuis la volonté hégémonique des neurosciences), il devient utile de préciser ce que désigne l'inconscient freudien (4)
L'inconscient, pour la psychanalyse, ce n'est pas le non-conscient ni le préconscient.
L'inconscient c'est ce qui échappe :
- d'une part, à la conscience du sujet (cela va de soi), au savoir, à la compréhension,
- d'autre part, à sa volonté, là où "ça parle à l'insu du sujet" (Lacan).
Puisque l'inconscient se manifeste sans cesse dans les rêves, les lapsi, les actes manqués, les symptômes.
"L'inconscient c'est ce qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets", (5)
(et qui est la condition même du désir, et non l'inverse )
En d'autres termes, contrairement à ce que d'aucuns pourraient imaginer, l'inconscient concerne, de façon inattendue peut-être, des représentations qui peuvent être perceptibles et mémorisables, mais caractérisées par l'absence de subjectivation, c'est-à-dire dont le sujet n'a pas la mesure, ni la maîtrise.
Ceci est une définition majeure dont il faudra apprécier toute la portée,
puisque c'est la subjectivation qui sera dès lors le but essentiel du travail psychanalytique.
On comprendra pourquoi la solution essentielle des problèmes psychiques n'est évidemment pas dans la rééducation (6), pour la simple raison que le déni du désir inconscient ne peut faire fi de notre division constitutive, et conflits intrapsychiques.
Alors, la solution va-t-elle être de rendre conscient l'inconscient ? (7)
Nous répondrons que la psychanalyse vise d'abord une articulation (8), et par essence une articulation langagière, c'est-à-dire faite de mots organisés, articulés (9).
"Moi, la vérité, je parle, et je suis pure articulation"
"L'inconscient c'est du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets."
Cela annonce bien sûr le travail de l'interprétation, à l'orée attendue de l'effet cathartique, où d'aucuns pourraient espérer qu'y soit articulée l'énonciation au niveau de l'énoncé
Mais, là encore, nous serons plus précis avec Jacques Lacan qui soutenait que
"ce n'est pas l'effet de sens qui opère dans l'interprétation, mais l'articulation dans le symptôme des signifiants (sans aucun sens) qui s'y sont trouvés pris" (10).
Les exemples sont multiples des analystes qui ont répété cela sans qu'on veuille vraiment les entendre.
Le problème du sens
Je voudrais parler en effet du problème du sens, tellement galvaudé dans notre champ.
Si le projet de la psychanalyse est bien de mettre des mots, comme on dit, sur les affects, à la place des symptômes, c'est-à-dire d'articuler les signifiants qui s'y sont trouvés pris, deux écueils peuvent se présenter :
- Car, d'un côté, on pourra nous objecter qu'on peut aussi parler pour ne rien dire. C'est pourquoi la psychanalyse s'efforce de réaliser une centrifugation de la parole vide, et pour cela impose un cadre, une limite, une scansion à la parole.
- À l'inverse, on pourrait y être confronté à un trop de sens, avec le risque de fascination qu'il comporte et la déperdition au niveau de l'être qu'il induit. (11)
De manière générale enfin, nous devons nous rappeler que parler ne sert à rien si cela n'aboutit qu'à fixer la signification, avec pour conséquence une reconduction de la souffrance. C'est un constat que nous avons tous fait.
Au risque de vous étonner ! Je voudrais donc souligner un malentendu concernant le savoir inconscient, et la demande de compréhension qu'il peut susciter ..
" Se garder de vouloir comprendre" était précisément une recommandation de Lacan lui-même, qui, à ce sujet a jeté quelques pavés dans la marre :
- Il montrait comment le savoir pendant des siècles a pu fonctionner comme défense contre la vérité, la vérité de la parole. (12) (Les bûchers ce l'inquisition en ont été l'outil le plus violent )
Et, de façon singulière, dans la cure psychanalytique, le savoir fait symptôme quand il est mis à la place de l'objet du manque, parce qu'il en épuise le ressort.
Mais encore, parce que le savoir en tant qu'universel est propre à occulter le savoir particulier du symptôme. Il y est nuisible s'il y est objectivant.
Le paradoxe c'est que la psychanalyse, ainsi, n'aboutit qu'en créant du non-savoir.
On peut rappeler un exemple fameux de ce constat :
vous savez comment l'analyse de l'homme aux rats a pu se terminer à partir, précisément, de l'impuissance de Freud à trouver une interprétation à l'énigmatique suite de lettres "W, L, K," d'un de ses rêves.
Mais, réduisons toutefois le malentendu que pourrait susciter notre propos
comme le disait Gaston Bachelard, dans sa Poétique de l'espace :
"le non-savoir n'est pas une ignorance, mais un acte difficile
de dépassement de la connaissance ". (13)
Le grand secret de la psychanalyse, enfin, c'est qu'elle dévoile une primauté de la structure sur l'histoire. Elle montre que l'histoire prend forme avec la structure.
La lecture structurale qu'elle promeut hypothèque la notion de psychogenèse et suspend la compréhension (14). Et peut-être la remet-elle à plus tard
Dès lors, c'est bien plutôt d'ENTENDRE qu'il va s'agir dans la cure psychanalytique avant que de comprendre.
Il faudrait faire là l'éloge de la surprise, tellement nécessaire aux deux voix du colloque psychanalytique, inhérente à l'efficace de l'interprétation elle-même.
Or, la condition à cela c'est la libre circulation du signifiant dans la parole de nos patients.
D'ailleurs, si le sens s'engouffre dans la structure, il faut repérer combien il peut être volatil, et déployer ses diverses dimensions, si l'on veut bien favoriser sa liberté.
- Ainsi l'exemple princeps du Petit Hans nous montre, au fil de l'analyse la multiplicité du sens que vient exprimer sa phobie (tour à tour le père, la moustache, la défécation, la mère, l'accouchement, etc.)
- Il nous montre comment le risque aurait été de figer les choses dans une compréhension univoque.
- Et cette réflexion est valable, comme nous le savons, pour une simple dépression, qui peut paraître avoir pour origine un événement précis, mais où une compréhension hâtive nous masquerait la mosaïque polysémique où se mettent en perspective et s'enchaînent toutes les expériences du sujet qui viennent y résonner (raisonner).
C'est ce qu'on retrouvera de la même façon dans l'étiologie du traumatisme.
Nous pouvons lire dans les réflexions de Jean Baudrillard sur la poésie (15) des échos remarquables de cette problématique, dans lesquelles il s'élève contre la tentative récurrente de réduire le poétique à l'ombre du sens.
Et il met en parallèle, justement la poésie et la psychanalyse :
Pour lui, le véritable but de la psychanalyse, comme celui de la poésie, n'est pas de révéler une quelconque signification, mais la "restitution de l'échange symbolique au cur même des mots".
Il dit ceci :
"Une fois brisée l'instance du sens, tous les éléments se mettent à s'échanger, à se répondre aucun contenu inconscient n'est libéré à travers eux : ils sont simplement rendus à l'échange"
Ceci passe par une "résolution du signifiant" (au sens mathématique), parce que "tout phonème produit et non détruit symboliquement s'accumule comme du refoulé, pèse sur nous de toute l'abstraction du langage mort".
Ainsi, "Il ne suffit pas de la disparition du tout signifié pour faire du poétique, il faut aussi que le signifiant s'abolisse" (16)
C'est pourquoi "La véritable opération analytique, disait-il, est celle qui anéantit son objet, [celle] qui en vient à bout".
Ajoutons encore cette précision :
Il y a bien sûr, dans la psychanalyse, un intérêt pour le sens de la parole, mais du côté du double sens, du sens en plus, conduisant, en fait, à la réduction du signifié au non-sens.
Malgré cela, il ne s'agira pas d'y soutenir une libération benoîte du langage qui serait pure métonymie, détachée de toute signification, mais d'y mettre en scène l'acte même de dire, en deçà du signifié : l'acte de dire qui engage le désir du sujet. (17)
Donc, contrairement à une idée reçue, nous voulons soutenir ici que l'écoute psychanalytique ne viserait pas d'emblée à dévoiler un savoir inconscient, elle ne chercherait pas à objectiver l'inconscient, ni un cas psychopathologique, mais elle proposerait d'abord une mise en perspective, un parcours.
Comme dans l'Odyssée d'Homère, l'important ce n'est pas l'arrivée à Ithaque, mais c'est le voyage lui-même. - Nous y reviendrons (18)
Ce parcours vérifie que, là encore contrairement à une autre idée rebattue, l'inconscient n'est pas à proprement parler un au-delà de la conscience, mais s'inscrit dans la topologie de la bande de Moëbius.
Le sujet, effet de langage et effet de parole
Je voudrais à présent vous inviter à considérer deux opérations du processus de subjectivation :
Celle par laquelle le sujet est effet de langage,
Et celle par laquelle le sujet est effet de parole.
En donnant la parole au patient la psychanalyse ne cherche pas à recueillir un savoir, mais, à travers le déploiement de la parole, elle ouvre l'analysant à un processus de subjectivation. Ceci est une proposition majeure.
L'écoute psychanalytique ne vise pas à donner un sens au discours, avons-nous dit, mais elle donne consistance au sujet.
C'est-à-dire qu'elle engage celui qui souffre à devenir sujet des phénomènes parfois exorbitants qui le transissent, de ses symptômes, de ses affects, de son histoire enfin.
C'est là une réponse à la problématique de l'inconscient, en tant que défaut de subjectivation, telle que nous l'avons formulée en préambule.
- Quant à l'absence d'objectivation, elle va parfois être manifeste dans l'expérience de la cure qui souvent nous étonne, où les effets thérapeutiques indéniables, parfois même instantanés, peuvent apparaître sans qu'il y ait eu réellement ce qu'on peut appeler une "prise de conscience" de la part de notre patient :
C'est une remarque que nous pouvons entendre dans l'après-coup d'une séance : "la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a changé, je vais mieux, etc.
- Que s'est-il produit ?... - Notre patient est devenu sujet de son Désir.
Et ceci, grâce à l'articulation de l'inconscient : s'il y a retour du refoulé, c'est dans l'articulation même qu'il s'effectue, et pas forcément dans la révélation d'une prise de conscience éclairante.
Et malgré les exemples que nous rencontrons, bien sûr, de ces apocalypses que peuvent nous offrir parfois les scénographies spectaculaires de l'abréaction
Ainsi, les progrès de la cure vont-ils de pair avec l'articulation de certains signifiants qui, associés à d'autres, mènent le sujet dans une logique qui réalise le projet de subjectivation que nous y attendons (car le pathos ne fait pas de lui-même sujet, il n'y suffit pas )
Autrement dit : C'est en articulant des signifiants qu'on devient sujet.
Nous avons évoqué tout à l'heure l'expression de concaténation signifiante pour caractériser le travail de l'articulation, où se produit le sujet : eh bien, c'est elle qui est opérante dans la règle fondamentale de la psychanalyse, celle que Freud appelait l'association libre.
C'est elle encore qui trouvera sa logique dans l'approche lacanienne des lois du langage et du signifiant, qui décrit l'enchaînement des signifiants et son effet de subjectivation ; ce que Lacan énonçait ainsi :
"Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant " (19)
C'est parce que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant que parler réalise le projet de subjectivation de la psychanalyse.
Et l'on observera dès lors comment ce sujet, de n'être jamais que divisé dans le langage, y apparaît évidemment comme organon "assujetti", comme "assujet" disait Lacan. C'est-à-dire un sujet barré, évanescent, dont on aura la prudence de ne pas confondre avec aucune espèce de personnalisme propice à toutes les confusions. (20)
Mais un sujet qui se trouve en quelque sorte "soudé" par l'effet métonymique de l'enchaînement des signifiants. Et qui y devient dès lors cet être solidaire dont nous avons la faiblesse de donner une image omnivalente, en quelque sorte moïque.
"Par exemple, dans on bat un enfant, le sujet peut être au niveau du un enfant, ou du bat, ou du on. Il devient quelque chose d'équivalent, cet être solidaire dont nous avons la faiblesse de donner une image omnivalente dans le discours comme s'il pouvait y avoir un sujet de tous les signifiants". (21)
Associer librement (22) mène toujours quelque part :
- du côté caché de la bande de Moëbius (unilataire) où s'énoncent la levée du refoulement, et l'effet de "traduction" au sens de Freud,
- mais surtout, cela rend sujet : Dans L'Odyssée d'Homère, nous l'avons dit, ce qui compte c'est le voyage lui-même, c'est-à-dire le passage d'île en île, de signifiant en signifiant, qui rend sa place à Ulysse, au sujet Ulysse.
Ce faisant, le symptôme prend une valeur symbolique, et donc résolutive, du fait de l'écoute psychanalytique, car il y prend sens d'y être articulé, ordonné dans une série signifiante, en tant que signifiant. (23)
Et c'est là que le sens prend sa dimension : celle d'une parole
La concaténation signifiante produit du sujet et produit du sens.
Mais un sens particulier : celui d'une jouissance inconsciente articulée dans le langage.
On aurait tort, cependant, de le fétichiser en tant que tel (ce qui, hélas, est devenu l'image d'Épinal de la psychanalyse), car, encore une fois, ce qui importe avant tout c'est l'effet sujet qu'il accompagne.
D'autant que le problème du sens, c'est qu'il s'oppose en fait à la subjectivation : plus il y a de sens et moins il y a de sujet. Et nous savons qu'il ne peut y avoir de manifestation du sujet au niveau du sens que de son aphanisis. (24)
Il faudrait montrer ici, si nous en avions le temps, comment les deux opérations de causation du sujet que sont l'aliénation et la séparation, développées par Lacan au cours de son enseignement, s'accordent harmoniquement au dire analysant qui fait ici notre propos.
→ Si, d'un côté, par l'aliénation le sujet est bien effet de langage, las de son versant létal où il n'apparaît que pour disparaître,
→ d'un autre côté, par la séparation, dans l'actualité de son rapport à l'Autre (dans le transfert, bien sûr, où il rencontre le désir de l'Autre), le sujet devient dès lors effet de parole.
Mais, de quelle parole s'agit-il ?
Nous l'avons dit, la cure psychanalytique ne vise pas la recherche d'un savoir, ni d'une sémiologie pour le clinicien. Et, contrairement à une idée reçue, s'il s'agit ici d'entendre une parole, ce ne sera pas non plus celle du bien-dire.
Car, loin de l'éloquence viendront ici des mots pour dire l'insu, et souvent l'ambivalence, le contradictoire, l'indécis : "Prends l'éloquence et tords-lui son cou !" disait Verlaine.
Nous verrons comment la poésie peut être un modèle pour la psychanalyse.
L'art poétique donnait ainsi le ton :
"Il faut aussi que tu n'ailles point
"Choisir tes mots sans quelque méprise :
"Rien n'est plus cher que la chanson grise
" Où l'indécis au précis se joint.
L'indécis joint au précis, nous paraissent bien qualifier, en effet la parole attendue dans la cure analytique.
Nous pourrions citer l'exemple d'un de nos analysants qui était un professionnel de l'écriture et de la parole, rompu aux énoncés ex cathedra : lorsqu'il quittait sa chaire pour le divan, la découverte de cette "parole horizontale", comme il disait, lui apparaissait, dans un étonnement émerveillé, suivant son expression, tel un "vertige". Au point de le faire tituber dangereusement dans l'escalier du retour.
Comme nous le verrons, ce "vertige" c'est le terme même qu'employait Rimbaud dans l'Alchimie du verbe.
Que découvrait notre patient au-delà de ses énoncés ? - Une intimité de son discours
Car, la psychanalyse vise, en effet, au-delà des énoncés la quête d'une énonciation, c'est-à-dire, dans l'acte même de dire, au-delà du langage lui-même, la quête d'une parole.
Ainsi, ne s'agit-il pas de parler pour ne rien dire, et l'analyste peut être là pour le rappeler.
Je est un autre, une position discordantielle
Or, cette parole, si nous la qualifions d'énonciation, précisément, c'est qu'elle prend là la vocation singulière de venir exprimer justement ce qui échappe au sujet dans l'acte même de dire.
Ainsi Freud attendait-il de ses analysants, non pas seulement qu'ils disent leurs idées, leurs fantasmes ou leurs souvenirs conscients, mais qu'ils se laissent aller à articuler ce qu'ils ne savaient pas. Il l'exprimait de la façon suivante :
"Avec les névrosés, nous concluons ce pacte : complète sincérité, en contrepartie de quoi totale discrétion. Ce qui fait impression ; autant que si nous nous efforcions de tenir la position d'un confesseur laïc. Mais, la différence est considérable, car nous ne voulons pas seulement entendre de lui ce qu'il sait et dissimule devant les autres, mais encore doit-il nous relater ce qu'il ne sait pas. Nous l'obligeons à la règle fondamentale de la psychanalyse qui devra désormais déterminer son rapport avec nous." (25)
Pourquoi cette exigence de Freud, qui pourrait paraître irréaliste ?
- Parce que l'énonciation se soutient d'une altérité subjective constitutive.
Et la poésie nous en fournira encore une fois un modèle :
En mai 1871, Arthur Rimbaud écrivait à son professeur de rhétorique Georges Izambard :
"C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire on me pense. - Pardon du jeu de mots. -
Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait !"
Et il reprenait, deux jours après, dans sa lettre célèbre à Paul Demeny, dite Lettre du voyant :
" Je est un autre, si le cuivre s'éveille clairon il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de ma propre pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bon sur la scène."
Ce n'est naturellement pas par coquetterie que je fais appel ici aux poètes, mais parce que ceux-ci ont une véritable pratique de la parole. Et j'ai depuis longtemps pensé que cette dernière citation de Rimbaud pourrait bien servir de manifeste à la psychanalyse.
On remarquera qu'on y retrouve cette part de nous qui échappe, dont je parlais en introduction pour qualifier l'inconscient.
Et c'est bien dans la pratique de l'association libre, dont la psychanalyse fait sa règle fondamentale, que ce qui échappe peut se faire entendre : des paroles échappant au factuel, les scories qui font le matériel de l'analyse, les rêves, les lapsi, les symptômes, les contradictions, c'est-à-dire les formations de l'inconscient, caractérisées par la discordance et non par le bien-dire (26)
Des bêtises, suivant l'expression radicale de Lacan.
Qui, lui-même, rappelait que cette exigence poétique attendue chez l'analysant, l'est aussi chez l'analyste, puisqu'il n'y a que la poésie, disait-il, qui permette l'interprétation.
Et là encore pas seulement pour y trouver du sens : il soutenait, en effet, que la poésie est un effet de sens, mais aussi un effet de trou. (27)
Chez Rimbaud toujours, nous retrouvons l'hypothèque sur le sens que je veux souligner, de façon un peu provocatrice, mais pour rappeler cette dimension sans doute méconnue de l'inconscient.
Alors que quantité d'exégètes ont tenté de donner une signification à son fameux poème intitulé Voyelles, voici ce que lui-même pouvait en dire dans l'Alchimie du verbe :
"J'inventais la couleur des voyelles ! - A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. - Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens, je réservai la traduction.
Ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexplicable, je fixais des vertiges". (28)
Dans la même veine, Mallarmé attendait de son lecteur un esprit, disait-il, "ouvert à la compréhension multiple" (29).
François Perrier parlait de l'inconscient en des termes semblables :
"Composé, disait-il, de lambeaux de phrases, d'éléments à la fois irréductibles, immuables, et en même temps contradictoires et toujours concernés par d'autres sens possibles, c'est-à-dire n'en ayant aucun en eux-mêmes". (30)
Et Serge Leclaire (son ami de la troïka) ajoutait comment le non-sens des termes ultimes de l'inconscient devait atteindre au Réel, que le travail analytique a pour tâche de "démasquer". (31)
C'est pourquoi l'écoute psychanalytique est davantage attentive au non-sens, à ce qui hésite ou discorde ; voire aux effets de trou, là encore, dont les épiphanies de Joyce ont pu nous donner la mesure du vertige, côtoyant le sens le plus articulé.
La psychanalyse n'est pas la quête du bien-dire, mais celle d'une énonciation, fût-elle absconse ou contradictoire. Ainsi ne se défie-t-elle pas d'être dupe de la parole du sujet, car elle ne cherche pas à objectiver un cas. Et cela d'abord, parce qu'elle invite le patient à parler, non pas pour recueillir des signes, mais dans un but de subjectivation dont elle fait son procès essentiel.
La pratique de l'inconscient, la pratique de l' "Autre scène", pour paraphraser Freud, découvre alors un lieu de fantasmatisation, pour dire autre chose, pour le tout dire de l'association libre. Tellement étrangère à la quête informationnelle factuelle, légitime cependant, de la clinique psychiatrique.
Nous y accueillons ces "bêtises", les scories qui font le matériel analytique : toutes ces productions relevant des "formations de l'inconscient", caractérisées par la discordance.
C'est cette discordance dont nous aurions l'impertinence de vouloir faire l'éloge
Dans le cadre naturellement forclusif de l'institution médicale, où l'on a à trancher et à décider, mais où nous autres psychologues avons à fonctionner en nous prévalant d'une avantageuse mais difficile extraterritorialité, cette pratique de l'Autre scène nous ouvre à un espace que nous appellerons discordantiel.
Vous savez peut-être que l'on doit ce terme de discordantiel (comme celui de forclusion) à Damourette et Pichon, auteurs avant-guerre d'une grammaire monumentale (32). Ils opposaient ainsi à la négation forclusive la négation discordantielle, manifeste dans ce que les linguistes appellent le "ne explétif", propre à marquer la discordance entre deux propositions, et à renforcer le sens de la phrase. C'est à partir de là que Lacan reconnut à ce petit "ne", qui semblait affoler les linguistes, la fonction de venir accentuer la dimension subjective, par cette discordance introduite entre l'énoncé et l'énonciation. (Car, lorsque je dis "je crains qu'il ne vienne", c'est bien le vu qu'il vienne qui s'évoque sur le plan de l'énonciation).
Ce niveau discordantiel va dès lors se trouver décliné pour nous suivant deux registres distincts, mais évidemment solidaires :
- D'une part, le niveau discordantiel du discours, qui accentue la dimension subjective : la psychanalyse y est attentive, non pas à son contenu objectif mais, à une parole qui représente les formations de l'inconscient.
- D'autre part, le niveau discordantiel qui donne ainsi à l'écoute de l'inconscient son statut d'extraterritorialité (face au discours du maître qui qualifierait les institutions de soin).
C'est cet espace, ce sanctuaire que nous invitons à comprendre comme un espace de liberté que nous voulons garantir à nos patients.
Signature :
Jacques LIS
Notes :
NOTES
1 Je me souviens du conseil d'un psychologue chevronné à un jeune homme, le futur psychologue que j'envisageais de devenir, des idées plein la tête. C'était avant 1968, à une époque où le cursus universitaire se cherchait encore. Il m'avait engagé à lire la poésie. Bien des années plus tard, elle fit entendre sa vérité.
2 Parler de la parole a quelque chose de redondant, et ceci reflète un peu la gageure que je m'impose aujourd'hui, d'abord parce que je suis plus habitué à écouter ou à écrire qu'à parler, mais aussi parce que se pose, dès qu'on prend la parole, la question de l'adresse de la parole, et donc des signifiants et des concepts singuliers que la parole véhicule, mais aussi des problématiques qu'on ne sait pas forcément partagés par les autres.
En tout cas, je parlerai de choses qui pour ma part m'ont intéressé, et se sont surtout posées à moi comme questions à un moment de ma pratique, et qui m'ont permis alors d'avancer un peu.
J'espère donc, pour être entendu, que ces questions qui sont les miennes vous avez pu vous-mêmes vous les poser.
Sinon, j'oserai attendre que les réponses que j'ai modestement essayé d'y apporter vous posent à votre tour question.
3 Afin d'éviter d'autres malentendus, nous nous démarquerons ici
- des thérapies dites de soutien, dont le risque, nous le savons, est de venir soutenir le symptôme
- ainsi que de la confusion entretenue trop souvent avec la rééducation, induite par le développement hégémonique des thérapies comportementales, ou cognitivistes, basées sur la suggestion.
Celles-ci conduisant à un préformatage des cures par les organismes de prise en charge, tel qu'on peut déjà le connaître en Allemagne, par exemple.
4 Voir G.Pommier, Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse, p.220 : pour les neurosciences, l'inconscient désigne une "mémoire implicite", évanescente, englobant tout ce dont nous ne sommes pas conscients, y compris les battements de notre cur ou la mesure de notre pression artérielle, ou bien quelque chose qui se présenterait comme un stock de "savoir insu" qui serait, pourquoi pas visualisable quelque part dans notre cerveau. (→ voir également, les phénomènes d'autoscopie de Paul Sollier, 1903).
5 "Il n'y a pas un inconscient parce qu'il y aurait un désir inconscient, obtus, lourd voir animal, désir inconscient levé des profondeurs, qui serait primitif et aurait à s'élever au niveau supérieur du conscient. Bien au contraire, il y a un désir parce qu'il y a de l'inconscient, c'est-à-dire du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets, et qu'il y a toujours au niveau du langage quelque chose qui est au-delà de la conscience, et c'est là que peut se situer la fonction du désir". J. Lacan, La place de la psychanalyse dans la médecine, Cahiers du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, n°12, 1966.
6 Ni dans le conditionnement, même habillé du titre de psychothérapie cognitive ou comportementale.
7 Que l'inconscient soit déchiffrable psychanalytiquement ne signifie pas qu'il recèle un sens caché : Déchiffrer en psychanalyse n'est pas synonyme de découvrir, mais de participer à la formation d'un nouveau chiffre. (J.-D. Nasio, Les yeux de Laure, p. 81.)
8 "La subjectivité livre sa structure véritable, celle où ce qui s'analyse est identique à ce qui s'articule". Lacan, Écrits, p. 576.
9 "Comment quelque chose devient-il conscient ? - Grâce à l'association avec les représentations verbales correspondantes."
10 J. Lacan, Position de l'inconscient, in Écrits, p.842.
11 ("L'être ou le sens disait Lacan").
(Le savoir abolit le sujet : c'est ce que nous montre le coma de Champolion lors de sa traduction des hiéroglyphes).
12 J. Lacan, Le séminaire, L'objet de la psychanalyse, 19 janvier 1961.
13 Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, P.U.F., 1957, p. 15.
14 "La structure c'est le réel qui se fait jour dans le langage". "La structure c'est l'asphérique recélé dans l'articulation langagière en tant qu'un effet de sujet s'en saisit". Lacan, L'étourdit, pp. 33,40.
15 Jean Baudrillard, L'échange symbolique et la mort, Éditions Gallimard, 1976, pp. 285-314.
16 " le mode symbolique implique l'un l'autre : liquidation du signifié et résolution anagrammatique du signifiant". Résolution dans le sens de résolution d'une équation mathématique. Ibid., p. 303.
17 Ettore Perrella, Langage, musique et poésie dans la psychanalyse (1913-1935), in Analytica n° 35, Navarin éditeur, 1984, pp.43-61.
18 "Nous devrions nous souvenir du poème du Constantin Cavafy, Ithaque : elle n'a rien à t'offrir d'autre que le voyage, et c'est cela qu'elle t'a donné dans sa pauvreté et son dénuement. Elle t'a donné ce qu'elle n'avait pas". Marcel Czermak, Le Discours Psychanalytique, févier 1989, p. 9.
19 C'est la structure du langage, du rêve, du mot d'esprit, de toutes les formations de l'inconscient. - Dans la séquence signifiante "les Tables de la Loi", le signifiant "table" représente le sujet Moïse pour un autre signifiant, la Loi, et c'est dans cette concaténation signifiante qu'il prend sens.
20 J. Lacan, Le séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre, Édit. du Seuil, 2006, pp. 81, 206, 317.
21 Ibidem, p. 23.
22 Librement ne veut rien dire d'autre que "congédiant le sujet"
23 Voir en annexe l'observation de Laetitia B.
Nous retrouvons là le procès symbolique de la cure à l'uvre dans le travail du symptôme avec des névrosés, à partir même du symbolique en tant qu'articulation signifiante, et qui se déclinera avec les psychosés, où il s'agira de donner une valeur signifiante à de qui se présente comme signe, à partir du réel pour les phénomènes élémentaires ou les hallucinations, et à partir de l'imaginaire pour le délire.
24 Lacan, Le séminaire, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, p. 201.
25 Abrégé de psychanalyse, p. 99. Traduction de Gabriel Balbo, Bulletin de l'A.F.I., n° 9.
26 Il y a dans la démarche psychiatrique une quête informationnelle, sémiologique, une recherche d'un savoir sur le cas, à partir de l'observation clinique certes, mais aussi des témoignages de l'entourage tout autant que du patient lui-même, objet parfois de quelque suspicion. L'écoute psychanalytique, elle, ne craint pas d'être dupe du discours du patient
27 Philippe Julien, Fin de séance, in Travailler avec Lacan, p. 57.
28 Arthur Rimbaud, Une saison en enfer.
29 Stéphane Mallarmé, La déclaration foraine, Poëmes en prose, in uvres complètes, Librairie Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1945, p.283. Souligné par Hugo Friedrich, Structures de la poésie moderne, Éditions Denoël/Gonthier, Paris, 1976, p.161.
30 François Perrier, Le corps malade des signifiants, Inter Édition, 1984, p. 105.
Serge Leclaire, La réalité du désir, in Sexualité humaine, Aubier-Montaigne, 1970.
31 "Si l'analyse retrouve les liens entre deux événements, c'est un signe qu'ils ne sont pas des termes ultimes irréductibles de l'inconscient". L'important pour lui c'était donc de trouver "des points de singularité ; sans doute, mais surtout de tenter de déceler l'absence de lien entre eux". "Être analyste, écrivait-il, c'est avoir le désir de cette absence de lien, de cette absence de sens, viser le non lien, le non-sens, ce qui est finalement le Réel.
"Démasquer le réel c'est le travail du psychanalyste. Le réel c'est ce qui résiste, insiste, existe irréductiblement, et se donne en se dérobant comme jouissance, angoisse, mort ou castration On se représente volontiers la psychanalyse comme s'intéressant avant tout à la mise en scène de l'imaginaire ou encore à l'architectonie de l'ordre symbolique, mais on oublie que ce sont là des intérêts qui ne requièrent somme toute aucune compétence psychanalytique particulière". Serge Leclaire, Démasquer le réel, Éditions du seuil, 1971.
32 Damourette J. et Pichon E., Des mots à la pensée, essais de grammaire de langue française, Tome 1, Vrin, 1911-1946, Paris.
Lire plus
"Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant"
Je voudrais mettre en exergue de mon intervention l'anecdote suivante, souvent rapportée :
Mallarmé répondit un jour ceci à son ami Edgar Degas qui, lorsqu'il ne peignait pas s'essayait en amateur à la poésie, et se plaignait des difficultés qu'il y rencontrait bien qu'il eût pourtant beaucoup d'idées : "Mais, Degas, ce n'est pas avec des idées que l'on fait de la poésie mais avec des mots !". (1)
La position discordantielle des psychologues travaillant en institution à l'endroit où leur propre théâtre d'action s'ouvre à cette "Autre scène" dont parlait Freud, s'accorde, comme nous allons le voir à la pratique de la parole qui qualifie son champ, non pas celle du bien dire comme on pourrait s'y attendre mais plutôt celle de la discordance où nous introduisent les formations de l'inconscient.
Ce qui nous conduit à intervenir sur ce sujet c'est l'usage trop souvent banalisé de la notion de parole, sans que jamais n'en soit explicité le sens utile, ni jamais interrogé véritablement ce que signifie l'acte de parler. (2)
Il y a une singularité de la parole à laquelle nous pouvons être sensibles dans l'utilisation que nous en faisons en psychanalyse, et qui concerne directement, comme nous le verrons, la question du sujet et de sa production.
C'est elle que je tenterai de souligner ici parce qu'elle est régulièrement méconnue : celle qui se qualifie de sa structure même ; celle qui est opérante dans notre pratique, malgré la vocation herméneutique dans laquelle on voudrait trop simplement, et trop souvent, la réduire.
Et vous verrez que ce que j'ai à vous dire n'est pas forcément ce qui serait le plus convenu.
Je voudrais donc vous inviter à réfléchir avec moi à quelques aspects du phénomène de la parole dans le cadre qui est le nôtre, et plus précisément :
Nous tenterons d'avancer d'abord dans le questionnement suivant :
- Que signifie parler en psychanalyse, et par extension dans toute thérapie impliquant le langage ?
- Quels effets entrainent l'acte de parler ?
- Enfin, comment qualifier la position de cette parole et par voie de conséquence la position particulière de ceux qui s'offrent à l'écouter ?
Si l'on considère le point de départ d'une cure, celui de la proposition faite à un patient d'aller parler, deux leitmotivs semblent se répéter :
- D'une part, l'idée intuitive d'un hygiénique défoulement pour celui-ci
- D'autre part, le projet de chercher à comprendre ce qui lui arrive, justifié par l'idée d'un savoir supposé, et à partir de là d'un sens à décrypter.
Or, ces motifs rebattus, qui ne soupçonnent pas la subtilité des processus en jeu, peuvent être source de malentendus dès lors qu'ils se trouvent énoncés au patient par la personne qui fait l'indication. (3)
Pour vous conduire à penser la fonction de la parole, je voudrais commencer par poser la logique du travail analytique.
Le premier registre conceptuel de notre champ opératoire c'est l'inconscient.
La psychanalyse donne en effet la parole au patient, et c'est dans cette parole qu'elle vérifie l'hypothèse de l'inconscient.
Or, comment définir rapidement l'inconscient ?
En ces temps où l'on utilise cette notion dans des domaines très différents (et depuis la volonté hégémonique des neurosciences), il devient utile de préciser ce que désigne l'inconscient freudien (4)
L'inconscient, pour la psychanalyse, ce n'est pas le non-conscient ni le préconscient.
L'inconscient c'est ce qui échappe :
- d'une part, à la conscience du sujet (cela va de soi), au savoir, à la compréhension,
- d'autre part, à sa volonté, là où "ça parle à l'insu du sujet" (Lacan).
Puisque l'inconscient se manifeste sans cesse dans les rêves, les lapsi, les actes manqués, les symptômes.
"L'inconscient c'est ce qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets", (5)
(et qui est la condition même du désir, et non l'inverse )
En d'autres termes, contrairement à ce que d'aucuns pourraient imaginer, l'inconscient concerne, de façon inattendue peut-être, des représentations qui peuvent être perceptibles et mémorisables, mais caractérisées par l'absence de subjectivation, c'est-à-dire dont le sujet n'a pas la mesure, ni la maîtrise.
Ceci est une définition majeure dont il faudra apprécier toute la portée,
puisque c'est la subjectivation qui sera dès lors le but essentiel du travail psychanalytique.
On comprendra pourquoi la solution essentielle des problèmes psychiques n'est évidemment pas dans la rééducation (6), pour la simple raison que le déni du désir inconscient ne peut faire fi de notre division constitutive, et conflits intrapsychiques.
Alors, la solution va-t-elle être de rendre conscient l'inconscient ? (7)
Nous répondrons que la psychanalyse vise d'abord une articulation (8), et par essence une articulation langagière, c'est-à-dire faite de mots organisés, articulés (9).
"Moi, la vérité, je parle, et je suis pure articulation"
"L'inconscient c'est du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets."
Cela annonce bien sûr le travail de l'interprétation, à l'orée attendue de l'effet cathartique, où d'aucuns pourraient espérer qu'y soit articulée l'énonciation au niveau de l'énoncé
Mais, là encore, nous serons plus précis avec Jacques Lacan qui soutenait que
"ce n'est pas l'effet de sens qui opère dans l'interprétation, mais l'articulation dans le symptôme des signifiants (sans aucun sens) qui s'y sont trouvés pris" (10).
Les exemples sont multiples des analystes qui ont répété cela sans qu'on veuille vraiment les entendre.
Je voudrais parler en effet du problème du sens, tellement galvaudé dans notre champ.
Si le projet de la psychanalyse est bien de mettre des mots, comme on dit, sur les affects, à la place des symptômes, c'est-à-dire d'articuler les signifiants qui s'y sont trouvés pris, deux écueils peuvent se présenter :
- Car, d'un côté, on pourra nous objecter qu'on peut aussi parler pour ne rien dire. C'est pourquoi la psychanalyse s'efforce de réaliser une centrifugation de la parole vide, et pour cela impose un cadre, une limite, une scansion à la parole.
- À l'inverse, on pourrait y être confronté à un trop de sens, avec le risque de fascination qu'il comporte et la déperdition au niveau de l'être qu'il induit. (11)
De manière générale enfin, nous devons nous rappeler que parler ne sert à rien si cela n'aboutit qu'à fixer la signification, avec pour conséquence une reconduction de la souffrance. C'est un constat que nous avons tous fait.
Au risque de vous étonner ! Je voudrais donc souligner un malentendu concernant le savoir inconscient, et la demande de compréhension qu'il peut susciter ..
" Se garder de vouloir comprendre" était précisément une recommandation de Lacan lui-même, qui, à ce sujet a jeté quelques pavés dans la marre :
- Il montrait comment le savoir pendant des siècles a pu fonctionner comme défense contre la vérité, la vérité de la parole. (12) (Les bûchers ce l'inquisition en ont été l'outil le plus violent )
Et, de façon singulière, dans la cure psychanalytique, le savoir fait symptôme quand il est mis à la place de l'objet du manque, parce qu'il en épuise le ressort.
Mais encore, parce que le savoir en tant qu'universel est propre à occulter le savoir particulier du symptôme. Il y est nuisible s'il y est objectivant.
Le paradoxe c'est que la psychanalyse, ainsi, n'aboutit qu'en créant du non-savoir.
On peut rappeler un exemple fameux de ce constat :
vous savez comment l'analyse de l'homme aux rats a pu se terminer à partir, précisément, de l'impuissance de Freud à trouver une interprétation à l'énigmatique suite de lettres "W, L, K," d'un de ses rêves.
Mais, réduisons toutefois le malentendu que pourrait susciter notre propos
comme le disait Gaston Bachelard, dans sa Poétique de l'espace :
"le non-savoir n'est pas une ignorance, mais un acte difficile
de dépassement de la connaissance ". (13)
Le grand secret de la psychanalyse, enfin, c'est qu'elle dévoile une primauté de la structure sur l'histoire. Elle montre que l'histoire prend forme avec la structure.
La lecture structurale qu'elle promeut hypothèque la notion de psychogenèse et suspend la compréhension (14). Et peut-être la remet-elle à plus tard
Dès lors, c'est bien plutôt d'ENTENDRE qu'il va s'agir dans la cure psychanalytique avant que de comprendre.
Il faudrait faire là l'éloge de la surprise, tellement nécessaire aux deux voix du colloque psychanalytique, inhérente à l'efficace de l'interprétation elle-même.
Or, la condition à cela c'est la libre circulation du signifiant dans la parole de nos patients.
D'ailleurs, si le sens s'engouffre dans la structure, il faut repérer combien il peut être volatil, et déployer ses diverses dimensions, si l'on veut bien favoriser sa liberté.
- Ainsi l'exemple princeps du Petit Hans nous montre, au fil de l'analyse la multiplicité du sens que vient exprimer sa phobie (tour à tour le père, la moustache, la défécation, la mère, l'accouchement, etc.)
- Il nous montre comment le risque aurait été de figer les choses dans une compréhension univoque.
- Et cette réflexion est valable, comme nous le savons, pour une simple dépression, qui peut paraître avoir pour origine un événement précis, mais où une compréhension hâtive nous masquerait la mosaïque polysémique où se mettent en perspective et s'enchaînent toutes les expériences du sujet qui viennent y résonner (raisonner).
C'est ce qu'on retrouvera de la même façon dans l'étiologie du traumatisme.
Nous pouvons lire dans les réflexions de Jean Baudrillard sur la poésie (15) des échos remarquables de cette problématique, dans lesquelles il s'élève contre la tentative récurrente de réduire le poétique à l'ombre du sens.
Et il met en parallèle, justement la poésie et la psychanalyse :
Pour lui, le véritable but de la psychanalyse, comme celui de la poésie, n'est pas de révéler une quelconque signification, mais la "restitution de l'échange symbolique au cur même des mots".
Il dit ceci :
"Une fois brisée l'instance du sens, tous les éléments se mettent à s'échanger, à se répondre aucun contenu inconscient n'est libéré à travers eux : ils sont simplement rendus à l'échange"
Ceci passe par une "résolution du signifiant" (au sens mathématique), parce que "tout phonème produit et non détruit symboliquement s'accumule comme du refoulé, pèse sur nous de toute l'abstraction du langage mort".
Ainsi, "Il ne suffit pas de la disparition du tout signifié pour faire du poétique, il faut aussi que le signifiant s'abolisse" (16)
C'est pourquoi "La véritable opération analytique, disait-il, est celle qui anéantit son objet, [celle] qui en vient à bout".
Ajoutons encore cette précision :
Il y a bien sûr, dans la psychanalyse, un intérêt pour le sens de la parole, mais du côté du double sens, du sens en plus, conduisant, en fait, à la réduction du signifié au non-sens.
Malgré cela, il ne s'agira pas d'y soutenir une libération benoîte du langage qui serait pure métonymie, détachée de toute signification, mais d'y mettre en scène l'acte même de dire, en deçà du signifié : l'acte de dire qui engage le désir du sujet. (17)
Donc, contrairement à une idée reçue, nous voulons soutenir ici que l'écoute psychanalytique ne viserait pas d'emblée à dévoiler un savoir inconscient, elle ne chercherait pas à objectiver l'inconscient, ni un cas psychopathologique, mais elle proposerait d'abord une mise en perspective, un parcours.
Comme dans l'Odyssée d'Homère, l'important ce n'est pas l'arrivée à Ithaque, mais c'est le voyage lui-même. - Nous y reviendrons (18)
Ce parcours vérifie que, là encore contrairement à une autre idée rebattue, l'inconscient n'est pas à proprement parler un au-delà de la conscience, mais s'inscrit dans la topologie de la bande de Moëbius.
Je voudrais à présent vous inviter à considérer deux opérations du processus de subjectivation :
Celle par laquelle le sujet est effet de langage,
Et celle par laquelle le sujet est effet de parole.
En donnant la parole au patient la psychanalyse ne cherche pas à recueillir un savoir, mais, à travers le déploiement de la parole, elle ouvre l'analysant à un processus de subjectivation. Ceci est une proposition majeure.
L'écoute psychanalytique ne vise pas à donner un sens au discours, avons-nous dit, mais elle donne consistance au sujet.
C'est-à-dire qu'elle engage celui qui souffre à devenir sujet des phénomènes parfois exorbitants qui le transissent, de ses symptômes, de ses affects, de son histoire enfin.
C'est là une réponse à la problématique de l'inconscient, en tant que défaut de subjectivation, telle que nous l'avons formulée en préambule.
- Quant à l'absence d'objectivation, elle va parfois être manifeste dans l'expérience de la cure qui souvent nous étonne, où les effets thérapeutiques indéniables, parfois même instantanés, peuvent apparaître sans qu'il y ait eu réellement ce qu'on peut appeler une "prise de conscience" de la part de notre patient :
C'est une remarque que nous pouvons entendre dans l'après-coup d'une séance : "la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a changé, je vais mieux, etc.
- Que s'est-il produit ?... - Notre patient est devenu sujet de son Désir.
Et ceci, grâce à l'articulation de l'inconscient : s'il y a retour du refoulé, c'est dans l'articulation même qu'il s'effectue, et pas forcément dans la révélation d'une prise de conscience éclairante.
Et malgré les exemples que nous rencontrons, bien sûr, de ces apocalypses que peuvent nous offrir parfois les scénographies spectaculaires de l'abréaction
Ainsi, les progrès de la cure vont-ils de pair avec l'articulation de certains signifiants qui, associés à d'autres, mènent le sujet dans une logique qui réalise le projet de subjectivation que nous y attendons (car le pathos ne fait pas de lui-même sujet, il n'y suffit pas )
Autrement dit : C'est en articulant des signifiants qu'on devient sujet.
Nous avons évoqué tout à l'heure l'expression de concaténation signifiante pour caractériser le travail de l'articulation, où se produit le sujet : eh bien, c'est elle qui est opérante dans la règle fondamentale de la psychanalyse, celle que Freud appelait l'association libre.
C'est elle encore qui trouvera sa logique dans l'approche lacanienne des lois du langage et du signifiant, qui décrit l'enchaînement des signifiants et son effet de subjectivation ; ce que Lacan énonçait ainsi :
"Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant " (19)
C'est parce que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant que parler réalise le projet de subjectivation de la psychanalyse.
Et l'on observera dès lors comment ce sujet, de n'être jamais que divisé dans le langage, y apparaît évidemment comme organon "assujetti", comme "assujet" disait Lacan. C'est-à-dire un sujet barré, évanescent, dont on aura la prudence de ne pas confondre avec aucune espèce de personnalisme propice à toutes les confusions. (20)
Mais un sujet qui se trouve en quelque sorte "soudé" par l'effet métonymique de l'enchaînement des signifiants. Et qui y devient dès lors cet être solidaire dont nous avons la faiblesse de donner une image omnivalente, en quelque sorte moïque.
"Par exemple, dans on bat un enfant, le sujet peut être au niveau du un enfant, ou du bat, ou du on. Il devient quelque chose d'équivalent, cet être solidaire dont nous avons la faiblesse de donner une image omnivalente dans le discours comme s'il pouvait y avoir un sujet de tous les signifiants". (21)
Associer librement (22) mène toujours quelque part :
- du côté caché de la bande de Moëbius (unilataire) où s'énoncent la levée du refoulement, et l'effet de "traduction" au sens de Freud,
- mais surtout, cela rend sujet : Dans L'Odyssée d'Homère, nous l'avons dit, ce qui compte c'est le voyage lui-même, c'est-à-dire le passage d'île en île, de signifiant en signifiant, qui rend sa place à Ulysse, au sujet Ulysse.
Ce faisant, le symptôme prend une valeur symbolique, et donc résolutive, du fait de l'écoute psychanalytique, car il y prend sens d'y être articulé, ordonné dans une série signifiante, en tant que signifiant. (23)
Et c'est là que le sens prend sa dimension : celle d'une parole
La concaténation signifiante produit du sujet et produit du sens.
Mais un sens particulier : celui d'une jouissance inconsciente articulée dans le langage.
On aurait tort, cependant, de le fétichiser en tant que tel (ce qui, hélas, est devenu l'image d'Épinal de la psychanalyse), car, encore une fois, ce qui importe avant tout c'est l'effet sujet qu'il accompagne.
D'autant que le problème du sens, c'est qu'il s'oppose en fait à la subjectivation : plus il y a de sens et moins il y a de sujet. Et nous savons qu'il ne peut y avoir de manifestation du sujet au niveau du sens que de son aphanisis. (24)
Il faudrait montrer ici, si nous en avions le temps, comment les deux opérations de causation du sujet que sont l'aliénation et la séparation, développées par Lacan au cours de son enseignement, s'accordent harmoniquement au dire analysant qui fait ici notre propos.
→ Si, d'un côté, par l'aliénation le sujet est bien effet de langage, las de son versant létal où il n'apparaît que pour disparaître,
→ d'un autre côté, par la séparation, dans l'actualité de son rapport à l'Autre (dans le transfert, bien sûr, où il rencontre le désir de l'Autre), le sujet devient dès lors effet de parole.
Mais, de quelle parole s'agit-il ?
Nous l'avons dit, la cure psychanalytique ne vise pas la recherche d'un savoir, ni d'une sémiologie pour le clinicien. Et, contrairement à une idée reçue, s'il s'agit ici d'entendre une parole, ce ne sera pas non plus celle du bien-dire.
Car, loin de l'éloquence viendront ici des mots pour dire l'insu, et souvent l'ambivalence, le contradictoire, l'indécis : "Prends l'éloquence et tords-lui son cou !" disait Verlaine.
Nous verrons comment la poésie peut être un modèle pour la psychanalyse.
L'art poétique donnait ainsi le ton :
"Il faut aussi que tu n'ailles point
"Choisir tes mots sans quelque méprise :
"Rien n'est plus cher que la chanson grise
" Où l'indécis au précis se joint.
L'indécis joint au précis, nous paraissent bien qualifier, en effet la parole attendue dans la cure analytique.
Nous pourrions citer l'exemple d'un de nos analysants qui était un professionnel de l'écriture et de la parole, rompu aux énoncés ex cathedra : lorsqu'il quittait sa chaire pour le divan, la découverte de cette "parole horizontale", comme il disait, lui apparaissait, dans un étonnement émerveillé, suivant son expression, tel un "vertige". Au point de le faire tituber dangereusement dans l'escalier du retour.
Comme nous le verrons, ce "vertige" c'est le terme même qu'employait Rimbaud dans l'Alchimie du verbe.
Que découvrait notre patient au-delà de ses énoncés ? - Une intimité de son discours
Car, la psychanalyse vise, en effet, au-delà des énoncés la quête d'une énonciation, c'est-à-dire, dans l'acte même de dire, au-delà du langage lui-même, la quête d'une parole.
Ainsi, ne s'agit-il pas de parler pour ne rien dire, et l'analyste peut être là pour le rappeler.
Or, cette parole, si nous la qualifions d'énonciation, précisément, c'est qu'elle prend là la vocation singulière de venir exprimer justement ce qui échappe au sujet dans l'acte même de dire.
Ainsi Freud attendait-il de ses analysants, non pas seulement qu'ils disent leurs idées, leurs fantasmes ou leurs souvenirs conscients, mais qu'ils se laissent aller à articuler ce qu'ils ne savaient pas. Il l'exprimait de la façon suivante :
"Avec les névrosés, nous concluons ce pacte : complète sincérité, en contrepartie de quoi totale discrétion. Ce qui fait impression ; autant que si nous nous efforcions de tenir la position d'un confesseur laïc. Mais, la différence est considérable, car nous ne voulons pas seulement entendre de lui ce qu'il sait et dissimule devant les autres, mais encore doit-il nous relater ce qu'il ne sait pas. Nous l'obligeons à la règle fondamentale de la psychanalyse qui devra désormais déterminer son rapport avec nous." (25)
Pourquoi cette exigence de Freud, qui pourrait paraître irréaliste ?
- Parce que l'énonciation se soutient d'une altérité subjective constitutive.
Et la poésie nous en fournira encore une fois un modèle :
En mai 1871, Arthur Rimbaud écrivait à son professeur de rhétorique Georges Izambard :
"C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire on me pense. - Pardon du jeu de mots. -
Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait !"
Et il reprenait, deux jours après, dans sa lettre célèbre à Paul Demeny, dite Lettre du voyant :
" Je est un autre, si le cuivre s'éveille clairon il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de ma propre pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bon sur la scène."
Ce n'est naturellement pas par coquetterie que je fais appel ici aux poètes, mais parce que ceux-ci ont une véritable pratique de la parole. Et j'ai depuis longtemps pensé que cette dernière citation de Rimbaud pourrait bien servir de manifeste à la psychanalyse.
On remarquera qu'on y retrouve cette part de nous qui échappe, dont je parlais en introduction pour qualifier l'inconscient.
Et c'est bien dans la pratique de l'association libre, dont la psychanalyse fait sa règle fondamentale, que ce qui échappe peut se faire entendre : des paroles échappant au factuel, les scories qui font le matériel de l'analyse, les rêves, les lapsi, les symptômes, les contradictions, c'est-à-dire les formations de l'inconscient, caractérisées par la discordance et non par le bien-dire (26)
Des bêtises, suivant l'expression radicale de Lacan.
Qui, lui-même, rappelait que cette exigence poétique attendue chez l'analysant, l'est aussi chez l'analyste, puisqu'il n'y a que la poésie, disait-il, qui permette l'interprétation.
Et là encore pas seulement pour y trouver du sens : il soutenait, en effet, que la poésie est un effet de sens, mais aussi un effet de trou. (27)
Chez Rimbaud toujours, nous retrouvons l'hypothèque sur le sens que je veux souligner, de façon un peu provocatrice, mais pour rappeler cette dimension sans doute méconnue de l'inconscient.
Alors que quantité d'exégètes ont tenté de donner une signification à son fameux poème intitulé Voyelles, voici ce que lui-même pouvait en dire dans l'Alchimie du verbe :
"J'inventais la couleur des voyelles ! - A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. - Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens, je réservai la traduction.
Ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexplicable, je fixais des vertiges". (28)
Dans la même veine, Mallarmé attendait de son lecteur un esprit, disait-il, "ouvert à la compréhension multiple" (29).
François Perrier parlait de l'inconscient en des termes semblables :
"Composé, disait-il, de lambeaux de phrases, d'éléments à la fois irréductibles, immuables, et en même temps contradictoires et toujours concernés par d'autres sens possibles, c'est-à-dire n'en ayant aucun en eux-mêmes". (30)
Et Serge Leclaire (son ami de la troïka) ajoutait comment le non-sens des termes ultimes de l'inconscient devait atteindre au Réel, que le travail analytique a pour tâche de "démasquer". (31)
C'est pourquoi l'écoute psychanalytique est davantage attentive au non-sens, à ce qui hésite ou discorde ; voire aux effets de trou, là encore, dont les épiphanies de Joyce ont pu nous donner la mesure du vertige, côtoyant le sens le plus articulé.
La psychanalyse n'est pas la quête du bien-dire, mais celle d'une énonciation, fût-elle absconse ou contradictoire. Ainsi ne se défie-t-elle pas d'être dupe de la parole du sujet, car elle ne cherche pas à objectiver un cas. Et cela d'abord, parce qu'elle invite le patient à parler, non pas pour recueillir des signes, mais dans un but de subjectivation dont elle fait son procès essentiel.
La pratique de l'inconscient, la pratique de l' "Autre scène", pour paraphraser Freud, découvre alors un lieu de fantasmatisation, pour dire autre chose, pour le tout dire de l'association libre. Tellement étrangère à la quête informationnelle factuelle, légitime cependant, de la clinique psychiatrique.
Nous y accueillons ces "bêtises", les scories qui font le matériel analytique : toutes ces productions relevant des "formations de l'inconscient", caractérisées par la discordance.
C'est cette discordance dont nous aurions l'impertinence de vouloir faire l'éloge
Dans le cadre naturellement forclusif de l'institution médicale, où l'on a à trancher et à décider, mais où nous autres psychologues avons à fonctionner en nous prévalant d'une avantageuse mais difficile extraterritorialité, cette pratique de l'Autre scène nous ouvre à un espace que nous appellerons discordantiel.
Vous savez peut-être que l'on doit ce terme de discordantiel (comme celui de forclusion) à Damourette et Pichon, auteurs avant-guerre d'une grammaire monumentale (32). Ils opposaient ainsi à la négation forclusive la négation discordantielle, manifeste dans ce que les linguistes appellent le "ne explétif", propre à marquer la discordance entre deux propositions, et à renforcer le sens de la phrase. C'est à partir de là que Lacan reconnut à ce petit "ne", qui semblait affoler les linguistes, la fonction de venir accentuer la dimension subjective, par cette discordance introduite entre l'énoncé et l'énonciation. (Car, lorsque je dis "je crains qu'il ne vienne", c'est bien le vu qu'il vienne qui s'évoque sur le plan de l'énonciation).
Ce niveau discordantiel va dès lors se trouver décliné pour nous suivant deux registres distincts, mais évidemment solidaires :
- D'une part, le niveau discordantiel du discours, qui accentue la dimension subjective : la psychanalyse y est attentive, non pas à son contenu objectif mais, à une parole qui représente les formations de l'inconscient.
- D'autre part, le niveau discordantiel qui donne ainsi à l'écoute de l'inconscient son statut d'extraterritorialité (face au discours du maître qui qualifierait les institutions de soin).
C'est cet espace, ce sanctuaire que nous invitons à comprendre comme un espace de liberté que nous voulons garantir à nos patients.
Signature :
Jacques LIS
Notes :
NOTES
1 Je me souviens du conseil d'un psychologue chevronné à un jeune homme, le futur psychologue que j'envisageais de devenir, des idées plein la tête. C'était avant 1968, à une époque où le cursus universitaire se cherchait encore. Il m'avait engagé à lire la poésie. Bien des années plus tard, elle fit entendre sa vérité.
2 Parler de la parole a quelque chose de redondant, et ceci reflète un peu la gageure que je m'impose aujourd'hui, d'abord parce que je suis plus habitué à écouter ou à écrire qu'à parler, mais aussi parce que se pose, dès qu'on prend la parole, la question de l'adresse de la parole, et donc des signifiants et des concepts singuliers que la parole véhicule, mais aussi des problématiques qu'on ne sait pas forcément partagés par les autres.
En tout cas, je parlerai de choses qui pour ma part m'ont intéressé, et se sont surtout posées à moi comme questions à un moment de ma pratique, et qui m'ont permis alors d'avancer un peu.
J'espère donc, pour être entendu, que ces questions qui sont les miennes vous avez pu vous-mêmes vous les poser.
Sinon, j'oserai attendre que les réponses que j'ai modestement essayé d'y apporter vous posent à votre tour question.
3 Afin d'éviter d'autres malentendus, nous nous démarquerons ici
- des thérapies dites de soutien, dont le risque, nous le savons, est de venir soutenir le symptôme
- ainsi que de la confusion entretenue trop souvent avec la rééducation, induite par le développement hégémonique des thérapies comportementales, ou cognitivistes, basées sur la suggestion.
Celles-ci conduisant à un préformatage des cures par les organismes de prise en charge, tel qu'on peut déjà le connaître en Allemagne, par exemple.
4 Voir G.Pommier, Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse, p.220 : pour les neurosciences, l'inconscient désigne une "mémoire implicite", évanescente, englobant tout ce dont nous ne sommes pas conscients, y compris les battements de notre cur ou la mesure de notre pression artérielle, ou bien quelque chose qui se présenterait comme un stock de "savoir insu" qui serait, pourquoi pas visualisable quelque part dans notre cerveau. (→ voir également, les phénomènes d'autoscopie de Paul Sollier, 1903).
5 "Il n'y a pas un inconscient parce qu'il y aurait un désir inconscient, obtus, lourd voir animal, désir inconscient levé des profondeurs, qui serait primitif et aurait à s'élever au niveau supérieur du conscient. Bien au contraire, il y a un désir parce qu'il y a de l'inconscient, c'est-à-dire du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets, et qu'il y a toujours au niveau du langage quelque chose qui est au-delà de la conscience, et c'est là que peut se situer la fonction du désir". J. Lacan, La place de la psychanalyse dans la médecine, Cahiers du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, n°12, 1966.
6 Ni dans le conditionnement, même habillé du titre de psychothérapie cognitive ou comportementale.
7 Que l'inconscient soit déchiffrable psychanalytiquement ne signifie pas qu'il recèle un sens caché : Déchiffrer en psychanalyse n'est pas synonyme de découvrir, mais de participer à la formation d'un nouveau chiffre. (J.-D. Nasio, Les yeux de Laure, p. 81.)
8 "La subjectivité livre sa structure véritable, celle où ce qui s'analyse est identique à ce qui s'articule". Lacan, Écrits, p. 576.
9 "Comment quelque chose devient-il conscient ? - Grâce à l'association avec les représentations verbales correspondantes."
10 J. Lacan, Position de l'inconscient, in Écrits, p.842.
11 ("L'être ou le sens disait Lacan").
(Le savoir abolit le sujet : c'est ce que nous montre le coma de Champolion lors de sa traduction des hiéroglyphes).
12 J. Lacan, Le séminaire, L'objet de la psychanalyse, 19 janvier 1961.
13 Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, P.U.F., 1957, p. 15.
14 "La structure c'est le réel qui se fait jour dans le langage". "La structure c'est l'asphérique recélé dans l'articulation langagière en tant qu'un effet de sujet s'en saisit". Lacan, L'étourdit, pp. 33,40.
15 Jean Baudrillard, L'échange symbolique et la mort, Éditions Gallimard, 1976, pp. 285-314.
16 " le mode symbolique implique l'un l'autre : liquidation du signifié et résolution anagrammatique du signifiant". Résolution dans le sens de résolution d'une équation mathématique. Ibid., p. 303.
17 Ettore Perrella, Langage, musique et poésie dans la psychanalyse (1913-1935), in Analytica n° 35, Navarin éditeur, 1984, pp.43-61.
18 "Nous devrions nous souvenir du poème du Constantin Cavafy, Ithaque : elle n'a rien à t'offrir d'autre que le voyage, et c'est cela qu'elle t'a donné dans sa pauvreté et son dénuement. Elle t'a donné ce qu'elle n'avait pas". Marcel Czermak, Le Discours Psychanalytique, févier 1989, p. 9.
19 C'est la structure du langage, du rêve, du mot d'esprit, de toutes les formations de l'inconscient. - Dans la séquence signifiante "les Tables de la Loi", le signifiant "table" représente le sujet Moïse pour un autre signifiant, la Loi, et c'est dans cette concaténation signifiante qu'il prend sens.
20 J. Lacan, Le séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre, Édit. du Seuil, 2006, pp. 81, 206, 317.
21 Ibidem, p. 23.
22 Librement ne veut rien dire d'autre que "congédiant le sujet"
23 Voir en annexe l'observation de Laetitia B.
Nous retrouvons là le procès symbolique de la cure à l'uvre dans le travail du symptôme avec des névrosés, à partir même du symbolique en tant qu'articulation signifiante, et qui se déclinera avec les psychosés, où il s'agira de donner une valeur signifiante à de qui se présente comme signe, à partir du réel pour les phénomènes élémentaires ou les hallucinations, et à partir de l'imaginaire pour le délire.
24 Lacan, Le séminaire, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, p. 201.
25 Abrégé de psychanalyse, p. 99. Traduction de Gabriel Balbo, Bulletin de l'A.F.I., n° 9.
26 Il y a dans la démarche psychiatrique une quête informationnelle, sémiologique, une recherche d'un savoir sur le cas, à partir de l'observation clinique certes, mais aussi des témoignages de l'entourage tout autant que du patient lui-même, objet parfois de quelque suspicion. L'écoute psychanalytique, elle, ne craint pas d'être dupe du discours du patient
27 Philippe Julien, Fin de séance, in Travailler avec Lacan, p. 57.
28 Arthur Rimbaud, Une saison en enfer.
29 Stéphane Mallarmé, La déclaration foraine, Poëmes en prose, in uvres complètes, Librairie Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1945, p.283. Souligné par Hugo Friedrich, Structures de la poésie moderne, Éditions Denoël/Gonthier, Paris, 1976, p.161.
30 François Perrier, Le corps malade des signifiants, Inter Édition, 1984, p. 105.
Serge Leclaire, La réalité du désir, in Sexualité humaine, Aubier-Montaigne, 1970.
31 "Si l'analyse retrouve les liens entre deux événements, c'est un signe qu'ils ne sont pas des termes ultimes irréductibles de l'inconscient". L'important pour lui c'était donc de trouver "des points de singularité ; sans doute, mais surtout de tenter de déceler l'absence de lien entre eux". "Être analyste, écrivait-il, c'est avoir le désir de cette absence de lien, de cette absence de sens, viser le non lien, le non-sens, ce qui est finalement le Réel.
"Démasquer le réel c'est le travail du psychanalyste. Le réel c'est ce qui résiste, insiste, existe irréductiblement, et se donne en se dérobant comme jouissance, angoisse, mort ou castration On se représente volontiers la psychanalyse comme s'intéressant avant tout à la mise en scène de l'imaginaire ou encore à l'architectonie de l'ordre symbolique, mais on oublie que ce sont là des intérêts qui ne requièrent somme toute aucune compétence psychanalytique particulière". Serge Leclaire, Démasquer le réel, Éditions du seuil, 1971.
32 Damourette J. et Pichon E., Des mots à la pensée, essais de grammaire de langue française, Tome 1, Vrin, 1911-1946, Paris.
HEAUTOSCOPIE et TRANSITIVISME Un trouble de la localisation de la pensée
Résumé : Il faut comprendre l'héautoscopie, qui se rencontre dans la psychose hallucinatoire, comme l'un des phénomènes du transitivisme, depuis la sensation d'une pure présence énigmatique, sans doute primitive, jusqu'à son incarnation dans l'image du double, en passant par l'hallucination des pensées propres du patient à l'extérieur.
Il est un peu court de les réduire à une origine simplement cénesthésique. Ici, dans l'espace ça pense, ça parle, et ça prend forme : effets d'une pluralité imaginaire du sujet. Ces phénomènes sont à rapprocher de l'immixtion des sujets, relevant des divisions psychiques communes, mais s'exprimant, dans la psychose, par la scission de la personnalité.
L'héautoscopie de la pensée dans le cadre du transitivisme est dès lors à concevoir comme un trouble de la synthèse psychique se manifestant par un problème de localisation de la pensée. Mais elle n'est possible que parce que nous pensons ordinairement dans l'espace, et que, dans la psychose, les pensées, en tant qu'objet a, peuvent être amenées à faire sécession. Et c'est ainsi le sujet lui-même qui se retrouve dehors.
Mots clés : Héautoscopie, transitivisme, dédoublement, psychose hallucinatoire, scission de la personnalité, immixtion des sujets, pensée dans l'espace, xénopathie.
.
.
Le voyant
Les réflexions qui vont suivre trouvent leur origine dans le cas d'un patient atteint d'une psychose hallucinatoire chronique que nous eûmes à traiter, et que nous avons eu l'occasion de décrire en détail dans un livre auquel on pourra se référer pour en apprécier la clinique de façon plus complète (1).
Dans les périodes critiques de sa psychose, M. N., souffrait d'un syndrome que nous avions proposé d'appeler "héautoscopie de la pensée", parce qu'il était en butte à la dispersion hors de lui-même de ses propres pensées visualisées par lui. À l'exemple de Rimbaud, le "voyant", il voyait ses pensées sur la scène (2), mais pour lui elles paraissaient dévoilées à tous. Un tel vécu est difficile à décrire. Une de nos patientes qui éprouvait des distorsions semblables nous fit un jour cette remarque inouïe : "j'ai des sensations dans la ville". M. N. quant à lui, qui subissait également des hallucinations gulliveriennes, pouvait, certaines nuits, avoir l'impression d'être lui-même la ville, toute la ville !
Ainsi pouvait-il devenir aérien, comme si, par un défaut de bornage, quelque chose de lui s'échappait de son corps. Ce qui lui donnait l'impression inouïe d'être à l'extérieur de lui-même. Et c'était donc surtout ses pensées qui se projetaient sous forme d'images, à la vue de tous, dans le ciel de façon spectaculaire, ou même directement dans les gens, ou les objets. Quand il se levait le matin, "sa pensée sortait dehors" comme s'il était "centré à l'extérieur de lui-même". C'était ainsi son propre Moi qu'il lui semblait voir devant lui, disait-il. Et tout le monde pouvait alors connaître ses pensées, comme si les autres étaient "des Moi à l'extérieur", des Moi à lui, faut-il comprendre, c'est-à-dire des duplications projetées de son propre Moi. Il appelait ces phénomènes le "dédoublement".
Cela pouvait se produire avec la télévision par exemple, où il ne manquait pas de se reconnaître. C'est là une expérience très répandue chez beaucoup de nos patients psychotiques. Dans le cas de M. N., de façon plus étrange, lorsqu'il prenait le métro, il pouvait arriver que la rame elle-même, quand elle entrait en station, reflétât sa pensée. Celle-ci semblait alors s'y incarner, et c'était bientôt tout son être qui s'y projetait. Il n'ignorait pas évidemment l'absurdité, voire la cocasserie, d'une telle assertion.
Certes, le dispositif psychique que nous observâmes chez notre patient évoquera naturellement cette "décomposition spectrale des identifications du moi" que Lacan appelait "l'immixtion des sujets", tirée d'un rêve de Freud dans lequel des personnages se succédaient qui exprimaient ses propres pensées. Elle rendait compte du cristal suivant lequel "c'est toujours autour de l'ombre errante de son propre Moi que se structurent pour l'homme tous les objets de son monde", et que se projette en de multiples points de tout tableau perceptif la diffraction de son image spéculaire (3). Se justifiant surtout du caractère infixable, indéterminable, du sujet assumant la pensée de l'inconscient (4).
Alors, comment M. N. voyait-il ainsi ses pensées à l'extérieur ? Elles apparaissaient pour lui sous la forme d'esthésies sensorielles extraordinaires, telles que des manifestations de luminescence, apparentées aux phosphènes connus des psychiatres. Ce sont là effectivement des phénomènes qui peuvent se rencontrer dans les cas d'héautoscopie (5). Il arrivait ainsi que sa pensée s'éclairât, devînt "lumineuse", exposée visuellement sous la forme de "pensées images" (6).
Ses pensées prenaient également la forme de phénomènes remarquables de résonance. Il décrivait cela ainsi : "c'est comme si j'étais à l'extérieur de moi, ma pensée résonne à l'extérieur, dans le ciel, dans les bruits de la rue, dans le plancher [ ], c'est un peu en écho, en cascade, en bruits mais aussi en images". Il faut donc imaginer une résonance visible, comme une vibration, associée souvent aux phénomènes luminescents. Cela pouvait se passer dans les objets : dans les meubles, dans le plancher, dans le métro comme nous l'avons vu, dans les bruits de la ville auxquels sa pensée s'associait littéralement (7). Ces résonances pouvaient encore se manifester dans les gens eux-mêmes. Plus encore qu'une classique divination de la pensée, les gens lui paraissaient résonner de ses propres pensées (8). Aussi pouvait-il se sentir responsable de ce que les autres pouvaient éprouver, et même de leurs actions.
Parfois, il sentait que "son corps physique quittait son corps", à l'instar des O.B.E. décrites dans les phénomènes d'autoscopie (9). Et son corps lui semblait alors résonner "à l'extérieur".
La psychiatrie classique a pu retenir sous le générique d' "autoreprésentation aperceptive", de Georges Petit(10), le vécu hallucinatoire singulier où le patient perçoit ses pensées comme si elles venaient d'autrui, accompagné du sentiment de vol de la pensée (11), de divination et de dévoilement, dont le caractère d'étrangeté et d'altérité inspirait au psychiatre Guiraud la notion de xénopathie (12). Si nous choisissons ici le terme d'héautoscopie pour qualifier les manifestations éprouvées par M.N., c'est en raison du caractère formellement visuel des manifestations, sur lequel il insistait, et que nous avons vu culminer dans une véritable jouissance hallucinée de l'objet de la pulsion scopique.
Nous nous autorisons à parler ici d' "héautoscopie de la pensée" bien que le terme d'héautoscopie pût sembler réservé quelquefois à la perception hallucinatoire du corps dédoublé du patient. Mais nous le faisons cependant en accord avec ce qui a été décrit classiquement. Car ce n'était donc pas essentiellement son corps que le sujet reconnaissait hors de lui, où l'on réduit trop souvent l'héautoscopie, mais bien plutôt le développement de ses pensées, autant dire de sa propre concaténation signifiante, c'est-à-dire le procès même de sa subjectivation. Ce qu'il voyait alors ce n'était pas simplement des pensées qui auraient pu être semblables aux siennes, ce n'était pas non plus son propre message reçu de l'autre sous une forme inversée, c'était l'articulation de ses pensées dont l'enchaînement le produisait comme sujet du côté de l'autre, et qui reléguait ce qu'il en serait de son moi, c'est-à-dire sa demeure, à l'état de reste, pour ne pas dire de déchet. Faute d'un hébergement moïque consistant, c'est le sujet qui semblait se répandre à l'extérieur.
Se voir soi-même
Sans refaire ici l'histoire de l'héautoscopie, il nous faut toutefois dire quelques mots, utiles à notre étude, des approches qui l'ont concernée.
Dans sa thèse fameuse de 1903, Paul Sollier a rappelé quelques jalons de ce phénomène qu'il appelait à l'époque "autoscopie" (13). Il mentionnait des études statistiques qui en signalaient la relative rareté bien qu'elle fût connue depuis Aristote, qui en décrivit un exemple, et qu'elle eût même été éprouvée directement par des personnes célèbres qui en témoignèrent, telles que Goethe, Shelley, Musset ou Maupassant.
Si, au XIXe siècle Wigan, Michéa ou Lasègue en ont rapporté des cas, c'est Brierre de Boismont qui donna à ce phénomène, à la suite des psychiatres allemands, le nom de deutéroscopie (14). Terme réprouvé par Féré qui lui préféra, en 1891, celui d'hallucination autoscopique, dont l'épithète lui paraissait plus extensive ; et qu'il qualifiait même de spéculaire, bien qu'elle ne fût pas une simple image en miroir, mais une représentation autonome du sujet avec ses réactions et ses attributs propres, distincts de l'original (physiques, vestimentaires, etc.) (15). C'est enfin Jean Lhermitte qui lui consacra de nombreuses pages et qui lui attribua, en 1939, l'appellation d'héautoscopie, après Menninger-Lerchenthal, parce que le terme d'autoscopie, signifiant "voir soi-même", ne traduisait pas le sens qu'on semblait lui prêter, tandis que celui d'héautoscopie, c'est-à-dire "se voir soi-même" convenait beaucoup mieux à son objet précis. (16)
Le trouble fut souvent considéré, à l'origine, non pas comme une hallucination, mais comme une illusion sensorielle, eu égard au constat qu'il pût sembler relever, dans un certain nombre de cas, d'un probable dysfonctionnement sensoriel. Ainsi peut-il apparaître dans toutes les psychopathies comme en dehors de toute affection pathologique. Puisqu'on le rencontre de fait dans les accès convulsifs de l'épilepsie, la fièvre typhoïde, l'hystérie, sous la prise de drogues (17), lors de la confusion mentale ou l'onirisme pathologique, lors d'hallucinoses pédonculaires, ou de séquelles d'encéphalites, des états de somnolence ou d'endormissement, etc., aussi bien que dans la psychose, où il s'y distingue par son caractère persistant et plus fréquent, comme un aspect de l'automatisme mental (18) ; avec un terrain de prédilection pour la schizophrénie. Notons dès à présent que cette universalité du trouble est probablement l'indice qu'il prend forme sur un substratum commun.
Concernant le statut nosologique de l'héautoscopie psychotique, nous pouvons signaler qu'il n'est sans doute pas indifférent qu'on ait pu la situer soit dans le registre des hallucinations vraies, soit dans celui des pseudo-hallucinations, mais nous ne saurions nous appesantir ici sur cette question, bien qu'elle posât évidemment problème, eu égard, notamment, à la question de sa projection spatiale. (19)
Des études plus récentes conduites par des neurologues ont bien sûr tenté de clarifier ces phénomènes. Nous citerons par exemple celle de Blanke, Landis et col., qui en distingue trois formes (20) : l'autoscopie, au cours de laquelle le patient a la vision (souvent ressentie comme déréelle) de lui-même à l'extérieur, sans quitter son corps ; le phénomène d'O.B.E. (out of body experience) au cours duquel le patient a le sentiment de quitter son corps et de se voir lui-même de l'extérieur (de façon tout à fait réelle), le plus souvent du dessus comme s'il flottait dans l'espace ; et enfin, l'héautoscopie, qui représente en quelque sorte une expérience intermédiaire au cours de laquelle le patient hésite sur la situation de son moi, la perspective visuospatiale parasomatique alternant avec l'habituelle perspective visuospatiale physique. Pour les auteurs, ces phénomènes peuvent avoir pour origine des affections cérébrales infectieuses, traumatiques, tumorales, épileptiques, mais aussi concerner des personnes saines comme on l'observa chez des cosmonautes lors de missions spatiales. Ces phénomènes leur paraissent en relation avec une intégration défaillante de l'information proprioceptive, tactile et visuelle, dans l'espace multisensoriel personnel, et sont associés à différents degrés de dysfonctionnements vestibulaires conduisant à la désintégration entre l'espace personnel (vestibulaire) et intrapersonnel (visuel). De cette étude très détaillée, nous ne discuterons pas ici les hypothèses neurologiques, qui ne sont pas de notre compétence, mais nous signalerons toutefois sa limite à saisir une compréhension globale de ces phénomènes, comme à rendre compte de certains détails qui ont pour nous leur importance. Elles se montrent, par exemple, insuffisantes pour expliquer les différences entre l'image hallucinatoire de soi et le corps réel : si elles peuvent éclairer les problèmes posés par la sensation de positions différentes des membres, etc., elles n'ont rien à dire à propos des différences d'aspect de l'image du double, qui peuvent concerner l'âge, les vêtements ou la coupe de cheveux.
Une présence d'abord, le transitivisme
L'histoire de la notion d'héautoscopie montre donc les hésitations de la délimitation nosologique de cette manifestation, ainsi que les divergences des cliniciens concernant son interprétation. Cependant, notre propos n'est pas ici de trancher ces questions, mais de nous interroger sur un aspect qui intéresse notre cas clinique, en nous demandant si l'appréhension habituelle du phénomène n'a pas eu le tort de le centrer sur la vision du double par le sujet sous la forme de son image du corps ; sans doute en raison de l'aspect spectaculaire que le phénomène pouvait y prendre. Nous ne saurions naturellement pas nier le grand intérêt et l'apport de ces études concernant la somatognosie. Mais nous pensons, à la lumière de la clinique de M. N., que l'héautoscopie chez lui ne pourrait constituer qu'une expression particulière d'une problématique plus globale appartenant au registre du transitivisme. Et nous constatons en effet que l'on a pu décrire, par ailleurs, dès l'origine, des manifestations du trouble dans lesquelles l'identification à l'image hallucinée pouvait n'apparaître que très imparfaite, ou encore ne s'exprimer que par une simple communication, non pas matérielle, mais spirituelle avec la présence du double ; telles qu'elles pourraient évoquer ce qui se passe dans les hallucinations psychiques, au sens de Baillarger (1842). Et, en effet, est-ce bien dans le registre des pseudo-hallucinations que l'on a pu classer ce phénomène (21), conduisant aux "autoreprésentations aperceptives" de Georges Petit. Nous rappellerons enfin que pour Gilbert Ballet l'hallucination psychique précède effectivement les hallucinations psychosensorielles, "n'étant au demeurant, disait-il, qu'une forme d'écho de la pensée" (22).
La clinique de l'héautoscopie, relativement à une présence extérieure concernant l'intimité du sujet, évoque avec une certaine évidence pour nous le cas du célèbre "appareil à influencer" décrit par Viktor Tausk (23). Cet appareil, dont sa patiente Nathalia A. éprouvait la présence contraignante et persécutrice, était décrit par elle sous la forme d'un corps humain dont la ressemblance, même non complète, avec le sien ne faisait pas de doute. Ce qu'il montrait en effet c'était bien une identité entre son corps et la machine-corps de son délire, en butte à des sensations voire à des lésions analogues, aux mêmes endroits. L'appareil, nous disait Tausk, ne représentait pas seulement les organes génitaux, suivant l'interprétation qu'il en donnait, mais "de toute évidence la malade dans son entier". Il concevait ici une véritable projection : "le corps de la malade, insistait-il, projeté dans le monde extérieur" (24). Corrélativement à ce phénomène, Tausk parlait de la perte des limites du moi, ce qui nous conduit évidemment à la notion de transitivisme. Elle est implicite dans sa description, qui évoque tellement le cas de M. N. : "Les malades se plaignent, disait-il, que tout le monde connaît leurs pensées, que leurs pensées ne sont pas enfermées dans leur tête, mais répandues sans limites dans le monde, de telle sorte qu'elles se déroulent simultanément dans toutes les têtes" (25).
Alors qu'en est-il du transitivisme ? À l'origine, le terme de transitivisme avait été introduit par Carl Wernicke pour désigner la projection par un sujet d'une sensation ou d'un sentiment, voire de ses symptômes, sur un objet extérieur pouvant prendre la forme d'un double, ce qui le poussait dès lors à se sentir autre. Bien plus tard, J.-M. Sutter en proposa une acception élargie, comme le seul terme de la psychiatrie qui comprît toutes les manifestations cliniques "dans lesquelles s'altère ou disparaît la distinction entre le corps et l'espace ambiant, entre la pensée personnelle et celle d'autrui, entre le moi et le monde extérieur" (26), témoignant de leur profonde identité. Dans ces occurrences, le sujet se trouve alors en butte à "un univers mouvant qu'il ressent comme une extension indéfinie de lui-même", ouvrant la voie à une grande variété symptomatologique allant de l'effraction du corps jusqu'au sentiment d'influence à l'uvre dans l'automatisme mental, tandis que le sujet s'éprouve comme l'origine des sentiments voire des agissements des autres. Un univers mouvant où on le verra aussi bien être lui-même habité par leur pensée, sur un mode persécuteur ou culpabilisant, c'était là un autre volet de la symptomatologie de M. N.
Il y a donc lieu, pensons-nous de mettre en relation transitivisme et héautoscopie. Comme nous l'avons vu, la clinique de M. N. nous y invitait clairement.
Dans un propos, souligné par Stéphane Thibierge (27), Hécaen et Ajuriaguerra précisaient que "l'héautoscopie n'est pas un fait univoque, (et que) sa signification comme ses modalités sont multiples. Les formes oscillent de l'hallucination visuelle, à la conscience non esthésique d'un être moralement identique à lui-même, ou même au sentiment de dédoublement éprouvé et non projeté" (28). Ainsi l'hallucination du compagnon, décrite par Jean Lhermitte, serait-elle à rapprocher de ces phénomènes, relativement au sentiment de pure présence qu'elle décrit ; à l'exemple de ce patient de Jaspers qui sentait la présence de quelqu'un près de lui, avec une netteté extraordinaire sans qu'il ne l'ait jamais vu. Dès lors ne saurions-nous pas ignorer l'hypothèse que l'hallucination de son propre corps par le patient pourrait être conçue comme l'une des manifestations possibles du processus héautoscopique ; non pas comme le phénomène originel, mais plutôt comme le résultat d'une problématique qui la précède, dans le cadre du transitivisme.
Nous ferons remarquer ainsi que les phénomènes d'héautoscopie semblent toujours débuter, avant la vision d'une image, par le sentiment irrépressible d'une "présence" extérieure, que l'on pourrait rapprocher de ce que Jaspers appelait une "vive conscience physique" ; une présence dont le sujet ne doute pas qu'elle soit quelque chose de lui-même. C'est là que paraît se produire le dédoublement de la personnalité, dont parlent explicitement tous les patients cités par Sollier (tout comme M. N.).
La deuxième remarque que nous devons faire, à la suite de nombreux auteurs, c'est que préexiste chez les patients la manifestation d'une sensation originelle d'un malaise. Merleau-Ponty, qui se référait abondamment aux travaux de Jean Lhermitte, insistait sur le fait que "dans l'héautoscopie, avant de se voir lui-même, le sujet passe toujours par un état de songe, de rêverie ou d'angoisse, et l'image qui apparaît au-dehors n'est que l'envers de cette dépersonnalisation" (29).
La troisième remarque, c'est que ce que ressentent ces patients (leurs sensations et leurs sentiments) vient en quelque sorte se manifester du côté du double, par ce que Lhermitte appelait un transfert. C'est dire que l'héautoscopie n'est pas seulement la vision d'une image du double, mais l'expression d'une correspondance spirituelle et sensorielle avec ce double, à l'exemple de la machine décrite par Tausk. Jean Lhermitte signalait ainsi que le sujet, pendant la durée de l'autoscopie, est "envahi par un sentiment de tristesse profonde dont l'expression rayonne au point de pénétrer l'image du double, laquelle semble animée de vibrations affectives identiques à celles que ressent l'original" (30). Et, il ajoutait que ce type de transfert peut se produire "sans qu'apparaisse nettement la vision du double du sujet en crise". Nous sommes là avec évidence dans le cadre du transitivisme. Notre patient M. N. décrivait, comme nous l'avons vu, des sensations comparables à celles-ci. Et il est pour nous tout à fait remarquable que Jean Lhermitte fût conduit à comparer ce phénomène de transfert à ce que l'on peut observer dans les rêves, à la suite de Freud (31), où le rêveur se trouve placé en face de personnalités qui expriment les sentiments qui sont les siens (32) (c'est-à-dire ce que Lacan appelait l' "immixtion des sujets") ; mais, des personnalités qui, soit dit en passant, ne sont pas ici non plus représentées spécifiquement par l'image du sujet.
Ce qui est ressenti et qui s'extériorise en s'autonomisant semble donc se manifester, dans un moment critique, avant la formation éventuelle de l'image en tant que telle, qui pourrait bien paraître en résulter.
Héautoscopie et cénesthésie ? La "scission de la personnalité"
Dès lors, comment devons-nous comprendre la formation de l'image du double chez certains patients, sous la forme d'une représentation de leur propre corps ? Merleau-Ponty avait l'idée que "c'est dans son propre corps que le malade sent l'approche de cet Autre qu'il n'a jamais vu de ses yeux" (33). Et ce faisant, son point de vue était assez proche de celui de Sollier qui soutenait que les phénomènes d'autoscopie, avant d'être de véritables hallucinations visuelles, relèvent d'abord de sensations cénesthésiques, affirmant que dans beaucoup de cas "le sujet ne voit pas son double, mais qu'il le sent à côté de lui" (34). Pour lui, la formation de l'image du double était donc consécutive à la sensation cénesthésique que le sujet a de lui-même (à partir de ses organes), à laquelle il ajoute alors les attributs extérieurs qui se manifestent par la vision. C'est ainsi, pensait-il, que l'émancipation du sentiment cénesthésique se trouve "objectivée" et "extériorisée", en prenant l'aspect d'une hallucination (35).
Pour Gilbert Ballet également le trouble intellectuel de l'héautoscopie était "conditionné par la cénesthésie". Dans son mémoire fameux de 1911 sur la psychose hallucinatoire chronique, il disait à propos des phénomènes hallucinatoires qu'il y décrivait : "On rencontre (toujours) à l'origine un état cénesthésique pénible fait d'inquiétude vague. Cet état cénesthésique conduit [...] à des idées explicatives de persécution et d'ambition. [...] Elles s'associent toujours à des hallucinations des divers sens, qui, par leur constance, semblent les conditionner". (36)
Rappelons aussi que pour Guiraud, c'était la non-intégration des sensations cénesthésiques au moi qui était la raison des produits de l'imagination à l'extérieur, c'est-à-dire à une spatialisation des contenus de conscience, le conduisant à souligner cette altérité vécue par le patient qu'il appela la "xénopathie" ; et cette manifestation était le résultat de ce qu'il jugeait être une désintégration du moi. (37)
Cependant, comme le disait Lhermitte, à l'inverse de Sollier, le sentiment cénesthésique n'est pas tout. Puisqu'il existe des cas où la vision du double, comme de l'image spéculaire, ne peut s'y réduire eu égard à la complexité de ce qui relève de l'image du corps en tant que telle. Et, cette explication concernant la cénesthésie, pour intéressante qu'elle fût, ne peut en effet nous suffire. Car, lorsque Sollier est amené à parler d'"autoscopie négative" face au miroir (38), nous avons du mal à en saisir le sens cénesthésique. Et pour tout dire, il nous semble par ailleurs que l'attention portée par lui aux autoscopies internes (39) dont il fait grand cas pour souligner la nouveauté de leur étude scientifique, et qu'il tient avec force à assimiler au même phénomène, l'ait porté à généraliser le caractère manifestement cénesthésique de ces dernières (puisqu'elles intéressent directement les organes mêmes du corps) à toutes les manifestations autoscopiques. Alors que, si l'autoscopie peut effectivement se rapporter à des perceptions externes et à des perceptions internes, nous ne pouvons nécessairement en déduire une identité des processus.
Pour le jeune Lacan, celui de la thèse de 1932, la théorie cénesthésique restait séduisante en raison de ce que la cénesthésie pouvait être considérée, avec Ribot, comme étant à la base du sentiment psychologique individuel. Mais, ajoutait-il, rien ne permet de confirmer l'assertion que des troubles cénesthopathiques soient réellement à la base des idées délirantes (liées aux hallucinations), pour lesquelles l'idéogénèse, beaucoup plus complexe, semble naturellement plus sûre. Et il en appelait à la "critique vigoureuse" de Pierre Janet qui n'hésitait pas à parler de son caractère "tout verbal". (40)
C'est pourquoi nous devons prêter attention à la thèse de Lhermitte pour lequel, en effet, comme pour V. Bogaert, l'origine du phénomène héautoscopique n'est pas cénesthésique, mais hallucinatoire. Car, il s'agissait bien pour lui ici d'hallucinations visuelles véritables, à la mesure de ce que l'image que les patients voient est tout à fait comparable à l'image que l'on peut se faire ordinairement de soi-même en fermant les yeux. Et cette hallucination lui paraissait articulée à une perturbation de la somatognosie, où la notion d'image du corps se substituait à la cénesthésie trop générale. Or, ce qui est significatif pour nous, soit dit en passant, c'est que la notion d'image du corps n'avait pas chez lui de fondement physiologique, mais se définissait à partir du rapport du sujet à l'espace (41). C'est ainsi que l'héautoscopie apparaît en relation avec le fait que l'image du corps dépasse les limites tégumentaires. Cela pouvant expliquer sa possible émancipation. C'est à partir de ce substratum que l'on peut saisir ce qui se passe dans la psychose. Car, "la scission de la personnalité" et le "sentiment de dépersonnalisation" qui y sont à l'uvre, et que Lhermitte considérait comme le phénomène primaire de l'héautoscopie, vont en quelque sorte y investir la structure où elles trouveront à s'articuler.
Dans les phases critiques de la schizophrénie et des psychoses hallucinatoires chroniques, c'est à l'automatisme mental qu'Henri Hey attribuait les états de dédoublement. On reconnaîtra ici la congruence des syndromes, si l'on veut bien saisir dans l'automatisme mental la matrice clairement décrite de cette potentialité du double avec ce que Clérambault appelait la "personnalité seconde" venant s'opposer à la "personnalité prime". Il disait ainsi que "toute psychose hallucinatoire est une sorte de délire à deux" (42). Aussi avons-nous rappelé la proximité des phénomènes de l'automatisme mental et des phénomènes héautoscopiques, en soulignant l'émancipation en écho, dans ces derniers, non plus de la voix, mais de l'objet scopique. Sollier lui-même décrivait des cas cliniques dans lesquels l'automatisme mental était clairement à l'uvre dans l'expression de l'héautoscopie (43).
À ce sujet, il est significatif que Freud, dans son article sur L'inquiétante étrangeté (44), lorsqu'il tentait d'expliquer les phénomènes de dédoublement, fût conduit à faire référence à certains aspects qui appartiennent à la problématique de l'automatisme mental. Nous trouvons là d'abord la référence à la "conscience morale", c'est-à-dire à ce qui sera nommé ultérieurement le surmoi, qui semble habiter le double et s'oppose au sujet en le critiquant (indice déjà de la structure langagière du phénomène). Il y a également la référence au moi idéal, là où le double peut être amené à représenter certaines aspirations inassouvies du sujet. Et, il y a enfin une interprétation du double comme une formation primitive, révélant "une régression à l'époque où le moi n'était pas encore nettement délimité par rapport au monde extérieur et à autrui". À partir de ces observations nous pouvons penser que l'héautoscopie est aussi en rapport avec la structure du moi. Ainsi que le notait encore Stéphane Thibierge, Freud, à partir de la nouvelle d'Hoffmann Les Élixirs du Diable, décrivait la mise en scène de personnages, où l'un participe aux sentiments et aux expériences de l'autre, de sorte, disait-il, "qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir quant au moi propre, ou qu'on met le moi étranger à la place du moi propre - donc dédoublement du moi [ ] problématique de scission, de réduplication [ ] considérée par Freud comme étroitement solidaire de la structure du moi" (45).
Lacan lui-même, dans son article de 1938 sur les complexes familiaux en pathologie, rapprochait l'héautoscopie et l'automatisme mental comme deux modalités possibles pour le sujet en butte à la psychose hallucinatoire. Il écrivait ceci : "Le moi archaïque manifeste sa désagrégation dans le sentiment d'être épié, deviné, dévoilé, sentiment fondamental de la psychose hallucinatoire, et le double où il s'identifiait s'oppose au sujet, soit comme écho de la pensée et des actes dans les formes auditives et verbales de l'hallucination, dont les contenus autodiffamateurs marquent l'affinité évolutive avec la répression morale, soit comme fantôme spéculaire du corps dans certaines hallucinations visuelles" (46). Et, nous ajouterions une troisième occurrence composée des deux autres : soit comme hallucination visuelle de la pensée.
Ces quelques réflexions sont les motifs de notre insistance à soutenir à présent que s'il y a héautoscopie, depuis la simple présence devinée jusqu'à la vision réalisée du double, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres doubles, c'est que la division elle-même nous structure. Comme nous le verrons, elle est l'effet de ce que nous sommes en tant que sujet de l'inconscient. Cette division constitutive a le plus grand rapport avec notre appréhension de l'espace.
Un "trouble de la localisation de la pensée", L'immixtion des sujets
Nous avons parlé de cette présence près du sujet, dont celui-ci a le sentiment irrépressible qu'il s'agit de lui-même, comme d'une manifestation sans doute originelle au phénomène global de l'héautoscopie. Car, ce que décrivent nombre de patients, avant que de parler d'une image de leur corps, c'est d'abord de ce dédoublement de la "conscience", à l'exemple de ce que M. N. pouvait exprimer lui-même. Comment appréhender cette présence ?
Jean Lhermitte citait le cas d'un épileptique de Lemaître qui disait que, lorsqu'il lisait, sa "conscience" lui semblait sortir de lui-même (47). Il rapportait encore les propos d'un schizophrène en butte à une sensation de dédoublement : "j'éprouve le sentiment que ma conscience n'est plus dans mon corps, mais à dix mètres devant moi ; je ne suis plus dans mon corps". Il rapportait également le témoignage d'un dentiste qui ne souffrait d'aucune affection, décrit par Menninger-Lerchenthal qui, lorsqu'il apercevait son double, s'écriait : "Mon esprit s'échappe de mon corps !". Mais encore, ajoutait Jean Lhermitte : "Ce sentiment de la fuite de la conscience hors du corps nous le retrouvons aussi chez un Aristeas, chez un Harmonius de Clazomène, chez un Epiménide, le prophète de la Crète. A-t-on oublié que Cardanus, au cours de ses "extases", déclarait ressentir que son âme s'échappait de son corps, que pendant ce court espace de temps, toute sensation corporelle s'effaçait pour le transformer en pure conscience ? C'est donc bien en face d'un sentiment très anciennement développé dans l'âme humaine que nous nous trouvons" (48). Il citait encore à ce propos les travaux de Lévy-Brühl décrivant la croyance primitive au dédoublement du corps réel et du "corps astral", tout ensemble indépendants et unis mystiquement, comme chez les Maoris de Nouvelle-Zélande.
Jean Lhermitte reconnaissait toutefois que l'héautoscopie était particulièrement fréquente dans les cas de schizophrénie, où éclosent de façon privilégiée les sentiments de dépersonnalisation et de déréalisation, et il rappelait que Bleuler avait effectivement insisté pour ces cas, dans lesquels les malades perdent le sentiment des limites de leur corporalité, sur les perturbations de l'orientation autopsychique (49). Plus encore, disait-il, "dans les récits de combien de déments précoces ou de schizophrènes n'a-t-on pas recueilli le témoignage de l'évasion hors du corps, de la conscience, de la pensée ?" (50).
Il reprenait dès lors les conclusions de Paul Schilder (51) qui, s'appuyant sur l'expérience que l'on peut faire communément de se sentir considéré par un il spirituel, parlait explicitement d'une conscience extériorisée propre à expérimenter la connaissance de sa corporalité comme de sa situation dans l'espace. C'est ainsi que le moi pensant serait de cette façon divisé, dont une partie apparaîtrait extérieure. Et c'est pourquoi, selon Paul Schilder, le phénomène de l'héautoscopie tiendrait essentiellement à "un trouble de la localisation de la pensée", et qu'ainsi le moi localiserait sa pensée dans l'espace extérieur, sans qu'il oubliât sa situation dans le corps réel pourvu des organes des sens.
Le cas de M. N. en présentait un exemple évidemment remarquable qui nous poussa à insister sur l'idée d'une "héautoscopie de la pensée", bien qu'une telle dénomination fût pour nous, en quelque sorte, redondante eu égard au sens originel que nous lui reconnaissons. Comme nous l'avons formulé, ce que voyait M. N. à l'extérieur, c'était l'articulation de ses pensées, dont l'enchaînement le produisait manifestement comme sujet du côté de l'autre et qui reléguait son moi à l'état de reste.
Ce qui paraît donc premier et déterminant dans les phénomènes héautoscopiques à l'uvre dans la psychose c'est le trouble de la synthèse psychique, c'est-à-dire la scission de la personnalité et le sentiment de dépersonnalisation, associé à un trouble de la localisation de la pensée. Voilà pourquoi certains patients parlent explicitement de l'externalisation de leur "conscience". Et c'est ce qui faisait dire à M. N. qu'il était "décentré".
Concernant la question de la conscience, Lacan disait que le phénomène de la conscience en tant que tel, dû à la fonction imaginaire du moi, nécessitait que l'homme prît vue de lui-même du point de vue de l'autre. C'est pourquoi nous pensons opportun de revenir ici à l'exemple du rêve qui nous permet d'observer un phénomène psychique que nous voulons saisir comme modèle. Il s'agit de cette manière qu'adopte le rêve parfois d'exprimer ce que le rêveur pense, ses difficultés, ses ambivalences, par l'intervention de divers personnages. Ce que l'on peut comprendre là d'une décomposition spectrale des identifications du moi expose ainsi la présentification d'une pluralité imaginaire du sujet, d'un sujet polycéphale en quelque sorte, que Lacan appelait l' "immixtion des sujets" (52). Or, il nous semble que cette immixtion des sujets dans l'espace peut concerner de façon directe l'incarnation subjective dans l'image du double (53). Certes, le travail du rêve a-t-il pour effet de masquer l'identification du sujet et de ses doubles, à la différence de l'héautoscopie, qui nous expose la structure en clair, mais l'analogie de fonctionnement nous paraît toutefois indéniable. Aussi nous paraît-il étonnant que l'on ait pu passer sous silence ce rapprochement pourtant sensible entre les deux manifestations.
Or, nous devons insister sur le phénomène langagier pouvant apparaître en sous-main dans l'héautoscopie, à l'image de ce qui se passe pour Narcisse dès lors que ce sont ses propres paroles renvoyées par Écho qui se produisent sur l'axe imaginaire, et pas seulement l'image de son corps (54). C'est pourquoi le rapprochement avec l'immixtion des sujets nous paraît instructif de permettre de saisir l'organisation de l'héautoscopie à partir d'un phénomène originellement langagier, concernant la place du sujet en tant que tel. Damourette et Pichon, chez qui Lacan avait puisé ce terme, l'assignaient en effet à une structure de style grammaticale par laquelle le langage donne comme soutien au groupe verbal une autre représentation que l'agent de l'action, en quelque sorte par la mise en scène d'un autre sujet (55). Ce qui s'accorderait au fait que Lacan parlât dans le cadre du rêve de l'immixtion des sujets, bien sûr en raison du caractère infixable du sujet de l'inconscient, mais aussi parce que dans cette démultiplication il s'agit d'abord de discours.
Cette observation est ainsi l'indice pour nous de la place essentielle de la parole dans les phénomènes autoscopiques (56) que le cas de M. N. avait l'intérêt remarquable de nous montrer de façon pure ; bien qu'elle fût relativement ignorée des cliniciens, peut-être distraits par le mirage de la représentation imaginaire. Le mécanisme de l'immixtion des sujets peut ainsi nous permettre de comprendre que c'est à partir de la division et de la distribution de la parole, de la pensée, ou de la conscience, dans l'espace, que se manifeste une incarnation subjective par l'héautoscopie, partielle ou totale, sous la forme de l'image du double.
L'espace n'est pas vide ni homogène comme le pensait Bergson, et il nous paraît peuplé de potentialités : dans l'espace, ça pense, ça parle, et ça prend forme. C'est à partir de là que dans l'héautoscopie quelque chose s'hypostasie, se personnalise en image sous la forme de moi extérieurs (57). C'est ce que nous montre l'expression de la psychose en crise : si l'héautoscopie peut concerner tout le monde, il y a dans la psychose une structure particulière qui donne à ce substratum sa dimension visible. Et nous devons en souligner la spécificité.
Si nous adhérons à ce constat que dans la psychose l'hallucination est toujours d'abord verbale (58), nous devons apprécier comment dans ce cadre particulier l'insistance d'une parole autonomisée peut saisir dans le lit structural de l'héautoscopie un média à sa mesure. C'est pourquoi nous suivrons cette idée que l'hallucination verbale peut trouver à "s'habiller en plus du phénomène de l'héautoscopie", suivant la formule d'Éric Blumel (59) qui la qualifiait d'"enflure imaginaire d'un fait réel" dont l'hallucination psychotique verbale rend compte (60). Si l'héautoscopie est bien un phénomène scopique, ce que nous dévoile la psychose, quand elle y est en butte, c'est qu'elle s'organise aussi avec la parole. Et, nous pensons que la psychose se montre ainsi singulièrement propice à mettre en évidence la manière dont la parole, c'est-à-dire la pensée, habite la spatialité, comme la place du sujet dans l'espace, dont la structure commune témoigne. Ainsi, le phénomène relève-t-il de ce qui s'exprime de la structure (topologique) du sujet dans son rapport à l'espace. (61)
La place de l'objet a et l'émancipation de l'espace
Lacan (62) a expliqué comment il fallait concevoir la composition de l'image, ainsi que son rapport avec l'apparition du double. Or, il a produit une écriture particulière pour l'image du corps, composée de l'objet du manque mis entre parenthèses : i(a). Dans sa théorie, l'objet a désigne la cause du désir pour autant qu'il se justifie d'un manque, qui est de structure pour le sujet. Pour comprendre le sens de cette écriture, il faut considérer comment l'individu se trouve être représenté dès avant sa naissance, par et pour autrui, avec ce que Lagache appelait des "attributs", résultants du désir de l'Autre qui le précède. C'est donc un manque dans l'Autre, élidé en tant que tel bien que manifesté par certains traits, que le sujet vient endosser inconsciemment. Et c'est dans une image où ce manque (qui le représente) est mis entre parenthèses, c'est-à-dire sur la base d'une "méconnaissance", que le sujet accède à sa reconnaissance (63).
Si le manque est de structure pour le sujet, et son objet frappé d'une "méconnaissance" (64), il existe cependant certaines occurrences, dont la psychose en crise peut parfois témoigner, où l'objet du manque va être en quelque sorte présentifié, et dès lors apparaître dans le champ perceptif "comme surgissement d'un inconnu comme éprouvé" (65). Et nous savons que l'apparition de l'angoisse est le signe de cette situation. Sans doute, l'angoisse, qui peut présider à l'héautoscopie psychotique, trouve-t-elle là son origine. Que se passe-t-il alors ?
Se produit ici l'angoisse en relation avec cette unheimlich, cette inquiétante familiarité, dont parlait Freud, à propos des captations de l'image dans le conte d'Hoffmann Les Élixirs du Diable. Lacan y soulignait la notion de heim, c'est-à-dire la "maison", "au-delà de l'image dont nous sommes faits" qui "représente l'absence où nous sommes", en tant que lieu d'accueil du sujet, dans l'Autre. Mais, disait-il, que se révèle ce qu'elle est comme "présence ailleurs qui fait cette place comme absente", alors "elle s'empare de l'image qui la supporte, et l'image spéculaire devient l'image du double avec ce qu'elle apporte d'étrangeté" (66). Le sujet alors vacille et perd ici ses repères qui le faisaient se connaître dans l'Autre, c'est-à-dire dans ce heim, et se retrouve ainsi dehors, unheim, "hors là", à l'exemple du Horla de Maupassant (67).
Quelque chose de cessible qui se dédouble de l'image, comme une présence extérieure, relevant de cet objet présentifié, réalise ce qui se manifeste dans l'héautoscopie. Quelque chose que le sujet ne saurait nommer en tant que tel, mais qui le concerne éminemment, comme une part de son identité. Nous avançons donc cette hypothèse : cette "présence", dont nous avons voulu consacrer le caractère primordial dans l'héautoscopie, distinguée du corps, va parfois demeurer le simple sentiment d'une présence, énigmatique, parfois s'incarner sous la forme des pensées du sujet faisant sécession, ou parfois s'habiller de l'image du sujet donnant corps au double. Et cela, sous la forme d'une deuxième image, non pas spéculaire et captive, mais autonome, par laquelle ce qu'il en serait d' "une personnalité seconde", pour parler comme Clérambault, viendrait éventuellement s'opposer à la "personnalité prime".
Si notre patient décrivait que quelque chose de lui, qui pouvait être ses pensées, se retrouvait au-dehors, il nous faut ici comprendre comment ses pensées devenaient donc cessibles, comme des objets a, qui lui échappaient et s'autonomisaient (jusqu'au mentisme parfois) sous une forme spatialisée : une spatialité de la pensée hallucinée. D'une certaine façon, ses pensées faisaient sécession. Et les éléments d'explication que nous en donnerons ne pourront dès lors se contenter, comme pouvait le faire Tausk, d'évoquer simplement la régression à un stade où le patient s'identifiait au monde extérieur, faute d'avoir encore fixé les limites de son moi (68). Ce en quoi l'attention que nous portons au phénomène héautoscopique, lorsqu'il vient compléter le tableau du transitivisme, peut nous permettre une compréhension plus avancée de celui-ci.
Si l'objet a peut se présenter comme l'investiture du sujet, on pourra comprendre que ce qui se retrouvait dehors pour notre patient, en même temps que ses pensées, c'était également lui en tant que sujet, reléguant son moi à l'état de déchet. Confronté dès lors à un tel "dédoublement", c'était, comme il le disait, en parvenant "à dénicher un jardin secret à l'intérieur de lui-même" qu'il pouvait arriver à se retrouver ; suivant une topologie des parenthèses que nous savons à l'uvre dans la fonction de i(a).
Pourquoi le sujet peut-il voir ce qui le présentifie dans l'espace sous l'espèce de ses pensées ? C'est parce que ses pensées, comme sa présence elle-même, participent à l'exercice du champ scoptophilique, et à cet événement, que nous avons soutenu, que l'objet a qui prend forme ici c'est l'espace lui-même (69). On a parfois cherché à montrer que ce qui peut venir se détacher de l'image "prime" pourrait être le regard en tant qu'objet a, positivé. Cette hypothèse conforte évidemment notre point de vue, à condition de bien vouloir comprendre ce sens extensif que nous donnons à la notion d'objet a regard.
Dans le registre de la vison, même si l'on sait la distinction faite par Lacan de l'il, comme organe, et du regard, comme objet de la pulsion (70), on a l'habitude, sinon d'identifier, du moins de superposer, le regard à l'il, de l'incarner en quelque sorte de cette façon. Mais, le regard en tant qu'objet a est essentiellement évanescent. Il nous semble ainsi que l'on se trompe à chaque fois que l'on essaie de tirer de cette superposition des conjectures concernant le regard en tant que tel. Il y en a de multiples exemples dans la littérature psychanalytique. Pour n'en prendre qu'un, concernant une étude sur l'héautoscopie que nous avons citée, nous considérerons ce que son auteur a tenté d'interpréter à partir de l'observation de la fixité de l'il du sujet face à un miroir (71). On nous dit ici qu'il peut arriver que le regard du reflet puisse subitement s'animer, et présider à l'émergence du double en place de l'image spéculaire ; et que l'angoisse qu'en ressent le patient résulte effectivement de cette animation subite de l'objet a. C'est ainsi que l'on prend la fixité de l'il pour l'élision de l'objet, et sa mise en mouvement pour la présentification de a. Mais, la fixité de l'il de celui qui se regarde dans un miroir procède d'un dispositif optique incontournable qui échappe assurément au sujet, mais ne relève pas du refoulement de son désir. Aussi, lorsqu'on s'égare dans ce type d'interprétation, nous semble-t-il, on ne voit pas que, s'il y a bien un "regard mobile" qui s'anime, ce n'est pas la mise en mouvement de l'il qui peut en rendre compte, mais l'idée qu'on peut se faire de l' "ubiquité du voyant" dont parlait Merleau-Ponty, c'est-à-dire d'un regard omnivoyeur, qui habite l'espace et s'y déplace. Il n'est pas jusqu'aux délires d'observation que nous ne puissions comprendre avec cette émergence du regard dans l'espace, spatialité lui-même et non pas il. Et cela, sans qu'il s'y inscrive pour autant par une représentation de lui-même, mais par le principe même d'une ouverture. Merleau-Ponty évoquait à ce sujet cet "affolement d'une puissance visuelle", qu'il voyait à l'uvre de façon exemplaire dans l'hallucination extracampine. C'est, pensons-nous, en cela que consiste l'objet a regard, en tant que tel.
L'objet a regard, ce regard scoptophilique qui habite l'espace en tant que présence de notre désir de voir, et dont il est la raison comme nous le soutiendrons, ce regard, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que sujet, s'hypostasie et s'émancipe dans l'héautoscopie sous la forme du double, mais aussi bien des pensées. Et, si "nous pensons dans l'espace", pour parler comme Bergson (72), nous devons saisir le rapport organique de la pensée et de l'espace. Aussi ne saurions-nous ignorer un constat majeur, dont l'indice nous est donné par les hallucinations gullivériennes, que, dans le cadre de l'héautoscopie, avec l'émancipation de la pensée ou de l'image, c'est bien l'espace en tant que tel qui s'émancipe. En cela l'héautoscopie intéresse la question de l'espace, et peut nous permettre d'avancer dans les progrès de sa compréhension.
Notes :
(1) Jacques Lis, L'homme à l'envers / Le rapport du sujet à l'espace et la question du dedans dehors, Éditions L'Harmattan, Paris, 2016.
(2) "Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de ma propre pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bon sur la scène" (Arthur Rimbaud, La lettre du voyant).
(3) J. Lacan, Le séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, éditions du Seuil, 1978, pp. 192-199.
(4) J. Lacan, Le séminaire, La logique du fantasme, inédit, séance du 15/02/67.
(5) Jean Lhermitte, L'image de notre corps (1939), Éditions de la nouvelle revue critique, Paris, 1939.
(6) Le Président Schreber, auquel Freud s'intéressa, parlait de manière semblable de "l'illumination du système nerveux interne" par les rayons divins (Daniel Paul Schreber, Mémoires d'un névropathe, éditions du Seuil, col. Points, pp. 135, 174, 248).
(7) Le président Schreber expliquait la pensée comme un phénomène vibratoire la mettant en relation homothétique, comme au diapason, avec les bruits extérieurs, sur lesquels venaient "se moduler et en quelque sorte s'inscrire" ses "esthésies sensorielles" (Mémoires d'un névropathe, op. cit., pp. 135, 174, 248).
(8) Dans le cas fameux de "l'homme aux paroles imposées" interrogé à Sainte-Anne par Lacan, quand le sujet pensait cela répondait ailleurs, dans un autre registre, dans le Réel, qui pouvait être quelqu'un passant à sa portée, qui résonnait alors réellement d'une pensée ; conduisant Marcel Czermak à subvertir la nomenclature de Sérieux et Capgras des folies raisonnantes pour parler à sa façon de "folie résonnante" (Marcel Czermak, Passions de l'objet, op. cit., p. 17.
(9) Ces expériences de sortie hors du corps (out of body experiences, OBE), ont été étudiées, entre autres, par des neurologues, comme Blanke et al., par exemple (Out of body experience and autoscopy of neurological origin, Brain, 2004, 127, pp. 243-258.). Nous les avons-nous même rencontrés chez des patients vraisemblablement sujets à des comitialités.
(10) Georges Petit, Essais sur une variété de pseudo-hallucinations, Les autoreprésentations aperceptives, Thèse, Cadoret, Bordeaux, 1913.
(11) Laing citait le cas de Julie qui, comme nous le verrons a quelque rapport avec celui de M. N. : "Elle pensait des choses (a,b,c). J'exprimais des pensées identiques (a1, b1, c1), donc j'avais volé ses pensées. L'expression psychotique de cet état de fait consistait pour elle à m'accuser d'avoir son cerveau dans ma tête. Réciproquement, lorsqu'elle m'imitait ou copiait mes attitudes, elle s'attendait à une réaction de ma part pour avoir "libéré" un peu de moi qu'elle estimait voir volé" (Le moi divisé, Tavistock Publications (1959), Éditions Stock Plus, Paris, 1970, 1979, p. 283.
(12) H. Ey, P. Bernard, C. Brisset, Manuel de psychiatrie, Éditions Masson & compagnie, Paris, 1962-67, p. 116.
(13) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, Éditions Alcan, Pairs, 1903.
(14) Alexandre Brierre de Boismont, Des hallucinations, ou Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, des rêves, du magnétisme, Éditions Germer Baillière, Paris, 1862.
(15) Charles Féré, Note sur les hallucinations autoscopiques ou spéculaires et sur les hallucinations altruistes, C.R. Société de Biol. 1891, p. 451.
(16) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op.cit., p.171.
(17) Expériences d'autoscopie sous intoxication par le haschich décrites par Paul Schilder.
(18) Bleuler décrivait, en effet, ce caractère de la "dépersonnalisation" de donner au patient le sentiment de la perte des limites de leur corporalité.
(19) Rappelons quand même le souhait de Nodet, dans sa critique du regroupement des phénomènes hallucinatoires par G. Ballet, de revenir à la définition traditionnelle de l'hallucination formulée par Esquirol pour rétrécir le champ de l'hallucination authentique. Il proposait ainsi de distinguer :
1) Les hallucinations vraies, définies comme perceptions sans objet, au sens de Ball, mais avec une nécessaire conviction intime. 2) Les hallucinoses, suivant le terme de Wernicke, qui sont des hallucinations auxquelles le patient n'ajoute pas foi, sans délire explicite, et le plus souvent d'origine neurologique ; semblables aux illusions des amputés, ou aux auras épileptiques, etc. 3) Les pseudo hallucinations, appartenant au monde intérieur de nos pensées, qui présenteraient un défaut d'objectivité spatiale et ne se projetteraient donc pas à l'extérieur (sic), mais qui révéleraient une pseudo-altérité psychique. Elles correspondent aux hallucinations psychiques de Baillarger. (Charles-Henri Nodet, Le groupe des psychoses hallucinatoires chroniques, Essai nosographique, Thèse, G. Doin & cie éditeurs, Paris, 1937, pp. 82-89)
(20) Olaf Blanke, Theodor Landis, Laurent Spinellii, Margatitta Seeck, Out-of-body-experience and autoscopy of neurological origin, Brain, 2004, 127, pp. 243-258.
(21) Charles-Henri Nodet, Le groupe des psychoses hallucinatoires chroniques, op. cit., p. 80.
(22) Gilbert Ballet, À propos de la psychose hallucinatoire, in L'encéphale, 1914 ; 9,7, pp. 79-81.
(23) Viktor Tausk, L' "appareil à influencer" des schizophrènes, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2010.
(24) Ibidem, p. 62.
(25) Ibidem, p. 70.
(26) J.-M. Sutter, Transitivisme, article du Manuel alphabétique de psychiatrie, ss la dir. d'Antoine Porot, P.U.F., Paris, 1952-1975, pp. 602-603.
(27) Stéphane Thibierge, L'image et le double, la fonction spéculaire en pathologie, op. cit., p. 30.
(28) H. Hécaen et j. Ajuriagerra, Méconnaissance et hallucinations corporelles, intégration et désintégration de la somatognosie, Éditions Masson, Paris, 1952, p. 336.
(29) Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Paris, 1945, p. 248.
(30) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op.cit., p.191.
(31) Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, Éditions des P.U.F., Paris, 1926, pp. 254, 278.
(32) Ibidem, p. 193 et 194.
(33) Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 248.
(34) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit., p. 38.
(35) Ibidem, p. 42.
(36) Gilbert Ballet, La psychose hallucinatoire chronique, Encéphale, 6e année, 2e sem., n°11, 10 novembre 1911, pp. 402-402.
(37) Paul Guiraud, Psychiatrie générale, Éditions Le François, Paris, 1950.
(38) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit., p.31.
(39) Ces autoscopies internes dont témoignent certains patients concernent la vision mentale de leurs organes internes, comme des objets pouvant y séjourner.
(40) Jacques Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Éditions Le François, Paris, 1932. Éditions du Seuil, Paris, 1975, p. 129.
(41) C'est à partir des travaux de Pierre Bonnier sur les troubles labyrinthiques que Jean Lhermitte soutenait cette idée qui pourrait paraître étonnante chez l'éminent neurologue qu'il était.
(42) Gaëtan Gatian de Clérambault, uvre psychiatrique, Tome II, Éditions des P.U.F., Bibliothèque de Psychiatrie, Paris, 1942, p. 563 et suiv.
(43) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit. p. 19.
(44) Sigmund Freud, L'inquiétante étrangeté, in Essais de psychanalyse appliquée, Editions Gallimard, Paris, 1971.
(45) L'image et le double, op. cit., p. 31.
(46) Jacques Lacan, Les complexes familiaux en pathologie, in Encyclopédie Française, Tome VIII, La vie mentale, sous la dir. d'Henri Wallon, mars 1938, chapitre II (8.42-2). Propos soulignés par Stéphane Thibierge.
(47) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op. cit., p. 191.
(48) Ibidem, p. 221.
(49) Ibidem, p. 223.
(50) Ibidem, p. 238
(51) Paul Schilder, L'image de notre corps, (1935), Éditions Gallimard, Paris, 1968, traduction François Gantheret.
(52) Jacques Lacan, Le séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, op. cit., pp. 192-200.
(53) À propos de l'automatisme mental, M. N. disait pas parfois : "c'est comme si je me faisais des reproches par l'intermédiaire d'autres personnes". Nous présentons là l'identité d'un phénomène primordial.
(54) Éric Blumel, L'hallucination du double, in Analitica n°22, Le miroir, le double, Cahiers de recherche du champ freudien, Éditions Lyse, Paris, 1980, p. 44.
(55) Par exemple : "Le vieillard prodigue vit payer ses dettes par son frère". Damourette et Pichon, Des mots à la pensée, Essais de grammaire de langue française, Paris, d'Artrey, 1911-1940, T. 5.
(56) Marcel Czermak a publié l'étude du cas, à "caractère héautoscopique", d'une de ses patientes en butte à la présence de son double près d'elle, non pas visualisée comme image de son corps, mais comme présence pure, "sans apparence physique", pour laquelle il soulignait précisément la relation du dédoublement de la parole d'avec le sentiment d'être dédoublé (Sur quelques phénomènes élémentaires de la psychose. À propos d'un cas, in Nodal N°1, Certaines conséquences de l'enseignement de Lacan, Editions Joseph Clims, 1984).
(57) Nous reprendrons ultérieurement le fameux stade du miroir avec lequel Lacan montrait le rôle de l'image de l'autre dans la constitution du moi, insistant sur cette "extériorité" d'une Gestalt rendant compte précisément des apparitions hallucinatoires de l'imago du corps propre du sujet dans l'héautoscopie.
(58) Nous pensons notamment à l'étude très claire qu'en fit Erik Porge : Abord de l'hallucination, in Littoral 3-4, L'assertitude paranoïaque, Éditions Érès, Paris, février 1982.
(59) Éric Blumel, L'hallucination du double, op. cit., p.52.
(60) Nous n'irions pas toutefois jusqu'à dire comme cet auteur que l'héautoscopie n'est pas une hallucination, car le fait que l'hallucination psychotique ait une origine verbale (fût-ce à y situer le symbolique forclos réapparaissant dans le réel) ne retire pas à son expression visuelle le caractère proprement hallucinatoire.
(61) Voir L'homme à l'envers, op.cit.
(62) Lacan, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : "Psychanalyse et structure de la personnalité", Écrits, pp. 647-684.
(63) Merleau-Ponty, entre autres, remarquait que le double n'est pas toujours reconnu à certains détails
(64) Dire que le manque est de structure c'est évoquer le fait qu'il est nécessaire à l'amorce de toute chaîne signifiante, tout en lui assignant sa place dans l'ontogenèse du désir. Ce qui fait du sujet un sujet désirant c'est que l'objet (perdu) qui cause son désir est marqué d'un interdit, et de fait refoulé. Ainsi, de façon paradigmatique, on peut dire que c'est l'interdit paternel qui s'oppose à un quelconque conjungo avec la mère, représenté structuralement par le signifiant du Nom-du-Père, celui de la loi et de la castration. C'est donc le signifiant du Nom-du-Père qui barre l'objet du désir, et l'élide du champ de la réalité, qui ne se soutient que de cette extraction, comme le soulignait Lacan. Sauf dans la psychose, en raison de la forclusion de ce signifiant primordial.
(65) Jacques Lacan, Le séminaire, livre X, L'angoisse, Éditions du Seuil, Paris, 2004, séance du 12/12/1962.
(66) Ibidem, séance du 5/12/1962.
(67) Antonio Quinet, Le plus de regard, Destin de la pulsion scopique, Éditions du champ lacanien, Paris, 2003, p. 162.
(68) L'appareil à influencer des schizophrènes, op. cit., p. 96.
(69) Voir L'homme à l'envers.
(70) Jacques Lacan, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, Paris, 1973, séances de février 1964.
(71) Éric Blumel, L'hallucination du double, op. cit.
(72) "Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le plus souvent dans l'espace", telle fut la première phrase de l'uvre de Bergson (Les données immédiates de la conscience, Éditions des P.U.F., Paris 1927, Éditions Quadrige, 2007, p. 1).
Lire plus
Il est un peu court de les réduire à une origine simplement cénesthésique. Ici, dans l'espace ça pense, ça parle, et ça prend forme : effets d'une pluralité imaginaire du sujet. Ces phénomènes sont à rapprocher de l'immixtion des sujets, relevant des divisions psychiques communes, mais s'exprimant, dans la psychose, par la scission de la personnalité.
L'héautoscopie de la pensée dans le cadre du transitivisme est dès lors à concevoir comme un trouble de la synthèse psychique se manifestant par un problème de localisation de la pensée. Mais elle n'est possible que parce que nous pensons ordinairement dans l'espace, et que, dans la psychose, les pensées, en tant qu'objet a, peuvent être amenées à faire sécession. Et c'est ainsi le sujet lui-même qui se retrouve dehors.
Mots clés : Héautoscopie, transitivisme, dédoublement, psychose hallucinatoire, scission de la personnalité, immixtion des sujets, pensée dans l'espace, xénopathie.
.
.
Les réflexions qui vont suivre trouvent leur origine dans le cas d'un patient atteint d'une psychose hallucinatoire chronique que nous eûmes à traiter, et que nous avons eu l'occasion de décrire en détail dans un livre auquel on pourra se référer pour en apprécier la clinique de façon plus complète (1).
Dans les périodes critiques de sa psychose, M. N., souffrait d'un syndrome que nous avions proposé d'appeler "héautoscopie de la pensée", parce qu'il était en butte à la dispersion hors de lui-même de ses propres pensées visualisées par lui. À l'exemple de Rimbaud, le "voyant", il voyait ses pensées sur la scène (2), mais pour lui elles paraissaient dévoilées à tous. Un tel vécu est difficile à décrire. Une de nos patientes qui éprouvait des distorsions semblables nous fit un jour cette remarque inouïe : "j'ai des sensations dans la ville". M. N. quant à lui, qui subissait également des hallucinations gulliveriennes, pouvait, certaines nuits, avoir l'impression d'être lui-même la ville, toute la ville !
Ainsi pouvait-il devenir aérien, comme si, par un défaut de bornage, quelque chose de lui s'échappait de son corps. Ce qui lui donnait l'impression inouïe d'être à l'extérieur de lui-même. Et c'était donc surtout ses pensées qui se projetaient sous forme d'images, à la vue de tous, dans le ciel de façon spectaculaire, ou même directement dans les gens, ou les objets. Quand il se levait le matin, "sa pensée sortait dehors" comme s'il était "centré à l'extérieur de lui-même". C'était ainsi son propre Moi qu'il lui semblait voir devant lui, disait-il. Et tout le monde pouvait alors connaître ses pensées, comme si les autres étaient "des Moi à l'extérieur", des Moi à lui, faut-il comprendre, c'est-à-dire des duplications projetées de son propre Moi. Il appelait ces phénomènes le "dédoublement".
Cela pouvait se produire avec la télévision par exemple, où il ne manquait pas de se reconnaître. C'est là une expérience très répandue chez beaucoup de nos patients psychotiques. Dans le cas de M. N., de façon plus étrange, lorsqu'il prenait le métro, il pouvait arriver que la rame elle-même, quand elle entrait en station, reflétât sa pensée. Celle-ci semblait alors s'y incarner, et c'était bientôt tout son être qui s'y projetait. Il n'ignorait pas évidemment l'absurdité, voire la cocasserie, d'une telle assertion.
Certes, le dispositif psychique que nous observâmes chez notre patient évoquera naturellement cette "décomposition spectrale des identifications du moi" que Lacan appelait "l'immixtion des sujets", tirée d'un rêve de Freud dans lequel des personnages se succédaient qui exprimaient ses propres pensées. Elle rendait compte du cristal suivant lequel "c'est toujours autour de l'ombre errante de son propre Moi que se structurent pour l'homme tous les objets de son monde", et que se projette en de multiples points de tout tableau perceptif la diffraction de son image spéculaire (3). Se justifiant surtout du caractère infixable, indéterminable, du sujet assumant la pensée de l'inconscient (4).
Alors, comment M. N. voyait-il ainsi ses pensées à l'extérieur ? Elles apparaissaient pour lui sous la forme d'esthésies sensorielles extraordinaires, telles que des manifestations de luminescence, apparentées aux phosphènes connus des psychiatres. Ce sont là effectivement des phénomènes qui peuvent se rencontrer dans les cas d'héautoscopie (5). Il arrivait ainsi que sa pensée s'éclairât, devînt "lumineuse", exposée visuellement sous la forme de "pensées images" (6).
Ses pensées prenaient également la forme de phénomènes remarquables de résonance. Il décrivait cela ainsi : "c'est comme si j'étais à l'extérieur de moi, ma pensée résonne à l'extérieur, dans le ciel, dans les bruits de la rue, dans le plancher [ ], c'est un peu en écho, en cascade, en bruits mais aussi en images". Il faut donc imaginer une résonance visible, comme une vibration, associée souvent aux phénomènes luminescents. Cela pouvait se passer dans les objets : dans les meubles, dans le plancher, dans le métro comme nous l'avons vu, dans les bruits de la ville auxquels sa pensée s'associait littéralement (7). Ces résonances pouvaient encore se manifester dans les gens eux-mêmes. Plus encore qu'une classique divination de la pensée, les gens lui paraissaient résonner de ses propres pensées (8). Aussi pouvait-il se sentir responsable de ce que les autres pouvaient éprouver, et même de leurs actions.
Parfois, il sentait que "son corps physique quittait son corps", à l'instar des O.B.E. décrites dans les phénomènes d'autoscopie (9). Et son corps lui semblait alors résonner "à l'extérieur".
La psychiatrie classique a pu retenir sous le générique d' "autoreprésentation aperceptive", de Georges Petit(10), le vécu hallucinatoire singulier où le patient perçoit ses pensées comme si elles venaient d'autrui, accompagné du sentiment de vol de la pensée (11), de divination et de dévoilement, dont le caractère d'étrangeté et d'altérité inspirait au psychiatre Guiraud la notion de xénopathie (12). Si nous choisissons ici le terme d'héautoscopie pour qualifier les manifestations éprouvées par M.N., c'est en raison du caractère formellement visuel des manifestations, sur lequel il insistait, et que nous avons vu culminer dans une véritable jouissance hallucinée de l'objet de la pulsion scopique.
Nous nous autorisons à parler ici d' "héautoscopie de la pensée" bien que le terme d'héautoscopie pût sembler réservé quelquefois à la perception hallucinatoire du corps dédoublé du patient. Mais nous le faisons cependant en accord avec ce qui a été décrit classiquement. Car ce n'était donc pas essentiellement son corps que le sujet reconnaissait hors de lui, où l'on réduit trop souvent l'héautoscopie, mais bien plutôt le développement de ses pensées, autant dire de sa propre concaténation signifiante, c'est-à-dire le procès même de sa subjectivation. Ce qu'il voyait alors ce n'était pas simplement des pensées qui auraient pu être semblables aux siennes, ce n'était pas non plus son propre message reçu de l'autre sous une forme inversée, c'était l'articulation de ses pensées dont l'enchaînement le produisait comme sujet du côté de l'autre, et qui reléguait ce qu'il en serait de son moi, c'est-à-dire sa demeure, à l'état de reste, pour ne pas dire de déchet. Faute d'un hébergement moïque consistant, c'est le sujet qui semblait se répandre à l'extérieur.
Sans refaire ici l'histoire de l'héautoscopie, il nous faut toutefois dire quelques mots, utiles à notre étude, des approches qui l'ont concernée.
Dans sa thèse fameuse de 1903, Paul Sollier a rappelé quelques jalons de ce phénomène qu'il appelait à l'époque "autoscopie" (13). Il mentionnait des études statistiques qui en signalaient la relative rareté bien qu'elle fût connue depuis Aristote, qui en décrivit un exemple, et qu'elle eût même été éprouvée directement par des personnes célèbres qui en témoignèrent, telles que Goethe, Shelley, Musset ou Maupassant.
Si, au XIXe siècle Wigan, Michéa ou Lasègue en ont rapporté des cas, c'est Brierre de Boismont qui donna à ce phénomène, à la suite des psychiatres allemands, le nom de deutéroscopie (14). Terme réprouvé par Féré qui lui préféra, en 1891, celui d'hallucination autoscopique, dont l'épithète lui paraissait plus extensive ; et qu'il qualifiait même de spéculaire, bien qu'elle ne fût pas une simple image en miroir, mais une représentation autonome du sujet avec ses réactions et ses attributs propres, distincts de l'original (physiques, vestimentaires, etc.) (15). C'est enfin Jean Lhermitte qui lui consacra de nombreuses pages et qui lui attribua, en 1939, l'appellation d'héautoscopie, après Menninger-Lerchenthal, parce que le terme d'autoscopie, signifiant "voir soi-même", ne traduisait pas le sens qu'on semblait lui prêter, tandis que celui d'héautoscopie, c'est-à-dire "se voir soi-même" convenait beaucoup mieux à son objet précis. (16)
Le trouble fut souvent considéré, à l'origine, non pas comme une hallucination, mais comme une illusion sensorielle, eu égard au constat qu'il pût sembler relever, dans un certain nombre de cas, d'un probable dysfonctionnement sensoriel. Ainsi peut-il apparaître dans toutes les psychopathies comme en dehors de toute affection pathologique. Puisqu'on le rencontre de fait dans les accès convulsifs de l'épilepsie, la fièvre typhoïde, l'hystérie, sous la prise de drogues (17), lors de la confusion mentale ou l'onirisme pathologique, lors d'hallucinoses pédonculaires, ou de séquelles d'encéphalites, des états de somnolence ou d'endormissement, etc., aussi bien que dans la psychose, où il s'y distingue par son caractère persistant et plus fréquent, comme un aspect de l'automatisme mental (18) ; avec un terrain de prédilection pour la schizophrénie. Notons dès à présent que cette universalité du trouble est probablement l'indice qu'il prend forme sur un substratum commun.
Concernant le statut nosologique de l'héautoscopie psychotique, nous pouvons signaler qu'il n'est sans doute pas indifférent qu'on ait pu la situer soit dans le registre des hallucinations vraies, soit dans celui des pseudo-hallucinations, mais nous ne saurions nous appesantir ici sur cette question, bien qu'elle posât évidemment problème, eu égard, notamment, à la question de sa projection spatiale. (19)
Des études plus récentes conduites par des neurologues ont bien sûr tenté de clarifier ces phénomènes. Nous citerons par exemple celle de Blanke, Landis et col., qui en distingue trois formes (20) : l'autoscopie, au cours de laquelle le patient a la vision (souvent ressentie comme déréelle) de lui-même à l'extérieur, sans quitter son corps ; le phénomène d'O.B.E. (out of body experience) au cours duquel le patient a le sentiment de quitter son corps et de se voir lui-même de l'extérieur (de façon tout à fait réelle), le plus souvent du dessus comme s'il flottait dans l'espace ; et enfin, l'héautoscopie, qui représente en quelque sorte une expérience intermédiaire au cours de laquelle le patient hésite sur la situation de son moi, la perspective visuospatiale parasomatique alternant avec l'habituelle perspective visuospatiale physique. Pour les auteurs, ces phénomènes peuvent avoir pour origine des affections cérébrales infectieuses, traumatiques, tumorales, épileptiques, mais aussi concerner des personnes saines comme on l'observa chez des cosmonautes lors de missions spatiales. Ces phénomènes leur paraissent en relation avec une intégration défaillante de l'information proprioceptive, tactile et visuelle, dans l'espace multisensoriel personnel, et sont associés à différents degrés de dysfonctionnements vestibulaires conduisant à la désintégration entre l'espace personnel (vestibulaire) et intrapersonnel (visuel). De cette étude très détaillée, nous ne discuterons pas ici les hypothèses neurologiques, qui ne sont pas de notre compétence, mais nous signalerons toutefois sa limite à saisir une compréhension globale de ces phénomènes, comme à rendre compte de certains détails qui ont pour nous leur importance. Elles se montrent, par exemple, insuffisantes pour expliquer les différences entre l'image hallucinatoire de soi et le corps réel : si elles peuvent éclairer les problèmes posés par la sensation de positions différentes des membres, etc., elles n'ont rien à dire à propos des différences d'aspect de l'image du double, qui peuvent concerner l'âge, les vêtements ou la coupe de cheveux.
L'histoire de la notion d'héautoscopie montre donc les hésitations de la délimitation nosologique de cette manifestation, ainsi que les divergences des cliniciens concernant son interprétation. Cependant, notre propos n'est pas ici de trancher ces questions, mais de nous interroger sur un aspect qui intéresse notre cas clinique, en nous demandant si l'appréhension habituelle du phénomène n'a pas eu le tort de le centrer sur la vision du double par le sujet sous la forme de son image du corps ; sans doute en raison de l'aspect spectaculaire que le phénomène pouvait y prendre. Nous ne saurions naturellement pas nier le grand intérêt et l'apport de ces études concernant la somatognosie. Mais nous pensons, à la lumière de la clinique de M. N., que l'héautoscopie chez lui ne pourrait constituer qu'une expression particulière d'une problématique plus globale appartenant au registre du transitivisme. Et nous constatons en effet que l'on a pu décrire, par ailleurs, dès l'origine, des manifestations du trouble dans lesquelles l'identification à l'image hallucinée pouvait n'apparaître que très imparfaite, ou encore ne s'exprimer que par une simple communication, non pas matérielle, mais spirituelle avec la présence du double ; telles qu'elles pourraient évoquer ce qui se passe dans les hallucinations psychiques, au sens de Baillarger (1842). Et, en effet, est-ce bien dans le registre des pseudo-hallucinations que l'on a pu classer ce phénomène (21), conduisant aux "autoreprésentations aperceptives" de Georges Petit. Nous rappellerons enfin que pour Gilbert Ballet l'hallucination psychique précède effectivement les hallucinations psychosensorielles, "n'étant au demeurant, disait-il, qu'une forme d'écho de la pensée" (22).
La clinique de l'héautoscopie, relativement à une présence extérieure concernant l'intimité du sujet, évoque avec une certaine évidence pour nous le cas du célèbre "appareil à influencer" décrit par Viktor Tausk (23). Cet appareil, dont sa patiente Nathalia A. éprouvait la présence contraignante et persécutrice, était décrit par elle sous la forme d'un corps humain dont la ressemblance, même non complète, avec le sien ne faisait pas de doute. Ce qu'il montrait en effet c'était bien une identité entre son corps et la machine-corps de son délire, en butte à des sensations voire à des lésions analogues, aux mêmes endroits. L'appareil, nous disait Tausk, ne représentait pas seulement les organes génitaux, suivant l'interprétation qu'il en donnait, mais "de toute évidence la malade dans son entier". Il concevait ici une véritable projection : "le corps de la malade, insistait-il, projeté dans le monde extérieur" (24). Corrélativement à ce phénomène, Tausk parlait de la perte des limites du moi, ce qui nous conduit évidemment à la notion de transitivisme. Elle est implicite dans sa description, qui évoque tellement le cas de M. N. : "Les malades se plaignent, disait-il, que tout le monde connaît leurs pensées, que leurs pensées ne sont pas enfermées dans leur tête, mais répandues sans limites dans le monde, de telle sorte qu'elles se déroulent simultanément dans toutes les têtes" (25).
Alors qu'en est-il du transitivisme ? À l'origine, le terme de transitivisme avait été introduit par Carl Wernicke pour désigner la projection par un sujet d'une sensation ou d'un sentiment, voire de ses symptômes, sur un objet extérieur pouvant prendre la forme d'un double, ce qui le poussait dès lors à se sentir autre. Bien plus tard, J.-M. Sutter en proposa une acception élargie, comme le seul terme de la psychiatrie qui comprît toutes les manifestations cliniques "dans lesquelles s'altère ou disparaît la distinction entre le corps et l'espace ambiant, entre la pensée personnelle et celle d'autrui, entre le moi et le monde extérieur" (26), témoignant de leur profonde identité. Dans ces occurrences, le sujet se trouve alors en butte à "un univers mouvant qu'il ressent comme une extension indéfinie de lui-même", ouvrant la voie à une grande variété symptomatologique allant de l'effraction du corps jusqu'au sentiment d'influence à l'uvre dans l'automatisme mental, tandis que le sujet s'éprouve comme l'origine des sentiments voire des agissements des autres. Un univers mouvant où on le verra aussi bien être lui-même habité par leur pensée, sur un mode persécuteur ou culpabilisant, c'était là un autre volet de la symptomatologie de M. N.
Il y a donc lieu, pensons-nous de mettre en relation transitivisme et héautoscopie. Comme nous l'avons vu, la clinique de M. N. nous y invitait clairement.
Dans un propos, souligné par Stéphane Thibierge (27), Hécaen et Ajuriaguerra précisaient que "l'héautoscopie n'est pas un fait univoque, (et que) sa signification comme ses modalités sont multiples. Les formes oscillent de l'hallucination visuelle, à la conscience non esthésique d'un être moralement identique à lui-même, ou même au sentiment de dédoublement éprouvé et non projeté" (28). Ainsi l'hallucination du compagnon, décrite par Jean Lhermitte, serait-elle à rapprocher de ces phénomènes, relativement au sentiment de pure présence qu'elle décrit ; à l'exemple de ce patient de Jaspers qui sentait la présence de quelqu'un près de lui, avec une netteté extraordinaire sans qu'il ne l'ait jamais vu. Dès lors ne saurions-nous pas ignorer l'hypothèse que l'hallucination de son propre corps par le patient pourrait être conçue comme l'une des manifestations possibles du processus héautoscopique ; non pas comme le phénomène originel, mais plutôt comme le résultat d'une problématique qui la précède, dans le cadre du transitivisme.
Nous ferons remarquer ainsi que les phénomènes d'héautoscopie semblent toujours débuter, avant la vision d'une image, par le sentiment irrépressible d'une "présence" extérieure, que l'on pourrait rapprocher de ce que Jaspers appelait une "vive conscience physique" ; une présence dont le sujet ne doute pas qu'elle soit quelque chose de lui-même. C'est là que paraît se produire le dédoublement de la personnalité, dont parlent explicitement tous les patients cités par Sollier (tout comme M. N.).
La deuxième remarque que nous devons faire, à la suite de nombreux auteurs, c'est que préexiste chez les patients la manifestation d'une sensation originelle d'un malaise. Merleau-Ponty, qui se référait abondamment aux travaux de Jean Lhermitte, insistait sur le fait que "dans l'héautoscopie, avant de se voir lui-même, le sujet passe toujours par un état de songe, de rêverie ou d'angoisse, et l'image qui apparaît au-dehors n'est que l'envers de cette dépersonnalisation" (29).
La troisième remarque, c'est que ce que ressentent ces patients (leurs sensations et leurs sentiments) vient en quelque sorte se manifester du côté du double, par ce que Lhermitte appelait un transfert. C'est dire que l'héautoscopie n'est pas seulement la vision d'une image du double, mais l'expression d'une correspondance spirituelle et sensorielle avec ce double, à l'exemple de la machine décrite par Tausk. Jean Lhermitte signalait ainsi que le sujet, pendant la durée de l'autoscopie, est "envahi par un sentiment de tristesse profonde dont l'expression rayonne au point de pénétrer l'image du double, laquelle semble animée de vibrations affectives identiques à celles que ressent l'original" (30). Et, il ajoutait que ce type de transfert peut se produire "sans qu'apparaisse nettement la vision du double du sujet en crise". Nous sommes là avec évidence dans le cadre du transitivisme. Notre patient M. N. décrivait, comme nous l'avons vu, des sensations comparables à celles-ci. Et il est pour nous tout à fait remarquable que Jean Lhermitte fût conduit à comparer ce phénomène de transfert à ce que l'on peut observer dans les rêves, à la suite de Freud (31), où le rêveur se trouve placé en face de personnalités qui expriment les sentiments qui sont les siens (32) (c'est-à-dire ce que Lacan appelait l' "immixtion des sujets") ; mais, des personnalités qui, soit dit en passant, ne sont pas ici non plus représentées spécifiquement par l'image du sujet.
Ce qui est ressenti et qui s'extériorise en s'autonomisant semble donc se manifester, dans un moment critique, avant la formation éventuelle de l'image en tant que telle, qui pourrait bien paraître en résulter.
Dès lors, comment devons-nous comprendre la formation de l'image du double chez certains patients, sous la forme d'une représentation de leur propre corps ? Merleau-Ponty avait l'idée que "c'est dans son propre corps que le malade sent l'approche de cet Autre qu'il n'a jamais vu de ses yeux" (33). Et ce faisant, son point de vue était assez proche de celui de Sollier qui soutenait que les phénomènes d'autoscopie, avant d'être de véritables hallucinations visuelles, relèvent d'abord de sensations cénesthésiques, affirmant que dans beaucoup de cas "le sujet ne voit pas son double, mais qu'il le sent à côté de lui" (34). Pour lui, la formation de l'image du double était donc consécutive à la sensation cénesthésique que le sujet a de lui-même (à partir de ses organes), à laquelle il ajoute alors les attributs extérieurs qui se manifestent par la vision. C'est ainsi, pensait-il, que l'émancipation du sentiment cénesthésique se trouve "objectivée" et "extériorisée", en prenant l'aspect d'une hallucination (35).
Pour Gilbert Ballet également le trouble intellectuel de l'héautoscopie était "conditionné par la cénesthésie". Dans son mémoire fameux de 1911 sur la psychose hallucinatoire chronique, il disait à propos des phénomènes hallucinatoires qu'il y décrivait : "On rencontre (toujours) à l'origine un état cénesthésique pénible fait d'inquiétude vague. Cet état cénesthésique conduit [...] à des idées explicatives de persécution et d'ambition. [...] Elles s'associent toujours à des hallucinations des divers sens, qui, par leur constance, semblent les conditionner". (36)
Rappelons aussi que pour Guiraud, c'était la non-intégration des sensations cénesthésiques au moi qui était la raison des produits de l'imagination à l'extérieur, c'est-à-dire à une spatialisation des contenus de conscience, le conduisant à souligner cette altérité vécue par le patient qu'il appela la "xénopathie" ; et cette manifestation était le résultat de ce qu'il jugeait être une désintégration du moi. (37)
Cependant, comme le disait Lhermitte, à l'inverse de Sollier, le sentiment cénesthésique n'est pas tout. Puisqu'il existe des cas où la vision du double, comme de l'image spéculaire, ne peut s'y réduire eu égard à la complexité de ce qui relève de l'image du corps en tant que telle. Et, cette explication concernant la cénesthésie, pour intéressante qu'elle fût, ne peut en effet nous suffire. Car, lorsque Sollier est amené à parler d'"autoscopie négative" face au miroir (38), nous avons du mal à en saisir le sens cénesthésique. Et pour tout dire, il nous semble par ailleurs que l'attention portée par lui aux autoscopies internes (39) dont il fait grand cas pour souligner la nouveauté de leur étude scientifique, et qu'il tient avec force à assimiler au même phénomène, l'ait porté à généraliser le caractère manifestement cénesthésique de ces dernières (puisqu'elles intéressent directement les organes mêmes du corps) à toutes les manifestations autoscopiques. Alors que, si l'autoscopie peut effectivement se rapporter à des perceptions externes et à des perceptions internes, nous ne pouvons nécessairement en déduire une identité des processus.
Pour le jeune Lacan, celui de la thèse de 1932, la théorie cénesthésique restait séduisante en raison de ce que la cénesthésie pouvait être considérée, avec Ribot, comme étant à la base du sentiment psychologique individuel. Mais, ajoutait-il, rien ne permet de confirmer l'assertion que des troubles cénesthopathiques soient réellement à la base des idées délirantes (liées aux hallucinations), pour lesquelles l'idéogénèse, beaucoup plus complexe, semble naturellement plus sûre. Et il en appelait à la "critique vigoureuse" de Pierre Janet qui n'hésitait pas à parler de son caractère "tout verbal". (40)
C'est pourquoi nous devons prêter attention à la thèse de Lhermitte pour lequel, en effet, comme pour V. Bogaert, l'origine du phénomène héautoscopique n'est pas cénesthésique, mais hallucinatoire. Car, il s'agissait bien pour lui ici d'hallucinations visuelles véritables, à la mesure de ce que l'image que les patients voient est tout à fait comparable à l'image que l'on peut se faire ordinairement de soi-même en fermant les yeux. Et cette hallucination lui paraissait articulée à une perturbation de la somatognosie, où la notion d'image du corps se substituait à la cénesthésie trop générale. Or, ce qui est significatif pour nous, soit dit en passant, c'est que la notion d'image du corps n'avait pas chez lui de fondement physiologique, mais se définissait à partir du rapport du sujet à l'espace (41). C'est ainsi que l'héautoscopie apparaît en relation avec le fait que l'image du corps dépasse les limites tégumentaires. Cela pouvant expliquer sa possible émancipation. C'est à partir de ce substratum que l'on peut saisir ce qui se passe dans la psychose. Car, "la scission de la personnalité" et le "sentiment de dépersonnalisation" qui y sont à l'uvre, et que Lhermitte considérait comme le phénomène primaire de l'héautoscopie, vont en quelque sorte y investir la structure où elles trouveront à s'articuler.
Dans les phases critiques de la schizophrénie et des psychoses hallucinatoires chroniques, c'est à l'automatisme mental qu'Henri Hey attribuait les états de dédoublement. On reconnaîtra ici la congruence des syndromes, si l'on veut bien saisir dans l'automatisme mental la matrice clairement décrite de cette potentialité du double avec ce que Clérambault appelait la "personnalité seconde" venant s'opposer à la "personnalité prime". Il disait ainsi que "toute psychose hallucinatoire est une sorte de délire à deux" (42). Aussi avons-nous rappelé la proximité des phénomènes de l'automatisme mental et des phénomènes héautoscopiques, en soulignant l'émancipation en écho, dans ces derniers, non plus de la voix, mais de l'objet scopique. Sollier lui-même décrivait des cas cliniques dans lesquels l'automatisme mental était clairement à l'uvre dans l'expression de l'héautoscopie (43).
À ce sujet, il est significatif que Freud, dans son article sur L'inquiétante étrangeté (44), lorsqu'il tentait d'expliquer les phénomènes de dédoublement, fût conduit à faire référence à certains aspects qui appartiennent à la problématique de l'automatisme mental. Nous trouvons là d'abord la référence à la "conscience morale", c'est-à-dire à ce qui sera nommé ultérieurement le surmoi, qui semble habiter le double et s'oppose au sujet en le critiquant (indice déjà de la structure langagière du phénomène). Il y a également la référence au moi idéal, là où le double peut être amené à représenter certaines aspirations inassouvies du sujet. Et, il y a enfin une interprétation du double comme une formation primitive, révélant "une régression à l'époque où le moi n'était pas encore nettement délimité par rapport au monde extérieur et à autrui". À partir de ces observations nous pouvons penser que l'héautoscopie est aussi en rapport avec la structure du moi. Ainsi que le notait encore Stéphane Thibierge, Freud, à partir de la nouvelle d'Hoffmann Les Élixirs du Diable, décrivait la mise en scène de personnages, où l'un participe aux sentiments et aux expériences de l'autre, de sorte, disait-il, "qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir quant au moi propre, ou qu'on met le moi étranger à la place du moi propre - donc dédoublement du moi [ ] problématique de scission, de réduplication [ ] considérée par Freud comme étroitement solidaire de la structure du moi" (45).
Lacan lui-même, dans son article de 1938 sur les complexes familiaux en pathologie, rapprochait l'héautoscopie et l'automatisme mental comme deux modalités possibles pour le sujet en butte à la psychose hallucinatoire. Il écrivait ceci : "Le moi archaïque manifeste sa désagrégation dans le sentiment d'être épié, deviné, dévoilé, sentiment fondamental de la psychose hallucinatoire, et le double où il s'identifiait s'oppose au sujet, soit comme écho de la pensée et des actes dans les formes auditives et verbales de l'hallucination, dont les contenus autodiffamateurs marquent l'affinité évolutive avec la répression morale, soit comme fantôme spéculaire du corps dans certaines hallucinations visuelles" (46). Et, nous ajouterions une troisième occurrence composée des deux autres : soit comme hallucination visuelle de la pensée.
Ces quelques réflexions sont les motifs de notre insistance à soutenir à présent que s'il y a héautoscopie, depuis la simple présence devinée jusqu'à la vision réalisée du double, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres doubles, c'est que la division elle-même nous structure. Comme nous le verrons, elle est l'effet de ce que nous sommes en tant que sujet de l'inconscient. Cette division constitutive a le plus grand rapport avec notre appréhension de l'espace.
Nous avons parlé de cette présence près du sujet, dont celui-ci a le sentiment irrépressible qu'il s'agit de lui-même, comme d'une manifestation sans doute originelle au phénomène global de l'héautoscopie. Car, ce que décrivent nombre de patients, avant que de parler d'une image de leur corps, c'est d'abord de ce dédoublement de la "conscience", à l'exemple de ce que M. N. pouvait exprimer lui-même. Comment appréhender cette présence ?
Jean Lhermitte citait le cas d'un épileptique de Lemaître qui disait que, lorsqu'il lisait, sa "conscience" lui semblait sortir de lui-même (47). Il rapportait encore les propos d'un schizophrène en butte à une sensation de dédoublement : "j'éprouve le sentiment que ma conscience n'est plus dans mon corps, mais à dix mètres devant moi ; je ne suis plus dans mon corps". Il rapportait également le témoignage d'un dentiste qui ne souffrait d'aucune affection, décrit par Menninger-Lerchenthal qui, lorsqu'il apercevait son double, s'écriait : "Mon esprit s'échappe de mon corps !". Mais encore, ajoutait Jean Lhermitte : "Ce sentiment de la fuite de la conscience hors du corps nous le retrouvons aussi chez un Aristeas, chez un Harmonius de Clazomène, chez un Epiménide, le prophète de la Crète. A-t-on oublié que Cardanus, au cours de ses "extases", déclarait ressentir que son âme s'échappait de son corps, que pendant ce court espace de temps, toute sensation corporelle s'effaçait pour le transformer en pure conscience ? C'est donc bien en face d'un sentiment très anciennement développé dans l'âme humaine que nous nous trouvons" (48). Il citait encore à ce propos les travaux de Lévy-Brühl décrivant la croyance primitive au dédoublement du corps réel et du "corps astral", tout ensemble indépendants et unis mystiquement, comme chez les Maoris de Nouvelle-Zélande.
Jean Lhermitte reconnaissait toutefois que l'héautoscopie était particulièrement fréquente dans les cas de schizophrénie, où éclosent de façon privilégiée les sentiments de dépersonnalisation et de déréalisation, et il rappelait que Bleuler avait effectivement insisté pour ces cas, dans lesquels les malades perdent le sentiment des limites de leur corporalité, sur les perturbations de l'orientation autopsychique (49). Plus encore, disait-il, "dans les récits de combien de déments précoces ou de schizophrènes n'a-t-on pas recueilli le témoignage de l'évasion hors du corps, de la conscience, de la pensée ?" (50).
Il reprenait dès lors les conclusions de Paul Schilder (51) qui, s'appuyant sur l'expérience que l'on peut faire communément de se sentir considéré par un il spirituel, parlait explicitement d'une conscience extériorisée propre à expérimenter la connaissance de sa corporalité comme de sa situation dans l'espace. C'est ainsi que le moi pensant serait de cette façon divisé, dont une partie apparaîtrait extérieure. Et c'est pourquoi, selon Paul Schilder, le phénomène de l'héautoscopie tiendrait essentiellement à "un trouble de la localisation de la pensée", et qu'ainsi le moi localiserait sa pensée dans l'espace extérieur, sans qu'il oubliât sa situation dans le corps réel pourvu des organes des sens.
Le cas de M. N. en présentait un exemple évidemment remarquable qui nous poussa à insister sur l'idée d'une "héautoscopie de la pensée", bien qu'une telle dénomination fût pour nous, en quelque sorte, redondante eu égard au sens originel que nous lui reconnaissons. Comme nous l'avons formulé, ce que voyait M. N. à l'extérieur, c'était l'articulation de ses pensées, dont l'enchaînement le produisait manifestement comme sujet du côté de l'autre et qui reléguait son moi à l'état de reste.
Ce qui paraît donc premier et déterminant dans les phénomènes héautoscopiques à l'uvre dans la psychose c'est le trouble de la synthèse psychique, c'est-à-dire la scission de la personnalité et le sentiment de dépersonnalisation, associé à un trouble de la localisation de la pensée. Voilà pourquoi certains patients parlent explicitement de l'externalisation de leur "conscience". Et c'est ce qui faisait dire à M. N. qu'il était "décentré".
Concernant la question de la conscience, Lacan disait que le phénomène de la conscience en tant que tel, dû à la fonction imaginaire du moi, nécessitait que l'homme prît vue de lui-même du point de vue de l'autre. C'est pourquoi nous pensons opportun de revenir ici à l'exemple du rêve qui nous permet d'observer un phénomène psychique que nous voulons saisir comme modèle. Il s'agit de cette manière qu'adopte le rêve parfois d'exprimer ce que le rêveur pense, ses difficultés, ses ambivalences, par l'intervention de divers personnages. Ce que l'on peut comprendre là d'une décomposition spectrale des identifications du moi expose ainsi la présentification d'une pluralité imaginaire du sujet, d'un sujet polycéphale en quelque sorte, que Lacan appelait l' "immixtion des sujets" (52). Or, il nous semble que cette immixtion des sujets dans l'espace peut concerner de façon directe l'incarnation subjective dans l'image du double (53). Certes, le travail du rêve a-t-il pour effet de masquer l'identification du sujet et de ses doubles, à la différence de l'héautoscopie, qui nous expose la structure en clair, mais l'analogie de fonctionnement nous paraît toutefois indéniable. Aussi nous paraît-il étonnant que l'on ait pu passer sous silence ce rapprochement pourtant sensible entre les deux manifestations.
Or, nous devons insister sur le phénomène langagier pouvant apparaître en sous-main dans l'héautoscopie, à l'image de ce qui se passe pour Narcisse dès lors que ce sont ses propres paroles renvoyées par Écho qui se produisent sur l'axe imaginaire, et pas seulement l'image de son corps (54). C'est pourquoi le rapprochement avec l'immixtion des sujets nous paraît instructif de permettre de saisir l'organisation de l'héautoscopie à partir d'un phénomène originellement langagier, concernant la place du sujet en tant que tel. Damourette et Pichon, chez qui Lacan avait puisé ce terme, l'assignaient en effet à une structure de style grammaticale par laquelle le langage donne comme soutien au groupe verbal une autre représentation que l'agent de l'action, en quelque sorte par la mise en scène d'un autre sujet (55). Ce qui s'accorderait au fait que Lacan parlât dans le cadre du rêve de l'immixtion des sujets, bien sûr en raison du caractère infixable du sujet de l'inconscient, mais aussi parce que dans cette démultiplication il s'agit d'abord de discours.
Cette observation est ainsi l'indice pour nous de la place essentielle de la parole dans les phénomènes autoscopiques (56) que le cas de M. N. avait l'intérêt remarquable de nous montrer de façon pure ; bien qu'elle fût relativement ignorée des cliniciens, peut-être distraits par le mirage de la représentation imaginaire. Le mécanisme de l'immixtion des sujets peut ainsi nous permettre de comprendre que c'est à partir de la division et de la distribution de la parole, de la pensée, ou de la conscience, dans l'espace, que se manifeste une incarnation subjective par l'héautoscopie, partielle ou totale, sous la forme de l'image du double.
L'espace n'est pas vide ni homogène comme le pensait Bergson, et il nous paraît peuplé de potentialités : dans l'espace, ça pense, ça parle, et ça prend forme. C'est à partir de là que dans l'héautoscopie quelque chose s'hypostasie, se personnalise en image sous la forme de moi extérieurs (57). C'est ce que nous montre l'expression de la psychose en crise : si l'héautoscopie peut concerner tout le monde, il y a dans la psychose une structure particulière qui donne à ce substratum sa dimension visible. Et nous devons en souligner la spécificité.
Si nous adhérons à ce constat que dans la psychose l'hallucination est toujours d'abord verbale (58), nous devons apprécier comment dans ce cadre particulier l'insistance d'une parole autonomisée peut saisir dans le lit structural de l'héautoscopie un média à sa mesure. C'est pourquoi nous suivrons cette idée que l'hallucination verbale peut trouver à "s'habiller en plus du phénomène de l'héautoscopie", suivant la formule d'Éric Blumel (59) qui la qualifiait d'"enflure imaginaire d'un fait réel" dont l'hallucination psychotique verbale rend compte (60). Si l'héautoscopie est bien un phénomène scopique, ce que nous dévoile la psychose, quand elle y est en butte, c'est qu'elle s'organise aussi avec la parole. Et, nous pensons que la psychose se montre ainsi singulièrement propice à mettre en évidence la manière dont la parole, c'est-à-dire la pensée, habite la spatialité, comme la place du sujet dans l'espace, dont la structure commune témoigne. Ainsi, le phénomène relève-t-il de ce qui s'exprime de la structure (topologique) du sujet dans son rapport à l'espace. (61)
L
Lacan (62) a expliqué comment il fallait concevoir la composition de l'image, ainsi que son rapport avec l'apparition du double. Or, il a produit une écriture particulière pour l'image du corps, composée de l'objet du manque mis entre parenthèses : i(a). Dans sa théorie, l'objet a désigne la cause du désir pour autant qu'il se justifie d'un manque, qui est de structure pour le sujet. Pour comprendre le sens de cette écriture, il faut considérer comment l'individu se trouve être représenté dès avant sa naissance, par et pour autrui, avec ce que Lagache appelait des "attributs", résultants du désir de l'Autre qui le précède. C'est donc un manque dans l'Autre, élidé en tant que tel bien que manifesté par certains traits, que le sujet vient endosser inconsciemment. Et c'est dans une image où ce manque (qui le représente) est mis entre parenthèses, c'est-à-dire sur la base d'une "méconnaissance", que le sujet accède à sa reconnaissance (63).
Si le manque est de structure pour le sujet, et son objet frappé d'une "méconnaissance" (64), il existe cependant certaines occurrences, dont la psychose en crise peut parfois témoigner, où l'objet du manque va être en quelque sorte présentifié, et dès lors apparaître dans le champ perceptif "comme surgissement d'un inconnu comme éprouvé" (65). Et nous savons que l'apparition de l'angoisse est le signe de cette situation. Sans doute, l'angoisse, qui peut présider à l'héautoscopie psychotique, trouve-t-elle là son origine. Que se passe-t-il alors ?
Se produit ici l'angoisse en relation avec cette unheimlich, cette inquiétante familiarité, dont parlait Freud, à propos des captations de l'image dans le conte d'Hoffmann Les Élixirs du Diable. Lacan y soulignait la notion de heim, c'est-à-dire la "maison", "au-delà de l'image dont nous sommes faits" qui "représente l'absence où nous sommes", en tant que lieu d'accueil du sujet, dans l'Autre. Mais, disait-il, que se révèle ce qu'elle est comme "présence ailleurs qui fait cette place comme absente", alors "elle s'empare de l'image qui la supporte, et l'image spéculaire devient l'image du double avec ce qu'elle apporte d'étrangeté" (66). Le sujet alors vacille et perd ici ses repères qui le faisaient se connaître dans l'Autre, c'est-à-dire dans ce heim, et se retrouve ainsi dehors, unheim, "hors là", à l'exemple du Horla de Maupassant (67).
Quelque chose de cessible qui se dédouble de l'image, comme une présence extérieure, relevant de cet objet présentifié, réalise ce qui se manifeste dans l'héautoscopie. Quelque chose que le sujet ne saurait nommer en tant que tel, mais qui le concerne éminemment, comme une part de son identité. Nous avançons donc cette hypothèse : cette "présence", dont nous avons voulu consacrer le caractère primordial dans l'héautoscopie, distinguée du corps, va parfois demeurer le simple sentiment d'une présence, énigmatique, parfois s'incarner sous la forme des pensées du sujet faisant sécession, ou parfois s'habiller de l'image du sujet donnant corps au double. Et cela, sous la forme d'une deuxième image, non pas spéculaire et captive, mais autonome, par laquelle ce qu'il en serait d' "une personnalité seconde", pour parler comme Clérambault, viendrait éventuellement s'opposer à la "personnalité prime".
Si notre patient décrivait que quelque chose de lui, qui pouvait être ses pensées, se retrouvait au-dehors, il nous faut ici comprendre comment ses pensées devenaient donc cessibles, comme des objets a, qui lui échappaient et s'autonomisaient (jusqu'au mentisme parfois) sous une forme spatialisée : une spatialité de la pensée hallucinée. D'une certaine façon, ses pensées faisaient sécession. Et les éléments d'explication que nous en donnerons ne pourront dès lors se contenter, comme pouvait le faire Tausk, d'évoquer simplement la régression à un stade où le patient s'identifiait au monde extérieur, faute d'avoir encore fixé les limites de son moi (68). Ce en quoi l'attention que nous portons au phénomène héautoscopique, lorsqu'il vient compléter le tableau du transitivisme, peut nous permettre une compréhension plus avancée de celui-ci.
Si l'objet a peut se présenter comme l'investiture du sujet, on pourra comprendre que ce qui se retrouvait dehors pour notre patient, en même temps que ses pensées, c'était également lui en tant que sujet, reléguant son moi à l'état de déchet. Confronté dès lors à un tel "dédoublement", c'était, comme il le disait, en parvenant "à dénicher un jardin secret à l'intérieur de lui-même" qu'il pouvait arriver à se retrouver ; suivant une topologie des parenthèses que nous savons à l'uvre dans la fonction de i(a).
Pourquoi le sujet peut-il voir ce qui le présentifie dans l'espace sous l'espèce de ses pensées ? C'est parce que ses pensées, comme sa présence elle-même, participent à l'exercice du champ scoptophilique, et à cet événement, que nous avons soutenu, que l'objet a qui prend forme ici c'est l'espace lui-même (69). On a parfois cherché à montrer que ce qui peut venir se détacher de l'image "prime" pourrait être le regard en tant qu'objet a, positivé. Cette hypothèse conforte évidemment notre point de vue, à condition de bien vouloir comprendre ce sens extensif que nous donnons à la notion d'objet a regard.
Dans le registre de la vison, même si l'on sait la distinction faite par Lacan de l'il, comme organe, et du regard, comme objet de la pulsion (70), on a l'habitude, sinon d'identifier, du moins de superposer, le regard à l'il, de l'incarner en quelque sorte de cette façon. Mais, le regard en tant qu'objet a est essentiellement évanescent. Il nous semble ainsi que l'on se trompe à chaque fois que l'on essaie de tirer de cette superposition des conjectures concernant le regard en tant que tel. Il y en a de multiples exemples dans la littérature psychanalytique. Pour n'en prendre qu'un, concernant une étude sur l'héautoscopie que nous avons citée, nous considérerons ce que son auteur a tenté d'interpréter à partir de l'observation de la fixité de l'il du sujet face à un miroir (71). On nous dit ici qu'il peut arriver que le regard du reflet puisse subitement s'animer, et présider à l'émergence du double en place de l'image spéculaire ; et que l'angoisse qu'en ressent le patient résulte effectivement de cette animation subite de l'objet a. C'est ainsi que l'on prend la fixité de l'il pour l'élision de l'objet, et sa mise en mouvement pour la présentification de a. Mais, la fixité de l'il de celui qui se regarde dans un miroir procède d'un dispositif optique incontournable qui échappe assurément au sujet, mais ne relève pas du refoulement de son désir. Aussi, lorsqu'on s'égare dans ce type d'interprétation, nous semble-t-il, on ne voit pas que, s'il y a bien un "regard mobile" qui s'anime, ce n'est pas la mise en mouvement de l'il qui peut en rendre compte, mais l'idée qu'on peut se faire de l' "ubiquité du voyant" dont parlait Merleau-Ponty, c'est-à-dire d'un regard omnivoyeur, qui habite l'espace et s'y déplace. Il n'est pas jusqu'aux délires d'observation que nous ne puissions comprendre avec cette émergence du regard dans l'espace, spatialité lui-même et non pas il. Et cela, sans qu'il s'y inscrive pour autant par une représentation de lui-même, mais par le principe même d'une ouverture. Merleau-Ponty évoquait à ce sujet cet "affolement d'une puissance visuelle", qu'il voyait à l'uvre de façon exemplaire dans l'hallucination extracampine. C'est, pensons-nous, en cela que consiste l'objet a regard, en tant que tel.
L'objet a regard, ce regard scoptophilique qui habite l'espace en tant que présence de notre désir de voir, et dont il est la raison comme nous le soutiendrons, ce regard, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que sujet, s'hypostasie et s'émancipe dans l'héautoscopie sous la forme du double, mais aussi bien des pensées. Et, si "nous pensons dans l'espace", pour parler comme Bergson (72), nous devons saisir le rapport organique de la pensée et de l'espace. Aussi ne saurions-nous ignorer un constat majeur, dont l'indice nous est donné par les hallucinations gullivériennes, que, dans le cadre de l'héautoscopie, avec l'émancipation de la pensée ou de l'image, c'est bien l'espace en tant que tel qui s'émancipe. En cela l'héautoscopie intéresse la question de l'espace, et peut nous permettre d'avancer dans les progrès de sa compréhension.
Notes :
(1) Jacques Lis, L'homme à l'envers / Le rapport du sujet à l'espace et la question du dedans dehors, Éditions L'Harmattan, Paris, 2016.
(2) "Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de ma propre pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bon sur la scène" (Arthur Rimbaud, La lettre du voyant).
(3) J. Lacan, Le séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, éditions du Seuil, 1978, pp. 192-199.
(4) J. Lacan, Le séminaire, La logique du fantasme, inédit, séance du 15/02/67.
(5) Jean Lhermitte, L'image de notre corps (1939), Éditions de la nouvelle revue critique, Paris, 1939.
(6) Le Président Schreber, auquel Freud s'intéressa, parlait de manière semblable de "l'illumination du système nerveux interne" par les rayons divins (Daniel Paul Schreber, Mémoires d'un névropathe, éditions du Seuil, col. Points, pp. 135, 174, 248).
(7) Le président Schreber expliquait la pensée comme un phénomène vibratoire la mettant en relation homothétique, comme au diapason, avec les bruits extérieurs, sur lesquels venaient "se moduler et en quelque sorte s'inscrire" ses "esthésies sensorielles" (Mémoires d'un névropathe, op. cit., pp. 135, 174, 248).
(8) Dans le cas fameux de "l'homme aux paroles imposées" interrogé à Sainte-Anne par Lacan, quand le sujet pensait cela répondait ailleurs, dans un autre registre, dans le Réel, qui pouvait être quelqu'un passant à sa portée, qui résonnait alors réellement d'une pensée ; conduisant Marcel Czermak à subvertir la nomenclature de Sérieux et Capgras des folies raisonnantes pour parler à sa façon de "folie résonnante" (Marcel Czermak, Passions de l'objet, op. cit., p. 17.
(9) Ces expériences de sortie hors du corps (out of body experiences, OBE), ont été étudiées, entre autres, par des neurologues, comme Blanke et al., par exemple (Out of body experience and autoscopy of neurological origin, Brain, 2004, 127, pp. 243-258.). Nous les avons-nous même rencontrés chez des patients vraisemblablement sujets à des comitialités.
(10) Georges Petit, Essais sur une variété de pseudo-hallucinations, Les autoreprésentations aperceptives, Thèse, Cadoret, Bordeaux, 1913.
(11) Laing citait le cas de Julie qui, comme nous le verrons a quelque rapport avec celui de M. N. : "Elle pensait des choses (a,b,c). J'exprimais des pensées identiques (a1, b1, c1), donc j'avais volé ses pensées. L'expression psychotique de cet état de fait consistait pour elle à m'accuser d'avoir son cerveau dans ma tête. Réciproquement, lorsqu'elle m'imitait ou copiait mes attitudes, elle s'attendait à une réaction de ma part pour avoir "libéré" un peu de moi qu'elle estimait voir volé" (Le moi divisé, Tavistock Publications (1959), Éditions Stock Plus, Paris, 1970, 1979, p. 283.
(12) H. Ey, P. Bernard, C. Brisset, Manuel de psychiatrie, Éditions Masson & compagnie, Paris, 1962-67, p. 116.
(13) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, Éditions Alcan, Pairs, 1903.
(14) Alexandre Brierre de Boismont, Des hallucinations, ou Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, des rêves, du magnétisme, Éditions Germer Baillière, Paris, 1862.
(15) Charles Féré, Note sur les hallucinations autoscopiques ou spéculaires et sur les hallucinations altruistes, C.R. Société de Biol. 1891, p. 451.
(16) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op.cit., p.171.
(17) Expériences d'autoscopie sous intoxication par le haschich décrites par Paul Schilder.
(18) Bleuler décrivait, en effet, ce caractère de la "dépersonnalisation" de donner au patient le sentiment de la perte des limites de leur corporalité.
(19) Rappelons quand même le souhait de Nodet, dans sa critique du regroupement des phénomènes hallucinatoires par G. Ballet, de revenir à la définition traditionnelle de l'hallucination formulée par Esquirol pour rétrécir le champ de l'hallucination authentique. Il proposait ainsi de distinguer :
1) Les hallucinations vraies, définies comme perceptions sans objet, au sens de Ball, mais avec une nécessaire conviction intime. 2) Les hallucinoses, suivant le terme de Wernicke, qui sont des hallucinations auxquelles le patient n'ajoute pas foi, sans délire explicite, et le plus souvent d'origine neurologique ; semblables aux illusions des amputés, ou aux auras épileptiques, etc. 3) Les pseudo hallucinations, appartenant au monde intérieur de nos pensées, qui présenteraient un défaut d'objectivité spatiale et ne se projetteraient donc pas à l'extérieur (sic), mais qui révéleraient une pseudo-altérité psychique. Elles correspondent aux hallucinations psychiques de Baillarger. (Charles-Henri Nodet, Le groupe des psychoses hallucinatoires chroniques, Essai nosographique, Thèse, G. Doin & cie éditeurs, Paris, 1937, pp. 82-89)
(20) Olaf Blanke, Theodor Landis, Laurent Spinellii, Margatitta Seeck, Out-of-body-experience and autoscopy of neurological origin, Brain, 2004, 127, pp. 243-258.
(21) Charles-Henri Nodet, Le groupe des psychoses hallucinatoires chroniques, op. cit., p. 80.
(22) Gilbert Ballet, À propos de la psychose hallucinatoire, in L'encéphale, 1914 ; 9,7, pp. 79-81.
(23) Viktor Tausk, L' "appareil à influencer" des schizophrènes, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2010.
(24) Ibidem, p. 62.
(25) Ibidem, p. 70.
(26) J.-M. Sutter, Transitivisme, article du Manuel alphabétique de psychiatrie, ss la dir. d'Antoine Porot, P.U.F., Paris, 1952-1975, pp. 602-603.
(27) Stéphane Thibierge, L'image et le double, la fonction spéculaire en pathologie, op. cit., p. 30.
(28) H. Hécaen et j. Ajuriagerra, Méconnaissance et hallucinations corporelles, intégration et désintégration de la somatognosie, Éditions Masson, Paris, 1952, p. 336.
(29) Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Paris, 1945, p. 248.
(30) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op.cit., p.191.
(31) Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, Éditions des P.U.F., Paris, 1926, pp. 254, 278.
(32) Ibidem, p. 193 et 194.
(33) Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 248.
(34) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit., p. 38.
(35) Ibidem, p. 42.
(36) Gilbert Ballet, La psychose hallucinatoire chronique, Encéphale, 6e année, 2e sem., n°11, 10 novembre 1911, pp. 402-402.
(37) Paul Guiraud, Psychiatrie générale, Éditions Le François, Paris, 1950.
(38) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit., p.31.
(39) Ces autoscopies internes dont témoignent certains patients concernent la vision mentale de leurs organes internes, comme des objets pouvant y séjourner.
(40) Jacques Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Éditions Le François, Paris, 1932. Éditions du Seuil, Paris, 1975, p. 129.
(41) C'est à partir des travaux de Pierre Bonnier sur les troubles labyrinthiques que Jean Lhermitte soutenait cette idée qui pourrait paraître étonnante chez l'éminent neurologue qu'il était.
(42) Gaëtan Gatian de Clérambault, uvre psychiatrique, Tome II, Éditions des P.U.F., Bibliothèque de Psychiatrie, Paris, 1942, p. 563 et suiv.
(43) Paul Sollier, Les phénomènes d'autoscopie, op. cit. p. 19.
(44) Sigmund Freud, L'inquiétante étrangeté, in Essais de psychanalyse appliquée, Editions Gallimard, Paris, 1971.
(45) L'image et le double, op. cit., p. 31.
(46) Jacques Lacan, Les complexes familiaux en pathologie, in Encyclopédie Française, Tome VIII, La vie mentale, sous la dir. d'Henri Wallon, mars 1938, chapitre II (8.42-2). Propos soulignés par Stéphane Thibierge.
(47) Jean Lhermitte, L'image de notre corps, op. cit., p. 191.
(48) Ibidem, p. 221.
(49) Ibidem, p. 223.
(50) Ibidem, p. 238
(51) Paul Schilder, L'image de notre corps, (1935), Éditions Gallimard, Paris, 1968, traduction François Gantheret.
(52) Jacques Lacan, Le séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, op. cit., pp. 192-200.
(53) À propos de l'automatisme mental, M. N. disait pas parfois : "c'est comme si je me faisais des reproches par l'intermédiaire d'autres personnes". Nous présentons là l'identité d'un phénomène primordial.
(54) Éric Blumel, L'hallucination du double, in Analitica n°22, Le miroir, le double, Cahiers de recherche du champ freudien, Éditions Lyse, Paris, 1980, p. 44.
(55) Par exemple : "Le vieillard prodigue vit payer ses dettes par son frère". Damourette et Pichon, Des mots à la pensée, Essais de grammaire de langue française, Paris, d'Artrey, 1911-1940, T. 5.
(56) Marcel Czermak a publié l'étude du cas, à "caractère héautoscopique", d'une de ses patientes en butte à la présence de son double près d'elle, non pas visualisée comme image de son corps, mais comme présence pure, "sans apparence physique", pour laquelle il soulignait précisément la relation du dédoublement de la parole d'avec le sentiment d'être dédoublé (Sur quelques phénomènes élémentaires de la psychose. À propos d'un cas, in Nodal N°1, Certaines conséquences de l'enseignement de Lacan, Editions Joseph Clims, 1984).
(57) Nous reprendrons ultérieurement le fameux stade du miroir avec lequel Lacan montrait le rôle de l'image de l'autre dans la constitution du moi, insistant sur cette "extériorité" d'une Gestalt rendant compte précisément des apparitions hallucinatoires de l'imago du corps propre du sujet dans l'héautoscopie.
(58) Nous pensons notamment à l'étude très claire qu'en fit Erik Porge : Abord de l'hallucination, in Littoral 3-4, L'assertitude paranoïaque, Éditions Érès, Paris, février 1982.
(59) Éric Blumel, L'hallucination du double, op. cit., p.52.
(60) Nous n'irions pas toutefois jusqu'à dire comme cet auteur que l'héautoscopie n'est pas une hallucination, car le fait que l'hallucination psychotique ait une origine verbale (fût-ce à y situer le symbolique forclos réapparaissant dans le réel) ne retire pas à son expression visuelle le caractère proprement hallucinatoire.
(61) Voir L'homme à l'envers, op.cit.
(62) Lacan, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : "Psychanalyse et structure de la personnalité", Écrits, pp. 647-684.
(63) Merleau-Ponty, entre autres, remarquait que le double n'est pas toujours reconnu à certains détails
(64) Dire que le manque est de structure c'est évoquer le fait qu'il est nécessaire à l'amorce de toute chaîne signifiante, tout en lui assignant sa place dans l'ontogenèse du désir. Ce qui fait du sujet un sujet désirant c'est que l'objet (perdu) qui cause son désir est marqué d'un interdit, et de fait refoulé. Ainsi, de façon paradigmatique, on peut dire que c'est l'interdit paternel qui s'oppose à un quelconque conjungo avec la mère, représenté structuralement par le signifiant du Nom-du-Père, celui de la loi et de la castration. C'est donc le signifiant du Nom-du-Père qui barre l'objet du désir, et l'élide du champ de la réalité, qui ne se soutient que de cette extraction, comme le soulignait Lacan. Sauf dans la psychose, en raison de la forclusion de ce signifiant primordial.
(65) Jacques Lacan, Le séminaire, livre X, L'angoisse, Éditions du Seuil, Paris, 2004, séance du 12/12/1962.
(66) Ibidem, séance du 5/12/1962.
(67) Antonio Quinet, Le plus de regard, Destin de la pulsion scopique, Éditions du champ lacanien, Paris, 2003, p. 162.
(68) L'appareil à influencer des schizophrènes, op. cit., p. 96.
(69) Voir L'homme à l'envers.
(70) Jacques Lacan, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, Paris, 1973, séances de février 1964.
(71) Éric Blumel, L'hallucination du double, op. cit.
(72) "Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le plus souvent dans l'espace", telle fut la première phrase de l'uvre de Bergson (Les données immédiates de la conscience, Éditions des P.U.F., Paris 1927, Éditions Quadrige, 2007, p. 1).
"GRAND COMME UNE VILLE" Un discours de la psychose à prendre au sérieux (1)
Nos patients psychotiques viennent "témoigner" auprès de nous des phénomènes souvent exorbitants dont ils sont l'objet. Ce faisant, ils posent, pour le clinicien, la question du statut expérientiel du témoignage, en même temps qu'ils nous interrogent sur l'emprise de nos préjugés, c'est-à-dire de nos refoulements. Ceux qui nous éloignent de l'éthique propre de notre travail d'écoute, et qui s'illustrent dans le climat délétère de suspicion, que nous offre malheureusement trop souvent la psychiatrie, à l'égard de ce que lui confient ses patients.
Je dois avouer avec une certaine honte que le cas de M.N., dont je vais parler me laissa très souvent le sentiment de me trouver face à un "Martien", étant donné une clinique de l'hallucination absolument extraordinaire comme la psychose en crise peut nous présenter parfois. Mais, c'est en prenant au sérieux ce qu'il me disait que je pense avoir réduit l'écart qui nous éloignait, et partagé quelque chose de son humanité. C'est-à-dire en prêtant attention à ce qui dans son témoignage le plus ahurissant, quelles que fussent ses différences, nous faisait partager le même Dasein, le même être-au-monde.
Or, notre patient nous disait cette chose étonnante qu'il lui était impératif de prendre lui-même au sérieux ses hallucinations, faute de quoi il serait littéralement devenu fou !
La pensée objective qui n'entend pas cela, non seulement ignore le procès de subjectivation qui est l'essentiel de notre travail analytique, mais elle passe à côté du Réel des phénomènes psychologiques (en prétendant s'y attacher).
Nous choisissons donc le parti de prendre au sérieux ce que nous disent nos patients. Parce que, dans le procès de notre écoute, doit se réaliser quelque chose du passage du signe au signifiant, ou de l'imaginaire au symbolique ; mais encore, parce que le vécu de la psychose dont ils témoignent nous parle du réel, et de la structure qui est première.
Je ne vais pas m'étendre ici sur la clinique très riche dont M.N. "témoigna" pendant les sept années qu'il vint se confier à moi. Je ne prendrai qu'un exemple, suffisamment cursif, des phénomènes qu'il subissait, de ce que la psychose peut nous offrir de plus remarquable.
Le cas de M. N. exposait une clinique éclatante de ce que la psychiatrie a décrit sous le terme de transitivisme, c'est-à-dire cet état dans lequel est altérée la délimitation entre le corps, ou le moi, et l'espace extérieur, comme entre la pensée du sujet et celle d'autrui. Parmi ses hallucinations si spectaculaires, lors de ses périodes critiques, il y avait ce que l'on pourrait appeler une "héautoscopie de la pensée", puisque caractérisée par la dispersion au-dehors de lui-même de ses propres pensées de manière visible, dans l'espace ainsi que dans les personnes de son entourage, qui faisait dire à M.N. qu'il était "à l'envers". Comme s'il était "centré à l'extérieur" de lui-même, disait-il. Ce qui n'était pas sans une certaine logique au regard de la topologie de l'inconscient, bien qu'une telle lucidité ne fût pas coutumière.
La psychiatrie a retenu sous le générique d'autoreprésentation aperceptive de Georges Petit, ce vécu hallucinatoire où le patient perçoit ses pensées comme émanant d'autrui, accompagné du sentiment de vol de la pensée, de devinement et de dévoilement dont le caractère d'étrangeté et d'altérité inspirait à Guiraud le terme de xénopathie.
La xénopathie, chez M.N., fonctionnait également dans l'autre sens, à la mesure de ce que les objets extérieurs, comme les pensées des autres, pouvaient résonner en lui, dans sa tête ou dans son corps.
Ces phénomènes, qui signaient un évident problème de limites, étaient couplés chez lui à des hallucinations d'énormité. Il décrivait ainsi ces vécus d'illimitation dans l'étendue, que nous pouvons reconnaître dans les syndromes de Séglas et Cotard, manifestant cette tendance au débordement de l'intuition spatiale, allant de l'extension volumétrique du corps propre à l'incorporation du non-moi par la personnalité délirante. Ce qu'un patient de Dide et Guiraud appelait ses "exilages" géographiques (2).
M.N. décrivait souvent comment il pouvait devenir aérien. C'est-à-dire comment il participait de l'espace où il se répandait. Il avait, disait-il, "la réflexion du monde" en lui.(3)
Il y avait aussi des enchaînements qui l'entraînaient dans des inflations exorbitantes. Par exemple, s'il lui arrivait de penser à un croissant, cela lui évoquait une boulangerie, et il devenait soudain lui-même la boulangerie, et la boulangerie devenait ensuite aussi grande qu'une ville : croissance du croissant.
Souvent en effet, il lui semblait qu'il était lui-même la ville, grand comme la ville, qui résonnait tout entière de ses pensées. Comment peut-on être une ville ? Notre patient en parlait avec réticence eu égard au caractère incommunicable de l'expérience, redoutant l'incrédulité de son interlocuteur. Nous percevions sur son visage le sourire appelant l'indulgence (4).
Une autre de nos patientes en butte à cette relation si prégnante à son Umwelt (qu'elle désignait du reste elle-même comme le lieu de l' "inconscient" qui la persécutait) nous fit un jour cette réflexion admirable: "j'ai des sensations dans la ville !".
Mieux encore, M. N. pouvait se lever le matin en pensant que c'était lui qui faisait se lever le soleil, comme s'il était lui-même le soleil levant. La débilité des limites entre lui et le monde avait cette conséquence, comme elle peut se rencontrer à l'orée du syndrome de Cotard : il était lui-même le monde.(5)
Ce dont nous parle un tel vécu c'est évidemment d'une participation du dedans et du dehors sous l'égide de ce qu'on pourrait appeler une immixtion de l'espace thymique dans l'espace orienté, propre à cette "subduction de l'espace" qui a bien sûr été soulignée dans les manifestations classiques de l'automatisme mental.
Alors, quel statut accorder aux dires de M. N. ? Quelle fiabilité peut-on leur reconnaître ? Doit-on les réduire à une fiction personnelle, une illusion pathologique, ou bien les prendre au sérieux au point d'en tirer un enseignement sur la structure ? La question ouvre le problème du vécu psychotique : de l'hallucination et du délire.
Eh bien, cette exigence, dont nous parlions de prendre au sérieux ce que nous disent nos patients m'a conduit à reconnaître l'actualité de travaux déjà anciens sur les rapports de l'homme à l'espace, parmi lesquels ceux de Merleau-Ponty constituent pour moi le fleuron.(6)
Ainsi trouve-t-on dans la "Phénoménologie de la perception" des pages lumineuses où Merleau-Ponty expose une théorie de l'hallucination propre à conforter notre position, et qui me semble pouvoir rendre compte de l'exemple clinique que je viens de dessiner.(7)
Cette théorie quelle est-elle ?
Elle s'inscrit dans une conception élargie de l'espace, à la suite des travaux qui mirent en question la suprématie de l'espace naturel : comme ceux de Cassirer, Erving Straus, Binswanger, Minkowski ou encore Piaget (8) Et même, le grand neurologue Jean Lhermitte.
D'abord, la "Phénoménologie de la perception" se justifiait d'une critique de la toute-puissance de l'analyse réflexive qui professe la supériorité de la réflexion par rapport à la perception. Celle par exemple qui pense connaître ce que vivent le rêveur ou le schizophrène mieux qu'eux-mêmes. Celle qui n'accorde pas aux espaces anthropologiques le statut de vérité de l'espace objectif.
Merleau-Ponty y faisait appel à une logique simple : soit le sujet d'une expérience sait ce qu'il vit, et alors le rêveur ou le fou, doivent être pris au sérieux, soit ceux-ci ne sont pas juges de ce qu'ils vivent et dès lors nous devons conclure à leur illusion. Mais alors, faudrait-il soutenir que l'on ne rêvât jamais ? disait-il. Et il ajoutait : "Tant qu'on admet le rêve, la folie ou la perception, au moins comme l'absence de la réflexion - et comment ne pas le faire si l'on veut garder une valeur au témoignage de la conscience sans lequel aucune vérité n'est possible - on n'a pas le droit de niveler toutes les expériences en un seul monde, toutes les modalités de l'existence en une seule conscience".
Nous devons donc prendre en compte ce qu'on observe de la perception infantile à la pensée mythique, et jusque dans les manifestations psychiatriques de la folie qui signent la solidarité de l'essence et de l'apparence (9). Mais, avec la dialectique nécessaire.
Et, ce que nous constatons, c'est qu'à l'inverse de ce que la psychiatrie a souvent soutenu contre toute évidence, nos patients différencient bien le plus souvent leurs hallucinations de leurs perceptions, et savent distinguer la facticité de leur monde de ce que l'on nomme la réalité. Et, comme nous en avons fait maintes fois l'expérience, s'ils insistent sur l'authenticité de ce qu'ils subissent, c'est pour que nous prenions au sérieux des phénomènes réels qui les dépassent (10). C'est pourquoi l'hallucination n'est pas un jugement ni une croyance téméraire. Et, les fous, nous disait Merleau-Ponty, savent qu'il s'agit là d'une expérience singulière.
Si les thèses empiriste et intellectualiste échouent à expliquer l'hallucination, c'est qu'elles affirment la priorité de la pensée objective. C'est la raison pour laquelle elles manquent le mode propre de certitude de l'activité hallucinatoire. Parce qu'elles cherchent à la critiquer avant que de la vivre. En réduisant ainsi le vécu, elles ne laissent aucune place, disait-il, à "l'adhésion équivoque du sujet à des phénomènes pré-objectifs". Or, "la connaissance ne peut jamais passer cette limite de la facticité".
Merleau-Ponty prenait l'exemple d'un patient schizophrène de Binswanger qui affirmait sentir à l'intérieur de sa tête une brosse posée à quelques mètres de lui, et sans qu'il cessât de l'y voir. Pourquoi ? La brosse n'était pas devenue une masse matérielle dans sa tête. Mais, disait-il, elle s'était trouvée "agglomérée au regard", par "ce poste de vigie" au sommet de son corps, et "cette puissance de se joindre à tous les objets de la vision et de l'audition", sans que la distance n'y pût rien changer.
Pour l'homme sain, les objets gardent leur distance, et si celui-ci échappe à l'hallucination c'est grâce à un rapport particulier avec l'espace. "Ce qui fait l'hallucination comme le mythe, disait Merleau-Ponty, c'est le rétrécissement de l'espace vécu, l'enracinement des choses dans notre corps, la vertigineuse proximité de l'objet (11), la solidarité de l'homme et du monde qui est non pas abolie, mais refoulée par la perception de tous les jours ou par la pensée objective ". C'est-à-dire que la psychose expose en clair ce que nous refoulons ordinairement : la proximité de l'objet (12), dans sa dimension réelle, propre à faire vaciller la subjectivité, qui est un aspect abrupt de l'inhérence essentielle du sujet et du monde. C'est pourquoi si nous voulons comprendre l'espace mythique ou schizophrénique il nous faut réveiller en nous la relation originelle du sujet et de son monde.
Concernant l'être-au-monde, Heidegger pouvait expliquer qu'il nous serait impossible d'appréhender l'espace, d'envisager même de nous y déplacer, sans cette ubiquité subjective dans l'étendue que rend possible la spatialité du Dasein. Si nous nous déplaçons à travers les espaces, c'est que nous nous y tenons déjà dans toute leur extension ; et sans cela, disait-il, imaginer d'ici le vieux pont de Heidelberg serait proprement impossible.(13)
Il y a là un voisinage évident avec la pensée de Merleau-Ponty pour laquelle, parce que le corps est Visibilité, errante ou rassemblée, il ne lui est pas prescrit de sortir de soi pour réaliser l'ubiquité de sa vision. En tant qu'être-au-monde, la constitution de l'homme dépasse en quelque sorte la question de la limite du dedans et du dehors. Car, ajoutait-il, "les choses n'existent qu'au bout de ces rayons de spatialité émis dans le secret de ma chair". "Il faut prendre à la lettre ce que nous enseigne la vision : que par elle nous touchons le soleil, les étoiles, nous sommes en même temps partout, aussi près des lointains que des choses proches".(14)
Cette notion de "chair", formulée in extremis dans "Le visible et l'invisible" comme la "chair du monde", était une incarnation du Dasein inouïe chez Heidegger. En tant qu' "élément de l'être", elle était avancée par Merleau-Ponty comme le "milieu formateur (à la fois) de l'objet et du sujet", permettant d'articuler la dichotomie soutenue classiquement du sujet et du monde. Il la concevait comme le point originel, primordial de la "visibilité" qui nous constitue.
"Je décris l'espace primordial, disait-il à la suite des travaux de Piaget (15), comme topo-logique (c'est-à-dire taillé dans une voluminosité totale qui m'entoure, où je suis, qui est derrière moi aussi bien que devant moi)".(16)
À ce sujet, Merleau-Ponty citait le cas de l'hallucination extracampine (17), dans laquelle le patient affirme voir ou sentir, sans le concours de ses organes périphériques, ce qui se passe en dehors de son champ perceptif, derrière son dos par exemple (18). Le phénomène est remarquable parce qu'il montre que l'illusion de voir ne concerne pas seulement un objet illusoire, mais bien le déploiement et comme "l'affolement d'une puissance visuelle", qui ne peut s'expliquer que part la relation essentielle du corps phénoménal avec son milieu. "Il y a des hallucinations parce que nous avons, par le corps phénoménal, une relation constante avec un milieu où il se projette". Et le corps possède, en toute circonstance, le pouvoir d'appeler par ses propres montages, une présence hallucinée de cet espace. Dans ce cadre, on ne peut pas dire que l'halluciné voit au sens classique, mais il utilise ses champs sensoriels pour faire de son monde "un milieu factice conforme à l'intention totale de son être".
Ce que nous montre encore l'hallucination extracampine c'est une quête de l'espace, et par là de l'expérience à l'état naissant, avant toute objectivation. Ce qui faisait dire à Merleau-Ponty que "le phénomène hallucinatoire nous ramène aux fondements prélogiques de notre connaissance" (19). "Avoir des hallucinations, disait-il, c'est mettre à profit cette tolérance du monde antéprédicatif". Celui d'une spatialité plus primitive, plus qualitative que l'espace rationnel, évoquant quelque chose des formes a priori de l'intuition dont nous parlait l'Esthétique transcendantale de Kant.
Ainsi, l'hallucination n'est-elle pas simplement une perception, mais elle vaut comme une réalité (celle de la spatialité "primordiale" du Dasein) qui prend pour le sujet une place plus prégnante que ses perceptions mêmes. Hallucination et perception ne sont enfin que des modalités d'une fonction capitale concernant notre relation au monde, et par laquelle nous pouvons nous sentir être dans le monde.
Comme vous le savez peut-être Lacan n'a cessé de faire l'éloge des idées de Merleau-Ponty sur l'espace. Et il partageait la même conception d'un sujet non pas ontologique mais anthropologique, en relation structurale avec son milieu (20). Plus encore, la topologie qu'ils abordèrent l'un et l'autre les faisait aller du même pas. Il serait malheureusement trop long ici d'en reprendre les thèses. Mais je voudrais cependant rappeler ceci pour conclure :
Jacques Lacan, dans sa "Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud"(21), nous donna son appréciation de la théorie merleau-pontienne de l'hallucination. Bien qu'il y affirmât son admiration pour la belle analyse de son ami, il pouvait y regretter naturellement que les progrès accomplis par celle-ci le fussent sans un questionnement du centrage sur les attributs de la conscience, puisque cette pensée cherchait dans la conscience la garantie de sa certitude. Car c'est bien en tant que phénomène de conscience que l'hallucination est appréhendée par la réduction phénoménologique, mais les limites à l'autonomie de la conscience dessinée par Merleau-Ponty paraissaient à Lacan, je cite, "beaucoup trop subtiles à manier pour barrer la route à la grossière simplification de la noèse hallucinatoire où les psychanalystes tombent couramment : utilisant à contresens les notions freudiennes pour motiver d'une éruption du principe de plaisir la conscience hallucinée". Il soutenait au contraire le rapport le plus contingent du noème de l'hallucination avec une quel-conque satisfaction du sujet ; avançant, avec la phénoménologie, une conversion de la question : celle de se demander si la noèse du phénomène pourrait avoir quelque rapport de nécessité avec son noème. (C'est avec ces progrès-là que Lacan dessinait le renouvellement de son champ.)
Dans son hommage à Merleau-Ponty, il donna aux idées de celui-ci une dimension nouvelle, dans le sens de ce qu'il pouvait supposer de la proximité d'avec la psychanalyse qu'elles eussent atteinte si la mort ne les avait arrêtées en chemin. Ainsi parla-t-il de la "Phénoménologie de la perception" : "La vacillation marquée dans tout ce texte de l'objet à l'être, le pas donné à la visée de l'invisible, montrent assez que c'est ailleurs qu'au champ de la perception qu'ici Maurice Merleau-Ponty s'avance" (22). Ce qu'il y reconnaissait, c'est le terrain du désir, où il voyait cette doublure du visible par l'invisible, avant même la publication de l'uvre posthume du philosophe qui en fut la marque éponyme. Car l'invisible dans le cadre de la psychanalyse est justement ce qui est propre à venir représenter cette absence par laquelle l'objet "cause du désir", en tant qu'objet du manque (c'est-à-dire l'objet a) peut échoir à se signaler dans le champ de notre perception. Ce que disait ainsi Lacan avec Merleau-Ponty c'est que le visible n'existe pas sans une part d'invisible, dans laquelle nous devons repérer le regard (comme objet petit a insaisissable en tant que tel).(23)
Merleau-Ponty avait ouvert ainsi sa "Phénoménologie de la perception" : "Je ne pense pas qu'on puisse comprendre l'homme et le monde autrement qu'à partir de leur facticité" (24).
Or, c'est ici évidemment de la structure dont il s'agit, et nous avons dit comment nos patients pouvaient témoigner de notre propre refoulement du réel.
Voilà pourquoi nous entendons prendre au sérieux ce qu'ils nous disent, à l'exemple de ce témoignage de M. N., qui nous parlait de sa participation à la chair du monde. Conforté comme nous le fûmes par la dénonciation du discours de "dénigrement" de la psychiatrie à l'endroit de ses clients, suivant le mot terrible de Van den Berg, repris par Laing en son temps de révolution (25).
Notes :
(1) Cet exposé reprend certains propos développés dans un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Études Psychanalytiques, sous le titre :" L'HOMME À L'ENVERS, Le rapport du sujet à l'espace et la question du dedans-dehors".
(2) Maurice Dide, "Variations psychopatiques de l'intuition durée-étendue", in Journal de psychologie, mai-juin 1929, pp. 410-424.
(3) Pour Marcel Czermak, Cotard se prenant pour l'objet a peut devenir alors l'univers et se répandre dans le monde. "Passions de l'objet", Éditions Joseph Clims, Paris, 1986, pp. 207, 223.
(4) On rencontre ce type d'expérience dans le syndrome de Cotard, que Marcel Czermak considérait comme ce que la psychose offre de plus pur. À l'exemple de sa patiente qui décrivait le morcellement de son corps, et comment elle s'éparpillait dans l'espace, avec l'impression qu'elle devenait "immense" : une "dispersion instable, oscillante et réversible au cours de laquelle le sujet passe d'une compacité pétrifiée à une expansion à la mesure du cosmos tout entier". In "Signification psychanalytique du syndrome de Cotard", Journées de l'Association Freudienne sur "les psychoses", 19-20 novembre 1983, in Le Discours Psychanalytique, n°10, mars 1984, p. 5 Rééd. In "Passions de l'objet", op. cit., p. 207.
(5) "Ainsi Cotard, se prenant pour l'objet a, l'étant devenu, est alors l'univers, et c'est pourquoi, il s'estime répandu dans le monde et tant qu'il en devient l'un des morceaux, un morceau du Réel, voire ce Réel même, exclu du désir puisqu'il en est la cause, d'où il oscille vers une identification au pur désir". Marcel Czermak, "Passions de l'objet", Ibid., p. 223.
(6) Une philosophie qui replace l'essence dans l'existence.
(7) Maurice Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", Paris, Gallimard, collection "Bibliothèque des idées", 1945, p. 342.
(8) L'espace mythique de Cassirer, l'espace présentiel de Straus, l'espace thymique de Binswanger, l'espace vécu ou l'espace noir de Minkowsi, l'espace topologique de Piaget.
(9) Se pose ici le problème du statut de l'hallucination. Si elle se distingue bien de l'illusion, où nous suivons naturellement Lasègue, nous ne pouvons certes pas nous satisfaire de la définition de Ball d'une perception sans objet. Et nous apprécierons l'approche critique de la phénoménologie face au sensualisme comme à l'intellectualisme.
(10) Melle B. bien que vierge se dit être enceinte. Dans un premier temps, elle nous confie que ce qu'elle a à dire est "imaginaire", mais qu'elle y est très sensible, semblant douter des termes à employer comme des faits eux-mêmes : "Être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas possible n'est-ce pas ?". Elle parle de ses "impressions", de son "ressenti", de son "vécu", les qualifiant d' "inconscient", paraissant minimiser l'hallucination, mais comme pour nous en faire accepter le fait. Et dans un second temps, s'il nous prend de souligner le caractère étonnant de ses propos, elle affirme énergiquement qu'elle pense qu'il s'agit de la réalité, comme si elle craignait d'être démentie.
(11) L'approche lacanienne nous a appris que l'hallucination a à voir avec le réel de l'objet a, sans la médiation du fantasme. Nous voyons dans cette "proximité de l'objet" la dimension crue du réel expérimentée par la psy-chose en crise, où la clinique de l'objet petit a montre un objet du désir qui n'a plus valeur de manque.
(12) Ce que Heidegger aurait appelé, suivant un étonnant néologisme, l'é-loignement propre à la spatialité du Dasein. "L'Être et le Temps", 1927, Éditions Gallimard, 1964, pp. 129-143.
(13) Martin Heidegger, "Bâtir habiter penser", in "Essais et conférences", Éditions Gallimard, 1958, pp. 187-188.
(14) "L'il et l'esprit", Éditions Gallimard, Paris, 1960, p. 83.
(15) Jean Piaget et Bärbel Inhelder, "La représentation de l'espace chez l'enfant", Presses Universitaires de France, Paris, collection Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1947. Ce que révéla cette étude a bousculé radicalement les idées reçues sur la genèse de l'espace chez l'enfant, puisqu'elle démentit la conception classique selon laquelle les notions spatiales de départ reposeraient sur des intuitions directement euclidiennes. Elles démontrèrent ainsi, à l'instar de l'analyse abstraite des géométries, que les notions fondamentales de l'espace ne sont pas euclidiennes mais topologiques.
(16) Merleau-Ponty, Notes de travail du 27/10/59, in "Le visible et l'invisible", Éditions Gallimard, 1964, p. 263.
(17) Décrite par Jaspers. Également, Bleuler. Voir : Conolly Norman, "Extracampine Hallucination", in journal of Mental Science, 50, The Royal College of Psychiatrist, 1904, p. 557.
(18) On pourrait rapprocher ce type d'hallucination des "Phénomènes d'autoscopie" décrits par Paul Sollier (Éditions Alcan, Paris, 1903).
(19) Maurice Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", op. cit., p. 391-402.
(20) Voir Bertrand Ogilvie, Lacan, "Le sujet", PUF, 1987, p. 51. Rappelons, par ailleurs, que Merleau-Ponty faisait appel à une "ontologie directe", et dénonçait un Dasein idéalement ek-statique.
(21) Jacques Lacan, "Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud", in Ecrits, Éditions du Seuil, Paris, 1966, pp. 381-399.
(22) Jacques Lacan, "Maurice Merleau-Ponty", in Les Temps Modernes, numéro spécial sur Maurice Merleau-Ponty, 1961.
(23) B. Baas, Notre étoffe (Lacan et Merleau-Ponty), op. cit., p. 54.
(24) M. Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", op. cit.,p. 7.
(25) Ronald D. Laing, "Le moi divisé", Tavistock Publications, 1959, Éditions Stock, 1970, p. 31.
Lire plus
Je dois avouer avec une certaine honte que le cas de M.N., dont je vais parler me laissa très souvent le sentiment de me trouver face à un "Martien", étant donné une clinique de l'hallucination absolument extraordinaire comme la psychose en crise peut nous présenter parfois. Mais, c'est en prenant au sérieux ce qu'il me disait que je pense avoir réduit l'écart qui nous éloignait, et partagé quelque chose de son humanité. C'est-à-dire en prêtant attention à ce qui dans son témoignage le plus ahurissant, quelles que fussent ses différences, nous faisait partager le même Dasein, le même être-au-monde.
Or, notre patient nous disait cette chose étonnante qu'il lui était impératif de prendre lui-même au sérieux ses hallucinations, faute de quoi il serait littéralement devenu fou !
La pensée objective qui n'entend pas cela, non seulement ignore le procès de subjectivation qui est l'essentiel de notre travail analytique, mais elle passe à côté du Réel des phénomènes psychologiques (en prétendant s'y attacher).
Nous choisissons donc le parti de prendre au sérieux ce que nous disent nos patients. Parce que, dans le procès de notre écoute, doit se réaliser quelque chose du passage du signe au signifiant, ou de l'imaginaire au symbolique ; mais encore, parce que le vécu de la psychose dont ils témoignent nous parle du réel, et de la structure qui est première.
Je ne vais pas m'étendre ici sur la clinique très riche dont M.N. "témoigna" pendant les sept années qu'il vint se confier à moi. Je ne prendrai qu'un exemple, suffisamment cursif, des phénomènes qu'il subissait, de ce que la psychose peut nous offrir de plus remarquable.
Le cas de M. N. exposait une clinique éclatante de ce que la psychiatrie a décrit sous le terme de transitivisme, c'est-à-dire cet état dans lequel est altérée la délimitation entre le corps, ou le moi, et l'espace extérieur, comme entre la pensée du sujet et celle d'autrui. Parmi ses hallucinations si spectaculaires, lors de ses périodes critiques, il y avait ce que l'on pourrait appeler une "héautoscopie de la pensée", puisque caractérisée par la dispersion au-dehors de lui-même de ses propres pensées de manière visible, dans l'espace ainsi que dans les personnes de son entourage, qui faisait dire à M.N. qu'il était "à l'envers". Comme s'il était "centré à l'extérieur" de lui-même, disait-il. Ce qui n'était pas sans une certaine logique au regard de la topologie de l'inconscient, bien qu'une telle lucidité ne fût pas coutumière.
La psychiatrie a retenu sous le générique d'autoreprésentation aperceptive de Georges Petit, ce vécu hallucinatoire où le patient perçoit ses pensées comme émanant d'autrui, accompagné du sentiment de vol de la pensée, de devinement et de dévoilement dont le caractère d'étrangeté et d'altérité inspirait à Guiraud le terme de xénopathie.
La xénopathie, chez M.N., fonctionnait également dans l'autre sens, à la mesure de ce que les objets extérieurs, comme les pensées des autres, pouvaient résonner en lui, dans sa tête ou dans son corps.
Ces phénomènes, qui signaient un évident problème de limites, étaient couplés chez lui à des hallucinations d'énormité. Il décrivait ainsi ces vécus d'illimitation dans l'étendue, que nous pouvons reconnaître dans les syndromes de Séglas et Cotard, manifestant cette tendance au débordement de l'intuition spatiale, allant de l'extension volumétrique du corps propre à l'incorporation du non-moi par la personnalité délirante. Ce qu'un patient de Dide et Guiraud appelait ses "exilages" géographiques (2).
M.N. décrivait souvent comment il pouvait devenir aérien. C'est-à-dire comment il participait de l'espace où il se répandait. Il avait, disait-il, "la réflexion du monde" en lui.(3)
Il y avait aussi des enchaînements qui l'entraînaient dans des inflations exorbitantes. Par exemple, s'il lui arrivait de penser à un croissant, cela lui évoquait une boulangerie, et il devenait soudain lui-même la boulangerie, et la boulangerie devenait ensuite aussi grande qu'une ville : croissance du croissant.
Souvent en effet, il lui semblait qu'il était lui-même la ville, grand comme la ville, qui résonnait tout entière de ses pensées. Comment peut-on être une ville ? Notre patient en parlait avec réticence eu égard au caractère incommunicable de l'expérience, redoutant l'incrédulité de son interlocuteur. Nous percevions sur son visage le sourire appelant l'indulgence (4).
Une autre de nos patientes en butte à cette relation si prégnante à son Umwelt (qu'elle désignait du reste elle-même comme le lieu de l' "inconscient" qui la persécutait) nous fit un jour cette réflexion admirable: "j'ai des sensations dans la ville !".
Mieux encore, M. N. pouvait se lever le matin en pensant que c'était lui qui faisait se lever le soleil, comme s'il était lui-même le soleil levant. La débilité des limites entre lui et le monde avait cette conséquence, comme elle peut se rencontrer à l'orée du syndrome de Cotard : il était lui-même le monde.(5)
Ce dont nous parle un tel vécu c'est évidemment d'une participation du dedans et du dehors sous l'égide de ce qu'on pourrait appeler une immixtion de l'espace thymique dans l'espace orienté, propre à cette "subduction de l'espace" qui a bien sûr été soulignée dans les manifestations classiques de l'automatisme mental.
Alors, quel statut accorder aux dires de M. N. ? Quelle fiabilité peut-on leur reconnaître ? Doit-on les réduire à une fiction personnelle, une illusion pathologique, ou bien les prendre au sérieux au point d'en tirer un enseignement sur la structure ? La question ouvre le problème du vécu psychotique : de l'hallucination et du délire.
Eh bien, cette exigence, dont nous parlions de prendre au sérieux ce que nous disent nos patients m'a conduit à reconnaître l'actualité de travaux déjà anciens sur les rapports de l'homme à l'espace, parmi lesquels ceux de Merleau-Ponty constituent pour moi le fleuron.(6)
Ainsi trouve-t-on dans la "Phénoménologie de la perception" des pages lumineuses où Merleau-Ponty expose une théorie de l'hallucination propre à conforter notre position, et qui me semble pouvoir rendre compte de l'exemple clinique que je viens de dessiner.(7)
Cette théorie quelle est-elle ?
Elle s'inscrit dans une conception élargie de l'espace, à la suite des travaux qui mirent en question la suprématie de l'espace naturel : comme ceux de Cassirer, Erving Straus, Binswanger, Minkowski ou encore Piaget (8) Et même, le grand neurologue Jean Lhermitte.
D'abord, la "Phénoménologie de la perception" se justifiait d'une critique de la toute-puissance de l'analyse réflexive qui professe la supériorité de la réflexion par rapport à la perception. Celle par exemple qui pense connaître ce que vivent le rêveur ou le schizophrène mieux qu'eux-mêmes. Celle qui n'accorde pas aux espaces anthropologiques le statut de vérité de l'espace objectif.
Merleau-Ponty y faisait appel à une logique simple : soit le sujet d'une expérience sait ce qu'il vit, et alors le rêveur ou le fou, doivent être pris au sérieux, soit ceux-ci ne sont pas juges de ce qu'ils vivent et dès lors nous devons conclure à leur illusion. Mais alors, faudrait-il soutenir que l'on ne rêvât jamais ? disait-il. Et il ajoutait : "Tant qu'on admet le rêve, la folie ou la perception, au moins comme l'absence de la réflexion - et comment ne pas le faire si l'on veut garder une valeur au témoignage de la conscience sans lequel aucune vérité n'est possible - on n'a pas le droit de niveler toutes les expériences en un seul monde, toutes les modalités de l'existence en une seule conscience".
Nous devons donc prendre en compte ce qu'on observe de la perception infantile à la pensée mythique, et jusque dans les manifestations psychiatriques de la folie qui signent la solidarité de l'essence et de l'apparence (9). Mais, avec la dialectique nécessaire.
Et, ce que nous constatons, c'est qu'à l'inverse de ce que la psychiatrie a souvent soutenu contre toute évidence, nos patients différencient bien le plus souvent leurs hallucinations de leurs perceptions, et savent distinguer la facticité de leur monde de ce que l'on nomme la réalité. Et, comme nous en avons fait maintes fois l'expérience, s'ils insistent sur l'authenticité de ce qu'ils subissent, c'est pour que nous prenions au sérieux des phénomènes réels qui les dépassent (10). C'est pourquoi l'hallucination n'est pas un jugement ni une croyance téméraire. Et, les fous, nous disait Merleau-Ponty, savent qu'il s'agit là d'une expérience singulière.
Si les thèses empiriste et intellectualiste échouent à expliquer l'hallucination, c'est qu'elles affirment la priorité de la pensée objective. C'est la raison pour laquelle elles manquent le mode propre de certitude de l'activité hallucinatoire. Parce qu'elles cherchent à la critiquer avant que de la vivre. En réduisant ainsi le vécu, elles ne laissent aucune place, disait-il, à "l'adhésion équivoque du sujet à des phénomènes pré-objectifs". Or, "la connaissance ne peut jamais passer cette limite de la facticité".
Merleau-Ponty prenait l'exemple d'un patient schizophrène de Binswanger qui affirmait sentir à l'intérieur de sa tête une brosse posée à quelques mètres de lui, et sans qu'il cessât de l'y voir. Pourquoi ? La brosse n'était pas devenue une masse matérielle dans sa tête. Mais, disait-il, elle s'était trouvée "agglomérée au regard", par "ce poste de vigie" au sommet de son corps, et "cette puissance de se joindre à tous les objets de la vision et de l'audition", sans que la distance n'y pût rien changer.
Pour l'homme sain, les objets gardent leur distance, et si celui-ci échappe à l'hallucination c'est grâce à un rapport particulier avec l'espace. "Ce qui fait l'hallucination comme le mythe, disait Merleau-Ponty, c'est le rétrécissement de l'espace vécu, l'enracinement des choses dans notre corps, la vertigineuse proximité de l'objet (11), la solidarité de l'homme et du monde qui est non pas abolie, mais refoulée par la perception de tous les jours ou par la pensée objective ". C'est-à-dire que la psychose expose en clair ce que nous refoulons ordinairement : la proximité de l'objet (12), dans sa dimension réelle, propre à faire vaciller la subjectivité, qui est un aspect abrupt de l'inhérence essentielle du sujet et du monde. C'est pourquoi si nous voulons comprendre l'espace mythique ou schizophrénique il nous faut réveiller en nous la relation originelle du sujet et de son monde.
Concernant l'être-au-monde, Heidegger pouvait expliquer qu'il nous serait impossible d'appréhender l'espace, d'envisager même de nous y déplacer, sans cette ubiquité subjective dans l'étendue que rend possible la spatialité du Dasein. Si nous nous déplaçons à travers les espaces, c'est que nous nous y tenons déjà dans toute leur extension ; et sans cela, disait-il, imaginer d'ici le vieux pont de Heidelberg serait proprement impossible.(13)
Il y a là un voisinage évident avec la pensée de Merleau-Ponty pour laquelle, parce que le corps est Visibilité, errante ou rassemblée, il ne lui est pas prescrit de sortir de soi pour réaliser l'ubiquité de sa vision. En tant qu'être-au-monde, la constitution de l'homme dépasse en quelque sorte la question de la limite du dedans et du dehors. Car, ajoutait-il, "les choses n'existent qu'au bout de ces rayons de spatialité émis dans le secret de ma chair". "Il faut prendre à la lettre ce que nous enseigne la vision : que par elle nous touchons le soleil, les étoiles, nous sommes en même temps partout, aussi près des lointains que des choses proches".(14)
Cette notion de "chair", formulée in extremis dans "Le visible et l'invisible" comme la "chair du monde", était une incarnation du Dasein inouïe chez Heidegger. En tant qu' "élément de l'être", elle était avancée par Merleau-Ponty comme le "milieu formateur (à la fois) de l'objet et du sujet", permettant d'articuler la dichotomie soutenue classiquement du sujet et du monde. Il la concevait comme le point originel, primordial de la "visibilité" qui nous constitue.
"Je décris l'espace primordial, disait-il à la suite des travaux de Piaget (15), comme topo-logique (c'est-à-dire taillé dans une voluminosité totale qui m'entoure, où je suis, qui est derrière moi aussi bien que devant moi)".(16)
À ce sujet, Merleau-Ponty citait le cas de l'hallucination extracampine (17), dans laquelle le patient affirme voir ou sentir, sans le concours de ses organes périphériques, ce qui se passe en dehors de son champ perceptif, derrière son dos par exemple (18). Le phénomène est remarquable parce qu'il montre que l'illusion de voir ne concerne pas seulement un objet illusoire, mais bien le déploiement et comme "l'affolement d'une puissance visuelle", qui ne peut s'expliquer que part la relation essentielle du corps phénoménal avec son milieu. "Il y a des hallucinations parce que nous avons, par le corps phénoménal, une relation constante avec un milieu où il se projette". Et le corps possède, en toute circonstance, le pouvoir d'appeler par ses propres montages, une présence hallucinée de cet espace. Dans ce cadre, on ne peut pas dire que l'halluciné voit au sens classique, mais il utilise ses champs sensoriels pour faire de son monde "un milieu factice conforme à l'intention totale de son être".
Ce que nous montre encore l'hallucination extracampine c'est une quête de l'espace, et par là de l'expérience à l'état naissant, avant toute objectivation. Ce qui faisait dire à Merleau-Ponty que "le phénomène hallucinatoire nous ramène aux fondements prélogiques de notre connaissance" (19). "Avoir des hallucinations, disait-il, c'est mettre à profit cette tolérance du monde antéprédicatif". Celui d'une spatialité plus primitive, plus qualitative que l'espace rationnel, évoquant quelque chose des formes a priori de l'intuition dont nous parlait l'Esthétique transcendantale de Kant.
Ainsi, l'hallucination n'est-elle pas simplement une perception, mais elle vaut comme une réalité (celle de la spatialité "primordiale" du Dasein) qui prend pour le sujet une place plus prégnante que ses perceptions mêmes. Hallucination et perception ne sont enfin que des modalités d'une fonction capitale concernant notre relation au monde, et par laquelle nous pouvons nous sentir être dans le monde.
Comme vous le savez peut-être Lacan n'a cessé de faire l'éloge des idées de Merleau-Ponty sur l'espace. Et il partageait la même conception d'un sujet non pas ontologique mais anthropologique, en relation structurale avec son milieu (20). Plus encore, la topologie qu'ils abordèrent l'un et l'autre les faisait aller du même pas. Il serait malheureusement trop long ici d'en reprendre les thèses. Mais je voudrais cependant rappeler ceci pour conclure :
Jacques Lacan, dans sa "Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud"(21), nous donna son appréciation de la théorie merleau-pontienne de l'hallucination. Bien qu'il y affirmât son admiration pour la belle analyse de son ami, il pouvait y regretter naturellement que les progrès accomplis par celle-ci le fussent sans un questionnement du centrage sur les attributs de la conscience, puisque cette pensée cherchait dans la conscience la garantie de sa certitude. Car c'est bien en tant que phénomène de conscience que l'hallucination est appréhendée par la réduction phénoménologique, mais les limites à l'autonomie de la conscience dessinée par Merleau-Ponty paraissaient à Lacan, je cite, "beaucoup trop subtiles à manier pour barrer la route à la grossière simplification de la noèse hallucinatoire où les psychanalystes tombent couramment : utilisant à contresens les notions freudiennes pour motiver d'une éruption du principe de plaisir la conscience hallucinée". Il soutenait au contraire le rapport le plus contingent du noème de l'hallucination avec une quel-conque satisfaction du sujet ; avançant, avec la phénoménologie, une conversion de la question : celle de se demander si la noèse du phénomène pourrait avoir quelque rapport de nécessité avec son noème. (C'est avec ces progrès-là que Lacan dessinait le renouvellement de son champ.)
Dans son hommage à Merleau-Ponty, il donna aux idées de celui-ci une dimension nouvelle, dans le sens de ce qu'il pouvait supposer de la proximité d'avec la psychanalyse qu'elles eussent atteinte si la mort ne les avait arrêtées en chemin. Ainsi parla-t-il de la "Phénoménologie de la perception" : "La vacillation marquée dans tout ce texte de l'objet à l'être, le pas donné à la visée de l'invisible, montrent assez que c'est ailleurs qu'au champ de la perception qu'ici Maurice Merleau-Ponty s'avance" (22). Ce qu'il y reconnaissait, c'est le terrain du désir, où il voyait cette doublure du visible par l'invisible, avant même la publication de l'uvre posthume du philosophe qui en fut la marque éponyme. Car l'invisible dans le cadre de la psychanalyse est justement ce qui est propre à venir représenter cette absence par laquelle l'objet "cause du désir", en tant qu'objet du manque (c'est-à-dire l'objet a) peut échoir à se signaler dans le champ de notre perception. Ce que disait ainsi Lacan avec Merleau-Ponty c'est que le visible n'existe pas sans une part d'invisible, dans laquelle nous devons repérer le regard (comme objet petit a insaisissable en tant que tel).(23)
Merleau-Ponty avait ouvert ainsi sa "Phénoménologie de la perception" : "Je ne pense pas qu'on puisse comprendre l'homme et le monde autrement qu'à partir de leur facticité" (24).
Or, c'est ici évidemment de la structure dont il s'agit, et nous avons dit comment nos patients pouvaient témoigner de notre propre refoulement du réel.
Voilà pourquoi nous entendons prendre au sérieux ce qu'ils nous disent, à l'exemple de ce témoignage de M. N., qui nous parlait de sa participation à la chair du monde. Conforté comme nous le fûmes par la dénonciation du discours de "dénigrement" de la psychiatrie à l'endroit de ses clients, suivant le mot terrible de Van den Berg, repris par Laing en son temps de révolution (25).
Notes :
(1) Cet exposé reprend certains propos développés dans un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Études Psychanalytiques, sous le titre :" L'HOMME À L'ENVERS, Le rapport du sujet à l'espace et la question du dedans-dehors".
(2) Maurice Dide, "Variations psychopatiques de l'intuition durée-étendue", in Journal de psychologie, mai-juin 1929, pp. 410-424.
(3) Pour Marcel Czermak, Cotard se prenant pour l'objet a peut devenir alors l'univers et se répandre dans le monde. "Passions de l'objet", Éditions Joseph Clims, Paris, 1986, pp. 207, 223.
(4) On rencontre ce type d'expérience dans le syndrome de Cotard, que Marcel Czermak considérait comme ce que la psychose offre de plus pur. À l'exemple de sa patiente qui décrivait le morcellement de son corps, et comment elle s'éparpillait dans l'espace, avec l'impression qu'elle devenait "immense" : une "dispersion instable, oscillante et réversible au cours de laquelle le sujet passe d'une compacité pétrifiée à une expansion à la mesure du cosmos tout entier". In "Signification psychanalytique du syndrome de Cotard", Journées de l'Association Freudienne sur "les psychoses", 19-20 novembre 1983, in Le Discours Psychanalytique, n°10, mars 1984, p. 5 Rééd. In "Passions de l'objet", op. cit., p. 207.
(5) "Ainsi Cotard, se prenant pour l'objet a, l'étant devenu, est alors l'univers, et c'est pourquoi, il s'estime répandu dans le monde et tant qu'il en devient l'un des morceaux, un morceau du Réel, voire ce Réel même, exclu du désir puisqu'il en est la cause, d'où il oscille vers une identification au pur désir". Marcel Czermak, "Passions de l'objet", Ibid., p. 223.
(6) Une philosophie qui replace l'essence dans l'existence.
(7) Maurice Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", Paris, Gallimard, collection "Bibliothèque des idées", 1945, p. 342.
(8) L'espace mythique de Cassirer, l'espace présentiel de Straus, l'espace thymique de Binswanger, l'espace vécu ou l'espace noir de Minkowsi, l'espace topologique de Piaget.
(9) Se pose ici le problème du statut de l'hallucination. Si elle se distingue bien de l'illusion, où nous suivons naturellement Lasègue, nous ne pouvons certes pas nous satisfaire de la définition de Ball d'une perception sans objet. Et nous apprécierons l'approche critique de la phénoménologie face au sensualisme comme à l'intellectualisme.
(10) Melle B. bien que vierge se dit être enceinte. Dans un premier temps, elle nous confie que ce qu'elle a à dire est "imaginaire", mais qu'elle y est très sensible, semblant douter des termes à employer comme des faits eux-mêmes : "Être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas possible n'est-ce pas ?". Elle parle de ses "impressions", de son "ressenti", de son "vécu", les qualifiant d' "inconscient", paraissant minimiser l'hallucination, mais comme pour nous en faire accepter le fait. Et dans un second temps, s'il nous prend de souligner le caractère étonnant de ses propos, elle affirme énergiquement qu'elle pense qu'il s'agit de la réalité, comme si elle craignait d'être démentie.
(11) L'approche lacanienne nous a appris que l'hallucination a à voir avec le réel de l'objet a, sans la médiation du fantasme. Nous voyons dans cette "proximité de l'objet" la dimension crue du réel expérimentée par la psy-chose en crise, où la clinique de l'objet petit a montre un objet du désir qui n'a plus valeur de manque.
(12) Ce que Heidegger aurait appelé, suivant un étonnant néologisme, l'é-loignement propre à la spatialité du Dasein. "L'Être et le Temps", 1927, Éditions Gallimard, 1964, pp. 129-143.
(13) Martin Heidegger, "Bâtir habiter penser", in "Essais et conférences", Éditions Gallimard, 1958, pp. 187-188.
(14) "L'il et l'esprit", Éditions Gallimard, Paris, 1960, p. 83.
(15) Jean Piaget et Bärbel Inhelder, "La représentation de l'espace chez l'enfant", Presses Universitaires de France, Paris, collection Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1947. Ce que révéla cette étude a bousculé radicalement les idées reçues sur la genèse de l'espace chez l'enfant, puisqu'elle démentit la conception classique selon laquelle les notions spatiales de départ reposeraient sur des intuitions directement euclidiennes. Elles démontrèrent ainsi, à l'instar de l'analyse abstraite des géométries, que les notions fondamentales de l'espace ne sont pas euclidiennes mais topologiques.
(16) Merleau-Ponty, Notes de travail du 27/10/59, in "Le visible et l'invisible", Éditions Gallimard, 1964, p. 263.
(17) Décrite par Jaspers. Également, Bleuler. Voir : Conolly Norman, "Extracampine Hallucination", in journal of Mental Science, 50, The Royal College of Psychiatrist, 1904, p. 557.
(18) On pourrait rapprocher ce type d'hallucination des "Phénomènes d'autoscopie" décrits par Paul Sollier (Éditions Alcan, Paris, 1903).
(19) Maurice Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", op. cit., p. 391-402.
(20) Voir Bertrand Ogilvie, Lacan, "Le sujet", PUF, 1987, p. 51. Rappelons, par ailleurs, que Merleau-Ponty faisait appel à une "ontologie directe", et dénonçait un Dasein idéalement ek-statique.
(21) Jacques Lacan, "Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud", in Ecrits, Éditions du Seuil, Paris, 1966, pp. 381-399.
(22) Jacques Lacan, "Maurice Merleau-Ponty", in Les Temps Modernes, numéro spécial sur Maurice Merleau-Ponty, 1961.
(23) B. Baas, Notre étoffe (Lacan et Merleau-Ponty), op. cit., p. 54.
(24) M. Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la perception", op. cit.,p. 7.
(25) Ronald D. Laing, "Le moi divisé", Tavistock Publications, 1959, Éditions Stock, 1970, p. 31.