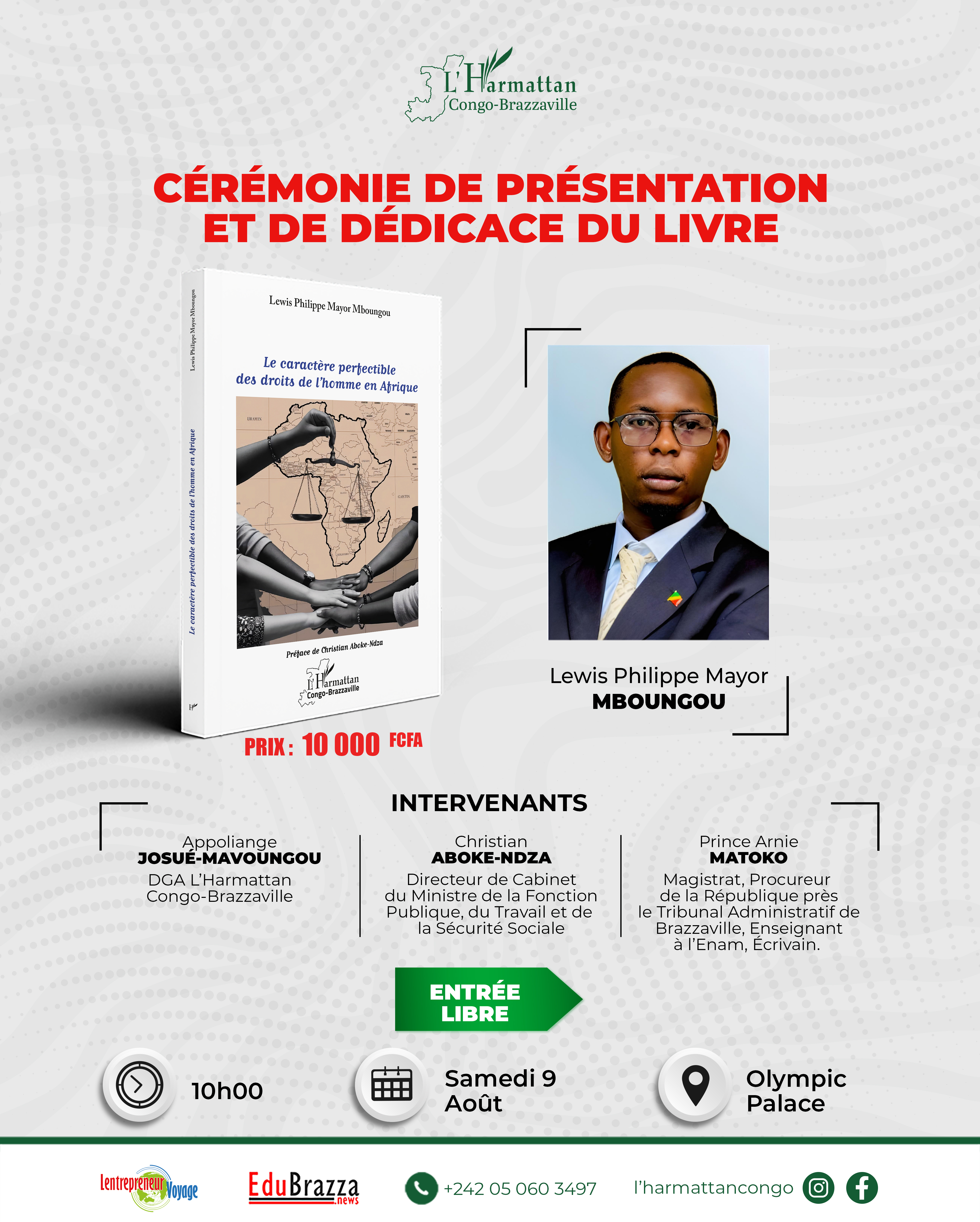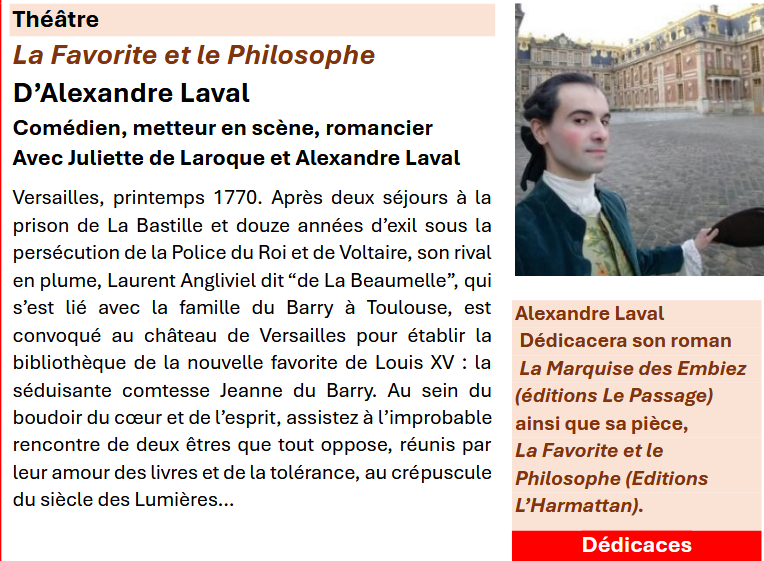jean claude Lorblanches
Contacterjean claude Lorblanches
Descriptif auteur
D'une singularité et d'une intelligence exceptionnelles, Napoléon était aussi d'une complexité et d'une originalité déconcertantes. Ces éminentes qualités ont largement contribué à son extraordinaire parcours d'homme d'État. Elles ne suffisent pas à expliquer les victoires de l'incomparable chef de guerre qu'il a été.
En le suivant avec un dévouement et une fidélité exemplaires, ses soldats ont largement participé à ses succès. Qui étaient-ils donc ?
Au-delà de l'imagerie populaire qui les a glorifiés, c'est dans les campagnes qu'ils ont menées loin de leur Empereur, notamment dans la Péninsule ibérique et aux Amériques, qu'ils dévoilent les multiples facettes d'une personnalité elle aussi souvent hors normes.
Vous avez vu 11 livre(s) sur 4
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Investissement de Bayonne en février 1814 <em>L'armée de Wellington franchit l'Adour sur un pont de bateaux</em>
Visites guidées sur l'Adour ("Bayonne-1814") les 22 et 23 février 2014
La bataille de Saint-Pierre-d'Irube 13 décembre 1813
Depuis le début de la matinée du 13 décembre 1813, une bataille à l'issue incertaine oppose le corps d'armée du général Drouet d'Erlon à celui du général anglais Hill. Les Français tentent de reprendre le contrôle de la rive droite de la Nive qu'ils ont malencontreusement abandonné aux Alliés, le 9 décembre. L'enjeu est la reconquête de Villefranque et de Mouguerre, et la maîtrise de la route de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port.
De violents combats, souvent menés jusqu'au corps à la baïonnette, se sont déroulés durant toute la matinée de ce lundi 13 décembre. Ils se sont avérés plutôt favorables aux Français. Pour la première fois depuis qu'il a pris son commandement, Soult peut envisager la victoire.
Mais à la guerre, rien n'est jamais assuré. En début d'après-midi, un événement majeur va précipiter un retournement du rapport de force, jusqu'alors favorable aux Français, en faveur des Alliés.
Jean-Claude Lorblanchès
Mouguerre
13 décembre 2013
Batailles de l'automne 1813 au Pays basque Considérées depuis le belvédère de la Rhune (900 m)
"Du haut de la Rhune, embrassez la longue rangée de sommets que couronnent les redoutes ; voyez sur leurs flancs les courts et modestes linéaments de tranchées, trop espacées pour se prêter un mutuel appui ; placez nos malheureuses divisions sur leurs positions ; étendez le rideau de leurs avant-postes ; suivez alors la marche des colonnes ennemies serpentant de hauteur à vallon jusqu'aux rampes de la barre d'Amotz, s'y élevant, précédées d'une nuée de tirailleurs qui aveugle la défense et noie les redoutes, et vous reconnaitrez que nul génie humain ne pouvait nous sauver d'un désastre." (Commandant Charles Clerc ; Campagnes du maréchal Soult dans les Pyrénées occidentales en 1813-1814 ; Paris 1894).
Carte de référence : IGN 1:50 000 Pays basque ouest.
En se repliant sur le territoire national, les Impériaux ont perdu l'initiative des opérations. Fort de son écrasante victoire à Vitoria, encouragé par ses succès à Sorauren, à San Marcial et à San Sebastian, Wellington dispose maintenant d'effectifs importants. Sans plus attendre, il décide de pousser son avantage. Profitant du fait que les fortifications françaises ne sont pas très avancées outre Bidasoa, il va tenter de se ménager une tête de pont pour porter son aile gauche en France. L'objectif qu'il se fixe est Bayonne, port où il pourrait faire débarquer les renforts qu'il a demandés à Londres en vue de la campagne qu'il se prépare à mener dans le sud-ouest de la France.
Soult est de plus en plus convaincu que c'est du côté de l'océan que son adversaire va essayer de pénétrer en France. Ne sachant pas où il va être attaqué, et manquant cruellement de personnels, le maréchal se contenter de mettre en place un dispositif linéaire s'appuyant sur des fortifications de campagne sommairement aménagées. Manquant de profondeur et de capacité de manuvre, son système de défense ressemble plus à un cordon d'alerte qu'à une ligne d'arrêt.
Établies sur des points hauts, les redoutes disposaient de vues le plus souvent dégagées. Susceptibles de s'appuyer mutuellement, elles pouvaient constituer une formidable ligne d'arrêt. Toutefois, en dehors des redoutes Louis-XIV et de la Croix des Bouquets, elles ne sont défendues que par des effectifs du niveau de la compagnie, voire inférieurs, et elles ne disposent d'aucune réserve de contre-attaque. Petits ouvrages isolés.
Elles étaient conçues pour permettre aux fantassins de se mettre à l'abri, au lieu d'avoir à se former en carré en terrain découvert. Situées sur des points hauts, elles comprenaient une partie centrale, plus ou moins aplanie, délimitée sur toutes ses faces par des tranchées. Ces dernières, généralement non recouvertes, devaient permettre à l'infanterie de se déplacer, tout en restant à l'abri, pour renforcer les zones attaquées, lui donnant ainsi une certaine capacité de manuvre.
Quand le terrain le permettait, les redoutes étaient creusées sur une profondeur de deux mètres et une largeur équivalente, ce qui donnait aux tireurs la possibilité d'utiliser les parapets pour y prendre appui, tout en se mettant à couvert des salves adverses. Lorsque la présence de roches interdisait de creuser, on élevait des murets, comme sur l'Altxanga.
Cette conception de la redoute ne favorisait pas les réactions de contre-attaque, car il n'était pas facile de sortir des tranchées, et le nombre d'hommes que celles-ci pouvaient abriter restait limité : mises en difficulté, elles ne pouvaient être efficacement dégagées que par l'intervention d'une réserve extérieure. Certaines des redoutes étaient armées de pièces d'artillerie qui étaient, le plus souvent, disposées sur la partie supérieure aplanie, et donc très exposées aux tirs adverses.
Sur l'aile droite, Reille couvre la zone qui s'étend de l'océan à Ascain, et en profondeur jusqu'à Urrugne. Au centre, Clauzel assure la défense de Sare et du massif de la Rhune. Drouet d'Erlon reste centré sur Ainhoa. À gauche, Foy se déploie jusqu'à Bidarray.
À hauteur de Béhobie, les Français ont commencé à aménager des défenses de circonstance sur la rive droite de la Bidasoa, mais sans conviction, car ils ne pensent pas que les Alliés se risquent à franchir l'estuaire. Ils ignorent encore que des pêcheurs espagnols leur ont signalé trois gués praticables à marée basse, entre le pont brûlé et la mer.
Le mauvais temps et la hauteur des marées retardent l'opération de franchissement, que Wellington finit par déclencher le 7 octobre. Vingt-quatre mille hommes y participent directement.
Au petit matin, poussé par le vent du sud, l'orage menaçant qui s'est formé sur les Peñas de Haya éclate violemment au-dessus des positions françaises. Les divisions de Graham en profitent pour rejoindre discrètement leurs positions de départ. Lancée du haut du clocher de Fontarabie, une fusée donne aux Anglo-Portugais le signal attendu de l'assaut. L'attaque, générale, se déploie sur un front d'une dizaine de kilomètres.
À sept heures, les Alliés commencent à franchir l'estuaire de la Bidasoa en empruntant les trois gués sur lesquels les guident des pêcheurs de crevettes locaux. Prenant de court les Français qui n'en croient pas leurs yeux, ils traversent la rivière avec de l'eau jusqu'à hauteur de la poitrine, sans avoir à tirer un coup de feu.
Appuyées par l'artillerie en position à San Marcial, quatre colonnes anglo-portugaises de l'aile gauche de Graham attaquent, dans la foulée, les positions françaises de la redoute Louis-XIV et du Café Républicain. Hendaye, qui n'était pas sérieusement défendue, doit être précipitamment évacuée.
Les Anglais s'emparent du Café Républicain et neutralisent la formidable position de la redoute Louis-XIV en la débordant. Poursuivant leur avance, ils attaquent la dorsale de la Croix-des-Bouquets, ultime ligne de défense des Impériaux, et ils en prennent le contrôle. Plus à l'est, après avoir franchi la Bidasoa à différents gués, les Espagnols se lancent à l'assaut du col des Poiriers.
Tout est allé si vite sur l'ensemble de la ligne de contact. Le dispositif français était trop étalé dans la profondeur pour que d'éventuelles contre-attaques aient pu être efficaces. Mais il n'y a même pas eu de véritables contre-attaques. La défense a été menée sans coordination, sans ordre et sans ensemble, avec moins de cinq mille hommes, alors qu'il aurait fallu réagir immédiatement, dès le début des franchissements de la Bidasoa, avec un effectif au moins double.
Les Français finissent tout de même par se ressaisir à hauteur du camp des Sans-Culottes, où plusieurs redoutes sont en cours d'aménagement.
Au moment même où la gauche alliée franchissait l'estuaire, vingt mille hommes de l'aile droite traversent la Bidasoa plus en amont, et se lancent à l'assaut du massif de la Rhune.
Les Impériaux sont désormais menacés sur toute leur ligne de défense. Descendus de l'Ibanteli, Giron et ses troupes andalouses ont occupé le col de Lizuniaga au lever du jour. Alten, avec sa division légère, a fait mouvement des hauteurs de Santa Barbara sur Vera de Bidasoa, où il a été renforcé par une partie des Espagnols de Longa. De part et d'autre du village, quatre colonnes se tiennent prêtes à faire mouvement vers le nord.
Chargé de défendre le remarquable observatoire de la Rhune et les accès de Sare, Clauzel ne peut aligner que seize pièces d'artillerie. Faisant face à Vera de Bidasoa qu'elle domine, la division Taupin occupe le Mandalé coiffé par la redoute de la Baïonnette. Un de ses bataillons est détaché en avant, sur l'Alzate Real. Un autre occupe la solide position constituée par la redoute étoilée de San Benito (Fuerte Viejo), ouvrage remarquablement bien situé sur le mouvement de terrain descendant plein sud depuis le Mandalé, et séparant les thalwegs redressés des regatas d'Ibardin et du Montoya. À deux kilomètres au sud de la frontière, les Français contrôlent le col d'Inzola qui commande le débouché de la gorge d'Olhette.
En 1813, le chemin de Vera de Bidasoa à Saint-Jean-de-Luz contournait l'Alzate Real par l'ouest, puis remontait le thalweg d'Inzola, avant de redescendre du col (274 m) vers la frontière. Selon un caprice du tracé assez courant dans la région, celle-ci ne suit pas la ligne de partage des eaux, mais elle coupe perpendiculairement le vallon, deux kilomètres plus au nord. Le chemin se faufilait au pied des falaises de l'Erintsu. Laissant la Montagne de Ciboure à droite, il basculait ensuite sur Olhette. La route actuelle passe plus à l'ouest, et elle s'élève plus haut, jusqu'au col d'Ibardin (317 m).
Dans la matinée du 7 octobre, Alten s'élance de sa base de départ du Barrio de Lesaca (Zalain) en direction de la redoute de la Baïonnette. Les Alliés s'emparent, non sans difficulté (trois assauts sont nécessaires), de la redoute étoilée de San Benito, premier obstacle sérieux sur leur axe de progression. Au même moment, une autre brigade d'Alten prend le contrôle de l'Alzate Real.
De leur côté, des éléments de l'aile gauche de Giron tournent la gauche de Taupin au col d'Inzola, et ils parviennent à prendre pied sur l'épaulement qui s'élève de ce col vers la Petite Rhune. Simultanément, montant de Biriatou, les Espagnols contournent le Mandalé par le col des Poiriers.
Prises en tenailles, et craignant de se voir débordées, les unités de Taupin refluent vers Olhette et Ascain. Après cinq heures d'un combat acharné, le Mandalé et la redoute de la Baïonnette, le Commissari et la redoute des Émigrés, les cols d'Ibardin et d'Inzola sont abandonnés les uns après les autres. Toutefois, soutenus par la réserve de Villate, qui s'est avancée en recueil au débouché de la gorge d'Olhette, les Français parviennent à se maintenir sur le versant occidental de la Montagne de Ciboure.
Débouchant sur la crête frontière avec la division légère à laquelle il appartient, le lieutenant Kincaid est fasciné par le spectacle qu'il découvre : "Nous étions maintenant en territoire français, avec des perspectives bien réjouissantes pour nous qui n'avions pas vu la mer depuis trois ans et dont l'horizon se limitait, ces derniers mois, au spectacle de montagnes embrumées. À notre gauche, la baie de Viscaye s'étendait jusqu'à l'horizon et l'on pouvait y voir plusieurs de nos navires. À nos pieds, la jolie petite ville de Saint-Jean-de-Luz semblait sortir tout droit du cadre lilliputien d'une vitrine de jouets. On apercevait aussi Bayonne dans le lointain et, sur notre droite, la vue embrassait le cadre magnifique d'une campagne couverte de bois et parsemée d'une multitude de petites villes et de villages, aussi loin que portait le regard."
Le terrain que le jeune officier a sous les yeux est celui sur lequel vont se dérouler, durant les trois prochains mois, de rudes combats qui tourneront à l'avantage des Alliés.
À l'est de la Rhune, la crête reliant l'Ibanteli à l'Atchouria ferme au sud la large cuvette de Sare. Se préparant à dévaler de ces hauteurs, les Alliés menacent directement le haut bassin de la Nivelle.
Une ligne de défense a été établie sur la dorsale qui sépare les deux thalwegs du Lizuniako, à l'ouest, et du Tombako, à l'est : quelques pièces d'artillerie arment les imposantes redoutes de Santa-Barbara et de Granada qui jalonnent ce mouvement de terrain jusqu'à la cote 167 où a été installé un poste d'infanterie.
Sur le contrefort que la Rhune projette vers le sud-est se détachent les rochers de Faague. Conroux s'y est déployé pour être en mesure d'intervenir sur des éléments qui tenteraient d'atteindre directement la Rhune depuis le col de Lizuniaga. Un peu en contrebas, une solide position d'infanterie a été aménagée autour de l'excellent belvédère de la chapelle d'Olhain. Maransin est maintenu en réserve au camp d'Helbarrun, au nord du village de Sare.
Débouchant à seize heures du col de Lizuniaga, Giron lance son aile gauche sur la large croupe frontière qui s'élève en direction du sommet de la Rhune. Les hommes de Conroux ne parviennent pas à empêcher les Espagnols de prendre pied sur le replat qui se situe au-dessus des rochers de Faague. Avant de poursuivre leur progression, les assaillants doivent cependant couvrir leur flanc droit que menacent les positions françaises. Ils entreprennent de les réduire ; à la tombée de la nuit, ils en contrôlent la plus grande partie.
Mais les Impériaux résistent encore sur les rochers du Béchinen et à la chapelle d'Olhain. Ils tiennent toujours la Rhune dont le sommet se présente sous la forme d'un étroit plateau de six cents mètres de long, légèrement incliné du nord-ouest vers le sud-est. Une division prendrait facilement place sur cette position dominante qui couvre tout le Labourd, et qui devrait donc être le point clé du système de défense français. Mais il n'en est rien.
Non seulement Soult manque de troupes pour mener une guerre de position face à un ennemi aux effectifs nettement supérieurs, mais ses soldats sont mal à l'aise sur ce type de terrain de montagne aux versants raides et escarpés. Le temps est exécrable. Quand le soleil daigne se montrer, les tireurs ont du mal à apprécier les distances : leurs tirs sont imprécis. Par ailleurs, la portée des fusils est insuffisante pour battre efficacement les points de passage obligé. Il faudrait les occuper, mais les deux régiments qui tiennent le sommet n'ont pas les effectifs nécessaires pour le faire. La ligne naturelle de défense, qui court de l'Ibanteli au Mandalé, en passant par la Rhune et le Soubissia, ne sera pas tenue.
La position la plus solide, le camp retranché du Mouiz, a été aménagée sur le versant nord de la Rhune, trois cents mètres au-dessous du sommet, entre la crête et le col de Saint-Ignace. Koralhandia (cote 537), une redoute en pierres sèches, en constitue l'élément défensif essentiel. Typique des ouvrages de circonstance de l'époque, elle a une forme d'étoile à six pointes, mais irrégulière. Elle mesure une cinquantaine de mètres dans sa plus grande longueur (est-ouest), sur une trentaine de large. Les murailles, de deux mètres de haut et de quatre-vingts centimètres d'épaisseur, sont en dalles de grès. Encore bien conservées de nos jours, elles n'ont pas de meurtrières.
La redoute est armée de six pièces d'artillerie. Quatre postes d'infanterie aménagés sur l'étroite barre rocheuse de l'Altxanga complètent ce dispositif défensif, véritable verrou à partir duquel devraient pouvoir être contrées d'éventuelles infiltrations ennemies en provenance, soit du vallon oriental du col des Trois Fontaines, soit de l'ouest. Judicieusement situé, l'ensemble constitue une position solide qui semble imprenable. Sentinelle avancée, la Rhune peut, certes, être contournée : par l'est en passant au-dessus des rochers de Faague, ou par le large col Zizkouist qui la sépare, à l'ouest, de la Petite Rhune. Mais, dans un cas comme dans l'autre, les agresseurs seront confrontés aux défenses du Mouiz et de l'Altxanga.
Le 7 octobre au soir, après une longue journée de combats, la situation se stabilise sur l'ensemble du front, de l'océan jusqu'aux hauteurs de Sare. Les Alliés ont forcé le passage en direction d'Urrugne, mais le seul avantage qu'ils aient acquis sur les contreforts de la Rhune est la conquête des rochers de Faague. Ils pourraient en être facilement chassés par une solide contre-attaque menée du Mouiz par la brèche d'Athekaleun, mais Conroux ne dispose pas des effectifs nécessaires pour exécuter ce mouvement.
Dès le lendemain matin, Wellington décide de faire effort sur cette zone où les Français ont l'air de vouloir s'accrocher. Les Impériaux sont rapidement submergés par l'attaque générale qui est lancée au milieu de l'après-midi. La position de la chapelle d'Olhain tombe au premier assaut, puis les Espagnols s'emparent de la redoute Santa-Barbara. Les ouvrages avancés défendant Sare doivent être évacués, mais la redoute de Granada (Errotaldekoborda) tient toujours. Toutefois, estimant que le pont d'Amotz est menacé et qu'il risque d'être coupé de ses arrières, Clauzel commence à se retirer pour regrouper ses forces aux lisières nord de Sare.
Les deux régiments qui défendent le sommet de la Rhune ont attentivement observé ce repli. Sans ordres, se sentant abandonnés, et redoutant de se retrouver eux-mêmes isolés, ils profitent de la nuit pour décrocher. Sans être attaqués, sans se battre, ils abandonnent leurs positions et se replient vers l'ouest, sur la Petite Rhune.
Cet abandon précipité et irrationnel de la ligne la plus naturelle de défense sera lourd de conséquences pour les Français. Les Espagnols s'installent au sommet de la Rhune, le 9 octobre au petit matin, sans avoir eu à tirer un seul coup de feu. L'avant-poste que constitue désormais la Petite Rhune sera-t-il suffisant pour contenir une tentative de débordement par l'ouest ? Rien n'est moins sûr.
Au lever du jour, les troupes de Clauzel sont toujours au contact des Espagnols devant Sare. Par une brillante contre-attaque, elles réussissent à reprendre la redoute Santa-Barbara, mais à dix heures elles en sont de nouveau chassées. Les combats continuent toute la journée pour le contrôle du hameau de Lehenbizkai dans lequel les Français tiennent bon.
Changeant une nouvelle fois de mains, la redoute Santa-Barbara sera reprise aux Espagnols, dans la nuit du 12 au 13 octobre. Après avoir résisté aux contre-attaques qu'ils lanceront au petit matin, les Impériaux devront finalement évacuer l'ouvrage, trop exposé en avant des lignes. Ils le reprendront encore une fois, avant d'en être définitivement chassés le 10 novembre, lors du repli général qui suivra la bataille de la Nivelle. Les combats livrés pour le contrôle de cette redoute, localisés mais violents, auront coûté deux cents hommes aux Français et cinq cents aux Espagnols.
Le 9 octobre dans la soirée, le front se stabilise. Un modus vivendi s'installe entre les adversaires. Ils vont marquer une pause d'un mois, s'observant et se jaugeant de part et d'autre d'une ligne de front qui, loin d'être hermétique, leur donne l'occasion de nouer des contacts.
Sur le versant sud de la Petite Rhune, Français et Anglais s'entendent pour neutraliser certains points. "De tels arrangements étaient fréquents Cela montre que des ennemis appartenant à des armées civilisées peuvent se comporter en gentlemen. Une telle courtoisie n'existait pas entre Anglais et Espagnols", relève Harry Smith.
Le commandant Smith partage son temps entre les reconnaissances de terrain, son travail d'état-major et sa vie de couple. Juanita, sa jeune femme espagnole, l'accompagne dans ses bivouacs, jusque sur les contreforts de la Rhune où, avec le concours de quelques domestiques, elle tient la maison : une tente et du mobilier démontable.
Les conditions de vie sont précaires. Le mauvais temps continue à sévir ; il a même neigé. Les troupes améliorent leur ordinaire en cueillant les châtaignes que l'on trouve en abondance vers le col de Lizuniaga et dans le vallon du rio Cia.
Le mois d'octobre a été difficile pour les Impériaux. Luttant à un contre trois, les unités de Clauzel ont perdu quatorze cents hommes dans la bataille de la Rhune, un peu moins que les Alliés dont les pertes sont estimées à seize cents.
Dans cette bataille de généraux qu'il vient de livrer à Soult, Wellington a été le meilleur. Manuvrant habilement pour attaquer séparément les positions en cordon des Français, il a réussi à les enlever sans que les réserves aient le temps d'intervenir. Avant même le déclenchement de son offensive, il avait averti ses commandants de division : "L'ennemi n'a pas suffisamment d'hommes pour occuper les positions qu'il tient. Il n'aura pas les moyens de concentrer des forces sur les points que je choisirai d'attaquer. Sur chacun de ces points, je pourrai engager des moyens supérieurs aux siens." C'est ce qui s'est effectivement passé. C'est ce qui va se reproduire.
On peut s'étonner que Soult n'ait directement engagé dans les combats que quatorze mille hommes, alors que Wellington a attaqué avec des effectifs près de trois fois supérieurs. Sur la défensive, moins bien renseigné que son adversaire, le maréchal a dû, pour une fois, se montrer plus prudent que l'Anglais. Installé à Vera, celui-ci ne juge pas opportun de s'enfoncer plus avant en territoire français tant que Pampelune ne sera pas tombée. Tout en réhabilitant les ponts sur la Bidasoa, et en fortifiant ses positions au sud du fleuve, il réorganise ses forces.
À l'aile droite, Hill étend son dispositif de Roncevaux jusqu'au Baztan. Au centre, la zone de Beresford va de Maya au Mandalé, en passant par Etxalar et la Rhune. À l'ouest, le lieutenant général John Hope (qui vient de remplacer Graham à la tête de l'aile gauche alliée) couvre le secteur allant du col des Poiriers à la Croix-des-Bouquets, puis à l'océan.
L'hiver 1813-1814 a été précoce (il a neigé dès le mois d'octobre), et il sera rigoureux. Début novembre, Wellington dispose de près de cent mille hommes dans la zone frontière. Soult ne peut en aligner que soixante mille.
Sur son aile gauche, Drouet d'Erlon a formé une première ligne de défense qui descend du Mondarrain vers la Nivelle. En arc de cercle, elle épouse le relief en suivant la dorsale de l'Atxulegi et de l'Ereby, sommets qui sont défendus par de solides redoutes, puis elle remonte sur Dancharia, et elle couvre les débouchés de la vallée du Baztan par Urdax.
En retrait de trois à cinq kilomètres, une deuxième ligne suit la crête allant du col de Pinodiéta au pont d'Amotz. Constituant la position principale, dite grande position de Souraïde, elle est armée de trois puissantes redoutes.
Au centre, Clauzel s'est établi sur les hauteurs, elles aussi fortifiées de redoutes, qui dominent la rive gauche de la Nivelle, du pont d'Amotz à Ascain. Vers l'avant, une première ligne, aux ordres de Conroux, couvre toujours les approches sud de Sare, d'Arrossakoborda aux redoutes très disputées de Granada et de Santa Barbara, puis d'Ibarsoroa au centre de résistance du Mouiz et à la Petite Rhune.
La défense du Mouiz, solidement renforcée, est assurée par la brigade Barbot de la division Maransin. En recueil au col de Saint-Ignace, la brigade Rouget assure le contact avec une deuxième ligne dont la défense a été confiée à Taupin. Cette ligne s'appuie sur un système de redoutes édifiées sur le mouvement de terrain qui descend vers le pont d'Amotz en passant par le Suhalmendi. Au-delà du pont d'Ascain, le camp retranché de Serrès est protégé par la brigade Darricau que renforce la brigade italienne de Saint Pol, elle-même détachée de la réserve de Villate.
La droite des Impériaux est, elle aussi, organisée en deux lignes de défense. Reille s'est disposé de part et d'autre de la route d'Espagne, en avant de Saint-Jean-de-Luz qu'il a pour mission de couvrir. C'est sur cet axe que Soult s'attend, à tort, à voir Wellington mener son action principale. À l'avant, les divisions Boyer et Maucune, déployées sur une ligne allant d'Urrugne à Ciboure, occupent les positions fortifiées du château d'Urtubie et du Bordagain.
À l'arrière, Villate maintient deux brigades à Saint-Jean-de-Luz et à Ciboure, ainsi que deux autres au camp de la Réserve situé sur les collines sud de la Nivelle. Il a pour mission de contre-attaquer pour interdire, le cas échéant, le débouché des cols d'Inzola et d'Ibardin par les gorges d'Olhette et d'Herboure.
Soult s'est fixé une deuxième ligne d'arrêt sur la rive droite de la Nivelle, du camp de Serrès à Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde, Cambo et l'Ursuya. Installé à Bidarray, Foy est chargé de surveiller les débouchés de la vallée de Baïgorry.
Le point faible de ce système de défense se situe entre la Rhune et la Nivelle, une rivière peu importante qui peut être traversée à gué à l'est du pont d'Amotz. Le dispositif manque de consistance.
Encore une fois trop linéaire et étiré (le col de Pinodieta est à dix-huit kilomètres à vol d'oiseau du fort de Socoa), il n'a pas une profondeur suffisante pour que puissent être menées, avec l'efficacité et la rapidité nécessaires, des contre-attaques du niveau de la division, seules susceptibles de dégager les centres de résistance des régiments. Ceux-ci n'ont pas de réserves propres pour pouvoir contrer immédiatement les assauts ennemis. Dans de telles conditions, il est difficile, sinon impossible de manuvrer. Il ne peut être question que de tenir, sans esprit de recul. Pourquoi, alors, ne pas avoir résisté sur la coupure naturelle de la Bidasoa et sur la crête frontière ? Soult s'est laissé leurrer par les opérations de diversion de Wellington : il connaît mal le dispositif de son adversaire, et il ignore quelles sont ses véritables intentions.
Comme d'habitude, le duc est beaucoup mieux informé de ce qui se passe chez les Français. Son plan de bataille est simple : attaquer sur toute la ligne.
La journée du 10 novembre s'annonce fort belle. Au lever du jour, trois coups de canon tirés du sommet de l'Atchouria signalent le déclenchement de l'attaque. Avant même que l'assaut principal ne soit lancé, la division légère a réussi à s'emparer de la Petite Rhune qu'elle a discrètement approchée de nuit.
La bataille engagée, les Alliés s'avancent en cinq colonnes de divisions. Précédée par de nombreux tirailleurs, et accompagnée d'une réserve qui lui est propre, chaque division a son objectif : le pont d'Amotz pour Colville, les redoutes de Granada et de Louis XIV pour Le Cor, Mendiondokoborda et la redoute du Suhalmendi pour Cole et Girón, la Petite Rhune, l'arête et le plateau de l'Altxanga, ainsi que les ouvrages du col de Saint-Ignace pour Alten et Longa, Ascain pour Freire.
Progressant depuis les Fermes de Sare sur les versants du vallon oriental du col des Trois Fontaines, les Alliés, bientôt appuyés par des éléments débouchant du sommet de la Rhune qu'ils occupent depuis un mois, et de la Petite Rhune dont ils viennent de s'emparer, prennent en tenailles les défenses du centre de résistance du Mouiz et de l'Altxanga.
Sans trop de difficulté, ils s'assurent de cette position en enlevant successivement le poste du Rocher, établi dans le thalweg, à la base nord de la Rhune et en direction du col des Trois Fontaines, puis les ouvrages en pierres sèches de la Place d'Armes et du Nid-de-Pie. Chacune de ces positions secondaires, dont il reste de nos jours quelques vestiges, était défendue par des effectifs de la valeur d'une compagnie. La voie ouverte, les assaillants peuvent alors dévaler vers le nord, sur le versant en pente douce où la Traverse et le Donjon n'offrent qu'une résistance symbolique.
Seule la redoute Étoile-de-Mouiz (Koralhandia) constitue une résistance sérieuse, mais la situation y devient rapidement intenable. "Sautant vaillamment sur son cheval, Colborne le pousse vers le fossé sous le feu des ennemis qui se fait plus hésitant au fur et à mesure qu'il approche. D'une voix forte, il les somme de se rendre. Tout aussi crânement, l'officier français répond : Reculez, Monsieur, ou je vous abats ! S'adressant aux soldats, Colborne rétorque : Si un seul coup de feu est tiré maintenant que vous êtes encerclés, vous serez tous passés au fil de l'épée." Le colonel obtempère, et ses hommes déposent les armes.
Craignant d'être tourné, Barbot décroche vers le col de Saint-Ignace, puis les redoutes de Mendibidea (cote 268) et d'Hermitebaita (cote 273). Il regroupe ses troupes sur le mouvement de terrain allant du Suhalmendi à la redoute Louis XIV. Il n'est que huit heures du matin.
Deux heures auparavant, au moment même où était lancée l'attaque sur l'Altxanga, deux divisions anglaises ont débouché du col de Lizarieta et marché sur les redoutes de Santa-Barbara et de Granada. Les assaillants se sont emparés du premier ouvrage par une manuvre hardie de débordement, du côté du thalweg du Lizuniako, au versant pentu et broussailleux. L'artillerie s'est chargée de réduire le second, qui était moins bien protégé. La route de Sare est ouverte : abandonné par Conroux, le village est coiffé, puis dépassé. Plus à l'est, les Espagnols accrochent les défenses du Mondarrain et de l'Atxuléguy, et les Anglais s'emparent des forges d'Urdax et d'Aïnoha.
Ayant avancé sur toute la ligne, les Alliés franchissent la Nivelle à gué, en amont du pont d'Amotz qui permet à l'aile gauche française de communiquer avec le centre. Remontant vers le pont en suivant la rive droite, ils tournent les premiers ouvrages défensifs de Drouet d'Erlon. D'autres colonnes, formées à Istilarté et à Sare, tentent de s'infiltrer entre la redoute Louis-XIV et le pont d'Amotz. Les Anglais sont repoussés deux fois par les défenseurs de la redoute, mais au troisième assaut cet ouvrage imposant tombe entre leurs mains (au cours de cette action, Maransin est fait prisonnier, mais il s'évade aussitôt). La garnison de la redoute des Signaux, qui est située immédiatement à l'ouest d'Uhaldekoborda (cote 187), succombe à son tour. Pas plus que les autres ouvrages défensifs, elle n'a pu être secourue.
Gravement touché à la poitrine, Conroux est évacué, ce qui démoralise ses troupes. Les hommes de Maransin faiblissent aussi. En début d'après-midi, les Impériaux se replient en franchissant la Nivelle sur le pont de Saint-Pée et sur celui d'Haroztegia (en face d'Ibarron). À seize heures, deux colonnes alliées traversent à leur tour la rivière. L'aile gauche française est désormais coupée du centre.
Plus à l'est, les onze mille hommes de Drouet d'Erlon ont eu du mal à défendre le secteur de onze kilomètres de front qui leur a été confié. La brigade Maucomble occupe l'Ereby et l'Atxulegi, tous deux défendus par des redoutes. Elle a mis en place des avant-postes sur l'Haitzaberri, longue crête frontière qui descend du Gorospil vers Dancharia.
Une batterie a pris position sur la hauteur d'Arbonakoborda pour couvrir le pont de Dancharia. Un ouvrage aménagé sur la cote 151, au nord-ouest d'Ordokikoborda et d'Ainhoa, assure le contact visuel avec les unités de la division Darmagnac et de la première brigade Abbé. Elles occupent les six redoutes de la crête allant du col de Pinodieta au pont d'Amotz (notamment celles d'Ordosgoitikoborda et des points cotés 279, 232 et 189). L'uniformité de ce mouvement de terrain n'est rompue que par l'affaissement du col d'Harismendia. Le chemin d'Ainhoa à Saint-Pée, qui emprunte ce passage, marque la limite entre Darmagnac et Abbé.
Chacune des redoutes est occupée par un bataillon. Celle de la cote 189 (la plus à l'ouest et la plus proche du pont) tombe la première aux mains des Alliés qui l'ont tournée sur la droite. Les autres sont prises en cascade. Darmagnac se replie en direction d'Habantzen, sur les hauteurs au nord-est de Saint-Pée.
Sur sa gauche, chassé lui aussi des redoutes du versant nord de l'Erebi, Abbé retraite vers le col de Pinodieta, puis Espelette et Cambo. Les éléments qui ont pris position sur le Mondarrain doivent l'abandonner à leur tour.
Les redoutes ont été submergées par l'ennemi, les unes après les autres, inexorablement. N'ayant pas de réserves propres, elles n'ont pas été en mesure de contre-attaquer les colonnes d'assaut que précédaient des nuées de tirailleurs chargés de coiffer les défenses et de les aveugler.
La situation des Français continue à se dégrader dans le secteur d'Ascain. Après s'être rendus maîtres de l'Altxanga, les Alliés ont dévalé le vallon du ruisseau des Trois Fontaines. Ils se dirigent vers le pont d'Ascain pour empêcher les réserves du camp de Serrès d'intervenir au profit de Clauzel. Ayant abandonné sans combat les deux redoutes du col de Saint-Ignace (Mendibidea et Ermitebaita), les Impériaux tentent désespérément de s'accrocher aux redoutes des Signaux, d'Arostaguia et du Bizkarzun. En dépit de leurs efforts, les Alliés prennent le contrôle du pont.
Il est quatorze heures. Se repliant sur toute la longueur de la ligne de bataille, les Impériaux franchissent la Nivelle sur différents ponts, entre Saint-Pée et Ascain, et ils rejoignent la position fortifiée d'Habantzen sur laquelle Soult a ordonné le regroupement. Établie sur un important carrefour de routes et de chemins, la zone de repli occupe une position dominante sur la route de Bayonne, à trois kilomètres au nord-est de Saint-Pée.
Maintenant le contact avec les troupes qui refluent, les Alliés franchissent à leur tour la Nivelle. Wellington emprunte lui-même le pont de Saint-Pée.
À la tombée de la nuit, la ligne de contact se stabilise enfin. Harassés par une journée de combats mobiles et continuels, les soldats des deux camps n'aspirent plus qu'au repos.
Soult, qui s'attend à ce que Wellington fournisse son effort principal en direction de Ciboure, tergiverse avant de se décider à intervenir en soutien de Clauzel. Les deux commandants en chef ne se font pas face. Le maréchal est statique et éloigné de la zone où se déroule l'action majeure. L'Anglais, qui est mobile, colle au plus près des unités qui vont réaliser la percée. Il dirige la bataille en ayant pratiquement une vue directe sur ses divisions.
Soult s'attarde inutilement à Saint-Jean-de-Luz. S'il entend le bruit du canon, il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il ne peut communiquer avec ses grands subordonnés que par estafettes. Celles-ci, mettent près d'une heure pour joindre Clauzel, soit plus d'une heure et demie pour faire un aller et retour. C'est rédhibitoire !
Reille est plus près de lui, et il sait qu'il éprouve des difficultés à contenir l'avance des Alliés. Or, il ne dispose que de la réserve de Villate pour tenter de limiter les dégâts, du côté de Clauzel comme de celui de Reille. Il la garde trop longtemps près de lui. Quand il envisage enfin de la lancer sur le flanc gauche des Alliés, devenus vulnérables quand ils dévalent le versant nord de la Rhune, il est trop tard : Ascain est déjà entre leurs mains.
En début de matinée, la position du camp des Sans-Culottes a été enlevée par les Alliés qui se sont emparés, dans la foulée, de celle du Bon-Secours (Sokorrie) qui couvrait Urrugne. Un peu plus à l'est, les combats vont se poursuivre toute la journée, du plateau qui domine l'Haniberreko, un petit affluent de la Nivelle, jusqu'aux lisières sud de Ciboure.
Pas plus que celles de Sare, de Saint-Pée et d'Ascain, les sept redoutes qui jalonnaient la route d'Olhette, ainsi que les huit autres qui couvraient le terrain entre cette dernière et la route d'Urrugne, n'ont pas servi à grand chose. Quoique mieux défendue que les autres et armée de pièces d'artillerie, la redoute de Nassau n'a pas résisté aux impétueux coups de boutoir de l'ennemi. Au nord-ouest, la position de Beltxenea, située immédiatement à l'est du péage actuel de Saint-Jean-de-Luz sud, a subi le même sort. Pour faire face à la poussée des Alliés, Reille a dû se résoudre à détruire tous les ponts qui avaient été jetés sur la basse Nivelle, puis il s'est retiré dans Saint-Jean-de-Luz.
Le 10 novembre au soir, l'armée impériale est ainsi rejetée derrière une ligne allant de Saint-Jean-de-Luz à Cambo. Occupant Ciboure et le Bordagain, Reille est le seul à se maintenir, pour quelques heures seulement, sur les deux rives de la Nivelle. La réserve de Villate bivouaque au camp de Serrès, Darricau se trouve du côté d'Ahetze, Clauzel campe sur les hauteurs d'Habantzen, Abbé s'est replié sur Cambo, Darmagnac sur Ustaritz, et Foy sur Bidarray. Les Alliés tiennent Urrugne, Ascain, Sare, Ainhoa, Espelette, Souraïde et Saint-Pée-sur-Nivelle.
Au cours de la nuit, Reille évacue le fort de Socoa et les positions défensives du Bordagain, puis il abandonne Saint-Jean-de-Luz, et il regroupe ses troupes sur les hauteurs de Bidart. Les seize redoutes qui devaient couvrir Saint-Jean-de-Luz n'ont pas réussi à ralentir l'avance de l'ennemi, qui a poursuivi implacablement sa progression.
Sur l'aile gauche alliée, l'infanterie de Hope a franchi la Nivelle en amont de Saint-Jean-de-Luz, et elle marche sur Bidart. Au centre, Beresford s'est avancé vers Arbonne. À droite, Hill, solidement établi à Souraïde et à Espelette, menace Cambo. Soult a rejoint le camp de Serrès au début de l'après-midi.
La bataille de la Nivelle a été minutieusement préparée par les Alliés. Pendant un mois, ils ont observé les positions françaises depuis les points hauts qu'ils avaient conquis en s'emparant de la Rhune. Ils ont multiplié les reconnaissances, de jour et de nuit, des itinéraires d'approche. Dans ces combats, les Français ont perdu quatre mille deux cent soixante-dix soldats et cent soixante-dix officiers (dont un général) tués, ainsi que quatorze cents prisonniers. Ils ont dû abandonner à l'ennemi leurs magasins de Saint-Jean-de-Luz et d'Espelette, ainsi que cinquante-et-un canons. Les Alliés n'ont perdu que deux mille six cent quatre-vingt-dix hommes et officiers.
Soult a mal préparé cette bataille, et une fois déclenchée, il l'a mal gérée. Selon Clerc, qui connaissait bien le terrain pour l'avoir parcouru en long et en large, et qui a pu consulter les documents officiels relatifs à ces combats, du côté français comme du côté allié :
"Les réserves auraient dû être placées à Amotz et Saint-Pée, mais non seulement les réserves, le quartier général. Il n'était pas de point plus central. L'aveuglement de Soult et son obstination demeurent inexplicables ; on peut dire que le jour où, cédant aux suggestions d'un faux point de vue, et qui sait, à des considérations secondaires, telles que les commodités de l'installation, il transféra le quartier général d'Ascain à Saint-Jean-de-Luz, d'un modeste village dans une bourgade, il commit une faute et l'expia par une sanglante défaite."
L'effet sur le moral va être désastreux, tant sur celui des soldats français que sur celui des populations locales accablées par une invasion qu'elles vont, de plus en plus, considérer avec une indifférence croissante. Elles sont d'ailleurs surprises, pour ne pas dire séduites, par le comportement des Anglais et des Portugais qui, obéissant aux ordres très stricts de Wellington, se montrent beaucoup plus corrects que ne l'ont été les Français.
Wellington est cependant contraint de marquer une pause : il doit restaurer les ponts de la Nivelle, entre Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, pour pouvoir faire franchir son artillerie sans laquelle il ne peut aller de l'avant.
Les Alliés ont pénétré sur le territoire français beaucoup plus facilement qu'ils ne l'avaient espéré. En s'emparant de la Rhune et de ses contreforts, ils ont enlevé le dernier rempart montagneux protégeant de l'invasion étrangère les plaines du sud-ouest de la France.
Les troupes n'ont guère respecté les populations civiles, et elles se sont livrées sans vergogne au pillage dans les fermes et les hameaux. Les Anglais, qui mettaient pour la première fois le pied en France, se sont montrés curieux de voir à quoi pouvait ressembler une maison française. En dépit des consignes qui avaient été données, les premières fermes se trouvant au pied de La Rhune ont été visitées par les soldats alliés qui se sont largement servis sur le bétail et les volailles pour améliorer l'ordinaire. Un peu déçus, les soldats britanniques ont trouvé que les modes de vie n'étaient guère différents d'un côté de la frontière à l'autre.
À Ascain, les Espagnols de Freire et de Longa se sont livrés au pillage, violant et tuant plusieurs habitants.. Dans quelques semaines, les bataillons d'Espoz y Mina, en partie mutinés, auront le même comportement du côté d'Hélette.
Le 12 novembre, pour mettre immédiatement un terme à ces excès, Wellington renvoie tous les Espagnols (plus de vingt mille) dans leur pays, à l'exception de la division Morillo. N'hésitant pas à s'affaiblir numériquement, il s'assure, par contre, la reconnaissance des Basques français.
C'est plutôt de bon gré que ces derniers vont coopérer avec les envahisseurs. Non par amour des Bourbons, mais par rejet de l'Empire, de ses guerres et de ses impôts. À peine les Anglais sont-ils arrivés à Saint-Jean-de-Luz que les officiers organisent des fêtes et des bals. Wellington, qui parle très bien le français, tient table ouverte, recevant les notabilités locales, et notamment le maire de Biarritz, ainsi qu'une autre "mystérieuse personne".
Quand on demandera au duc s'il n'était pas imprudent de bavarder comme il le faisait avec les civils français, il répondra : "Vous les preniez pour des espions, je suppose, et pensiez que j'aurais dû me tenir sur mes gardes. À quoi bon ? Ce qu'ils disaient ou entendaient m'était indifférent. D'autres me fournissaient plus de renseignements qu'il ne m'était nécessaire. Ceux qu'ils donnaient à Soult ne pouvaient lui servir. Je ne suis point tout à fait sûr que le maire de Biarritz était un espion double ; quant à l'autre, je n'en ai jamais douté, je le savais aux gages de Soult comme aux miens. Il y avait beaucoup d'espions dans mon camp, et il ne m'est jamais venu à l'esprit de les pendre." (cité par Clerc).
Exposées aux tourmentes de neige, de grêle et de pluie d'un hiver particulièrement sévère, les armées des deux camps vivent au jour le jour. Les Anglais sont toutefois les mieux lotis. Ils reçoivent assez régulièrement du ravitaillement du Royaume Uni et d'Espagne, et ils ont de l'argent pour payer les marchandises qu'ils se procurent en France. Les Impériaux sont à cet égard nettement moins bien favorisés. Ils signent des réquisitions au grand dam des habitants, qui redoutent de ne jamais être payés.
Le problème du fourrage pour les chevaux est un casse-tête permanent pour le commandement. Il fait cruellement défaut, et les bêtes en sont parfois réduites à manger le blé en herbe, ce qui exaspère les paysans. Les montures doivent être retirées de la zone des combats pour aller pâturer plus au nord.
Dès le 17 octobre, Soult écrivait à Clark : "Nos troupes ont commis des excès. Je suis loin de les excuser ; mon cur en a été navré et j'en ai témoigné mon extrême mécontentement en prenant toutes les mesures de répression qui sont en mon pouvoir ( ) Il est fâcheux de reconnaître que le manque de fourrages a été le prétexte pour la troupe pour s'introduire dans les maisons ; la pénurie que nous éprouvons sous ce rapport est telle que si elle continue il ne sera plus possible de tenir des chevaux en ligne, et le service des subsistances en souffrira beaucoup."
Partout, routes et chemins sont en très mauvais état, et les débordements de rivières gênent les communications, ce qui perturbe le flux des approvisionnements.
Depuis la retraite de la Nivelle, le soldat de l'armée impériale, qui n'était déjà payé qu'avec retard et de manière très irrégulière, ne reçoit plus qu'une demie ration de pain.
La misère et les réquisitions frappent lourdement les populations, très affectées par la guerre. Outre l'entretien des routes et chemins, elles sont requises pour les transports de l'artillerie et du train des équipages, la fourniture de vivres pour les hommes et de fourrage pour les chevaux, ainsi que pour le cantonnement des troupes.
Il n'est pas rare de voir une compagnie ou un escadron arriver, à la tombée de la nuit, dans une maison que ses occupants habituels doivent précipitamment quitter en n'emportant que de maigres bagages et provisions. Leurs logis confisqués, les habitants abandonnent souvent leurs pauvres biens à la rapacité des soldats, et ils en sont réduits à aller chercher un refuge précaire dans les bois ou dans les villes qui, comme Bayonne, sont encombrées de ces malheureux. Le plus souvent, ils ne retrouveront à leur retour qu'une maison saccagée et pillée. Sans illusions, ils savent qu'après le départ des Impériaux il faudra qu'ils assurent le soutien des Alliés.
Des communes rurales, comme Anglet, sortiront ravagées des opérations de l'hiver 1813-1814. La forêt de Blancpignon sera complètement dévastée quand les Alliés investiront Bayonne. Déjà, à la mi-novembre, près de la moitié de la population, chassée de chez elle, s'est réfugiée au Boucau.
Le capitaine Marcel se fait l'écho des relations difficiles que l'armée impériale entretient avec les gens du pays. Replié à Cambo, il note, le 12 novembre 1813 : "Nos soldats ne faisaient nullement attention qu'ils étaient dans un village français ; les habitants s'étaient sauvés à l'approche de l'ennemi et le soldat n'épargna pas plus leurs maisons que celles de l'Espagne que nous venions de quitter. Le temps était froid et pluvieux, j'en conviens, et les hommes avaient absolument besoin de se réchauffer, mais ils auraient dû souffrir plutôt que de faire du mal à leurs compatriotes déjà éprouvés par le fléau de la guerre ; mais les dangers et les privations avaient endurci leurs curs et ni les représentations, ni les menaces des officiers ne purent empêcher la dévastation."
De plus en plus de Français désertent : entre le 1e octobre et le 16 décembre, deux mille neuf cent quatre-vingt-trois hommes, qui ne sont ni prisonniers ni hospitalisés, seront rayés des comptes "pour longue absence".
Évoquant les Basques, et plus particulièrement les jeunes recrues, Soult constate amèrement que "la plupart d'entre eux désertent ( ), aucun département ne compte autant de réfractaires ( ), beaucoup se joignent à des bandes de contrebandiers, de malfaiteurs, ou même d'insurgés espagnols qui ont longtemps commis des excès dans les montagnes".
Le préfet des Basses-Pyrénées a suggéré au maréchal de suspendre la levée de la classe 1815, ou du moins d'incorporer les jeunes recrues dans des unités dites franches de chasseurs ou éclaireurs basques, suggestion qui sera en partie retenue quand Harispe recevra, en janvier 1814, la mission de constituer des unités spéciales chargées de harceler les Alliés.
Soult doit, de toute urgence, remanier son dispositif. En deçà de la Nivelle, la première ligne naturelle d'arrêt est la Nive, rivière plus large et plus difficile à franchir. Le maréchal voudrait profiter du court répit que lui accorde Wellington pour se rétablir sur une ligne allant de Bidart à Habantzen et Ustaritz. Il n'y parvient pas. Les ouvrages de défense n'étant pas terminés, il est une nouvelle fois obligé de reculer et de resserrer ses troupes sur une zone plus étroite, avec sa droite sur les hauteurs situées entre Bidart et Ilbarritz, son centre au niveau d'Arbonne, et sa gauche à Arrauntz.
Le 12 novembre au petit matin, sous le couvert d'un épais brouillard, les Français décrochent discrètement. Quand ils découvrent que la voie est libre, les Alliés reprennent leur progression. Hope pousse jusqu'à Bidart. Beresford s'installe à Ahetze, puis, s'avançant jusqu'aux portes d'Arbonne, il prend position sur la colline Sainte-Barbe. Sur la droite, Hill se heurte aux troupes de Foy qui défendent, avec succès, les ponts de Cambo et d'Ustaritz.
Derrière leur nouvelle ligne d'arrêt, les Impériaux occupent les hauteurs sud d'Anglet, ainsi que celles de Beyris et de Marracq, positions avancées du camp retranché de la route d'Espagne.
Avec deux divisions, Reille s'appuie sur le bas Adour, sur lequel patrouille une flottille de canonnières, entre Bayonne et la Barre. Il renforce le contrôle de la route d'Espagne. Traversant les marais de l'Aritxague, elle peut être inondée entre Lachepaillet et Saint-Amand. Des fortins sont édifiés de part et d'autre de cet axe, jusqu'aux limites d'Anglet.
Tout en se protégeant de possibles débarquements, Reille se tient en outre en mesure d'appuyer Clauzel. Avec ses trois divisions, ce dernier a pris position sur le plateau de Parme, d'où il domine le moulin de Brindos et la maison Bordenave. Vers l'est, il occupe le terrain jusqu'à la Nive, surveillant une zone en partie marécageuse, et même inondée à hauteur du ruisseau d'Urdainz. La division de réserve occupe le plateau de Beyris. Il n'arrête pas de pleuvoir.
Au confluent de la Nive et de l'Adour, le camp retranché de Bayonne constitue une ultime position de défense, la citadelle en formant le dernier réduit. Il est délimité par les ouvrages de la corne de Mousserolles (camp des Prats), du bastion des Mineurs, du front de Marracq, des redoutes des Sapeurs et du Séminaire, de la digue de la route d'Espagne, du fort de Beyris, des redoutes des Grenadiers et de la Pointe. Entre Nive et Adour, le front de Mousserolles est défendu par le corps de Drouet d'Erlon.
Après avoir franchi la Nive à Bayonne, les divisions Darricau, Darmagnac et Abbé sont venues s'établir à Jatxou, Villefranque et Vieux Mouguerre, dont elles occupent les hauteurs. Elles sont renforcées par Foy qui s'est déployé, depuis Halsou, jusqu'aux gués situés en amont de Cambo. À Louhossoa, Pâris garde les débouchés de la vallée de Baïgorry. La cavalerie de Pierre Soult est à Hasparren et Urcuray. Les grands dépôts de l'armée se trouvent à Dax et à Peyrehorade.
Le franchissement de la Nive, le 9 décembre 1813, sera le prélude à la bataille de St Pierre-d'Irube livrée quatre jours plus tard, puis de l'investissement de Bayonne à la fin du mois de février 1814.
Soldats de Napoléon aux Amériques Conférence
Ces soldats de Napoléon aux Amériques sont des combattants de tous grades qui ont servi sous Bonaparte, quand il était Directeur et Premier Consul, d'octobre 1795 à décembre 1804, ou sous Napoléon, Empereur. Réfugiés de Saint-Domingue, certains ont rejoint les Etats-Unis, ou se sont établis autour du golfe du Mexique et dans les Caraïbes, dès le début des années 1800. La plupart d'entre eux n'ont toutefois rallié le continent américain qu'après la chute de l'Empire, en 1815. Ils espéraient libérer l'Empereur, retenu prisonnier à Sainte-Hélène. Surpris par sa mort, en 1821, ils vont s'engager dans la lutte pour l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique et du Brésil. Nombreux seront ceux qui s'établiront dans les pays d'adoption pour lesquels ils se seront battus.
Signature :
Jean-Claude Lorblanchès
Anglet le 18 juin 2013
De la débâcle française de Sedan au désastre espagnol à Cuba - La nation en crise
Les faits
Français et Espagnols ont souffert des inconséquences de leur gouvernement, du manque de préparation de leurs forces armées, de l'incompétence de leur haut commandement militaire, de l'apathie de leurs opinions publiques.
Emile Ollivier, qui présidait le gouvernement de Napoléon III, déclarait le 30 juin 1870 : "Á aucune autre époque le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré." Le 6 juillet, le maréchal Lebuf, ministre de la défense, assurait l'Empereur que l'on pouvait sans crainte se lancer dans la guerre. Face à la Prusse, la France impériale, diplomatiquement isolée, ne pouvait compter sur aucune alliance. C'est pourtant elle qui, le 19 juillet, prenait l'initiative de la déclaration de guerre.
Trois semaines plus tard, le 6 août, l'armée française subissait deux défaites majeures, à Frschwiller et à Forbach. Le 12 août, Napoléon III remettait le commandement en chef de l'armée du Rhin au maréchal Bazaine. Souffrant d'un calcul dans la vessie, très affaibli, n'étant plus que l'ombre de lui-même, ne se sentant pas capable d'exercer ses responsabilités à la tête des armées, l'Empereur venait pratiquement d'abdiquer. Éloigné de Paris, il n'assurait plus le pouvoir civil : l'impératrice Eugénie exerçait en effet la régence.
Le 30 août, censé se porter au secours de Bazaine assiégé dans Metz, Mac-Mahon se laissait stupidement enfermer dans Sedan. Le 1er septembre au matin, les Prussiens attaquaient. Blessé, le général remettait son commandement à un de ses seconds. Celui-ci devait l'abandonner à son tour à un troisième général qui n'était arrivé sur le terrain que la veille. Désorganisées, les unités françaises ne savaient plus à quel saint se vouer. Le 2 septembre, l'Empereur, qui était présent mais n'exerçait pas de commandement, intervenait pour mettre fin au massacre de l'armée. Il se constituait prisonnier. Deux jours plus tard, l'Empire était déchu. La III° République était proclamée à Paris.
Le 19 septembre commençait l'investissement de la capitale. Le 27 octobre, Bazaine capitulait à Metz. Les garnisons de l'est se rendaient les unes après les autres. Gambetta échouait dans ses tentatives d'organiser la résistance en province. Le 26 février 1871, Bismarck et Thiers signaient les préliminaires de paix à Versailles. La France était vaincue. Le 9 juin, l'Alsace-Lorraine était incorporée dans l'Empire allemand.
Mal préparés pour entrer en campagne, les Français manquaient de soldats, de munitions, d'approvisionnements, et d'une artillerie capable de contrer l'artillerie prussienne. Mal organisée, l'armée était mal commandée. Les généraux étaient certes courageux (entre le 4 août et le 2 septembre, seize seront tués, et quarante-cinq blessés). Encore fallait-il qu'ils soient capables. L'objectif politique de la guerre ne leur avait pas été précisé, alors qu'il était parfaitement clair pour Moltke, le commandant en chef prussien.
Á Cuba, l'abolition de l'esclavage, en 1870, n'avait pas mis fin à sa pratique. La colonie comptait un peu plus de deux millions d'habitants, dont près de la moitié étaient des Noirs et des métis. En novembre 1876, une révolte des esclaves avait conduit la métropole à dépêcher dans l'île un corps expéditionnaire de vingt-cinq mille hommes pour rétablir l'ordre. La situation restait confuse. Des Noirs libres, des métis et même des créoles soutenaient la rébellion. Un accord, conclu en 1878, prévoyait une amnistie et l'affranchissement des esclaves. Ne satisfaisant pas les planteurs, il n'avait pas été appliqué. Relancée en 1881 sous forme de guérilla, l'insurrection avait pris une ampleur telle qu'en 1895 l'Espagne avait dû envoyer des troupes supplémentaires.
Comme cela avait été le cas en France en 1870, la finalité politique de l'intervention armée restait floue, imprécise. Ni la reine mère Marie Christine, régente depuis 1885, ni son gouvernement ne donneront d'instructions claires aux commandants en chef qui se succéderont, si ce n'est de mater la rébellion. Cela, les militaires pouvaient le faire : les effectifs des forces armées espagnoles atteindront deux cent mille hommes, soutenus sur place par quatre-vingt mille miliciens. Les insurgés ne seront quant à eux jamais plus de cinquante mille.
Si l'Espagne n'avait pas de politique bien arrêtée concernant l'avenir de Cuba, il n'en était pas de même pour les Américains. Á plusieurs reprises, les États-Unis avaient affiché leurs intentions : en 1848, 1851 et 1856, ils avaient proposé d'acheter l'île. En 1895, face à la recrudescence des troubles, ils avaient signifié qu'ils ne laisseraient pas le désordre s'installer à leur porte. En avril 1896, ils venaient de faire une nouvelle offre d'achat, encore une fois rejetée par Madrid.
Á défaut de recevoir de leur gouvernement des orientations politiques précises, les commandants en chef du corps expéditionnaire espagnol concentreront leur action sur l'éradication de l'insurrection. Trois d'entre eux se succéderont à la tête des troupes en quelques mois. Les deux premiers quitteront l'île sur un constat d'échec. Le troisième mènera une politique de la terre brûlée qui ne fera que renforcer la détermination des rebelles, et incitera les Américains à intervenir directement dans le conflit pour limiter les dégâts.
Ils étaient d'autant plus encouragés à le faire que, en juin 1896, les planteurs s'étaient adressés directement au président Cleveland pour demander aux Américains d'annexer leur île. Les créoles doutaient, de plus en plus, de la détermination de l'Espagne à trouver au conflit une solution qui préserverait leurs intérêts économiques. Ils craignaient que, en cas de victoire, les insurgés ne mènent à bien la redistribution des terres qui faisait partie de leur programme. Ils estimaient que seule une intervention américaine pouvait assurer leur sauvegarde.
L'idée d'une prise en charge du problème cubain par les États-Unis faisait aussi son chemin à Madrid. Deux options étaient couramment envisagées. Soit les Américains intervenaient aux côtés des Espagnols, et ceux-ci n'auraient plus qu'à passer la main. Soit ils soutenaient ouvertement les insurgés, et les Espagnols se replieraient après un simple baroud d'honneur.
Fin 1897, Washington envoie à Madrid un émissaire porteur d'un message comminatoire : "L'armée américaine interviendra dans l'île si l'Espagne n'accepte pas de vendre Cuba aux États-Unis pour la somme de trois cents millions de dollars." La réponse des Espagnols étant une nouvelle fois négative, les Américains envoient un croiseur, le Maine, à la Havane, pour suivre de près l'évolution de la situation. Dans la nuit du 15 février 1898, le navire est détruit par une explosion qui cause la mort de deux cent soixante marins américains. Les Espagnols assurent qu'elle est purement accidentelle.
Réfutant cette explication, les Américains considèrent qu'il s'agit d'un acte délibéré. Le 23 avril, leur demande de réparation revêt la forme d'un véritable ultimatum. C'est la guerre. L'amiral Cervera, commandant de l'escadre des Canaries, reçoit l'ordre de faire route sur Cuba où ne sont stationnés que quelques bâtiments mineurs. Il obtempère, bien qu'il eût préféré attendre une attaque des Américains sur l'Espagne péninsulaire pour les prendre en tenailles avec la flotte de Carthagène. L'amiral connaît trop bien les faiblesses des bâtiments sous ses ordres pour ne pas se faire d'illusions sur les chances de succès de sa mission aux Caraïbes.
L'escadre est nettement surclassée par le nombre, le tonnage et l'armement de la flotte américaine. Non seulement les navires espagnols sont vieux, mais ils souffrent d'un manque d'entretien, de graves déficiences d'approvisionnements, et de défauts rédhibitoires de fonctionnement de leur artillerie. Ils ne font pas le poids face à des bâtiments américains modernes, cuirassés, rapides, dotés d'excellents canons. Cervera rejoint Santiago de Cuba, au sud-ouest de l'île, le 19 mai. Huit jours plus tard, une escadre américaine commence à établir un blocus devant l'embouchure du port. Des troupes sont débarquées pour réaliser l'encerclement terrestre.
Le dimanche 3 juillet, sur ordre du capitaine général Blanco, commandant en chef des forces espagnoles à Cuba, Cervera effectue une sortie pour forcer le blocus. La bataille se déclenche à neuf heures du matin, à l'initiative des Espagnols qui espèrent bénéficier d'un effet de surprise à l'heure habituelle des offices religieux. C'est un massacre, une véritable exécution. En quelques heures, la flotte espagnole est détruite. Trois cent vingt cinq hommes périssent au combat. Quelque mille six cents sont faits prisonniers. Les Américains ne perdent qu'un officier et ne déplorent que neuf blessés.
L'humiliation des Espagnols est à la hauteur de ce bilan. Ils craignaient d'être défaits à terre par des troupes américaines venues soutenir les insurgés. Mais ils ne s'attendaient pas à un tel désastre naval. En une seule journée, ils viennent de perdre la guerre dans des circonstances particulièrement déshonorantes. Le traité de paix qu'ils signent, le 10 décembre 1898, déclare Cuba indépendante. Une indépendance toute relative, car il est précisé que l'île restera occupée par les États-Unis tant qu'elle ne se sera pas dotée d'un gouvernement stable. Le départ des soldats américains, en 1903, sera assorti d'un amendement les autorisant à intervenir dans l'île si leurs intérêts sont menacés. Les Philippines et Porto-Rico deviennent des protectorats américains.
Le désastre du 3 juillet traumatise l'Espagne. La destruction de leur flotte laisse les Espagnols profondément meurtris, désemparés. Comment leur marine, dont ils étaient si fiers, a-t-elle pu être à ce point ridiculisée ? Ils cherchent des responsables. Non pas parmi ceux qui armaient les bâtiments : ils n'ont pas démérité. Mais sont mis en cause, sont accusés ceux qui étaient chargés de la mise sur pied et de l'entretien de la flotte, et ceux qui, tout en connaissant ses faiblesses, ont décidé de son engagement.
Construits en bois, mus par d'antiques machines à vapeur, par ailleurs chichement dotées en combustible, les navires espagnols n'avaient qu'une artillerie rudimentaire. Les Américains disposaient quant à eux de puissants bâtiments cuirassés, armés de canons de forts calibres et à longue portée.
Près de la moitié des deux cent mille hommes du corps expéditionnaire sont morts, la majeure partie d'entre eux en dehors des combats : dysenterie, malaria, fièvre jaune ont décimé les unités. Les soldats n'étaient pas entraînés pour ce type de conflit. Ils ont dû affronter un ennemi insaisissable qu'on ne leur avait pas appris à combattre. Leur armement, leurs équipements n'étaient pas adaptés à la mission qu'ils avaient reçue. L'intendance fonctionnait mal. Le service de santé était déficient.
Les Espagnols ont le sentiment d'avoir été trompés. Les militaires reprochent aux politiques de les avoir entraînés dans une aventure coloniale mal conçue, mal préparée, sans leur donner les directives et les moyens de remplir correctement leur mission. Ils s'estiment trahis par des décideurs politiques incompétents, voire irresponsables. Dans ces circonstances difficiles, l'Espagne s'est trouvée isolée sur le plan diplomatique. Comme la France l'avait été en 1870.
Les réactions
En Espagne, comme cela avait été le cas en France, le choc psychologique a été considérable. Désastre pour l'une, débâcle pour l'autre, la défaite militaire et ses conséquences politiques ont été mortifiantes. Les Français ont perdu l'Alsace-Lorraine. Les Espagnols ont dû abandonner ce qui leur restait de l'empire colonial que depuis cinq siècles ils avaient édifié aux Amériques.
Les Français vont se mobiliser en tant que nation dans un dessein de "revanche". Gambetta a tracé la voie lors de l'enterrement du maire de Strasbourg, au printemps 1871 : "Il faut que les républicains s'unissent étroitement dans la pensée d'une revanche qui sera la protestation du droit et de la justice contre la force et l'infamie."
Ce sera le leitmotiv d'un nationalisme à la française, jacobin, cocardier. Il s'agira de renforcer la cohésion nationale, et de se doter de moyens capables d'affronter la redoutable armée prussienne pour reconquérir, le moment venu, l'Alsace et la Lorraine. Cette idée de "revanche" ne revêt pas seulement un caractère guerrier : elle manifeste l'ambition de retrouver la position prééminente qu'avait la France en Europe et dans le monde.
Pour les Français, l'exaltation du sentiment patriotique repose sur le concept d'un État-nation. Le partage d'intérêts et d'idéaux communs exige une grande cohésion. Il faut donc, en premier lieu, renforcer l'unité nationale. Intellectuels, romanciers et poètes vont spontanément concourir à cet effort. L'école et l'armée joueront, quant à elles, un rôle essentiel dans le façonnement du sentiment national.
Les Espagnols vont réagir de manière différente. Recherchant dans l'approfondissement des cultures populaires et l'exaltation des particularismes régionaux les fondements de leur génie national, ils vont tolérer, et même favoriser l'émergence de nationalismes séparatistes.
La République française est une, indivisible. Centralisatrice, elle ne peut pas tolérer les singularités régionales. Le français sera imposé comme seule langue de communication. Á l'école, il sera interdit d'utiliser les langues et dialectes locaux. Paris, capitale, sera le centre de toutes les activités du pays. Se tournant résolument vers l'extérieur, la France aura retrouvé, à l'aube du XX° siècle, une place éminente en Europe. Son rayonnement s'étendra sur le monde entier, et elle se sera résolument lancée dans l'aventure coloniale. L'Espagne va au contraire se replier sur elle-même. Coupée du monde, elle restera en marge de l'Europe, et elle renoncera à toute ambition coloniale.
Au lendemain du désastre de 1898, il n'y a chez les Espagnols ni esprit de revanche ni haine à l'égard du vainqueur. Seulement une grande tristesse, une profonde amertume. Mais aussi la volonté de surmonter l'épreuve, et le désir de retrouver l'esprit d'entreprendre de l'époque des conquêtes. Le constat que dressent " ceux de 98 ", mouvance d'écrivains et d'universitaires qui se proposent de régénérer l'Espagne, est terrible : corruption généralisée, immoralité des classes dirigeantes, rôle débilitant de l'Église, faiblesse endémique de l'armée, dégradation des murs, analphabétisme. L'Espagne n'est plus qu'un pays de second ordre, et elle est diplomatiquement isolée.
En 1871, la France s'est, elle aussi, trouvée isolée en Europe. Mais elle n'a pas renoncé à sa position de grande puissance. Si elle a subi un revers, celui-ci est resté d'ordre militaire. Son drame a été l'amputation territoriale qu'elle a dû consentir. Mais ce sera aussi sa force, car l'idée de revanche assurera le support idéologique de son redressement. Elle va connaître des moments difficiles, et l'affermissement de la République prendra du temps. Mais il s'effectuera dans l'unité, dans la cohésion nationale.
Héritière d'un passé historique complexe, marqué par des alternances de confrontations et de cohabitations entre des entités politiques aux caractères fortement affirmés, l'Espagne va suivre une voie différente. Recherchant dans la célébration des particularismes des provinces qui la composent les ressources d'un renouveau politique, elle va réveiller des nationalismes qui, à terme, menaceront sa pérennité en tant qu'État.
La "régénération" qu'elle entreprend de réaliser est ambitieuse dans la mesure où elle concerne l'ensemble des domaines dans lesquels elle a accumulé les retards depuis plus d'un siècle, qu'ils soient d'ordre politique, économique, social, culturel, diplomatique... Sous l'impulsion de "ceux de 98", les Espagnols vont rechercher en eux-mêmes les moyens de sortir du marasme qui est, selon eux, la cause première du désastre de Cuba. Ce repli généralisé, cette espèce d'introspection collective, sera une façon d'aborder le problème d'un renouveau politique sans équivalent en France. Cela débouchera sur le régionalisme, présenté comme étant la véritable réalité de l'Espagne, le fondement même de son unité. Le pays traversera une profonde crise de conscience nationale, les partisans de la Régénération s'avouant incapables de définir l'essence d'une nation espagnole.
Les Espagnols rejoindront les Français dans la quête quasiment obsédante de ce qu'est la nation. Pour tous, c'est certes une langue et une culture propres, une forte cohésion sociale, une conscience collective marquée. Pour les Français, ces caractéristiques seront celles de la France éternelle, qu'elle soit un royaume, un empire ou une république. Il n'en sera pas de même pour les Espagnols.
En Espagne, après 1898, il n'y a pas eu la réaction nationaliste qu'a connue la France au lendemain de la débâcle de Sedan. Le sursaut patriotique n'a pas été de même nature. Dans l'adversité, les Espagnols n'ont pas manifesté la même cohésion que les Français. Sabino Arana Goiri, chantre de la nation basque, fondateur du Parti Nationaliste Basque, a été un des tous premiers responsables politiques étrangers à adresser au Président des États-Unis un télégramme de félicitations.
En 1870, la France est un État-nation. En 1898, l'Espagne n'est qu'un État regroupant un certain nombre de régions. En quelque sorte, une "nation de nations". Les descendants d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon ont administré, avec plus ou moins de difficultés et de succès, un État espagnol dont l'unité se maintenait vaille que vaille à la fin du XIX° siècle. Les "régénérationistes de 98" ont ouvert la boîte de Pandore des séparatismes, remettant en question l'unité nationale du pays.
Les vocables de particularisme, régionalisme, séparatisme, nationalisme vont progressivement apparaître en Espagne pour définir des situations politiques qui seront la concrétisation de mouvements initiés dans les années de l'immédiat après-1898. En France, on ne retiendra que ceux de particularisme et de régionalisme, le premier s'apparentant à une forme de folklore, le second devant déboucher, dans le courant des années 1970, sur une réforme de l'État ne touchant pas à l'intégrité de la Nation.
En Espagne, les premiers mouvements politiques ouvertement nationalistes se manifesteront d'abord en Catalogne, puis au Pays Basque, et un peu plus tard en Galice. Ces trois provinces sont des communautés humaines que leur dimension géographique, leur cohésion sociale et leur passé historique peuvent qualifier pour exister en tant que nation. C'est à ce titre qu'elles s'arrogeront le droit de revendiquer le plein exercice de leur souveraineté, ou du moins qu'elles réclameront que leur soit reconnue une autonomie complète à l'intérieur de l'État espagnol.
Les zélateurs de "98" n'ont pas été les premiers à poser le problème de l'identité nationale espagnole. Mais les idées qu'ils ont émises ont provoqué des remises en question, voire esquissé des solutions pour tenter de résoudre la question lancinante de l'unité de l'État dans le respect des particularismes. Une quête qui, chez les Espagnols, prend parfois l'allure d'un questionnement métaphysique. Entre 1979 et 1983, dix-sept communautés autonomes seront constituées. Survenue quelque quatre-vingt ans après le désastre de Cuba, la création des autonomies n'a toutefois pas mis fin au problème des nationalismes.
Après 1870, la France sera, elle aussi, confrontée à des tendances centrifuges, voire à des dérives ethniques. Mais le régionalisme à la française n'aura pas la virulence du séparatisme à l'espagnole. Recherchant le support des langues régionales, il se cantonnera dans la sphère culturelle, n'empiétant que rarement dans le domaine politique. La création des régions répondra à une nécessité de découpage administratif conçu comme une responsabilité d'État, et non pas à des revendications politiques séparatistes.
La débâcle de Sedan a donné naissance à la III° République. S'appliquant à tous dans la plus parfaite égalité, la loi républicaine condamne tout privilège et tout particularisme : elle récuse l'existence de frontières internes et ne reconnaît qu'une seule nation. Á la différence de l'Espagne hésitante sur la conduite à tenir, la France a agi avec un volontarisme d'une redoutable efficacité, mais prenant parfois l'allure d'un autoritarisme excessif.
L'école a joué un rôle essentiel dans le façonnement et la consolidation de l'identité nationale. En imposant l'usage du français, à l'exclusion de toute autre langue, elle a renforcé la cohésion nationale. En enseignant l'histoire comme une mythologie, elle a développé le patriotisme. Un élément déterminant dans la construction de l'identité nationale sera, en 1889, l'établissement du service militaire obligatoire. S'affranchissant des barrières sociales et des préjugés ethniques, il va concourir au rapprochement de jeunes hommes issus d'horizons différents, favoriser la mixité des cultures régionales et forger un esprit patriotique commun.
En conclusion
En septembre 1914, sur la Marne, la France évitera de justesse une nouvelle débâcle. Celle de 1940 sera encore plus tragique que celle de 1870. Mais l'unité nationale sera chaque fois préservée, et la nation française trouvera en elle-même la capacité de rebondir.
L'Espagne oscillera entre libéralisme et conservatisme. Elle sera royaliste, républicaine, anarchiste, fasciste. Elle subira une abominable guerre civile. L'État espagnol survivra toutefois à toutes ces péripéties.
La France est une, l'Espagne est multiple. Leur héritage historique est foncièrement différent. Il serait vain de vouloir déterminer lequel des deux pays a choisi la meilleure voie pour assurer sa pérennité.
Sans doute serait-il plus intéressant de chercher à évaluer l'impact qu'a pu avoir, au lendemain des crises de 1870 et de 1898, l'essor des nationalismes séparatistes espagnols sur les populations basques et catalanes françaises. Cela dépasse le cadre de ce bref exposé.
Colloque "Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique".
Société des Sciences Lettres et Arts, Bayonne, novembre 2011
Le faux pas espagnol de Napoléon
Signature :
Jean-Claude Lorblanchès
Napoléon et Bayonne
Université du Temps Libre d'Anglet
Signature :
Jean-Claude Lorblanchès
Femmes dans la guerre d'Espagne (1807-1814)
Section Côte Basque de la Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur.
Napoléon à Bayonne
Signature :
Jean-Claude Lorblanchès
Les soldats de Napoléon en Espagne et au Portugal
Ces soldats n'étaient pas des saints. Ce n'était pas non plus des brutes sanguinaires. Seulement des hommes ordinaires, précipités, bien malgré eux, dans des situations extraordinaires. Prématurément mûris par les souffrances physiques et morales qu'ils ont dû surmonter, ils ont eu des comportements parfois déconcertants. Vivant comme des mécréants, ils pouvaient être d'une crédulité étonnante. Messagers de la Révolution, ils restaient conservateurs dans l'âme. Inépuisables marcheurs, ils auraient été volontiers casaniers. Épris de gloire, ils étaient conscients de la vanité des honneurs.
Inébranlables au combat, d'une solidarité sans faille envers leurs camarades, ils ont fait preuve, dans l'adversité, d'un loyalisme exemplaire. Leurs chefs ont été honorés : les maréchaux n'ont-ils pas leurs boulevards ? Les combattants de 14-18, ceux de 39-45, ont leurs monuments. Pour les soldats d'Espagne, il n'y a rien. Ce sont des oubliés de l'histoire.
Pendant près de sept ans, ces soldats ont vécu des expériences hors du commun. Tellement invraisemblables, qu'elles sont difficiles à imaginer. De retour dans leurs foyers, les survivants se sont parfois murés dans un silence qui en disait long sur les épreuves qu'ils venaient de subir. Ressassant leurs souvenirs, nombreux sont toutefois ceux qui ont cherché à entretenir l'exaltation qu'ils avaient connue sous les armes. Certains ont rédigé leurs mémoires.
Quel crédit peut-on accorder à ces témoignages ? Faisant la part belle aux anecdotes, ils doivent être considérés avec précaution, car les faits qu'ils rapportent sont souvent enjolivés. Ce n'est pas une raison pour se laisser aller à un scepticisme systématique : en les confrontant entre eux, on peut juger de leur véracité. Ces témoignages sont des compléments précieux aux documents d'archives. La touche humaine qu'ils apportent permet de mieux appréhender ce qu'a été le quotidien du soldat en campagne.
Un milieu hostile
Heurtés, d'emblée, par la pléthore du clergé et la richesse des établissements religieux, les Français se méprennent sur la profondeur et la qualité des liens qui unissent les ecclésiastiques au peuple, dont ils sont issus, et dont ils partagent les misères autant que les passions.
Les hommes d'église prêchent la haine de Napoléon. N'incarne-t-il pas la Révolution ? N'est-il pas cet Antéchrist qui a chassé les moines de leurs monastères, obligé les prêtres à apostasier, profané les lieux de culte, proscrit la religion ? Confondant le nationalisme et le religieux, la doctrine qu'ils propagent n'est pas sans rappeler l'âpreté de la croisade contre les Maures.
Partout présents, les prêtres enflamment les fidèles par leurs prêches dirigés contre l'envahisseur hérétique. Bannis de leurs couvents, les moines se font les porte-parole et les messagers de la résistance. Renseignant sans vergogne les bandes de guérilla, ils en prennent parfois le commandement.
Parfaitement intégrés à la population, sur laquelle ils exercent un contrôle sans failles, "confondant la cause du Christ avec celle des Bourbons", les membres du clergé seront les principaux adversaires des Français. Ennemis parfaitement identifiés, ils seront honnis et combattus sans pitié.
De leur côté, les soldats choquent les âmes pieuses par l'étalage de leur incrédulité, de leur impiété. Se moquant des cérémonies religieuses, ils les parodient de manière bouffonne. Sur l'air des cantiques, ils adaptent des chansons grivoises. Pour eux, ce n'est que de la provocation. Pour les populations, c'est une offense impardonnable, un blasphème inexpiable.
Sec, la mine patibulaire, le regard sombre, impénétrable, l'Espagnol surprend les Français par son attitude hiératique et figée. Triste et taciturne, il leur semble fier, méprisant, imbu de sa personne, convaincu de la justesse de la cause qu'il défend, prêt à tout sacrifier pour elle. Pour les soldats impériaux, c'est un militant, qui, sous une apparente indifférence, est un exalté et un fanatique auquel on ne peut accorder aucune confiance.
Assumant les tâches les plus ingrates, les femmes du peuple leur semblent reléguées à un rôle purement utilitaire. Ils apprendront à ne pas trop se fier à ces apparences d'humilité et de servilité, car elles joueront un rôle important dans la guérilla.
Les paysages sont rudes, les écarts de température surprenants, les conditions de vie épouvantables. Le climat est sec, mais la façade océanique est très humide. Partout, de violents orages peuvent provoquer des inondations catastrophiques. Dans l'intérieur, la chaleur est étouffante en été, mais les hivers peuvent être extrêmement rigoureux. Dense dans les zones humides, la végétation est clairsemée, voire inexistante, sur les vastes étendues arides des plateaux centraux. L'Espagne est le pays des extrêmes : "Neuf mois d'hiver, trois mois d'enfer".
C'est dans le cadre sévère, étrangement sauvage, de la meseta centrale, que se dérouleront les principales batailles. Les défilés, qui en défendent l'accès, sont creusés dans les escarpements dominant les dépressions. Passages obligés, ils seront de véritables pièges pour les convois logistiques et les petits détachements de l'armée impériale.
Les zones les plus difficiles d'accès serviront de sanctuaires. Après chacune de leurs défaites, les armées espagnoles viendront s'y reconstituer. Elles offriront à la guérilla des bases arrières sûres et protégées, à partir desquelles les bandes pourront, avec une grande impunité, exécuter des coups de main sur les voies de communication.
Isolés, bâtis en pisé, poussiéreux, crayeux, les villages "ressemblent à des ruines de terre". De couleur jaunâtre, on les remarque à peine, car ils s'intègrent au terrain, uniforme, nu, faiblement vallonné. Seules les tours carrées des églises signalent leur présence, des églises qui ressemblent plus à des forteresses qu'à des sanctuaires, avec leurs murs épais, percés d'étroites meurtrières, et leurs contreforts massifs. Dans les rues étroites, au tracé souvent capricieux, dans les maisons à l'agencement compliqué, les partisans trouveront des refuges plus confortables que ceux des sierras.
Recrues et vétérans
Pour combler ses pertes et se renforcer, la Grande Armée a dû, dès l'été 1807, faire appel à des contingents de plus en plus importants de soldats d'origine étrangère. En novembre 1808, quarante-sept mille d'entre eux servent déjà dans la Péninsule. Originaires de pays conquis, alliés ou vassaux de la France, ils appartiennent à une quinzaine de nations. Il y a de tout parmi eux, et le pire y côtoie le meilleur.
Deux divisions italiennes, une division polonaise, et une division allemande, constituent le gros des effectifs. Le royaume de Westphalie est représenté par un régiment de chevau-légers, et la principauté de Berg par un escadron. Un bataillon irlandais se distinguera dans l'armée du Portugal.
Les Suisses sont des mercenaires, qui ont été recrutés par l'Espagne. Leur contrat stipulant qu'ils ne peuvent pas se battre entre eux, presque tous rallieront l'armée de la Junte.
Grenadiers et cavaliers polonais ont une terrible réputation de courage, mais leurs débordements ne sont pas moins célèbres. D'un dévouement exemplaire à la France au cours des campagnes menées en Europe du nord, ils déserteront en grand nombre en Espagne, préférant rejoindre les rangs de l'armée anglaise, dont la solde et les conditions de vie leur paraissent plus intéressantes. Peu motivés, les chasseurs hanovriens seront, eux aussi, nombreux à déserter.
Devenus Français par annexion, Piémontais, Belges et Toscans forment sept régiments.
Communiquer pose des problèmes au sein d'une armée dans laquelle tant de langues et de dialectes sont parlés. Langue de travail, le français s'impose comme langue de communication européenne.
Fin 1807, les premières unités qui franchissent la Bidassoa sont en majorité composées de jeunes recrues. Hâtivement recrutés, sous-équipés, mal instruits, ces conscrits n'ont été ni préparés aux combats qu'ils vont livrer, ni entraînés au rythme de marche démentiel qui leur est imposé. Sans vêtements chauds, ils manquent de chaussures. Presque tous souffrent de la gale.
Au-delà de Salamanque, les fantassins, qui n'ont ni linge ni vêtements de rechange, et dont les chaussures ont trop souvent été aspirées dans des torrents de boue, commencent à marcher à la débandade. Retardés par l'état des chemins sur lesquels leurs chariots ne cessent de s'embourber, les artilleurs arrivent toujours en retard aux bivouacs où ils ne trouvent plus rien. Les soldats commencent à se servir sur les habitants. Exaspérés par les pillages à répétition, ceux-ci s'en prennent à leur tour aux traînards, qu'ils assassinent sauvagement.
Au Portugal, c'est encore pire. Junot écrit à sa femme : "Une fois dans l'Estrémadure portugaise, tous les habitants que l'on rencontrait étaient autant d'ennemis. En Espagne, on pouvait au moins espérer une neutralité passive, mais en Portugal, chaque regard cherchait une victime et chaque parole était une trahison. Sans cesse les guides étaient surpris conduisant par de mauvaises routes. Chaque paysan devenait un assassin égorgeant son hôte dans le sommeil."
Á l'occasion de cette folle équipée, Espagnols et Portugais découvrent, avec étonnement, des soldats d'une apparence souvent pitoyable. Est-ce là cette Grande Armée qui, d'Austerlitz à Friedland, vient d'étriller, de manière insolente, tous les appareils militaires de l'Europe continentale ? Durant l'été 1808, la capitulation de Dupont, à Bailén, puis celle de Junot, à Cintra, vont étayer cette première impression : l'armée impériale n'est plus invincible.
C'est un leurre, car, quelques mois plus tard, les corps d'armée qui déferlent sur la Péninsule dans le sillage de Napoléon, ont une tout autre allure. Venus restaurer une situation militaire fortement compromise, ils sont formés de vétérans qui viennent de s'illustrer sur les champs de bataille d'Allemagne, d'Autriche, de Prusse et de Pologne.
Ce ne sont plus de jeunes recrues imberbes. Portant les cheveux longs, liés en queue de cheval par un ruban noir, avec une tresse de chaque côté du visage, pour protéger cou et oreilles des coups de sabre, ces vétérans arborent de longs favoris, taillés "en crosse de pistolet", et d'énormes moustaches "à la gauloise". Conscients de leur force, se croyant invulnérables, les "grognards" n'ont peur de rien. Qui oserait leur résister ?
La bataille
Sans être totalement stéréotypées, les trente-huit batailles majeures, que les Impériaux vont livrer, se dérouleront de manière similaire. Il suffit d'évoquer la première d'entre elles, Medina de Rioseco, pour donner une idée des procédés tactiques mis en uvre.
Le 14 juillet 1808 au petit matin, le maréchal Bessières a disposé son corps d'armée en avant de Palacios de Campos. Une division d'infanterie s'est déployée sur chacune des ailes. Il se tient lui-même au centre, avec la cavalerie et la réserve. Á sept heures du matin, renseigné sur le dispositif adverse par des reconnaissances de cavalerie, il lance ses premières colonnes de fantassins à l'assaut des lignes espagnoles. Les grenadiers et fusiliers progressent sous le couvert des nuages de poussière que soulèvent les cavaliers de l'avant-garde sur le sol crayeux et sec.
Deux heures plus tard, l'artillerie prend position sur un mamelon qui vient d'être conquis de vive force. Les batteries de huit pièces se mettent en place dans le tohu-bohu des ordres hurlés, des chevaux hennissant, des cadavres piétinés, des blessés à l'abandon, des aides de camp caracolant d'une autorité à l'autre, tout cela dans une confusion apparente, mais avec la redoutable efficacité d'une mécanique bien huilée.
Les canons de six pouces commencent par tirer des boulets pleins sur les Espagnols. Après avoir été culbutés sans ménagement, ces derniers tentent de reformer les rangs. La portée des projectiles n'excède pas douze cents mètres, mais ils ne sont guère efficaces au-delà de six cents mètres. C'est à cette distance que les artilleurs des deux camps se livrent un combat de duel. Les batteries cherchent à se neutraliser mutuellement, et les premiers dégâts que causent les boulets sont parmi les artilleurs.
Que ce soit en tir direct ou en ricochant, les boulets font mouche dans le fatras des pièces, des munitions entassées auprès d'elles, des caissons d'approvisionnement, des soldats qui s'affairent, des chevaux affolés. Le bruit est infernal, la visibilité incertaine.
Les boulets pleins, qui sont de la grosseur d'une boule de pétanque pour une pièce de quatre, arrachent les membres, perforent les troncs des hommes et ceux des chevaux. Les ricochets, aux parcours incertains, multiplient les risques. Faisant des écarts désordonnés pour tenter de les éviter, les chevaux ajoutent à la confusion.
Les bouches à feu dégagent d'épaisses volutes d'une fumée noire et âcre. S'élevant au-dessus des emplacements de batteries, dispersée par le vent, cette fumée se répand sur tout le champ de bataille. Avec la poussière, que les projectiles soulèvent en heurtant le sol sec et friable, et celle que provoque le piétinement de milliers de chevaux, elle forme des nuages qui occultent les évolutions des troupes.
Profitant de ce couvert, fantassins et cavaliers cherchent à se positionner pour prendre sur l'adversaire l'avantage qui décidera du sort du corps à corps final. Car c'est au contact que se fera la décision. Et ce contact sera celui des armes blanches : baïonnettes des fantassins, sabres et lances des cavaliers.
Les lances, qui équipent les chasseurs et les hussards de la cavalerie légère, sont redoutables, bien que difficiles à manier. Elles piquent et coupent en même temps. Leur puissance est décuplée par la force d'inertie du cavalier dressé sur son cheval au galop. Les blessures qu'elles provoquent sont profondes, souvent mortelles.
La baïonnette des fantassins ne fait que piquer, mais elle est d'un maniement plus facile, et donc d'une plus grande précision. Si la victime du coup n'est pas touchée en un point vital, elle a plus de chances de survivre que si elle reçoit un coup de lance.
Le sabre des dragons et des cuirassiers peut piquer lui aussi, mais les cavaliers ont appris à le manier pour couper, fendre les visages, faire éclater les têtes, démembrer, ouvrir les poitrines, éventrer Droit ou incurvé, il est assez court, ce qui oblige le sabreur à se pencher et à se découvrir pour porter son coup.
Formés en rectangles, les dragons s'avancent vers l'ennemi à faible allure, chevaux serrés flanc contre flanc, cavaliers parfaitement droits, bien alignés, imperturbables, totalement concentrés sur ce qu'ils font.
Les automatismes acquis à l'instruction subliment l'exaltation extraordinaire qui les saisit : la charge est, pour le cavalier, sa raison d'être ; elle excite son imaginaire, comme le fait l'assaut en ligne pour le fantassin. Rien ne saurait arrêter cet impétueux mouvement vers l'avant, cette furia française qui transporte les cavaliers ! Rien, si ce n'est un carré d'infanterie.
Il est midi quand les lignes espagnoles commencent à céder. Le général Cuesta a beau payer de sa personne, allant jusqu'à se jeter dans la mêlée en brandissant l'étendard de l'un de ses régiments, rien ne peut plus endiguer le mouvement de panique qui submerge ses rangs.
En début d'après-midi, il fait très chaud, l'eau manque, les troupes sont épuisées, les chevaux meurent par dizaines. La poursuite de l'ennemi s'avère démentielle. Le contact est vite rompu. Les vainqueurs se répandent alors dans la ville. Incendiant des maisons, profanant les églises, brutalisant la population, il la mettent à sac.
L'assaut d'une place forte est généralement la phase ultime d'un siège. Le combat est d'une autre nature. Quand, le 17 octobre 1811, les troupes de Suchet donnent l'assaut à la forteresse de Sagunto : "La brèche fut aussitôt couverte d'hommes exaltés par l'enthousiasme et par la fureur. Ils répondaient par des coups de fusil à chaque coup de canon, replaçaient les sacs à terre renversés et par une obstination inouïe, pendant cinq ou six heures sans relâche, debout sur le rempart, sous le feu non interrompu de quatre pièces de 24 battant de plein fouet, ils se succédaient à l'envi, remplaçaient les morts, réparaient avec ardeur les effets du boulet et poussant de grands cris, nous provoquaient à monter jusqu'à eux pour combattre de plus près."
Le siège de Saragosse aura été le plus terrible de cette guerre. Les Espagnols renforcent les défenses, non seulement du mur d'enceinte, des bastions et des redoutes, mais aussi des rues, des venelles et des maisons. Chaussés d'espadrilles, ils se déplacent sans faire de bruit. La plupart des maisons étant en briques et à plusieurs niveaux, ils démolissent les escaliers, et les remplacent par des échelles qu'ils retirent quand les Français se présentent. Du haut des étages, ils ouvrent le feu, et, par des trous ouverts dans les planchers, ils lancent toutes sortes de projectiles sur les agresseurs. Ayant recouvert les murs d'un mélange de résine et de goudron, ils les enflamment avec des fagots. La combustion est lente, le feu ne peut pas être éteint, et la fumée dégagée est particulièrement âcre et épaisse.
À peine les Français se sont-ils enfoncés dans le labyrinthe des rues étroites qu'ils sont assaillis de toutes parts par des Espagnols en furie. On les fusille depuis les fenêtres, les balcons, les toits des maisons. On les égorge dans les patios et les courettes : "C'était comme un volcan par les explosions continuelles qui avaient lieu. On entendait les cris des vainqueurs et des vaincus ; ici la victoire, là le désordre et la fuite ; amis et ennemis combattaient tous pêle-mêle et sans ordre. Chacun se défendait là où il était attaqué et attaquait là où il rencontrait l'ennemi ; le hasard seul présidait à ce chaos. Les rues étaient jonchées de cadavres ; les cris que l'on entendait du milieu des flammes et de la fumée ajoutaient encore à l'horreur de cette scène de désolation et le tocsin, qui sonnait de toutes parts, semblait annoncer l'agonie de Saragosse."
Les damnés de la guerre
Chaque régiment dispose d'un caisson d'ambulance à quatre chevaux, qui peut transporter six blessés. Malheur toutefois à ces derniers ! Dès qu'ils sont trop nombreux, ils ont peu d'espoir d'être évacués. Mieux vaudrait qu'ils aient été tués, car le sursis qui leur est accordé n'est qu'une période d'intenses souffrances, avec, de toute façon, la mort au bout. Abandonnés sur le champ de bataille, souffrant atrocement de la soif, ils mettent parfois plusieurs jours à mourir.
Parmi ceux qui ont la chance d'être secourus, les plus gravement atteints surmontent rarement les épreuves qui les attendent, la moins terrible étant l'amputation, qui, seule, a des chances de les sauver de la gangrène. Les conditions d'hygiène sont détestables, et le savoir faire des chirurgiens limité.
Dans les hôpitaux, il n'y a pas d'infirmiers français, et les Espagnols massacrent blessés et malades dès que l'occasion se présente. Quand les troupes se replient, ils sont souvent abandonnés, soit parce qu'ils sont intransportables, soit parce qu'il n'y a pas assez de fourgons pour les transporter. Ceux-là sont promis à une mort certaine. Quand Joseph s'enfuit de Madrid, il laisse deux mille quatre cents blessés et malades dans les hôpitaux. On n'a pas pu les emmener, mais on a trouvé les moyens pour transporter le produit des rapines, ainsi que de belles Castillanes.
Être fait prisonnier n'est guère plus enviable. S'il est capturé par la guérilla, le soldat a peu de chance d'échapper à la mort, non sans avoir préalablement subi les pires tortures. S'il tombe entre les mains d'une armée espagnole, il aura peut-être la vie sauve, mais il devra subir brimades et vexations, avant de terminer dans d'infectes géôles. S'il est prisonnier des Anglais, il sera relégué sur les effroyables pontons de Portsmouth. S'il est blessé, il a peu de chance d'être soigné, mais la quasi certitude de mourir de faim et d'inanition.
Plus de dix mille prisonniers français seront confinés aux Baléares, sur l'ilôt espagnol de Cabrera, survivant en se nourrissant de soupes d'orties, de racines, de feuilles de trèfle et de chardons, allant même, parfois, jusqu'à s'entre-dévorer. En 1814, on ne retrouva que quelque trois mille six cents survivants, dont quelques dizaines de femmes, réduits à l'état sauvage, entièrement nus et squelettiques. Durant quatre ans, ils ont dû supporter les pires vicissitudes. Un tiers des quarante mille prisonniers internés en Angleterre ne reverront pas la France.
Une guérilla omniprésente
Tout est hostile au soldat dès qu'il sort de son cantonnement, dès qu'il quitte son bivouac, dès qu'il s'écarte de la grande unité à laquelle il appartient. Le danger vient de partout. Non seulement du terrain et des hommes, mais aussi de la nourriture, à laquelle il ne parvient pas à s'habituer ; du vin, fort et corsé, qui le rend fou ; de l'eau, de mauvaise qualité ; des poux, qui transmettent le typhus ; des moustiques, vecteurs du paludisme ; de la fièvre jaune, qui réapparaît fin 1810...
Mais le plus grand danger, c'est le guérillero. Ce n'est pas la bataille avec un grand "B" qui est le quotidien du soldat, mais la guérilla, cette "petite guerre" dont les tactiques se révèlent sournoises, déconcertantes. Ce n'est plus une lutte à la loyale dans laquelle le plus fort prend l'avantage. Il s'agit moins d'être malin que fourbe pour gagner, moins de savoir se battre que de savoir surprendre. Agissant de manière le plus souvent impulsive, les chefs de bande ont rarement de véritables plans d'action. Ils improvisent.
La guérilla use les soldats impériaux, les démoralise, alors qu'elle-même se régénère des succès qu'elle obtient. Les chefs de l'armée, qui la méprise au lieu d'essayer de comprendre ses procédés pour mieux les contrer, se révèlent incapables de la réduire.
Peuple guerrier dont les ancêtres ibères passaient déjà, à l'époque romaine, pour les plus belliqueux des barbares, les Espagnols utilisent, d'instinct, la guérilla pour lutter contre l'invasion et l'ingérence étrangères. Cette petite guerre leur convient parfaitement. S'accommodant des occupations habituelles des partisans, notamment des paysans qui peuvent continuer à cultiver leurs champs, elle leur épargne la rigueur de la discipline de l'armée régulière, dont la hiérarchie est peu estimée.
Les guérilleros ne sont pas tous des hidalgos. On trouve dans leurs rangs de faux mendiants, dont les hordes avaient l'habitude d'assiéger les cloîtres ; des muletiers, authentiques héros de romans picaresques ; des contrebandiers réduits au chômage par la guerre et le blocus ; des bandits de grand chemin, qui, autrefois, menaçaient le voyageur l'escopette à la main. Déserteurs et repris de justice pillent allégrement pour leur compte. Certains se forgeront une renommée par les atrocités auxquelles ils se livreront, aussi bien sur la population que sur les occupants.
L'objectif de la guérilla est de gêner les déplacements des unités impériales, de perturber leurs approvisionnements, de saper leur moral. S'emparant des isolés, des blessés et des malades, les guérilleros les torturent. Non seulement pour obtenir des renseignements, mais aussi et surtout pour les faire souffrir le plus possible, avant de les mettre à mort. Ils détruisent les dépôts de vivres. Ils attaquent les postes et détachements isolés. Ils harcèlent les lignes de communication. Ils interceptent les courriers. Leurs coups sont exécutés en souplesse, par surprise, du fort au faible, sans faire de quartiers : la guérilla ne capture pas de prisonniers, sauf parfois des femmes, qui sont nombreuses dans le sillage des armées napoléoniennes.
Pillages et cruautés
Les exactions de la guérilla entraînent des ripostes musclées de l'armée impériale. Cet enchaînement de l'action et de la répression ne fait qu'accroître la xénophobie des populations. Le combat change d'âme. À l'origine de toute la cruauté, de toute la sauvagerie de cette guerre barbare, il y a l'attitude impitoyable de la guérilla. Mais le comportement des troupes impériales y concourt aussi.
Des guerres révolutionnaires à celles de l'Empire, les soldats ont appris le chapardage. Il est bien toléré par les grands chefs, qui y participent à leur manière, et même par l'Empereur, pour qui "la guerre doit nourrir la guerre". Le soldat ne se contente pas de vider les caves. Il se sert en vivres. Il ouvre les coffres et les armoires. Il brise le mobilier, les portes et les fenêtres, pour alimenter les feux de bivouac.
La bataille terminée, que ce soit dans l'euphorie de la victoire, ou dans la douleur de la défaite, il met un certain temps à surmonter l'extraordinaire excitation du combat. Tout lui paraît possible ; tout lui semble permis. Ses repères moraux s'estompent. Livré à ses pires instincts, il se comporte comme une bête. La population subit ces débordements qu'elle ne comprend pas.
"La prise de Cordoue n'avait pas coûté dix hommes", pourtant la ville fut pillée et saccagée pendant trois jours, sans raison valable, si ce n'est le comportement méditerranéen de ses habitants, qui excitèrent les soldats par leurs gesticulations, leur jactance, leur arrogance. Civils massacrés, maisons forcées, femmes mises à mal, vont provoquer une réaction à froid des montagnards andalous, qui se vengeront en massacrant les soldats français isolés.
Les maréchaux eux-mêmes se servent libéralement, aussi bien dans les musées que dans les palais. Certains ont du goût pour les uvres d'art, tel Murat pour le Corrège, ou Soult pour les Murillo et les Rubens. On vole les toiles de Raphaël à l'Escorial ; ailleurs, celles des maîtres flamands et italiens.
Les soldats se rabattent sur les bijoux, l'or et l'argenterie, facilement monnayables. Ciboires, calices, statues en or sont transformés en lingots, avant d'être expédiés à Bayonne ou à Perpignan. À Cuenca, les églises sont passées au peigne fin, et les calices vendus dans les rues. Les soldats torturent les prêtres pour leur faire avouer où sont cachés les trésors. Le vol et la concussion se répandent à tous les niveaux de la hiérarchie.
Mais le vol est un moindre mal comparé à la cruauté qui se généralise, d'un côté comme de l'autre. Écartèlements, mutilations, strangulations lentes et graduées, tout est employé par les Espagnols à l'encontre des Français, "excepté ce qui, par une mort prompte, délivre de la vie".
Le commissaire des guerres Vosgien est scié en morceaux. Un autre commissaire, qui voyage avec sa femme et leur jeune enfant, est capturé par les guérilleros : "Après avoir traité cette dame avec la dernière indignité, en présence de son mari, les scélérats, pour prolonger l'agonie de leurs victimes, les enterrèrent vivantes, la tête hors de terre, en exposant au milieu d'elles leur enfant éventré."
Le général René est jeté dans une cuve d'huile bouillante. Le long des routes, des cadavres se dressent dans des poses grotesques, nus et mutilés, parfois cloués sur les portes, les organes sexuels enfoncés dans la bouche. Á quelques kilomètres de Tarazone, Marbot trouve sur la route "un jeune officier du 10e de chasseurs à cheval, encore revêtu de son uniforme, cloué par les mains et les pieds à la porte d'une grange ! Ce malheureux avait la tête en bas et l'on avait allumé un petit feu dessous."
Le capitaine Marcel a vu des soldats "criblés de coups de lance, mutilés, empalés vifs, crucifiés ou sciés entre deux planches. On en retrouve égorgés, avec les parties génitales dans la bouche, d'autres qui n'ont plus d'yeux ou de langue, le nez, les oreilles et les ongles arrachés. Un caporal de la garnison de Zamora est trouvé pendu par les pieds dans la boutique d'un boucher de la ville, fendu comme un cochon et entièrement vidé."
Les Espagnols qui servent dans les rangs français ont droit aux traitements les plus horribles. L'un d'eux ayant été pris, "on lui écorcha entièrement la tête, on lui coupa la langue, un de ses yeux fut arraché et son orbite vidée pour y introduire une cartouche. On mit le feu à cet il chargé comme un pistolet et l'explosion de la poudre fit sauter le crâne de l'infortuné prisonnier."
Les femmes, qui préparent les repas des soldats, les empoisonnent. L'une d'elles tue ainsi sept cuirassiers. D'autres, les attirant à l'écart pour se prostituer, les poignardent durant leurs ébats. À Manzanarès, deux cents soldats français sont torturés et massacrés, ongles et yeux arrachés, membres découpés et donnés en pâture aux cochons.
Les réactions françaises sont parfois terribles. Bessières fait raser Torquemada où l'Empereur a été brûlé en effigie. Devant Valence qui résiste, les soldats de Moncey dévastent les orangeraies et les oliveraies qui sont la richesse de la province. Caulaincourt ordonne le pillage systématique des églises de Cuenca. À Medina de Rioseco, une femme est violée par quarante soldats et les religieuses de la ville sont rassemblées dans l'église de Santa Cruz pour être livrées à la soldatesque. Au bivouac d'Alcazar, plus de trois cents femmes sont violées et soixante-neuf notables exécutés.
Les moissons prêtes à être récoltées sont incendiées. Les bibliothèques sont dispersées, leurs livres brûlés. À Burgos, les tombeaux du Cid et de Chimène sont saccagés par des dragons qui cherchent de l'argenterie. Dans le monastère de las Huelgas, reconverti en écuries, ceux des anciens rois sont forcés. Dépités de ne pas trouver de trésors, les soldats exhument les cadavres et les traînent dans la poussière.
À Tamames, une trentaine d'hommes du 15e Chasseurs sont capturés par les Espagnols ; leurs camarades, impuissants, les voient jetés vivants dans des brasiers. Un peu plus tard, victorieux à Alba de Tormes, les cavaliers refuseront la reddition de quinze cents Espagnols qu'ils passeront au fil de l'épée ou égorgeront au cri de Tamames !
Les habitants fuient les villes mises à sac et dévastées. Se répandant dans les rues, les soldats visitent les maisons qu'ils se disputent. Des cantinières s'installent, inscrivant sur leur porte les noms des meilleurs restaurants de Paris. Le commandement ne sévit pas : "il faut laisser aux soldats une compensation, puisqu'on ne leur fait aucune distribution", déclare l'Empereur. Quand le soldat est puni, c'est souvent mal à propos. Il ne comprend pas que le pillage soit autorisé un jour et interdit le lendemain.
Tous les Français ne se comportent pas de la sorte, loin de là ! Il n'y a pas que "cruelles représailles et sanglantes répressions" chez les Impériaux. Nombreux sont les chefs qui, investis d'une responsabilité territoriale, s'attachent à remettre de l'ordre, dans le meilleur sens du terme, à administrer leur circonscription avec impartialité, à développer l'enseignement et l'éducation des jeunes, en un mot, à diffuser la civilisation française, et à tenter, de bonne foi, de moderniser l'Espagne.
Pour l'honneur malgré tout
Lorsque Napoléon quitte l'Espagne, en janvier 1809, après seulement deux mois et demi de présence, il laisse la péninsule dans une situation qui lui paraît claire, mais qui est pleine d'ambiguïté pour ses troupes. Très vite, il s'avère que les soldats ne sont plus en phase avec le haut commandement. La guerre des maréchaux n'est pas la leur. Des graffiti, qui en disent long, sont gribouillés sur les murs des cantonnements : "Espagne, fortune des généraux, ruine des officiers, mort du soldat."
Après les rudes campagnes qu'ils mènent depuis une quinzaine d'années, les chefs de l'armée estiment qu'il est temps de toucher les dividendes des sacrifices qu'ils ont consentis. Ayant fait le plein de batailles, de blessures, d'héroïsme, ils sont fatigués. En remerciement des services rendus, ils ne se contentent plus d'honneurs. Ou alors, ce sont ceux-là qui leur font tourner la tête. Á quoi bon la noblesse d'Empire, si l'on ne peut pas profiter de la vie de château qu'elle laissait espérer ? Á quoi bon les rentes juteuses, si l'on ne peut pas vivre dans le luxe et l'oisiveté ?
L'Empereur n'a-t-il pas libéralement distribué des royaumes à ses frères et surs ? Il ne pourra pas faire moins que de concéder à ses maréchaux les conquêtes qu'ils vont faire dans cette péninsule qu'il jugent, à tort, affaiblie. C'est du moins ce que pensent les intéressés. Chacun tente de s'assurer son propre domaine. Soult ambitionne de s'établir roi à Porto. Chassé par les Anglais, il se crée, en Andalousie, une principauté à sa dévotion. Suchet lui-même régit l'Aragon, la Catalogne et les provinces du Levant, avec une grande indépendance.
Ce comportement petit-bourgeois des maréchaux surprend. On les a connu plus entreprenants, plus intrépides. Á Sainte-Hélène, Napoléon confiera amèrement à Las Cases : "Ils avaient bu à la coupe des jouissances et désormais ils ne demandaient que du repos, ils l'eussent acheté à tout prix." Les maréchaux ont perdu l'habitude d'agir dans l'intérêt commun. Sans esprit d'entraide, se jalousant les uns les autres, réticents à se prêter assistance, ils n'hésitent même plus à se faire tort, quand l'occasion se présente.
Pourtant, au combat, rien n'a changé. Du lieutenant au général, la place du chef est toujours devant : trente-trois généraux laisseront leur vie dans cette guerre. Perclus de fatigue par la marche d'approche, affamé, assoiffé, le soldat est transfiguré dès que le premier coup de canon est tiré. Ce n'est pas la haine de l'ennemi qui le motive, ni l'esprit de revanche qui le pousse, c'est simplement l'honneur : il doit tenir sa place.
S'il doit mourir, que ce soit dans le rang, aux côtés de ses camarades ! La bataille engagée, il ne se pose plus de questions. Il n'a pas le choix : il ne peut être que brave ou lâche, jamais indifférent. Or, la lâcheté, c'est la honte, l'infamie. Il sera donc brave. Pour l'honneur. Et quand il ne peut plus supporter ses souffrances, quand il arrive au bout du rouleau, il se tire une balle dans la tête : "Je suis un brave homme, vous m'avez vu au feu. Je ne veux pas déserter, mais ceci est trop fort pour moi." "Foutu métier !" jure Napoléon lui-même, en glissant sur le verglas, lors de l'épique franchissement de la sierra de Guadarrama.
L'Empereur exerce sur ses soldats un ascendant extraordinaire. Au combat, ils sont subjugués par son audace. Au bivouac, ils sont séduits par la façon directe, familière, dont il s'adresse à eux. Napoléon, qui a compris l'importance qu'ils attachaient à la reconnaissance publique, sait les mettre en valeur, flatter leur ego.
Ce ne sont pas de grands idéaux patriotiques qui motivent le soldat. Mais l'épopée que l'armée impériale s'est elle-même forgée, avec ses symboles et ses légendes. Il se sent personnellement l'héritier, le dépositaire, de cette gloire qui rejaillit sur lui. Il en est le continuateur. Il doit rester fidèle à cette gloire, que le vieux briscard estime avoir acquise ; et que la jeune recrue ambitionne d'acquérir à son tour. Au combat, bien sûr !
Bugeaud, le futur pacificateur de l'Algérie, s'interroge :"Quand cesserons-nous de tourmenter le monde ? Ah ! sans le patriotisme, que je serais las du premier de tous les métiers... Il faut aimer la gloire, car nous n'avons que cela, et nous l'achetons bien cher."
Surtout en Espagne. Cette guerre, qui n'en finit pas, est de plus en plus débilitante. Pour qui se bat-on ? Pour le roi Joseph, pour lequel le soldat n'a aucune estime ? Á quoi bon se battre, d'ailleurs, puisque l'Empereur n'est pas là ? Certainement pas pour les maréchaux, qui n'ont ni son aura ni son charisme. L'étendard de la gloire est en berne.
Certes, l'esprit de corps subsiste, mais le but poursuivi devient de plus en plus flou. Le soldat n'a plus de repères. L'égoïsme des chefs, qui privilégient leurs intérêts personnels, déteint sur lui. L'Empereur lui-même n'a-t-il pas oublié ses soldats d'Espagne ? Ils se sentent abandonnés, orphelins, déboussolés. La déprime se développe, la foi s'amenuise. Ils se démobilisent.
Les soldats des armées d'Espagne et du Portugal ont souffert. Bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Par avance, ils avaient accepté la tourmente, les souffrances, les blessures, la mort même. Pour la gloire d'être vainqueurs, pour l'aigle de leur régiment, pour l'Empereur.
Quand ils repassent les Pyrénées, que reste-t-il de leurs espérances ? Un rêve évanoui, une grande amertume, un gâchis dont ils ne se sentent pas responsables, mais victimes. Pourtant, ils ne manifestent aucune acrimonie envers le "Petit Caporal". Ils conservent admiration, estime et respect à "Ce grand capitaine, ce grand homme qui fit le bien et le mal, mais plus de bien que de mal."
Signature :
JCL
Conférence prononcée le 11 août 2007 au Casino de Biarritz