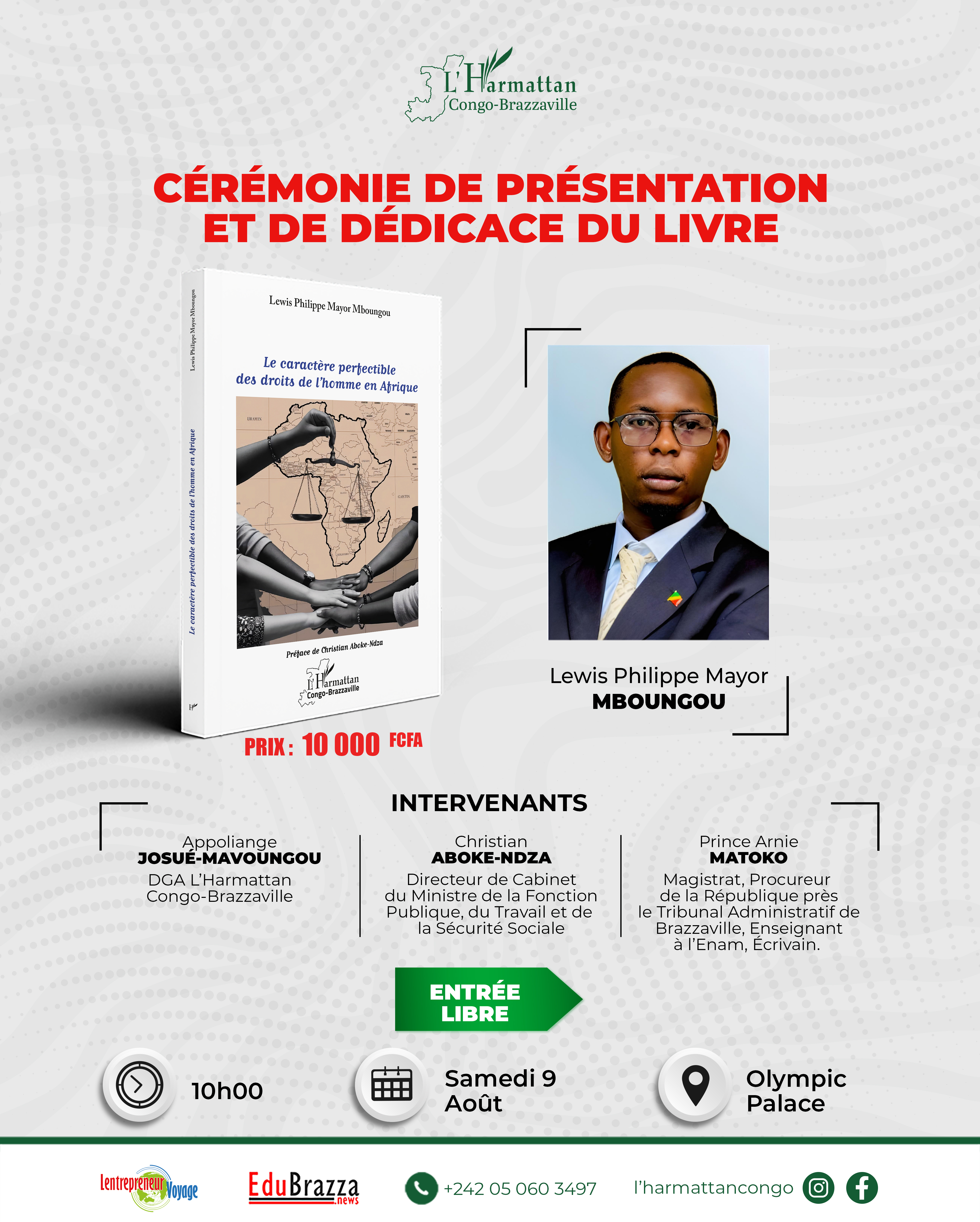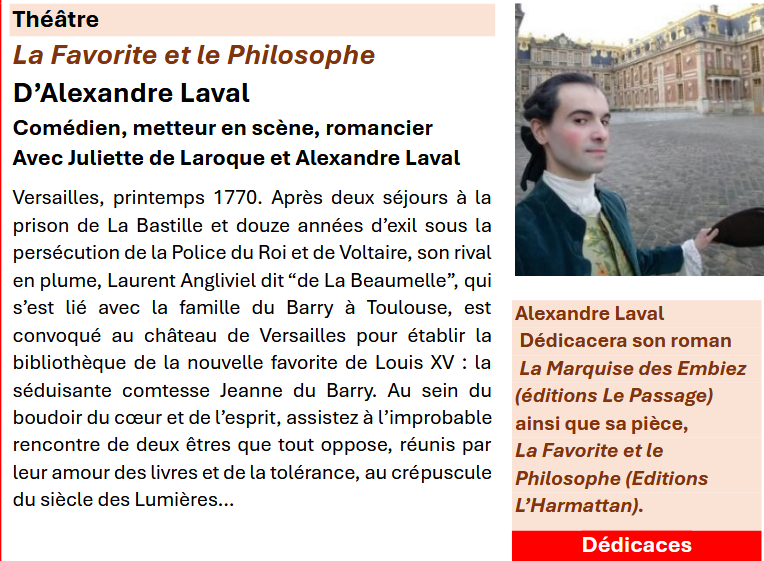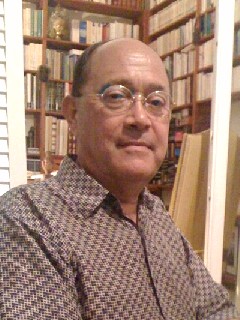
Jean Lombard
ContacterJean Lombard
Descriptif auteur
Philosophe et helléniste, Jean Lombard a confronté, au fil d'une trentaine d'ouvrages parus principalement chez L'Harmattan, l'Antiquité et la modernité dans les champs philosophiques de l'éducation, de la médecine et du soin. Il a notamment étudié, en Grèce ancienne, la fonction éducative du savoir et son lien avec le politique, la relation de la médecine et de la philosophie et les sources philosophiques de l'éthique et du discours médical et social de l'Occident. Il a également publié dans le domaine de l'esthétique, abordant à travers la peinture des Pays-Bas du XVIIe siècle - et particulièrement la problématique de la peinture de genre - l'épistémologie de l'histoire de l'art.
Jean Lombard s'est consacré à l’administration de l’éducation, à la mise en oeuvre de politiques éducatives et à la coopération internationale. D'abord professeur de philosophie aux lycées de Saint-Denis de la Réunion (alors Juliette Dodu et Leconte de Lisle) puis Inspecteur départemental de l'Education nationale, il a plus tard quitté l'île pour exercer au Gouvernement du Québec (directeur adjoint, Ministère des Affaires Intergouvernementales, CEDEP, Québec). Nommé Inspecteur d’Académie à son retour en France, il a exercé en cette qualité dans le département du Pas-de- Calais (Académie de Lille), avant de retrouver la Réunion comme Inspecteur d'Académie adjoint au Recteur lors de la création de l'Académie. Correspondant pour l'éducation de la Commission de l'Océan Indien alors naissante, il a également créé et dirigé à la même période la Mission de Coopération Régionale en Education (M.C.R.E.) qui a établi les axes de la coopération éducative avec les pays de la zone, principalement Maurice, Madagascar, les Comores et les Seychelles. Il sera nommé Vice-Recteur de la Nouvelle Calédonie au lendemain des Accords de Matignon puis quatre ans plus tard Conseiller spécial du Ministre de l’Education du Congo (Brazzaville) chargé de la réforme du système éducatif et enfin, par la suite, Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale du Lot (Académie de Toulouse) et de l'Oise (Académie d'Amiens) avant de présider, de retour dans l'Océan Indien, la société de consultants internationaux en éducation, formation et développement Educandi Consultants International (Maurice-Montréal-Paris).
Il a conduit des actions de coopération et assuré des missions d’expertise des systèmes éducatifs et de conseil en matière d’éducation et de formation en Amérique du Nord, en Europe (Pologne en particulier), en Afrique, dans l’ensemble des pays de l’Océan Indien et dans de nombreux pays du Pacifique sud et du Pacifique central. Il avait été notamment chargé, à l'initiative de l'Ambassade de France aux Fidji, de l'expertise du système éducatif de la République de Nauru alors que s'annonçaient les difficultés qui allaient ensuite attirer l'attention du monde entier sur l'étonnante destinée de ce petit pays. Organisateur de colloques internationaux, notamment sur l'école maternelle, sur l'enseignement technique et sur la diversification des voies de la réussite, il a dirigé la conception et la mise en œuvre de programmes de l’UNICEF (dont, par exemple, le plan pour l’alphabétisation des femmes à l'Ile Rodrigues) ou de l’Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire, organe consultatif de l’UNESCO. Il a conçu et dirigé en collaboration avec Bernard Vandewalle les programmes de formation continue des personnels hospitaliers "Philosopher à l'hôpital". Il intervient dans des formations liées aux métiers de la santé et de l'action sociale et médico-sociale et dans le champ de la critique philosophique de la modernité et de l'éthique. Aux éditions L'Harmattan, il dirige la collection "Hippocrate et Platon, études de philosophie de la médecine" et il co-dirige avec Bernard Jolibert la collection "Education et philosophie".
Structure professionnelle : Téléphone 06 92 61 40 94 Télécopie 02 62 40 98 83 Nationalité(s) : française et canadienne
Titre(s), Diplôme(s) : Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, Inspecteur d'Académie, Docteur d'Etat (Philosophie), Docteur de l'Université de Strasbourg (Histoire de l'art). Diplômé de la Faculté des Sciences de Paris en anthropologie - paléontologie.
Vous avez vu 11 livre(s) sur 25
AUTRES PARUTIONS
J. LOMBARD, ISOCRATE, RHETORIQUE ET EDUCATION, Klincksieck,1990.
J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE ET SOIN, ITINERAIRES PHILOSOPHIQUES A L'HOPITAL, éditions Seli Arslan, 2009.
J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE, CONCEPTS ET PROBLEMATIQUES, éditions Seli Arslan, 2010.
J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE DE L'ALTERITE, CONCEPTS ET PROBLEMATIQUES DE L'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE, éditions Seli Arslan, 2012.
J. LOMBARD, "L'EXERCICE PHILOSOPHIQUE ET LES SOIGNANTS : RENCONTRE ET CONSEQUENCES" in LES SOIGNANTS, L'ECRITURE, LA RECHERCHE, LA FORMATION éditions Seli Arslan, 2012.
J. LOMBARD, "LES INFIMIERES ET L'UNIVERSITE : UNION DES CONTRAIRES OU CHOC DE DEUX MONDES", in ETRE INFIRMIERE A L'ERE UNIVERSITAIRE, éditions Seli Arslan, 2013.
LES Collections dirigées
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Jacobus Vrel singulier contemporain du siècle d'or hollandais. Une éclairante énigme. Conférence à St Denis, Réunion, décembre 2023
Fictions savantes et savoirs fictifs : "réalité" et "réalisme" dans la peinture hollandaise du XVIIème siècle.
Cet article est paru dans l'ouvrage Fictions et Savoir, sous la direction de Gilles Ferréol, E.M.E. Louvain la Neuve et L'Harmattan, Paris, 2020.
L'instauration par la philosophie d'un espace discursif, c'est-à-dire soumis au règne du logos ̶ ce qui est le principal objet des dialogues de Platon ̶ a assuré la prééminence d'un idéal de savoir rationnel fait d'objectivité, de cohérence et de rigueur. Pourtant, au coeur même de ces textes où pour la première fois est mis en scène le triomphe de la raison, un second pôle résiste et s'affirme, celui du mythe. D'emblée muthos et logos vont se trouver dans une sorte d'équilibre fait à la fois d'antagonisme et de complémentarité : si le travail de la raison s'écarte radicalement de ce qui serait simplement de l'ordre du récit, il laisse une place importante à une autre forme de discours où sont contées des choses lointaines ou passées, inventées ou fausses, car il est permis et même recommandé de "dire le faux" si c'est pour aller vers le vrai (République, II, 328 b-d, 377 c). Souvent il a recours à des récits invérifiables - et c'est en ce sens qu'"il faut croire ce que disent les mythes" (Lois, XI, 913 c). Dès lors le mythe, ce beau conte pour enfants (Sophiste, 242 c), cette fable poétique ou sacrée venue d'un ailleurs, datée du "temps fabuleux des commencements" (Éliade, 1962, p. 16) et porteuse de vérités imaginaires, devient l'autre du discours philosophique puis finalement de tout discours rationnel. Dans cette lignée, une part de fiction est, non sans paradoxe, indispensable à la recherche et à l'énoncé du savoir, dont pourtant la vocation est de dire ce qui est.
Cependant, la ligne qui délimite la réalité et la sépare de ce qui n'est pas elle est un repère mouvant, qui se déplace à mesure que s'effectue le travail de la pensée : celui-ci n'est possible qu'en allant de fiction en fiction. Les catégories, les principes, les concepts qui font le savoir sont des éléments d'abord imaginés pour permettre une représentation ultérieure de la vérité à soumettre à une vérification par le réel, comme le rappelle la philosophie du comme si (Vaihinger, 2008). Toute démarche de l'esprit comporte ainsi une part de fiction, une dimension de pari, un itinéraire dans lequel le réel et l'irréel interfèrent et se mêlent.
I. MIMÈSIS-MUTHOS : PEINTURE DE LA RÉALITE ET FICTION CRÉATRICE
C'est toujours par l'idée de réalité que passe la véritable démarcation entre le savoir et la fiction. D'une manière générale, une fiction est d'abord "un construit auquel rien ne correspond dans la réalité". Épistémologiquement, elle est une irréalité par laquelle peut être exposé ou même expliqué le réel, formant ainsi un moyen irremplaçable de penser, comme Nietzsche le rappelait à propos de cette fiction essentielle qu'est le sujet, substrat forgé par nous pour exister derrière la succession de nos états (La Volonté de puissance, II, 2, § 150). Elle peut être aussi, par exemple dans la littérature d'imagination en tant que celle-ci est l'opposé de la chronique historique, "une séquence narrative ou représentative traitant d'événements non survenus". Ainsi le désaccord souvent évoqué entre Platon et Aristote sur le statut de l'imitation artistique de la nature "se retrouve tout au long de l'esthétique occidentale à travers la valorisation ou la dévalorisation de la réalité" (Auroux, 1990, p. 984). Selon l'angle choisi, l'artiste est en effet tantôt l'homme de la dissimulation du réel, de la feinte (de fingere, comme fiction), et tantôt, au contraire, le créateur de mondes possibles et, en ce sens, un éminent inventeur de réalité. La pratique de l'art est nécessairement double : elle relève, selon Ricur dans le commentaire qu'il fait de La Poétique, du "couple mimèsis-muthos", qui renvoie à l'imitation elle-même (la mimèsis d'Aristote, qui n'est pas dévalorisée comme chez Platon et qui n'est pas un éloignement de l'être mais devient la source même du plaisir esthétique) et d'autre part à une "mise en intrigue" (Ricur, 1983, p. 65 sq.), un mouvement créateur par lequel l'art produit, en lui donnant une existence neuve, quelque chose qui existe naturellement, sans que cette référence soit un décalque. Peindre, par exemple, ce n'est représenter ni ce qui est ni ce qu'on sait de ce qui est. On se souvient des mots de Cézanne évoquant son travail de paysagiste devant la montagne Sainte-Victoire : "Je commence, disait-il, à me séparer du paysage", autrement dit à abandonner ce que je sais puis à confier à la réalisation de l'uvre en projet une nouvelle expérience du monde, un nouveau savoir sur lui. Cette relation ambiguë de la fiction au savoir est évidemment sa fonction même : "J'appelle fiction [plasma, de plassô, équivalent grec de fingo] la violence faite à la vérité en vue de satisfaire à une hypothèse", dit Aristote avec force (Métaphysique, M, 1082 b). C'est par une illusion tenace que nous assimilons le savoir au réel (il n'y aurait de savoir que de l'existant) et la fiction à l'irréel (rien de fictif ne pourrait avoir de réalité véritable).
Cette problématique parcourt toute l'histoire de l'art. Certes, au sens le plus commun du terme, réalisme signifie bien "voir les choses comme elles sont" mais comme les choses sont comme on les voit, c'est-à-dire comme on se les représente, c'est plutôt la réalité qui paraît suspendue à la fiction. L'histoire de l'art en revanche appelle réaliste un courant ou un style qui se soumet "à l'observation et à l'imitation de la réalité davantage qu'à l'imagination" (Comte-Sponville, 2001, p. 491) et, dans ce schéma, c'est la fiction qui se trouve rattachée à une réalité connue ou en tout cas connaissable par elle-même, objet d'un savoir qui ne lui devrait rien, comme le montre l'étonnante catégorie à succès de "peintre de la réalité", créée en 1862 par Champfleury pour les "frères Le Nain" et qui sera étendue à bon nombre d'autres peintres très divers. Et plus que tout autre, sans doute, le discours de l'histoire de l'art sur la peinture dans les Pays-Bas du XVIIe siècle met en évidence que le savoir (et, au premier chef, celui qu'elle tente établir) peut être une fiction alors qu'à l'inverse la fiction (dont elle fait son objet d'étude) peut être une révélation du réel et ainsi une modalité du savoir.
II. UNE "FICTION RÉTROSPECTIVE" : PEINTURE ET DISCOURS INDIRECT
La peinture hollandaise comme discours indirect de la réalité des Pays-Bas, comme figuration du moment mythique des Provinces-Unies qu'on appelle le siècle d'or, est à l'évidence une de ces "fictions rétrospectives qui aident à rythmer le cours de l'histoire" qu'André Chastel avait si bien analysées (Chastel, 1959, p. 2). La fiction est alors tout entière dans l'interprétation, dans le schéma conçu pour donner à l'immense production picturale une forme de rationalité. Elle fait un saisissant contrepoint à l'apparente absence de fiction dans les toiles elles-mêmes, qu'on est tenté de voir comme autant de simples reflets du monde. Plus qu'un art de peindre, la description sans fin des choses évoque un art de dépeindre, selon le mot de Svetlana Alpers, car dépeindre c'est, selon Littré, "représenter [
] d'une manière assez vive pour qu'on puisse comparer à une peinture" et ce n'est donc pas vraiment peindre.
De longue date, depuis Frans Hals jusqu'à Vermeer et même au-delà, la peinture des Provinces-Unies a été regardée comme une vaste description de la Hollande et de la vie hollandaise et comme un sommet de l'art descriptif : le pays aurait fait son propre portrait sous tous les angles, autorisant du coup l'histoire de l'art à s'en tenir aux manières de peindre et à constituer à cette fin une prolifération de catégories socio-historiques et socio-esthétiques ̶ styles, techniques, influences, apogée, déclin, "réalisme", baroque, résistance au baroque, courants, idéal bourgeois, capitalisme naissant, "esprit de la Réforme", peinture "nationale" ̶ dans lesquelles l'explication, finalement, vient moins s'alimenter que se dissoudre. Les illustres travaux de Schnaase, Kugler, Burckhardt, Thoré-Bürger, qui fut le découvreur de Vermeer, Hofstede de Groot, Bode, Friedländer, sont la face savante de cette interprétation sociologique qui prend sa source dans les Leçons sur l'esthétique, où Hegel avait établi pour la première fois la corrélation entre les conditions socioéconomiques des Pays-Bas du Nord et le passage de la peinture religieuse à un art désormais voué aux paysages, aux natures mortes et aux sujets de genre. En l'absence de toute cour royale, l'art devait se développer en direction de la vie privée, d'où l'abondance des uvres de format modeste et le succès des thèmes intimistes. En outre, destinés à des demeures bourgeoises et non plus à des palais, voués à des sujets décoratifs profanes, les tableaux auraient été la traduction esthétique de l'affairisme ambiant, de l'accession de la classe marchande au pouvoir et des goûts protestants.
Cette lecture d'un art pictural renvoyant constamment une image du réel ̶ cette obsession, pourrait-on dire, d'un prétendu réalisme ̶ relaie la thèse d'Eugène Fromentin selon laquelle la peinture hollandaise se serait contentée de regarder autour d'elle et se serait passée de sujet (Fromentin, 1972). Elle a été quelquefois dénoncée (de Jongh, 1971), mise en perspective critique (Rosenberg et al., 1966), mais, même réaménagée, elle demeure vivace (Todorov, 1993), sans doute parce qu'elle correspond à l'impression que donnent ces tableaux d'avoir été peints "d'une main loyale et d'un il fidèle" (Alpers,1990, p. 137) et parce que l'habileté technique qui s'y exprime est le signe d'un vrai souci d'observation et de connaissance de la nature. Dans l'emblématique Allégorie de la peinture de Vermeer (Vienne, Kunsthistorisches Museum), on peut lire, en bordure de la carte qui y est représentée et qui reproduit non pas le territoire des Provinces-Unies mais celui des dix-sept provinces d'avant l'armistice avec l'Espagne au Traité d'Anvers de 1609, le mot descriptio (nova descriptio) qui atteste de l'intention du peintre de capter et transmettre connaissances et informations sur le monde. On a pu analyser aussi la Vue de Delft (Mauritshuis, La Haye), au-delà de la poésie du "petit pan de mur jaune" que Bergotte "adorait et croyait connaître très bien", comme ayant une réelle portée historique et géographique, Vermeer ayant "ramené la ville à ses origines cartographiques comme s'il voulait en affirmer la véritable nature" (Alpers, 1990, p. 213). Il s'agit en tout cas d'exemples de ce que peuvent être les plus hauts degrés de la fiction savante. Tout le siècle s'est du reste émerveillé de "regarder le monde comme vu d'un autre monde grâce à l'art du dessin", dira Samuel van Hoogstraten dans ce qui apparaît comme un bilan, Inleiding tot de Hooge Schoole der Schilderkunst (Rotterdam, 1678).
L'hommage à la réalité, l'illustration plus ou moins cryptée du monde des objets, la représentation de l'univers quotidien sont, dans la Hollande du XVIIe siècle, des fonctions essentielles de l'art. Il n'est donc pas étonnant que le stilleven, la "vie silencieuse" que nous appelons nature morte, soit "un merveilleux champ d'expérience" : les peintres se soucient de rechercher "le pittoresque dans les choses les plus familières" (Gombrich, 1960, p. 35) et ce penchant collectif pour la contemplation des choses explique sans doute le nombre étonnant de petits maîtres tendant au réel une perpétuelle embuscade, prenant à leur piège les choses, rares ou usuelles, éphémères ou permanentes, ramenant l'univers à l'environnement, fascinés par le concret et nullement gênés par son prosaïsme. Au contraire sont dits avec une égale ferveur, surtout dans les vanités, les plaisirs et leurs vestiges.
Au même moment, le genre du paysage connaît, pour des raisons analogues, sa véritable naissance (Stechow, 1966). Forme d'art bourgeois et résultat d'une ardente interrogation sur la nature qui culmine à cette époque, il est l'aboutissement d'un processus artistique qui voit, dès les années 1600, s'épuiser la tradition maniériste, à commencer par les peintures urbaines et les tableaux d'architecture. Le paysage devient une sorte de genre naturel lié à une capacité de regarder hors de soi selon une vision enfin libérée des schémas artificiels qui l'entravaient jusque-là. L'idée est ainsi accréditée d'un paysage qui accéderait à une représentation vraie, à une limpidité retrouvée du regard, dans une magique coïncidence des deux sens du mot paysage, genre pictural et réalité représentée.
III. LA CHRONIQUE ET L'ÉNIGME. AVÈNEMENT DE LA PEINTURE DE GENRE
Cette rhétorique du réel s'amplifie considérablement avec un événement d'une grande importance dans l'histoire de la peinture des Provinces-Unies, la construction et le développement de la peinture de genre (Lombard, 2001, pp. 21-52). Celle-ci représente a priori une référence plus marquée à la réalité vécue et à la vie sociale, même si certains schémas sont hérités d'une tradition déjà ancienne : scènes de taverne, kermesses et "joyeuses compagnies" surtout dans les premières années du siècle, scènes paysannes, entremetteuses, ateliers de peintre, "portraits" de savants et de philosophes et scènes de musique à toutes les périodes, puis de dame avec sa servante aux innombrables variantes après 1650, en même temps que se répand la mode des scènes galantes, tous ces tableaux contenant eux-mêmes une infinité de natures mortes, de paysages, de portraits et de "tableaux dans le tableau".
Il semble, au premier abord, que ce séduisant surgissement du réel savamment documenté, intense et presque entêtant, signifie la mise à l'écart de la fiction. En fait, la peinture de genre vouée à la quotidienneté et à l'anecdote introduit, dans la production picturale, une relation au monde très particulière, puisqu'elle institue la négation du thème et la suppression du sujet. Une scène de genre est d'abord un tableau qui se définit négativement comme n'étant ni une peinture d'histoire, ni une nature morte, ni un paysage, ni rien de ce qui relèverait d'un genre déterminé ; d'autre part, et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes, tout véritable sujet y est complètement nié, car lorsque tout est sujet plus rien finalement ne l'est, et inversement. Par exemple, on voit à l'uvre dans L'Arrière de la maison de Pieter de Hooch, qui est au Louvre, ou dans La Ruelle de Vermeer peinte la même année (1658), qui est à Londres (National Gallery), le mécanisme du genre, avec sa représentation caractéristique d'un non-événement : ce qui se passe semble avoir été pris au hasard dans une quelconque journée, les personnages ne font rien de précis, les regards sont presque absents, les mouvements sont comme suspendus, les personnages ne sont en vérité personne. La scène de genre ne rapporte pas les faits et gestes d'individus mais de types ou de groupes anonymes. Le genre est la limitation imposée au champ du possible, l'interruption du processus des connotations, l'isole-ment voulu de ce qui est donné à voir, qui devient un monde d'invention, un monde fictif dans le monde réel. Jusqu'à la fin du siècle, la peinture de genre procédera à cette surenchère de l'anodin, avec des actions à peine évoquées, des intentions simplement suggérées. L'uvre est comme extérieure à son sujet apparent : les joueurs de cartes ne jouent pas, les femmes devant leurs miroirs ne se regardent pas, des repas sont servis auxquels les convives ne portent nulle attention. Loin de transcrire le visible, le genre confronte et intervertit constamment le réel et l'imaginaire (Sutton, 1984, pp. XIII-LXXXVIII).
Entre le décor du quotidien et le contenu des uvres, la parenté est superficielle. D'abord la vie hollandaise comportait beaucoup d'attitudes symboliques et ritualisées (Zumthor, 1959) et c'est donc tout aussi bien le réel qui évoque le pictural que l'inverse, de telle sorte que leur "ressemblance", qui est au cur du prétendu réalisme, est de pure forme. Ensuite, les artistes n'ont pas peint ce qu'ils voyaient mais ce qu'ils composaient en atelier, faisant de l'atelier un laboratoire - et non du monde un atelier : l'esthétique de l'allusion a été très tôt une esthétique de l'illusion. Le récit et la description ont perdu du terrain et le réel a été abandonné, au point que c'est plutôt "le monde qui est devenu peinture", comme disait Malraux à propos de la Lettre d'amour de Vermeer (Malraux, 1952, p. 111). Vermeer a peint, en effet, ces nouveaux portraits de genre vers lesquels tout le siècle semble avoir cheminé inexorablement. On observe aussi comment Jacob Vrel "à chaque uvre se détourne du monde" (Brière-Misme, 1935, p. 68), peignant un jour qui n'éclaire pas, des actions immobiles, des silences pleins.
Ainsi, les uvres ne renvoient plus à la réalité ni au sens symbolique qui lui était jusque-là associé, elles constituent une réalité formelle qui nie l'univers réel et forge une nouveau mode de signification. La chronique rassurante cesse d'être une chronique et fait place à une énigmatique fiction dont le sens est toujours à établir. Dans cette conquête d'une fonction symbolique qui était jusque-là usurpée ̶ dont l'uvre de Vermeer est la sublime et décisive étape ̶ se trouve sans aucun doute le principal évènement pictural du siècle d'or.
IV. PORTRAIT, PAYSAGE, NATURE MORTE : DÉTOURNEMENT DU RÉEL ET MONDE FICTIF
Quoi qu'il en soit, le mouvement initié par la peinture de genre s'étend peu à peu à tous les genres, n'épargnant même pas la production de tableaux italianisants ou les centres de résistance comme l'école d'Utrecht, refuge du réalisme caravagiste. Le siècle d'or est l'histoire de cette subversion qui fait de la peinture de genre le genre dominant qui envahit et absorbe tous les autres, le genre dans lequel tous les genres vont finir par se fondre, devenant portraits de genre, paysages de genre, natures mortes de genre, vanités de genre, le phénomène atteignant ce qu'il reste de tableaux historiques, mythologiques ou bibliques.
C'est ainsi que la rhétorique de la peinture de genre vient très vite pervertir celle du portrait et se substituer à elle. Frans Hals a peint des scènes de genre à la manière de Karel van Mander au début de sa carrière, et la parenté du portrait et de la peinture de genre restera au cur de son uvre. Rembrandt lui-même, pourtant éloigné de cette peinture, ne fait pas exception et le visage aux traits "pré-saskiens" qui apparaît régulièrement dans son uvre n'est pas celui d'un modèle mais d'un type. Chez Vermeer, la Jeune femme écrivant une lettre (1663, Dresde), la Jeune femme devant son virginal (après 1670, Londres, National Gallery) et plusieurs autres toiles sont de parfaits exemples d'invasion du portrait par le genre. Au triomphe de la peinture des choses, le portrait aurait pu apporter un démenti, mais tout portrait est avant tout la projection d'une conception de soi et des autres et le portraitiste ne montre la réalité que pour construire une apparence, ce qui est déjà en soi une production de fiction.
De la même manière, l'histoire du paysage hollandais est celle d'une tentative éperdue pour atteindre l'espace vécu par-delà des formules héritées d'une rhétorique ancienne mais cette tentative un moment réussie est vite contredite par la rhétorique nouvelle. Esaias van de Velde, si soucieux du réel qu'il ait pu être, a été un peintre de genre qui poursuivait les innovations de Buytewech et recherchait surtout l'ordre et la symétrie. De même, Isaac van Ostade mêle genre et paysage et "transfère la vie paysanne en plein air" (Leymarie, 1956, p. 118). Le paysage connaît alors un infléchissement qui le ramène à son origine : une fois dépassés scènes de genre en plein air et panoramas à l'ancienne, les tableaux se repeuplent de personnages et s'emplissent à nouveau de scènes anodines ou dramatiques. Le paysage hollandais n'est donc qu'un moment entre deux périodes de domination du genre : après avoir été la découverte enthousiaste d'une image du monde, il redevient ce qu'il avait été, un monde d'images, moins une référence au pays qu'un moyen de dépaysement. Frans Post et sa peinture coloniale, dont on attribue le succès à la puissance hollandaise outre-mer, incarnent plutôt la persistance d'un rêve d'évasion qui est tout aussi présent dans les tableaux à l'italienne des années 1640, les paysages scandinaves d'Everdingen ou les incendies d'Egbert van der Poel. Ces peintres des lointains finissent par être des peintres de l'absence, pour choisir un terme qui fasse pendant à celui de peintres de la réalité (Lombard, 1988, p. 423 sq).
Le phénomène touche aussi la nature morte, qui se dissout dans l'abondance dont elle était née. Elle a conté d'abord l'émergence des choses au premier plan de la réalité, la victoire des objets et la progressive absence de l'homme, embusqué derrière le regard qu'il jette sur ses biens et vaincu par les prestiges de la matière. Plus qu'une mystique de l'univers inerte, plus qu'un éloge de la dignité des choses, c'est une collective absence à soi-même lentement apparue que suggère le discours indirect du stilleven. Si on compare le Repas au hareng de Pieter Claesz (Rotterdam, Musée Boymans van Beuningen) et le Banketgen met een pastry de Willem Claesz Heda (Haarlem, Musée Frans Hals), pourtant peints tous deux un peu avant 1640, on voit dans le second un formalisme nouveau qui tend déjà à remplacer le "réalisme alimentaire", car si le contenu paraît analogue, l'intention est bien différente. Plus tard, la peinture de repas entamés et de reliefs de repas s'achèvera dans une contemplation anorexique de la nourriture, négation ultime de la consommation réelle : la représentation des repas fait place à celle de leurs restes ou de leurs ustensiles, le consommable est remplacé par l'inconsommé puis par l'inconsommable, dans un triomphe des objets au détriment des aliments, devenus eux-mêmes objets quand ils sont encore présents. Dans l'univers du repas, la consommation n'est plus figurée ni par ses promesses ni par ses vestiges. L'impression que les convives se sont absentés pour toujours, et avec eux l'appétit, s'accentue inexorablement, comme dans plusieurs autres Repas de Pieter Claesz (à Cassel et à Budapest). Dans une Vanité de Jan Fris (1667, Stockholm), l'intense désordre et les nombreux débordements par rapport à la table donnent l'impression angoissante d'un équilibre prêt à se rompre, d'un écroulement imminent, avec l'affaissement d'un papyrus au premier plan. Au-delà des objets choisis, c'est désormais le réel lui-même qui est vanité. Ce n'est donc pas tant l'ostentation qui domine la période tardive, que le détournement du réel, son retournement en un monde de fiction.
Comme le rêve, ce monde ne tient sa réalité que de ce qu'il est imaginé. L'évolution rhétorique et sémantique des genres picturaux met en évidence que la "réalité" du siècle d'or est la création picturale elle-même et qu'elle n'a pas d'existence hors de cette "représentation". Les "objets figuratifs" que sont les tableaux forment un système de signification où l'époque projette ses mythes et son existence socio-historique : l'art n'est évidemment ni "le doublet d'une autre expérience ou d'un autre langage" ni "le reflet d'une réalité fixée en dehors de lui et avant lui" (Francastel, 1970, pp. 50 et 117). La fiction que portent les uvres recèle un savoir, et le savoir établi sur ces uvres comporte sa part de fiction : à la fiction savante correspondent, comme on le verra au passage, quelques savoirs fictifs.
V. SAVOIRS DE LA FICTION ET FICTIONS DU SAVOIR
La fiction savante dit principalement "les vrais événements du siècle d'or" ainsi que la relation de la peinture au temps (Lombard, 2001, pp. 141-184). Elle révèle d'abord, avec le passage d'un mode de création et de perception esthétique à un autre, la naissance d'un nouveau système culturel, événement sans commune mesure avec les variations stylistiques ou techniques qu'on a pris l'habitude de tenir pour l'histoire de la peinture hollandaise. Et, par ailleurs, c'est à un savoir à bien des égards fictif que recourt le discours traditionnel en disant qu'entre Hals et Vermeer il ne s'est rien passé d'important, que le vrai ressort de la peinture hollandaise est un jeu dont on ne finit pas d'écrire les règles entre des courants, des influences et des styles, que la peinture de genre n'est qu'un genre parmi d'autres et même un genre mineur, alors que c'est en vérité tout l'inverse qui est arrivé : la nature morte et le paysage ont détourné le réel en lui substituant des signes qui lui ont été empruntés, le portrait et la peinture de genre en tenant un discours élaboré sans lui.
C'est d'abord, à travers ces genres majeurs, un éclairage sur les relations sociales dans les Provinces-Unies qui retient l'attention. La vie sociale a été de moins en moins représentée par les peintres : au fil du temps, ils l'ont plutôt, dans des proportions variables, dissimulée, suggérée, projetée, rêvée, déformée ou réinventée. Si le social est éclatant chez Hals, s'il faut lui porter attention chez Rembrandt, il faudra le débusquer chez Vermeer : il est mis en évidence dans Le Corps des archers de la Saint-Georges (1627, Haarlem, Musée Frans Hals), il est pensé et maîtrisé ̶ c'est ce qui rend l'uvre inestimable ̶ dans la Ronde de Nuit (1642, Rijksmuseum) au milieu du siècle, il est invoqué, supposé, traité par allusion ou métaphore et transfiguré en mythe au centre du monde de La Liseuse (1662-1663, Rijksmuseum), dans la dernière période. La peinture a tendu, dans un premier temps, à figurer la société néerlandaise et son cadre, les modèles sociaux inspirant alors les modèles picturaux. Ensuite, dans une esthétique nouvelle, les modèles picturaux l'emportent sur les modèles sociaux et anticipent sur eux : la société qui a été le modèle de la peinture en devient l'antimodèle. Un temps visée comme référence, elle est ensuite niée et symbolisée, devenant une référence indirecte. Le remplacement des réjouissances collectives par la peinture d'intérieur, où dominent les scènes galantes et domestiques, peut apparaître aussi comme une forme d'évitement visant à taire la réalité de la vie sociale d'abord proclamée. La tendance au fastueux est la marque d'une consommation symbolique des biens et un nouveau spectacle que la société se donne à elle-même. Il y a là, en tout cas, l'image d'un monde triste, qui contraste avec l'émerveillement de la première partie du siècle : plus qu'un "déclin du réalisme" ̶ autre catégorie constitutive d'un savoir fictif ̶ c'est l'amorce d'un désenchantement, l'avènement d'une mélancolie. L'euphorie du siècle d'or aura donc été de courte durée : la peinture de genre devient peinture de l'oubli ̶ oubli du temps, du travail, des soubresauts de l'action ̶ et une tentative pour donner une image de l'activité apaisée et sanctifiée, selon le mot de Jean Desanti (Desanti, 1956, pp. 205-206).
Un autre apport de la fiction picturale concerne le temps. La peinture hollandaise du temps avait été d'abord un simple hommage à l'instant. Les portraits de Frans Hals sont des instantanés sans évocation de l'avenir ou de la durée, de simples constats riches et évocateurs mais limités à l'éphémère, comme par exemple Le Banquet des officiers de la Garde civique de Saint-Adrien (Musée Frans Hals, Haarlem), où rien ne se prépare ni ne s'achève : l'instant est extérieur à l'écoulement général du temps. Une autre étape est franchie avec Rembrandt, dont la plupart des uvres définissent le temps du projet et de l'action immédiate, le moment où les décisions sont prises, comme dans la Ronde de nuit (1642, Rijksmuseum) qui montre le passage du repos au mouvement, l'étonnant moment où rien n'est encore fait mais où tout est déjà irréversible. Ce temps de l'imminence était aussi celui de la Leçon d'anatomie du Pr Tulp (1632, Mauritshuis, La Haye). Quand, plus tard, la fonction utopique de l'espérance des débuts ne s'exercera plus, la représentation du temps fera place à l'obsession de la durée. Faire durer, de peur que le monde s'écroule : telle a été, sans doute, l'angoisse du siècle d'or tardif, sourde, presque imperceptible, celle qu'on lit dans des tableaux aux accents d'éternité. Le temps de Vermeer est le temps du mal du temps. Cette perception lancinante du temps qui s'écoule montre que la tonalité du siècle qui va s'achever n'est pas le repos satisfait, l'acceptation heureuse ou le contentement sans mélange qu'on attendrait d'un siècle d'or. Après 1650, la peinture devient un art de solitude dans une société troublée qui est saisie d'une égale crainte de voir son univers se perpétuer ou se dissoudre.
En tant que fictions savantes, ces tableaux nous donnent accès à des craintes, à des désirs, à des attitudes collectives, à des valeurs partagées ou non et à l'univers perceptif et intellectuel de la Hollande du XVIIe siècle. À cet égard, ils sont sans doute pour l'histoire des Provinces- Unies un apport inestimable : la connaissance de l'imaginaire, loin d'en dépendre, contribue à celle du réel. C'est sans doute à un savoir fictif, en revanche, que pourrait conduire une lecture des uvres qui s'enfermerait dans un jeu de catégories esthétiques dont le fonctionnement absorbe plus d'attention que les objets auquel il s'applique. Il en sera de même en cas d'application directe à l'art de schémas directement empruntés à l'histoire, à laquelle doit au contraire concourir la connaissance des aventures plastiques. Telles sont en effet les deux tentations de l'histoire de l'art : tantôt, elle réduit la peinture à ce qui n'est pas elle (l'histoire, la société, la religion) ; tantôt, elle l'enferme en elle-même et cesse de la tenir pour intelligible si ce n'est au fil de ses propres subdivisions et au gré des catégories qu'elle engendre, ne mettant alors en évidence que des destins ou des avatars. Le savoir qu'elle vise a pourtant pour véritable objet la fiction comme activité première qui ordonne le monde.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALPERS Svetlana (1990), L'Art de dépeindre. La peinture hollandaise du XVIIe siècle (1e éd. américaine 1983), Paris, Gallimard.
AUROUX Sylvain (sous la dir. de) (1990), Encyclopédie philosophique universelle, vol. II : Les Notions philosophiques, Paris, PUF.
BRIÈRE-MISME Clotilde (1935), "Un intimiste hollandais : Jacob Vrel", Revue de l'Art Ancien et Moderne, n° 68, juin-décembre, pp. 97-114 et pp. 157-172.
BROWN Christopher (1984), La Peinture de genre hollandaise. Images d'un monde révolu, (1e éd. néerlandaise 1984) Paris, De Bussy Vilo.
CHASTEL André (1959), Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris, PUF.
COMTE-SPONVILLE André (2001), Dictionnaire philosophique, Paris, PUF.
DESANTI Jean-Toussaint (1956), Introduction à l'histoire de la philosophie, Paris, La Nouvelle Critique.
DUVIGNAUD Jean (1972), Sociologie de l'art, Paris, PUF.
GOMBRICH Ernst (1960), Art and Illusion, New-York, Pantheon Books.
GOMBRICH Ernst (1961), "Tradition and Expression in Western Still-life", Burlington Magazine, n° 103, mai, pp. 175-180.
ÉLIADE Mircéa (1962), Aspects du mythe, Paris, Gallimard.
FRANCASTEL Pierre (1970), Études de sociologie de l'art, Paris, Denoël-Gonthier.
FROMENTIN Eugène (1972), Les Maîtres d'autrefois, Paris, Garnier (1ère éd. : 1876).
JONGH Eddy de (1971), "Realisme en Schijnrealisme in de schilderkunst van de zeventiende eeuw", in Rembrandt en zijn tijd, Catalogus Brussel, pp. 143-194.
LEYMARIE Jean (1956), La Peinture hollandaise de Gérard de Saint-Jean à Vermeer, Genève, Skira.
LOMBARD Jean (1988), "Chronique des jours et discours de l'absence : fonction esthétique de l'évocation des lointains dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle", in BUISINE Alain et DODILLE Norbert (sous la dir. de), L'Exotisme, Paris, Didier, pp. 419-428.
LOMBARD Jean (2001), Peinture et société dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Essai sur le discours de l'histoire de l'art, Paris, L'Harmattan.
MALRAUX André (1952), Tout Vermeer de Delft, Paris, Gallimard.
RICUR Paul (1983), Temps et récit, Paris, Seuil, t. I. ROSENBERG Jakob, SLIVE Seymour et TER KUILE Engelbert (1966), Dutch Art and Architecture, 1600-1800, Harmondsworth, Penguin Books,
STECHOW Wolfgang (1966), Dutch Landscape Painting in the 17th Century, Londres, Phaidon.
SUTTON Peter (1984), Masters of Seventeenth-Century Dutch Genre Painting, Philadelphia, Museum of Art.
TODOROV Tzvetan (1993), Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Paris, Seuil.
VAIHINGER Hans (2008), La Philosophie du comme si, Paris, Kimé, 2008.
ZUMTHOR Paul (1959), La Vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt, Paris, Hachette.
Une version intégrale de ce texte figure dans Fictions et Savoirs, sous la direction de Gilles Ferréol, Louvain la Neuve, 2020.
Le refus de soins. Repères et enjeux éthiques. Communication à la 5ème journée de l'Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire le 29 novembre 2021 (en visioconférence depuis la Réunion)
Je vous remercie de m'accueillir parmi vous (1) pour cette intervention dont les 10000 km qui nous séparent font un bel exemple de cet étrange mixte d'éloignement et de présence que le lexique pandémique appelle le distanciel. Pourtant, je ne cache pas qu'en lisant et relisant le titre qui a été donné à cette journée, ainsi que l'argumentaire et le programme qui l'accompagnent, je me suis interrogé sur le rôle qui pourrait bien être le mien dans cette problématique du refus de soins, dont en raison de votre expérience, de vos compétences et de votre vécu vous possédez à l'évidence tous les éléments constitutifs d'un savoir alors que je m'en trouve, par rapport à vous, relativement démuni. Mais après tout c'est une situation habituelle pour le philosophe d'avoir à donner, de façon paradoxale, des avis à plus savant que lui : philosopher, c'est toujours entreprendre une navigation dont le port d'attache est heureusement l'ignorance et dont le mode de propulsion est l'invention et l'utilisation de concepts - car les concepts, disait Deleuze, "ne nous attendent pas tout faits comme des corps célestes" (2). Et c'est justement un travail du concept que je voudrais essayer d'engager en proposant quelques catégories pour essayer de penser le refus et particulièrement le refus de soin, à charge pour vous, au fil des étapes de cette journée, d'activer ou non ces catégories, de leur imprimer votre lecture de professionnels, de les nourrir de votre expérience et de les modifier en fonction de ce que vous voudrez vous donner à penser à travers elles. Pour ce que j'ai conçu comme une introduction à vos travaux, je procèderai en trois temps que j'appellerai, dans l'ordre, le refus et la démarche éthique, puis petite philosophie du dire non et enfin une pratique réfléchie de la liberté.
Deux précisions d'abord. L'une de vocabulaire : j'utiliserai refus de soin en sous-entendant d'accompagnement pour désigner toute forme de refus de ce qui est proposé ou offert ou recom-mandé ou prescrit dans une situation qui peut être soit de soin stricto sensu soit de réparation de la dépendance ou de la fragilité. De même sera sous-entendue la distinction essentielle entre refus de soin et refus de traitement. La deuxième remarque concerne la conjonction et le chevauchement des deux champs d'action, le médical et le social, qui sont représentés dans l'assistance que vous formez. Je relisais il y a peu un passage éblouissant du livre intitulé Mes mille et une nuits que Ruwen Ogien avait écrit peu avant de mourir, où il expliquait, je le cite, comment en tant que "malade de longue durée" il se sentait comme "un chômeur vieillissant et sans qualification à la recherche d'un emploi minable et mal payé" (3). Cette porosité de la frontière qui sépare le médical et le social atteste qu'ils relèvent tous deux d'une même démarche éthique et que ce qui les différencie tient surtout à ce qu'on pourrait appeler la pesanteur ontologique des situations : cela ne pèse évidemment pas du même poids et n'a pas les mêmes enjeux de rejeter l'idée de tel ou tel placement, ou de refuser d'appeler le médecin, ou de ne pas accepter telle ou telle aide ou bien de refuser toute aide, ou de vouloir se soustraire à un traitement décisif ou à l'accomplissement de gestes du quotidien, sans parler des différences considérables entre le patient hospitalisé ou à son domicile, la reconnaissance de la personne et de son identité et de ce fait la prise en compte de son refus étant loin d'être la même dans ces deux cas. Tous ces refus ont néanmoins, d'un point de vue éthique, une unité fondamentale parce qu'ils se situent tous sur un continuum que nous a légué la pensée antique, et qui va de bios et zoè d'un côté et d'épiméléia à thérapéia de l'autre. Il y avait en Grèce ancienne deux manières de désigner la vie que nous avons conservées, d'une part zoè, la vie animale, la vie nue, si on peut dire, la vie qui fait parler d'urgence vitale, zoè comme dans zoologie. Et d'autre part bios, la vie que l'on vit, la vie dont chacun pour notre propre compte nous écrivons le récit dans notre quotidien, dans nos décisions, dans nos projets et dans nos rêves, ou autrement dit l'existence, le bios de biographie. Or en pratique aucun soin ni aucun accompagnement ne concernent exclusivement la seule zoè ou le seul bios (4). Il y a toujours, si peu que ce soit, du bios dans la zoè et de la zoè dans le bios et en faisant du respect absolu de la vie la valeur suprême au rebours des murs de l'époque, le Serment d'Hippocrate, sur lequel nous reviendrons, visait à la fois bios et zoè. Et de fait, celui qui soigne ne peut négliger la dimension existentielle de la "vie" du patient ni le travailleur social perdre de vue les exigences, y compris les plus techniques, de la santé et de la vie saine. De même, on soigne quelque chose, une maladie (c'est ce que dit thérapeia), mais on soigne ou on aide aussi quelqu'un, c'est-à-dire qu'on s'occupe de lui (c'est ce que dit epiméleia) et on s'occupe donc de son existence et de sa liberté au moins par interim, en quelque sorte. Cette unité des deux versants que sont le soin et le prendre soin avait conduit Platon à classer la médecine dans les "arts du salut", avec le pilotage des navires.
J'aborde donc le refus et la démarche éthique. Je considère ici le face à face entre le refus, variété du dire-non et modalité particulière de la négation, et la démarche éthique. Et si je dis démarche éthique c'est pour distinguer l'éthique au sens le plus large, celui auquel se référait Wittgenstein dans sa célèbre Conférence sur l'éthique de 1929 en disant qu'elle est "l'investigation de ce qui est bien" (5) et la démarche éthique (6) qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la recherche souvent éperdue de ce que nous avons à faire dans le cadre de l'action et même dans le feu de l'action, à la jonction toujours risquée et fréquemment tragique des principes et du réel.
Mais on voit aussitôt que quelque chose ne va pas dans ces énoncés car d'une certaine façon sur ce qui peut ou doit être fait en cas de refus de soins, tout semble être déjà dit (7). Je me garderai d'anticiper sur l'intervention qui va suivre la mienne mais on sait qu'il n'est pas de texte de référence qui ne réponde pas de façon plus ou moins articulée et précise, aux questions soule-vées par tout refus de soins. Si j'ouvre le Code de déontologie médicale (8) et si je lis les articles 6, 8, 9, 34, 35, 37, 39, 40 et surtout l'article 36 portant sur le consentement, qui faut-il le rappeler est le relief en creux du refus, je trouve là effectivement tout ce qui est nécessaire à des décisions et à des choix éclairés et professionnellement irréprochables en matière de refus de soins. Le droit de refus et les conditions détaillées de son exercice sont également exposés dans de grands textes fondamentaux, et je pense par exemple à quelques alinéas essentiels de l'article 16 du Code civil, ou aux dispositions de l'article L. 1111 du Code de santé publique, ou à la loi du 4 mars 2002 sur les droits du patient, qui pose le respect du refus de soin comme étant le droit commun, sans parler de l'abondante jurisprudence sur ces questions ou des innombrables études qui leur sont consacrées ou des circulaires comme celle du 6 mai 1995, connue comme la Charte du patient hospitalisé. Et face à un savoir aussi élaboré et souvent assorti de son mode d'emploi, dont l'avis n° 87 du Comité Consultatif National d'Éthique constitue une belle synthèse, on peut se demander si l'éthique n'est pas condamnée à rester sur ces questions une sorte de commentaire moral de ce qui se passe, un simple rappel, comme on a pu le dire, "de bons sentiments et de grands principes" (9). Je pense au contraire que le refus de soins est comme tout refus un puissant générateur de situation éthique, celle-ci lui étant en somme homogène puisqu'elle est elle-même issue d'un refus, comme je vais essayer de le montrer.
Pour cela, il faut revenir un instant à la notion même d'éthique pour la situer par rapport à deux autres notions avec lesquelles elle a des frontières communes, la morale et la déontologie. D'abord, la morale. Il y a ce que nous appellerons une région du bien et du mal, un ensemble de principes, de normes, d'idéaux, de règles sur lesquels il peut certes y avoir débat mais aux-quels globalement nous sommes liés par un sentiment d'obligation : c'est la morale, c'est ce que Ricur appelle le "royaume des normes", dans lequel on peut ranger aussi les lois et les règlements, puisqu'ils jouent le rôle de normes régulatrices de l'action et qu'ils sont supposés avoir été délibérés en fonction de la morale admise et donc lui être conformes. Ensuite, second niveau, il y a, la déontologie, qui dans la plupart des situations fixe précisément des règles et donne des consignes, nous apportant en somme des réponses avant même que nous ayons à nous poser véritablement les questions. Elle nous indique la conduite à tenir ou à éviter et les choix à faire et à ne pas faire, et généralement cela suffit, fort heureusement, aux besoins habi-tuels de l'action courante. Enfin, troisième niveau, lorsque se présentent des doutes ou des hésitations sur les choix à faire, lorsque s'avère nécessaire un débat mettant en cause tel ou tel aspect de la déontologie ou la morale, lorsque s'impose une interrogation sur les valeurs, les normes ou les principes eux-mêmes, alors on aborde la sphère de l'éthique. Se demander au nom de valeurs qu'on estime plus hautes ou d'idéaux plus désirables si on doit se soumettre à tel article de la déontologie, si on doit accepter jusqu'au bout tel impératif de la morale ou lui en préférer d'autres jugés en la circonstance plus pertinents, c'est cela entrer dans l'éthique (10).
Pourtant on confond souvent la déontologie et l'éthique et parfois on les laisse confondre à dessein. Il faut savoir pourtant que déontologie est un faux mot grec qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire de grec ancien car c'est une fabrication de circonstance : il a été construit sur déon, ce qu'il faut ou contraire ce qu'il ne faut pas. Cette idée d'un logos du déon, d'une science du il faut et du il ne faut pas qui a donné déontologie, est due à Bentham, un philosophe utilitariste anglais du 19ème siècle précurseur du libéralisme et elle entretient l'illusion que la déontologie et l'éthique ont la même origine, le même statut, le même poids et la même signification. Il n'en est rien pourtant, car l'éthique et la déontologie représentent en fait deux démarches différentes et même à beaucoup d'égards opposées. D'abord, une déontologie, qui est par définition professionnelle, est pour un métier donné un code de l'interdit et de l'obligatoire, les deux pôles qui dans le système de la modernité encadrent et enserrent la liberté, la prenant en tenaille et ne la tolérant que résiduelle et, nous le voyons aujourd'hui, de plus en plus limitée. Elle est un code fixe pour des situations-type, un système de décisions toute prêtes, une source a priori d'in-jonctions (11). Si vous m'y autorisez, je prendrai sur ce point un exemple qui a l'avantage d'être extérieur au domaine de l'action médicale et médico-sociale et qui est donc à la fois neutre et de portée très large. Il s'agit du texte d'un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une banque : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des dirigeants, des employés et bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse" (12). Ce texte nous donne à penser et surtout il nous permet de faire un magnifique voyage. Avec le tout début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le "royaume des normes". Avec la suite et l'évocation de la bonne foi, on peut apercevoir encore, si on passe rapidement, le champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a changé de monde, on est dans la déontologie, ici la pure déontologie financière, la logique sans pitié du profit. On voit donc la délimitation entre déontologie et éthique et le passage de l'une à l'autre quand la déontologie devient problématique, dès que s'engage un débat avec soi-même sur les valeurs et les idéaux en cause dans une situation concrète. C'est ce que fera par exemple l'employé de banque en se demandant un beau matin si par humanité, il ne doit pas prolonger gratuitement le découvert d'un client père de famille au bord de la ruine, même si cette décision ne va pas dans l'intérêt de la banque qu'il a pourtant juré de défendre et n'est donc pas conforme à la règle déonto-logique - mais au fond pas du tout morale - qui en principe s'impose à lui. Et peut-être est-ce ce client ruiné qui aura lui-même opposé aux menaces brandies par la banque un refus de soins d'un genre particulier. La frontière est nette : dans la déontologie, il s'agit de se conformer, donc d'obéir, certes de manière éclairée, alors que dans l'éthique il s'agit de décider de l'action juste et de la qualité de notre contribution au monde, autrement dit d'être libre (13) : l'éthique est avant tout une libre interpellation du savoir et du pouvoir,
Telle est, en tout cas, la consubstantialité de l'éthique et du refus de soins que je vais maintenant tenter de replacer dans l'ensemble plus vaste de cette petite philosophie du dire-non que je vous ai annoncée tout à l'heure et qui correspond à la sympathique demande qui m'a été faite de "donner une épaisseur à la notion de refus y compris dans d'autres sphères que le soin", en raison, je suppose, de quelques réflexions que j'avais consacrées au dire-non en 2017, à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme (14). Bien entendu, on ne doit pas mettre tous les refus sur le même plan : les refus de soins, qui portent la marque de l'incertitude, de la souffrance, de la crainte ou de la désespérance, ne sont pas nécessairement des refus d'allure héroïque mais ils ont souvent une dimension tragique et il ne vous semblera peut-être pas sans intérêt de vous demander en arrière-plan de ce que je vais dire à présent quelle place ils occupent dans ce qui est leur lieu naturel, le dire-non humain.
L'intérêt d'une éthique du refus, en effet, c'est qu'elle prend complètement à revers l'idéologie du consensus dans laquelle nous vivons : elle s'oppose aux positivités triomphantes et elle proclame que c'est la négation qui est créatrice et non pas l'affirmation, comme le prétendent les discours convenus et les conditionnements médiatiques. Pensons à l'idéal humanitaire qu'Henri Dunant a tiré des horreurs de la bataille de Solférino pour créer en 1863 la Croix Rouge. On voit très bien par cet exemple que l'idéal de paix est le fils tardif de la guerre, que l'idée de repos est la fille de la fatigue, que la justice est la fille du refus de l'injustice, que l'idée de loisir est la descendante en ligne directe des souffrances que nous inflige le dur labeur et même que c'est dans le rapport à sa propre négation, la maladie, que la santé elle-même trou-ve son sens. Toujours l'émergence des positivités intervient en rupture par rapport aux néga-tivités correspondantes. Or c'est justement ce que la modernité voudrait nous faire oublier. Par les temps qui courent, le désaccord a mauvaise presse. S'il en survient un qu'on n'a pas su empêcher, il est mis sur le compte d'un échec de la communication : c'est qu'on a mal expliqué, il faut faire plus de pédagogie, selon la formule consacrée. L'idéal est à présent le consensus, mais le plus souvent le consensus est un accord qui justement n'a pour fondement que l'absence de refus. C'est donc le moment de parler de ce que Sartre appelle la "négativité productrice" (15) c'est-à-dire de la positivité de la négativité. L'idée de refus recouvre un ensemble large allant du simple énoncé négatif à toutes les variétés du dire-non : la dénégation, le démenti, la dissension, le désaveu, la protestation, la résistance, dans l'ordre de la pensée comme dans l'ordre de l'action. L'esquisse que je vais tenter aura une visée tour à tour ontologique (qu'est-ce que refuser, quelles sont les tonalités et les fonctions du refus), épistémologique (comment délimiter les concepts en cause dans l'idée de refus) et pour finir éthique (quel est le bon usage du refus).
Premièrement, ontologie du refus, dessinée à grand traits : le refus est l'arrière-plan de l'existence des hommes, il en est la trame. C'est le refus qui trace la délimitation entre l'humanité et l'animalité, car l'animal fait principalement ce que lui dicte son corps et seul l'homme est capable de se dire non, de se refuser à lui-même : "l'âme, disait justement Alain (16), c'est ce qui refuse le corps. [L'âme, c'est] ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de prendre quand le corps désire". Penser aussi, c'est dire non, dit Alain, car "réfléchir, c'est nier ce qu'on croit" (17). Mais une ontologie du refus doit porter également sur la diversité du dire non : refuser peut être aussi contester, protester, se soustraire, se rebeller. Le dire non du refus a mille nuances : pensons au veto, ce refus absolu qui tient sa force herculéenne du fait qu'il peut s'élever, solitaire, quand tous les autres disent oui ; pensons au refus indirect, et qui se prête à une interprétation sans fin, de la désapprobation, de la désobéissance, de la dénonciation, du démenti, de l'objection, du retrait, de la démission ; au refus militant exprimant une fin de non-recevoir opposée à l'ordre des choses, tel qu'on peut le trouver dans l'insoumission, l'insurrection ; au refus symbolique qu'on voit dans l'indignation, si bien incarné par le mouvement des Indignés, assis sur les marches de l'Opéra Bastille ou ailleurs dans une dénonciation silencieuse d'une rare force ; au refus intérieur inébranlable et sans merci décrit par Vercors dans Le silence de la mer, où un vieil homme et sa fille opposent à l'officier allemand qu'ils sont tenus d'héberger, sous l'Occupation, un silence qui est une impressionnante négation de la présence de l'autre et une envoûtante manière de l'exclure du monde. Le lexique en atteste et l'énoncé "refus de" a toujours une grande force qui dépasse celle des positivités. Les exemples ne manquent pas : le refus de soins, bien sûr, mais il y a la même force ou presque dans refus de la misère, refus de vente, refus de vote (qui n'est pas l'abstention), refus de priorité et aussi, radical, polyvalent et splendide dans un registre plus militaire, refus d'obtempérer.
Il faut donc faire place, dans une ontologie du refus, à une analyse de l'intensité du dire non et au refus qui en devenant chronique se transforme en style de vie ou devient un mode de relation au monde. On pense ici au refus nihiliste nietzschéen (18) au refus intraitable où les armes sont mises au service d'une vérité supérieure dans un combat sans fin (19) et à tous les cas où le refus est si désespéré qu'il devient lui-même un espoir comme, par exemple, celui des Prisonnières de la Tour de Constance, enfermées des dizaines d'années dans des conditions abominables parce qu'elles refusaient d'abjurer leur foi. Elles avaient gravé sur la margelle d'un puits le mot résister qu'on peut voir encore aujourd'hui (20). Mais il faut penser aussi, à l'autre bout de l'échelle d'intensité du refus, à la puissance infinie des refus minuscules comme celui de Bartleby, le personnage de Melville (21), engagé comme copiste d'un notaire et qui d'abord zélé et consciencieux refuse ensuite certains travaux de plus en plus nombreux, avec la célèbre formule "j'aimerais mieux pas" (I would prefer not to), jusqu'à ne plus travailler du tout et devenir par ce refus lisse, par cette réticence chronique, la réticence étant un refus distillé, le symbole de la résistance passive (22) qui sape l'ordre établi.
Se pose en même temps la question du refus comme risque, de la difficulté majeure qu'on rencontre lorsqu'en refusant une chose qui existe on est obligé de s'en remettre à une chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire lorsque le refus semble conduire à l'inconnu ou au néant. Pour prendre un exemple historique et politique (23), on n'aurait pas pu pendant la Nuit du 4 août 1789 mettre fin à l'Ancien Régime puisqu'on n'avait pas élaboré le modèle qui allait le remplacer. On n'aurait pas pu non plus répondre à l'appel du Général de Gaulle en juin 1940, faute d'imaginer par avance le schéma de ce qui allait arriver, généralisation du conflit - montée en puissance de la Résistance - entrée en guerre de l'URSS, ce qui montre que répondre à cet appel n'était pas tant un acte d'adhésion qu'un acte de refus et qu'un authentique refus ne s'appuie pas sur ce qui est possible mais au contraire se dresse pour décider ce qui le sera. Paradoxalement, le refus est la source du possible et non pas sa limite. De tels exemples abondent dans l'histoire des savoirs et des idées comme dans celle des luttes et des actions quotidiennes : ils montrent que refuser en l'absence d'hypothèse alternative, c'est-à-dire en pratique refuser sans avoir de solution de rechange, n'est pas du tout une simple circonstance particulière et méritoire du dire non, mais qu'elle en est au contraire l'essentiel. Les refus fondateurs et émancipateurs sont marqués par ce caractère d'absolue négativité : refuser n'est pas simplement délaisser une option au profit d'une autre, c'est rejeter une solution qui paraissait unique et qui voulait s'imposer à ce titre. Le vrai refus, en ce sens, c'est de consentir à se priver d'issue et se mettre soi-même dans la périlleuse obligation d'inventer, situation qui est justement une caractéristique du questionnement éthique. Refuser, ce n'est pas simplement faire un choix négatif, c'est faire un saut : ce saut dans l'inconnu, cette remise en cause de l'apparent ordre des choses sont essentiels à la fonction émancipatrice du refus. L'homme du refus est en vérité un flambeur. Un flambeur est un joueur qui non seulement est prêt à perdre, ce qui va de soi puisqu'il mise, mais que sa passion et sa folle attente d'un salut improbable rend prêt à tout perdre.
On retrouve là les origines du refus en Occident. Le refus s'était construit de façon continue en Grèce ancienne à partir de trois moments qui s'étaient succédé de façon saisissante. Je n'en dirai que deux mots. Il y avait eu d'abord le refus d'Ulysse. Au chant V de l'Odyssée, Calypso lui propose un marché: s'il accepte de demeurer avec elle au lieu de retourner à Ithaque où l'at-tend Pénélope, elle fera en sorte qu'il devienne immortel et qu'il demeure éternellement jeune, autrement dit qu'il ait un statut divin. Et là, contre toute attente, Ulysse dit non, il préfère rentrer chez lui, il oppose à Calypso un "refus héroïque de l'immortalité". C'est le premier refus existentiel, c'est-à-dire un refus par lequel il apparaît que seul Ulysse peut décider pour Ulysse. Le second temps du refus antique sera celui d'Antigone : elle refuse l'ordre de son oncle Créon, roi de Thèbes, de laisser sans sépulture son frère Polynice, laissant de ce fait son âme errante. Et c'est en bravant cet interdit qu'Antigone sera surprise et condamnée à être emmurée. Mais elle incarne alors un soulèvement absolu et sans médiation possible, elle crée un refus éthique et politique d'une profondeur abyssale, dans lequel tout refus pourra désormais trouver son origine, sa place ou son sens. Enfin, troisième temps, le refus émancipateur de la philosophie. Socrate, "maître du refus" a-t-on dit, refuse de transiger sur la vérité et par cette continuelle dissidence qu'il institue - la dissidence étant une forme de refus larvé - il installe le refus philo-sophique dans la fonction de subversion qui en est demeurée depuis la caractéristique essen-tielle. Celui qui sait dire non est depuis Platon une référence indispensable : savoir dire non à ses interlocuteurs et leur apprendre à savoir dire non en retour est la condition même de la dia-lectique. Et le refus est par là même le paradigme de la liberté. Sartre qui a toujours été l'homme de tous les refus, disait très bien que "c'est en refusant jusqu'à ce que nous ne puissions plus refuser que nous sommes libres" (24). De même L'homme révolté de Camus est un homme qui dit non mais qui en disant non ne renonce pas, de telle sorte qu'en un certain sens il dit oui. Les refus de ce type ont aussi installé la subversion dans le champ du savoir, aspect que je n'aborderai pas plus en détail faute de temps, ainsi que dans l'action, la vie collective ou la pensée politique. Le texte sublime du Discours de la servitude volontaire écrit par La Boétie en 1547, soutient sa thèse libertaire du refus libérateur. Si un pouvoir s'exerce sur nous, dit La Boétie, c'est que nous y consentons : "soyez résolus à ne plus servir et vous serez libre", autre-ment dit la première cause de servitude est l'oubli de la liberté. Ce manifeste de l'émancipation trouvera son plus bel écho dans les premiers mots du texte de Kant Qu'est-ce que les Lumières ? (26), où figure l'illustre devise "Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement !" (27) qui annonce une puissante méthodologie du refus.
Mais je reviens au refus par excellence, celui qu'on oppose à ce qui est présenté comme la seule voie possible, celui qui s'élève pour faire barrage à ce que dans l'inénarrable vocabulaire contemporain on dit incontournable. De même qu'on n'aurait pas dû, en principe, faire la nuit du 4 août avant que l'Assemblée Constituante réorganise la France, de même qu'on n'aurait pas pu en principe répondre à l'Appel du 18 juin 1940 sans rien connaître du déroulement du conflit qui a suivi, il serait à présent interdit de mettre en cause le système mondialisé et de refuser la façon dont va le monde tant qu'on n'est pas en mesure de proposer une alternative, alors que celle-ci dépend, à l'évidence, d'une invention de l'humanité qui est encore à venir. J'ai repris ici les exemples historiques que j'avais cités mais toutes proportions gardées, les re-fus de soins sans visibilité, si je puis dire, relèvent d'un schéma qui n'est pas si différent, et je vous laisse transposer au refus de soins autant d'éléments de cette petite philosophie du dire non que vous voudrez car, vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas les analogies qui manquent.
Quoi qu'il en soit, le refus est en ce sens-là la figure même du possible, le temps fort de toute émancipation, le geste premier de la liberté et une éthique du refus est donc, comme nous l'avons entrevu, une éthique non pas tant de l'insurrection que de l'espérance. C'est ce qui me conduit, pour finir, à parler comme annoncé de l'éthique du refus de soins en tant que "pratique réfléchie de la liberté", formule que j'emprunte à Michel Foucault dans ses Dits et écrits (28). La question qui se pose en cas de refus de soins n'est pas seulement, même si c'est essentiel, de savoir ce qu'est et ce que dit ce refus, ni ce qu'est et ce que dit la rupture que ce refus provoque dans le cours jusque-là bien réglé des choses. Je n'aurai pas le temps de présenter un classement des refus de soins à partir de leurs visées, par exemple désir de garder un contrôle sur le cours des choses, demande d'une écoute différente, tentative pour avoir le dernier mot, pied de nez désespéré à un destin contraire, perte d'intérêt pour la vie ou pour l'existence (encore zoè ou bios). De toute façon, d'un point de vue éthique, il n'y a pas deux refus semblables et même temps il n'y en a pas deux différents car la dignité ne se détaille pas. En fait, pour celui qui essuie le refus, puisqu'on dit essuyer un refus comme on dit essuyer une tempête, essuyer un revers ou essuyer des lourdes pertes, pour celui qui essuie le refus donc, la question est surtout que répondre à ce refus, que faire de lui. Il s'agit paradoxalement de la réponse à donner à ce qui n'était pas une question, puisque le refus de soins était déjà une réponse à une prescription à laquelle il s'était frontalement opposé (29).
Aussi bien, sur la conduite à tenir, on traite souvent le refus de soin, au moins implicitement, comme un intrus, allant au-delà des textes qui fixent des limites à l'autonomie du patient et donc à son droit de dire non (30) : par exemple lorsque par son refus il risque de se porter préjudice à lui-même ou bien lorsqu'il risque de créer un conflit insoluble en matière de responsabilité juridique ou morale pour celui qui le soigne ou pour l'institution. C'est qu'une fois ces points vérifiés, c'est-à-dire une fois franchie la dernière protection fournie par la déontologie, plus rien ne permettra d'arbitrer le conflit entre les attentes normatives de l'auteur de la prescription et le libre choix de son bénéficiaire. Les "recommandations" de l'avis n° 87 du CCNE déjà cité mettent en évidence qu'une fois le refus acté, si on peut dire, c'est-à-dire au moment précis où s'exerce l'infinie liberté du patient, qui n'a finalement que des droits, jaillissent ensemble la responsabilité et la totale solitude du soignant qui, lui, semble n'avoir, symétriquement, que des devoirs (31) - je me place, je le rappelle, d'un point de vue éthique et non pas juridique. L'épisode du refus de soins assure donc le déclenchement par le patient - et non pas, pour une fois, par le soignant - du passage de la déontologie à l'éthique. Mais en ouvrant cette perspective il entraîne la mise à l'épreuve de la liberté du prescripteur et il donne le signal d'un intense moment de vérité des valeurs. À cet instant, en effet, rien ne dit plus ce qu'il faut faire pour bien faire, rien ne permet plus d'échapper à la contingence de l'action : la démarche éthique est en fusion dans l'évènement dont elle a émergé et auquel elle ne survivra pas (32). Pour un temps se trouve ainsi rétablie dans ce qu'elle a de fondateur et de fondamental l'éthique hippocratique.
Il faut rappeler qu'avec le Serment d'Hippocrate, je parle ici du texte pythagoricien en neuf articles construits selon la technique des anneaux imbriqués (33) s'est produite pour la première fois la transformation d'une simple pratique (le soin) en une activité professionnelle authentique (la médecine) par son inscription dans un espace subitement défini non plus seulement par des objectifs ou des techniques, mais par des valeurs (34). On sait depuis qu'il faut prendre garde à ne pas faire l'inverse, qu'il ne faut jamais renoncer à l'encadrement par des valeurs au profit d'un retour cynique à l'encadrement par des objectifs ou à la régulation par des situations de fait et c'est en cela que l'éthique médicale est devenue ensuite le modèle de toute éthique. Bien au-delà des interdits et des devoirs qu'il énonce et auxquels on le réduit trop souvent, le Serment ouvre en réalité un espace éthique en posant que c'est de la conscience du praticien aux prises avec la complexité du réel et l'imprédictible nouveauté de chaque situation que relèvent les choix éclairés et justes. C'est dans chaque cas à la totalité de son savoir, de son savoir-faire, de son expérience, de sa philosophie et des idéaux du royaume des normes que celui qui soigne aura à se référer pour discerner ce que l'Éthique à Nicomaque appelle très bien "la droite règle (orthos logos) dans les circonstances difficiles de l'action". À la question de savoir que faire devant un refus de soin, le Serment (35) répond et sa réponse est la suivante : premièrement agir selon l'art, c'est-à-dire au nom du savoir et des techniques disponibles, deuxièmement agir dans le seul intérêt du patient et de ce que révèle son refus, donc au seul bénéfice de l'autre et non de soi ou de la corporation ou de l'institution ou de quelque tiers intéressé, et enfin, troisièmement, agir par un investissement personnel, c'est à dire, même si c'est par l'échange et en équipe que se vit et se répare le choc du refus, sans aucune dilution de responsabilité dans un collectif souvent insaisissable.
Cette question du refus de soin, que nous ressentons comme actuelle - et dont l'actualité est soulignée encore par la pandémie en cours - est en fait des premières questions que se sont posé les praticiens hippocratiques et ce n'est sûrement pas un hasard. Observateur avisé de la médecine naissante, Platon remarque au livre IV des Lois (36) qu'il existe deux façons de soigner. D'un côté, je cite, il y a "le médecin [qui] ne prescrit rien au malade avant de l'avoir persuadé d'une façon ou d'une autre. Il ne cesse pas de s'occuper de lui en adoucissant ses peines et il tente d'achever son uvre en le ramenant à la santé". On voit qu'il s'agit là d'une médecine libre - et libre aussi au sens athénien du terme - mais qu'il en existe une autre pour les serviteurs et esclaves. Et là, le médecin, sans doute esclave lui-même, se comporte bien différemment. Je lis ici deux lignes de l'analyse implacable que fait Platon de cette autre pratique radicalement opposée à la première : "aucun des médecins de ce genre ne donne d'explication à ceux qu'il soigne ni n'en accepte, mais avec une arrogance qui s'apparente à celle d'un tyran et après avoir prescrit ce qu'il croit être le mieux et comme s'il savait parfaitement à quoi s'en tenir, il s'en va et court soigner un autre malade" (37). Voilà qui montre bien que la question du refus de soins n'est pas juste un chapitre parmi d'autres de l'éthique ordinaire du soin et de l'accom-pagnement mais un redoutable révélateur de ce qui est la condition même de toute pratique médicale ou sociale qui peut se dire humaniste, la rencontre entre deux libertés. Et nous avons entrevu au passage que l'humanisme, c'est de ne jamais réduire bios à zoè.
1 - Intervention à la 5ème journée de l'Espace de Réflexion Éthique des Pays de la Loire, 29 novembre 2021 (transcription assortie de notes et références). Titre lors de la journée : "Repères et enjeux éthiques sur le refus de soin".
Lien avec la video de l'intervention et de la journée:
https://www.youtube.com/watch?v=dQAbDPwWy5M&t=4374s
2 - G. Deleuze et F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, Les éditions de Minuit, Paris, 2005. La philosophie y est définie comme "l'art d'inventer, de fabriquer et d'utiliser des concepts".
3 - R. Ogien, Mes mille et une nuits, Paris, Albin Michel, 2017, p. 34
4 - L'avis 87 du CCNE dit en ce sens que "soigner n'est pas seulement prendre en compte l'aspect médical mais l'unité même de la personne".
5 - Conférence sur l'éthique, Paris, Folio-Plus, 2015, p. 9.
6 -Cf. sur cette question J. Lombard, Philosophie de la démarche éthique. Anti-manuel d'éthique pour l'ère des néo-valeurs, Paris, L'Harmattan, 2020.
7 - Dans tous les domaines il y a une prolifération qui déferle à présent sous le nom d'éthique : par exemple, pour les évènements du monde, il y a une éthique des droits de l'homme, pour les rapports sociaux une éthique du vivre ensemble, pour les médias une éthique de la communication, pour le cadre de vie une éthique de l'environnement, et même, pour l'univers du profit, qui pourtant altère ou détruit tous les autres, une éthique des affaires.
8 - Code de déontologie médicale édité par Louis René, Paris, Seuil, 1996, préfacée par P. Ricur qui donne là son analyse du "pacte de soin" comme alliance permettant de dépasser la dissymétrie initiale du soignant et du patient.
9 - Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale de M. Canto-Sperber, Paris, PUF, 2004.
10 - Paul Ricur distingue l'éthique antérieure, qui s'intéresse aux fondements de l'action et s'interroge sur les notions et les principes, hors de toute application, et d'un autre côté, en aval des normes, une éthique postérieure, qui vise à insérer ces "normes dans des situations concrètes".
11 - De la même façon, les "recommandations de bonne pratique" anticipent sur la réflexion éthique au point de la remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel.
12- Manuel "Administration de l'établissement" d'une "caisse de crédit" de Belgique, section 2000, p. 2-2.
13 -L'éthique est un questionnement inventif et l'éthique médicale l'est plus que de toute autre, car soigner nécessite, dans un univers incertain et changeant où rôdent la faute, l'erreur, l'aléa, une pratique permanente de la décision à travers ce que Kant appelle des jugements réfléchissants. Dans la Critique de la raison pure, il pose la distinction entre le jugement déterminant, celui qui consiste à partir d'une règle établie et à l'appliquer à un cas particulier, et le jugement réfléchissant qui consiste à inventer une règle pour le cas singulier que l'on a à traiter.
14 - Cf. J. Lombard, "Dire non. Philosophie du refus", consultable à l'adresse Philosophie.Ch, portail suisse de phi-losophie.
15 - J.-P. Sartre, Situations philosophiques, Gallimard, Paris, 1990, p. 73.
16 - Alain, Définitions, 1953.
17 - Alain, Libre propos, 1924.
18 - Sur le nihilisme et Nietzsche, cf. Christian Savès, Éthique du refus, L'Harmattan, Paris, 2011, pp. 57 à 70.
19 - Cf. sur ce sujet Ph. Joutard, Les Camisards, Gallimard 1976 (rééd. Folio Histoire, 1994).
20 - Plus loin, dominant la Tour, se trouve le plateau où d'autres sauront dire non à nouveau, à la barbarie nazie cette fois, en offrant refuge aux juifs persécutés : la prison au bord de la mer et la montagne des justes sont à la fois des sommets du dire-non et des places-fortes de l'espérance.
21 - Bartleby, the Scrivener - A story of Wall Street, nouvelle parue en 1853. Cf. l'édition GF (Paris, 1989) avec la postface de Deleuze ("fuir mais en fuyant chercher une arme, dit-il aussi dans Dialogues, Flammarion, 1974).
22 - Prenant modèle sur ce Bartleby de Melville, l'écrivain italien Ennio Flaiano - le scénariste de La Dolce Vita - a édifié une philosophie du refus adaptée à nos besoins d'aujourd'hui : "Toujours préférer le refus, dit-il. Ne pas répondre aux enquêtes, refuser les interviews, ne pas signer de pétition, car tout est ensuite utilisé contre vous, dans une société clairement opposée à la liberté de l'individu [
] Refuser mais sans expliquer la raison car elle serait également déformée, récupérée [
] Ne pas préférer quoi que ce soit [
].Voir aussi Gilles Deleuze, "Bartleby ou la formule", en postface de l'édition GF, pp. 161-190.
23 - Dans le champ de l'histoire des idées, cf. J.-F. Revel La cabale des dévôts : "Montaigne n'aurait jamais dû écrire une ligne faute de pouvoir être à la fois et sans délai Galilée, Newton, Lavoisier, Darwin et Freud".
24 - J.-P. Sartre, Situations, I.
25 - C'est souvent par un certain refus paradoxal que se signale l'intervention du philosophe. Ainsi Hannah Arendt refusant lors du procès d'Eichmann la thèse soutenue par l'opinion unanime de la "monstruosité" de l'accusé et édifiant, dans la réprobation générale, sa théorie de la banalité du mal, d'une portée qui balayera tout, comme le montre le film de Margarethe von Trotta en 2013.
26 - Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les lumières ?, 1784.
27 - Sapere aude (ose te servir de ton intelligence) est un vers du poète latin Horace dans ses Épitres, I, 2, 40.
18 - M. Foucault, Dits et écrits, t. IV, texte n° 356, p. 711.
29 - Il y a là une de ces contradictions caractéristiques de toute situation éthique. Ici, le refus est générateur de trouble dans le processus de soin ou d'accompagnement alors que sa possibilité et même son acceptabilité devraient aller de soi puisque le consentement, lui, sous réserve d'être éclairé, est accepté comme prérequis. De la même manière, le savoir scientifique et l'intention professionnelle bienveillante au nom desquels la prescription a été faite sont en fait soumis au jugement du bénéficiaire, autonome mais dont le fait d'être concerné n'augmente pas la compétence.
30 - Cf. sur ce point P. Le Coz, L'Éthique médicale, Presses Universitaires de Provence, 2018, pp. 119-124.
31 - Cf. le propos attribué à Kant : "vouloir le bien des autres est la pire des tyrannies".
32 - De fait, si on ne peut pas, comme disait Aristote, apprendre la médecine en lisant des recueils d'ordonnances, on ne peut pas davantage écrire un manuel d'éthique à partir d'avis ou de décisions qui par nature s'évanouissent avec le questionnement qui les a engendrés ou se figent en déontologie ou en codes de bonnes pratiques.
33 - Le Serment comporte, dans le texte grec, neuf articles appariés entre eux, selon le procédé dit "des anneaux imbriqués", qui est une tradition remontant à Pythagore lui-même. Anneaux imbriqués signifie que l'article 9, le dernier, est à mettre en parallèle avec l'article 1, que le 8 est symétrique du 2, le 7 du 3, et ainsi de suite, l'article 5, en position centrale et donc sans symétrique, représentant l'apogée du texte et en exprimant ce qu'on appellera la quintessence : "Purs et saints je conserverai ma vie et mon art", ce qui est le point suprême, l'akmè (le sommet) de l'éthique hippocratique.
34 - Cf. sur ce point les analyses conduites, dans un champ différent, par Barbara Stiegler dans "Il faut s'adapter". Sur un nouvel impératif politique, Gallimard, Paris, 2019.
35 - Le Serment repose sur un socle auquel les plus ardents modernisateurs ont dû renoncer à toucher. Cette éthique transposable à nombre d'autres domaines a été exposée aux Rencontres Hippocrate du 13 février 2012 par Armelle Debru, en considération du grand risque qui était apparu en séance de défaire le Serment en voulant à toute force le refaire. On dira peut-être, ici ou là, que ce Serment est une vieille chose, respectable mais usée mais il faut rappeler que Freud disait que "Pompéi ne semble en ruines que depuis qu'elle est déterrée" : plus le Serment est lu comme dépassé ou inactuel et plus on découvre au contraire ce qu'il a au d'inaltérable en tant que construction du champ éthique.
36 - Cf. J. Lombard, Platon et la médecine, L'Harmattan, Paris, 1999.
37 - Platon, Lois, 720 c-e. Ce texte fait écho au Gorgias, 456 b, où Gorgias, son frère et "d'autres médecins" rendent visite à des "malades qui ne consentaient ni à boire leur remède, ni à se laisser saigner et cautériser", ce qui nécessite l'intervention de spécialistes pour convaincre les récalcitrants par une rhétorique appropriée.
Équivalence et différenciation. Perspectives éthiques d'une philosophie de l'égalité. Conférence donnée le 5 mai 2021 à Saint-Denis (Réunion)
Qu'est-ce qu'aller à l'école ? suivi d'une note sur la dénomination d'école maternelle récemment mise en cause.
Cette courte étude (dont une version complète a été publiée dans le numéro 625 des Cahiers Rationalistes) fait écho à Hannah Arendt, éducation et modernité, du même auteur, paru chez L'Harmattan.
Si la réflexion sur l'école est parsemée de tant d'embûches, si elle révèle tant de conflits - d'idéaux ou d'intérêts - qui en forment la trame tantôt visible et tantôt cachée, si elle réveille les passions, c'est parce qu'en un sens l'école, c'est nous : l'école est notre origine et notre devenir, l'objet de notre nostalgie et de notre espérance, tant ce qu'elle deviendra importe encore à ceux qui y sont allés. Surtout, il nous est de plus en plus difficile, dans un monde "de calcul glacé et de profit déchaîné", comme dit si bien Edgar Morin, de définir ce que nous entendons véritablement par éducation : nous avons du mal à distinguer ce qui dans l'éducation est institutionnel, donc de l'ordre des moyens - le système scolaire - et ce qui relève du processus à la fois essentiel et désintéressé dont ce système a la charge, l'école comme devant assurer à chacun, à partir de l'étude et de l'acquisition de savoirs, le développement sans lequel il ne peut devenir ce qu'il est - ce qui cette fois est de l'ordre des fins.
L'école, service de proximité de l'universel
Qu'est-ce qu'aller à l'école ? Pourquoi veut-on faire fonctionner à tout prix cette institution tout entière consacrée, à l'origine, au loisir et à la liberté (scholè est l'activité de l'homme libre par opposition au labeur pénible) et à qui on fait maintenant tous les reproches du monde, jusqu'à celui de produire elle-même l'échec scolaire, qui est pourtant le contraire de sa finalité ? Que ne la confie-t-on à tous ceux - et il n'en manque pas - qui prétendent savoir mieux qu'elle ce qui serait bon pour elle ?
C'est qu'en vérité l'école, service de proximité de l'universel, est seule, parmi tant de modes possibles de diffusion de la connaissance, à pouvoir répondre à un besoin bien particulier, celui d'une éducation par le savoir. L'humanité suppose en effet la médiation de la connaissance et la constitution en chaque individu d'un équipement intellectuel - et pas seulement d'une familiarité avec le réel - alors que des aptitudes instinctives complétées par l'imitation et par l'exercice, spontané ou orienté par la génération précédente, suffisent à l'animalité. L'enfant de l'homme ne peut avoir simplement des activités ou être mis en contact avec le monde, ce à quoi on tend à présent à réduire la fonction de l'école. Enseigner, instruire, ce n'est pas du tout la même chose qu'informer ou même que faire savoir. L'élève doit accéder à des savoirs, non pour le seul avantage de les posséder, d'autant qu'à l'ère de l'informatique il les a "en machine", mais pour bénéficier de ce qu'apporte leur conquête - ou en tout cas leur poursuite : le savoir scolaire, c'est littéralement celui qui passe par la tête, celui qui produit ses effets, durables et fondateurs, dans l'édification de celui qui tente de s'en emparer. Ces effets ne sont d'ailleurs pas entièrement absents lorsque l'apprentissage est insuffisant ou manqué : l'échec scolaire n'est pas la pure négativité qu'on veut nous faire croire. Avoir échoué, c'est encore être allé à l'école. Les appareils scolaires qu'on brandit comme étant plus performants sont évalués sur des résultats statistiques qui captent la réussite dans des tâches scolaires, mais ce qu'il y a d'essentiel dans le fait d'aller à l'école échappe largement à ce type de mesure qui, convient mieux, il faut bien le dire, à la production industrielle qu'à la construction humaniste du futur.
L'histoire de l'école le confirme clairement. La naissance de l'idée d'école est liée à un moment déterminé de la promotion du savoir : c'est sur le lien privilégié de l'activité scolaire avec des savoirs désintéressés que s'est construite, en Grèce ancienne, une éducation dont la nouveauté radicale a été d'emblée de conduire l'élève d'un même mouvement vers l'acquisition de la connaissance et vers l'édification d'un savoir-être dans la cité - c'est-à-dire à peu de chose près ce que nous appelons aujourd'hui, avec beaucoup de désir dans la voix, éducation à la citoyenneté. De fait, la naissance de l'école a découlé de la constitution de connaissances théoriques distinctes de leurs applications. Par exemple, ce sont les problèmes rencontrés par les techniques de construction des bâtiments qui ont en un sens créé le besoin d'une mathématique, mais c'est ce que celle-ci, une fois inventée, a comporté de théorique, d'universel et d'étranger à toute considération d'utilité pratique qui en a justifié l'enseignement, visant une véritable formation et exerçant une fonction proprement éducative. Il y a eu là un pas décisif : non plus simplement apprendre l'arithmétique requise par l'architecture, le commerce ou la navigation, mais viser à travers cet apprentissage la capacité de mémoire, la rigueur de pensée et le goût de l'étude qui pourront servir à d'autres usages et d'autres disciplines et contribueront ainsi à créer chez celui qui les possède, et du fait qu'il a accompli l'effort de les acquérir et mis en uvre à cette fin les comportements nécessaires, la capacité de devenir un homme libre et un citoyen.
Aussi bien c'est ce qui a fait choisir pour des siècles certains enseignements plutôt que d'autres : la littérature, avec tous ces textes majeurs dont J.-L. Borges dit "que les générations humaines, pressées par des raisons différentes, [les] lisent avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté", la sévère et enthousiasmante mathématique, née de l'esprit humain et qui à tout jamais le fait vivre, les sciences à la conquête du monde et en même temps de la raison, l'histoire mettant temporalité et intelligibilité dans l'aventure des hommes, etc. Les exercices scolaires eux-mêmes, même éprouvants, et parce qu'éprouvants, ont des vertus du même ordre, qui font que rien ne peut vraiment les remplacer, tant les contraintes dont ils sont porteurs sont, une fois surmontées, libératrices. Songeons par exemple à tout ce qu'un élève retire de l'expérience de la version latine, en termes de maîtrise de soi et même de technique du corps, d'attention incessante, de mise en perspective temporelle et de compréhension du passé, d'acquisitions méthodologiques pratiquement illimitées, avec l'utilisation ordonnée du dictionnaire, la formulation, la confrontation et la vérification d'hypothèses à partir de jugements portés sur la vraisemblance et la cohérence, l'obligation de procéder à des choix raisonnés par rapport aux problèmes complexes de transposition d'une langue à l'autre, etc.
Savoir et être : l'éducation humaniste
C'est volontairement qu'on a choisi ici un exemple presque provoquant tant il peut sembler dépassé (mais on aurait pu aussi bien parler d'un problème de géométrie) : ce que la version latine a la vertu de requérir et par conséquent de faire naître, car elle est le type même d'exercice où toute progression entraîne et mobilise un progrès, on tendra aujourd'hui à le demander, sans pouvoir obtenir à coup sûr un résultat équivalent, à une série d'activités (ateliers informatiques, recherche documentaire, voire séances de yoga peut-être, etc.) Cette pédagogie sera certes plus ludique - il semble à présent admis que tout doit être ludique, que le jeu est en quelque sorte l'arme absolue du pédagogue. Il n'en est rien. Certes, "le jeu est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie", selon la belle et clairvoyante formule de Pauline Kergomard inventant l'école maternelle française. L'éducation par le savoir - modèle dont personne n'a eu jusqu'ici l'audace d'annoncer l'abandon, même s'il est hélas constatable - a pour fin d'instituer graduellement un rapport au monde qui ne soit plus un jeu de découverte mais une maîtrise de l'action et de la pensée. C'est d'ailleurs le sens profond de ce que disait Pauline Kergomard. Tous les pédagogues savent bien que le plaisir du jeu est aisément remplacé, si l'action éducative est conduite comme elle doit l'être, par un paradoxal plaisir de l'effort infiniment créateur. C'est ce passage en forme de révélation à soi qui se produit quand on va à l'école.
On sait depuis Platon que la pédagogie ne doit pas s'interdire le recours aux attraits du sensible et aux activités de jeu, parce que l'étude forcée est indigne d'un futur homme libre ; mais la nécessaire primauté de l'intelligible limite cette tolérance accordée au sensible aux seuls besoins liés à l'accès au savoir. Cette difficulté traverse toute l'histoire de l'éducation : en consentant à l'oublier un instant, fût-ce même pour d'excellentes raisons, telles que rendre les apprentissages attrayants et plus faciles ou "motiver" les élèves, comme on dit à présent, on prend le double risque de s'écarter de l'objectif véritable et de compromettre ce que sa poursuite directe apporte par elle-même d'éducatif et de formateur pour la raison. C'est, dès lors, un problème majeur qui est posé : celui de la place que l'école doit faire à l'approche concrète et à la connaissance, au moyen et à la fin, à la pédagogie et à son objet, au savoir enseigner et aux savoirs enseignés. De fait, toute la suite des doctrines comme des pratiques scolaires a été marquée par la recherche d'une convergence et d'un équilibre entre les deux grandes fonctions de l'éducation, que la tradition, dans une certaine mesure, mais bien davantage encore la modernité, ont souvent opposées : la découverte du monde et la transmission des savoirs. Dans l'école humaniste dont nous sommes les héritiers, la première est assurée par la seconde et elle lui est donc subordonnée.
L'essentiel de cette éducation qui malgré le contexte très différent dans lequel on enseigne aujourd'hui, est restée le modèle de toute école, se trouve dans ce principe fondamental : loin d'être purement et simplement le résultat de la formation, le savoir est en lui-même formateur, à travers l'effort si particulier d'appropriation qu'il requiert. Autrement dit, les effets qu'on peut attendre de la connaissance ne sont pas tant dans sa possession ou dans son usage que dans les démarches qui en permettent l'acquisition. Tout savoir scolaire a donc une fonction éducative qui dépasse de beaucoup son contenu intellectuel ou sa portée pratique. D'une éducation vraiment digne de ce nom, on doit pouvoir espérer des résultats non pas seulement en termes d'avoir mais aussi et surtout en termes d'être. D'ailleurs le mot même d'élève renvoie à l'idée d'élever, c'est-à-dire à un niveau existentiel et non pas à une possession qui pourrait se juger à la quantité, comme dans l'image convenue du "bagage" scolaire.
Mais pour que ce lien entre savoir et être qui fonde l'action d'éduquer soit effectif, pour qu'il produise l'effet attendu, il faut que l'acquisition du savoir reste réellement au cur des activités scolaires et pour cela que soient remplies deux conditions fon-damentales : d'une part que les disciplines et les contenus enseignés soient de nature à garantir la portée éducative des connaissances à acquérir et d'autre part que les modalités d'acquisition de ces connaissances ne viennent pas contrecarrer ou empêcher l'exercice de cette fonction éducative du savoir.
Cela signifie d'abord que la vocation principale de l'école comme institution éducative n'est pas d'enseigner directement et en tant que tel ce qui sera utile à la future vie d'adulte de l'élève mais d'enseigner à cet élève ce qui le rendra adulte et par voie de conséquence capable de s'approprier en permanence les connaissances dont il aura besoin - ou de les mobiliser s'il les possède déjà. L'école se doit de viser la transmission de savoirs scolaires formateurs et non de savoirs directs qui pour utiles qu'ils soient n'auraient pas été d'abord intégrés à la perspective de l'école.
Éducation et exposition au monde
Or c'est de plus en plus le contraire qui se produit : pour préparer, croit-on, de futurs citoyens avisés, on fait entrer a l'école pour transmission immédiate et sous couvert de sensibilisation des connaissances liées aux problèmes, aux intérêts immédiats, aux angoisses, avouées ou non, voire aux parti-pris militants ou aux priorités du monde adulte. La diététique, l'humanitaire, la sauvegarde de la forêt ou du patrimoine, la connaissance du monde de l'entreprise, le secourisme, pour ne citer que quelques exemples et ne pas refaire la liste des actions de prévention de tous les maux du monde dont on charge l'école, sont sans doute de nobles causes dignes d'intérêt. On peut néanmoins s'inquiéter de voir l'école toujours plus envahie, sous prétexte d'ouverture, par des activités qui exposent l'élève à une espèce d'éblouissement du réel et qui diluent, quand elles ne la contredisent pas, l'action éducative. Car seuls les savoirs scolaires, adaptation des savoirs des hommes à travers un processus spécifique dont Condorcet avait saisi toute l'importance peuvent être pour l'enfant les véritables "représentants du monde", selon le mot de Hannah Arendt, ceux dont il a besoin pour grandir : recevoir une éducation, en effet, nous l'avons vu, ce n'est pas être exposé au monde, encore moins si c'est pour lui être par avance soumis.
Il va sans dire que cette dérive continuelle vers un apprentissage direct de la vie et des choses, justifiée par la recherche d'un ancrage de 1'école dans le concret - en pédagogie comme partout ailleurs, le mythe du concret est florissant - s'accompagne inévitablement de démarches qui compromettent l'action éducative parce qu'elles prétendent imposer soit une sorte de continuelle découverte, dans laquelle le savoir constitué passe nécessairement au second plan, soit, sous couvert de modernité, des modes d'accès direct à un savoir disponible que l'on peut très bien atteindre sans avoir à travailler à son acquisition.
Les conditions dans lesquelles fonctionne aujourd'hui l'école ne sont donc guère de nature à favoriser le maintien ou l'émergence d'un processus éducatif fondé sur le savoir. À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, aux premiers temps de ce qu'on appelle avec nostalgie l'école de la République, une sorte d'attente des savoirs facilitait, sans doute, son action. À présent, les pressions conjuguées des réalités économiques et sociales, des enjeux politiques et des menaces que fait peser l'internationalisation de la problématique scolaire ont créé une attente de résultats, une sorte d'exigence formelle de réussite qui assimile l'effet de l'activité scolaire à une production sur le mode de l'industrie, ouvrant la voie à un tournant libéral dont l'idée d'étude est la première victime. Car le libéralisme scolaire est d'abord le renoncement implicite à l'idéal d'accès individuel au savoir par une démarche laborieuse : former à l'emploi, élaborer un produit - fût-il humain - qui réponde à l'attente économique, préfigurer le citoyen non plus de la cité idéale mais du monde trop réel de la consommation et de la recherche généralisée du profit, ce n'est certainement pas émanciper par le savoir et ce n'est pas non plus rendre citoyen par cet "éveil de la raison" dont Alain faisait la première tâche de l'école. La belle idée de service public d'éducation, si justement mise en avant aujourd'hui, sert trop souvent à accréditer l'existence d'une espèce de droit au succès scolaire entendu comme une espèce de prestation sociale.
L'essentiel et l'accessoire
D'autre part, tout constat d'échec ou d'insuffisance, fait le plus souvent en fonction des attentes des usagers - qui ne sont pas toutes nécessairement précises, fondées et raisonnables - appelle une nouvelle réforme, un nouveau changement de cap ou, à tout le moins, une nouvelle chamarrure de vocables. On se contente, bien souvent, comme l'a noté Alain Touraine, de "modifier l'organisation scolaire pour limiter [...] les effets négatifs de l'institution". Le débat s'enflamme toujours sur la taille des établissements, la gestion des flux, la répartition des activités, le retentissement des problèmes de la société malade sur le public scolaire l'organisation administrative, le cadre, temporel ou spatial, de l'éducation et les fameux rythmes et calendriers, mais jamais sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on doit faire dans ce cadre sans cesse réaménagé. La question dite de la semaine de quatre jours fait suite à une volonté ministérielle hautement respectable, puisque pour la première fois depuis longtemps on veut traiter les problèmes de l'école par plus d'école et non par moins d'école. Cependant les débats qui ont suivi illustrent de manière éclatante la perpétuelle confusion entre l'école qui instruit et éduque (celle que manifestement le Ministre a choisie, celle qui peut finir de bonne heure et respecter le temps de repos des enfants) et une école chargée d'une fonction utilitaire de garderie, qui fait ajouter au temps proprement scolaire des activités dites "éducatives", ce caractère n'étant nullement garanti pas plus d'ailleurs que la qualité de l'encadrement correspondant. La contradiction éclate alors entre l'éducation, dont il n'est pas si difficile de fixer les jours et heures, et le service jamais achevé à rendre à une société asservie au circuit économique, tant au niveau de la production (il faut travailler tard, et bientôt la nuit, le dimanche, etc.) qu'à celui de la consommation (il faut pouvoir emmener les enfants dans les grandes surfaces, prévoir des dates de vacances qui permettent le remplissage bien étalé des hôtels, des campings, des aires de loisir, etc.)
Ces problèmes d'organisation doivent être traités, bien entendu, mais sans oublier que l'organisation est un moyen et non pas une fin. On peut s'inquiéter de voir revenir régulièrement à l'ordre du jour des projets de réorganisation du système, comme si la toute première urgence pour une action éducative malade de l'oubli des savoirs et du pouvoir que donne leur acquisition était de passer, par exemple, à un mode de gestion plus local, ou plus global, ou plus régional, finalement peu importe. Naguère, le slogan du dégraissage du mammouth a illustré parfaitement cette confusion tenace et dangereuse consistant à mettre sur le même plan les finalités du système et les décisions touchant à son fonctionnement, qui n'ont de sens que si elles leur sont subordonnées et qui, de toute manière, ne peuvent par elles-mêmes tenir lieu ni de pensée ni de politique éducative.
Au reste, le besoin d'innover à tout prix relève de la fuite en avant. Dans un monde où prévaut l'opinion médiatique, il faut toujours que l'autorité compétente prenne des mesures, lance des projets d'action ou de réforme, modifie l'existant afin de paraître exister elle-même. De ce fait, le réseau scolaire est sans cesse lancé sur de nouvelles pistes et il ne doit finalement son salut qu'à son inertie ou à son indocilité. Constamment sollicitée par un insatiable appétit du neuf, l'école court le risque mortel d'être de moins en moins une institution par laquelle sont rendus possibles l'accès au savoir avec les conséquences éducatives qu'on en attend, mais un simple service d'accueil des enfants et des adolescents. L'accent y est encore mis, sans doute, sur des connaissances à acquérir, mais la fonction et la visée de ces acquisitions sont perdues de vue et leur place s'amenuise au profit d'activités régies par des modes changeantes, des objectifs incertains et des approches largement incontrôlées qu'on appelle éducatives pour dire assez souvent le contraire. L'éducatif se déplace ainsi graduellement du scolaire vers le non-scolaire (mais on l'enveloppe de péri) et c'est tout juste, dans certains projets éducatifs dits globaux, si les enseignants ne deviennent pas, malgré eux, la composante jugée la moins importante, la moins fiable, voire la plus suspecte, de ce qu'on appelle par un étrange abus de langage la communauté éducative. Ce sera bientôt à eux de mendier un droit de regard sur leurs écoles. Pendant ce temps, les parents qui le peuvent, offrent à leurs enfants le soutien scolaire, dont on voit bien que le marché fleurit à proportion de la progressive déscolarisation de l'école. Et peu à peu les notes et les classements, ces voies du regard sur soi et de l'émulation dont l'enfant peut se saisir pour mesurer - et donc pour réaliser - ses propres progrès, seront chassés de l'école et réservés, au même moment, au monde de la Star Ac et de tous ces concours médiatiques de danse et de chanson, revêtus d'habits toujours plus scolaires (jurys, évaluations chiffrées, pression continuelle de l'élimination) comme pour en attester le sérieux, montrant ainsi clairement ce qui compte vraiment dans une société de concurrence effrénée et sans limite.
Qu'on ne voie pas dans ces remarques l'éloge nostalgique d'une éducation sévère. Il ne s'agit aucunement de déplorer la prise en compte des besoins et des intérêts qu'à tort ou à raison on croit être ceux des enfants ou des adolescents à un instant donné, ni de contester l'ouverture si souvent demandée de l'école à son environnement, ni de renoncer à prendre appui sur le plaisir d'apprendre, ni de refuser de mettre l'élève "au centre du système", selon l'inévitable formule à succès. Mais encore faudrait-il s'entendre sur ce le sens de cette formule, devenue si incantatoire que tout sens paraît s'en être absenté. Mettre l'élève au centre du système, c'est surtout veiller à ce qu'il soit réellement le bénéficiaire de sa scolarité. Il ne faut pas que celle-ci lui procure à tout prix, pourrait-on dire, des connaissances dont la simple addition attesterait de la réussite du processus éducatif. À l'école, nous l'avons vu, c'est l'acquisition du savoir en tant que modèle sans cesse perfectionné d'autres acquisitions et non sa possession qui éduque - ce qui donne son sens à l'indispensable et méritoire éducation prioritaire.
Savoir et pseudo-savoir
Tout le problème est de rendre possible cette acquisition aux meilleures conditions, mais sans la réduire pour autant à une transmission simplifiée, factuelle et sans portée, autrement dit à une transmission qui ne transmet presque plus rien et de ce fait n'éduque pas. Il n'existe sans doute pas de pire tentation pour l'école que celle d'une pédagogie de la facilitation qui compromet par avance la valeur éducative des acquisitions, car beaucoup plus que la relation maître-élève, c'est la relation de l'élève au savoir qui est essentielle au processus éducatif. Les détours, les ruses pédagogiques, les esquives de toutes sortes peuvent rendre moins abrupt l'accès à la connaissance, mais on ne peut indéfiniment reculer, atténuer, abréger ou simuler la rencontre avec le savoir, sur laquelle repose fondamentalement l'action de l'école. Ainsi, la facilitation n'est pas la démocratisation mais son image dégradée, caricaturale et en fin de compte inversée.
En elle-même, la diversification des modalités d'apprentissage est une excellente chose. La multiplication d'activités éducatives peut sans doute compléter et renforcer le travail scolaire ou même, dans certaines limites, se substituer à lui pour respecter le rythme de certains élèves, au titre de l'unité et de la globalité de l'action éducative. Reste que toute facilitation excessive se paiera au prix fort, d'une moindre efficience éducative : éduquent pleinement les savoirs qui résistent, l'art du pédagogue étant de trouver en cette matière de justes proportions. En tout cas, toute activité, même offerte dans le cadre de l'école n'a pas nécessairement un caractère éducatif. Toute activité plaisante, ou bien divertissante, ou encore favorisant les effets de groupe ou relative à l'environnement de l'école ne possède pas ipso facto la vertu d'éduquer. Tout au plus permet-elle, dans certains cas, de mettre en évidence la part que les partenaires - et surtout les parents - prennent à la vie de l'école, accréditant utilement son action auprès des enfants. Néanmoins, le véritable poids éducatif reste dans la dimension proprement scolaire de l'activité instituée à cet effet. Leçons, étude, exercices, même si ces appellations paraissent maintenant austères, sont les seules clés, à effet non pas lointain mais immédiat, de la liberté.
Mais ne faut-il pas, disions-nous, placer l'élève "au centre du système" ? Oui, au sens où il faut d'abord respecter la condition enfantine : la prise en compte de l'enfance est depuis toujours le préalable à toute pédagogie. Mais là encore c'est l'inverse que l'on tend à faire par des pratiques qui reposent sur une perpétuelle confusion de l'enfant et de l'adulte : sous prétexte de préparer à la condition adulte, on la suppose réalisée, on la met en scène, oubliant que l'accession à la maturité ne peut s'appuyer sur le simple oubli de l'enfance ou sa mise entre parenthèses. Par exemple, l'imitation (il n'y a pas d'autre mot) de l'action civique et politique dans des conseils municipaux ou généraux d'enfants, souvent mise en place par des élus qui en toute bonne foi se veulent éducateurs - et relayée avec délectation par les médias - montre bien qu'on a perdu de vue que la pédagogie est avant tout un art de distinguer les étapes.
Il est vrai qu'enfantin et scolaire sont des mots qui à présent sonnent mal. Pourtant, ils renvoient l'un et l'autre à un moment fondamental de l'existence, celui où nous sommes en quelque sorte institués par le savoir. En ce sens, ce qui doit inquiéter dans l'échec scolaire, ce n'est pas tant l'insuffisance des acquisitions, qui est par nature toujours réparable, c'est plutôt le défaut d'éducation qui en est à la fois la cause et la conséquence et qui est autrement plus grave parce qu'il empêche cette rupture de destin que l'école a pour première tâche de produire. À l'inverse, en l'absence d'échec proprement dit, un déficit d'éducation est possible si l'acquisition des savoirs a été poursuivie pour elle-même, par des voies qui reviennent en fait à en écarter le pouvoir formateur ou par des méthodes qui traitent la connaissance comme un simple produit de consommation. C'est une des caractéristiques de l'enseignement de l'ignorance qu'a analysé J.-C. Michéa, montrant qu'il est peut-être moins "l'effet d'un dysfonctionnement regrettable de notre société [...] qu'une condition nécessaire de son expansion" : l'école produira ainsi de futures victimes du monde consumériste, des ignorants-informés qui pourront connaitre beaucoup et ne rien comprendre.
Ce type nouveau de pseudo-savoir que les besoins de l'économie mondialisée ont généré et qui subrepticement se répand dans le champ de 1'école, offre l'avantage, du fait qu'il est dissocié de toute visée explicite d'autonomie intellectuelle et de toute implication de la raison, de pouvoir être appris seul, par exemple par ordinateur. Une telle non-formation, si rien ne vient lui faire contrepoids, place d'emblée celui qui l'a reçue en position de consommateur, soumis d'avance à l'ordre économique établi. Le recours, dans la classe, à une pédagogie inspirée du talk-show télévisé, la mise en place d'activités soi-disant transversales qui consistent à comparer ou à lier entre elles des choses qu'on ignore, la tentation permanente, si actuelle, de surfer sur les savoirs conduit à ces lacunes et à ces impasses. On voit ici les limites de la lancinante question des méthodes pédagogiques à laquelle on consacre une énergie disproportionnée. Des méthodes, il en faut, certes, mais on en trouve toujours, ce n'est pas ce qui manque. Si la réussite des systèmes scolaires allait de pair avec le nombre et la subtilité des méthodes créées par les pédagogues, l'école serait partout triomphante. Il n'est donc sans doute pas aussi utile qu'on croit de leur consacrer des expérimentations souvent interminables, qui se font généralement au détriment de la mise sous tension du système. Ce n'est pas aux méthodes que tient la vraie difficulté, mais aux contenus d'ensei-gnement, c'est-à-dire au choix des savoirs à faire acquérir par les élèves, auxquels on décide de conférer le statut de savoir scolaire. Sans quoi l'école se transforme, sur le modèle de la circulation interurbaine, en une vaste autoroute de l'éducation et devient une sorte d'enseignement à distance donné sur place.
Des inconvénients de l'ignorance informée. Petit éloge des vrais savoirs
Car savoir que n'est pas savoir, être informé n'est pas connaitre, communiquer n'est pas transmettre : les pseudo-savoirs n'apprennent pas à penser. Des connaissances en îlots, aléatoires, sans vertu critique, ne peuvent évidemment assurer l'accès ni à une interprétation du monde, ni à une culture commune porteuse d'une relation harmonieuse aux autres, ni à la citoyenneté véritable, dont seule l'éducation par le savoir peut donner l'espérance. Une école entièrement livrée aux pseudo-savoirs, devenue un vaste foyer occupationnel voué à la culture jeune répondrait mieux, il est vrai, aux attentes d'un monde dirigé par le profit et le show-business. Le déficit de savoirs authentiques a été analysé sous le nom d'école déculturée, c'est-à-dire frappée par une "dislocation systématique de la transmission des savoirs" érigée en doctrine par le pédagogisme. Le souci de réaliser non pas 1'égalité des chances, voulue par l'idéal démocratique, mais l'égalité des bénéfices apparents de la scolarité conduit à mettre l'accent, plus ou moins explicitement, sur les objectifs de socialisation et de convivialité plutôt que sur l'exigence didactique et la formation intellectuelle, qui révèlent à coup sûr des inégalités plus grandes. La pédagogie bavarde préfère les sorties, les débats sur des sujets actuels ou la vague constitution de dossiers, à l'explication de texte ou à la dissertation, par exemple, dont les enjeux et les exigences sont d'un niveau évidemment bien supérieur.
Ce type de renoncement accentue symboliquement la perte d'autorité du professeur à travers celle du savoir lui-même, dont il est le représentant. Elle accrédite, à terme, une conception de l'activité qui détruit graduellement la notion de travail scolaire. Tout se passe en fait comme si on avait décidé, d'"enseigner la jeunesse aux jeunes", selon le mot de Finkielkraut, de les maintenir en quelque sorte en l'état, de leur faire oublier, avec leur condition d'élèves, ce qui fait l'ambition et le sens de 1'école, à savoir justement élever. Le versant "pédagogiste" de la contre-culture est la contre-école : à la subversion contemporaine de la culture par une pseudo-culture médiatique correspond, à l'école, celle des savoirs fondateurs par les pseudo- savoirs.
Car tout savoir n'est pas susceptible d'être un savoir scolaire. Un savoir scolaire, nous l'avons vu, est un savoir qui ne vaut pas seulement par sa possession mais par les effets éducatifs de son acquisition et par la "valeur ajoutée" qu'il apporte en augmentant la capacité d'en acquérir d'autres. C'est un savoir dont la fonction éducative dépasse de beaucoup le contenu intellectuel ou pratique. C'est un savoir dont nous nous instruisons mais qui en même temps nous instruit. Et c'est aussi un savoir qui est porteur d'une cohérence avec d'autres savoirs : la culture scolaire n'est pas faite d'éléments qui s'additionnent, elle est un ensemble structuré et structurant. Or, ce ne sont pas n'importe quels savoirs qui ont de telles vertus. Le choix de ce qu'il faut apprendre a donc quelque chose d'essentiel car rien ne serait pire, sous le prétexte de parler aux élèves de ce qui leur est familier, que de dispenser à l'école des connaissances qui aboutiraient à l'ignorance informée qui sévit partout à l'ère de la communication. En ce sens, l'enjeu de toute éducation, interculturelle ou non, est la capacité de concilier l'identité des élèves et l'universalité des savoirs.
Au remplacement actuel des valeurs de l'art par celles des loisirs et des médias techniciens correspond celui des contenus scolaires qui donnent sens aux disciplines par leur forme inférieure de compétences vérifiables par Q.C.M. L'usage intensif du mot culturel et le repli corrélatif de cultivé soulignent cette chosification de la culture. Ce n'est plus dans le regard que je suis capable de porter sur un tableau, dans la manière dont je lis un texte, ou dans ce que ce tableau et ce texte vont en retour m'apporter qui me fasse mieux voir et mieux lire, que réside la culture, cette cultura animi venue des temps où s'inventa l'école et qui permet de discerner le sens des choses et d'en apprécier la saveur. Ce sont à présent les objets eux-mêmes qui sont décrétés culturels ou non : il y a des "activités culturelles", des "animations culturelles", des "produits culturels", il y a même, dans une suprême contradiction, une "industrie de la culture". On décerne ainsi le label "culturel" à ce qui relève en fait du seul divertissement, et de simples habitudes de vie sont proclamées "cultures". Il n'y a donc plus guère de place pour la culture comme accès de plus en plus assuré aux savoirs, comme démarche qui s'enrichit indéfiniment de ses propres conquêtes et qui agit sur la personne. Pour ceux qui, victimes de cette nouvelle culture chosifiée, n'auront pas découvert dans l'étude la quête individuelle dont l'authentique culture est faite, l'interrogation du monde et de soi sera pour toujours une difficile épreuve.
L'école de demain : parc d'attractions scolaires ou stage d'entreprise ?
Là encore, ce n'est pas la modernisation de l'école qui est en cause, mais le maintien ou l'abandon de ce qui la constitue. L'utilisation des "nouvelles technologies", qui graduellement s'impose, et à juste titre, dans tous les compartiments de l'appareil scolaire, n'est pas en elle-même un facteur d'irrespect envers le savoir. Au contraire, le vrai défi de ces technologies est de réussir à élaborer une offre pédagogique qui préserve la fonction générale de formation des savoirs, quel qu'en soit le support. Car la question est de savoir si l'école pour-suivra encore demain un tel objectif ou si, comme certains semblent le recommander, elle se transformera en une espèce de parc d'attractions scolaires et deviendra un système d'échanges de moins en moins formels et de circulation, sur le modèle de l'entreprise, de soi-disant produits culturels, un service commun chargé d'organiser l'être ensemble de la jeunesse dans l'attente de son "insertion" dans le règne de la consommation. En d'autres termes si elle assurera encore une tâche qu'on pourra réellement appeler éducation, ou bien si - autres temps, autres besoins - elle sera, à tous les sens du terme, dénaturée, rendue étrangère à cette idée de la vertu éducative des savoirs dont elle était née et qui la définissait, et si pour finir elle n'aura plus d'école que le nom, vestige d'un idéal perdu.
Encore faut-il essayer de justifier cette évolution, dans laquelle l'école se nie elle-même, par une apparence de science. C'est la fonction de l'évaluation, cette idéologie travestie en objectivité qui s'est emparée du monde néolibéral. L'enquête PISA, dont on fait tant de cas à l'ère où tout doit être classé - et où les systèmes scolaires des nations sont alignés comme pour un concours de miss - correspond à des intentions parfaitement claires, malgré l'ambiguïté évidemment voulue de leur formulation : il s'agit, à travers le paradigme de la compétence, de rendre marginale la connaissance, de remplacer les savoirs par leur mise en uvre, c'est-à-dire par des savoir-faire dont disposera plus aisément l'entreprise, de substituer, dès l'école primaire, la visée du rendement à celle de la culture, la recherche de l'utile à celle du vrai, et l'asservissement réclamé par le monde de la production à l'action libératrice qui est la fonction véritable de l'école. Cette variété d'idéologie de l'évaluation correspond parfaitement à la définition qu'avait donnée Marx : une représentation illusoire qui déforme la réalité mais qui a le pouvoir d'entraîner la croyance et l'adhésion. Si l'État éducateur n'a pas encore cédé devant l'État évaluateur, cela ne devrait plus tarder.
Dans une école en route vers sa propre destruction, on s'apercevra peut-être du peu d'importance de questions dont faute de comprendre les dangers autrement plus graves qui menacent on débat aujourd'hui avec tant de passion : la querelle des rythmes scolaires, opposant à l'infini les thèses contradictoires des chronobiologistes, des médecins autoproclamés pédagogues et des autres représentants du scientisme ambiant, la prise en compte prioritaire des intérêts de l'activité économique pour infléchir les objectifs, les démarches et les contenus de l'éducation, dont PISA est de manière tantôt sournoise tantôt cynique l'antichambre, et plus largement tout ce qui fait de la modernité elle-même, qui hait le savoir, une puissante contre-école.
En attendant, le temps où on va à l'école reste le seul où on échappe encore un peu - si peu - à la rhétorique publicitaire qui régit le monde. Seule l'école permet - tout au moins le temps d'une enfance qui est en vérité de plus en plus courte - de vivre sous l'autorité du savoir et hors de tout intérêt affairé, dans cette liberté originelle de la scholè qui à présent manque tellement à la cité.
Note sur la dénomination école maternelle récemment mise en cause.
Une question a été posée dans le cadre des questions au Gouvernement (cf. J.O. du 18/12/2012, p. 7480) par une députée qui a attiré l'attention de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale sur l'appellation'école maternelle'. Cette dénomination institutionnelle, qui figure dans le code de l'éducation, laisse entendre que l'univers de la petite enfance serait l'apanage des femmes et véhicule l'idée d'une école dont la fonction serait limitée à une garderie. À l'heure où se prépare une loi de programmation et d'orientation pour la refondation de l'école, et où le gouvernement s'engage fortement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, remplacer ce nom em>genré par un nom neutre redonnerait symboliquement aux pères la place qui leur revient dans l'éducation de leur enfant, et repositionnerait l'école dans son rôle éducatif différent de celui des parents."
Cette question a tenté d'ouvrir un débat dont l'urgence et l'enjeu sont si faibles qu'elle apparaît d'emblée comme une tentative assez artificielle, opportunément imaginée pour faire parler de son auteur ou pour raviver la querelle linguistique sur l'égalité des sexes ou même pour proposer, à l'heure de la rigueur, des mesures de peu de conséquence pour le budget. Sur tous ces points, il faut d'ailleurs reconnaître qu'elle est une parfaite réussite. Le texte de la question a soulevé, en ligne, beaucoup de réactions indignées, sur le thème nos parlementaires n'ont-ils vraiment rien d'autre à faire ? - et il faut bien reconnaître que la tentation est forte, dans un premier temps, de se joindre à ce cri du coeur.
Mais la question mérite un examen plus attentif. On s'aperçoit alors qu'elle pose également, à partir d'un exemple très précis, le problème beaucoup plus complexe qu'on ne pense de savoir ce qu'il faut entendre par refondation : comment fonder encore ce qui est par hypothèse déjà fondé (ici, l'école maternelle) ? Le texte écrit de la question aborde seulement l'appellation école maternelle, pour demander son remplacement par un nom non genré
(occasion d'accroître son vocabulaire d'un mot qui n'est pas dans le dictionnaire et qui à l'écran de l'ordinateur se souligne de rouge comme un barbarisme). Il s'agit de séparer de manière en
quelque sorte plus étanche la tâche, non sexuée, d'élever des enfants, et la dimension féminine de tout soin maternel. La fonction de l'école maternelle est à peine évoquée, juste comme différente de celle de la famille, ce qui appellerait un "repositionnement", sans doute par rapport à une dérive qui n'est pas autrement précisée. En revanche, dans les propos qu'elle a tenus sur RTL, tels du moins que les rapporte le Nouvel Observateur, la députée a parfaitement rappelé la définition et les caractéristiques de l'école maternelle, la solidité de ses visées pédagogiques et sa capacité à se démarquer de tout maternage (1). Voilà qui rassure sur la valeur reconnue par l'élue à l'enseignement maternel et par conséquent sur la mise en cause de son appellation : la plaie est ainsi pansée, d'une certaine façon, au moment même où elle est ouverte.
Aucune proposition de changement de nom ne figure dans la question, mais certaines ont été évoquées à la radio. Leur faiblesse est évidente et même en un sens significative : "petite école" va à l'encontre du but recherché, "première école" télescope manifestement école primaire, auquel il serait dommage d'avoir à renoncer tant l'usage établi lui a donné de force. On remarquera à cette occasion la cohérence tout à la fois notionnelle et lexicale de l'édifice éducatif français : le primaire regroupe exactement le maternel et l'élémentaire. Et à élémentaire, mieux vaudrait ne pas toucher, au moins par respect pour l'oeuvre fondatrice de Condorcet, qui a mis ce mot en avant une fois pour toutes.
On voit bien, également, que les appellations en usage à l'étranger ne conviennent pas, précisément parce que l'école maternelle a des objectifs originaux qui font d'elles une école et non pas un jardin d'enfants ou un établissement pré-scolaire. C'est d'ailleurs ce qui a toujours fait sa grandeur. Voici le texte du Nouvel Observateur : "La députée a expliqué sur RTL avoir saisi le gouvernement pour faire débaptiser l'école maternelle qui renvoie trop, selon elle, à l'image de la seule mère. "C'est une école, pas un lieu de soin, de maternage, c'est un lieu d'apprentissage", a-t-elle plaidé. "Changer le nom en'petite école' ou'première école', c'est neutraliser d'une certaine manière la charge affective maternante du mot maternelle" ; "ça rendrait justice au travail qui y est fait, au professionnalisme de ceux qui y interviennent et ça rappellerait aussi qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'éducation des enfants est partagée entre les parents et n'est pas la spécificité des femmes", selon l'élue. La force de l'école maternelle française lui a valu d'être, après plus d'un siècle d'existence au service de l'école de la République et de ses idéaux, un modèle respecté, admiré, désiré et souvent imité, dans le monde entier.
Faut-il donc débaptiser cette invention française ? Faut-il remettre en cause d'un changement de vocable cette réussite de la pédagogie humaniste qui reste opposable, comme un ultime symbole de résistance, à l'envahissement de l'école libérale ? D'un côté, il n'est pas du tout certain que cela assurerait à la protéiforme cause anti-sexiste une avancée décisive : une pareille tâche est par nature infinie et elle demanderait à revoir de loin en loin la totalité du lexique. Les maternités, par
exemple, sont aussi des affaires d'hommes, pour quantité de raisons qu'on n'examinera pas ici, et la gynécologie est après tout une spécialité dont la désignation a des relents sexistes : elle semble exclure les hommes de son champ d'action, elle semble dire que seules les femmes sont malades, etc. En
allant au bout de telles logiques, il faudrait même s'en prendre à la mère-patrie. Et d'un autre côté, l'école maternelle est sans aucun doute le domaine dont l'histoire rendra la plus difficile toute tentative de purification par le non
em>genré : dès l'émergence du concept, pendant le dernier quart du 19ème siècle, ce sont des femmes en effet qui ont assuré tout ce développement éblouissant de la
maternelle française. Depuis les enseignantes inventives des écoles de quartier et des classes enfantines
surpeuplées jusqu'à l'inspection générale des écoles maternelles, de très grandes dames ont formé constamment le bataillon féminin de l'épopée de l'enseignement de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson. Mentionner leur militantisme pour la cause de la petite enfance ou bien faire remarquer qu'elles en ont été de façon prophétique les spécialistes, est-ce se montrer sexiste ? D'autant que leur apport a fait avancer l'école tout entière. La pédagogie maternelle peut apparaître comme une spécialisation de la pédagogie générale parce qu'elle a recours à un matériel particulier, parce qu'elle a ses rites propres qui ne sont pas ceux de l'école élémentaire, parce que celles et ceux qui y exercent forment volontiers, au sein du corps enseignant, une sorte de monde à part. Pourtant elle est en réalité la pédagogie dans sa forme la plus radicale. Aucun autre moment de la scolarité ne consiste en un contact aussi direct entre l'élève et le monde. Celui qui veut bien feuilleter un manuel de pédagogie maternelle s'aperçoit qu'on parle du temps, de l'espace, du langage, de la création artistique, des sens, du corps. On dirait un programme de philosophie pour le baccalauréat ou pour la licence. On peut aussi observer, à la porte des écoles maternelles, les parents qui y conduisent leurs enfants. Ils ne sont pas là seulement pour accompagner des tout-petits qui ne peuvent pas aller seuls : ils savent que cette école est un prolongement de leur propre action, qu'elle est jour après jour un temps essentiel de l'existence de leurs enfants, qu'elle ne distribue pas simplement du savoir mais de l'élan pour devenir. C'est ce qui explique qu'ils se présentent à l'école avec un air complice qu'ils n'auront peut-être plus jamais. Ils ont sans doute été plutôt rares, ceux qui parmi eux ont eu "l'idée d'une école dont la fonction serait limitée à une garderie". Peut-être faudrait-il ajouter que contrairement à ce que laisse entendre le texte de la question, ce n'est pas davantage ainsi qu'on se représente le rôle de mère.
Seule école dont le nom rappelle qu'elle est un parent de plus pour l'enfant, longtemps source vive des grandes avancées éducatives et terrain des innovations les plus hardies, lieu irremplaçable d'instauration de la liberté en même temps que de la discipline de soi, indispensable étape de la socialisation en même temps que de l'égalisation des chances, l'école maternelle est l'école qui rend possible l'école. Dans école maternelle, maternelle a évidemment la même signification que dans langue
maternelle. La langue maternelle n'est pas la langue de notre mère, même si c'est notre mère qui nous l'a transmise, elle est la langue dont nous sommes faits, intellectuellement, socialement et existentiellement pourrait-on dire. De la même manière, l'école maternelle est l'école dont naît l'élève. Elle a ceci de commun avec la mère qu'au-delà de ses possibles imperfections et de ses défaillances, le véritable mal est son absence. À cet égard, une politique volontariste et ciblée d'ouverture de classes maternelles, lorsqu'elle est décidée par le ministre de l'Éducation Nationale (2), est pour l'école une des meilleures nouvelles qu'il soit donné d'entendre. Même (ou surtout) sous cette belle dénomination jugée genrée.
J.L.
(1) Voici le texte du Nouvel Observateur : "La députée de Paris a expliqué sur RTL avoir saisi le gouvernement pour faire débaptiser l'école maternelle qui renvoie trop, selon elle, à l'image de la seule mère. "C'est une école, pas un lieu de soin, de maternage, c'est un lieu d'apprentissage", a-t-elle plaidé. "Changer le nom en'petite école' ou'première école', c'est neutraliser d'une certaine manière la charge affective maternante du mot maternelle" ; "ça rendrait justice au travail qui y est fait, au professionnalisme de ceux qui y interviennent et ça rappellerait aussi qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'éducation des enfants est partagée entre les parents et n'est pas la spécificité des femmes", selon l'élue".
(2) Voir la réponse du Ministre à la question de la députée au J.O. du 06/08/2013, p. 8471.
"La place d'Éros : prospective et éthique de l'intimité en situation d'accompagnement". Communication au Colloque "Sexualité en établissements et services sociaux et médico-sociaux : quelle équation ?" Sainte-Clotilde, Ile de la Réunion, 8 novembre 2019 (IRTS - collectif SAMSAH - ADC)
De Platon à Orwell. Idéaux et néo-valeurs. Conférence à la Bibliothèque Alain Lorraine, Saint-Denis (Ile de la Réunion), le 25 avril 2019.
Malgré la référence chronologique à Platon et à Orwell qui se trouve dans le titre, c'est bien d'une interrogation d'une brûlante actualité qu'il va s'agir ce soir, puisqu'elle va porter sur les valeurs au moment précis où nous entrons dans ce qu'on pourrait appeler une ère des valeurs, un monde où triomphe une lancinante rhétorique de la proclamation des valeurs, j'en donnerai dans un instant quelques exemples. Aujourd'hui, les valeurs - mais vous remarquerez qu'on ne sait jamais bien lesquelles au juste, puisque la plupart du temps on dit simplement les valeurs avec un air entendu et tout le monde semble s'en contenter - sont en tout cas au centre du discours public et surtout du discours politique, à quelque niveau qu'il soit tenu, des fêtes de village jusqu'aux plus hautes instances de l'État.
Par exemple, reçu par l'Assemblée nationale française en janvier 2018, le président du Bundestag allemand commençait son allocution en disant aux députés : "c'est pour moi un très grand honneur de m'adresser à vous en ce lieu chargé d'histoire pour votre pays et pour l'Europe et ses valeurs"(1). On remarque ici que l'appel aux valeurs a lieu dès première phrase du discours, et qu'en un sens il est effectivement la condition de tout ce qui va suivre : sans les valeurs, supposées communes, l'orateur ne pourrait pas véritablement invoquer l'Europe. Sans ces valeurs, l'Europe ne serait qu'une notion purement géographique, une "catégorie à tendance anecdotique", comme disait Kant en soutenant que la géographie n'existe véritablement que si elle est là pour donner "un lieu à l'histoire". Sans ces "valeurs" invoquées d'entrée - si peu définies qu'elles soient (2), car le texte de l'intervention n'y reviendra pas et elles n'auront donc été qu'une référence de principe et à usage incantatoire - c'est tout le discours de M. Schaüble qui aurait pu sembler dépourvu d'objet et a fortiori de portée. On voit là comment les valeurs, brandies comme des devises sur le fronton d'un monument ou comme des slogans sur les banderoles d'un défilé, servent en fait à donner une substance au discours.
D'une façon générale, l'habitude a été prise d'évoquer les valeurs soit dans cette perspective de renforcement du discours, soit dans celle plus consistante d'une sorte de référencement moral et culturel. Pour prendre un second exemple, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui s'est adressé lui aussi, environ deux mois plus tard, à l'Assemblée nationale française, a employé à trois reprises le terme de valeur, deux fois à titre de référencement à des valeurs humanistes et une autre fois comme simple renforcement du discours, quand il s'est agi de tenter de justifier l'accord commercial entre la France et le Canada : cet accord, a dit alors M. Trudeau, est "à l'image de nos valeurs"(3). On voit ici que les valeurs rassurent et qu'évoquées ainsi elles n'engagent à rien, qu'elles sont en quelque sorte solubles dans leur propre évidence.
On retrouve les valeurs - pas davantage définies - dans quantité d'allocutions de circonstance, où, sur ce modèle que nous venons de voir de l'Europe et ses valeurs, on mentionne et on glorifie l'école et ses valeurs, l'entreprise et ses valeurs, la société X ou le groupe Y et ses valeurs. Parfois même, les valeurs sont au centre du discours sans pour autant apparaître comme un idéal. Par exemple, dans son livre Construisons ensemble l'école de la confiance (4) - et il y aurait déjà beaucoup à dire sur la promotion de la confiance au rang de néo-valeur qui se dissimule derrière ce titre - l'actuel ministre de l'Éducation Nationale rappelle que l'école enseigne des savoirs et des valeurs et il met en avant comme première valeur à l'école le "respect de l'autre". Or le respect n'est pas du tout une valeur mais une attitude ou un comportement : ce n'est pas le respect qui est une valeur, c'est ce qu'on respecte qui l'est. Par respect de l'autre on désigne donc en fait une conduite et non pas un idéal, on est dans l'immanence et non dans la transcendance. La preuve en est donnée par la suite du texte, qui parle de "garantir à l'école la sécurité" : on voit bien, alors, qu'il s'agit de faire respecter non pas des personnes mais les règlements qui organisent la vie scolaire, ce qui est certes nécessaire, mais il ne s'agit pas de valeur mais de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre apparaît bien sûr comme un objectif plus noble si l'ordre est présenté comme une valeur - ce qu'il n'est pas, puisqu'il est manifestement un moyen et non une fin.
Alerte dans le ciel de l'éthique : des OVNI nommés valeurs
Quoi qu'il en soit, les valeurs gagnent chaque jour du terrain, au moins en apparence, et nos politiques sont de grands moralistes ou se présentent en tout cas comme tels. En outre, le ressassement médiatique porte l'évocation des valeurs à des sommets. Il s'est aggravé avec la place prise par les chaînes info et leur répétition vertigineuse : avec cette information en continu où tout ce qui est arrivé arrivera plusieurs fois par heure et pendant de longs jours, c'est en permanence que nous entendons évoquer les valeurs et qu'emportés malgré nous par cette foi nouvelle injectée à heures fixes et à doses massives, nous finissons par les invoquer nous aussi : en tête, avec les incontournables valeurs de la République, les valeurs de la famille, les valeurs du sport, les valeurs citoyennes, les valeurs de tel ou tel corps de métier (car vous ne pouvez plus à présent faire poser une fenêtre sans avoir droit à une déontologie du PVC). Il y a aussi, jumelles au sens d'à la fois inséparables et identiques les valeurs de droite et les valeurs de gauche, pratiquement interchangeables parce que c'est une caractéristique constante des valeurs d'être à la fois hiérarchisées et indissociables : par exemple, ce qui est juste est nécessairement aussi à certains égards vrai et beau et vice-versa. En réalité on ne devrait pas dire les valeurs de ceci ou de cela, en leur assignant des compartiments, car un tel découpage n'est pas compatible avec le statut transversal des valeurs - nous y reviendrons - et on voit bien que les valeurs qui nous sont présentées comme étant celles du sport, de la famille, de l'entreprise ou de la République sont finalement les mêmes, comme cela apparaît très vite si on entre dans le détail.
Dans l'ère des valeurs où nous vivons, les valeurs nous sont offertes un peu comme les objets en vente dans une grande surface : elles sont destinées à remplir l'abyssal vide de valeurs de la société marchande et à faire passer les hiérarchies économiques pour des hiérarchies morales. Beaucoup parmi ces valeurs dont on nous parle tant - valeurs de l'entreprise, du couple, etc. je ne recommence pas la liste - ne sont en vérité pas du tout des valeurs : si on les regarde de près on voit qu'il s'agit plutôt, en réalité, des préférences de groupe, de désirs collectifs, de normes sociales, d'orientations existentielles, de styles de vie, de préjugés idéologiques ou culturels, voire, pire encore, de règlements déguisés ou d'éléments de propagande qui ne disent pas leur nom. Avec cette multiplicité confuse et trompeuse, les valeurs sans cesse invoquées ont tout de ces phénomènes qu'on observe sans vraiment pouvoir les identifier et dont on ignore la nature exacte, ce qui est la définition même des OVNI. L'ère des valeurs a commencé par une espèce d'alerte aux OVNI dans le ciel de l'éthique, comme le confirme l'existence d'un Observatoire des valeurs (5).
C'est cette situation astronomique à tous les sens du mot que je souhaite examiner maintenant. Je vous propose de questionner d'abord l'idée même de valeur, qui appartient au lexique moderne mais qui est issue d'une tradition philosophique ancienne. Nous allons voir que malgré les illusions répandues par le discours convenu, les valeurs ne sont pas des choses : on ne peut pas partir avec ses valeurs sous son bras, ni les imposer à son voisin, ni les décréter ni les inculquer aux enfants, comme on dit si maladroitement. Même leur apparente réalisation momentanée, quand elle se produit, ne fait pas d'elles des objets disponibles, elles ne s'offrent jamais toutes faites. Il conviendra, dans un second temps, d'analyser cette chosification dont nous sommes les témoins à l'époque pré-orwellienne que nous vivons. Enfin j'essayerai pour terminer de dire ce qu'on peut appeler ou non valeur, car la leçon de la vision d'Orwell dans son illustre livre 1984, dont nous allons parler, c'est qu'il faut absolument sauver les valeurs avant qu'un terrifiant futur ne les engloutisse sous nos yeux.
Référence à l'invisible : l'horizon des valeurs
Premier point : la vogue actuelle des valeurs pourrait faire croire que l'idée de valeur est une création de la modernité. L'exercice un peu obligé de mise en perspective historique du lexique entretient cette illusion : tout bon dictionnaire étymologique renvoie à valeur au sens premier de bravoure (la valeur qui rend valeureux), donc en gros au 11ème siècle et à la chanson de Roland, puis à la longue décantation à l'âge classique, et on cite alors inévitablement Corneille et la fameuse valeur qui "n'attend pas le nombre des années". En fait, la valeur comme référence de ce qui vaut et du fait de valoir (6) existera surtout à partir du 18ème siècle avec l'irremplaçable analyse que fait Kant de ce qui vaut absolument, analyse qui marque une rupture radicale avec la relativité de la valeur d'échange des économistes (7). Ensuite, mais je n'y insisterai pas, au 19 ème siècle, Nietzsche (8) et Max Scheler (9) feront du concept de valeur le centre de la démarche éthique, après quoi la modernité pourra se définir comme une crise des valeurs, dans laquelle on verra - ou on ne verra pas, c'est selon - le signe d'une décadence.
En réalité, si l'usage du terme de valeur semble moderne, l'idée de la référence à des idéaux transcendants est liée, en revanche, aux premiers temps de la philosophie. La valeur a même été le tout premier champ d'action des philosophes et Jean Beaufret disait en ce sens que la philosophie grecque a été "une première variation sur le thème de la valeur" et que la philosophie naissante s'est donné pour première tâche de fixer une échelle des valeurs (10). De fait, il y a bien eu deux moments essentiels de ce qui a constitué en Grèce ancienne l'invention des valeurs et du coup l'invention de l'éthique, car l'éthique est elle-même le moment de vérité des valeurs.
Le premier moment est le socratisme. Dans le Lachès de Platon, un des interlocuteurs dit en parlant de Socrate : "il nous entraîne dans un discours sans fin jusqu'à ce que nous rendions raison de nous-mêmes, de la manière dont nous vivons ou de celle dont nous avons vécu dans le passé"(11). Autrement dit, celui qui rencontre Socrate est remis en question dans ce qui est le fondement de sa vie, il prend conscience du problème qu'il est pour lui-même : les valeurs qui sont les siennes sont révélées, reconsidérées et le plus souvent renversées par l'examen socratique. Et ce qu'on a appelé, lors du procès de Socrate, corrompre la jeunesse n'est pas autre chose que le fait, pour le philosophe, d'enseigner à ses disciples le refus des fausses valeurs.
Un second grand moment de l'invention de la philosophie des valeurs dans l'Antiquité est sans aucun doute l'épisode illustre de la contre-façon de la monnaie par Diogène de Sinope, le maître de l'école cynique (12). Avec son père, qui était le gérant de la banque publique de Sinope, leur cité, il a falsifié la monnaie non pas à des fins d'enrichissement mais pour bien montrer qu'aux yeux du sage la vraie monnaie est en réalité la fausse - fausse comme le sont les conventions, les honneurs, le pouvoir, la vanité, les richesses en général. Paradoxalement, falsifier la monnaie c'est la rétablir dans sa vraie nature, c'est la purifier de ce qu'elle a d'artificiel - et cela, bien sûr, ne vaut pas que pour la monnaie. Diogène voulait dire que les vraies pièces de monnaie sont des contremarques sans valeur et qu'à tout prendre, les fausses pièces sont plus vraies que les vraies dans la mesure où, par le scandale que constitue leur fausseté, elles renversent les valeurs de la cité, elles aident à dénoncer le prix exorbitant et artificiel des choses et elles proclament, d'une façon aussi explosive qu'inattendue, que le bonheur n'est pas dans la possession mais dans l'être. Avec cette falsification cynique, la Grèce nous a légué un modèle de génération des valeurs par la négativité. Car les valeurs naissent le plus souvent de la négation de leurs contraires. Par exemple, l'idéal de paix est le fils tardif des horreurs de la guerre. Ainsi la Croix Rouge est née de l'expérience qu'a faite Henri Dunant de la terrible bataille de Solférino. De même la justice est, comme Antigone elle-même, la fille rebelle de l'injustice et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas de valeur qui n'ait sa source dans un certain refus du monde comme il va. Aujourd'hui, refuser le règne de l'impitoyable loi du plus fort, contester la distribution de l'humanité entre des vainqueurs et des loosers, dénoncer l'anarchie de ce monde du profit où il faut "marcher sur les autres pour avoir un peu", c'est pour chacun dire non à sa participation au monde tel qu'il est et instituer des valeurs différentes de celles de la cupidité régnante.
Voilà donc pour la source des valeurs. Mais une fois passé le stade initial du refus, les valeurs connaissent encore une existence ambiguë. Observons par exemple qu'on peut donner sa vie pour des valeurs, mais aussi que pour ces mêmes valeurs, exactement les mêmes, on peut tout aussi bien tuer - c'est ce qu'on voit dans toutes les guerres. Ensuite, autre trait marquant, les valeurs tout à la fois sont et ne sont pas. Alain disait en ce sens qu'"il faut croire à la justice parce qu'elle n'est pas" (13). De fait, rien n'est réel dans les valeurs sauf la place que de loin en loin nous leur faisons : les valeurs sont une perpétuelle référence à l'invisible. Nous ne les rencontrons jamais : ce que nous rencontrons "ce sont des biens ou des maux, des objets utiles ou dangereux, des hommes bons ou méchants, des institutions" (ou des actions ou des décisions) "justes ou injustes" (14) : des valeurs se trouvent impliquées dans tout cela, mais n'y sont pas enfermées. Elles y sont présentes mais d'une présence fragile et parcellaire. Il n'est question de valeurs, disait Ricur, que lorsque nous nous "arrachons au cours des choses, à la nature et à ses lois", lorsque nous nous tournons vers une transcendance que nous appelons selon le cas justice, fraternité, solidarité, etc.
Autrement dit, les valeurs n'existent que si, de façon paradoxale, nous nous dirigeons vers quelque chose qui nous dépasse. Et en effet le mode d'être des valeurs est à bien des égards incertain et flottant. Certes, si nous nous interrogeons sur les valeurs, nous pouvons d'abord être rassurés car en un certain sens elles sont bien là, à chaque moment de notre existence. Dans un passage célèbre de L'Être et le Néant, Sartre analyse cette continuelle présence des valeurs : "Je suis engagé dans un monde de valeurs", dit-il, car "dans ce monde où je m'engage, mes actes font lever des valeurs comme des perdrix"(15). Cependant, remarque-t-il, les valeurs ne sont pas déjà là avant mon passage, elles n'ont pas été posées à l'avance "comme des écriteaux qui interdisent de marcher sur le gazon" - admirons la formulation sartrienne. Autrement dit, contrairement à la tranquille conviction du sens commun, ce n'est pas après avoir contemplé l'honnêteté que les "honnêtes gens", s'en inspirant, deviennent honnêtes, c'est exactement l'inverse, de la même façon que c'est l'indignation que je ressens qui me signale la bassesse de ce dont je m'indigne et l'admiration que j'éprouve qui me donne l'idée de la grandeur de la chose que j'admire : pour le dire en termes existentialistes, c'est par "la réalité humaine que la valeur arrive dans le monde" - je cite ici de nouveau L'Être et le Néant. Les valeurs sont "la saisie réflexive de la liberté par elle-même", dit le texte plus loin, et c'est ce qui explique que tout en s'offrant légères et multiples comme des perdrix dans leur envol, elles soient comme cet envol et comme tout envol "insaisissables"(16). À les "prendre comme des êtres, on risque de méconnaître leur irréalité", dit enfin Sartre, car elles ne sont pas de l'être mais du dépassement d'être. Je prendrai sur ce point l'exemple d'une valeur qui est emblématique de l'idéal humaniste, la dignité.
Consistance et précarité : l'exemple de la dignité
On sait avec quelle insistance la dignité est quotidiennement invoquée, qu'il s'agisse du discours éthique, juridique, politique, social ou médical. Par exemple, la demande de légalisation de l'euthanasie est associée à la formule droit de mourir dans la dignité. De même, la décision du Conseil de l'Europe d'interdire en 1999 le clonage humain s'est fondée sur l'idée qu'il est contraire à la dignité. Pour autant, la dignité n'est pas seulement une constante du discours bioéthique. Si on veut demander une amélio-ration des conditions de travail, on évoquera aussi la dignité des salariés. Si on cherche à faire interdire ou réglementer la prostitution ou la pornographie, on mettra en avant la dignité de la personne. Ou encore, pour parler des devoirs qu'on a envers soi-même, on fera appel à l'idée de dignité sous l'angle du respect de soi, etc.
La dignité est invoquée dans tous les grands débats sur la liberté ou sur l'interdiction de vendre ou d'acheter des services sexuels, sur la question de la gestation pour autrui, laquelle implique comme on sait la déconstruction de toute la représentation humaine de la parenté. La dignité est devenue un concept si large qu'il sert d'argument universel et de véritable passe-partout dans le débat éthique (17). Du coup, la dignité, en tant que valeur, sert à justifier tout et son contraire, comme le montre à merveille l'exemple du lancer de nains sur lequel nous reviendrons si vous le souhaitez. Dans le débat sur l'euthanasie, la dignité est utilisée pour plaider tout aussi bien la dépénalisation que l'interdiction, les deux camps en présence se servant de la même idée de respect de la dignité et donc de la même valeur pour soutenir des thèses diamétralement opposées. Ceux qui s'opposent à l'interruption volontaire de la vie entendent par dignité que toute vie humaine est sacrée et que personne n'a à juger de sa valeur en vue d'y mettre un terme. Ceux qui militent pour la légalisation de cette interruption de la vie disent que toutes les vies ne se valent pas, que seuls ceux qui les vivent peuvent juger de leur valeur et décider si elles sont dignes ou bien indignes d'être vécues : à l'abri du même concept, ils disent donc exactement le contraire (18).
Ruwen Ogien demandait, dans une analyse provocante mais subtile et surtout très actuelle s'il faut ou non, en vertu d'une certaine idée qu'on se fait de la dignité, condamner moralement une pratique qui consisterait à rester des journées entières vautré sur son canapé à regarder des séries américaines à la télévision en se gavant de gros biscuits chocolatés (19). Si on répond que ce n'est pas indigne, en tout cas pas plus qu'autre chose, on accepte une idée au fond peu glorieuse de la liberté. Mais si on répond au contraire qu'il n'est pas digne d'être aussi avachi, aussi improductif, aussi stupide, aussi gourmand et à terme aussi obèse, on risque tout simplement de nier la liberté, car si la liberté n'est pas posée comme infinie, au moins dans son principe, on ne saura jamais où tracer la ligne où elle s'arrête et qui l'anéantit toute entière. Mais alors, comment la dignité peut-elle être à la fois indispensable et risquée, consistante et précaire (20) ? Justement parce qu'elle est une valeur et qu'en tant que telle elle est asymptotique et que, si on peut dire, sa réalité est idéale. Sa précarité n'est pas une de ses faiblesses, elle est son essence même : Dupréel, philosophe des valeurs du 20ème siècle, disait qu'il est essentiel à la nature de la valeur "de ne pas être assurée d'être" (21). La place des valeurs est sur une ligne vers laquelle on se dirige sans l'atteindre, elle est donc un horizon, puisque l'horizon, comme chacun sait, recule quand on avance. Nous ne trouvons les valeurs que dans une projection de nos engagements, une poursuite de nous-mêmes. Simone de Beauvoir disait même que sans le fondement que leur donne notre liberté, il n'existerait pas de valeurs (22) et que c'est "l'existence humaine qui fait surgir dans le monde les valeurs d'après lesquelles elle pourra juger les entreprises où elle s'engagera".
Malaise dans les valeurs : l'esprit de sérieux de la mondialisation
De ce fait, objectiver les valeurs, les tenir pour des idéaux préétablis, les poser comme des modèles auxquels il n'y aurait qu'à se conformer, croire qu'on les atteint du seul fait qu'on s'en recommande, c'est en réalité fuir sa responsabilité et renoncer à sa liberté. C'est exactement ce que Sartre appelait l'esprit de sérieux, cette forme de mauvaise foi et de lâcheté par laquelle, angoissés que nous sommes de ne pas pouvoir nous soustraire à notre liberté, de ne pas assumer notre responsabilité, nous tentons de nous cacher derrière des prétendues valeurs ou des présumés devoirs qui ne tiennent leur validité et leur poids que de nous et de nos choix. "L'esprit de sérieux, c'est de considérer les valeurs comme des choses toutes faites"(23) derrière lesquelles on peut trouver peureusement refuge.
Le principal signe du malaise dans les valeurs qui s'est à présent installé est justement la pression qui est exercée sur chacun afin qu'il choisisse son camp, qu'il se prononce clairement pour la moralité ou pour ce qu'il est prié de considérer comme la moralité. Car tel est l'esprit de sérieux de la mondialisation : il faut désormais avoir des valeurs, faire partie de ceux qui ont des valeurs. Ainsi on répète béatement à tout propos mes valeurs, nos valeurs, vos valeurs, leurs valeurs : toujours le lexique de la possession, exactement comme quand on dit mes actions, nos contrats, vos bureaux, leurs comptes en Suisse. L'amour sans limite pour les positivités est, il est vrai, une caractéristique de la modernité. Jusqu'ici, le verbe avoir était déjà utilisé pour parler de valeur, puisqu'on disait avoir une valeur ou avoir de la valeur, mais on ne disait pas avoir des valeurs (24). Dire j'ai des valeurs est une façon d'afficher une sorte de garantie de moralité, par opposition à ceux qui n'en affichant pas sont les suspects, les infâmes, les dangereux déviants qui s'écartent du credo et ne récitent pas le catéchisme néolibéral. La problématique des valeurs semble à présent se réduire, si on n'y prend pas garde, à la logique binaire du titre elliptique du roman d'Hemingway En avoir ou pas (25).
On voit tout l'intérêt que cette chosification représente pour le système néolibéral : il est bien plus facile, surtout pour la contourner, d'avoir à faire à une morale constituée à partir de valeurs toutes faites et classifiées, qu'à une authentique morale qui serait un mouvement constituant dans lequel les valeurs prendraient leur source et trouveraient leur sens. C'est ce qui explique le sentiment que nous éprouvons souvent d'une invasion des valeurs, d'un apport continuel de néo-valeurs vagues. Je pense à toutes les néo-valeurs à succès que sont, pour ne citer que quelques exemples, la transparence, le partage, l'ouverture, la convivialité, la mixité, la proximité, la traçabilité, le dépassement de soi, et même le vivre-ensemble (26), qui sont aujourd'hui brandis à l'égal du vrai, du bien ou du juste, alors qu'ils n'ont en réalité de sens que par eux. Mais dans l'univers édifiant et prude des médias, où chacun semble parler au nom de la vertu, tout finit par trouver une place dans ce genre de valeurs ambiguës et évanescentes, donnant raison à Kierkegaard quand il définissait les valeurs comme des "illusions confortables". On dirait qu'il suffit d'invoquer les valeurs pour bénéficier de leur protection, on dirait que ce qui compte, c'est de les nommer, de les afficher, de les dire. On voit bien à présent que les classifications de valeurs se multiplient jusqu'à fabriquer une espèce de carte du tendre des valeurs. Un document établi par des professionnels du coaching (27) dit ceci : "vous pouvez trouver vos valeurs dans ce tableau". Et là, en 14 lignes et 5 colonnes, soit 70 cases contenant une valeur chacune, on trouve tout, en effet, de la générosité au travail en équipe et à l'authenticité, de rendre service à avoir le choix ou à se faire plaisir. Et ce n'est pas encore suffisant : "vous pouvez ajouter les valeurs qui vous sont propres", dit encore ce texte ineffable.(28). En somme, la devise du monde libéral pourrait être : chacun ses valeurs et la morale sera bien gardée. De la même façon, on peut s'interroger sur le système monobloc de ces valeurs de la République dont tout le monde se réclame et que personne ne définit plus. La République elle-même n'est d'ailleurs pas une valeur ni un système de valeurs mais un régime, c'est-à-dire un mode d'organisation des pouvoirs.
Apparaissent aussi nombre de valeurs ad hoc, de valeurs de circonstance - ce qui est contradictoire dans les termes car en vérité aucune valeur ne peut être de circonstance - et nombre de ces prétendues valeurs se révèlent être en réalité des normes, des règles, de simples faits de culture, des pratiques ou des coutumes respectables, sans doute, mais sans aucun lien voire même en complète opposition avec l'exigence et la revendication d'universalité que porte en elle toute valeur véritable (29). Dans ce flot incantatoire se glissent aussi les pseudo-valeurs si en vogue sur le net. On peut par exemple découvrir, présentées sous l'appellation valeurs, "les dix qualités incontournables du leadership entrepreunarial"(30) ou cette définition du leader comme étant celui qui "met en avant un certain nombre de valeurs". Le mot hideux entrepreunarial à lui seul exprime parfaitement l'artificialité, l'incongruité et les excès du monde libéral. On pourrait même en fabriquer une étymologie à la manière du Cratyle de Platon (31), quand Socrate s'amuse à montrer comment les mots s'expliquent par leur ressemblance avec les choses qu'ils désignent. On apprend aussi dans le même site que les valeurs sont "au sein d'une entreprise, des leviers de performance" : alors l'Orange attitude pourrait bien être une valeur, elle est, nous dit-on, "à la croisée de principes moraux et de stratégies marketing - croisée qui est évidemment impossible. Valeur aussi quand Nestlé s'engage (32) et la preuve que c'est bien une néo-valeur, c'est qu'on ne saura jamais vraiment à quoi. La valeur n'est là qu'une une ruse de plus de l'idéologie mercantile et productiviste, un simple outil de promotion - et on n'en doute plus en lisant dans la Tribune de Genève qu'en préparant la défense de ses intérêts, je cite, "la haute horlogerie défend ses valeurs face à la crise"(33). L'actualité politique montre bien à quelles contradictions conduit une néo-valeur à la mode qui est l'exemplarité : l'exemplarité est une néo-valeur mort-née par excellence puisque donner l'exemple suppose une sorte de valeur déjà réalisée et indépassable qui contredit donc sa propre idéalité.
L'expansion et la chute : l'effet novlangue sur les valeurs
Ces événements sémantiques doivent nous alerter parce qu'ils ne révèlent pas un simple renouvellement superficiel du discours mais une déstructuration en profondeur de tout le champ des valeurs qui sonne comme la menace d'un monde sans valeurs et donc sans éthique. Le concept même de valeur se trouve aujourd'hui endommagé selon un processus qui nous renvoie à la constitution du novlangue dans 1984 de George Orwell. Vous avez lu sans doute et en tout cas vous connaissez cette anticipation si éclairante du despotisme moderne, dont on ne peut pas oublier la figure métaphorique de Big Brother, qui décrit comme chacun sait un univers totalitaire dans lequel ont été graduellement abolies toute pensée libre et toute existence individuelle grâce notamment à une technologie avancée - on pense au redoutable télécran qui jusque dans chaque logement donne à voir et à entendre dans les deux sens, assurant une surveillance généralisée - mais aussi par la mise en place d'un langage empêchant toute pensée différente de celle du Parti (Parti avec une majuscule évidemment). Le totalitarisme suppose en effet un conditionnement radical qui rende impossible toute critique - surtout de l'État - ce qui entraîne la mise en oeuvre d'un langage neuf, le novlangue, où le vocabulaire est réduit, où la grammaire est simplifiée et les nuances rendues inaccessibles afin de paralyser toute pensée spéculative porteuse d'un risque de contestation. La méthode est d'hébéter le peuple pour le contrôler, ce qui nécessite une désinformation systématique sous une apparence d'information. On se souvient des trois célèbres slogans de l'Océania, le pays où se déroule l'action : la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force, formules dont toute rationalité semble s'être absentée (34). On voit bien là comment intervient une véritable destruction du langage. On remarque aussi en ce moment un début de novlanguisation du vocabulaire politique en France quand le Ministère de la santé déclare supprimer des lits pour améliorer les soins, quand le Ministère du Travail soutient qu'en défaisant le Code du Travail il étend les garanties des salariés et quand le Gouvernement proclame qu'une nouvelle loi anticasseurs vise en fait à protéger le droit de manifester. Presque tout ce qu'Orwell avait déjà présenté comme caractéristique d'un régime totalitaire aux dimensions planétaires concerne d'ailleurs ce que nous appelons maintenant la mondialisation et plus largement ce que tout processus unificateur entraîne avec lui de confusion et d'ambiguïté. Ainsi, nous voyons bien que si tout est valeur, plus rien n'est valeur et si plus rien n'est valeur, alors tout est valeur - on dirait de nouveaux slogans de l'Océania (35). Autrement dit, l'extension extrême du concept de valeur finira par le détruire ou par l'abolir en faisant éclater sa compréhension. Ce risque d'implosion concerne toute la novlanguisation du lexique contemporain de l'éthique, et même si aucune intention proprement bigbrothérienne n'est pour le moment avérée, on peut remarquer une chute des valeurs qui revêt principalement deux aspects.
D'abord, l'ensemble du système des valeurs est de façon de plus en plus marquée centré sur la morale, les valeurs morales ou en tout cas de prétendues valeurs morales prenant le pas sur toutes les autres. L'appel à ces valeurs se généralise dans la vie politique : "travail, famille, patrie, mérite, ordre, discipline, autorité"(36). La chute du système des valeurs se fait au bénéfice d'un conservatisme inébranlable à travers une moralisation par les valeurs, devenues les instruments d'un permanent contrôle moral : Mikel Dufrenne disait déjà, parlant de notre époque, que "les valeurs tombent du ciel pour soutenir l'ordre établi"(37). Ce processus d'altération des valeurs au nom d'une prétendue exigence de moralité institue une forme dégradée de la morale (38). On se souvient que Nietzsche avait donné le nom de moraline (das Moralin) à ce genre de morale donneuse de leçons, à ce terrorisme pseudo-intellectuel à la fois culpabilisant et décadent (39). Ainsi, quelqu'un qui tente à présent de s'opposer à la politique dominante ou à la pensée unique sera attaqué, on le voit constamment, d'un point de vue moral, sur sa personnalité ou son passé : il sera mis à mal sur le plan moral plutôt que combattu sur le terrain politique (40). On touche là à ce que Tchouang Tseu, le philosophe chinois, appelait "l'odeur rance de sainteté dont les peuples raffolent"(41).
Un second aspect de la novlanguisation concerne une évolution qui affecte, à partir des valeurs, le champ de la morale dans son intégralité. Il s'agit de la régression par laquelle chaque niveau se replie vers le niveau immédiatement inférieur. Avec cette dégradation, l'universel devient le général, la société se réduit au système du marché, la valeur se fige en norme, l'éthique s'affaiblit en déontologie. Alors que l'éthique est questionnement et usage critique de la raison, la déontologie est un code fixe pour des situations définies et une source d'injonctions sans débat (42). Un exemple frappant en est donné, dans le domaine de la banque, par le code de déontologie d'une Caisse de Crédit qui mérite d'être cité. L'engagement qui doit être signé lors de l'embauche par les futurs employés (43) dit ceci : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des dirigeants, des employés et des bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse".
Ce texte permet de faire en quelques mots un magnifique voyage. Avec le début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le ciel des valeurs. Avec la suite, l'évocation de la bonne foi, on aperçoit encore, si on passe rapidement, le vaste champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a changé de monde et on est dans la pure déontologie financière, on est hors du champ des valeurs, on est dans la logique sans pitié du profit. On voit ici la séparation et même l'opposition entre la déontologie et l'éthique. Quand il y a une hésitation sur les choix à faire pour respecter la déontologie, dès qu'apparaît une interrogation sur la mise en oeuvre des règles ou dès que s'engage un débat, on se trouve dans la sphère de l'éthique, donc dans le royaume des valeurs : se demander, au nom de valeurs qu'on juge plus hautes si on doit se soumettre ou non à telle prescription de la déontologie, c'est cela, entrer dans l'éthique. En ce sens, l'éthique est le lieu des valeurs et donc de la liberté et la déontologie est celui de la compromission avec le réel et de l'obéissance.
Peut-être l'employé de la Caisse de crédit qui avait signé cet engagement jugera-t-il un jour, devant un client ruiné et une famille détruite, qu'il est sans doute plus conforme à l'idée qu'il se fait de la justice de ne pas défendre ou du moins de ne pas défendre seulement l'intérêt de la caisse. Peut-être ressentira-t-il le besoin d'opposer une transcendance à un geste mécanique, un idéal à la triste loi du réel, une valeur à ce que dicte, sous le nom de déontologie (44), la simple codification de la pratique.
Présence absente, règne des fins, idées régulatrices
Il agira alors au nom d'une valeur. La véritable question que posent maintenant les valeurs si nous ne voulons pas nous réveiller demain en 1984 et dans un monde orwellien est donc celle-ci : à l'heure de leur profusion et du manque qui paradoxalement en résulte, comment distinguer les valeurs de leurs contrefaçons ? Je voudrais pour terminer, tout en renvoyant faute de temps à une autre occasion une analyse plus approfondie des néo-valeurs, répondre précisément à cette question en indiquant trois grandes caractéristiques des valeurs qui permettent, me semble-t-il, de les identifier : leur saisissante présence absente, leur appartenance sans partage au règne des fins et leur fonction d'idée régulatrice au nom d'un absolu.
Une toute première propriété des valeurs et le signe le plus certain sans doute de leur authenticité est qu'elles sont présentes en leur absence et absentes alors même qu'elles sont présentes. En d'autres termes, une valeur est un idéal qui a cette particularité qu'"en étant réalisé il reste encore un idéal"(45). Prenons cette fois, pour changer, l'exemple d'une valeur esthétique, le beau : les musées et les salles de concert sont pleins d'uvres où la beauté a été atteinte et incarnée et pourtant, après tant de tableaux sublimes qui ont été peints et exposés et tant de grandioses symphonies qui ont été composées et interprétées, en tant que valeur, la beauté reste encore à inventer et à désirer, et tous les peintres et tous les compositeurs continuent de la rechercher et de la poursuivre chaque jour dans les tourments de la création. Autrement dit, les valeurs sont encore transcendantes et inaccessibles même lorsqu'on a déjà pu ou cru pouvoir les approcher. D'une certaine façon, la valeur est l'objet d'un désir toujours inassouvi : elle est comme l'eau qui recule devant l'homme assoiffé ou les fruits qu'on ne parvient qu'à effleurer du bout des doigts, selon la lumineuse légende grecque du supplice de Tantale. C'est même le propre de toute valeur de ne pouvoir être contenue ou enfermée dans aucune des réalisations qu'elle a inspirées. Qu'on ait toujours besoin de la désirer et de la viser encore, c'est justement ce qui fait qu'elle est une valeur (46) et qu'elle ne puisse jamais être autre que ce qu'elle est, c'est ce qui fait son universalité : ainsi, pour revenir au domaine moral, la générosité et le sens de l'honneur sont des valeurs même pour les pires bandits. En sens inverse, une valeur brandie sans être aucunement désirée n'en est plus une. Qu'est-ce donc par exemple que la liberté quand le peuple, dans une prétendue démocratie, ne décide en pratique plus rien de ce qui touche réellement à son propre devenir ? Qu'est-ce que l'égalité si on accepte sans rien dire des inégalités dépassant toute mesure ? Qu'est-ce que la fraternité lorsque l'insolente prospérité de quelques-uns n'est même pas troublée par la triste condition qui est faite à tous les autres ? En ce sens, les valeurs sont des irréels qu'étrangement le réel peut ensevelir (47).
Un second caractère des valeurs, tout aussi essentiel, est qu'elles appartiennent sans partage au seul règne des fins et sont radicalement étrangères à celui des moyens. Par exemple, je lis dans un texte fourni par un site de création d'entreprises (48) qu'une "culture d'entreprise, c'est avant tout les valeurs que vous souhaitez partager" - nous connaissons cette chanson-là - et que "les entreprises qui ont une forte culture d'entreprise sont six fois plus performantes que les autres". N'allons pas plus loin : si des objectifs de rendement et de profit entrent dans l'affirmation de valeurs, celles-ci cessent aussitôt de l'être, car une valeur asservie à d'autres fins qu'elle-même n'est plus une valeur. Kant a montré dans une analyse fondatrice qu'il n'y a de valeur que ce qui n'a pas de prix, que de ce qui est objet non pas d'échange ou de commerce, mais seulement de respect. "Dans le règne des fins, dit-il, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui mérite le respect"(49). Autrement dit, une valeur exclut toute demi-mesure, elle ne peut être qu'un absolu attaché à l'humanité qui est une fin en soi. D'autres fins sont également respectables - nous n'avons rien contre les bénéfices ou la prospérité - mais elles ne relèvent en aucune façon de l'absolu des valeurs. En ce sens, dès qu'un slogan publicitaire brandit une valeur, il la disqualifie, il la nie en tant que valeur et d'un point de vue éthique il se dévalorise lui-même. Malheureusement une absorption de la valeur morale par la valeur économique se retrouve dans la plupart des prétendues chartes éthiques des entreprises.
Par exemple on note, parmi les cinq valeurs fièrement annoncées par la "Charte éthique" de Dassault Aviation, la "performance économique", qui est définie par la rentabilité financière, où la valeur est donc clairement économique et non morale, sans que le rédacteur ou son commanditaire semble s'être aperçu et encore moins étonné du faramineux glissement de sens du mot valeur qui fait littéralement exploser son texte. Deux préceptes de Bruno Lamborghini expriment cette ambiguïté des rapports entre l'économie et de l'éthique. Le premier dit : "le défi pour l'entreprise est de veiller à servir d'exemple". Fort bien. Mais le second dit : "une bonne conduite est la condition d'une expansion continue", ce qui révèle le dessous des cartes. Quand on dit qu'il faut être moralement parfait pour faire le plus de profit possible, c'est le profit qui devient une valeur suprême et la morale qui est déchue. En fait, il y a toujours un équilibre à trouver entre la pureté de la vertu et la morale du tiroir-caisse, sans parler des tiroirs-caisses sans morale, simples jouets de la cupidité et du cynisme ordinaire de l'économie moderne.
Enfin un troisième critère d'identification de la valeur est la possibilité de la rattacher à une catégorie qui permet de la penser comme telle. Les valeurs ne sont ni des principes dont il n'y aurait plus qu'à décliner imperturbablement les prescriptions à la manière d'une procédure, ni de simples modèle ou des constructions effec-tuées à partir d'une réalité constatée dont on voudrait a posteriori faire une norme. Elles sont des idées régulatrices. Ainsi par exemple l'idée du juste, est régulatrice (50) par rapport au champ du droit positif et au domaine de la loi : elle est la référence idéale qui permet d'ordonner les systèmes naturels dominés par l'injustice et l'inégalité. De même, l'idée régulatrice dans le domaine du soin est l'humanité : par exemple, quand nous sommes malades, nous ne voulons pas être soignés par des robots ni comme des robots et quand nous sommes soignants, nous ne voulons pas accomplir des gestes qui se réduisent à une pure technicité. Le double lien par lequel, dans l'acte de soin, chacun fait droit à la dignité de l'autre au nom de la sienne propre est porteur de cette valeur commune qui est précisément l'humanité. À l'aune de ces critères, nombre de soi-disant valeurs dont chaque jour la communication nous accable pour présenter comme vertueuse la société détestable où nous vivons passeront à la trappe des objets illusoires. Les valeurs sont les formes intelligibles qui peuvent survivre à ce tri. Mais un monde dérégulé, qui se choisit et qui se proclame tel, comme le monde néo-libéral, tente toujours de réduire les idées régulatrices suprêmes que sont les valeurs au rang de simples faire-valoir, objets d'une dérisoire délectation média-tique. Si des néo-valeurs sont indéfiniment ressassées, c'est parce que le Big Brother qui nous attend au tournant essaie de faire passer les valeurs pour allant de soi et de nous faire croire qu'elles sont déjà sont réalisées du simple fait qu'elles sont invoquées, que le monde est sur la bonne voie et que nous sommes priés par conséquent d'approuver tout ce qui se fait en notre nom et pour notre plus grand bien.
En réalité, dans un monde où il ne restera bientôt plus de liberté qu'économique, la morale sera évidemment dissoute. Déjà les grands débats moraux d'aujourd'hui sont d'interminables sagas qui sont vides de tout véritable contenu éthique : l'équité dans la succession de Johnny Halliday, les abus sexuels dans le monde du cinéma et la pédophilie dans l'Église, les emplois fictifs et les fraudes fiscales dans le monde politique et tant d'autres problématiques sans issue qui sont brassées sans fin avec une sorte de délectation pour leur dimension de scandale - la dernière étant évidemment la moralité du mécénat dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le point commun entre ces thématiques à haute prétention morale - mais qui sont en réalité biaisées par la substitution de l'économie et de la politique à l'éthique - est qu'on en arrive à travers elles à nous faire adhérer à des pseudo-valeurs déjà novlanguisées ou en passe de l'être, à un monde où tout étant soi-disant moral du coup plus rien ne l'est. Toutes ces pseudo-valeurs suffisent à notre société moderne où domine la communication. La communication, en effet, "est la transmission et la propagation de l'information", comme disait Gilles Deleuze en rappelant que l'information est "un ensemble de mots d'ordre" et que "quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire".
Cette continuelle propagande de la mondialisation conquérante ne rencontre plus qu'un ultime obstacle, celui que lui oppose l'éthique et que je résumerai ainsi, en forme d'avertissement : le règne des valeurs, ce n'est jamais quand on n'a pas le choix mais au contraire toujours quand on l'a (51) - ou quand ne l'ayant pas on s'en empare - ce qu'ont fait les hommes dans les moments de l'histoire où ils ont, souvent contre toute attente, approché de plus près l'horizon des valeurs. On pense par exemple à la Révolution française, si bien décrite par Kant comme le passage de l'état de minorité asservie à celui de majorité responsable. La Révolution a sans aucun doute été, de point de vue éthique, le plus extraordinai-re renversement de valeurs qu'ait connu le monde et on voit bien qu'elle l'a été parce qu'elle a vraiment affirmé et non pas aseptisé la liberté.
Notes :
1 - Wolfgang Schaüble s'est exprimé en français au Palais Bourbon le 22 janvier 2018 à l'occasion de la résolution sur un "nouveau traité de l'Elysée".
2 - On peut supposer qu'il s'agit des "valeurs de l'Union" dont la liste figure dans les traités de Maastricht et de Lisbonne : respect de la dignité humaine, démocratie, état de droit, tolérance, solidarité
3 - M. Trudeau était invité le 17 avril 2018.
4 - Jean-Michel Blanquer, Construisons ensemble l'école de la confiance, Éditions Odile Jacob, 2018, p. 167 sq.
5 - http://www.observatoiredesvaleurs.org
6 - Cf. l'article "valeur" du Dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, PUF, Paris, 2001, p. 606.
7 - Rudolf Eisler, Kant-Lexicon, Gallimard, Paris, 1994, pp. 1058-1059. Marx traitera très tôt de la valeur d'échange en lien avec la valeur d'usage, au tout début de Misère de la philosophie (1847).
8 - Cf. Nietzsche, "Nos valeurs sont des interprétations introduites par nos soins dans les choses", La volonté de puissance, livre 2, t. I, § 134. Le renversement (réévaluation) des valeurs est un concept nietzschéen.
9 - Dans Le Formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs, 1916 (Gallimard, Paris, 1991), Max Scheler prolonge Nietzsche puis fait des valeurs des essences idéales saisissables par une intuition : le juste, le sacré, le noble, etc.
10 - Jean Beaufret, Philosophie moderne, Dialogue avec Heidegger II, éd. de Minuit, Paris, 1977.
11 - Platon, Lachès, 187 e. Cf. l'interprétation de Pierre Hadot dans Éloge de Socrate, Allia, Paris, 1998, pp. 31-32.
12 - Sur Diogène et la falsification de la monnaie, cf. E. Helmer, Diogène le cynique, Les Belles Lettres, 2017, p. 144 sq.
13 - Alain, 81 chapitres sur l'esprit et les passions, IV, 7.
14 - Mikel Dufrenne, Pour l'homme, Seuil, Paris, 1988.
15 - J.-P. Sartre, L'Être et le Néant, Gallimard, Paris, 1943, p. 74.
16 - Id., p. 131-132. La liberté sartrienne est à la fois rapport de l'existant au monde et relation de l'existence à soi.
17 - Dans toute activité de soin, la notion de dignité renvoie à deux choses : d'un côté à la réalité, aux conditions matérielles et psychologiques du soin et aux situations souvent difficiles et jugées plus ou moins dignes ou plus ou moins indignes qui les accompagnent ou qui en résultent, et d'un autre côté à une sorte d'invariant ontologique qui est l'idée de l'être humain en tant que tel, qui n'est pas susceptible de plus et de moins et qui est indépendante de toute circonstance particulière. On voit qu'il y a une double nature de la dignité, avec un versant réel et un versant idéal, qui se conjuguent de manière différente selon les époques. Dans l'hôpital du Moyen Âge, la situation matérielle du malade, accueilli dans des salles communes, le caractère rudimentaire de la plupart des soins dispensés, la place modeste de la lutte contre la douleur, ont des aspects qui sembleraient plutôt indignes selon notre jugement d'aujourd'hui. En revanche, dans ce monde médiéval, les soins sont placés sous une sorte de protection divine : l'hôpital s'appelle une maison-dieu (ou un hôtel-Dieu) et le personnel soignant est invité à recevoir le patient hospitalisé comme "s'il était le Christ en personne". Ce qui fait alors la véritable dignité du malade, c'est qu'il est une créature de Dieu dont il faut sauver le corps si possible mais surtout l'âme.
18 - Le lancer de nains est une attraction d'origine américaine qui consiste, dans des bars ou dans des discothèques, à lancer un nain casqué et portant une tenue rembourrée le plus loin possible sur des matelas. En France le Conseil d'État a décidé qu'un maire peut interdire le lancer de nain comme portant atteinte à la dignité de la personne humaine et troublant l'ordre public (27 X 1995). On peut penser, inversement, que la dignité du nain est dans sa liberté de se produire dans le rôle de son choix et de tirer avantage de sa condition. Cf. Céline Husson, "Lancer de nain ou lancer de nains, variations sur un thème", L'Europe des libertés, 2005, n° 11.
19 - Cf. Ruwen Ogien, L'éthique aujourd'hui, maximalistes et minimalistes, Paris, Gallimard, 2007, p. 11 et p. 130 sq.
20 Id., p. 172. Cf., du même auteur, La vie, la mort, l'état, le débat bioéthique, Paris, Grasset, 2009, pp. 87-88
21 - Eugène Dupréel, Esquisse d'une philosophie des valeurs, Paris, Alcan, 1939.
22 - S. de Beauvoir, Pour une morale de l'ambiguïté, Paris, Gallimard, 1947, p. 20
23 - S. de Beauvoir, Pour une morale de l'ambiguïté, op. cit., p. 47 sq. On notera l'analyse du monde enfantin, dans lequel il n'est possible que de "respecter et obéir", les valeurs existant ailleurs (dans un monde adulte) "comme il existe un soleil et une lune". Ce processus d'infantilisation ne vaut pas seulement pour l'âge mais pour toute situation générant la servitude et il est tout aussi vrai dans la bigbrothérisation présentée par G. Orwell dans 1984. Sur l'esprit de sérieux, cf. Sartre, L'Être et le Néant, p. 75. Dire j'ai des valeurs c'est dire au fond il y a des valeurs et il existe donc une instance qui les fixe : c'est le point de départ de la mauvaise foi, par laquelle nous refusons notre responsabilité (cf. L'Être et le Néant, p. 98). Dans l'ontologie sartrienne, l'homme est "condamné à être libre" et il projette donc librement les valeurs qui déterminent son action, qui ne lui sont pas données par une puissance extérieure. Aussi bien, la moralité est une "adhésion à soi", selon le mot de S. de Beauvoir (op. cit., p. 43).
24 - Cf. sur ce point André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris, 1947, p. 1159 sq.
25 - To Have and Have Not est paru en 1937.
26 - Cf. sur cette notion au statut incertain B. Jolibert, L'unité politique et la diversité, Autour du "vivre-ensemble", Paris, L'Harmattan, 2016. Comme valeur, le vivre-ensemble relève de la même contradiction que l'exemplarité (cf. p. 11).
27 - Cf. Ebook - Les valeurs, 2012.
28 - Une incursion sur les sites commerciaux d'internet permet de découvrir des énoncés complètement vides de sens qui sont supposés représenter des valeurs. Par exemple si vous allez sur la rubrique "valeurs" du site d'une "conciergerie de luxe" à Paris, Tao prestige - corporation en pointe en matière de communication et de startupmania - vous voyez s'afficher une liste dite "valeurs et philosophie du groupe" dont les éléments sont : excellence et challenge, satisfaction client, service personnalisé, politique d'excellence, éthique et confidentialité, évaluation selon des critères rigoureux, qui sont évidemment des pseudo valeurs ou des néo valeurs qui renvoient les unes aux autres dans une chorégraphie sans fin, exactement comme un dictionnaire qui définit consciencieusement le commerce comme trafic et négoce, puis le trafic comme commerce et négoce, puis le négoce comme trafic et commerce
29 - Cf. sur ce point l'étude d'A.- M. Drouin-Hans, "Valeurs et culture(s) : peut-on encore penser l'universel ?" in Tréma, 23/2004. Voir en particulier III, 3 : comment "en elles-mêmes les traditions ne sont pas des valeurs". Sur les valeurs ad hoc, voir Le Canard enchaîné du 17 janvier 2018 où on apprend que "la loyauté vis-à-vis de François Hollande est une valeur" (propos de Stéphane Le Foll).
30 - Cf. http://marcobernard.ca/10-qualites-incontournables-leadership-entrepreneurial
31 - Cf. Platon, Cratyle, par exemple 400 b sq.
32 - Parfois l'objectif est défini : à Abidjan "Nestlé s'engage à accroître l'employabilité pour plus de 300.000 jeunes". En France, d'après La Dépêche du midi, Nestlé s'engage "à n'utiliser que des ufs de poule élevées en liberté".
33 - Tribune de Genève, 10 novembre 2016, p. 15.
34 - G. Orwell, 1984, Gallimard, Paris, 2017, p. 14.
35 - Le système de désorganisation de la pensée qu'expose 1984 est symbolisé par les attributions des ministères de l'Océania : la guerre pour celui de la Paix, les mensonges pour celui de la Vérité et la famine pour celui de l'Abondance. Le but du novlangue n'est pas de donner à penser mais de "rendre impossible tout autre mode de pensée".
36 - Ruwen Ogien, L'Etat nous rend-il meilleurs ?, Gallimard, Paris, 2013, p. 239 sq.
37 - Des études marquantes ont déjà montré le rôle que ces valeurs morales ont joué à des moments-clé de la politique américaine, par exemple, lors de la réélection de George W. Bush en 2004, lorsque l'électorat modeste avait voté pour les positions moralisantes défendues par le candidat républicain, la valeur famille, la valeur vie, la valeur sécurité, au détriment de ses propres intérêts et des valeurs d'égalité ou de fraternité.
38 - Ce thème de la dégradation de la morale en une sorte de "sagesse sirupeuse" se trouve déjà en Chine ancienne et Tchouang Tseu parle de "l'odeur rance de sainteté dont les peuples raffolent" (Les uvres de Maître Tchouang, trad. Jean Lévi, p. 7).
39 - Il y a trois occurrences du mot dans L'Antéchrist et Ecce homo de Nietzsche, toutes les trois négatives (moralinfrei).
40 - On voit alors que les néo-valeurs sont les représentantes d'une espèce de sagesse des nations se fondant sur de pseudo évidences morales. Cf. S. de Beauvoir, "L'existentialisme et la sagesse des nations", op. cit.
41 - Tchouang Tseu en tirait la célèbre conclusion : "Eliminons la sainteté, éradiquons la sagesse".
42 - Les "recommandations de bonne pratique", formule de plus en plus utilisée, anticipent sur la réflexion éthique au point de la remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel fixé d'avance.
43 - Extrait du manuel "Administration de l'établissement" d'une "caisse de crédit" de Belgique, section 2000, 2-2.
44 - La déontologie est une éthique professionnelle, donc limitée à un contexte déterminé. Elle est une théorie des devoirs, positifs ou négatifs, rassemblés dans un code spécialisé qui renvoie non pas aux valeurs mais au permis, qu'elle délimite, au prescrit, qu'elle recommande, et au défendu, qu'elle condamne et promet à une sanction. En pratique elle est un code de l'interdit et de l'obligatoire, les deux pôles qui dans le système de la modernité encadrent et enserrent la liberté, ne la tolérant finalement que de plus en plus résiduelle.
45 - Paul Césari, La valeur, PUF, Paris, 1957, p.1.
46 - Pour reprendre l'exemple de la dignité, on peut tenir a priori pour suspecte la maison de retraite qui prétend atteindre un total respect de la dignité de ses résidents et de ses personnels et considère ainsi comme un acquis ce qui en tant que valeur doit rester une visée.
47 - Socrate disait déjà que "le bien n'est pas l'essence mais quelque chose qui est au-delà de l'essence, dans une surabon-dance de majesté et de puissance" (Platon, République, VI, 509 b).
48 - Cf. blog neocamino.com
49 - Kant, Fondements de la métaphysique des murs, II.
50 - Ricur dit en ce sens transcendantale : cf. Le juste, la justice et son échec, L'Herne, Paris, 2005.
51 - Sartre dit bien, suivant Kant sur ce point, que la morale consiste dans le fait que "la liberté veut elle-même et la liberté des autres" (L'existentialisme est un humanisme, p. 85).
Direction d'établissement social et rapport aux valeurs. Éléments pour une éthique du pilotage. Communication faite à la Journée d'étude IRTS - ADC "L'éthique dans la fonction de direction. Interroger ses pratiques de direction et d'encadrement" (établissements sociaux et médico-sociaux), IRTS de la Réunion, Saint-Benoît, 7 décembre 2018.
Je vous remercie de m'avoir invité une fois encore à votre journée d'étude, alors même que vous avez appris par une expérience de plusieurs années maintenant que la contribution à vos travaux d'un philosophe, ou en tout cas de quelqu'un qui s'efforce de philosopher, consiste surtout, comme nous l'avions déjà noté, à vous compliquer la tâche en apportant sans relâche des problèmes à vos solutions. Mais sans doute avez-vous de bonnes raisons d'accepter cette situation qui a aussi ses avantages, car même si le travail philosophique est une traversée incertaine, puisque son port d'attache est l'ignorance, on peut en attendre quelques plaisirs rares : un moment de suspension des contraintes, une prise de distance par rapport à la quotidienneté, au discours ambiant, aux conformismes et aux prétendues évidences, un retour utile sur le sens de l'action, une immersion tranquille dans la jungle qu'on croyait jusque-là impénétrable de l'abstraction et au final, malgré l'effort à fournir et la difficulté inhérente à toute pensée, un ineffable sentiment d'aventure et de liberté.
C'est particulièrement vrai pour notre thème d'aujourd'hui puisque l'éthique est une visée qui relève de la sphère de l'idéal et qui exige donc plus que tout autre sujet que nous puissions échapper, au moins en partie, à la pesanteur des choses. Mais cela, nous le savons parce que dans la réflexion de ce matin nous ne partons pas de rien : sous des titres divers et dans des thématiques apparemment très diverses, le souci de l'éthique, pendant toutes ces années, ne vous a pas quittés. Peut-être certains d'entre vous dans cette salle sont-ils les valeureux survivants de la formation CAFDES organisée par l'IRTS en 2011 pendant laquelle deux journées entières avaient été consacrées déjà à "l'éthique et la responsabilité du directeur dans le secteur social et médico-social", et nous avions alors construit de superbes constellations conceptuelles à propos du territoire et des frontières de l'éthique et de la déontologie dans le secteur de l'encadrement. Sans remonter jusque-là, souvenons-nous des trois questionnements successifs que nous avons conduits ici-même et qui avaient l'éthique pour objet, que le mot ait été présent ou bien dissimulé dans le titre : en 2014, c'était "marketing et action sociale : la question éthique", en 2015, c'était "penser l'institution autrement" et l'an dernier, en 2017, "les établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ de l'économie sociale et solidaire", où nous avons ausculté le rapport des valeurs à l'économie - valeurs dont précisément nous allons reparler parce que l'éthique, selon une formule désormais bien connue, est le "moment le vérité des valeurs", celui où est validée leur authenticité - et c'est ce qui sera au centre de cet exposé.
Je commence donc notre questionnement sur l'éthique et je redis d'abord que tout questionnement véritable doit commencer par questionner les termes mêmes de la question, comme Platon l'a montré dans quelques lignes "à couper le souffle" au tout début du dialogue qui s'appelle le Ménon, lorsque Socrate met en avant une terrible contradiction que je résumerai ainsi : s'interroger sur quelque chose suppose de savoir de quoi on parle, alors que justement on l'ignore au moins en partie, puisque précisément on s'interroge. Dans le cas qui nous préoccupe, je ne peux pas ne pas souligner d'entrée ce qu'il y a de saisissant dans l'idée même d'un questionnement sur l'éthique, car l'éthique elle-même n'est par nature qu'un éternel questionnement, une absence essentielle et définitive de tout contenu positif. On voit tout de suite que s'il y a des traités de morale, au sens strict du terme il ne peut pas y avoir vrai-ment de traité d'éthique parce que si on retranscrit comme un résultat normatif, comme une recette, ce que la démarche éthique a établi à un moment donné dans une circonstance parti-culière, on le transforme, on le dénature, même, en déontologie, en réglementation ou en énoncé moral. Et en ce sens c'est à juste titre que la notice de présentation de notre journée parle de l'éthique comme d'une démarche et non comme d'un savoir, tout simplement parce que l'éthique ne relève pas de l'application de règles générales, préétablies et indépendantes de la réflexion du moment sur ce que toute situation a toujours d'irréductiblement singulier. Petit rappel : nous connaissons depuis la Critique de la raison pure de Kant la distinction essentielle entre les jugements déterminants, qui consistent à partir d'une règle établie et à l'appliquer à un cas particulier, et les jugements réfléchissants qui consistent au contraire à inventer une règle pour chaque cas singulier que l'on a à traiter. Vous agissez chaque jour conformément à des jugements, déterminants ou réfléchissants, que vous formez, et vous formez d'autant plus de jugements réfléchissants que vous avez à traiter des questions plus complexes ou plus originales, ce à quoi vous destinent tout particulièrement les fonctions de direction et d'encadrement - sans pour autant que les autres personnels en soient dispensés, bien entendu, car l'exigence éthique vaut pour toute conscience et donc pour tout acteur dans les domaines qui sont les vôtres.
De ce point de vue, il faut le dire d'emblée, il ne peut pas y avoir d'éthique du directeur à proprement parler, car la voie éthique est la même pour tout un chacun, directeur ou non. En revanche, il y a, à l'entrecroisement de la démarche éthique et du réel, une situation que j'ai appelée situation de pilotage, parce qu'elle est caractérisée par l'exercice de l'autorité et de la responsabilité qui sont les attributs du directeur : j'y viendrai tout à l'heure en essayant de dire ce que représente cette éthique en situation de direction et quel en est le cadre, mais je rappelle que ce cadre a été défini dès l'origine par la philosophie antique et je me souviens encore de l'intérêt qu'avait suscité ici même, à l'IRTS, chez les futurs directeurs, la lecture et l'explication d'un superbe texte de Platon dans le livre VI de la République sur les malheurs d'un capitaine de navire malgré sa compétence avérée, puisqu'il savait, dit le texte, "tenir compte du temps, des saisons, du vent, et de tout ce qui a rapport à son art". Il s'agit bien sûr de l'art de la navigation mais l'exemple est éminemment transposable. C'est à ce schéma platonicien et non pas, comme on pourrait le croire, en imaginant les directeurs que vous êtes enfermés dans une espèce de cockpit administratif que j'ai décidé d'utiliser le terme de pilotage pour cet exposé et pour le travail d'atelier qui suivra cet après-midi : on sait que le pilote (de navire) et le médecin sont les figures emblématiques de ce que Platon appelle les arts du salut, c'est-à-dire les arts qui ont un rapport particulier à l'éthique en raison du prix de ce dont ils ont la charge ou de ce dont ils sont les garants, à savoir par exemple la santé, la vie, l'existence, et tous vos établissements ont à être avant tout des producteurs d'existence.
Pour revenir à nos catégories, car j'ai bien conscience que ma principale tâche est de proposer des catégories qui permettent d'organiser et de mettre en perspective le thème du jour, il est clair tout d'abord que par nature l'éthique n'est pas une démarche déterminante mais une démarche réfléchissante, dans la mesure où elle cherche des réponses à des questions posées par les cas souvent inédits que la perpétuelle nouveauté et la variété infinie du monde ne cessent de multiplier. Ainsi, tout comme Kant disait qu'on ne peut apprendre la philosophie mais seulement apprendre à philosopher, voulant dire qu'il n'existe pas et qu'il ne peut pas exister un livre dont on dirait en désignant son contenu "voici la philosophie", de même il n'existe pas de savoir dont on puisse dire, que ce soit dans le médical ou dans le social, "voici l'éthique", une éthique toute faite, une éthique déjà bâtie, livrée clé en mains et dont il n'y aurait plus qu'à prendre livraison.
Ce parallèle entre l'éthique et la philosophie n'a d'ailleurs rien de surprenant compte tenu de leur parenté, qui est très étroite car l'éthique est une création de la philosophie grecque, avec notamment l'illustre et emblématique Éthique à Nicomaque d'Aristote. Et lorsque, à l'époque des Lumières, Kant décrit le domaine de la philosophie, il montre que la philosophie a pour objet de tenter de répondre d'abord à trois questions : "que puis-je savoir ?, que dois-je faire ?, que m'est-il permis d'espérer ?", questions qui interfèrent entre elles. Que-dois-je faire ? est évidemment la question de l'éthique, un chapitre essentiel de la philosophie donc. Aujourd'hui encore, faire de l'éthique, c'est bel et bien philosopher, en tout cas se faire pour un temps philosophe même si on ne l'est pas au sens corporatif ou disciplinaire du terme. Il en va ainsi depuis l'origine et c'est d'ailleurs, comme chacun sait, l'éthique médicale, elle-même née de la philosophie notamment pythagoricienne, qui est tenue - et à juste titre - pour la toute première des éthiques. L'éthique médicale grecque n'est pas seulement une éthique de référence, elle en est le modèle absolu, elle est le modèle de toute éthique, exactement comme la leçon de philosophie est devenue en même temps, dès la Grèce ancienne, le modèle occidental de toute leçon. Et cette éthique qui a surgi avec le Serment d'Hippocrate, au IVème siècle avant J.-C., n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, un simple texte de déontologie - et je reviendrai tout à l'heure sur cette distinction fondamentale. Dans le monde antique où si j'ose dire on avortait allègrement, où on exposait et où on tuait les enfants non voulus ou mal formés, où on se suicidait beaucoup - le suicide a été très en honneur en Grèce ancienne et à Rome - le Serment est venu proclamer tout-à-coup le principe intangible du respect de la vie, donc complètement à contre-courant de la réalité et des pratiques du temps, et c'est justement ce qui nous intéresse ici : avec ce Serment, on voit naître l'éthique comme refus, comme rupture où s'exprime face à l'imperfection du réel la force des valeurs. Regardons bien ce qui s'est passé alors : pour la première fois, en Occident, s'est produit un événement considérable, la transformation d'une simple pratique, d'une technique (iatrikè technè), la médecine, en une activité pleinement authentique par son inscription dans un espace défini désormais non plus seulement par des objectifs et des procédés, mais par des valeurs.
On sait bien, depuis, qu'il faut prendre garde à ne jamais faire l'inverse, qu'il ne faut jamais renoncer à l'encadrement de l'activité par des valeurs au profit d'un retour cynique à l'encadrement par des objectifs ou des procédés ou à la régulation par des situations de fait. Et cela vaut encore à présent et pour toutes les activités des hommes : ce n'est pas parce qu'une situation s'impose à nous d'une manière ou d'une autre que l'éthique doit s'en accommoder, ou l'approuver, ou l'accepter comme exemplaire et encore moins la justifier. Au contraire, l'éthique est là pour instituer un droit et un devoir imprescriptible de dire non quand il le faut. Pensons à tout ce qui, dans la longue histoire du monde, a pu sembler longtemps "incontournable", comme on dit, avant d'être ensuite balayé grâce au refus obstiné et à la résistance des hommes au nom d'une vérité plus haute. D'emblée, l'éthique a donc été une capacité de refus, une forme d'interpellation et même de subversion dans le champ de la moralité.
Mais sans doute serait-il temps, puisque nous parlons déjà de l'éthique, de nous soucier de ce qu'elle est. Je commencerai par l'évocation rapide des deux grands paradoxes qui semblent la caractériser et qui traduisent ce qu'elle a de lumineux et en même temps d'énigmatique : d'une part elle est à la fois de source antique, comme nous l'avons vu, et pourtant de floraison moderne, d'autre part elle est en même temps insaisissable et omniprésente, à la jonction de deux grands règnes antagonistes qui sont celui des moyens et celui des fins. D'abord, donc, l'éthique suggère à la fois l'antiquité et la modernité, elle nous renvoie tout autant à l'origine la plus lointaine du discours moral qu'à l'extrême actualité. Dire l'éthique, c'est évoquer la généalogie de la pensée, c'est remonter vers une dimension oubliée, c'est "mettre à nu les structures de l'Occident", comme disait un psychanalyste. Mais dire l'éthique, c'est aussi désigner quelque chose qui est devenu aujourd'hui triomphant. Alain Badiou a noté, je le cite, que "ce mot d'éthique, qui sent si fort son grec ou son cours de philosophie, qui évoque l'Éthique à Nicomaque, un best-seller fameux, est sous les feux de la rampe" et que l'éthique, venue tout droit de l'Antiquité", je cite à nouveau, est à présent "plébiscitée sur le tard", faisant un peu penser à "une vieille fille résignée qui devient sans comprendre pour-quoi la coqueluche d'un salon". L'image qu'utilise ici Badiou est éclairante : de la même manière que la vieille fille a pu être autrefois pleine d'attraits - et peut-être même follement séduisante - l'éthique a eu une glorieuse jeunesse : elle a été, en Grèce ancienne, la recherche d'une excellence dans la manière d'être, la poursuite d'une existence ordonnée au bien, d'une sagesse de l'action. Elle est, dit en substance Aristote, ce qui permet d'aller au-delà du simple nécessaire, elle est ce qui fait qu'on fait plus que "simplement vivre" - c'est l'expression d'Aristote -, elle est une visée d'absolu au sein du relatif. En fait, l'éthique grecque pose une question personnelle et même intime, la question de la manière de vivre, du genre de vie qu'il convient d'adopter, et elle la pose - et nous fait nous la poser - jusqu'au cur même de l'activité professionnelle. Comment faut-il vivre cette vie d'homme et quel rapport devons-nous entretenir avec elle? Qu'en est-il de notre relation à l'argent, aux honneurs, à l'ambition, à nos désirs, nos plaisirs, nos passions ? En somme il ne s'agit pas simplement de vivre mais de bien vivre et c'est ce qui est au centre de la philosophie antique, mais je vous propose de retenir pour nous aussi, qui sommes confrontés aux périls de la modernité, cette idée que l'éthique contient et jusque dans la profession, jusque dans le travail, une dimension d'accomplissement de soi, chacun ayant en somme à façonner son éthos à partir de la matière première qu'est sa vie. On voit bien là déjà la dimension personnelle de l'éthique du pilote. Wittgenstein disait même, dans sa très célèbre conférence de 1929 à Cambridge que l'éthique est, je cite, "une investigation de ce qui rend la vie digne d'être vécue".
D'ailleurs, au siècle des Lumières, éthique a désigné chez Kant la moralité tout entière, la raison pratique. Mais ensuite, je reprends le fil, l'âge est venu et comme chez la vieille fille, les traits se sont altérés, la beauté a perdu de son éclat. L'éthique moderne tend à devenir une sorte de régulation vague de ce qui se passe et de ce que nous faisons, une codification à visée consensuelle - donc un peu mécanique et plutôt molle - de la vie, de la mort et des gestes des hommes. L'actualité nous montre tous les jours l'incroyable inflation du discours éthique dans le monde contemporain, avec une espèce de pullulement sémantique où l'éthique, comme substantif ou comme adjectif, est mise à toutes les causes. Éthique est devenu une sorte de signifiant maître devant lequel il faudrait sans cesse courber l'échine.
D'où cette prolifération qui déferle maintenant sous le nom d'éthique : pour les événements du monde, il y a une éthique des droits de l'homme, pour les rapports sociaux une éthique du vivre ensemble, pour les médias une éthique de la communication, pour le cadre de vie une éthique de l'environnement, et il y a même, pour l'univers du profit, une éthique des affaires. Ce qu'on a pu appeler une poussée d'éthique, avec son paternalisme insidieux, est un fait marquant de ce 21ème siècle commençant. On peut même se demander parfois si l'éthique ne vient pas se substituer à la politique défaillante et investir les comportements individuels pour leur permettre de s'adapter à la dureté du monde hyper-libéral et si elle ne s'est pas, d'une certaine façon, constituée sous nos yeux en pratique de consolation face aux duretés de l'existence, s'inventant une nouvelle fonction quasi thérapeutique. De la même façon que Marx disait dans la Critique de la philosophie du droit de Hegel, que "la religion est le cur d'un monde sans cur et l'esprit d'un monde sans esprit", il se pourrait que l'éthique ne soit, bien souvent, que l'illusion d'un monde sans illusions, si nous n'y prenons pas garde. Mais si vous avez voulu poser la question de l'éthique en interrogeant vos pratiques, comme le dit l'intitulé de cette journée, c'est à l'évidence pour y prendre garde. De fait, l'éthique est toujours le miroir grossissant d'un besoin de sécurité parce qu'elle correspond à la recherche d'une espèce de garantie de validité de l'action. Je vous propose donc comme "élément pour une éthique du pilotage" de réfléchir ensemble à ce qui semble bien être au sein de l'éthique la garantie ultime, la "garantie de la garantie", en quelque sorte, à savoir les valeurs, qui sont, et ce n'est pas sans raison, au centre de tout le débat éthique de la modernité.
Pour cela, je reviens d'abord à la notion même d'éthique pour la situer par rapport à deux autres notions avec lesquelles elle a des frontières communes, la morale et la déontologie. Je reprends rapidement sur ce point ce que nous avons souvent dit ensemble. D'abord la morale. Il y a une région du permis et du défendu, du bien et du mal, un ensemble de principes, de normes, d'idéaux sur lesquels il peut y avoir débat mais auxquels globalement nous nous sen-tons tous liés par un sentiment d'obligation : c'est la morale, c'est ce que Ricur a appelé le "royaume des normes". La morale est un réservoir normatif qui contient tout le matériel qui peut permettre de répondre de façon théorique à la question que faut-il faire ou ne pas faire, que faut-il préférer.
La déontologie, maintenant. On confond souvent la déontologie et l'éthique, et on dirait même qu'on les laisse confondre à dessein. Mais déontologie est un faux mot grec qu'on ne trouvera dans aucun dictionnaire de grec ancien. C'est une fabrication de circonstance, réali-sée à partir de racines grecques, pour désigner ce qui doit ou ne doit pas être fait : le mot a été construit sur déon, ce qu'il faut ou contraire ce qu'il ne faut pas. Cette idée d'un logos du déon qui donne donc déontologie est due à Bentham au 19ème siècle - comme par hasard un utilitariste anglais précurseur du libéralisme - et elle entretient l'illusion que la déontologie et l'éthique ont la même origine, le même poids, la même signification. Il n'en est rien, pourtant, car l'éthique et la déontologie représentent en fait deux démarches non seulement différentes mais à beaucoup d'égard opposées. Une déontologie est par définition étroitement liée à une activité professionnelle : elle est une liste des devoirs positifs ou négatifs rassemblés dans un code qui traite non pas des principes ou des idéaux comme tels mais du permis, qu'elle délimite, du prescrit, qu'elle recommande, et du défendu, qu'elle condamne et promet à une sanction. En pratique, une déontologie est pour un métier donné un code de l'interdit et de l'obligatoire, les deux pôles qui dans le système de la modernité encadrent et enserrent la liberté, la prenant en tenaille et ne la tolérant que résiduelle et donc de plus en plus limitée. Une déontologie est une sorte d'éthique express, par laquelle est faite l'économie d'un débat éthique, qui est supposé avoir déjà eu lieu. Elle est un code fixe pour des situations générales, un système de décisions déjà arrêtées, une source a priori d'injonctions.
Je reprendrai un exemple auquel j'ai déjà eu recours devant vous parce qu'il a l'avantage d'être extérieur au domaine l'action sociale et d'avoir en même temps une portée très large. Je l'ai relevé dans un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une banque, une caisse de crédit pour être plus précis. Je lis : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des employés et bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse". J'ai pris l'habitude de dire que ce texte, qui donne à penser, permet aussi de faire en quelques mots un très grand voyage. Avec le début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le "royaume des normes", la morale. Avec la suite et l'évocation de la bonne foi, on aperçoit peut-être encore, si on passe rapidement, le vaste champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles der-niers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a complètement changé de monde, on est entré dans la pure déontologie, dans la logique financière sans pitié du profit. Ici, je laisse chacun de vous appliquer ce schéma à son propre champ d'activité et de compétence.
En tout cas, on voit bien là les délimitations et les lignes de fracture entre les trois notions-clés qui représentent bien trois niveaux distincts. Comme royaume des normes, la morale contient les éléments nécessaires à toute réflexion et à toute prise de décision. Elle est un réservoir dans lequel nous allons chercher des éléments de réponse aux questions que nous nous posons. Ensuite, second niveau, dans la plupart des situations, la déontologie fixe des règles et donne des consignes, nous apporte des réponses avant que nous ayons à nous poser véritablement les questions, elle nous indique la conduite à tenir ou à éviter et les choix à faire, et généralement cela suffit, heureusement, aux besoins courants de l'action, ce qui au fond nous évite d'avoir à mettre sans arrêt de l'éthique partout. Enfin lorsqu'il existe des hésitations sur les choix, lorsque s'engage un débat mettant la déontologie ou la morale en cause,quand apparaît une interrogation sur les valeurs ou la mise en uvre de principes ou normes à portée universelle, on entre, troisième niveau, dans la sphère de l'éthique. Se de-mander au nom de valeurs plus hautes si on doit se soumettre à telle ou telle prescription de la déontologie ou si on doit accepter comme telle une norme ou une loi morale, c'est entrer dans l'éthique.
Éthique, disait Paul Ricur, qui "se brise en deux sur la morale", dont elle forme à la fois l'aval et l'amont. Il y a d'un côté, en amont des normes, une éthique antérieure, qui s'intéresse aux fondements de l'action et qui s'interroge sur les éléments du royaume des normes (par exemple si je me demande ce qu'est la justice), et d'un autre côté, en aval des normes, une éthique postérieure qui vise à insérer ces "normes dans des situations concrètes" et qui joue le rôle d'une "sagesse pratique" permettant de discerner "la droite règle dans les circonstances particulières et difficiles de l'action", pour le dire en termes aristotéliciens (par exemple si j'hésite à choisir telle solution à un problème que je veux traiter avec justice). Ce sont ces questionnements que nous appelons éthique.
L'éthique répond d'une manière fractionnée dans les situations complexes que nous rencontrons à la question comment agir, comment vivre, comment faire ?- nous l'avons dit- mais par définition cette question ne reçoit pas de réponse valable à tout jamais, transférable et généralisable et elle rebondira inévitablement dans d'autres situations singulières. C'est ce qui fait que l'éthique - je l'indiquais en commençant - est toujours un questionnement et qu'elle ne se réduit jamais à un système de prescriptions qui seraient entièrement codifiables. Elle est un chemin vers une action ou une décision convenable, mais un chemin qui n'était pas tracé d'avance et qui trouve son sens dans ce qui est au-delà du royaume des normes, dans ce qu'on appelle les valeurs. Et on voit tout de suite la frontière nette qui sépare ce troisième niveau des deux autres : dans la déontologie et même dans la morale, il s'agit surtout de se conformer, d'obéir, alors que dans l'éthique comme champ des valeurs, il s'agit d'être libre et de décider au nom de cette liberté du sens de nos actions et de notre contribution au monde.
C'est pourquoi je vais tenter maintenant d'apporter à titre d'"éléments pour une éthique du pilotage", comme annoncé, un regard sur les valeurs en tant qu'elles sont à la fois le matériau et la visée de l'éthique, laissant à partir de là de côté ou en tout cas ramenant à leur juste place les règles et les normes qui relèvent de la déontologie et de la morale générale, dont je ne doute pas que le personnel d'encadrement que vous êtes ait déjà une grande maîtrise.
Et ce faisant, j'aborde une problématique contemporaine qui est absolument envahissante : comme l'éthique, les valeurs sont aujourd'hui partout, elles gagnent chaque jour du terrain, au moins en apparence. Le ressassement médiatique porte sans cesse l'énonciation des valeurs à des sommets. C'est en permanence que nous entendons évoquer les valeurs et qu'emportés un peu malgré nous par cette foi nouvelle qui nous est injectée en continu et par tous les moyens possibles, nous finissons parfois par les invoquer nous aussi : en tête, avec les incontournables valeurs de la République, les valeurs de la famille, les valeurs du sport, les valeurs de tel ou tel corps de métier (car il n'y plus de pose de fenêtre possible sans une déontologie du PVC), les valeurs citoyennes, celles qu'on évoque sans doute dans des buffets citoyens qui pourtant ressemblent beaucoup aux autres buffets. Il y a même, jumelles, au sens d'inséparables et identiques, les valeurs de droite et les valeurs de gauche, interchangeables parce que c'est justement une caractéristique des valeurs d'être à la fois hiérarchisées et indissociables : par exemple, ce qui est juste est en même temps à certains égards vrai et beau, et vice-versa. Mais dans l'ère des valeurs où nous sommes, les valeurs nous sont données comme des choses, des objets indifférenciés qui viennent remplir l'abyssal vide de valeurs de la société marchande et faire passer les hiérarchies économiques pour des hiérarchies morales. La plupart du temps, les valeurs dont on nous parle sans cesse n'en sont pas : elles s'apparentent tantôt à des préférences ou à des désirs collectifs, tantôt à des adhésions à des normes sociales, ou à des orientations existentielles, à des styles de vie, à des choix politiques ou culturels. Par cette multiplicité diffuse et trompeuse, elles ont tout de ces phénomènes qu'on observe sans pou-voir les identifier et dont on ignore la nature exacte - ce qui est la définition même des OVNI, et de fait l'ère des valeurs que nous vivons a commencé par une espèce d'alerte aux OVNI dans le ciel de l'éthique, ce que confirme l'existence d'un Observatoire des valeurs.
Parfois même, ce qu'on invoque sous le nom de valeurs renvoie à des évidences et à des truismes au point de rendre vaine et vide toute idée d'éthique. Je lis par exemple cette "charte éthique" d'un grand groupe industriel. C'est un texte étonnant mais qui est en même temps conforme à la rhétorique habituellement en usage dans ce genre d'écrit pseudo-éthique. L'objectif de cette charte, dit l'introduction, "est de fédérer les hommes et les femmes de notre groupe autour de ces valeurs". Ensuite sont énumérées cinq valeurs qu'un "code de conduite" traduit en "termes opérationnels" - ainsi parle-t-on aujourd'hui, en effet. Mais voici les cinq valeurs : un, "l'esprit client", qui est, dit le texte, une philosophie et une ligne de conduite, mais on n'en saura pas plus, deux "les qualités humaines" (le thème étant que "l'homme est au cur du groupe", nous voilà bien avancés), trois "l'excellence technologique" (définie comme "initiative créatrice et respect de l'éthique", et là l'éthique se réfère donc à elle-même comme le serpent se mord la queue), quatre "la performance économique" en tant que création de valeur (et ce n'est donc plus la valeur éthique qui est visée mais la valeur financière, c'est-à-dire le profit), enfin, cinq, "l'ouverture au monde", qui renvoie à la communication, annoncée comme "loyale et transparente". Comme chemin de croix de la platitude, triomphe de la tautologie et gesticulation verbale dans le vide, on ne fait pas mieux, et ce document montre très bien comment l'éthique est en pareil cas soluble dans l'évidence - mais il montre surtout que l'éthique ne peut jamais être simplement ce qui va de soi ni surtout n'être le contraire de rien. Peut-on réellement concevoir une entreprise sans un esprit client, sans des qualités humaines, sans un niveau technologique et un certain souci d'innover, sans succès dans la performance et sans communication ? Donc inversement l'entreprise dotée de ces atouts ne renvoie à rien qui soit de l'ordre de l'éthique. Si ce qui est annoncé comme une éthique ne peut être ni contesté ni contredit par personne, parce que le contenu en est tragique-ment évident et par conséquent consensuel par nature, c'est qu'on est sorti de l'éthique. Faire de l'éthique de cette façon-là, c'est, selon la belle formule de Sartre, "faire comme un enfant qui est assis sur une chaise, qui fait teuf-teuf et qui croit qu'il avance".
Quoi qu'il en soit, les valeurs sont toujours, comme nous l'avions noté déjà pour l'éthique, invisibles, absentes, insaisissables et elles vivent d'une existence terriblement ambigüe. Ainsi par exemple on peut donner sa vie pour des valeurs, mais pour ces mêmes valeurs, exacte-ment les mêmes, on peut aussi bien tuer : c'est le cas dans la plupart des guerres, où on tue et où on est tué en toute symétrie et réciprocité. Ensuite, les valeurs tout à la fois sont et ne sont pas. "Il faut croire à la justice parce qu'elle n'est pas", disait Alain, c'est-à-dire qu'en tant que valeur, elle n'existe que si nous nous en préoccupons et que mystérieuse est son existence muette le reste du temps, lorsque nous n'y pensons pas. Rien n'est réel dans les valeurs, sauf justement la place que nous leur faisons : l'horizon des valeurs est une référence à l'invisible. Les valeurs, on ne les rencontre jamais : ce qu'on rencontre, "ce sont des biens ou des maux, des objets utiles ou nuisibles, des hommes bons ou méchants, des institutions" (ou des actions ou des décisions) "justes ou injustes". Il n'est question de valeurs que si nous nous "arrachons au cours des choses, à la nature et à ses lois", disait encore Ricur, autrement dit si nous nous tournons vers une transcendance que nous nommons justice, fraternité, solidarité, etc. Les valeurs n'existent que lorsque, de façon paradoxale et dans un parcours discontinu, nous nous dirigeons vers ce qui nous dépasse.
En outre, ce mode d'être des valeurs est à bien des égards incertain et flottant. Certes, si je m'interroge sur les valeurs, je peux d'abord être rassuré, car en un sens, elles sont bien là, à chaque moment de mon existence. Dans un passage célèbre du premier chapitre de L'Être et le Néant, Sartre décrit magnifiquement cette continuelle présence : "Je suis engagé dans un monde de valeurs", dit-il, car "dans ce monde où je m'engage, mes actes font lever des valeurs comme des perdrix". Mais les valeurs ne sont pas là avant mon passage, posées de longue date : elles ne sont pas, dit Sartre, "comme des écriteaux qui interdisent de marcher sur le gazon". Contrairement à la tranquille conviction du sens commun, ce n'est pas après avoir contemplé l'honnêteté que les "honnêtes gens" le deviennent, c'est l'inverse, exacte-ment de la même façon que c'est mon indignation qui m'indique la bassesse et mon admira-tion qui me donne l'idée de la grandeur : c'est par "la réalité humaine que la valeur arrive dans le monde". Les valeurs sont "la saisie réflexive de la liberté par elle-même", et c'est ce qui explique justement que tout en s'offrant légères et multiples comme des perdrix dans leur envol, elles soient "insaisissables". À les "prendre comme des êtres, on risque de mécon-naître leur irréalité", car elles ne sont pas de l'être mais du dépassement d'être. La place des valeurs est sur une ligne vers laquelle on se dirige sans l'atteindre, donc un horizon puisque l'horizon, comme on le sait, recule quand on avance. Nous ne trouvons les valeurs que dans une poursuite de nous-mêmes, par une projection de nos engagements. Sans le fondement que leur donne notre liberté, il n'y a pas de valeurs, seulement des dénominations que nous prenons ou qu'on nous fait prendre pour des valeurs.
Or ce quiproquo renverse et d'une certaine façon annule les valeurs : les objectiver, les tenir pour des idéaux tout faits, les poser en modèles inconditionnels auxquels il n'y aurait qu'à se soumettre, croire qu'on les atteint du seul fait qu'on les énonce ou qu'on s'en recommande, c'est fuir sa responsabilité et renoncer à sa liberté. Exactement ce que Sartre appelle l'esprit de sérieux, cette forme de mauvaise foi et de lâcheté par laquelle, angoissés que nous sommes de ne pouvoir nous soustraire à notre liberté, nous nous cachons derrière des devoirs ou des valeurs qui n'en sont pas ou qui ne tiennent leur poids que de nous et de nos choix. Le principal signe du malaise dans les valeurs qui s'est installé est la pression qui est exercée sur chacun afin qu'il choisisse son camp, qu'il se prononce clairement pour la moralité ou pour ce qu'il est prié de considérer comme la moralité. Tel est l'esprit de sérieux de la mondialisa-tion : il faut désormais avoir des valeurs, il faut être de ceux qui ont des valeurs. Ainsi répète-ton mes valeurs, nos valeurs, vos valeurs, leurs valeurs : toujours le lexique de la possession, comme lorsqu'on on dit mes actions, nos contrats, vos bureaux, leurs comptes en Suisse. Dire j'ai des valeurs affiche une garantie de moralité, par opposition à tous ceux qui n'en ayant pas sont les suspects, les infâmes et surtout les déviants qui s'écartent du credo libéral. Au fond, la problématique moderne des valeurs, qui est celle du moralisme contemporain, se réduit à la logique binaire du titre elliptique du roman d'Hemingway En avoir ou pas.
On voit bien tout l'intérêt que cette chosification des valeurs représente pour le système libéral : il est plus facile d'avoir à faire à une morale constituée, structurée à partir de valeurs toutes faites et cataloguées, qu'à une éthique véritable qui est en réalité un mouvement constituant dans lequel les valeurs prennent leur source. La réification moderne des valeurs explique le sentiment que nous avons d'une invasion de néo-valeurs vagues, dont la morale média-tique assure la promotion, comme par exemple la transparence, l'exemplarité, le partage, la traçabilité, le dépassement de soi, et même, il faut bien le dire, le vivre-ensemble, qui sont aujourd'hui brandis à l'égal du vrai, du bien ou du juste. Dans l'univers édifiant et prude des médias, tout finit par devenir valeur, au sens où Kierkegaard définissait les valeurs comme des "illusions confortables". Les classifications de valeurs se multiplient jusqu'à fabriquer de véritables cartes du tendre des valeurs. "Vous pouvez trouver vos valeurs dans ce tableau", dit un document qui a été établi par des professionnels du coaching : en 14 lignes et 5 colonnes, soit 70 cases contenant une valeur chacune, on trouve tout, de la générosité au travail en équipe et à l'authenticité, de rendre service à avoir le choix ou à se faire plaisir. Et cela ne semble pas encore suffisant : "vous pouvez ajouter les valeurs qui vous sont propres", ajoute ce texte ineffable. Ainsi, la devise du monde libéral pourrait être : chacun ses valeurs et la morale sera bien gardée. Et dans ce flot incantatoire se glissent des pseudo-valeurs en vogue : on peut ainsi découvrir présentées sous l'appellation valeurs "les dix qualités incontournables du leadership entrepreunarial " et la définition du leader comme étant celui qui "met en avant un certain nombre de valeurs". On apprend aussi que les valeurs sont, "au sein d'une entreprise, des leviers de performance" : l'Orange attitude pourrait bien être une valeur, "à la croisée de principes moraux et de stratégies marketing", nous dit-on. Valeur aussi lorsque Nestlé s'engage, et la preuve que c'est bien une néo-valeur, c'est qu'on ne sait jamais exactement à quoi. La valeur est devenue un outil de promotion et on n'en doute plus si on lit dans la Tribune de Genève qu'en préparant la défense de ses intérêts, c'est-à-dire l'augmentation des tarifs, "la haute horlogerie défend ses valeurs face à la crise".
Du coup, l'ensemble du champ des valeurs est de façon de plus en plus marquée centré sur la morale. Les valeurs morales ou en tout cas de prétendues valeurs morales prennent le pas sur les autres. L'appel aux valeurs se généralise dans la vie sociale et la politique : "travail, famille, patrie, mérite, ordre, discipline, autorité". Tenter d'en faire un examen critique se retourne contre tous ceux qui s'y risquent, aussitôt discrédités comme n'ayant pas de valeurs. La chute du système des valeurs se fait au bénéfice d'un conservatisme inébranlable à travers une moralisation par les valeurs, devenues les instruments d'un permanent contrôle moral. Mikel Dufrenne disait que "les valeurs tombent du ciel pour soutenir l'ordre établi". On se souvient que Nietzsche avait donné le nom de moraline (das Moralin) à cette morale donneuse de leçons, à ce terrorisme pseudo-intellectuel à la fois culpabilisant et décadent.
La question est donc : à l'heure de la profusion et du manque paradoxal qui en résulte, comment distinguer les valeurs authentiques de leurs contrefaçons ? Trois caractéristiques que nous avons déjà entrevues me semblent permettre de les identifier : leur saisissante présence absente, leur appartenance sans partage au règne des fins et leur fonction d'idée régulatrice au nom d'un absolu. Ce sont aussi, me semble-t-il, trois repères essentiels en vue d'une éthique du pilotage.
Une première propriété des valeurs est qu'elles sont présentes en leur absence et absentes alors même qu'elles sont présentes. En somme, une valeur est un idéal qui "peut être une réalité, mais parce qu'en étant réalisé il reste un idéal". Pour prendre cette fois l'exemple d'une valeur esthétique, le beau, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire devant vous, les musées et les salles de concert sont pleins d'uvres où la beauté a été atteinte et incarnée et pourtant, après tant de tableaux sublimes qui ont été peints et exposés et tant de grandioses symphonies qui ont été composées et interprétées, en tant que valeur, la beauté reste encore à inventer et à désirer, et tous les peintres et tous les compositeurs continuent de la rechercher chaque jour dans les tourments de la création. Les valeurs sont encore transcendantes et inac-cessibles même lorsqu'on a déjà pu ou cru pouvoir les approcher. D'une certaine façon, la valeur est par nature hors de portée, elle est au-delà de ce qu'on est capable d'atteindre, elle est l'objet d'un désir toujours inassouvi : elle est comme l'eau qui recule devant l'homme assoiffé ou comme les fruits qu'on ne parvient qu'à effleurer du bout des doigts, selon la lumineuse métaphore grecque du supplice de Tantale. C'est le propre de la valeur de ne pou-voir être contenue dans aucune des réalisations qu'elle a inspirées et d'en appeler d'autres encore plus hardies. En ce sens, piloter selon l'éthique c'est toujours prendre en charge une constante réinvention des valeurs.
Un second caractère des valeurs est qu'elles appartiennent sans partage au seul règne des fins et sont radicalement étrangères à celui des moyens. Je lisais dans un texte fourni par un site de création d'entreprise qu'une "culture d'entreprise, c'est avant tout les valeurs que vous souhaitez partager" et que "les entreprises qui ont une forte culture d'entreprise sont six fois plus performantes que les autres". Si des objectifs de rendement et de profit entrent dans l'affirmation de valeurs, celles-ci cessent aussitôt de l'être, car une valeur asservie n'est plus une valeur. Kant montre dans une analyse fondatrice qu'il n'y a de valeur que ce qui n'a pas de prix, que de ce qui est objet non pas d'échange ou de commerce mais seulement de respect. "Dans le règne des fins, dit-il, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui mérite le respect". Autre-ment dit, une valeur ne peut être qu'un absolu, du fait qu'elle est attachée à une fin en soi qui ne peut relever ni de l'échange ni du commerce. En ce sens, piloter selon l'éthique, c'est toujours tenter de faire prévaloir en toutes circonstances des fins valant pour elles-mêmes.
Enfin, un troisième critère d'identification de la valeur est son rattachement à une catégorie qui permet de la penser comme telle. Les valeurs ne sont pas, comme on l'a entrevu, des principes dont il n'y aurait plus qu'à décliner imperturbablement les prescriptions ou les contenus, à la manière d'une procédure. En fait, la valeur est avant tout une idée régulatrice. Par exemple, l'idée du juste est régulatrice par rapport au champ pratique et au droit positif : elle est la référence qui permet d'ordonner les systèmes naturels dominés par l'injustice et par l'inégalité. De même, l'idée régulatrice dans le domaine du soin est l'humanité, au sens où en parlait Kant. Par exemple, si nous sommes soignés, nous ne voulons pas être soignés par des robots ni comme des robots et si nous sommes soignants, nous ne voulons pas accomplir des gestes qui se réduisent à une pure technicité. Le lien à double sens - et à double profit - par lequel, dans l'action de prendre soin, chacun fait droit à la dignité de l'autre au nom de la sienne propre est porteur de cette éblouissante valeur commune qui est l'humanité. Et en ce sens-là, piloter selon l'éthique, c'est toujours être garant du lien de parfaite réciprocité qu'on appelle justement humanité.
Reste qu'un monde dérégulé - qui se choisit et qui se proclame tel, comme le fait monde libéral qui est le nôtre - tente en permanence de réduire les idées régulatrices suprêmes que sont les valeurs au rang de simples faire-valoir, objets, nous l'avons vu, d'une dérisoire délectation médiatique. On voit bien que si les valeurs sont indéfiniment ressassées, c'est parce qu'on tente par cette sempiternelle redite de les faire passer pour allant de soi, pour déjà réalisées du simple fait d'être nommées et répétées en boucle. Mais toute la publicité moralisatrice de la mondialisation conquérante doit toujours échouer à nous imposer ses soi-disant valeurs parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la valeur, ce n'est pas quand on n'a pas le choix mais au contraire quand on l'a. En ce sens, malgré l'apparence, toute éthique du pilotage se fonde sur une liberté. Dans le domaine social, le pilote est celui qui est au plus haut point rendu responsable par le fragile, comme disait Ricur, celui qui dispose d'un pouvoir dont il sait user contre le pouvoir, celui qui protège l'institution de ses effets contre-productifs. Il est l'arbitre de l'affrontement entre la poursuite de l'idéal et les contraintes du réel, le contrôleur d'une déontologie qui peut devenir folle quand elle n'est plus sous le contrôle de l'éthique, et je dirai même qu'il est le dernier défenseur de l'utopie dans un espace réglementé. Le pilote est, selon un mot d'Hannah Arendt qui ne lui était pas destiné mais qui lui va très bien, le représentant du monde, c'est-à-dire le gardien des valeurs, le maître de l'horizon.
Le même et l'autre. Philosophie de l'altérité. Conférence donnée à St Denis (Réunion) le 5 avril 2017.
Je vous remercie de m'offrir à nouveau l'occasion d'être pour un soir le philosophe de service, fonction et dénomination sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque je m'en suis déjà expliqué. Nous avons examiné précédemment deux processus qui occupent ensemble une place centrale dans l'activité philosophique et qui ont été, pour cette raison, contemporains de la naissance de la philosophie en Grèce ancienne : la transmission et l'émancipation. Ce sont en effet les deux grandes modalités de l'affrontement, longuement mis en scène par Platon, entre la continuité et la rupture et donc entre ce qui demeure et ce qui change, c'est-à-dire entre ce qui demeure le même et ce qui devient autre. Il nous reste donc à examiner à titre de synthèse, dans le prolongement de nos précédentes réflexions, ce qui a été le moteur de la pensée de l'Occident, à savoir la dialectique du même et de l'autre et la fonction de l'altérité dans la construction de la rationalité. Les deux mots grecs, autos, le même, et allos, un autre ou l'autre - dont il n'y a même pas besoin d'évoquer la descendance étymologique tant elle est pléthorique - sont déjà parmi les termes les plus employés, et peut-être les plus employés chez Platon puis chez Aristote et dans toute la philosophie antique. L'identité et l'altérité, pour utiliser cette fois leurs équivalents, les substantifs latinisés correspondants, ont été eux aussi deux catégories majeures, et cela se comprend, car élaborer un concept, ce qui est toujours la première tâche du philosophe, c'est rassembler le même qu'on arrive à regrouper et à unifier, et rejeter comme étant autre tout ce qui n'entre pas dans cette unification ou ce regroupement. Je dirai, dans le langage des logiciens, que l'autre et le même renvoient aux deux éléments qui constituent la structure de tout concept, son extension et sa compréhension.
Mais ce n'est pas seulement au resurgissement de cette problématique ancienne que nous allons nous consacrer car entre temps, la modernité, sur ce point comme sur tant d'autres, a largement fait écho à l'Antiquité et l'a considérablement relayée : avec une saisissante symé-trie, la question du même et de l'autre qui était au cur de l'ontologie antique se retrouve, et avec la même intensité, dans la pressante interrogation contemporaine sur l'identité et la différence. L'ancienneté de cette question et sa persistance à travers le temps montrent bien qu'elle est constitutive du discours de l'Occi-dent, c'est-à-dire de l'histoire de la raison. Elle sera au centre de notre réflexion d'aujourd'hui, que je vous propose d'organiser, si vous voulez bien, selon trois étapes, comme toujours ontologie, épistémologie, éthique. D'abord, je vais essayer de tracer dans ses grandes lignes une philosophie générale du même et de l'autre et de montrer la place que tient l'altérité à la fois dans la constitution de la réalité et dans la genèse de la pensée et plus particulièrement de la philosophie. J'envisagerai ensuite l'altérité dans ses dimensions de relation à autrui et de mise en rapport entre des mondes différents et surtout dans la manière dont se déplacent ce que j'appellerai les lignes d'altérité, dont le tracé, qui relève de notre jugement et donc de notre liberté, sépare et constitue le même et l'autre. Enfin, je poserai la question de savoir comment une éthique de l'altérité peut à partir de là être définie et, pour compléter cette perspective éthique et en souligner l'actualité, comment s'effectuent la construction sociale des figures de l'autre - la folie, la déviance, le handicap, la marginalité, par exemple - et l'édification possible d'un monde commun.
L'identité et la délimitation : premiers regards sur l'altérité
Portons pour commencer sur l'objet de notre étude un regard en quelque sorte extérieur. Car à l'instant même où je m'adresse à vous, l'altérité, qui va être l'objet de la réflexion de ce soir, est déjà constituée. D'une certaine manière, elle est là parmi nous, entre nous, du seul fait de notre présence ensemble dans ce lieu. Elle est ce qui fait que notre présence est plurielle. Elle est dans ce qui à la fois nous divise et nous rassemble, car l'altérité à la fois sépare et rapproche, une différence étant toujours aussi une forme de lien. Par exemple, les uns et les autres, dans l'assemblée que nous formons, ou bien nous sommes venus de loin ou bien nous habitons tout près et nous sommes là en voisins : altérité selon l'origine et le trajet, à vrai dire altérité bénigne et de peu d'importance. Ou bien, clivage d'une autre ampleur déjà, nous sommes dans le rôle de celui qui accueille, comme vous, ou au contraire de celui qui est accueilli, comme moi, et le langage marque si bien l'altérité dans ce cas qu'il utilise paradoxa-lement le même mot, hôte, pour désigner celui qui reçoit et celui qui est reçu, comme s'ils partageaient, au-delà de ce qui les distingue et même les oppose, une relation de symétrie. Maison d'hôtes est aussi une appellation unitaire mais à double sens Cette propriété n'est pas un hasard de la langue puisqu'on la trouve déjà dans l'origine étymo-logique du mot hôte : le terme latin dont il provient, hospes, désigne l'invité, le voyageur, mais également celui qui reçoit chez lui, c'est-à-dire celui qui est son parfait contraire, ce qui montre bien qu'une com-plète similitude peut être le siège d'une complète opposition. Par cette racine latine, hôte est d'ailleurs apparen-té à hôtel (et à ses dérivés), à hôpital (et à ses dérivés), et aussi, malgré la différence orthogra-phique, à otage - au départ l'otage est un invité malgré lui, un hôte forcé en quelque sorte. Et enfin il y a, plus importante encore, l'altérité selon la personnalité et le statut : nous avons tous des traits de caractère, des profils, des parcours, des fonctions et des rôles diffé-rents, qui font que nous sommes ceci ou cela - comprenons bien ceci ou cela que les autres justement ne sont pas. Si nous devions séance tenante nous présenter les uns aux autres, nous dirions chacun ce qui nous distingue, et ce qui nous distingue le mieux c'est ce que les au-tres, contrairement à nous, ne sont pas. C'est un des aspects essen-tiels du grand principe "toute détermination est négation". Selon ce principe, nous instaurons ici, par notre présence groupée, une série d'altérités, du seul fait que nous avons chacun telle compé-tence, telle manière de penser ou telles caractéristiques qui font de nous des individus.
On pourrait alors penser qu'en disant individu, on ne parle pas du tout d'altérité, puisque par définition, au sein d'un groupe ou d'un ensemble collectif, l'individu est n'importe qui. Mais on s'aperçoit vite qu'il n'en est rien et que l'individu représente au contraire l'altérité suprême, puisque par essence il est exactement ce que ne sont pas tous les autres. On voit déjà tout ce que contient ce paradoxe : l'altérité est non seulement ce qui nous sépare ou nous rapproche, elle est aussi, à la convergence des deux, ce qui nous identifie. Le principe spinoziste que j'évoquais à l'instant semble alors s'inverser ou en tout cas se retourner : non seulement toute détermination est négation mais toute négation est détermination. Définir, c'est en effet toujours tracer une limite : dans l'étymologie de définition, il y a le latin finis qui signifie la limite. Toute définition est comme un trait faisant le tour de la chose et formant une frontière qui supprime ou met à l'écart par la pensée le reste du monde. Une chose n'apparaît jamais que sur un fond dont elle s'isole, un reste qu'on nie et un infini premier dont on la détache. Définir, c'est délimiter, dans la chose qu'il s'agit de définir, ce qui est le même et ce qui est autre par rapport à une autre chose supposée connue.
Mêmeté et identité : de l'identité idem à l'identité ipse
Nous retrouvons ainsi notre paradoxe sous une forme différente, car on pourrait penser que pour définir il faut surtout parler positivement, dire principalement ce que la chose est, donc à quoi elle s'identifie, par rapport à quoi elle est la même. Or là aussi c'est, pour l'essentiel, tout l'inverse et la preuve en est donnée à presque toutes les pages des dictionnaires, par exemple quand on définit le commerce comme trafic ou négoce, puis le négoce comme trafic ou commerce, puis le trafic comme commerce ou négoce. Une définition qui renvoie ainsi à des syno-nymes, c'est-à-dire qui sur le plan sémantique va du même au même, semble inattaquable, et en un sens elle l'est, mais elle pose des identités si parfaites qu'elle ne définit finalement plus rien ou ne donne qu'une définition circulaire et vide. Tel est d'ailleurs le lot de toute identité. L'identité est le fait d'être le même, mais si on demande le même que quoi, la réponse est évidemment le même que le même. Si on parle d'une personne, le vrai même, c'est cette personne et seulement elle, c'est, comme on dit, cette personne elle-même. Si on parle d'objets, ce sont des objets qui ne font qu'un avec le premier, sans quoi ils ne seraient pas tout à fait les mêmes. Même peut signifier aussi l'identité dans le temps, la simultanéité (au moment même), ou la similitude, avec semblable, similaire, ressemblant, qui expriment toute une série d'identités relatives. Il y a d'ailleurs symé-triquement les mêmes degrés dans l'altérité, avec la différence, la dissemblance, etc. En tout cas, l'identité absolue, c'est l'unicité. Rien ni personne ne peut être parfaitement le même que de soi. Par rapport à moi, le vrai même, c'est moi-même. C'est ce qui fait la profondeur du très beau titre que Paul Ricur a donné à un de ses livres, Soi-même comme un autre, dans lequel il montre que dire soi ce n'est pas la même chose que dire je, qu'il y a une grande différence entre dire le même empereur et dire l'empereur lui-même. Ricoeur établit là sa célèbre distinction entre ce qu'il appelle l'identité idem, celle de ce qui est le même au sens de persistance à l'identique à travers le temps, et l'identité ipse, celle qui correspond à la conscience d'exister et à l'affir-mation de soi.
En fait, l'identité demande à être nourrie d'une substance qui semble lui être extérieure. Autrement dit, à identité, il faut toujours ajouter quelque chose : on dira identité culturelle, par exemple. Mais alors, c'est en fait de la culture qu'on parle, et donc en fin de compte non plus tellement d'identité mais au contraire d'altérité, puisqu'une culture n'existe que par différence avec d'autres. L'anthropologue Maurice Godelier, par exemple, a montré dans une passionnante étude intitulée Communauté, société, culture, trois clés pour comprendre les identités en conflit, comment une identité culturelle et sociale peut se fabriquer - et souvent se fabrique - à partir d'une autre. Il prend l'exemple d'une tribu de Papouasie Nouvelle Guinée, les Baruya, qui avaient la même culture, la même langue et les mêmes rites qu'un ensemble plus grand auquel ils appartenaient, et qui ont proclamé eux-mêmes leur existence comme Baruya au XVIIème siècle, d'abord en entrant en conflit avec leurs voisins (rien de tel que se battre pour exister et créer des liens, car le combat est fondateur à la fois et indissolublement d'altérité et d'identité) puis en décidant de reprendre à leur compte et de présenter comme leur étant propre une culture qu'en fait ils avaient jusque-là partagée avec d'autres et qu'ils se donnaient l'air, désormais, de défendre mieux qu'eux et même contre eux. Nous reviendrons sur ces questions mais nous voyons déjà que le concept d'identité est tout à la fois vide et nécessaire : il correspond à un envers, à un relief en creux par rapport à l'altérité, qui seule produit l'existence et le savoir, et en même temps il est ce qui rend possible la différence et le discours sur la différence, origine de tout ce qu'on appelle la pensée.
Altérité et philosophie : aspects de la construction de la pensée
C'est d'abord la philosophie elle-même qui peut témoigner du rôle irremplaçable de l'altérité dans la construction de la pensée, et de trois façons. Elle en témoigne évidemment en tant qu'art "de former, d'inventer et de fabriquer des concepts", comme la définissait Deleuze, puisqu'elle est elle-même à l'origine du concept d'altérité, posé par les penseurs présocratiques il y a plus de vingt-cinq siècles.
Deuxièmement, la philosophie place l'altérité au centre de sa pratique, et on pourrait dire qu'elle en a fait son moteur et son instrument de navigation. Pas de pensée sans l'autre, quelle que soit la forme de sa présence, fût-elle une présence absente. Platon a ainsi établi que la pensée est "un dialogue de l'âme avec elle-même". La dialectique, justement, est le moyen de connaître ce qui est à travers le dialogue et le dialecticien est selon la définition du Cratyle "celui qui sait interroger et répondre". La toute première et la plus fondamentale des altérités est celle de la question et de la réponse. Autrement dit, pour penser, il faut impérativement dialoguer, même si on est tout seul et si c'est à soi que l'on s'adresse. Les interlocuteurs de Socrate ont en effet un statut très particulier, ils représentent le dédoublement de l'âme, ils sont des personnages par qui les opinions deviennent discours, ils sont la figure même de l'altérité dans ce qu'elle a de nécessaire à l'établissement de la rationalité. Dans ce qui peut sembler un paradoxe suprême, ils sont dans une large mesure des gens dont la présence auprès de Socrate permet à Socrate de penser tout seul. C'est l'illustration du double sens du mot logos, à la fois raison et discours : si un autre ne me fait pas écho, ne me renvoie pas de signe qui me conforte ou qui m'arrête dans ma démarche rationnelle, si je ne peux même pas être ou me faire moi-même cet autre à un moment donné, je ne peux pas articuler de pensée. Et sans le secours de l'autre, réel ou imaginaire, comment être et se sentir soi, et comment se maintenir dans sa propre identité ? Ne parlons même pas de l'action : que pourrait être un métier dont les effets ne seraient ressentis par personne, un métier qui relèverait de la catégorie si bien dénommée du ni vu ni connu ?
Enfin, troisièmement, la philosophie est en elle-même une forme d'altérité, une manière toujours difficile et risquée de transporter le débat ailleurs, de penser autrement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité "sans position de l'altérité. La vérité, ce n'est jamais le même, il ne peut y avoir de vérité que sous la forme de l'autre monde ou de la vie autre" : ce sont les derniers mots écrits par Michel Foucault sur la dernière page du manuscrit de son dernier cours en 1984, juste avant sa mort. Dans un texte célèbre de L'usage des plaisirs, Foucault avait déjà montré que faire de la philosophie, c'est tenter trois choses : penser autrement qu'on ne pense, voir les autres et les choses autrement qu'on ne les voit d'habitude, et au final, vivre autrement qu'on ne vivait auparavant. Car la philosophie a été dès l'Antiquité une ma-nière de vivre autrement, et on le voit bien dans la vie en commun des écoles en Grèce ancienne : fréquenter l'Académie, le Lycée, le Jardin, le Portique ou tant d'autres écoles philosophiques, c'était, comme l'ont rappelé les travaux de Pierre Hadot, s'engager dans une pra-tique qui concernait l'être autant et plus encore que le savoir. Grâce à ce travail en commun, philosopher a été d'emblée devenir autre, faire vivre en soi l'altérité, la faire entrer à la fois dans sa pensée et dans son existence : c'est pourquoi philosopher est depuis toujours un geste qui déconcerte et qui inquiète parce qu'il vient menacer la logique rassurante de l'identité. Penser, c'est s'exposer à ce qui n'est pas soi, c'est ouvrir l'identité, qui ne demande qu'à se refermer. Ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie montre que les philosophes tentent sans cesse, comme la vie et comme la société, de fabriquer de l'identité rassurante en rangeant soigneusement et en mettant en équilibre les concepts qu'ils ont forgés, jusqu'au moment où un autre philosophe fait de nouveau souffler un vent puissant qui remet tout en mouvement et qui dérange gravement ce qui avait été si bien rangé. Leibniz a dit, avec une image restée légendaire, que le philosophe voudrait bien rentrer au port mais se retrouve à chaque fois rejeté en pleine mer. En d'autres termes, la démarche de la philosophie c'est tour à tour de rechercher le même dans l'autre et d'introduire de l'autre dans le même.
Altérité et existence : aspects de la construction du monde
La philosophie n'est pas un discours parallèle au monde mais un discours divergent. Mais si sans altérité, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas non plus de réalité. Et il n'y a pas davantage d'existence individuelle. "Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres", dit Sartre, qui voit en autrui ce qui nous fait être en même temps que ce qui nous fait obstacle, puisqu'autrui destitue la prétention de notre conscience "à être le centre de tout". Sans altérité, pas de vie non plus : vivre c'est sans cesse différer de soi, d'un moment à un autre. S'il n'y avait au monde que de l'identité, tout serait indistinct, confus, figé dans une mortelle immobilité. Les choses, en tant qu'elles sont distinctes les unes des autres, sont nécessairement des mixtes de même et d'autre et c'est bien sur cette idée que la philosophie s'est constituée à l'origine. Elle a d'abord été en Grèce, et à bien des égards elle est demeurée depuis, une vaste tentative pour mettre de l'ordre dans la confrontation entre ces éternels adversaires que sont l'altérité et l'identité et aussi entre leurs variantes temporelles, c'est-à-dire ordonnées selon le temps, que sont le changement et la permanence. Ainsi, Platon consent à l'idée héraclitéenne que "tout coule", il fait une place au changement selon Héraclite, admettant, selon la célèbre formule, qu'"on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve". Mais cette idée d'écoulement, Platon ne l'admet qu'en partie : il la limite au monde sensible, qui ne fait l'objet que d'une forme inférieure de connaissance, celle qui porte sur ce qui change (la doxa, l'opinion). L'exigence de stabilité c'est-à-dire de mêmeté l'emporte au contraire dès qu'il s'agit de rechercher le véritable savoir, c'est-à-dire la science, d'accéder à l'intelligible : tout simplement parce que le fonctionnement du logos, l'exercice de la raison, ne semble pas possible dans une réalité mouvante. Ce n'est donc pas du tout par un simple effet de mode que le thème de l'altérité retient autant l'attention aujourd'hui. Certes, la circulation accélérée des personnes, l'importance des migrations, la multiplication des occasions de rencontre avec l'autre ont fait du rapport à l'altérité un enjeu majeur, mais cet enjeu existe depuis l'origine des temps. Depuis toujours ce problème s'est constamment posé : s'il n'y a pas à la fois du même et de l'autre, le monde n'est pas possible, mais s'il y en a, le monde est un perpétuel affrontement entre les deux, une lutte sans fin entre des alter et des ego.
Aussi, la première tâche de la pensée antique, celle qu'on trouve déjà dans Homère et dans Hésiode, a été de fixer une première grande ligne d'altérité, celle qui trace la frontière entre les hommes et les dieux. On connaît la légende racontée par Hésiode dans Les Travaux et les Jours. À l'origine du monde, les hommes sont mêlés aux dieux, vivent avec eux, mangent avec eux. La mort n'existe pas et d'ailleurs il n'y a pas non plus de naissance à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de femme et donc pas de reproduction sexuée. Il n'y a autour des dieux que des andres, des mâles. Mais cet état de coexistence paisible ne dure pas, malheureuse-ment, et c'est par la faute des dieux. Il va y avoir une guerre entre Kronos et Zeus, comme vous le savez, suite à une forme de refus de l'autre qui s'appelle la rivalité. Et c'est Zeus qui va gagner cette guerre. Une fois victorieux, il demande aussitôt ce que font là les anthropoï, ces hommes qui vivent avec les dieux mais qui ne sont pas des dieux. Il veut qu'on précise leur statut, qu'entre les dieux et eux il y ait une frontière claire, une altérité. Chacun doit avoir son lot. C'est alors qu'intervient Pandore, la première femme, créée sur l'ordre de Zeus qui voulait se venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée, Pandore, le cadeau (doron) de tous (pan) les dieux, merveilleuse à voir mais animée, dit le texte, "d'un esprit de chienne et d'un tempérament de voleur". Quand elle ouvre la fameuse boîte, toutes sortes de maux vont en sortir et se répandre sur la terre. Les hommes, qui cette fois sont aussi des femmes, vont devoir se nourrir pour survivre, se reposer quand ils sont fatigués, se soigner quand ils sont malades, mais sans garantie de guérison : il leur faut désormais accepter la menace de la mort et la mort elle-même. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont a été tracée une ligne infranchissable, une première altérité fondamentale, entre les immortels, les êtres qui connaissent une parfaite félicité du seul fait de leur existence, et les mortels qui doivent se mettre eux-mêmes en quête de leur bonheur et à qui est refusé le privilège de l'immor-talité. Partout les mythes remplissent cette fonction parce qu'aucune représentation du monde et donc aucune existence humaine ne sont possibles sans des lignes d'altérité qui les organisent et qui les structurent.
L'absolu et le relatif, ou la ligne d'altérité
Mais ce qui vaut pour l'imaginaire vaut aussi pour le réel et pour le cours des choses. On sait bien que l'histoire des hommes s'est tout entière construite sur la désignation de l'autre. Qui est autre et qui est l'autre sont toujours les premières questions qui se posent lorsqu'on se de-mande qui on est soi-même - ce que partout les hommes n'ont cessé de faire. Les grands changements, au long de l'histoire, sont ceux qui ont modifié les lignes d'altérité. Je prends l'exemple des grandes découvertes. Une découverte, en effet, est toujours, comme tout vrai voyage, une irruption de l'altérité dans le savoir déjà établi ou inversement, si on préfère, car c'est une question de point de vue, du savoir établi dans ce qui est par rapport à lui une altérité. Par exemple, jusqu'au voyage de Christophe Colomb, premier navigateur à avoir découvert un nouveau monde, le monde des européens, c'était encore la Méditer-ranée, avec ses abords immédiats, c'est-à-dire un petit monde insulaire entouré par un grand océan, selon la représentation héritée des Grecs. Même Marco Polo, en allant jusqu'en Chine, n'avait pas vraiment quitté tout à fait ce monde, il était plutôt allé jusqu'à ses confins. Il était resté en quelque sorte dans les extrêmes limites du même. Mais Christophe Colomb, qui ne comprend pas encore en quel sens il a découvert un nouveau monde, un monde autre - mais pas un autre monde - se heurte, lui, à une altérité imprévue. Il voit d'autres hommes, beaux, allant et venant nus sans aucune gêne, si différents de lui qu'ils sont des hommes autres ou même peut-être pas des hommes du tout, et c'est l'origine, comme chacun sait, d'un extraordinaire débat de fond qui est connu sous le nom de Contro-verse de Valladolid. Cette controverse pose très exactement la ques-tion du même et de l'autre, c'est-à-dire du degré d'altérité. L'altérité absolue qu'on entrevoit alors se retrouvera au XVIIIème siècle lors des voyages dans le Pacifique de Cook et de Bougainville avec quantité de peuples visités et bien entendu au XIXème siècle dans la conquête de l'Ouest américain avec les amérindiens du nord.
Mais même en dehors des grands voyages, dans la vie quotidienne, le rôle de l'autre est lui-même toujours mouvant et l'altérité fluctue. Je vais prendre un exemple du déplacement de la ligne d'altérité en m'appuyant sur l'expérience de l'écriture, de la production de textes écrits. Si j'écris une lettre, le destinataire est l'autre. Il l'est pleinement, il est complètement autre, si c'est à ma banque ou à une adminis-tration que j'écris. Si c'est à quelqu'un avec qui j'ai de vrais liens personnels, il reste l'autre formellement, mais il existe selon une altérité différente, qui prend en compte les identités : il est certes absent quand je m'adresse à lui, mais il est relié à moi, il est comme en position de vis-à-vis, et il existe déjà par avance une sorte d'espace commun intermédiaire entre l'auteur que je suis et le lecteur qu'il sera, dans une configuration où chacun a besoin de l'autre pour exister et recevoir un statut. Le destinataire est déjà en puissance un autre très particulier, puisqu'il est celui qui a le pouvoir d'écrire une réponse se situant sur le même plan. Une lettre à un ami relève d'une connivence, d'une intimité qui autorise les demi-mots, les sous-entendus, l'idée d'un monde partagé qui n'existe évidemment pas si j'écris aux services fiscaux ou au service clientèle d'un fournisseur. Troisième cas, j'écris mon journal intime, et là le schéma est encore différent : l'autre n'est nulle part, puisque le texte n'a pas de destinataire extérieur. Dans un journal intime, l'auteur lui-même se projette en autre et peut-être sera l'autre lorsque plus tard il relira son journal, tout en restant le je qui l'a écrit, un je dont la mêmeté aura persisté mais se sera altérée. Ou si d'aventure le journal est publié, c'est le monde entier qui sera l'autre : le texte sera offert à tous ceux qui voudront être cet autre et qui le liront chacun en se croyant le seul autre et en se prenant plus ou moins pour le je qui l'avait écrit ou en s'identifiant à lui. Enfin, quatriè-me niveau, dans la lettre d'amour, celle que semblent écrire les personnages des tableaux de Vermeer, l'altérité tend à s'abolir com-plètement dans une sorte de fusion avec l'autre et c'est le sens de la défini-tion de l'amour que donnait André Breton dans un lexique épis-tolaire : "l'amour, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous".
Ce qui saute aux yeux, à travers ces quelques exemples, c'est la confirmation que la mêmeté et l'altérité ne sont pas du tout des choses, mais d'emblée des relations. Selon l'angle qu'on choisit, l'autre du même est tout autant le même de l'autre. Pour reprendre l'exemple des voyages de Christophe Colomb ou de Bougainville, il est clair que pour les populations autochtones, ce sont le découvreur européen et ses compagnons qui sont l'autre et qui doivent donc être divinisés ou assimilés ou expulsés ou détruits. Dans le Pacifique, les fameux cultes du cargo ont pris des formes contradictoires, qui reflétaient la volonté, selon les cas, de nier l'autre, c'est-à-dire l'euro-péen, de l'anéantir, ou bien de l'intégrer et de se lier à lui par une espèce de nouvelle mêmeté. Le culte du cargo est comme on sait un ensemble de rites apparus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle chez les aborigènes de Mélanésie en réaction à la colonisation. Il consiste à imiter les opérateurs radios commandant du ravitaillement et toute la technologie occidentale en espérant obtenir les mêmes effets. Les indigènes, ignorant les modalités de production de l'Occident, attribuent l'abondance des biens apportés par cargo à une faveur divine, l'avion-cargo devenant un dieu. "Les indigènes ne pouvaient pas imaginer le système économique qui se cachait derrière la routine bureaucratique et les étalages des magasins, rien ne laissait croire que les Blancs fabriquaient eux-mêmes leurs marchandises. On ne les voyait pas travailler le métal ni faire les vêtements et les indigènes ne pouvaient pas deviner les procédés industriels permettant de fabriquer ces produits. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'arrivée des navires et des avions". Certains imitaient donc simple-ment, pour s'y identifier et en tirer profit, le mode d'approvision-nement maritime des européens. D'autres marquaient une rupture avec les pratiques traditionnelles au profit d'un nouvel environnement économi-que, social et culturel reconstruit sur le mode de vie des européens mais tenant les européens à l'écart, ce qui est une façon de recourir tour à tour à la mêmeté et à l'altérité. Au Vanuatu, sur l'île de Tanna, un culte du cargo bien connu, celui de John Frum, engageait à se défaire de l'argent, qui devait être dépensé ou jeté à la mer, ce geste étant supposé entraîner le départ définitif des marchands blancs et leur remplacement par des autochtones, l'autre étant ainsi absorbé et donnant magiquement naissance à un nouveau soi-même.
Variations de l'être-autre : problématiques de la diversité et de la différence
Il se vérifie ainsi chaque fois qu'une très grande altérité, une altérité qui déplace radicalement la ligne frontière de ce qu'on connaît et qui de ce fait dérange, doit être à tout prix réduite, afin que puisse être préservé l'arrangement antérieur du monde. L'autre - que ce soit une per-sonne, un objet, une idée ou un système de concepts - doit toujours être récupéré, il doit impérativement recevoir une place compatible avec l'ordre précédent. Pour cela, il peut être asservi, instrumentalisé, comme on dit à présent, adoré ou anéanti : les solu-tions ne manquent pas pour rétablir l'équilibre en faveur du même, pour assurer la prééminence de l'identique qui nous est naturellement si chère. Ranger et déranger sont deux grands axes de l'activité humaine. Notons au passage que ramener au même est également la démarche de la science, car la recherche scientifique consiste à tenter de rattacher ce qu'on ignore à ce qu'on connaît. Mais il reste toujours, dans quelque science que ce soit, un résidu, un élément qui résiste. C'est ce que montre l'ethnologie, qui est un art particulier de compren-dre le même et l'autre - au sens pre-mier de comprendre, prendre ensemble. Même converti, même amené à une certaine mêmeté, l'autre, l'indigène, peut rester malgré tout "intensément autre", j'em-prunte le mot à une étude au titre révélateur sur le tahitien qui serait "toujours l'autre, encore nous".
Nous retrouvons ici la notion d'altérité radicale, que nous avions entrevue tout à l'heure. Elle tend d'ailleurs à changer, de forme comme de contenu, dans le monde moderne. Victor Segalen en exposait le déclin dans son célèbre Essai sur l'exotisme. Dans les années 1900, il parlait d'exotisme au sens de contact avec cette altérité radicale. Et en effet les voyages étaient plus rares qu'aujourd'hui et Segalen pouvait parler d'"ivresse de la rencontre". Mais désormais la terre a été explo-rée à satiété et elle devenue, en ce sens, une boule sans relief où les voyages ne sont plus guère des aventures : on en fait juste le tour et c'est ce qui s'appelle fort justement le tourisme. Le tourisme est la rencontre d'une altérité soft, et peut-être la mode des objets ethniques a-t-elle le sens d'une nostalgique compensation. Par ailleurs, l'altérité radicale n'est pas pour autant absente de la modernité. Comme si elle ne pouvait être contenue, elle ressurgit ailleurs, par exemple dans l'insociabilité des mondes urbains, dans tous les lieux apparemment normalisés où ce que Baudrillard appelle l'altérité "ingérable, mena-çante et explosive" peut à tout moment faire irruption dans le champ social : monde de la violence, concentration des problèmes dans les cités et partout où se manifeste de façon plus ou moins aigüe "l'inso-ciable sociabilité des hommes", comme disait Kant.
Le même et l'autre renvoient donc de la même façon à des problèmes d'ontologie classique et à la constante interrogation de la modernité sur l'identité et la différence, sur le rapport à l'autre, à cet autre si dissemblable dans une humanité pourtant commune. Car l'altérité n'est pas un repère fixe, elle n'est pas en soi un état. Le plus souvent, elle va, vient et fluctue. Il est significatif que les Grecs l'aient repré-sentée dans leur Panthéon par un dieu à part, Dionysos, un dieu à la fois vagabond et sédentaire, qui arrive partout en étranger mais veut être accueilli comme étant chez lui. Dionysos représente ce qui est différent, déconcertant, impré-visible, ce qui est complètement autre. Il est par exemple le dieu des épidémies et chacun peut constater, par les temps qui courent, combien l'aspect déroutant fait partie de la nature même des grandes épidémies. Ici, à la Réunion, nous avons été bien placés pour savoir quelle sorte d'altérité insaisissable avait introduit le chikungunya - et par quelles étapes.
L'altérité en effet, nous l'avons entrevu, est susceptible de degrés. Pensons à la Métamorphose de Kafka, où Grégoire Samsa, vendeur de son état, se réveille un matin transformé en un "monstrueux insecte". Il perçoit, il comprend et il pense comme un humain, mais étant donné son apparence, sa famille et son entourage le considèrent désormais comme étant radicalement autre en raison de sa graduelle accession à l'animalité qui se substitue malgré lui à son statut humain de fils, de frère ou d'employé d'assurances. Au fil du récit, son langage devient inintelligible, il perd sa place dans le monde social, il devient peu à peu un parfait étranger, une chose, un détritus. Sa métamor-phose le conduit à la solitude absolue et à la privation de toute rencon-tre, au terme d'une lente et incommunicable dégradation, jusqu'à une altérité radicale qui recoupe évidemment la frontière entre humanité et animalité, selon le modèle de la séparation antique par ligne d'altérité que nous avons évoquée tout à l'heure à propos de la séparation des dieux et des hommes.
Du bon usage du même et de l'autre : éthique de l'altérité
On voit bien à travers cette métaphore de la Métamorphose de Kafka, qui est en vérité une grille de lecture universelle, comment le passage de la ligne d'altérité en commandant le découpage de la réalité et la qualification de ses composantes est aussi la source du traitement différencié des choses qui est au fondement de la démarche que nous appelons éthique. Je voudrais donc faire, dans cette perspective d'une éthique de l'altérité, quelques remarques sur la problématique essen-tielle, celle du bon usage de la différence. Il y a toujours en effet, et nous avons vu que c'est la cadre même de notre existence, un affron-tement incessant entre l'identité et la différence. La différence, avons-nous dit, est première et c'est par elle que tout existe. Il n'y aurait pas de mélodie s'il n'y avait qu'une note, ni de symphonie s'il n'y avait qu'un instrument. C'est donc à juste titre qu'on fait l'éloge de la diffé-rence et même qu'on invoque le droit à la différence. Mais droit à la différence signifie en réalité droit à l'identité, car on voit bien qu'en disant différence on veut dire indirectement, identité. Pourtant diffé-rence des choses et choses différentes ne reviennent pas du tout au même. Beaucoup de différences ne constituent pas des identités. Par exemple dire les jeunes, ce n'est pas désigner une espèce. La jeunesse ne constitue pas une différence à vocation identitaire, même si heureuse-ment il existe une histoire, une psychologie et une socio-logie de la jeunesse, qui nous sont fort utiles. Et cela vaut pour beau-coup d'autres catégories : être objet de recherche et de connais-sance ne confère pas d'office un statut existentiel.
Autrement dit, la différence n'est qu'un élément ou un ensemble d'éléments qui distin-guent une chose qui par ailleurs se rattache par quantité de traits essentiels à une autre réalité plus large. La différence ne fait pas par elle-même une identité, ou plutôt elle ne fait une iden-tité que sous certaines conditions et à partir d'un certain seuil. Claude Lévi-Strauss a bien montré, par exemple, que la civilisation n'est pas fracturée par la coexistence des cultures mais au contraire consiste dans cette coexistence même. La diversité est une richesse et l'uniformisation une perte, mais en même temps "l'écart différentiel" par lequel une culture existe n'a de sens que dans l'unité du mouve-ment par lequel toutes les cultures expriment ce qu'elles ont de fonda-mentalement commun, à savoir un même effort pour s'arracher à la nature. En d'autres termes, plus les mille et une façons par lesquelles les hommes s'affirment comme tels se révèlent différentes, et plus elles proclament en réalité une même et commune humanité. Ce qui nous rappelle à la fois que l'identité est ce qui résiste aux différences, que la vraie perception de la différence dépend de la conscience de l'identité et que c'est justement le fait d'être aveugle à l'universel qui rend esclave des différences et amène à croire qu'elles sont indépas-sables. Par exemple, ramener son identité aux spécificités du groupe auquel on appartient - telle culture, telle religion, telle ethnie, tel âge de la vie, tel sexe, etc. - c'est oublier ou mettre de côté les deux plus grandes richesses que chacun possède : sa propre singularité et en même temps son appartenance à une universalité. Il en va de même, naturellement si c'est à autrui qu'on applique ce schéma, et si c'est l'autre qu'on enferme dans son altérité.
La grande priorité d'une éthique de l'altérité est donc d'apprendre à bien juger de ce qui est même et de ce qui est autre, de découvrir où passe la ligne entre les identités vraies et les dérives identitaires, entre la légitime affirmation de soi et le narcissisme ou l'exhibitionnisme de la diversité. Car l'universel, qui est le principe de toute éthique huma-niste, n'a pas de visage. Il est dans tous les visages. Il fait penser à ce que Leibniz disait de la ville. Une ville, quelle qu'elle soit, on ne la voit que partiellement quand on se promène dans les rues. Si on change de quartier, la vue change aussi, puisqu'on n'est plus dans la même rue et que décor est donc modifié. Mais la ville qui paraît différente qu'on voit alors, c'est néanmoins toujours la même ville. La perception de la différence n'est possible que par la conscience de l'identité et inversement. De la même façon, la place que nous faisons à ce qui nous semble autre définit aussi notre propre place : devant l'altérité, nous sommes plus que jamais, selon la formule bien connue de Bourdieu, "des classeurs classés par nos classements".
Unité et diversité : monde propre, monde de l'autre, monde commun
Je voudrais donc, pour terminer, évoquer le problème central de l'altérité que constitue le rap-port entre le monde propre, le monde de l'autre et le monde commun. Chacun, spontanément ou immédiate-ment, est à lui-même son propre monde et le monde commun est ainsi traversé par une pluralité de mondes particuliers. La même forêt par exemple n'a pas le même sens pour un couple d'amoureux qui s'y promènent, pour l'agent forestier attentif aux chantiers en cours ou à venir, pour le ramasseur de champignons ou pour le sportif qui la traverse en courant. Spinoza notait dans l'Éthique qu'un soldat tombant sur une trace de cheval pensera aussitôt au cavalier puis à la guerre, tandis que le paysan pensera à la charrue et aux récoltes. Ainsi, chacun est à lui-même son propre monde singulier, en fonction de son éducation, de sa culture, du groupe social auquel il appartient.
D'un autre côté, autrui est un monde possible, selon la belle définition de Gilles Deleuze, un monde autre avec tout ce qu'il peut envelopper comme singularités ou comme particularités. Rencontrer quelqu'un, c'est déplier quelques aspects de ce monde singulier en fonction du de-gré d'intimité qu'on a avec lui. L'autre est un pliage d'éléments qui lui sont propres et le monde qui est le mien est ainsi entouré d'une multiplicité de mondes possibles, de mondes autres. Sur ce point de vue unique sur le monde qu'occupe autrui, je ne peux faire que des conjectures ou des hypothèses. Déplier le monde propre de l'autre ne va jamais de soi. Nous nous trompons souvent en jugeant autrui par analogie, sur la base des sentiments que nous éprouvons nous-mêmes. Et croire qu'on peut accéder au monde de l'autre immédiate-ment, par exemple dans l'expérience de la pitié ou de la sympathie (sentir avec) est tout aussi trompeur : les moralistes savent bien par exemple que dans la pitié on ne fait souvent que pleurer sur soi-même. Les situations ne sont jamais superposables. L'autre est dans une situation toujours spécifique. Il souffre parce qu'il a perdu sa femme ; je souffre parce qu'il souffre ou je me mets en colère parce qu'il s'est mis en colère. De lui à moi, le rapport au monde n'est jamais le même et les significations engagées sont à chaque fois différentes. Il y a ainsi des situations littéralement incompréhensibles, par exemple celle du malade pour le bien-portant, ou du chômeur pour celui qui travaille.
L'altérité, c'est précisément ce qui fait que l'autre est mon semblable tout en étant différent. L'autre est celui qui peut me surprendre, celui dont le comportement peut me déconcerter et se révéler énigmatique. Autrui est l'intrusion d'un monde autre dans mon monde propre, une surprise qu'il peut aussi être pour lui-même, comme je le suis pour moi jusque dans la solitude, car autrui ne cesse, comme moi, de changer, de différer de lui, d'être autre à travers le temps. La possibilité d'une surprise est la garantie que l'autre est un sujet libre, irréductible à ce que je projette sur lui et à mes attentes. L'autre est ainsi une figure profondément contradictoire : trop loin, je le perds, car sa différence le rend sans rapport avec moi, trop près, je le nie dans son identité au point de le perdre d'une autre façon, par une sorte de suppression. Il faut trouver l'eumétrie, la bonne distance : ni trop loin, ni trop près.
Aux sources de la dialectique : le couple fécond d'autos et allos
Mais cette question se pose dans une cadre social, à travers les figures concrètes de l'altérité que la société constitue. De ce proces-sus, nous avons des exemples particulièrement significatifs : la folie, le handicap, la délinquance, la pauvreté, etc. La première altérité, la plus radicale sans aucun doute, est la folie. L'aliénation - mot de la famille d'altérité - est le fait de devenir étranger à soi-même et aux autres, donc de devenir plus ou moins entièrement "autre". Cependant, la folie n'est pas une vérité de nature mais un produit historique : elle a connu une grande diversité d'élaborations sociales et culturelles et une multiplicité de formes. Le partage entre normal et pathologique, qui est une des grandes codifications de la relation du même et de l'autre, a débouché à partir du XIXème siècle sur la médicalisation et la capta-tion psychiatrique de l'altérité. Sur ce modèle de la folie, Michel Foucault a soumis la société à une interrogation plus large sur ce qu'elle rejette à sa marge, ce qu'elle repousse du centre vers la périphérie. La question est : qu'est-ce qu'une société considère comme normal, habituel, comme une mêmeté rassurante ? Car le même se définit par son autre, par ce qu'il rejette ou par ce à quoi s'oppose. En témoignent bien d'autres formes d'altérité, comme par exemple celle du handi-cap, celui qui y est confronté étant constitué par le regard de l'autre. Comme le montrent les analyses de Sartre dans L'Être et le Néant, de sujet libre, de pour-soi qu'il est, celui qui rencontre le handicap risque de devenir un en soi, il est "réifié", d'une certaine façon transformé en chose. Il est placé devant une double possibilité, soit nier son handicap (recherche de l'identité), soit se conformer à l'image attendue (durcissement de la différence et de l'altérité). Car l'ordre social, tout comme l'ordre biologique, vise toujours à la reproduction du même, d'où l'inquiétude que provoquent l'altérité et la différence en tant que source d'écarts à la norme, qui bien souvent nourrissent aussi la peur.
Ce problème de l'altérité s'aggrave de ce que nos sociétés sont des sociétés normalisatrices qui rejettent les différences. Michel Foucault a montré comment ce rejet s'inspirait de grands modèles historiques, et d'abord celui du rejet de la lèpre et des lépreux. L'exclusion du lépreux est le prototype de la ségrégation (pratiques de clôture et d'exil, la léproserie constituant une sorte d'image inversée du monde). L'autre grand modèle est le quadrillage de la peste, où la séparation est faite au cur même du système social, dans une espèce d'exil intérieur. Les deux modèles se fondent ou se combinent ensuite, le lépreux pouvant être traité comme un pestiféré ou le pestiféré comme un lépreux dans diverses formes de mixité entre ségrégation et intégration disciplinaire, comme le montreront au XIXème siècle la mise en place de l'hôpital, de l'asile, de la prison, de la fabrique, qui sont autant de déclinaisons de l'altérité - et il y en a bien d'autres figures, comme par exemple la délinquance, où l'autre est celui qui ne respecte pas les règles, ou encore la marginalité, où l'autre est celui qui ne se conforme pas au modèle dominant.
C'est dire combien de problèmes aigus, combien d'aspérités de la modernité, combien de menaces pour l'avenir des hommes aussi, relèvent aujourd'hui de l'opposition du même et de l'autre. Non seulement même et autre ne sont pas, nous l'avons vu sous différents angles, des concepts figés, usés par l'âge, mais ils sont la source vive du processus dialectique qui est, comme Platon l'a dit avec tant d'insistance, au centre de toute la philosophie. Dans des textes absolument essentiels du Phèdre, du Sophiste et du Politique, il analysait les deux grandes voies de la dialectique, la division (diairesis) et l'unification (sunagogê). Or, dans cet entrecroisement de l'unité et de la multiplicité qui est, nous l'avons vu, le principe même de la pensée, la division est ce qui ramène le même à l'autre et l'unification inversement est ce qui ramène l'autre au même. En ce sens, allos et autos demeurent un couple à la fécondité inépuisable qui permet d'appréhender en permanence l'épaisseur du monde.
Qu'est-ce que voter ? La subversion du politique. Conférence pour les Amis de l’Université de la Réunion le 21 mars 2017 au Centre Culturel Langenier de Saint-Pierre.
Sur l'économie sociale et solidaire. L'économie et les valeurs : rencontre et conséquences
Intervention pour la journée d'études et de formation ADC-IRTS de la Réunion le 24 février 2017 : "Les établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Quelles opportunités pour les cadres de direction et dans quelles perspectives éthiques ?"
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée d'étude et je vous remercie de m'avoir confié une fois encore le rôle de philosophe de service, fonction et dénomination sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque je m'en suis déjà expliqué devant vous et que, si vous le permettez, je considérerai cette assemblée que j'ai le plaisir de rencontrer chaque année comme "un même homme qui subsiste toujours et apprend continuellement", selon la formule bien connue de Pascal.
D'une certaine façon, cette continuité se retrouve dans les thèmes qui ont été choisis depuis trois ans : en 2014, c'était "le marketing et l'action sociale", avec la question de l'éthique du mécénat et de la publicité, en 2015 "Penser l'institution autrement", où l'examen de la désinstitutionalisation avait fait évoquer le risque d'une forme d'ubérisation dans le secteur social. Ces deux interrogations renvoyaient très directement à des questions de financement et à des aspects budgétaires essentiels du fonctionnement des établissements - ce qui ne signifie pas que nous ne venons ici que pour parler d'argent car les problématiques qui ont été abordées étaient plus larges et orientées comme toujours vers l'évolution de vos fonctions de direction et leur dimension éthique. L'économie sociale et solidaire, qui est le thème d'aujourd'hui, vient souligner de nouveau, mais cette fois-ci par une espèce de relief en creux, la dimension économique des établissements, alors même que ce sont des établissements du champ social qui par nature se situent aux antipodes de l'intentionnalité économique proprement dite. On voit bien que parler dans une même phrase des Établissements et services sociaux et médico-sociaux et de l'économie sociale et solidaire, ce qui est le cas de notre titre de ce jour, c'est courir le risque d'énoncer, selon la lecture qui en sera faite, soit une contradiction soit un pléonasme. D'un côté, toute activité et même toute existence humaines sont sociales par essence (du mot construit sur socius, le compagnon, l'allié), car rien de ce qui est vraiment humain ne peut être solitaire (de solus, tout seul). En outre social entraîne nécessairement solidaire (de solidus, ce qui est lié à tout le reste, donc solide, car l'idée même de société, qu'on parle d'un simple groupe ou de l'humanité tout entière, est toujours la coïncidence d'une multiplici-té et d'une unité). Pour le dire d'un trait, dans tout ce qui vient de socius, rien ne peut être solus et tout est nécessairement solidus. Donc, au sens strict des termes, si je dis qu'une économie, c'est-à-dire un système d'échange, est sociale et solidaire, j'énonce ses propriétés de manière fondamentalement pléonastique. La notice de présentation de cette journée - excellente, comme toujours - dit très bien que vos établissements "se situent implicitement dans le champ de l'économie sociale et solidaire" et qu'ils ont même été à son origine historique, et je vous renvoie sur ce point précis au premier alinéa de la rubrique "contexte". Mais à l'inverse, si je disais que tel établissement à caractère social ne procède pas d'une démarche sociale et solidaire ou n'en relève pas, j'énoncerais une contradiction, une proposition impossible et intenable, je créerais un objet impensable qui ne pourrait pas entrer dans un système conceptuel cohérent. Voilà en tout cas un premier constat que nous pouvons faire.
Mais en même temps souvenons-nous que nous vivons dans un monde où on ne cherche que des réponses et qu'il n'y plus guère que la philosophie qui donne vraiment sa chance au questionnement. Car la philosophie a hérité de ses origines antiques une démarche fondamentale qui est de questionner les termes de la question qui se pose avant que ce soit elle qui se mette à nous narguer de façon énigmatique et muette, nous empêchant alors de répondre et nous clouant dans un manque de savoir stérilisant. Au début d'un illustre dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, et qui est donc un des premiers textes de ce qu'on commen-çait à Athènes, au Vème siècle av. J.-C., à appeler la philosophie, Socrate fait une remarque dont on a souvent dit, à juste titre, qu'elle était "à couper le souffle" : il dit que s'interroger sur quelque chose suppose de savoir de quoi on parle, alors qu'en réalité on l'ignore au moins sous certains aspects, puisque justement on s'interroge. Cette remarque concerne toute l'activité de la pensée, car ce qu'on connaît, on ne le cherche pas, puisqu'on le connaît, mais ce qu'on ne connaît pas, on ne le cherche pas non plus, puisque ne connaissant pas ce qu'on cherche on ne peut pas le reconnaître, même si d'aventure on l'aperçoit. C'est sur cet embarras étrange que prend appui la philosophie, traversée incertaine dont la destination est un certain savoir mais dont le port d'attache est une certaine ignorance consciente d'elle-même et qui rend le savoir désirable - c'est d'ailleurs pour son ignorance de ce qu'on sait mieux que lui qu'on fait appel au philosophe.
Ce matin, je voudrais effectuer avec vous une navigation en trois étapes, on-tologie, épistémologie, éthique, comme toujours. Premièrement, comment les choses se présentent-elles, comment, dans un champ déterminé, l'économie et les valeurs se rencontrent-elles ? Deuxièmement, quelle est la validité des notions utilisées pour rendre compte de cette rencontre et pour en dégager une problé-matique ? Par exemple, de quoi parle-t-on, en matière sociale, quand on évoque les valeurs, l'utilité ou la démocratie et comment la jonction se fait-elle alors entre le réel et l'idéal ? Enfin, troisièmement comment peut-on non pas envisager une éthique complète - il n'est pas question d'écrire ce matin un Serment d'Hippocrate du social - mais au moins une forme de régulation du rapport entre l'entreprise et les valeurs, qui serait confiée à ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la gou-vernance.
D'abord, donc, comment les choses se présentent-elles ? Là aussi, bien entendu, je me reporte à notre notice, second paragraphe et je lis : "l'évolution économique, la rationalisation des coûts, la volonté de maîtriser les dépenses [
] nous ont amenés à nous orienter vers un modèle fondé sur des valeurs". Ce qui veut clairement dire que l'exigence de valeurs apparaît liée aux difficultés générées par l'économie, qu'elle en est même la conséquence ou le résultat à travers les dispositifs imaginés pour corriger ou limiter des excès constatés et pour trouver, comme on dit, une alternative aux échecs du système dominant. Si on annonce qu'on veut se fonder sur des valeurs, c'est que jusque-là on ne le faisait pas ou pas assez Le texte de la loi du 31 juillet 2014, dont je considèrerai, si vous le permettez, que nous l'avons tous à l'esprit, ne commence pas par un préambule de ce genre, mais manifestement il le suppose acquis et accepté. L'Institut de Re-cherche des Nations Unies pour le Développement Social présente explicitement dans une de ses publications l'économie sociale et solidaire comme un mode alternatif né, je cite, "de crises mondiales à répétition et du développement dicté par le marché". Voilà des accusations précises. L'avènement de l'économie sociale et solidaire correspond donc bien à un surgissement des valeurs, au réveil d'une posi-tivité militante par rapport à la négativité d'une économie libérale dont les va-leurs se sont absentées depuis que le profit a été promu au rang de principe direc-teur du monde. Que ce soit dans le texte de la loi de 2014, dans les documents qui ont été rédigés pour l'expliquer et pour la diffuser, dans les études et les ar-ticles parus sur le sujet, ou même dans la sympathique et passionnante réunion que nous avons tenue entre nous en décembre dernier pour préparer cette jour-née, je remarque que c'est toujours par une exposition immédiate aux valeurs que l'on commence. On dit d'entrée que l'économie sociale et solidaire est une économie et un mode d'entreprendre qui mettent en avant des valeurs. Lesquelles ? On répond par exemple la solidarité, la démocratie, la non-lucrativité. Ce qui est au fond une façon de dire que l'économie en général, c'est le contraire : le chacun pour soi, la plou-tocratie et la loi du profit sans limites. Et on reconnaît là, sans hésitation possible, les caractéristiques du monde de concurrence effrénée qui est le nôtre, du néolibéra-lisme mondialisé et des déséquilibres et injustices qu'il entraîne, d'un système où, comme le disait déjà Karl Marx, les gouvernements en place sont des fondés de pouvoir du capital et où l'absolutisme économique régnant impose des idéaux au fond terrifiants de croissance perpétuelle. L'économie sociale et solidaire apparaît alors comme une économie dont les valeurs de référence sont exactement celles qui devraient être la référence de toute économie mais qui ne le sont pas. Je laisserai de côté, dans cet exposé, la question de savoir si dans un monde libéral, l'économie sociale et solidaire, n'est pas aussi, sous couvert de valeurs, un secteur où sont ras-semblées les actions non rentables pour le secteur marchand, autrement dit un champ où sont transférés les devoirs de la République envers ses propres enfants lorsqu'ils sont jugés trop coûteux, surtout pour le monde perpétuellement en crise qu'on nous présente comme étant le nôtre. Invoquer des valeurs pour réduire la dépense serait alors le degré suprême de l'art qui consiste à faire, comme on dit, de nécessité vertu.
Quoi qu'il en soit, on voit que ces questions concernent l'économie dans son ensemble, et donc la politique au sens d'organisation et de gouvernement de la cité, puisque l'économie et la politique ont été les premières inventions de la philosophie, lorsque la Grèce ancienne a nommé le monde, donné un horizon aux choses et institué la cité (polis), c'est-à-dire lorsqu'elle a fixé le cadre dans lequel nous vivons encore. L'économie est née, en effet, lorsque l'oikos, en grec le lieu où on habite, n'a plus été seulement la maison, le domaine ou la propriété, mais la cité, puis le pays, puis le monde - à l'époque le monde de la Méditerranée - c'est-à-dire un ensemble supposant une stratégie et une législation sur les échanges (car nomos, c'est la loi, la règle, l'usage codifié, d'où l'économie, le nomos de l'oikos, c'est-à-dire, au fond, la loi du monde). Mais ne pensez pas qu'en avançant ces quelques mots de grec, je m'éloigne de notre question. Au contraire je la rétablis dans sa vraie perspective, car toute réflexion fondamentale sur l'économie nous vient de la philosophie de Platon, qui en a établi les catégories et pensé par avance les modes de régulation, dont l'écono-mie sociale et solidaire est un cas particulier parmi d'autres possibles. Platon, premier penseur de l'économie en Occident, a établi tout d'abord que l'économie est par nature ambivalente, puisque tour à tour elle fait et elle défait la cité. Elle la fait, puisque ce sont des appétits et des intérêts à satisfaire qui poussent les hommes à s'associer et donc à créer des cités. Mais par la suite, très vite les intérêts divergent, les appétits deviennent démesurés et des conflits surviennent. Ce qui devait faire le bonheur de la cité, à savoir la primauté des échanges sur la production, fait désormais son malheur : alors, la cité se défait, car ceux que nous appelons maintenant les acteurs économiques, faisant valoir que l'économie est à l'origine de la cité, se mettent à penser qu'ils doivent aussi la diriger politiquement, alors que la véritable politique au contraire est là pour arbitrer entre les intérêts, pour viser à l'harmonie et à la régulation de l'économie au bénéfice de la cité tout entière. Or, remarque Platon, une fois exacerbé le désir de possession et de domination, l'enrichissement des uns, les riches, se fait indéfiniment au détriment des autres, les pauvres : seule la politique, c'est-à-dire le juste gouvernement de la polis, peut intervenir par la loi pour mettre un terme aux discordes, à la surenchère et à la dégradation de la cité. Malgré tout, Platon n'a pas eu à se demander, comme nous aujourd'hui, s'il est possible de gouverner un pays de façon juste lorsqu'il y a des frontières pour les dettes et pas de frontières pour les profits, et cette question l'aurait sûrement intéressé, mais il a en tout cas établi que la cité ne peut durer que si elle reste une communauté politique et ne devient pas un syndicat d'hommes d'affaires. On voit bien toute l'actualité de la réflexion antique. La cité ne reste une cité que si elle est régulée par le politique, c'est-à-dire par des objectifs, des finalités, des principes, des idéaux, par tout ce qui constitue le champ des valeurs, celui justement auquel se rattache l'économie sociale et solidaire.
Et nous abordons là le second temps de notre navigation, le plus périlleux sans doute, puisqu'il s'agit de comprendre une démarche par laquelle on veut, au sens où l'avait dit Platon, interdire à la société de marché de faire la loi pour tout - en termes modernes interdire à ceux qu'on appelle à présent d'un curieux mot les décideurs de tout décider. Des textes, législatifs ou réglementaires, définissent l'encadrement très strict de l'économie sociale et solidaire en tant qu'organisation d'une économie du partage : leur analyse et leur interprétation seraient d'un grand intérêt, mais dans le cadre limité de cet exposé, je soulignerai seulement la force du mouvement d'inversion éthique que constitue une économie qui se définit comme sociale et solidaire. Car il faut avoir à l'esprit que nous vivons à présent un monde dont les héros sont les créateurs de start up, les sportifs professionnels, avec leurs ballons d'or qui sont en or au sens propre plus encore qu'au sens figuré, les vedettes du star system généralisé dont il ne semble pas que l'activité désintéressée soit précisément le principe de vie, sauf quand il s'agit de se montrer ostensiblement au service d'une noble cause à la mode, dans un monde, donc, où le seul but de la vie des hommes semble être la croissance et la création de richesse - c'est du moins ce que le discours politico-médiatique nous répète inlassablement pour nous faire accepter notre asservissement à l'économie. Et alors que les télévisions nous représentent 24 heures sur 24, pour en faire la publicité directe ou indirecte, le modèle à la fois désespérant et anesthésiant de la prospérité hyper-libérale, c'est un véritable choc éthique qui se produit lorsque la loi ouvre, je cite, un "périmètre contrôlé" autour des trois grands principes "but autre que le partage des bénéfices, gouvernance démocratique et gestion responsable". Et on lit encore, un peu plus loin, qu'il faut organiser l'activité de telle manière que "les hommes et les femmes prédominent face au capital", ce qui est un objectif pleinement humaniste. Vous aurez remarqué qu'on retrouve là une troublante parti-cularité qui a été déjà entrevue tout à l'heure : on attribue à l'économie sociale et solidaire des caractéristiques dont on crédite d'habitude l'économie tout entière. Car nous savons bien qu'à travers la culture d'entreprise, la globalisation, la compétitivité et autres pseudo-valeurs à la mode, la prospérité est toujours présentée comme la source du bonheur collectif et la croissance comme la condition du salut de l'humanité, à l'heure où l'hyperconsommation à marche forcée, le mirage du pouvoir d'achat et le désastre du chômage de masse font de l'employeur un sauveur et de l'entreprise qui gagne un paradis sur terre, même si elle gagne surtout en détruisant les autres et en les envoyant en enfer.
L'économie sociale et solidaire représente donc un moment très particulier où vient s'arrimer aux règles de l'activité économique dite publique et marchande un système complexe de valeurs mises en relation avec des statuts et des modes de gestion qui visent le partage et la solidarité. Les statuts des entreprises, avec les quatre grandes familles (coopératives, mutuelles, associations et fondations) définissent, comme on sait, l'économie sociale, alors que le fonctionnement démocratique et l'utilité, pour simplifier, seraient les piliers de l'économie solidaire. Dans l'ensemble à deux têtes, social et solidaire, qui en résulte se trouvent articulés de façon originale trois éléments : les valeurs qui commandent l'action, les objets sur lequel porte l'action et la liberté, ou l'autonomie par rapport à la loi du profit, au nom de laquelle l'action est conduite. Je voudrais maintenant questionner un instant ce discours du social et du solidaire.
Voyons d'abord les valeurs, pas toujours nommées ainsi dans les textes, mais servant de référence ultime à de nombreuses reprises et sous diverses appellations. Solidarité, égalité, équité, démocratie, durabilité, utilité sociale, etc. ne sont d'ailleurs pas toutes sur le même plan : certaines sont plutôt des vertus, des règles, des principes, mais je vous propose de les accepter comme valeurs dans la mesure où elles forment ensemble et par leur convergence dans une nouvelle économie, les éléments moraux de la construction d'un monde différent. Mais de quoi parle-t-on quand on dit les valeurs ? Car on le dit sans cesse : tous les jours nous entendons évoquer nos valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs du sport, les valeurs de tel ou tel corps de métier, les valeurs citoyennes, comme il y a des buffets citoyens et des défilés citoyens qui ressemblent beaucoup à ceux qui ne le sont pas. Il y a aussi les valeurs de la République, dont on parle tout le temps, il y a même aujourd'hui les valeurs de droite et les valeurs de gauche, en grande partie interchangeables car c'est une propriété des valeurs d'être hiérarchisées mais indissociables : on voit bien par exemple que ce qui est juste est en même temps d'une certaine façon vrai et beau, et inversement.
Mais parler des valeurs tout le temps, ce n'est pas la même chose que s'engager chaque jour dans leur réalisation, à la mesure des moyens dont on dispose, dans une démarche qui restera par définition inachevée et imparfaite, parce que toute valeur est par nature toujours à réaliser. En d'autres termes, les valeurs ne sont pas des choses, on ne peut pas partir avec ses valeurs sous son bras, ni les emprunter ou les prêter à son voisin ni les installer par décret là où elles n'étaient pas. Même leur réalisation momentanée n'en fait pas des objets disponibles et transférables. Autrement dit, les valeurs ne s'offrent jamais toutes faites.
Je prends volontairement un exemple hors du domaine social et je choisis pour changer un peu une valeur esthétique, le beau. Les musées ou les salles de concert sont pleins d'uvres où la beauté a été atteinte et incarnée et pourtant, après tant de tableaux sublimes qui ont été peints et exposés et après tant de su-blimes symphonies qui ont été composées et interprétées, en tant que valeur la beauté est toujours à inventer et à désirer. Tous les peintres et tous les composi-teurs la cherchent chaque jour dans les tourments de la création. Les valeurs sont encore transcendantes et sont encore inaccessibles même quand on a déjà pu ou cru les approcher. C'est la définition même de la valeur de ne pouvoir être con-tenue ou enfermée dans aucune des réalisations qu'elle a inspirées et c'est ce qui fait son idéalité (elle est par essence inaccessible) et en même temps sa précarité (par définition, quels que soient les succès remportés, elle ne se capture pas). Mais qu'on ait toujours besoin de la désirer et de la viser encore et encore, c'est ce qui fait sa force, et qu'elle ne puisse pas ne pas être autre que ce qu'elle est, c'est ce qui fait son universalité - ainsi la solidarité, le bénévolat et l'honnêteté sont des valeurs même pour les pires bandits. C'est dire que les valeurs de l'économie so-ciale et solidaire ne sont pas données par les modalités d'organisation ou par les labellisations des lois et règlements. Ceux-ci en définissent la recherche et en fixent les conditions mais ils n'en garantissent ni le désir ni la poursuite. Comme disait Mikel Dufrenne, "les biens sont [toujours] à faire, la liberté à conquérir, l'honneur à sauver, la vie à défendre". Autrement dit, on ne peut pas se conten-ter d'attendre les valeurs en les invoquant ou en les prenant fièrement pour de-vise. Il ajoutait qu'il faut, et cela peut valoir particulièrement pour la solidarité, "se méfier des valeurs qui tombent du ciel pour soutenir l'ordre établi".
Si le dispositif de l'économie sociale et solidaire ne peut donc pas être à lui seul un chemin assuré vers les valeurs dont il se recommande, du moins offre-t-il de puissants moyens pour le tracer, et il le fait notamment sur deux plans, dési-gnés dans les textes sous les noms d'utilité et de démocratie. Ils se profilent dans l'article 2 de la loi de 2014, dont les trois alinéas ont en commun de décliner une même visée, qu'on pourrait appeler l'identification de la démarche à son objet. L'utilité est définie comme le service offert aux publics en situation de fragilité, économique, sanitaire, sociale, médicale ou personnelle et, vous l'aurez remarqué, la fragilité concerne aussi bien les bénéficiaires que les agents de l'action d'aide, d'accompagnement ou de soutien - c'est la magnifique énumération du premier alinéa : "ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires". La fragilité est comme on sait l'état d'une subs-tance qui se brise lorsqu'on lui impose des contraintes ou des déformations trop brutales et il faut donc, surtout dans ce qui touche au domaine social, que l'intervention soit de même force que ce sur quoi ou en faveur de qui elle porte. Si on juge utile ce qui répare, renforce ou tisse du lien social, selon la métaphore de Pla-ton sur le tissage de la cité qui nous sert encore aujourd'hui, l'un des critères de l'utilité est l'homogénéité entre la modalité de l'inter-vention et l'objet sur lequel elle porte. Intervenir sur le fragile suppose de n'être pas trop fort, de même qu'on ne confie pas sa porcelaine à des éléphants, si bien intentionnés soient-ils.
Il en va de même, en un sens, de la lutte contre les exclusions et inégalités de tous ordres, au deuxième alinéa, et du développement durable dans ses diffé-rentes dimensions, au troisième alinéa de l'article 2 de la loi : sont utiles les actions menées au titre de ce qu'elles visent à réparer ou à instaurer. Par exemple, con-courir au développement durable, c'est d'abord et nécessairement se situer soi-même en dehors du système de surproduction et de mortelle concurrence qui est à l'origine du problème à traiter et de son aggravation continuelle. Créer du lien social, c'est d'abord et nécessairement conduire des projets collectifs et non des entreprises à caractère individuel. Plus largement, agir dans le domaine social, c'est d'abord et nécessairement se placer dans un système d'alliance et non dans des rivalités mortelles.
Ici se révèle l'unité du social et du solidaire qui est le fondement humaniste d'une économie alternative. Car la solidarité est une valeur singulière, dans la mesure où elle est par certains aspects le contraire d'une valeur morale comme la générosité. La générosité en effet, c'est d'agir en faveur de quelqu'un dont je ne partage pas les intérêts. Je suis généreux quand je fais du bien à d'autres sans que cela m'en fasse à moi. Ainsi, lorsque je donne quelques pièces à un SDF ou bien un pourboire à un employé méritant, je donne un secours ou une récompense mais je ne récolte moi-même aucun avantage, si ce n'est peut-être un peu de bonne conscience - mais chacun sait qu'en réalité, selon l'illustre formule, "c'est la mauvaise conscience qui est la bonne". Quoi qu'il en soit, la solidarité, c'est d'agir en faveur de quelqu'un dont je partage les intérêts ou la condition : en les défendant je défends aussi les miens - et vice-versa. Par rapport à la générosité qui est unilatérale, la solidarité est par essence une réciprocité. La solidarité, c'est par exemple lorsque je m'engage dans une grève avec les autres : si l'issue du conflit est positive, mon salaire augmentera comme le leur, ou ma situation s'améliorera comme la leur. La solidarité, c'est donc aussi, pour les mêmes rai-sons, quand je souscris une police d'assurance, quand je paye mes impôts ou quand je donne mon sang, autrement dit chaque fois que d'une manière ou d'une autre je défends ou secours ou protège les autres en même temps et au même titre que moi et moi en même temps et au même titre que les autres, au moins potentiellement. On voit donc que social et solidaire, d'une certaine façon, s'identifient, se superposent, se confondent et même se génèrent l'un l'autre : la solidarité est la vertu du social et le social est le cadre naturel de la solidarité, son univers de référence. En un sens, la solidarité n'est pas une valeur, elle n'est que l'expression du système de droits élémentaires et d'obligations minimales de toute société digne de ce nom - et on voit bien que ce dont nous partageons les intérêts et la condition, c'est, de loin en loin, l'humanité tout entière.
Mais nous entrons ici dans le troisième et dernier temps de notre réflexion, avec la question de la régulation de l'action en fonction des valeurs et de ses consé-quences en termes de direction des établissements. Il faut noter au passage - et je reprends les termes précis de la loi - que ce n'est pas un établissement en tant que tel qui "adhère" au "mode d'entreprendre" et de développement économique qu'on appelle économie sociale et solidaire, mais la structure, souvent l'association, qui en est le support et le cadre de gestion. L'établissement, lui, est un pôle d'aide, d'accueil, d'accompagnement, de soin, etc. c'est-à-dire une structure d'interventions sur la réalité humaine, c'est-à-dire d'actions à conduire au nom de la commune huma-nité des acteurs et des destinataires. Sur ce point, je vous suggère de vous livrer à un petit exercice dont la difficulté me semble éclairante et qui serait de tenter de voir de façon précise comment l'établissement dont vous avez, avez eu ou souhaite-riez avoir ou partager la charge s'inscrit dans les activités dont la liste figure au second paragraphe de l'article 1 de la loi. Comment vous situeriez-vous ? Je relis l'énumération des composantes de l'économie sociale et solidaire : diriez-vous que vous avez (ou que votre établissement ou votre équipe a), je cite, "une activité de production, de transformation, de distribution, d'échange, de consommation de biens ou de services" ? Choisissez et au besoin complétez, nuancez, combinez. Les difficultés que vous rencontrerez pour formuler une réponse qui vous semble pleinement satisfaisante traduiront la distance qui sépare toujours les fins écono-miques et les fins sociales.
Comme on pouvait s'y attendre, le premier problème de la gouvernance dans l'économie sociale et solidaire n'est donc pas social et solidaire, c'est économie. Certes, d'être sociale et solidaire humanise l'économie, mais d'être soumise à un modèle économique risque toujours, bien qu'à des degrés divers, de déshumaniser l'action sociale. Une fois définies les règles et mises en places des normes, ce qu'ont fait la loi et la règlementation, il reste à faire fonctionner conformément aux valeurs qu'elle a avancées la "nouvelle voie économique" du "capitalisme non lucratif". Un type d'entreprise nouveau, issu d'un métissage entre la solidarité et la rentabilité, capable de prendre en matière sociale la place du secteur public, implique évidemment un pilotage particulier fait au nom de l'éthique. Il ne va pas suffire de regarder chaque soir sur le tableau de bord le cadran de la rentabilité, comme on ferait dans une banque, mais aussi le cadran de la solidarité et des va-leurs. Car tout idéal qu'on perd de vue, ne fût-ce qu'un instant, risque de se dé-grader en procédure et la procédure à son tour en un système figé. L'entreprise qu'on a voulue nouvelle ressemblera alors très vite aux anciennes et elle laissera paraître au grand jour la contradiction éclatante qu'elle porte en elle entre le profit et le désintéressement. Sur cette possible dégradation de l'idéal dans le secteur so-cial, je vous renvoie par exemple aux analyses substantielles de Jean-Louis Laville sur ce qu'il appelle "l'alignement progressif des règles sur les autres entreprises", sur tout ce qui malgré le "garde-fou" donné par la loi contre les "dérives du néocapitalisme" peut malgré tout céder à la pression du fonctionnement concur-rentiel. Il n'est pas facile de s'opposer à la fois à des entreprises capitalistes et à des structures publiques, surtout lorsqu'on ne s'en différencie pas complète-ment. En matière de gouvernance, la problématique concerne donc deux as-pects essentiels que je vais simplement évoquer : la subordination effective des moyens aux fins et la poursuite, prescrite par les textes, d'un idéal démocratique.
La toute première fonction de la gouvernance est d'empêcher les pratiques ges-tionnaires de prendre ou de reprendre le dessus et de faire éclater la fragile convergence qui est née de la rencontre de l'économie et des valeurs. Elle est de conserver dans l'action quotidienne un bien suprême dont l'éthique est le gardien : la priorité des fins sur les moyens, des idéaux sur les contraintes et des valeurs sur les normes. C'est là le centre et le cur même de la fonction de direction, que la probléma-tique de l'économie sociale et solidaire ne modifie pas mais porte à son plus haut degré. Diriger, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, s'opposer à l'inertie, surtout quand on se réfère à des valeurs. Il ne faut donc pas accepter l'économie sociale et solidaire comme une notion inerte, un discours dans l'air du temps ou un simple appareil règlementaire jugé plus ou moins innovant : elle n'a vraiment de sens qu'à la condition, précisément, de ne pas être seulement un dispositif ou un système clos dont il n'y aurait plus qu'à décliner presque mécaniquement les prescriptions. Mais sur la gouvernance, je vous renvoie aussi, et je pense notamment à ceux avec qui j'ai eu le plaisir de faire cette lecture en commun, au texte sublime du livre VI de la République, où Platon analyse le commandement à travers l'exemple d'un capitaine de navire et de son équipage - et on sait que gouver-nance est de la même famille que gouvernail. Je n'ai pas le temps de reprendre en détail l'analyse de cette métaphore de l'autorité mais souvenons-nous de ce capi-taine devant ses marins dont chacun prétend que c'est à lui qu'il revient de pilo-ter et qui tous ensemble réclament qu'on leur confie la barre et complotent pour s'emparer du navire et de sa cargaison, se souciant surtout de festoyer, sans se rendre compte que le commandant d'un navire doit, je cite, "tenir compte du temps, du ciel, des astres, des vents et de tous les éléments qui importent dans l'art de naviguer". Ce texte célèbre révèle en réalité une image inversée de l'autorité et il décrit une gouvernance mise en échec. Il ne parle pas d'un véritable navire et de son équipage : il est, on l'apprend en lisant la suite, une représentation par Platon de la gouvernance désordonnée dont souffre une cité démocratique.
Or, la gouvernance démocratique est justement celle qui est prescrite à l'économie sociale et solidaire - notamment par l'article 1 de la loi, avec un alinéa qui concerne au plus haut point la fonction de direction, puisqu'il énonce les conditions de son exercice. La gouvernance démocratique repose, dit ce texte, "sur des statuts prévoyant l'information et la participation" et sur l'absence de lien entre l'apport financier et le poids dans la prise de décision afin de garantir une place équitable à chacun dans la délibération. Mais n'est pas démocratique tout pilotage qui fait place à la "palabre", comme sur le bateau ivre décrit par Platon. De quelle démo-cratie s'agit-il, au juste, lorsqu'elle peut être en quelque sorte injectée, introduite une fois pour toutes à travers des statuts ? En fait, démocratie est un concept d'origine politique et il en existe deux acceptions possibles : l'une qui en fait véri-tablement un idéal, l'autre qui y voit simplement le mode de désignation de ceux qui vont gérer les affaires, originellement des affaires de la cité, la démocratie que nous connaissons, où nous votons tout le temps sans jamais peser vraiment sur l'avenir de la cité. Il y a en fait plusieurs niveaux ou degrés de la démocratie, de-puis le plus bas, celui de cette espèce de citoyenneté en fin de droits de nos régimes représentatifs modernes, où la démocratie se réduit au fait que le peuple est ap-pelé de loin en loin à désigner ses maîtres, jusqu'au niveau le plus élevé, l'idéal démocratique originel, la souveraineté populaire qu'exprimait la mention célèbre qui, en Grèce ancienne, figurait sur les lois et les décrets une fois qu'ils avaient été votés. Je ne résiste pas au plaisir de la citer : elle disait magnifiquement, en haut de chaque texte adopté : "il a plu au peuple que".
Dès qu'on se recommande de la démocratie, dans quelque domaine que ce soit, la question est donc de savoir de quelle façon et à quel moment le "peuple" peut dire ce qui lui plaît, c'est-à-dire ce qu'il décide. La mention dans le texte de la loi de juillet 2014 de l'information et de la participation, qui semblent définir la gouver-nance démocratique, donne à penser que l'idéal démocratique qui est visé l'est d'une manière surtout formelle. Avec l'information et la participation, il se pourrait qu'on recherche surtout un consensus, favorable à la production. Nous sommes à l'heure du consensus, en effet : il faut à présent résoudre tous les problèmes par un art de la synthèse douce, il faut dépasser les différends grâce aux vertus du dialogue. Surtout pas de vagues : par les temps qui courent, le désaccord a mauvaise presse et si d'aventure il en survient qu'on n'a pas pu empêcher, il est mis sur le compte d'un échec de la communication. C'est probablement qu'on a mal expliqué, il faut faire davantage de pédagogie, selon la formule consacrée des gouvernements en difficulté ou pris la main dans le sac. Cette obsession du consensus est évidem-ment liée aux avancées de l'univers libéral. Cependant le consensus est un accord qui n'a en général pour tout fondement que l'absence de refus. C'est une forme de positivité passive qui est d'ailleurs devenue la norme de notre monde : le progrès, le bonheur, l'idéal, c'est désormais l'implicite, ce qui va de soi, ce qui va sans dire - tout le contraire de l'affrontement contradictoire, du choc des idées et du débat qui sont l'origine et la substance même de la démocratie. La réduction de la démo-cratie à l'information et à la participation est donc un énoncé qui peut paraître insuf-fisant et même peut-être inquiétant, car il n'y a vraiment de démocratie que s'il est possible à un moment donné de dire non.
C'est pourquoi le second point que j'aurais voulu dégager en matière de gou-vernance, et qui confirme le premier, est l'accroissement de la fonction éthique du directeur d'établissement. Je parle d'éthique par opposition à déontologie, et donc par opposition avec les principes définis d'avance et même avec ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Je m'explique, en reprenant pour finir un petit texte que je cite souvent, extrait d'un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une banque, et il s'agit en l'occurrence d'une caisse d'épargne de Belgique : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des diri-geants, des employés et des bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, avec bonne foi et dans l'intérêt de la caisse". Ce texte permet de faire en quelques mots un magnifique voyage. Avec le début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans l'idéal moral. Avec l'évocation de la bonne foi, on aperçoit encore un peu, en passant rapidement, le champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a complètement changé de monde, on est entré dans la pure déontologie finan-cière, dans la logique sans pitié du profit.
On voit que la rencontre entre l'économie et les valeurs a de grandes consé-quences, et surtout en matière de gouvernance puisqu'elle crée une nouvelle obli-gation éthique, au sens où l'éthique est une attitude de questionnement et ne se réduit pas à un système de prescriptions décidées d'avance, au sens où l'éthique est la possibilité de mise en cause d'un système établi et son interpellation au nom de valeurs jugées plus hautes. Deux préceptes de Bruno Lamborghini expriment cette ambiguïté des rapports entre l'économie et de l'éthique. Le premier dit : "le défi pour l'entreprise est de veiller à servir d'exemple". Le second dit : "une bonne conduite est la condition d'une expansion continue". Il y a ainsi un juste milieu à rechercher entre une morale du tiroir-caisse, forcément ambigüe et incertaine, et au contraire des tiroirs-caisses sans morale, instruments de la cupidité et du cynisme de l'économie ordinaire. Mais ce juste milieu est à la fois désirable et introuvable, car dans l'entreprise ou non, dans le secteur social ou non, la morale, comme disait Sartre, a pour caractéristique d'être "à la fois impossible et nécessaire".
Dire non. Philosophie du refus. Conférence à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Amis de l'Université de la Réunion
Filiation et rupture : philosophie de la transmission. Conférence à Saint-Denis, Ile de la Réunion, septembre 2015.
Concepts et problématiques de l'institution. Dialectique du modèle et de l'antimodèle. Communication au Colloque "Penser l'institution autrement...", IRTS de la Réunion (Journée d'étude ADC-IRTS du 11 décembre 2015). Transcription.
Je suis très heureux d'être de nouveau parmi vous, après les belles séances auxquelles l'IRTS et l'ADC m'ont permis de prendre part ces dernières années, et je vous remercie d'avoir fait de moi une fois encore votre philosophe de service pour un nouveau chantier. Je pense ici au philosophe de service comme fournisseur de concepts, qui s'applique à une lecture du monde pour le compte de la cité et qui tente - et, s'agissant de la philosophie, tente de la manière la plus radicale qui soit - de questionner le réel.
Et c'est sans doute ce que vous me demandez de faire à propos de la désinstitutionalisation que vous rencontrez et qui en tant que personnels de direction vous concerne au premier chef - c'est bien le cas de le dire. Néanmoins, je ne reprendrai pas ici cette problématique en tant que telle, ni l'ensemble du débat auquel depuis un certain temps elle donne lieu. D'abord, il existe là-dessus une littérature abondante : les analyses, les arguments, les documents et les études ne manquent pas et pour l'essentiel vous les connaissez sans doute, au moins dans les grandes lignes. D'autre part, plusieurs commu-nications et moments d'échange vont porter, au cours de cette jour-née, sur les aspects théoriques et pratiques de cette question. Des expériences de terrain seront présentées cet après-midi et mon propre passé québécois me fait penser qu'elles apporteront un utile éclairage. Enfin, l'objet de notre réflexion, l'institution, c'est vous qui en détenez une connaissance fine et qui en avez l'expérience la plus immédiate, puisque vous y investissez jour après jour vos compétences. Une fois de plus, le philosophe de service va donc être par contraste celui qui ne sait pas. Après tout, c'est son métier, car la philosophie est une traversée dont le port d'attache est l'ignorance - c'est ce qui en fait le risque et c'est même ce qui en fait tout le prix. Aussi bien, mon rôle est seulement de proposer ici quelques éléments pour penser l'institution dans un contexte particulier et à un moment précis de son histoire : quelques catégories donc et aussi, un peu comme un coureur de fond s'exerce en faisant quelques "départs", un certain nombre d'angles d'attaque, qui seront peut-être utiles à la réflexion chemin faisant - aujourd'hui ou plus tard. En somme, je ferai, comme nous en avons pris l'habitude au fil des ans, une sorte d'avance sur concept.
"Penser l'institution autrement" : vous aurez sans doute remarqué en consultant la notice de présentation de cette journée que ce titre apparaît sur un panneau orienté vers le ciel et se détachant sur fond céleste - est-ce le ciel des idées je ne sais pas, mais en tout cas un ciel serein parcouru d'innocents nuages blancs qui sont manifestement sans gravité sur le plan météorologique. Le montage donne l'impression d'un mouvement d'ascension plein d'aisance mais les majuscules d'imprimerie épaisses, bien droites et verticales sur le support penché semblent suggérer que l'institution, bien qu'elle " décolle" selon une trajectoire digne d'un engin volant, reste elle-même, qu'elle résiste, qu'elle est une structure pérenne, inaltérable, au fond, malgré le mouvement qui l'emporte. Ce que confirme le contraste entre le bois ancien et rustique du panneau indicateur et la modernité de son énoncé. Rien ne pouvait, mieux que cette image figurer la problématique que nous allons affronter et dont la notice donne page 2, sous la rubrique le contexte, un aperçu à la fois évocateur et précis: il s'agit, nous dit-on, d'un "mouvement considéré comme irréversible", ce qui veut dire déjà engagé et en même temps encore inachevé, lancé sans retour mais encore à construire. Je vous propose de commencer par prendre en compte ce contexte en considérant la désinstitutionalisation comme un tournant dans l'histoire de l'institution, comme un évènement.
Or, un évènement, ce n'est pas seulement comme on le croit souvent une chose qui arrive, mais beaucoup plus, sans quoi il y aurait des évènements tout le temps, il n'y aurait plus que des évènements incessants, comme sur les chaînes info, et donc à la limite presque plus d'évènements du tout. En réalité un évènement véritable, c'est une chose qui, du fait même qu'elle arrive, fait apparaître quelque chose qui était jusque-là invisible, ou impossible, ou impensable. Car "un évènement n'est pas par lui-même la création d'une réalité : il est la création d'une possibilité", il nous "propose quelque chose" et "tout va dépendre de la manière dont cette possibilité proposée par l'évènement" est accueillie puis "incorporée et déployée dans le monde". Cela vaut pour tout ordre de réalité mais je prends un exemple simple, un évènement de la vie, que j'emprunte à l'expérience de la rencontre. Un jour, vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez l'impression, à la fois indéfinie et forte, d'une possibilité radicalement neuve, de quelque chose que rien ne laissait prévoir. Rien ne pouvait arriver sans cette rencontre, mais en elle-même elle n'est rien, elle n'ouvre qu'une possibilité, et tout va dépendre de ce que vous allez en faire, de ce que vous allez construire sur ce possible à l'état pur. Ce qui fait de cette rencontre un évènement, ce n'est pas la mise en présence des personnes : si c'était le cas, comme notre quotidien est rempli de mises en présence continuelles, nos existences finiraient par donner le vertige, elles seraient comme des "chaînes info" intimes. En fait, la rencontre est un évènement non pas en elle-même mais par l'ouverture qu'elle porte en elle, par ce champ qu'elle offre tout d'un coup à la liberté, à l'imagination et à la construction d'un monde neuf.
C'est en ce sens que nous pouvons considérer un instant la désinstitutionalisation non pas seulement comme l'effet d'une politique et d'une série de mesures, ce qu'elle est en effet - je vous renvoie sur ce point aux nombreux textes, législatifs, réglementaires, etc. - mais aussi comme un évènement où se trouve bousculé un équilibre antérieur et annoncé un équilibre futur qui reste à trouver. L'évènement ici est que l'institution, longtemps modèle dominant dans une série d'actions d'aide, d'accueil, de soin, d'accompagnement, etc., devient sous nos yeux, par un phénomène de retournement, un anti-modèle. La naissance, entre ces deux pôles opposés, d'une tension créatrice et en même temps d'un espace de liberté est ce que j'ai appelé la dialectique du modèle et de l'anti-modèle, non pas pour donner à mon propos une tonalité platonicienne ou hégélienne, mais pour dire qu'il y a dans tout système institutionnel une sorte de moteur interne qui le fait évoluer par négation et contradiction ou au contraire par réconciliation et par synthèse. Pour autant, anti-modèle n'est pas, malgré les apparences, une notion négative, pas plus que ne le sont antichambre, antidote ou anticyclone. Anti-modèle indique un déplacement du modèle sur un axe continu qui relie deux extrêmes. Autrement dit l'institution et son contraire la non-institution, si on peut dire, sont deux réponses opposées mais apparentées et complé-mentaires à une même question et elles courent sur le même axe. Prenons cette fois-ci pour changer un exemple dans l'art, avec la Joconde, le portrait de Mona Lisa, ce tableau du Louvre que chacun connaît bien ou croit bien connaître. Les deux significations du tableau courent aussi d'un extrême à l'autre sur le même axe. Au premier regard, la Joconde représente évidemment le sourire du modèle, mais si on garde plus longuement le regard sur elle, si on la fixe et qu'elle semble presque sourire plus ou moins selon le moment, au bout d'un certain temps tout s'inverse : elle cesse d'être le sourire du modèle et elle devient le modèle du sourire. C'est ce passage subreptice d'un statut à l'autre qui explique sans doute que l'oeuvre de Léonard de Vinci soit à ce point devenue légendaire.
Quoi qu'il en soit, c'est évidemment par le concept d'institution qu'il faudrait commencer l'avance sur concept que je vous ai annoncée, car Socrate nous a enseigné qu'avant de dire quelque chose à propos d'une chose, il faut d'abord savoir ce qu'est cette chose. Par le mot institution nous désignons, selon un usage assez particulier, un établissement, c'est-à-dire une structure, un mécanisme doté de modalités d'action adaptées à des fins particulières, un point de concentration de ressources et de compétences face à des besoins déterminés et en faveur de publics précis. Nous pourrions nous croire à mille lieues des institutions à dimension politique sur lesquelles s'interrogent les philosophes du droit naturel ou les théoriciens de l'État. Pourtant, une parenté cachée demeure entre ces acceptions diverses du mot institution, entre lesquelles nous pouvons aller et venir librement, parce qu'en réalité il y a une institution dans tout système normatif et un système normatif dans toute institution. Instituer, c'est non seulement organiser, rationaliser un faire et disposer des moyens en vue d'une fin, mais c'est établir des normes d'action en fonction d'un système de valeurs, c'est construire un pouvoir durable, c'est capitaliser l'expérience en lui donnant un siège et un terrain d'emprise. Je n'entre-prendrai pas ici un éloge de l'institution, même si aller à contre-courant de la mode est toujours tentant, mais il faut avoir à l'esprit que l'institution est protectrice par essence et qu'elle ne se protège pas seulement elle-même, comme on lui en fait souvent reproche, mais qu'elle est un rempart contre l'instabilité du monde et un emblème de la persévérance des hommes.
Au fond, la question est toujours de savoir ce que l'institution institue au juste, c'est-à-dire ce qui dans les institutions comme celles dont vous avez la charge "dépasse", si on peut dire, par rapport aux objectifs annoncés, ce qu'elles ont de plus qu'un simple service. De la même manière, par exemple, que l'école est une institution parce qu'elle n'assure pas seulement une instruction, un transfert des connaissances, mais qu'elle institue un ordre, qu'elle fonde en même temps l'autorité de la connaissance et transforme les enfants en élèves et les individus en citoyens - c'est pourquoi on parle d'éducation et pas seulement d'instruction : les maîtres d'école ont été appelés instituteurs parce que la tâche qu'ils ont à accomplir, instituer, est à l'entrecroisement d'une action, l'instruction, et des valeurs et principes qui fondent cette action et lui donnent son sens. Il est vrai que la distinction entre enfant et élève s'atténue à présent sous les coups de boutoir de la modernité, qui font que l'école devient de moins en moins instituante : dans le monde hyper-libéral, les enfants seront priés toujours davantage de se construire eux-mêmes et l'éducation relèvera de plus en plus des stratégies individuelles, l'existence de chacun étant conçue au fond comme une entreprise, vouée à la fameuse concurrence "libre et non faussée". Déjà les maîtres ne s'appellent plus instituteurs et même si on évoque encore pieusement, de temps à autre, la sanctuarisation de l'école, sa suppression et son remplacement par une solution plus moderne comme le maintien des enfants dans les familles avec accès internet n'est peut-être plus aussi éloigné qu'on le croit. Ce sera suffisant pour assurer la fonction actuelle de l'école, celle que Jean-Claude Michéa a appelée, dans un livre qui porte ce nom, l'enseignement de l'ignorance mais ce qui manquera alors et deviendra objet de nostalgie, ce sera justement ce qui est lié à la dimension proprement institutionnelle de l'école, celle qui fait son caractère humaniste et qui s'exprime dans les principes qu'elle proclame, comme la devise inscrite sur le seuil : "liberté, égalité, fraternité".
Je fais ce détour par l'école pour souligner qu'une institution se situe toujours à deux niveaux de réalité, qui sont reliés l'un à l'autre mais distincts : d'un côté la dimension active, l'invention, le geste créateur (quand je dis j'institue) et d'un autre côté le résidu de ce geste, la trace de ce qu'il a accompli, le résultat bientôt passif de la création active, tout ce qui sert de base à d'autres actions dans une répétition qui peut forcément devenir mécanique. L'institution est marquée par la même dualité et la même contradiction que l'idée de création, que d'ailleurs elle recoupe. On dit comme vous savez la Création, avec une majus-cule, pour désigner le travail divin qui a eu lieu en six jours selon l'Écriture (le septième étant celui du repos) mais on appelle aussi création ce qui existe, c'est-à-dire non plus le geste qui créée mais la chose qui a été créée, l'univers. C'est dans le passage d'une dimension à l'autre que réside le principe de la dégradation de toute institution, celui qu'on retrouve au coeur de la critique philosophique des institutions, qui est déjà ancienne mais qui est devenue insistante dans la pensée de la modernité, chez Sartre, chez Ivan Illich, chez Michel Foucault - je vais y revenir.
Après ces deux premiers concepts, évènement et institution, je vous propose donc le couple central de toute notre problématique, celui que forment, liés indissolublement mais en opposition radicale, la fin et le moyen. La prédominance des moyens sur les fins dénature l'institution, qui se détourne alors de sa fonction et devient à elle-même sa propre fin. En sens inverse, la prédominance excessive des fins sur les moyens rend l'institution stérile et la priver d'efficacité. Ces deux processus opposés ont paradoxalement pour conséquence un même enfermement sur soi, une même tendance à l'inertie. L'analyse sartrienne de l'institution se fonde sur cette notion d'inertie, qui à l'origine a une portée bien plus large. Ce que Sartre appelle pratico-inerte dans la Critique de la raison dialectique caractérise le rapport de l'homme à ses propres créations : l'homme doit affronter ces choses inertes mais puissantes que sont les machines qu'il a inventées - mais ce sont aussi bien les institutions. L'homme devient alors "le produit de son produit", son activité devient passive et c'est la passivité des choses créées par lui qui, dans une espèce de retournement radical, devient active. Peut-être l'éprouvez-vous quelquefois lorsque vous affrontez les caprices de votre téléphone portable ou bien l'obstination de votre ordinateur. Vous constatez alors que l'action humaine peut se trouver mise contre son gré au service d'une finalité qui est par définition inhumaine. Je vous laisse méditer sur la situation où une institution remplacerait l'homme, imposant son inertie, une institution où la force instituée éliminerait entièrement la force instituante. "Une exigence pratico-inerte traite les hommes comme des choses", dit Sartre à ce sujet, dans un autre texte. Si l'institution est à la fois action et chose, praxis et inertie, tout déséquilibre entre ces deux axes peut faire d'elle un remède pire que le mal, et la confiscation de la fin par le moyen, qui fait de l'institution une totalité figée, est le principe de cette dégradation.
Une des critiques les plus anciennes et les plus classiques des institutions à caractère sociales a porté sur les cas extrêmes de ce phénomène de confiscation, liés historiquement aux modalités de traitement des problèmes médicaux et sociaux en usage aux époques concernées. Les analyses décisives de Michel Foucault ont bien montré comment deux modèles ont commandé, directement ou indirectement, tous les grands dispositifs médicaux et sociaux à partir du Moyen-Âge : d'une part l'exclusion du lépreux, prototype de ségrégation, de rejet, d'exil et de clôture, d'autre part le quadrillage normalisateur de la peste, technique de contrôle née des épidémies. Ces deux modèles fusionneront ensuite, au cours du XIXème siècle, dans des systèmes mixtes intégration-ségrégation, avec ce qu'on a appelé l'intégration disciplinaire qui va régir pour longtemps les asiles, les prisons, les hôpitaux, les maisons de correction et autres établis-sements - je vous renvoie sur tous ces points au cours de Michel Foucault au Collège de France en 1974-1975 et à l'étude qu'il a consacrée au "grand renfermement" des mendiants, infirmes, pros-tituées et vagabonds dans l'Histoire de la folie à l'âge classique. Nous avons mieux compris depuis ces travaux de Foucault qu'il existe deux erreurs également fatales, que nous avons souvent du mal à éviter tout à fait : traiter le lépreux comme un pestiféré et traiter le pestiféré comme un lépreux - c'est bien entendu une métaphore. Mais Foucault a mis en évidence aussi que toute société suppose une structure d'exclusive, un ensemble de gestes, de pratiques et de discours par lesquels elle repousse à ses marges tous ceux, malades, fous, déviants, handicapés, isolés, fragiles, qu'elle classe autres. Toute société s'institue elle-même non pas malgré mais par ces exclusions. En d'autres termes, il n'y a pas de société sans une partition fondatrice entre le normal et l'anormal ou entre l'identique et le différent. Notons au passage que l'intégration repose sur le principe exactement inverse, à savoir qu'il n'y a pas d'identité sans différence. Freud, entre autres, a montré que l'idée d'une normalité absolue est un leurre, chaque individu ayant sa vulnérabilité, son défaut fondamental, son manque à être. Aussi bien, il n'y a pas de handicap, de maladie ou de désavantage en soi, ils n'existent que par rapport à un environnement social et culturel et rapportés à des attentes normatives. Et c'est ici que devrait prendre place, si nous en avions le temps, l'examen critique de ce qu'on appelle le milieu ordinaire par opposition au milieu spécialisé dont parle la notice de présentation. Le milieu ordinaire, dont la désinstitutionalisation fait au moins en partie son idéal, est celui-là même qui rejette, qui exclut, qui sépare, qui frappe d'inégalité, d'inaptitude, de violence, d'injustice, celui qui en générant le dommage ou en y contribuant appelle l'action réparatrice de l'institution. L'invoca-tion du milieu ordinaire est l'illustration de la remédiation du mal par le mal dans une sorte d'espérance homéopathique où la fin et le moyen se confondent.
Mais je reviens à la critique des institutions pour rappeler les analyses radicales d'Ervin Goffman qui ont porté sur les asiles américains du milieu du XXème siècle et qui sont des cas limite d'institutions totales - institution totale est d'ailleurs le concept mis au point par Goffman lui-même pour désigner le suprême degré de coupure par rapport au monde extérieur, de summum du fonctionnement bureaucratique et de destruction des identités dans les institutions. À coup sûr, on peut trouver là une des sources majeures du retournement à partir duquel l'institution deviendra un anti-modèle. Un anti-modèle qui aurait dû s'effacer à mesure que le modèle lui-même reculait et que les asiles ne ressemblaient plus à ceux que Goffman avait justement dénoncés, mais ce n'est pas ce qui est arrivé : au contraire, le placement en institution était devenu entre-temps l'emblème de la manière dont un moyen se retourne contre sa fin en passant au-delà d'un seuil qui est celui de la contre-productivité. Il est significatif, à cet égard, que la recommandation du Conseil des Ministres européens de février 2010 parle dans son paragraphe 15 a) de "prévention du placement en institution" comme on parlerait de combattre une maladie, une propension pathologique et perverse des décideurs du secteur social. Cette idée d'une contre-productivité de l'institution a été explorée bien avant et installée par les travaux d'Ivan Illich - Illich si oublié et si actuel à la fois. À partir du moment où la société industrielle institu-tionnalise un moyen (qu'il soit outil, mécanisme, organisation, etc.), ce moyen se renforce jusqu'à dysfonctionner et pervertir les objectifs initiaux, voire les contredire. Autrement dit, le moyen devient obstacle, ou selon la formule de La convivialité, "l'outil, de serviteur, devient despote". Ainsi, l'automobile nuit au transport - c'est ce que nous pensons tous, au fond, quand nous sommes pris dans un bouchon - l'école compromet l'éducation et, pour reprendre les premiers mots restés célèbres d'un autre ouvrage d'Illich, "l'entreprise médicale menace la santé". Illich élargit la problématique de l'institution à l'échelle de la société tout entière et il annonce ses enjeux, qui sont considérables : toute activité outillée (donc toute institution) finit à un moment donné par créer un monopole et par prendre tant d'impor-tance qu'elle se retourne contre sa fin et "menace de destruction le corps social tout entier" - je cite l'ouvrage majeur qu'est La convivialité, où s'applique l'adage latin Corruptio optimi quae pessima, la corruption du meilleur devient le pire, ce qui veut dire que l'institution la plus per-formante a vocation à être aussi la plus nocive. Ce mécanisme avait été étudié pour l'école dans Une société sans école, où les systèmes scolaires étaient tenus pour carrément polluants. Les enfants, disait Illich, n'apprennent pas de l'école à parler, à jouer, à aimer ou à se sociabiliser, et leurs capacités d'apprendre seraient moins bridées si c'est du monde et des autres qu'ils s'instruisaient. Il faut donc rompre, je cite encore, "les chaines de l'habitude, refuser la soumission, indiquer d'autres voies", car "l'école s'approprie l'argent, les hommes et les bonnes volontés disponibles et jalouse de son monopole s'efforce d'interdire aux autres d'assumer leurs tâches éducatives". Je passe sur les sophismes d'Illich, par exemple lorsqu'il s'appuie, pour nier l'utilité du système scolaire, sur le fait qu'on peut apprendre comme lui l'espagnol en fréquentant des quartiers porto-ricains, mais on voit aussitôt qu'on ne sait pas dans quel quartier apprendre les mathématiques.
Ce qui est mis en cause en tout cas, c'est la transformation de l'éducation en un produit de service, et c'est justement ce qui nous intéresse, car nous sentons tout l'intérêt d'une transposition de ces analyses aux institutions sociales et médico-sociales. Ivan Illich montre bien, d'ailleurs, que la dérive qu'il décrit pour l'école concerne également, je le cite, "la santé [...], la liberté individuelle et le bien-être social". Faute de temps, je ne peux que vous renvoyer à ce qu'il appelle "l'analyse spectrale des institutions". Dans le chapitre passionnant qui porte ce titre, il distingue d'une part les institutions qu'il appelle "manipulatrices", qui présentent à ceux qu'elles accueillent une "image destructrice d'eux-mêmes", et d'autre part les institutions "ouvertes et non contraignantes", avec, entre les deux, toutes les nuances d'un arc en ciel. Il faut donc toujours se demander dans quelle mesure une institution n'aboutit pas, sur le modèle de la médecine et de la santé dans Némésis médicale, à une expropriation par rapport à ce qu'elle a pour vocation de produire. Ivan Illich disait qu'il avait voulu proposer "une méthodologie permettant de détecter les moyens qui se sont changés en fin" - et nous avons grand besoin d'une telle méthodologie - mais il a défini aussi, avec le concept de convivialité, le principe positif de toute désinstitutionalisation. "J'entends par convivialité l'inverse de la productivité industrielle [...]", dit-il. La "relation conviviale, toujours neuve", est celle qui assure en permanence "la création de la vie sociale". Elle est "l'inverse de la logique de l'institution", car l'institution "se conjugue en termes d'avoir et la convivialité en termes d'être" - remarquons bien cet énoncé à résonance ontologique. Il souligne que la convivialité désigne un accès immédiat au réseau social de l'existence, une intégration absolue qui est sous-jacente aussi à l'idée de désinstitutionalisation. La société conviviale est "une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créative", c'est-à-dire qui institue sans institution : elle seule, disait prophétiquement Ivan Illich, empêche la "transformation de la planète en une vaste zone de services".
La convivialité - ou ce qui en un sens revient au même la désinstitu-tionalisation - est évidemment une utopie, il n'y pas d'illusion à avoir sur ce point. Cependant les analyses de Michel Foucault, sur lesquel-les j'arrêterai ce survol des critiques philosophiques de l'institution, nous disent au fond que toute institution également est une utopie. Dans une belle conférence qui a pour titre "Les utopies réelles ou Lieux et autres lieux", Foucault expliquait ceci : "on vit, on meurt et on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveaux, des creux, des bosses, des régions ouvertes, des régions fermées". Mais je vous laisse le soin de lire vous-même ce texte trop peu lu. Vous vous sentirez sûrement concerné en y trouvant plus loin ceci : "parmi ces lieux [...] il y en a qui sont absolument différents, des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés à les effacer, à les compenser, à les neutraliser, à les purifier. Ce sont des contre-espaces, des utopies réalisées [ ], des utopies situées, des lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les asiles, les maisons closes, les prisons, les Club Med et bien d'autres". Naturellement nous ajouterons à cette liste les institutions. Les institutions sont des hétérotopies, c'est-à-dire, dans le lexique foucaldien, des localisations physiques de l'utopie, des lieux qui à l'intérieur d'une société obéissent à leurs principes propres, qui peuvent s'ouvrir et se fermer, s'isoler ou se rendre accessibles, des "espaces d'illusion" et des "espaces de perfection" à la fois, des "contre-emplacements" privilégiés dont aucune société ne peut se priver, comme le montre toute l'histoire des hommes. Hannah Arendt disait en ce sens que pour entrer dans le monde, il faut d'abord être protégé de lui. Dans La crise de la culture, elle montre comment un "nouveau venu" peut être "détruit ou dévasté" par le monde, ce qui justifie par avance qu'un dispositif ad hoc soit institué.
Ces analyses soulignent que pour parler des institutions, il faut en appeler à toute la chaîne conceptuelle qui se rattache à l'idée d'exis-tence. Nous avons déjà croisé, tout à l'heure, cette référence à l'être en parlant de l'école : aller à l'école, comme on dit, c'est apprendre à lire, écrire et compter mais c'est aussi, dans une école digne de ce nom, apprendre à être - même si cette dimension n'a pas beaucoup de place dans les classements technocratiques et néolibéraux de type PISA que publie l'OCDE. L'école a pourtant deux fonctions, l'une technique (enseigner, procurer des savoirs), l'autre existentielle (faire devenir). De la même façon, les établissements de soin, par exemple les hôpitaux, mais pas seulement, ont une double vocation : soigner quelque chose (la maladie, le corps), ce qui relève d'un pouvoir scientifique et technique, et d'autre part soigner quelqu'un (le malade), ce qui suppose une prise en compte d'autrui, une sollicitude, au sens originel de souci de l'autre. Nous retrouvons là les deux fondamentaux légués par la pensée grecque, le soigner proprement dit (thérapeia) et le prendre soin (épiméleia), c'est-à-dire le fait de s'occuper de, cur de l'action sociale, allant d'inciter à guider et à permettre de, d'apporter une aide ou un accompagnement jusqu'à accomplir avec l'autre les actions de la vie. Mais la partie spécialisée de l'accueil et du soin (la thérapeia) suppose toujours une mise entre parenthèses au moins partielle de l'existence ordinaire. Ainsi, les fonctions de lieu de vie et de lieu de soins ne sont jamais totalement compatibles ni superpo-sables et le thème récurrent de la déshumanisation des structures spécialisées trouve son origine dans cette contradiction essentielle. Ces observations sont évidemment transposables à tous les types d'institutions.
La question qui se pose maintenant est donc celle-ci : qu'est-ce qui dans les institutions au sens où nous en parlons ce matin correspond à la visée du savoir dans l'école et à la fonction de soin de l'hôpital ? Que peuvent bien avoir en commun les différentes catégories d'établis-sements, de ceux qui accueillent les personnes âgées jusqu'à ceux qui se consacrent aux handicaps de tous ordres, ceux qui assurent à un titre ou à un autre la protection de l'enfance, l'héber-gement des adultes, la réinsertion, les différentes formes de remédia-tion à l'isolement et aux dérives sociales - et il faut y ajouter tous les services mobiles qui remplacent les placements par leurs propres déplacements ? En d'autres termes, par opposition à l'épiméleia, qui est commune à toutes les organisations de ce type, quel est l'équi-valent de la thérapeia, quelle est la technè spécifique des institutions à caractère social ? Ces institutions ont en réalité en partage une voca-tion ontologique : elles ont toujours, quel que soit leur champ d'inter-vention, à prodiguer de l'existence, à donner, comme disait Merleau-Ponty, le mouvement par lequel on est au monde, elles visent toutes à créer ou restituer de l'être, à donner à être. J'espère que vous me pardonnerez d'énoncer un objectif si abstrait (rien de plus abstrait que l'être) et en même temps si concret (rien de plus concret que l'être). En tout cas, l'existence de l'autre est la matière première de l'institution, l'institution responsable du fragile aurait dit Paul Ricoeur, chargée de construire des vies souveraines, aurait préféré dire Michel Foucault.
Il n'est pas facile, quoi qu'il en soit, d'évoquer la production d'existen-ce, qui est pourtant la vocation d'une institution sociale - existence étant le bios des Grecs, la vie des hommes, le bios de biographie, par opposition à zôè, l'aspect indifférencié, banal et en somme animal de la vie, le zôè de zoologie. La description de cette fonction ontologique de l'institution n'a été vraiment tentée que dans de grands textes, et je pense, de ce point de vue, à deux sommets de la littérature du XXème siècle qui posent magnifiquement la question de l'institution et qui nous apportent une réponse aujourd'hui encore indépassable : ils nous donnent à penser à un point inimaginable, sous réserve, évidemment, que nous les lisions en opérant les transpositions nécessaires, car ils ne concernent pas directement les institutions ici représentées - mais ils ont l'avantage de mettre en avant l'un la négativité intrinsèque de l'institution et l'autre au contraire sa positivité intrinsèque.
D'un côté, la négativité, avec l'inoubliable Montagne magique (parue en 1924) où Thomas Mann, pour analyser ce qu'on pourrait appeler la séduction de la maladie, étudie un sanatorium de Davos, le Berghof, institution assimilatrice qui formate et même sélectionne à son image ceux qu'on lui confie, dans une intéressante temporalité du provisoire qui s'éternise. Je laisse de côté d'autres aspects importants de l'uvre, l'obsession de la mort, le snobisme ou le désir d'assimilation, encore que celui-ci nous rapproche du thème central qui nous intéresse. Hans Castorp, le héros, est venu rendre visite à son cousin et il est littéralement recruté comme malade, dès son arrivée, par le docteur Behrens, qui juge qu'il a non pas la tuberculose - d'ailleurs il ne l'a pas - mais le profil pour un séjour réussi au sanatorium. Hans, lui, est attiré par ce monde clos où une existence toute faite s'étire, dans laquelle l'individu n'a plus en somme qu'à se couler. Nul doute qu'une recommandation européenne, s'il en avait existé à l'époque, aurait interdit à juste titre un tel placement - du moins si d'autres solutions avaient été possibles.
À l'opposé la positivité de l'institution, avec un autre texte irremplaça-ble qui est La métamorphose de Kafka, magnifique clé de lecture et accès universel à la complexité du fonctionnement des choses. Sans doute vous souvenez-vous de Grégoire Samsa, cet employé aux écri-tures habitant en famille, qui se réveille un beau matin transformé en insecte, les gestes difficiles et la voix méconnaissable, et qui au fil des jours, fatalement incompris de ses parents et malgré le soin que sa sur essaye de prendre de lui, se sent exclu de la société humaine, tout en espérant être entendu d'elle et y être réintégré. De sa fenêtre, il voyait jusque-là les murs gris d'un hospice à l'aspect si triste qu'il se refusait à y aller quoi qu'il arrive, mais devenant de plus en plus myope, il n'en aperçoit plus désormais que l'ombre floue et il prend conscience douloureusement que dans cette institution qu'il avait tant évitée, fuie et détestée, se trouvait sans doute, perdu à jamais, le seul secours qu'il pouvait attendre du monde. Autrement dit, dans son cheminement tragique et à sa manière, Grégoire Samsa tour à tour désinstitutionalise et réinstitutionalise. Et de toute manière il existe bien, selon ce qu'on en fait, deux pôles opposés de l'institution, que l'anthropologue Marc Augé a appelés le lieu et le non-lieu. Le non-lieu est un espace où les individus, si positifs que puissent être leurs rapports, ne s'approprient pas le lieu, avec lequel ils n'entretiennent au final qu'une relation de consommation : le non-lieu est un espace de non-rencontre, il ne construit pas de références de vie, il ne confère pas d'existence. C'est par exemple le cas limite d'un camp de transit ou d'une aire d'autoroute, mais aussi de toute institution qui ne serait pas, au sens plein du terme, habitée. Au contraire un lieu est "iden-titaire, relationnel et historique", dit Marc Augé, il offre un espace partageable par des personnes - vous reconnaissez là l'institution réussie. Il arrive ainsi qu'un centre commercial soit un lieu parce qu'il offre un cadre social et qu'un établissement social soit un non-lieu, peut-être parce qu'il s'est au fond dégradé en centre commercial.
Si nous en avions le temps, plusieurs autres concepts devraient être avancés, sur la même ligne que l'existence, parce que dans notre problématique ils lui sont reliés : la personne et l'autonomie, néces-saires à une pensée de l'accompagnement, mais aussi la valeur et la norme, et surtout la liberté, puisque l'institution est toujours une aide à contenir ce que Sartre appelle la facticité, c'est-à-dire le contraire, l'envers et la limite de la liberté. La facticité, c'est tout ce que nous ne choisissons pas et que notre liberté consiste précisément à surmonter. Que ne choisissons-nous pas ? Naître, mourir, bien sûr, mais surtout être comme on est, avec ou sans telle aptitude, dans telle ou telle condition, etc. Il faut lire un passage de ce texte essentiel qui a été publié par la fille de Sartre après sa mort sous le titre de Cahiers pour une morale. Il y est dit en substance que nous sommes tous, je cite, à la fois "facticité investie" et "projet-dépassement" - je conclurai dans un instant sur ces catégories. Me voilà malade, imagine Sartre, et alors que j'étais sportif, je ne peux plus l'être. Négativement, je suis déchar-gé par mon handicap de la responsabilité d'être sportif - et c'est bien ce qu'on appelle être diminué. Mes capacités formaient un bouquet, quelques fleurs ont disparu et le bouquet est réduit. Est-ce bien ce qui se passe ? Pas du tout ! Cette représentation mécaniste n'est pas la bonne, dit Sartre : en réalité, "mes possibilités ne sont pas supprimées mais remplacées par un choix d'attitudes possibles envers la dispari-tion de ces possibilités" : dans l'exemple du sportif malade, être un bon ou un mauvais malade, préserver son statut social ou y renoncer, gagner sa vie malgré tout ou non, vivre en autonomie ou non, etc. Autrement dit, une fois que la maladie ou la malchance a produit ses effets, il y a une nouvelle facticité que je dois investir, une nouvelle condition à l'intérieur de laquelle, "je suis de nouveau libre et sans excuses" - c'est la magnifique formule utilisée par Sartre. Ainsi, le handicap, l'âge, la solitude, la vulnérabilité, la déviance, la déficience, sont des conditions dont la prise en compte par l'institution doit être telle que ceux qui sont accueillis ou aidés soient "libres et sans excuses" - ce qui revient à trouver de la force dans la faiblesse et à affirmer par-delà l'inégalité des individus l'égale dignité des personnes.
Le paradoxe de l'institution est justement dans ce rapport complexe qu'elle entretient avec la facticité, dont à certains égards elle libère alors qu'à d'autres elle l'aggrave et en augmente le poids. Et la désinstitutionalisation s'inscrit dans cette ambiguïté : d'un côté les établissements constituent une médiation, ils sont des moyens de réparation et de promotion, personnelle et sociale, et en ce sens ils donnent accès au monde ; d'un autre côté, en tant que structures intermédiaires, avec leur logique propre, ils sont aussi, par rapport à cet accès, des détours et des obstacles. D'où le caractère libérateur de l'idée d'un accès direct, d'une confrontation immédiate à l'existen-ce, réduisant à rien ou à peu de chose cet empêchement d'être ou en tout cas cette distance à l'être dont l'institution a pu avec le temps devenir l'emblème. La visée de la désinstitutionalisation est l'abolition de cette distance, comme le montre parfaitement le lexique de l'espa-ce qui est utilisé : proximité, milieu ordinaire - où conduisent des passerelles, dit notre notice - désenclavement, environnement, externalisation, parcours (de la personne), réseau (intervention en réseau), dispositifs "hors les murs", par exemple, sont autant de figures spatiales d'un idéal d'accessibilité. C'est toute la problématique que nous avons à examiner qui nous renvoie à l'espace et pour évoquer d'un mot l'autre partie de notre thème ("vers de nouvelles pratiques de direction"), je dirais qu'à l'heure du retournement du modèle institutionnel, diriger va être assurer au mieux le passage de l'insularité des institutions à une nouvelle disposition en archipel.
Je me réfère à nouveau ici au texte de la notice de présentation. On comprend bien que "penser l'institution autrement" débouche sur la nécessité de définir de "nouvelles pratiques de direction". C'est pourquoi on lit aussi facilement l'affiche de haut en bas, dans une parfaite logique descendante, car la descente est la meilleure figuration possible de la déduction. Cependant les pratiques de direction ne découlent pas seulement de l'institution et des modifications qui l'affectent. Pour une large part, c'est peut-être même le contraire qui se produit et c'est plutôt l'institution qui résulte des pratiques de direction. On voit du reste que les pratiques de direction ne figurent pas sur le panneau de bois rustique mais très logiquement dans ce qui apparaît, à tous les sens du mot, comme un horizon. Diriger une institution en partie désinstituée, si on peut dire, c'est opérer dans un cadre à réinstituer, c'est établir une organisation "polyvalente, polycentrée, polyarchique" comme disent les disciples d'Edgar Morin. Diriger suppose de prendre en compte de l'ininstitué, début de réponse à la double question de la notice : "Quelles seront les nouvelles compétences à mobiliser dans l'exercice du métier de directeur et quid de la responsabilité accrue du directeur du fait de cette évolution ?" Je n'en dirai que quelques mots pour finir.
Sur le premier point, il me semble que la compétence à mobiliser dans l'exercice du métier de directeur dans un contexte désinstituant, ce sera justement l'art de mobiliser les compétences, c'est-à-dire de savoir concentrer, regrouper et mettre en cohérence avec les besoins les savoir-faire qu'un fonctionnement en réseau risque toujours d'éparpiller et de déprofessionnaliser. Le travail social, qui est une forme exemplaire de l'activité humaine, répond à des conditions pratiques, épistémologiques et éthiques spécifiques et il doit satisfaire à des exigences contradictoires qui touchent à la fois à la nécessité sociale et à la liberté individuelle. Diriger, c'est se porter garant de ces repères, c'est rassembler et faire tenir ensemble dans un dispositif à géométrie variable une palette d'outils et de partenaires de plus en plus large. Car la désinstitutionalisation s'inscrit, chacun le soit bien, dans une perspective redoutablement libérale. L'application de la logique de marché au domaine social, la dérégulation qui en découle et l'assimilation du geste social à une prestation relevant de la consommation créent un risque d'ubérisation - je me sers volontai-rement du mot rendu célèbre par la colère des taxis pour désigner la désorganisation et l'intermittence du travail social qui sont à craindre, car la norme néolibérale nous enjoint de vivre dans un univers de compétition généralisée et demande à chaque individu de se concevoir comme une entreprise qui doit être rentable ou périr.
Second point, l'idée de responsabilité accrue du directeur recoupe cette fonction de garant du geste social et lui en ajoute d'autres. La désinstitutionalisation est en effet une révolution de type copernicien, où est décrétée une permutation du centre et de la périphérie. Dans le système de Copernic, qui est l'anti-modèle du géocentrisme de Ptolémée, le soleil et la terre échangent leur place. Toute la pensée occidentale a eu recours, depuis, au modèle de la révolution coperni-cienne, à commencer par la théorie de la connaissance au siècle des Lumières, lorsque Kant inverse les places du sujet connaissant et de l'objet connu. Ce modèle copernicien, à quelque domaine qu'on l'applique, est toujours un renversement du monde ou de la représen-tation du monde. Il n'en va pas autrement dans le secteur social, même quand les établissements survivent par un changement de paradigme et en intégrant de nouvelles logiques d'action. De fait, nos institutions se copernisent, si on peut dire : la référence et le point central se déplacent, nous l'avons entrevu, de l'institution en tant que structure sédimentée à un système souple et globalisé de prise en compte des situations dans des projets singuliers. Ce n'est plus l'institution qui est le centre du monde, mais, si on peut dire, le monde qui est appelé à devenir le centre de l'institution. La direction d'établis-sement déborde alors de la fonction classique de pilotage d'un mécanisme préexistant, pour devenir création continue de projets. Ou bien, pour reprendre les catégories existentialistes que j'évoquais tout à l'heure, elle substitue à la gestion de la "facticité investie" l'invention continue de "projets-dépassements". En ce sens, la responsabilité de directeur, est plus que jamais, comme le dit une autre belle définition de Hannah Arendt, de "rendre tous les commencements possibles".
Ce que nous avons entrevu, en effet, c'est que la désinstitutionalisa-tion est pour les établissements une opportunité historique de regard sur soi, une saine invitation à la dissidence créative et une chance d'assurer une libération du modèle par l'anti-modèle. Mais cette pers-pective ne va pas sans appréhension et, de fait, elle n'est pas sans risque, car l'anti-modèle à son tour va devenir modèle, puisqu'ainsi va le monde, "construction et destruction, destruction et construction" disait Héraclite. Et les normalisations futures seront de plus en plus asservies aux règles du jeu de la modernité, notamment la politique du chiffre et la concurrence dérégulée de tous contre tous. Il n'est que de voir l'expansion actuelle du commerce - il n'y a pas d'autre mot - de l'aide à la personne, ce champ où se télescopent la solidarité qui fonde le soin humain et la dure loi du profit qui gouverne le monde. De quoi aggraver la peur du vide qui accompagne toujours le projet de revenir sur l'institution. C'est même sans doute ce qui a toujours empêché la mise en application des thèses d'Ivan Illich : si admirées et si admira-bles qu'elles aient pu être, elles n'auront guère exercé qu'une fonction de révélation et de dénonciation de la production par les institutions de leur propre déviance.
Mais pour faire le tour de l'institution considérée comme objet philoso-phique, il faudrait l'explorer encore sous bien d'autres aspects : comme révélateur idéologique de la cité, comme modalité de l'espace-temps, comme champ du questionnement éthique, comme confronta-tion entre le pouvoir et la norme, le possible et le réel, le désir et le manque. Ce sont autant de projets d'étude pour plus tard, mais pour le moment il me reste simplement à vous remercier de l'attention que vous avez portée aux problèmes que j'ai essayé de trouver à vos solutions.
Ulysse et Socrate. La philosophie comme aventure. Conférence à la Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine, Saint-Denis, Réunion, le 28 novembre 2019.
Politiques d'éducation dans un contexte original : analyses comparatives et indications de pilotage. Conférences données au Colloque "Bilinguisme et interculturalité", Mayotte, 20, 21, 22 mars 2006
Tout système éducatif, même issu d'une longue tradition et fondé sur l'action lente et ancienne du temps, demeure par essence toujours à construire et se renierait lui-même s'il venait à ne plus se définir comme tel. Cependant, la rencontre - dont est faite l'histoire de l'école - entre les idéaux d'éducation et les réalités auxquelles l'institution tente de les appliquer fait que cette vocation naturelle à innover, tout aussi consubstantielle à l'idée d'enseignement que sa fonction apparemment inverse de conservation et de transmission, semble à un instant donné inégalement répartie. Ainsi il existe de toute évidence, au-delà des spécificités si souvent invoquées dans le discours pédagogique, une sorte de fonds commun des situations où l'école est plus qu'ailleurs encore à construire et donne, en raison des circonstances, une plus grande place au champ du possible et à la temporalité de l'urgence. Ainsi, à Mayotte, l'exigence de développement peut parfaitement s'accorder à l'idéal de l'école républicaine mais pas du tout au rythme de l'édification de l'école de Jules Ferry, dont les effets se sont accumulés, en métropole pendant plus d'un siècle : il s'agit de construire l'école au moment où cette institution, même là où elle est depuis très longtemps construite, affronte le choc désorganisateur de la modernité. Ce fut et c'est encore le cas dans d'autres contextes de l'outre-mer et c'est à ce titre que la comparaison de politiques scolaires conduites dans des circonstances à première vue assez différentes peut constituer un apport utile à la recherche de quelques constantes du pilotage des systèmes éducatifs. Nous allons, dans le cadre ainsi défini, rapporter à la question de l' "aménagement du système éducatif" de Mayotte une série d'éléments qui sont empruntés à l'histoire de l'école calédonienne au lendemain des Accords de Matignon. Ce rapprochement ne vaut, cela va de soi, que si au-delà des analogies sur lesquelles repose la possibilité de comparer les deux situations, on précise les éléments qui limitent l'exemplarité de cette comparaison.
D'une part, les circonstances historiques, qui sont essentielles à toute action éducative, diffèrent fortement. La Nouvelle Calédonie de 1988 sortait, grâce à un consensus porteur d'espoir, d'une période tragique et elle avait à développer une nouvelle citoyenneté sur les dispositions adoptées par la voie référendaire, qui prévoyaient une distribution radicalement nouvelle du pouvoir politique, administratif et économique, en fonction d'un mécanisme qu'on a appelé alors le "rééquilibrage" du territoire. D'autre part, les conditions démographiques (160.000 habitants pour une superficie 60 fois supérieure à celle de Mayotte), avec une population peu nombreuse, dispersée et à faible accroissement, étaient très différentes de celles qui prévalent à Mayotte, où s'additionnent les deux urgences du quantitatif et du qualitatif. Le système scolaire calédonien était déjà relativement ancien et équipé, même s'il était par bien des côtés très inégalitaire. Le système économique et la problématique de l'emploi étaient également très différents. Enfin la situation calédonienne avait comme caractéristique le face-à-face de deux grandes communautés, l'une mélanésienne et l'autre européenne, d'importance sinon égale tout au moins comparable, qu'opposait depuis fort longtemps un contentieux historique complexe. Dans ce contexte marqué par l'inégalité de statut des langues et le bilinguisme "diglossique", la question des langues enseignées et pratiquées à l'école, ou plutôt, devrait-on dire, ayant leur entrée à l'école, la place accordée aux cultures locales, objet de revendication ancienne et d'une reconnaissance toute récente par la volonté républicaine, était porteuse d'un poids symbolique considérable.
Dimensions linguistiques et dimensions techniques de l'action éducative
Ce n'est pas seulement l'aspect symbolique de question des langues qu'il a fallu prendre en compte à l'époque, mais aussi l'aspect technique et l'aspect pédagogique, ces différentes dimensions intervenant toutes, à des degrés divers, dans la conception d'une politique éducative. Toutes les études disponibles montraient que les disparités d'une région à l'autre du territoire, en termes de résultats scolaires, étaient importantes et qu'elles étaient de toute évidence largement reliées aux conditions tant matérielles que psychosociales de l'accès à l'école, aux secteurs géographiques et aux types de populations accueillies. Pour ne donner qu'un exemple simple, le taux de redoublement du CP était le double dans l'intérieur de ce qu'il était à Nouméa et la plupart des indicateurs de scolarisation et a fortiori de rendement du système allaient clairement dans le même sens. L'apprentissage du français, s'il n'était pas seul en cause, était donc manifestement un facteur à prendre en compte en priorité, en raison de la présence d'un nombre considérable d'élèves dont, surtout en dehors de la province sud, il n'était pas la langue maternelle, au sens tantôt propre, tantôt figuré du terme.
Mais la situation linguistique de la Nouvelle-Calédonie est complexe. On y parle près de 30 langues vernaculaires, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire, sont très différentes les unes des autres et correspondent à des aires linguistiques bien déterminées. Il faut noter au passage que l'absence d'intercompréhension entre certaines de ces langues confère au français un statut particulier de langue en quelque sorte doublement véhiculaire, puisqu'en raison de l'histoire, il s'offre comme une sorte de recours commun aux mélanésiens parlant des langues différentes. Par ailleurs, quelques unes de ces langues avaient été dotées au 19ème siècle, dès le début de l'évangélisation, d'une écriture diffusée et fixée par la traduction de la Bible ou d'autres écrits religieux. Néanmoins pour la plupart elles n'ont pas eu, pendant longtemps, de code écrit, et même pour celles qu'on avait appris à écrire, les habitudes sont toujours restées beaucoup plus de lecture que d'écriture. Ces langues sont donc, en fait, de "tradition orale", ce qui rend plus difficile pour leurs locuteurs l'accès à une école où prédomine l'acquisition, l'usage et même, pourrait-on dire, l'idéologie "humaniste" de l'écrit comme support de la connaissance objective, partagée et formatrice, qui est comme chacun sait au fondement des systèmes éducatifs de l'Occident. Dans le cadre d'une relance du système scolaire, visant un rééquilibrage des chances et une amélioration globale de la réussite, la place des langues vernaculaires et des cultures correspondantes ne pouvait donc pas ne pas être posée comme une sorte de préalable, compte tenu des apports de la recherche linguistique et pédagogique dans ce domaine.
Agir localement : concertation et mobilisation des compétences
La question des langues vernaculaires a été posée, dans le cadre des pouvoirs donnés à l'administration de l'Education nationale sur place, de deux manières. D'une part, en mobilisant les compétences, et prioritairement les compétences locales, en matière de constitution et de rassemblement de données scientifiques sur la description des langues vernaculaires. D'autre part, en faisant mener à bien, à partir des travaux existants, une recherche méthodologique et didactique dans la perspective de l'introduction de ces langues aux différents niveaux de la scolarité. Une Mission des langues et cultures régionales, avait été créée au Vice-Rectorat, pour assurer le suivi et la synthèse de cette recherche. Cette mission s'est chargée de faire l'inventaire des besoins et des ressources dans ce domaine et de concevoir des actions de formation et d'animation en faveur des enseignants concernés. Il s'agissait en outre d'aider les instituteurs à observer les élèves, notamment mélanésiens, pendant les activités scolaires, afin de prévenir les difficultés qu'ils pourraient rencontrer en raison de données collectives que le pédagogue doit savoir prendre en compte. Dans ces domaines, le mouvement avait été amorcé notamment par l'enseignement privé, souvent plus présent en tribu que l'école publique. En même temps était organisée une consultation générale des acteurs, des responsables et des partenaires de l'école, réunis dans des conseils et des structures paritaires, commissions paritaires, comité technique paritaire, conseil de l'éducation, créés à cette occasion car le territoire en était jusque là dépourvu : enseignants, parents d'élèves, élus du congrès du territoire et élus des provinces, celles-ci ayant reçu de la loi référendaire la pleine compétence d'organisation de l'enseignement primaire, dont l'Etat n'assurerait plus que le contrôle pédagogique et la détermination des programmes, lesquels pouvaient désormais faire l'objet, dans certaines limites, d'une adaptation par les provinces elles-mêmes. Cette concertation aux dimensions du territoire, confrontée aux résultats des recherches conduites, a abouti en un an à l'élaboration d'un texte approuvé ensuite par le Ministre de l'Education Nationale, arrêtant les conditions et les modalités de l'enseignement des langues mélanésiennes et de l'adaptation des programmes scolaires.
Donner un cadre à l'enseignement des langues vernaculaires à l'école
Le texte du 28 février 1990 a donné un cadre à l'enseignement de ces langues dans le premier degré et à toutes les mesures d'adaptation des programmes aux réalités locales. Il prévoyait, à l'école maternelle, l'accueil en langues suivi d'une acquisition progressive du français. A l'école élémentaire, il attribuait à l'enseignement en langue vernaculaire un quota de cinq heures hebdomadaires. Cet horaire était à prélever, et il convient d'insister sur ce point, sur l'ensemble des disciplines. L'objectif était en effet non pas seulement d'enseigner la langue maternelle mais aussi d'enseigner dans la langue maternelle les disciplines et les programmes scolaires : le terme d'adaptation des programmes ne signifie pas autre chose que la prise en compte du vécu des enfants et l'intégration des éléments culturels dont ils sont porteurs dans la démarche générale d'accès aux savoirs scolaires. Du reste, il a fallu convaincre les opposants à ces mesures en leur expliquant qu'adaptation ne voulait pas dire folklorisation, pas plus, par exemple, que démocratisation ne doit signifier facilitation.
Dans la pratique, certains aspects de cette politique d'enseignement ont pu varier, d'une province à l'autre, ce qu'avaient prévu et même encouragé la souplesse et le caractère volontairement ouvert du texte-cadre et la nouvelle répartition des responsabilités en matière d'enseignement primaire, l'Etat n'ayant plus en ce domaine qu'un rôle au demeurant assez mal défini par la loi référendaire, de "contrôle pédagogique". En concertation avec les directions de l'enseignement dans chaque province, il avait été convenu que ce contrôle porterait sur l'inspection des maîtres et l'évaluation, pendant que l'animation pédagogique, la recherche didactique et l'élaboration de documents seraient assurées en collaboration par les services provinciaux et les instances du Vice-Rectorat, dont la Mission des langues et cultures régionales et les services mis en place pour animer ce renouveau pédagogique, comme le Service de l'éducation populaire, responsable de toute l'action socio-éducative et chargé de recruter, de former et de mettre en place des animateurs scolaires proposés par les communautés pour faire le lien entre elles et le réseau scolaire. L'ensemble des aspects administratifs et financiers de toutes ces opérations, ainsi que l'impulsion et la coordination, étaient assurés par une Division de l'Innovation, créée au Vice-Rectorat afin de souligner que l'administration sait, lorsqu'il le faut, faire la part du nécessaire encadrement réglementé du système et de l'invention et de la liberté que suppose une politique originale et volontariste.
En même temps, les provinces mettait en uvre l'enseignement qui était de leur ressort au titre des "adaptations aux spécificités provinciales", visant de façon explicite quelques objectifs essentiels : "prise en compte de l'identité culturelle de l'enfant, affermissement et enracinement de l'enfant dans sa langue et dans sa culture, insertion harmonieuse de l'enfant dans le système scolaire, bilinguisme et biculturalism e pour la réussite scolaire et l'intégration socioculturelle". C'est du reste dans le droit fil de ces orientations que l'Accord de Nouméa, dix ans plus tard, reconnaîtra les langues kanak comme étant, avec le français, des "langues d'enseignement et de culture", soulignant le lien entre politique éducative et politique linguistique. Mais surtout il faut noter que si dès l'origine, le but était de permettre à la fois un meilleur apprentissage du français en milieu mélanésien et une plus grande réussite scolaire, il s'agissait en même temps, et ce point est essentiel, de faire en sorte que le milieu familial et culturel des enfants ne soit pas dépossédé trop tôt par l'école de ses prérogatives. Cette dépossession provoque en effet des ruptures dommageables pour l'ensemble des apprentissages et pour la cohérence globale du processus éducatif.
Au-delà de l'enseignement primaire
Dans le second degré, la problématique se présentait de manière un peu différente, la dimension identitaire et la préservation du lien avec le milieu n'intervenant plus au même titre qu'à l'élémentaire. C'est l'occasion de rappeler, peut-être, que la pédagogie est avant tout un art de distinguer les étapes et qu'on ne peut par définition accueillir et adapter indéfiniment tout au long du système scolaire. Les élèves doivent pouvoir être, à certains moments du cursus, considérés comme aptes à l'universalité. C'est le but même de l'école, comme le dit bien le vocabulaire : dans élève, il y a élever et dans université, il y a universel. Au collège, les langues kanak devenaient donc des matières d'enseignement comme les autres. Les enseignements optionnels correspondants y ont été, à ce titre, systématisés et renforcés. Six langues ont été régulièrement enseignées au collège, elles sont huit aujourd'hui. Quatre langues, les mieux décrites et les plus parlées, ont été introduites au lycée comme LV 2 ou LV 3. Cet enseignement est officiel depuis 1992, et, depuis cette date, ces langues donnent lieu à des épreuves orales et écrites du baccalauréat régies par un programme officiel. On a considéré, en effet, à la lumière de ce qui avait été fait pour le tahitien en Polynésie Française, qu'au niveau du second cycle, les langues et cultures régionales constituaient un apport qui avait toute sa place dans les savoirs et les compétences évalués au baccalauréat et qu'il était en outre légitime que leur connaissance vienne contribuer à rendre plus accessible le grade de bachelier à des élèves que pouvaient défavoriser tant d'autres facteurs.
La formation des enseignants, à son tour, a intégré cet enseignement. A l'Institut de Formation des Maîtres (IFM) et à l'Ecole Normale de l'enseignement privé (ENEP), des unités d'enseignement ont été consacrées aux langues et civilisations mélanésiennes. Par ailleurs, l'Université de la Nouvelle Calédonie a ouvert depuis un DEUG puis une licence de Langues et cultures régionales, qui ont été un élément essentiel de formation d'enseignants diplômés, sans pour autant préparer entièrement à l'enseignement des langues kanak. Malgré tout, on peut considérer que dans le domaine des langues et cultures régionales, le système éducatif calédonien a finalement réussi, ce qui est le plus à même de construire l'école : un développement qui s'est presque entièrement fondé sur la mobilisation et l'extension de ses propres ressources. Par exemple, dans le premier degré, alors qu'il fallait traiter le problème des instituteurs déjà en fonction, principalement en brousse, et considérés comme sous-qualifiés ou sous-titrés, c'est un dispositif original de formation continue intensive, en deux ans et à temps plein, donnée au cur des provinces qui a été choisi, plutôt que de tout attendre de la venue d'enseignants de l'extérieur ou d'une réforme mirifique de la formation des enseignants.
On a aussi rapproché dans toute la mesure du possible l'école de son milieu par la création de structures scolaires innovantes comme l'ALEP (Annexe de Lycée professionnel) d'Ouvéa, appelée de ses voeux par la population, implantée sur des terrains proposés par la commune et le système coutumier, construite sous forme de chantier de formation par une main d'oeuvre locale, au premier rang de laquelle les familles des futurs élèves, puis fonctionnant avec un personnel enseignant recruté principalement sur place parmi des étudiants diplômés, formés ensuite spécifiquement à leur tâche. Ce que doit viser idéalement une politique éducative dans ce type de contexte, c'est, dans le respect des exigences de l'enseignement public, la mise en place de ressources de formation qui soient complètement homogènes aux besoins qu'elles ont à satisfaire.
Apports et incertitudes de l'évaluation
Bien entendu, dans une telle entreprise, les obstacles et les échecs, momentanés ou durables, n'ont pas manqué. A l'examen, il apparaît que la plupart ont été des révélateurs de l'unité de l'action éducative : ils ont permis de constater que toucher à l'une seule de ses dimensions, c'est s'exposer à devoir la réinventer tout entière. Tel est, sans aucun doute, le premier enseignement qu'il faut tirer de cette expérience. En la relatant, Le Monde avait parlé à juste titre, à l'époque, de "l'éveil tourmenté de l'école calédonienne". Et le second est que compte tenu précisément de cette unité, les mesures les plus importantes qu'il convient de prendre concernent, au-delà de la mise en place d'un enseignement des langues locales, l'encadrement des activités scolaires, l'aide au travail et l'accompagnement pédagogique, l'animation et la formation des maîtres, c'est-à-dire tout ce qui assure au système éducatif une dynamique de succès dont il a grand besoin lorsqu'il est en phase de développement.
Apprécier les effets de cette dynamique - c'est-à-dire évaluer la politique conduite - est cependant difficile, pour des raisons d'ordre méthodologique qu'il n'est sans doute pas inutile d'évoquer. D'abord, on peut se demander ce que signifie au juste évaluer une politique éducative. L'évaluation porte habituellement sur des objets plus limités : les résultats scolaires à tel ou tel niveau, ou bien telle ou telle formation, ou encore telle expérience déterminée. Par exemple, on tente d' "évaluer les ZEP", c'est-à-dire de comparer les résultats obtenus soit par rapport aux autres ZEP soit par rapport à la situation d'origine qui a donné lieu à l'inscription en ZEP ou à telle situation d'étape intermédiaire. Cependant, à la limite, il est impossible de mesurer l'action ZEP en elle-même, c'est-à-dire par rapport à l'absence de ZEP, d'autant que d'autres facteurs ont subi entre temps des modifications qu'on ne mesure pas non plus. On oublie souvent que sans les ZEP, des secteurs entiers du réseau scolaire se seraient sans doute enfoncés encore davantage dans leurs difficultés et peut-être même se seraient dramatiquement effondrés scolairement et socialement parlant, même si on ne peut évidemment pas en faire la démonstration. Cette difficulté qui vaut pour une expérience comme celle des ZEP vaut pour toute politique volontariste et se trouve même aggravée lorsqu'il s'agit d'une politique éducative globale innovante, comme celle mise en place en Nouvelle Calédonie et comme celle, quelle qu'elle soit, qui devra être conduite à Mayotte. Certes, il est toujours possible de s'appuyer sur les éléments objectifs, que tiennent soigneusement à jour les services statistiques : on peut comparer dans l'espace ou dans le temps des taux de scolarisation, de passage, de déperdition, de réussite aux examens, de performances dans telle discipline, le français, par exemple, ou les langues vivantes, y compris régionales, à partir des résultats scolaires, etc. Reste que la seule comparaison qui serait vraiment éclairante, celle qu'il faudrait absolument faire, c'est justement la seule qui est impossible : la comparaison de l'état du système éducatif avec ce qu'il aurait été si la politique éducative qui a été conduite n'avait pas eu lieu ou si elle avait été différente : une fois qu'une expérience majeure a été engagée sur la durée, elle apporte des modifications irréversibles qui agissent sur l'ensemble des facteurs et empêchent de saisir dans le détail le mécanisme de leur interaction.
L'école, en ce sens, se comporte comme un système vivant. C'est comme si, lorsqu'un malade qui a été bien soigné retrouve la santé, on essayait de savoir dans quelle proportion sont intervenus dans sa guérison tel médicament, tel élément du traitement ou bien sa solide constitution ou bien encore sa destinée, qui aurait fait que sa dernière heure n'était tout simplement pas venue. Par définition, et fort heureusement, il n'y a pas d'autopsie du patient qui survit à sa maladie, et il n'y en a pas davantage des systèmes éducatifs. Il est donc bien difficile de dire ce que serait devenue l'école calédonienne sans un "traitement" de ses maux, c'est-à-dire des retards et des déséquilibres qui étaient les siens au lendemain des Accords Matignon. Pour la même raison, il est presque impossible de distinguer, parmi les effets de la politique éducative qui a été conduite, les résultats induits par les mesures prises en matière de langues et cultures régionales et ceux qui découlent des actions visant au développement général du système scolaire, tant elles sont liées.
Il est possible, néanmoins, d'esquisser le tableau des acquis et des manques tels qu'ils peuvent apparaître aujourd'hui, soit presque 20 ans plus tard, l'état du malade, pour continuer dans la comparaison médicale, s'étant à coup sûr beaucoup amélioré, ce qui montre du moins qu'aucun des traitements qu'il a reçus n'a été tout-à-fait contre-productif. Il faut noter d'ailleurs - et c'est une forme d'évaluation indirecte - qu'à aucun moment les principes adoptés, les méthodes choisies et les objectifs spécifiques qui avaient été fixés n'ont été remis en cause jusqu'à aujourd'hui ni par l'administration ni par les instances élues, qui ont reçu depuis de nouvelles compétences en matière d'éducation. Ainsi, par exemple, on continue à travailler sur l'image que le milieu se fait de l'école et sur sa corrélation avec la réussite scolaire, sur la maîtrise des langages et le rapprochement de l'école et de ses acteurs, toujours affichés comme des priorités. On continue aussi à tenir la problématique du français pour inséparable d'un certain nombre de facteurs spécifiques dont la prise en compte conditionne tout progrès : statut respectif des langues maternelles et du français, représentation du français chez les mélanésiens, approches cognitives et approches socio-ethnologiques des processus d'apprentissage en Nouvelle Calédonie.
Tout cela, il est vrai, ne constitue pas un vrai satisfecit et demeure ambigu : d'un côté, s'il reste tant à faire, c'est que le système ne donne pas satisfaction, d'un autre côté si le mouvement engagé se poursuit dans la même direction, c'est qu'il démontre de lui-même, jusqu'à un certain point, son bien-fondé.
L'enseignement des langues mélanésiennes : une avancée paradoxale
Une analyse objective met en évidence qu'un certain nombre de difficultés ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, en dépit d'une tendance à l'amélioration, le niveau des élèves sortant de l'école primaire demeure, si on examine les tests de compétence, assez nettement inférieur à la moyenne nationale. Les données concernant l'orientation en fin de troisième ont les mêmes caractéristiques. Dans deux des trois provinces (Nord et Iles), le taux d'orientation vers les secondes générales et technologiques était, il n'y a pas si longtemps, inférieur de 20 points à la moyenne nationale. Il est intéressant de noter que le Vice-Rectorat invoque, entre autres éléments explicatifs, la différence de qualification des maîtres entre Nouméa et l'intérieur dont on ne sait pas en réalité le rôle exact qu'elle joue, mais qui montre en tout cas que le rééquilibrage dans ce domaine est encore loin d'être achevé. En ce qui concerne les langues d'origine, la Mission aux Langues et Cultures Régionales a fait récemment le constat de ce qu'elle appelle une "progression du français" parmi les jeunes, progression qu'elle ne présente pas d'ailleurs pas comme étant un progrès et qui s'accompagnerait d'un net recul des langues maternelles, de moins en moins bien maîtrisées par les jeunes - et peut-être faudrait-il dire aussi de moins en moins parlées. Cela met en évidence que le statut et le poids relatif des langues ne dépend pas autant qu'on croit des politiques scolaires et que c'est une illusion de tout attendre de l'école en ce domaine.
D'autres facteurs complexes interviennent sans doute, comme l'influence grandissante des médias, soulignée à juste titre par la Mission, qui signale également la difficulté de former les enseignants de langues régionales. Le corps enseignant spécialisé qui intervenait, encore récemment, dans les établissements secondaires publics et privés, comptait surtout des auxiliaires, des instituteurs détachés, des intervenants extérieurs vacataires et quelques compléments de service. De tous ces éléments d'analyse, la Mission tirait la conclusion qu'il fallait aller plus loin dans l'enseignement des langues kanak et mettre en place une politique d'éducation complètement et explicitement bilingue, toujours axée sur "l'apprentissage du français grâce à de meilleures compétences linguistiques acquises dans la langue maternelle", perspective que l'expérience ne semble pas avoir pleinement accréditée. Cette proposition ne va donc pas sans paradoxe et on peut se poser la question de savoir où passe exactement la limite entre prise en compte par l'école des réalités linguistiques et culturelles et recours à l'école pour assurer le maintien ou le renouveau de langues et de cultures dont la pratique se raréfie ou qui sont contrebattues par les effets irrépressibles du système médiatique dont sont victimes aussi des langues véhiculaires. Il n'est certainement pas indigne de l'école de contribuer à maintenir les traditions. Cependant, si c'est ce qu'on attend d'elle, il serait préférable de lever toute ambiguïté sur les fins poursuivies et d'en tirer les conséquences pour les démarches à mettre en uvre : ce n'est pas la même chose, pour le pédagogue, de prendre en compte la réalité, qui s'impose à tous, et d'entretenir un idéal qui est propre à certains.
Les dimensions positives : rattrapage des retards et appropriation de l'école
En contrepartie, les acquis et les effets positifs de la politique engagée ne manquent pas. Le système éducatif a réagi tout de suite aux mesures prises dès la rentrée scolaire de mars 1989. Les études dirigées, l'encadrement des études pour les élèves internes - donc venant de l'intérieur - grâce à d'importants moyens spécifiques, la dynamique de l'adaptation des programmes, la mobilisation et l'animation systématique du réseau scolaire, le renforcement et la réorientation de la formation continue, la valorisation des initiatives dans l'intérieur et aux îles Loyauté, la production locale d'outils pédagogiques et didactiques, l'amélioration des taux de scolarisation, surtout en maternelle, l'implantation rééquilibrée et rééquilibrante de moyens nouveaux, tout cela a eu des effets presque immédiats, mesurables dès la rentrée 1990 et a fortiori lors des suivantes, par exemple en termes de taux de passage pour les élèves à tous les niveaux, et même en termes de qualification des enseignants et de qualité de l'enseignement. En trois ans, le taux d'admission en 6ème a gagné 10 points, les redoublements en collège ont connu des baisses allant jusqu'à 12 %, le taux de scolarisation des 14 ans a augmenté de 14% et atteint enfin 100 %.
La convergence de ces résultats est incontestable et n'a d'ailleurs jamais été contestée. Elle donne l'impression que l'école n'attendait que d'être délivrée de certaines des pesanteurs qui l'affectaient pour faire un bond en avant. Un seul indicateur de rendement suffit à le montrer, celui du nombre de bacheliers. Entre 1989 et aujourd'hui, la population du territoire est passée de 165.000 à plus de 220.000 habitants, soit une augmentation de l'ordre de 30 %. Le nombre annuel de bacheliers, lui, est passé dans le même temps de 600 à la session 1989 à 1800 à la session 2005. L'augmentation est de 300%, dix fois plus forte donc que celle de la population. Ce résultat - et bien d'autres comme par exemple la meilleure scolarisation que traduit le nombre total d'élèves, qui s'est accru dans des propor-tions considérables pendant la même période - met en évidence une extension à l'ensemble des régions et donc des ethnies de ce qu'on peut appeler une appropriation de l'école, qui est pour tout système scolaire de ce type le signe le plus certain des progrès accomplis. Il est significatif que le nombre d'élèves du primaire n'ait pas beaucoup augmenté entre les années 80 et le début des années 2000 (8 %, liés en bonne part à l'amélioration du taux de préscolarisation), alors qu'en revanche le nombre d'élèves a explosé dans l'enseignement secondaire passant de 14000 à 30 000 (+ 125 % environ).
On voit bien, à travers ces indicateurs, qui expriment le rattrapage rapide d'un retard, que la place faite aux langues mélanésiennes et les mesures d'adaptation non seulement n'ont pas compromis mais ont largement favorisé et amélioré les apprentissages dans leur ensemble, y compris celui du français, et, à travers lui, l'accès aux savoirs universels dont le baccalauréat continue de mesurer l'acquisition. La hausse du niveau scolaire a été tellement perceptible que le Vice-Rectorat considère à présent que trop d'élèves sont orientés vers les lycées professionnels et que beaucoup des élèves de LP pourraient réussir tout aussi bien dans des lycées généraux : cela expliquerait qu'aux sessions récentes du baccalauréat, le partage des bacheliers entre baccalauréats généraux, baccalauréats technologiques et baccalauréats professionnels (trois fois un tiers) semble moins favorable que celui de métropole au développement de l'enseignement supérieur alors qu'il lui serait en réalité tout à fait comparable. On peut voir dans ce phénomène un signe de la persistance d'une sorte de manque d'ambition qui est sans doute de nature culturelle. Reste que dans cette même période de référence on est passé dans le territoire de 30 établissements du second degré à 65, dans un contexte qui n'est pas de croissance démographique rapide, comme on sait.
Le progrès accompli va pourtant bien au-delà de ces avancées essentielles. Il concerne la construction d'un enseignement destiné aux calédoniens sans pour autant rien sacrifier de leur accès à l'universalité des savoirs. C'est ce dont témoigne de manière exemplaire la mise au point de programmes adaptés, pas seulement au primaire mais au secondaire, dans ces disciplines-clés que constituent, dans un contexte interculturel, l'histoire, la géographie et l'éducation civique. Elles ont à donner un sens au monde dans lequel évoluent les élèves et à les conduire à l'exercice futur de leur citoyenneté. Le système éducatif ne pouvait ignorer ces enjeux et devait se situer entre les deux écueils symétriques que pouvaient constituer d'une côté les excès d'un certain occidentalisme éducatif et de l'autre ceux de ce qu'on a pu appeler l'insularo-centrisme. C'est un dispositif parfaitement équilibré qui a été construit avec le réajustement des programmes et l'attribution d'horaires précis, de l'ordre de 10 à 20 heures sur 77 heures annuelles, à consacrer à l'histoire et aux mutations de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. La mise en uvre de ces programmes s'est accompagnée d'un remarquable travail documentaire, pédagogique et didactique et les contenus, pour chaque niveau jusqu'aux classes terminales, constituent un édifice d'une extrême richesse, qui offre aux élèves non pas les mêmes chapitres d'histoire et de géographie que dans l'hexagone mais l'acquisition aussi exigeante qu'ailleurs du langage de l'histoire et de celui de la géographie. L'évaluation que l'on peut faire, avec le recul, de toute cette expérience, c'est qu'elle a au moins contribué à la construction d'une école calédonienne à la fois digne du système éducatif français et capable d'assumer de façon originale son destin.
Elle a aussi mis en évidence, derrière les questions touchant à l'interculturel à l'école, une série de difficultés relatives aux modalités pédagogiques du recours aux langues et cultures régionales dans tout système scolaire qui veut à la fois progresser et leur donner une fonction autre qu'accessoire ou ornementale. Même si les contextes particuliers dans lesquels intervient l'école contre-indiquent l'idée de transférer des types de politiques scolaires qui par définition tiennent leur valeur de leur adéquation à des besoins spécifiques, quelques enseignements peuvent être tirés, semble-t-il, de l'expérience calédonienne, en particulier pour ce qui concerne les éléments dont on peut raisonnablement penser qu'ils doivent impérativement être pris en compte dans l'aménagement d'un système éducatif.
Et d'abord, l'idée même d'aménagement. Dans le cas d'un système scolaire en voie d'installation et de constitution, dont on sait que, pour des raisons historiques, il n'a pas encore produit ses pleins effets, il faut faire la part de ce qui revient à son inadaptation et de ce qui relève simplement de son inachèvement. Comme Paris, l'école ne se bâtit pas en un jour. D'ailleurs, sous la Troisième République, qui à l'échelle de l'histoire de l'école n'est pas si éloignée, dans presque toutes les régions d'une France alors rurale où prédominaient largement les parlers régionaux, les élèves ont appris le français à l'école. Cela n'a pas empêché la réalisation en quelques décennies d'un admirable projet républicain d'instruction publique, d'une école de la République, qu'on évoque aujourd'hui avec une nostalgie qui n'est hélas pas toujours sans fondement. En tout cas, on voit bien que l'adaptation ou l'inadaptation d'un système scolaire ne se réduit certainement pas à la seule question des langues d'enseignement, que cette question renvoie à un diagnostic plus global et qu'on ne peut laisser de côté le facteur temps, essentiel à l'édification de l'école. On peut seulement ruser avec le temps : il s'agit de produire au plus vite de la réussite pour appeler la réussite. Il s'agit de savoir commencer.
Politique des langues et politique éducative : la problématique du savoir scolaire
A la question qui est posée de "l'approche à privilégier pour réussir", on peut donc donner un premier élément indirect de réponse : la mise en place d'un enseignement fondé sur la prise en compte de la langue et de la culture d'origine n'est pas du tout une arme absolue et ne peut en aucun cas être une mesure isolée. Sinon, ce serait se fonder sur l'idée vraiment un peu courte que l'apprentissage sera plus efficace du simple fait qu'il se fera dans une langue familière aux enfants. S'en tenir à cela, même en s'appuyant sur des considérants théoriques, c'est se préparer à rencontrer des problèmes bien plus ardus que ceux qu'on prétendait résoudre. Car derrière la langue, ce sont évidemment toutes sortes de données plus complexes qu'il faut mettre en évidence pour adapter au mieux les conditions d'accès aux savoirs scolaires pour des enfants qui participent d'une autre culture, en fonction de cette culture, précisément, et c'est là, bien entendu, un travail de spécialistes. L'essentiel, en effet, ce n'est pas d'autoriser l'usage d'une langue d'origine et de lui confier de fait et sans autre forme de procès la fonction du français jusqu'à ce que celle-ci puisse s'exercer, l'école demeurant pendant le temps de cette attente identique à elle-même malgré le changement de langue - et donc confrontée aux même difficultés qu'avant et peut-être même à d'autres.
Au contraire, toute mesure d'ordre linguistique et culturel dans un système éducatif en développement doit faire l'objet, dès le départ, d'une série d'actions plus générales, sans lesquelles elle resterait dénuée de sens et même génératrice de risques. Six de ces actions au moins paraissent essentielles.
1 - D'abord la formation continue des maîtres et l'animation pédagogique, qui sont des priorités absolues. Car, là encore, il faut se garder d'une fausse bonne idée, une de plus, selon laquelle le maître locuteur local serait ipso facto de plain pied avec la tâche d'enseigner aux élèves eux-mêmes locuteurs. Voir les choses ainsi, c'est avoir foi en une école qui serait comme "tombée du ciel" puisque sans autre modèle pédagogique que celui qu'on lui veut faire remplacer et qui serait donc condamnée soit à le copier servilement, ce qui est indigne de l'école, soit à s'en démarquer à toute force, ce qui n'est pas mieux.
2 - Ensuite un travail d'analyse et de concertation doit être mené en vue de la préparation et de la mise en oeuvre d'instructions pédagogiques spécifiques pour les différents niveaux, qui sont indispensables dans tout le cursus et tout spécialement à la maternelle. Car la maternelle doit être conçue et repensée en pareil cas comme une école qui rend possible l'école, où se concentrent les difficultés mais aussi les immenses potentialités de l'ensemble du dispositif fondé sur l'accueil et l'adaptation. Des livrets d'instructions pédagogiques, établis sur place par des commissions ad hoc travaillant en équipe, publiés par le Vice - Rectorat et diffusés au titre de l'animation pédagogique avec le concours des personnels qui sont chargés de l'encadrement sont un excellent moyen d'associer sur le terrain la formation des maîtres et le pilotage du changement.
3 - Il faut également investir beaucoup dans l'accompagnement et l'aide au travail scolaire, surtout à la fin du primaire et au début du collège et du lycée, car c'est le seul moyen, dans un premier temps du moins, de promouvoir une relative égalité des chances et une meilleure réussite, non comme un idéal, mais comme un moteur du progrès de l'école. Il s'agit de permettre au système scolaire, comme on fait pour un vélo, de tenir en équilibre en avançant et d'avancer en mettant à profit cet équilibre. Il y a vraiment là quelque chose d'essentiel : l'amélioration considérable qui avait été constatée en Nouvelle Calédonie de la réussite au lycée et des taux d'obtention du baccalauréat - et qui avait profité surtout aux élèves mélanésiens qui ne fréquentaient pas jusque là le lycée ou y rencontraient des difficultés majeures - devait certainement beaucoup à la mise en place de moyens massifs destinés à encadrer le travail des élèves internes, par définition ceux qui n'étaient pas de Nouméa. Ce point donne l'occasion de rappeler que contrairement à un schéma pseudo cartésien dont l'esprit des pédagogues a du mal à se défaire, le "décollage" d'un système éducatif ne peut se concevoir que globalement, en s'attaquant en même temps à tous les niveaux de la scolarité : vouloir se limiter à la "fabrication" d'une génération nouvelle d'élèves entrant à la maternelle ou au cours préparatoire dont ensuite le cursus, fondé sur des débuts radieux, règlerait les problèmes rencontrés jusque-là relève bien évidemment de l'utopie.
4 - Dans la même optique, une place importante doit être faite aux actions à conduire à partir de l'école pour réduire autant que possible l'écart béant et souvent fatal entre l'univers vécu et l'univers scolaire des élèves, ce qui suppose de faire de l'école à la fois le lieu des apprentissages, le terrain de l'insertion des jeunes et le support de l'action culturelle, de la formation continue et de l'éducation populaire en direction des familles, sous toutes leurs formes. La Télévision Scolaire de la Nouvelle Calédonie avait été un outil de documentation, de formation, de réflexion et de communication essentiel, avec son émission-phare "Accent Tonique", qui a résisté à l'usure du temps et qui a porté vaillamment le message de l'école un peu partout dans le territoire et même au delà. Naturellement, il n'est pas indispensable d'avoir une télévision scolaire, mais il est nécessaire d'établir, selon des modalités à inventer, un contact non didactique - car il ne s'agissait pas du tout de faire la classe à l'antenne - entre le monde de l'école et le grand public, dont font partie les familles des élèves, souvent déconcertées ou démotivées par l'institution scolaire.
5 - Il faut penser également, dans un contexte insulaire, à l'ouverture du système éducatif vers l'extérieur. C'est un élément d'équilibre et de mobilisation indispensable. Mettre en commun avec d'autres systèmes, différents mais présentant des analogies, est un moyen de se situer, d'interpréter ses propres difficultés et ses propres ressources, de sortir de soi. En matière d'éducation, coopérer consiste d'abord à échanger ce qu'on n'a pas, ce que l'on cherche, c'est-à-dire l'essentiel. Une coopération régionale active est dans le domaine éducatif un atout majeur pour l'élucidation de soi et pour la construction de l'avenir.
6 - Enfin, l'expérience nous apprend que tout aménagement d'un système scolaire s'appuyant sur des spécificités linguistiques et culturelles rencontre presque inévitablement une difficulté qui n'est pas celle qu'on attendait. Cette difficulté ne concerne pas du tout les méthodes d'enseignement. Les méthodes ont certes leur importance, mais on leur consacre souvent trop d'énergie. Des méthodes, il en faut, mais on en trouve toujours, ce n'est pas ce qui manque. Si la réussite des systèmes scolaires allait de pair avec le nombre et la subtilité des méthodes créées par les pédagogues, l'école serait partout triomphante. Il n'est donc sans doute pas aussi utile qu'on le croit de leur consacrer des expérimentations souvent interminables, qui se font généralement au détriment de la mise sous tension du système. Ce n'est pas aux méthodes en tant que telles que tient la vraie difficulté, mais à l'adaptation des contenus d'enseignement, c'est-à-dire au choix, parmi les éléments des cultures locales, des savoirs à faire acquérir par les élèves, auxquels on décide de donner le statut de savoir scolaire.
Car tout savoir n'est pas susceptible d'être un savoir scolaire. Un savoir scolaire est un savoir qui ne vaut pas seulement par sa possession mais par les effets éducatifs de son acquisition et par la "valeur ajoutée" qu'il apporte en augmentant la capacité d'en acquérir d'autres. C'est un savoir qui, loin d'être le simple résultat de l'apprentissage, est en lui-même formateur, un savoir dont la fonction éducative dépasse de beaucoup le contenu intellectuel ou pratique. C'est un savoir dont nous nous instruisons et qui en même temps nous instruit. Et c'est aussi un savoir qui est porteur d'une cohérence avec d'autres savoirs : la culture scolaire n'est pas faite d'éléments qui s'additionnent, elle est un ensemble structuré et structurant. Or, ce ne sont pas n'importe quels savoirs qui ont de telles vertus. Le choix de ce qu'il faut apprendre a donc quelque chose d'essentiel car rien ne serait pire, sous le prétexte de parler aux élèves de ce qui leur est familier, que de dispenser à l'école des connaissances qui aboutiraient à cette espèce d'ignorance informée qui sévit partout à l'ère de la communication. En ce sens, tout l'enjeu de l'éducation interculturelle est la capacité de concilier l'identité des élèves et l'universalité des savoirs. Le premier travail est donc la mise au point et l'écriture de programmes adaptés. Les modalités de ce travail peuvent être analogues à celles de la rédaction des instructions pédagogiques déjà évoquées et il y a, en préalable, une importante tâche d'inventaire et de recherche à conduire.
Bilinguisme et modernité : le double défi
Il ne faut pas oublier que l'école se doit d'assurer, aujourd'hui plus que jamais, deux fonctions qui peuvent sembler opposées : l'une de transmission - des savoirs, des valeurs morales et civiques - l'autre de promotion de la modernité et de préparation du futur. D'un côté, il faut transmettre une tradition, une culture, un ensemble cohérent de connaissances, de comportements et de repères, sans lesquels il n'y a pas d'éducation véritable. D'un autre côté, il faut faire place aux exigences nouvelles qu'entraîne l'évolution rapide et irréversible des conditions d'accès au savoir. C'est donc une école de la modernité qu'il faut construire sur l'enracinement dans la tradition que représentent les langues et cultures locales. La
"révolution numérique", l'impact du multimédia sur la didactique et sur les pratiques scolaires, le rôle des outils télématiques dans l'échange et l'appropriation des connaissances modifient, selon un processus inexorable qui s'accélère irrésistiblement et à l'échelle mondiale, non seulement le contexte et les moyens des apprentissages mais l'activité scolaire dans son ensemble. La place faite à la tradition vivante ne doit donc pas être le début de la construction de l'école d'hier, au nom d'une espèce de nostalgie de ce qui n'a pas été, mais au contraire, si on autorise ce pléonasme, d'une école de demain. Et c'est un plan global, comportant aide à la scolarité, modernisation de l'école et diffusion des nouvelles technologies, qui permettrait d'atteindre des résultats significatifs en matière à la fois d'action éducative, de diffusion culturelle, d'animation et d'insertion.
Ce serait une chance historique de l'école mahoraise de se construire en relevant en même temps le défi du bilinguisme et de l'interculturalité et celui de la modernité. Et on peut l'en croire capable, parce que l'école réussit toujours lorsqu'on ne l'enferme pas dans sa dimension institutionnelle et qu'on lui permet d'affronter la réalité du monde.
Marketing et action sociale, la question éthique. Intervention à la Journée "Marketing et action sociale", IRTS de la Réunion, 9 novembre 2014.
Je suis très honoré d'intervenir une fois encore à l'I.R.T.S, après la conférence et le débat sur le thème de l'altérité à l'occasion du dixième anniversaire et après les journées de formation que j'avais assurées l'an dernier sur "éthique et responsabilité du directeur d'établissement". Je ne me doutais pas, alors, de ce que ce titre avait de prophétique par rapport au thème d'aujourd'hui, dont nous sentons tous ce qu'il a de terriblement actuel [1].
Je me réjouis d'autant plus de tenir de nouveau parmi vous pendant un moment le rôle de philosophe de service[2]. Philosopher, c'est entreprendre une élucidation du fonctionnement des choses, c'est essayer de trouver un sens aux désordres du monde et c'est mettre en uvre, pour y parvenir, un certain "art de former, d'inventer et de fabriquer des concepts", selon la définition que Gilles Deleuze donnait de la philosophie [3]. Je n'aurai donc pas de mal à entrer dans le sujet qui m'est confié, puisque que la difficulté de financer l'action sociale est bien en un certain sens, un désordre du monde - et même un double désordre au sein de la cité, dans la mesure où c'est un désordre qui affecte un processus, l'action sociale, qui est lui-même par nature déjà destiné traiter des désordres sociétaux et qui est à ce titre un strict devoir de l'État.
Autant vous le dire d'emblée, j'ai bien eu conscience dès le moment où on m'a proposé cette intervention, puis un peu plus en lisant le programme, puis encore bien davantage en assistant à la séance de ce matin que ma tâche allait être - comment dire - de venir une fois de plus devant vous pour trouver des problèmes à vos solutions. Je vais essayer en tout cas vous proposer un appareil conceptuel qui, je l'espère, pourra être utile à votre propre questionnement et je vais partir de ce que je suppose être votre attente, telle du moins que l'expriment la notice de présentation de cette journée et le titre qui lui a été donné.
Je vois bien - et vous voyez aussi - que dans la formulation Marketing et action sociale, le et n'est pas une simple conjonction grammaticale. Il ne traduit évidemment pas l'addition d'une chose à une autre, comme quand on dit fromage et dessert ou scénario et dialogues. Ce et a au contraire une fonction majeure d'interface, une fonction qui d'ailleurs est très souvent la sienne dans la démarche philosophique dans des couples de notions très problématiques, comme l'être et le néant ou l'âme et le corps, l'importance des enjeux et des contenus étant mise à part. Entre le marketing et l'action sociale, il existe une quantité de liens possibles, qui interfèrent, qui s'entrecroisent et qui forment un tissu à trame complexe.
Nous voyons bien que la relation exprimée par notre titre est dissymétrique : marketing et action sociale semble mettre sur le même plan une stratégie et un champ d'action, qui sont donc de nature différente. C'est pourquoi la juxtaposition des deux mots crée un étonnement, puis installe un doute, et même, si on insiste, peut provoquer une sorte de malaise. On voit bien que la formule a tout l'air d'un oxymore, comme quand on dit aigre-doux, ou silence étourdissant ou bien, "l'obscure clarté qui tombe des étoiles" [4], comme il est dit dans Le Cid de Corneille. Marketing et action sociale résonne comme un affrontement entre deux mondes, celui de la marchandisation et celui de ce qui apparaît comme non marchandisable, c'est-à-dire de tout ce qui doit être protégé au titre de valeurs indépassables de liberté, de dignité et d'autonomie qui définissent la sphère idéale de l'humain [5].
Ce refus de rattacher l'action sociale à un système avec lequel elle nous semble a priori incompatible sur un plan moral, je ne l'invente pas, je ne le tire pas de quelque conviction philosophique qu'on pourrait juger idéaliste par opposition à la dureté du monde réel, je le lis tout simplement dans la notice "40 ans de l'ADC, Marketing et action sociale". Ce texte est très bien écrit et très éclairant et il est aussi palpitant - et même haletant.
Dès le début, on est dans l'univers économique : il est question de contraintes budgétaires, de raréfaction des fonds publics rendant nécessaire un auto-financement d'un nouveau type. Et c'est au détour du 4ème paragraphe que surgit la question. Je la résume ainsi : l'agir social n'étant pas réductible à l'agir économique, ces stratégies qu'on va devoir mettre en uvre ne remettent-elles pas en cause les pratiques et même l'éthique du secteur social ? Alors, aussitôt, tout se précipite. Le paragraphe 5, faisant arrière toute, répond en substance : c'est à craindre et pourtant il va bien falloir. Oui, il va bien falloir, reprend le paragraphe 6 dans un élan un peu désespéré, mais va-t-on seulement pouvoir, avec tous les "freins" qui font obstacle, la nostalgie, le tabou de l'argent, la fidélité à son identité et à ses valeurs ? Vous aurez noté qu'avec ces derniers mots apparaissent paradoxalement comme des obstacles les fondements même de l'action que vous avez à mener, ceux qui lui donnent tout son sens. En fait, la véritable question qui est posée - et qui est tout à fait lancinante - c'est celle de savoir si on peut éviter l'inévitable. Et cette question qui est centrale au cur de ce texte si mouvementé, le dernier paragraphe va l'inverser en affirmation, mettant subitement un terme au débat, avec l'idée qu'il est plus prudent de se préparer, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Cette notice d'introduction au marketing semble déjà inspirée par lui et elle en montre par avance toute la puissance.
Comme je vous le disais en commençant, la question éthique que j'ai à aborder a bien été d'une certaine façon déjà tranchée par l'application d'un principe de réalité et l'organisation de cette journée en est la preuve. Est-il bien utile, alors, d'y revenir ? Faut-il, à l'heure de la concurrence et de la productivité, dans un monde gouverné par le profit, investir dans le commentaire moral après-coup ? Faut-il laisser le souci éthique ralentir la glorieuse marche en avant du souci économique et budgétaire ? La réponse est oui, parce que l'éthique n'est pas une simple composante dans les choix qui à un moment donné se présentent à nous, encore moins un ornement qui donnerait à nos actes une plus belle apparence. Elle est une faculté permanente de mise en cause de ce que nous faisons, un droit inaliénable de refus de ce qu'on nous dit de faire, un pouvoir infini d'interpellation du monde au nom de la moralité.
Mais éthique est à présent un mot tellement utilisé qu'on finit par ne plus penser à ce qu'il permet de nommer. Il faut donc s'y arrêter un instant. Le terme évoque à la fois l'antiquité et la modernité. Avec son origine grecque et son succès actuel, l'éthique, comme dit Badiou [6], fait penser à "une vieille fille résignée qui devient sans comprendre pourquoi la coqueluche d'un salon". Car l'éthique est aussi un questionnement à la mode, elle est omniprésente et triomphante. D'ailleurs, l'essor de l'éthique accompagne souvent les périodes de crise ou de déclin. Comme le disait naguère Jean François Revel, "il faut faire circuler le plus possible les denrées qui se raréfient". De fait, une sorte de prolifération normative déferle actuellement sur nous sous le nom d'éthique : pour les évènements du monde, il y a une éthique des droits de l'homme, pour les rapports sociaux une éthique du vivre ensemble, pour les médias une éthique de la communication, pour le cadre de vie une éthique de l'environnement, pour l'univers envahissant du profit une éthique des affaires, etc. L'éthique, c'est comme le respect dans certains quartiers : on l'invoque à proportion de son absence. On a le sentiment que l'éthique sert surtout à panser les plaies en rappelant la dimension morale des choses, mais une fois qu'on a laissé la considération des moyens et des bénéfices s'exercer librement. Dans un monde où tout a surtout un prix, qui importe plus que la valeur - pour reprendre la grande distinction rappelée par Kant au siècle des Lumières - on en appelle à l'éthique à titre de supplément d'âme, mais une fois que les décisions ont été prises.
Précisons maintenant en quelques mots le statut et la fonction de trois notions dont nous allons avoir besoin : la morale, l'éthique et la déontologie. D'abord la morale. Il y a une région du permis et du défendu, un ensemble de principes, de normes, d'idéaux, de valeurs - solidarité, justice, égalité, etc. - sur lesquels il peut y avoir débat, mais auxquels globalement nous nous sentons liés par un sentiment d'obligation. C'est la morale, c'est ce que Paul Ricur a appelé d'une magnifique formule le "royaume des normes". La morale est un réservoir normatif, elle contient tout le matériel qui doit permettre de répondre de façon impérative et théorique à la question que faire, que préférer, "tout ce qui, dans l'ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs" [7]. Voilà le royaume des normes.
L'éthique, à présent. C'est comme chacun sait l'éthique médicale qui est tenue, et à juste titre, pour la première des éthiques. D'une certaine façon, elle en est le modèle absolu. Elle a surgi avec le Serment d'Hippocrate, au IVème siècle avant J.-C. et vous allez comprendre aisément pourquoi je vous en parle. Dans un monde antique où on avortait allègrement, où on exposait et même où on tuait les enfants non voulus ou mal formés, où on se suicidait beaucoup - le suicide était même très en honneur en Grèce ancienne et à Rome - ce texte, le Serment, vient proclamer tout-à-coup le principe intangible du respect de la vie, complète-ment à contre-courant de la réalité et des pratiques du temps, et c'est cela qui nous intéresse : avec le Serment, on voit naître l'éthique comme refus, comme rupture. Regardons de plus près ce qui se passe alors : pour la première fois en Occident a lieu la transformation d'une pratique en une activité authentique par son inscription dans un espace qui est défini non plus par des objectifs ou par des techniques, mais par des valeurs. On sait depuis lors qu'il faut prendre garde à ne jamais faire l'inverse, à ne jamais renoncer à l'encadrement par des valeurs au profit d'un retour cynique à l'encadrement par des objectifs ou à la régulation par les situations de fait. Ce n'est pas parce qu'une situation, économique par exemple, s'impose à nous d'une manière ou d'une autre que l'éthique se doit de l'accepter, de l'approuver et encore moins de la justifier. Songeons un instant à tout ce qui dans l'histoire du monde a semblé incontournable avant d'être ensuite balayé grâce au refus obstiné et à la résistance des hommes au nom d'une vérité plus haute[8].
Car justement la fonction de l'éthique est fondamentalement la mise en cause d'un pou-voir ou d'un état de fait et son interpellation au nom de valeurs qu'on juge à un moment donné supérieures. L'éthique repose sur l'idée que le possible ne s'identifie pas nécessaire-ment au souhaitable et qu'il existe une grande différence entre être en mesure de faire telle ou telle chose - par exemple introduire le marketing dans l'action sociale - et accepter d'en répondre, d'en prendre la responsabilité, d'en défendre jusqu'au bout le principe. L'éthique est une interpellation du possible au nom du royaume des normes. Elle permet de répondre à la question comment agir, comment vivre, mais de manière fractionnée, éparpillée dans les situations que nous rencontrons. Elle n'apporte pas une réponse valable à tout jamais, transfé-rable ou généralisable, même si une sorte de jurisprudence éthique peut à terme s'établir et parfois s'intégrer au système normatif de la morale. Les questions rebondiront, elles se poseront autrement dans d'autres situations singulières. Par nature l'éthique se trouve perpé-tuellement à la jonction des principes et du réel. Elle est un mouvement d'articulation entre un système de valeurs (le royaume des normes) et des données particulières de l'action [9]. Et c'est ce qui fait qu'elle est toujours une attitude de questionnement, qu'elle ne se réduit jamais à un ensemble de prescriptions arrêtées d'avance - et encore moins à des prescriptions qui découleraient non pas du royaume des normes mais d'une soi-disant nécessité économique.
La déontologie, enfin. On confond souvent déontologie et éthique, et je dirais même qu'on les laisse confondre à dessein. Le faux mot grec déontologie n'est dans aucun dictionnaire de grec ancien. C'est une fabrication de circonstance, à partir de racines grecques, pour désigner ce qui doit ou ne doit pas être fait : le mot a été construit sur déon, ce qu'il faut ou contraire ce qu'il ne faut pas. Cette idée d'un logos du déon est due à Bentham au 19ème siècle - un anglais utilitariste et précurseur du libéralisme - et elle a surtout pour fonction d'entretenir l'illusion que la déontologie et l'éthique ont la même origine et en quelque sorte le même âge, le même poids et la même signification. Il n'en est rien, pourtant. Éthique et déontologie représentent au contraire, nous allons le voir, deux démarches non seulement différentes mais opposées [10].
Une déontologie est étroitement liée à une activité professionnelle. Elle est une liste des devoirs, positifs ou négatifs, rassemblés dans un code qui traite non pas des principes comme tels mais du permis, qu'elle délimite, du prescrit, qu'elle recommande, et du défendu, qu'elle condamne et promet à une sanction. En pratique, une déontologie est pour un métier donné un code de l'interdit et de l'obligatoire, les deux pôles qui dans le système de la modernité encadrent et enserrent la liberté, la prenant en tenaille et ne la tolérant que résiduelle [11]. Une déontologie est une sorte d'"éthique express", par laquelle on peut faire l'économie d'un véritable débat éthique. Au départ, c'est sur des valeurs morales universelles que sem-blent reposer, dans tous les codes de déontologie, les obligations et les interdictions qui sont faites aux professionnels : elles sont toujours définies par référence à des idéaux d'honnêteté, d'honneur, de loyauté, de respect.
Mais les règles de la déontologie sont en réalité de nature juridique plutôt que morale. Alors que l'éthique est questionnement, réflexion, usage critique de la raison, quand ce n'est pas subversion, comme nous l'avons entrevu, la déontologie est un code fixe pour des situations définies, un système de valeurs déjà arrêtées, une source a priori d'injonctions. Je prendrai à titre comparatif, un exemple auquel j'ai recours une fois de plus parce qu'il est extérieur au domaine l'action sociale. Je l'ai relevé dans un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une banque belge, une caisse de crédit pour être plus précis. Écoutez bien : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des employés et bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse" [12]. Ce texte donne à penser et il permet de faire en quelques mots un magnifique voyage. Avec le début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le "royaume des normes". Avec la suite et l'évocation de la bonne foi, on aperçoit peut-être encore, en passant rapidement, le vaste champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a complètement changé de monde, on est entré dans la pure déontologie financière, dans la logique sans pitié du profit. Je vous laisse appliquer ce schéma à vos champs de compétence [13].
On voit bien ici la délimitation, la ligne de fracture. Lorsqu'il y a des hésitations sur les choix à faire pour respecter la déontologie, lorsque s'engage un débat, lorsqu'apparaît une interrogation sur les valeurs ou sur la mise en uvre de normes à portée universelle, on entre dans la sphère de l'éthique. Se demander au nom de valeurs plus hautes si on doit se soumettre à telle ou telle prescription de la déontologie, c'est entrer dans l'éthique. C'est ce que fera par exemple un employé de banque en se demandant si par humanité, il ne doit pas prolonger le découvert d'un client père de famille au bord de la ruine, même si cette décision ne va pas dans l'intérêt de la banque qu'il a juré de défendre et n'est donc pas conforme à la règle déontologique qui en principe s'impose à lui. L'éthique va être son pilote.
Maintenant que nous sommes munis des instruments et des catégories ad hoc, nous pouvons nous poser la question éthique : à savoir quel est le pilotage approprié à la relation du marketing et de l'action sociale, quelle attitude il convient de tenir, en fonction du degré d'implication et de responsabilité de chacun dans la chaîne de décisions. De cette interrogation, rappelons d'abord le contexte et la signification. Les situations du travail social sont des situations éthiques par excellence, non seulement parce que plus que d'autres elles doivent respecter des règles ou en forger, mais parce qu'elles s'inscrivent dans la perspective de fragilité, de vulnérabilité, d'incertitude de ceux auxquels elles s'adressent, qui font à des degrés divers mais toujours plus intensément que la moyenne l'expérience de la dépossession de soi et de la finitude. Ces situations sont éthiques aussi parce qu'elles sont complexes : si elles étaient simples, elles pourraient relever de la seule rectitude du "royaume des normes" ou de l'application automatique des règles de la déontologie. Cette complexité est liée aux modalités infiniment diverses des interventions en matière sociale : aide, assistance, accompagnement, protection, écoute, soin, prévention, tutelle, accueil, éducation, rééducation, insertion, réinsertion, etc.
Le travail social est de toute évidence partie intégrante de la politique de la cité, il en est le cur. Il a à prendre en charge les effets pervers que toute société engendre ou subit en termes d'inégalités ou de difficultés, même si elles sont aussi le fait des individus, même si elles résultent simplement, pour certains, d'un destin contraire. Si on emprunte au royaume des normes les valeurs de référence que sont l'égalité, la solidarité et la justice, on est évidemment conduit à dire que c'est sans aucun doute possible à la cité elle-même de prendre en charge ceux qui à un titre ou à un autre ont besoin de l'action sociale. Cette action ne peut en rien dépendre d'intérêts privés ou du bon vouloir apparent mais invérifiable sur le plan moral du monde de l'entreprise, même si ce monde dans le système hyper-libéral dont les médias distillent à chaque minute les irremplaçables bienfaits, est présenté systématiquement comme devant nous apporter le salut et s'il appuie impudiquement sur cette présentation vaniteuse de lui-même pour en faire une publicité afin d'augmenter ses profits.
En fait, il me semble qu'il existe deux grands types d'objection à soulever contre l'idée de recourir au financement privé de l'action sociale, du moins quand il n'est pas simplement complémentaire, quand il cesse d'être à la marge, comme l'ont été à travers l'histoire le mécénat ou les systèmes de commandite.
La première objection tient à la subordination à l'intérêt général dans laquelle la politique a le devoir de tenir le monde économique. C'est d'ailleurs le principe de l'impôt. Mais Platon, déjà, avait montré dans Le Politique et dans la République que l'économie joue toujours un rôle ambivalent, qui est source de risque. D'un côté l'activité économique est l'origine et le point de départ de la cité. Car c'est bien "la nécessité de subvenir à leurs appétits matériels qui pousse les hommes à s'associer". Mais si ensuite le politique ne maîtrise pas l'économie, si la république ne fait pas régner l'ordre dans la multiplication de ces appétits, si elle ne maintient pas un équilibre suffisant dans la communauté d'intérêts sur laquelle elle repose et laisse ceux qui en tirent profit la conduire à leur guise, elle se détruit elle-même. Car du fait que l'activité économique est à l'origine de la cité, "les agents économiques vont finir par prétendre qu'elle la constitue tout entière", ils veulent tout accaparer. Alors, cette économie qui, nous l'avons vu, a fait la cité, va peu à peu la défaire [14]. Notons au passage que c'est aussi le cur du mythe platonicien de l'Atlantide, ce continent englouti ruiné par sa richesse.
La seconde objection - qu'on peut emprunter également au royaume des normes - tient à la qualification éthique de l'aide qui est apportée par ceux, quels qu'ils soient, à qui on va demander d'assurer un financement à visée sociale. Kant a démontré une fois pour toutes que ce n'est pas ce que je veux atteindre qui fait la valeur morale de mon acte, mais la raison pour laquelle je veux l'atteindre. Il prend même - et cela ne surprendra personne - son principal exemple dans l'activité commerciale. Un marchand honnête, dit Kant, a un comportement moral s'il est honnête par devoir, mais en revanche cette honnêteté est purement apparente, et elle est sans valeur morale si, en se montrant honnête, le marchand veut principalement conserver ou accroître sa clientèle, c'est-à-dire agit par intérêt. "Le devoir, c'est d'accomplir une action par respect pour la loi morale" [15]. Il n'y a rien de moral, ni de solidaire, ni de juste dans tout ce qui, à un titre ou un autre, est fondamentalement une ruse commerciale et a principalement une visée intéressée [16]. Le retour de l'action sociale à la charité ne peut certainement pas être présenté comme un progrès, et Michel Foucault, qui a écrit une véritable archéologie des pratiques charitables depuis le XVIème siècle a bien montré que les pratiques de charité sociale sont le plus souvent, en réalité, des actes visant le maintien de l'ordre établi la protection des intérêts économiques en place, voire la répression des initiatives sociales.
On voit ici comment l'éthique est un véritable moment de vérité des valeurs, celui de la vérification de leur authenticité et surtout celui de la dénonciation de cette espèce d'union discrète et hypocrite de la morale et de l'intérêt qui est au centre de la plupart des déontolo-gies professionnelles mais aussi de la quasi totalité des messages publicitaires. Pour compléter la lecture du règlement de la banque belge, je vais citer pour changer de champ d'activité et de pays, deux préceptes du président de la société italienne Olivetti, Bruno Lamborghini : "le défi pour l'entreprise est de veiller à servir d'exemple", dit le premier dont la teneur morale paraît irréprochable. Mais voici le second qui lui fait suite et qui nous révèle la vraie nature du premier : "une bonne conduite est la condition d'une expansion continue". Entre les deux sphères, celle des valeurs non-marchandes et celle des valeurs marchandes, passe une frontière dont l'éthique ne peut pas approuver le franchissement parce qu'il est en réalité, au plan moral, une transgression [17].
Mais attention, nous nous sommes ici au niveau des principes : c'est le choix d'un type de société et d'un système politique et économique qui est en cause lorsque les fonds publics de l'action sociale viennent à manquer au point qu'il faut rechercher des fonds privés. Et c'est seulement en tant que citoyen qu'on peut le refuser ou l'accepter - enfin, du moins tant que la démocratie en donne le droit, tant qu'une force mondialisée, auto-désignée et anonyme, n'imposera pas le pouvoir absolu de la politique du chiffre, la loi de la concurrence sans limite de tous contre tous et une société si entièrement normalisée que le mot social aura bientôt plus de sens dans plan social que dans action sociale. Pour le moment on voit bien, dans le monde gagné par l'idéologie hyper-libérale et l'anglomanie béate qui l'accompagne, l'admiration que suscite la réduction à presque rien des budgets des États, qui entraîne évidemment à terme la privatisation de tout, et évidemment en priorité du financement de l'action sociale. Je vous renvoie aux articles admiratifs que les plus grands journaux (y compris français) se sont empressés de consacrer le 20 octobre dernier aux décisions annoncées à Londres par l'Office anglais de responsabilité budgétaire - l'appellation est déjà tout un programme : il s'agit de la suppression par la Grande Bretagne de près d'un demi-million d'emplois publics dans les deux ans, des colossales coupes sombres dans les dépenses publiques, de l'arrêt du gaspillage (je cite le mot qui a été employé), c'est-à-dire de milliards en moins pour les budgets sociaux qui servent jusqu'ici à payer les allocations chômage, les allocations logement et les aides aux handicapés.
Dans un monde où le signe de la vertu économique est la plus grande réduction possible des dépenses de l'État, où on essaie de faire entrer dans le royaume des normes comme nouvelle valeur suprême la compétitivité [18], il ne serait pas du tout étonnant que la démarche marketing devienne un ressort essentiel de l'action sociale et qu'elle soit inscrite dans la déontologie de base des directeurs d'établissements. Ce sera évidemment un devoir d'assurer l'action sociale dans ces nouvelles conditions. Mais aux responsables que vous êtes, il reviendra malgré tout un deuxième niveau de questionnement éthique. Le service à rendre au monde de l'exclusion, du handicap, de la dépendance, de la délinquance, la création du lien social, aussi - pour utiliser cette autre grande trouvaille du lexique hyper-libéral - tout cela est l'objet de votre tâche et donc votre souci éthique au jour le jour. Si vient à se produire, comme c'est probable, une évolution conduisant à une "fonction commerciale du directeur", comme le suggère le programme de cet après-midi, l'éthique y trouvera, bien entendu, un champ d'action supplémentaire.
Car le marketing lui-même relève, tout autant qu'une autre technique, d'une exigence éthique, et même d'un contrôle par l'éthique. Là comme ailleurs, la ligne à ne pas franchir et que l'éthique permet justement de tracer, c'est celle qui passe entre vendre et se vendre. Il vous faudra en somme débusquer tout ce qui dans les moyens mis en uvre grâce au marketing pourrait faire oublier ou négliger ou renier les fins poursuivies à titre social. Il vous faudra sans doute négocier avec un monde intéressé pour pouvoir mener avec l'aide qu'il apportera une action dont la grandeur est de rester désintéressée. Voilà qui ne s'annonce pas facile. Mais comme vous le savez, Freud a déjà expliqué que soigner, éduquer et gouverner - c'est-à-dire au fond tout ce qu'à divers titres vous ne cessez de faire - sont ce qu'il appelle les trois métiers impossibles. La possible aggravation des conditions de l'exercice de ces métiers montre bien que la soi-disant crise dont on nous parle sans cesse n'est pas du tout un moment limité du temps mais le signe d'un dérèglement durable et sans cesse aggravé du monde et la trame même de la modernité [19], une modernité que la culture du marketing, en un sens, aidera peut-être à affronter.
Notes :
[1] Sans doute parce que survenant en temps de crise, mais le mot crise, au-delà du contenu spécifique tel qu'il est analysé par les économistes, exerce une fonction surtout rhétorique : il permet de présenter comme réversible un état de ralentissement ou de panne qui est en réalité une modalité chronique de l'organisation des échanges, de l'état des sociétés et d'une concep-tion jamais remise en cause de la façon dont doit aller le monde. C'est ce qu'on avoue lorsqu'on parle de crise structurelle, expression qui au sens strict des termes a autant de sens que cercle carré.
[2] Raphaël Enthoven [2] dans un essai qui porte ce titre parle de ce philosophe comme de celui qui anime la "pause-concept" ou l'"instant prise de tête" et qui de studio de radio en colloque et en plateau de télé, devient "celui qu'on regarde sans le voir, qu'on entend sans l'écouter, qu'on invente quand on l'invite, et qui s'éteint quand la lumière s'en va".
[3] G. Deleuze, F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991.
[4] Corneille, Le Cid, Acte IV, scène 3.
[5] La preuve en est que nous serions aussi heurtés, que nous ressentirions le même genre scrupule de conscience si à la place de marchandisation de l'action sociale nous entendions le mot ou la notion exactement inverse, qui est la collectivisation
[6] A. Badiou, L'éthique. Essai sur la conscience du mal, Paris, Nous, 2003, p. 15 sq.
[7] Sur l'exposé de l'éthique de P. Ricur, cf. Soi-même comme un autre, Paris, éd. du Seuil, 1996, texte repris et modifié dans l'article "éthique" du Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, pp. 689-694.
[8] En tout cas, après le Serment d'Hippocrate, l'éthique et à sa suite la déontologie ont été pour longtemps des modes de pensée et des systèmes de référence inséparables de la pratique de la médecine, dans laquelle elles ont trouvé leur origine et qu'elles ont fini par symboliser. Mais il semble y avoir désormais autant de déontologies, réelles ou prétendues, qu'il y a de corps de métiers. Brandir l'existence d'un système déontologique fait maintenant partie intégrante du discours publicitaire : dire déontologie, c'est faire la promotion de l'activité concernée
[9] En fait l'éthique, comme dit encore Ricur, vient "se briser en deux sur la morale", dont elle forme à la fois l'aval et l'amont. Il y a d'un côté, en amont des normes, une éthique antérieure, qui s'intéresse aux fondements de l'action, qui s'interroge sur les notions et sur les principes. Puis il y a, de l'autre côté, en aval des normes, une éthique postérieure dont la visée est d'insérer ces "normes dans des situations concrètes" : elle joue le rôle d'une "sagesse pratique", elle permet de discerner, en termes aristotéliciens, "la droite règle (l'orthos logos) dans les circonstances difficiles de l'action".
[10] Ce point est important car il porte en lui le ressort profond de la démarche éthique. Car on peut être tenté de dire : la déontologie est une dépendance de la morale et de l'éthique. Oui, elle l'est, mais elle l'est seulement au sens où s'il n'y avait pas de morale ou d'éthique, la déontologie n'existerait pas non plus.
[11] De la même façon, les "recommandations de bonne pratique", formule de plus en plus utilisée, anticipent sur la réflexion éthique au point de la remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel. Mais là encore, il est sans doute bon que de telles recommandations existent, pour le cas où l'éthique serait absente ou défaillante.
[12] Extrait du manuel "Administration de l'établissement" d'une Caisse de crédit de Belgique, section 2000, p. 2-2.
[13] De la même façon, les "recommandations de bonne pratique", formule de plus en plus utilisée, anticipent sur la réflexion éthique au point de la remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel. Mais sans doute est-il bon que de telles recommandations existent, pour le cas où l'éthique serait absente ou défaillante. Quoi qu'il en soit, elles ne la remplacent pas.
[14] On se reportera sur la création par Platon de l'économie politique et d'une philosophie de l'économie à l'étude d'Etienne Helmer, La part du bronze, Platon et l'économie, Paris, Vrin, 2010.
[15] Kant, Fondements de la métaphysique des murs, Delagrave, Paris, 1943, p. 100. Il s'agit évidemment de la loi morale.
[16] Même principe dans l'Évangile de Matthieu, 6, 2-4 : "Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites [
] afin d'être glorifiés par les hommes [
]. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra".
[17] Sur les préceptes attribués à B. Lamborghini, cf. "Leading from the Front", OECD Observer Preview, déc. 2000, p. 1.
[18] Sur "la compétitivité, un mythe", comme credo de l'Europe et "nouveau Graal", cf. l'article de Gilles Ardinat dans le Monde diplomatique d'octobre 2012, pp. 1 et 22.
[19] Cf. Amin Maalouf, Le dérèglement du monde, Grasset, Paris, 2009.
Approche philosophique de la complexité en situation de soin. Communication à la Deuxième Journée de Soins Palliatifs de l'Océan Indien, La Réunion, 2011
Comme il convient à un philosophe - ou en tout cas à quelqu'un qui s'efforce de l'être - au moment de prendre la parole, je pense aux raisons qui font que vous me la donnez. Et je m'inquiète, car soigner appartient au règne de l'action, qui a priori ne fait guère de place à l'exercice philosophique. Mais en même temps, deux choses viennent me rassurer un peu sur le risque que je prends. La première est qu'à présent on fait appel aux philosophes dans tous les domaines, chaque fois qu'il s'agit de trouver un sens aux difficultés du quotidien, à la dureté du vécu et aux désordres du monde. La modernité semble avoir repris et renouvelé à sa manière le statut du philosophe en Grèce ancienne, sa fonction originelle d'opérateur intellectuel de la cité. Second point, plus encourageant encore : la médecine - incluant au départ l'art du soin, qui s'en est différencié très tardivement - et la philosophie ont été à leurs débuts, également en Grèce ancienne, deux surs, intimes et rivales, et même plus parentes encore que des surs, puisque nées ensemble mais aussi à bien des égards nées l'une de l'autre. Et cette parenté qui s'est maintenue sous différentes formes à travers le temps favorise toujours la réflexion commune des philosophes et des professionnels de la santé.
Pourtant, en voyant le titre donné à cette journée, je m'interroge sur le rôle qui peut être le mien dans une problématique, celle du soin, dont vous possédez, en raison de votre expérience et de vos compétences, tous les éléments constitutifs d'un savoir, alors que j'en suis par rapport à vous démuni et privé. De vous à moi, j'espère faire de grands progrès d'ici ce soir. Mais après tout c'est une situation habituelle pour le philosophe d'avoir à donner, paradoxalement, des avis à plus savant que lui. C'est, dès l'origine de la philosophie, la situation de Socrate et chacun sait que c'est en proclamant sans cesse son ignorance que Socrate s'affirme philosophe. Il ne dit jamais ce qui est vrai ou ce qu'il faut savoir, il dit ce qu'on peut faire pour parvenir à la découverte de ce qui est vrai et pour édifier tel ou tel savoir dont on vient à éprouver le manque, par suite généralement d'une défaillance du savoir qu'on croyait jusque là posséder. Car les interlocuteurs de Socrate doivent apprendre dans un premier temps à se défaire de leur savoir antérieur - ou de ce qu'ils croyaient en être un - pour en établir un autre à partir d'une démarche qui est éminemment philosophique et qui est la construction de concepts. C'est la définition que Gilles Deleuze donnait de la philosophie : elle est, disait-il, "l'art d'inventer, de fabriquer et d'utiliser des concepts". Et c'est bien un travail du concept que nous allons tenter et auquel je vais contribuer de mon mieux en proposant quelques concepts à votre expérience, à charge pour vous de les activer, comme on dit à présent, de leur imprimer votre lecture de soignants, de les articuler pour rationaliser ce que vous voulez vous donner à penser à travers eux, car les concepts, disait aussi Deleuze d'une belle formule, "ne nous attendent pas tout faits comme des corps célestes".
Je commence cette avance sur concept que sera mon exposé par la complexité. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui est déjà dit et très bien dit de la notion de complexité dans l'"édito" qui figure sur le programme de notre journée. On y trouve, après la formule "En soins palliatifs, la complexité concerne entre autres
", une énumération très éclairante que nous pourrions expliciter et commenter, et sans doute le ferez-vous dans la courant de la journée : le patient, le système familial et culturel, la maladie, la multiplicité des intervenants, la confrontation à la mort. Mais pour le moment, je vous propose une autre voie qui nous situera un peu en surplomb. Il me semble qu'on peut partir de ce constat : le réel a toujours quelque chose de complexe si au lieu de se contenter de l'apercevoir, on le scrute. Ce qui m'amène à rappeler d'entrée que la complexité n'est pas du tout une notion moderne, même si les thèses d'Edgar Morin ont pris appui sur elle pour édifier une épistémologie de la science contemporaine. En réalité, la philosophie antique a déjà été une tentative éperdue pour mettre de l'ordre dans la confrontation entre ces éternels adversaires dans lesquels nous verrions aujourd'hui de la complexité et que les anciens appelaient l'un et le multiple, le changement et la permanence, l'écoulement et la stabilité, l'identité et l'altérité. Il y avait déjà là une tentative pour clarifier tout ce que la réalité a par nature d'inextricable. Et aujourd'hui encore, c'est une course folle qui s'engage si essaye de réduire à du simple la complexité qui est la trame des choses.
Pourquoi cette course est-elle folle ? Parce que, nous allons le voir, le simple et le complexe ne sont pas réellement des contraires et que si les deux notions se font face, elles ne sont pas pour autant symétriques. Par exemple, dans le titre donné à cette journée, on pose la question "peut-on faire simple ?", ce qui nous rappelle au passage que nous vivons dans un univers bipolaire avec deux valeurs dominantes, la simplicité étant le pôle positif - ce contre quoi s'est justement élevé Edgar Morin, estimant, je résume à l'extrême, que seul un regard complexe est capable d'embrasser une réalité complexe. Mais à la simplicité évoquée dans faire simple s'opposent deux ordres de réalité bien distincts, comme le montre très bien le corps de notre titre : "situations complexes, diversité des réponses". Que voulons-nous dire lorsque nous disons situations ? Les situations ne sont rien d'autre que les manières infiniment diverses dont, sous un certain angle et selon un certain regroupement dont l'esprit décide, les choses se présentent à nous (admirons le génie du langage dans cette expression trompeuse les choses se présentent à nous). Les situations sont des évènements emmêlés du monde que nous considérons comme formant un tout à un certain moment du déroulement d'une action. D'un côté, leur contenu est donc par définition composite, et il y a complexité, dans un tout premier sens du terme, dès qu'il y a présence d'une pluralité d'éléments perçus comme théoriquement dissociables même s'ils ne sont pas faciles à dissocier et s'ils sont interactifs. En ce sens-là, il est clair que la complexité est dans les choses, qu'elle réside hors de nous, qu'elle existe dans ce qui nous est donné comme monde. Une situation apparaît ainsi comme ce qui ne dépend pas de nous, selon la célèbre formule des Stoïciens. Si on reprend le modèle de définition que donnait Bergson dans sa célèbre formule "la limace, c'est ce qu'on écrase", on peut dire que "la situation, c'est ce qu'on affronte". De ce point de vue, ce qui marque la situation, et particulièrement la situation de soin, c'est qu'elle est une jonction, une convergence, une zone de contact entre ce que nous appelons des évènements et ce que nous appelons des actes. La complexité se dissimule souvent dans cette imbrication de ce qui se passe et de ce qui se décide, du voulu et du non voulu. On peut considérer que toute situation de soin présente, à des degrés divers, la complexité d'un problème qui empiète sur ses propres données, formule par laquelle Gabriel Marcel définissait le mystère.
Mais le titre de cette journée parle aussi de la diversité des réponses. Là, changement radical : nous nous trouvons cette fois dans la catégorie inverse, dans ce que les Stoïciens appelaient ce qui dépend de nous. Comme leur nom l'indique, puisque répondre c'est réagir à ce qui nous vient du monde, les réponses résultent de notre analyse des situations, des choix stratégiques que nous opérons, des modalités et de la qualité de l'action que nous conduisons. Les réponses sont des actes, non des évènements, même si elles interviennent suite à des évènements et si elles finissent par en générer. Elles montrent en tout cas que la complexité peut se trouver non plus dans les choses, mais dans la pensée et dans l'action, dans tout ce qui constitue notre retour sur les choses. Complexe ne veut plus dire alors réductible à des composants qu'il suffirait d'analyser jusqu'à obtention d'une multiplicité de simples, d'une sorte de paisible coexistence d'éléments. Dans ce second sens du terme, complexité ne signifie plus réductibilité au simple, mais exactement le contraire, c'est-à-dire irréductibilité. Elle est perceptible dans le fait que nous rencontrons à un moment donné une impossibilité de saisir les choses sans que l'organisation que nous inventons pour les classer ou les modifier se heurte à de l'imprévisible, à de l'obscurité, à de la discordance, sans qu'une partie de notre savoir en détruise une autre, sans que l'interaction des niveaux d'investigation vienne compromettre l'unité du discours que nous tenons. Sans doute cette résistance à la simplification et à la réduction est-elle reliée en partie à des propriétés des choses à connaître. Elle nous donne l'impression que nous sommes confrontés, comme dit Edgar Morin "au fouillis, à la solidarité des phénomènes entre eux, au brouillard"[2], caractéristiques de ce qu'il appelle le paradigme de complexité. Mais en pratique elle traduit surtout les incertitudes de la démarche intellectuelle, les limites de l'entendement et surtout cet obstacle essentiel au savoir que constitue l'inadéquation de la méthode à son objet. La complexité, en ce second sens, naît des insuffisances de la pensée, elle résulte de ce que l'esprit est naturellement simpliste. Observons que le mot simpliste a une charge négative : il exprime l'étrange retournement en son contraire du simple, qui est, lui, porteur d'une valeur positive, comme nous l'avons vu il y a un instant.
Sans doute faut-il maintenant tracer en deux mots la frontière qui sépare le complexe et le compliqué. Il y a là, en effet, une ligne de démarcation fondamentale. Le compliqué est ce que nous pouvons toujours décomposer et recomposer, simplifier et re-compliquer, comme un puzzle, jeu qui se fonde, justement, sur la métamorphose laborieuse du compliqué en simple : le puzzle est compliqué et déroutant quand il est démonté et il est simple et signifiant une fois monté. Je reprendrai le fameux exemple choisi par Michel Crozier du Boeing 747 et des 35.000 pièces dont il est composé[3]. Avec du temps et des moyens techniques et humains, on pourra toujours, si difficile que cela puisse être, parvenir à démonter et à remonter les 35000 pièces. Le compliqué, c'est ce dont nous pouvons toujours nous rendre maître en y consacrant l'énergie voulue, c'est ce que nous pouvons théoriquement ramener à du simple. En ce sens, le compliqué porte en lui l'espérance du simple. En revanche, le complexe se caractérise par l'impossibilité de garantir le succès de la simplification quels que soient les moyens qu'on est prêt à mettre en uvre. C'est cette fois l'exemple non moins célèbre des spaghetti que Michel Crozier oppose à celui du Boeing 747 : on n'a, dit-il, aucune chance, avec une fourchette et une cuillère, de parvenir à prendre deux fois de suite dans son assiette la même quantité de spaghetti et a fortiori d'en faire deux fois de suite une même bouchée. Une frontière radicale, équivalent de ce que les géographes appellent en hydrographie la ligne de partage des eaux, sépare donc le compliqué, par essence maîtrisable, et le complexe, qui comporte l'impossi-bilité en quelque sorte statutaire d'une rationalisation complète et qui induit donc d'emblée, au plan épistémologique, une désespérance. La complexité est en elle-même "une sorte de trou, de confusion, de difficulté"[4], dit Edgar Morin, et il ajoute qu'elle nous conduit à "penser dans des conditions dramatiques". Autrement dit, la pensée complexe implique l'accep-tation d'un savoir relatif, d'une méthode qui s'ajuste modestement aux choses, dans un dialogue entre la raison et le réel, d'une démarche qui permettra non de maîtriser la situation mais seulement de l'apprivoiser - ce qui par rapport à l'ambition scientifique d'explication et de transparence du monde est un objectif en repli et même, si nous pensons à l'idéal de Descartes de nous rendre "maîtres et possesseurs de la nature", une désillusion.
Voici venu le moment de croiser le concept de complexité avec celui de soin. En effet, l'intelligibilité est à chercher, presque toujours, non pas seulement dans tel ou tel concept pris isolément mais dans des entrecroisements et des imbrications de concepts. Je prendrai d'abord comme modèle de cette opération essentielle un exemple en dehors du domaine du soin. Je l'emprunte aux très belles analyses qu'Alain Badiou, dans son livre Éloge de l'amour[5], consacre à la déclaration d'amour. Il utilise deux concepts, contingence et nécessité, qu'il relie et qu'il emboîte pour mettre en évidence dans la banale et apparemment usée mais toujours sacramentelle formule "je t'aime", le passage, qui fait tout son sens, du hasard de la rencontre (la contingence) à la construction d'un destin (la nécessité). En d'autres termes, dire je t'aime c'est dire, par la conjonction de ces deux concepts, que de l'absolu est advenu dans le relatif [6]. Mais le niveau de rationalité atteint par cette analyse conceptuelle transcende toute réalité empirique : aucun amour humain exprimé par le je t'aime ne peut faire exception à ce schéma, quelles que soient les modalités particulières du vécu qu'il exprime et même quelles que soient les déterminations culturelles en cause, dont les sciences humaines, par exemple, font leur objet. Le sociologue et le psychologue peuvent établir des statistiques savantes et réaliser de passionnantes enquêtes sur l'amour, l'historien de la littérature peut nous intéresser en parlant à l'infini de l'amour courtois, de l'amour libertin et de l'amour romantique, Brassens peut chanter les amours de banlieue, avec les "nymphes de ruisseau" et les "Vénus de barrière" - "dans un train de banlieue on partait pour Cythère"[7] - l'univers de la chanson créole peut nous charmer des beaux serments d'amour que répertorie le site Mi aime a ou.com, il reste que le seul sens du je t'aime, du moins quand il n'est pas une ruse du séducteur (ou de la séductrice), est de transformer une rencontre hasardeuse en destin, il est de dire, pour reprendre un vers de Mallarmé que "le hasard est enfin fixé". On a là une approche philosophique dans la mesure où le système conceptuel dans lequel on inscrit le je t'aime pour en rendre compte, loin d'être simplement issu et dérivé de l'expérience, permet au contraire d'ordonner cette expérience et de la rendre intelligible, indépendamment de toute circonstance particulière et donc universellement. Le je t'aime apparaît alors dans sa vérité : il est toujours et à tous points de vue singulier et en même temps il n'en a pas moins à chaque fois une signification universelle. Autrement dit il n'y a pas deux déclarations d'amour identiques et en même temps il n'y a en a pas deux différentes [8]. La singularité n'est pas antagoniste de l'universalité.
Et contrairement aux apparences, nous ne nous sommes pas du tout éloignés de notre sujet, car nous voyons bien que cette conjonction de la singularité et de l'universalité est également au centre de toute situation de soin, selon un schéma analogue : dans l'absolu, il n'y a pas deux patients identiques mais en un certain sens il n'y a pas non plus deux patients intrinsèquement différents, car la relation l'emporte ici encore sur ce qui est relié. Chaque patient contient dans sa singularité la totalité de l'humanité, exactement comme chaque serment exprime à sa manière la totalité de l'amour. Et il en est de même pour la conjonction du simple et du complexe, qui souvent se superposent et semblent se cacher l'un sous l'autre, selon le regard que nous portons sur eux, comme nous l'expérimentons en regardant le sourire de la Joconde. Ce sourire légendaire est à la fois singulier et universel, puisque d'un côté c'est un sourire, un certain sourire, c'est le cas de le dire, celui d'une dame nommée Mona Lisa vers 1503, mais d'un autre côté c'est le sourire, c'est l'essence même du sourire. Au fond, ce n'est plus, aujourd'hui, le sourire du modèle que nous voyons au Louvre mais le modèle du sourire, de la même façon, notons-le en passant, que le soin ne reproduit pas la relation interhumaine mais plus fondamentalement contribue à la constituer et à la manifester. On peut dire aussi que le sourire de la Joconde est à la fois simple et complexe : il est ce qui est là, directement donné à voir, infiniment simple, donc, mais inversement on peut le décomposer et le recomposer, tout comme le puzzle, le reconsidérer encore et encore jusqu'à avoir l'impression qu'il se modifie pendant que nous l'observons et qu'au moment précis où nous croyons l'empri-sonner dans notre regard, il nous échappe encore davantage [9]. Il apparaît comme suspendu, toujours prêt à s'éteindre. En fait, nous le regardons, sans pouvoir nous en empêcher, de ce regard insistant qui a le pouvoir de rendre le simple complexe (ou le complexe simple) parce qu'il va au-delà de l'apparence, ce regard si proche de ce que Michel Foucault appelait le regard clinique. Constantin Brancusi, l'illustre sculpteur, disait en ce sens : "Regardez mes sculptures jusqu'à ce que vous les voyez". Regarder de cette manière c'est édifier du complexe afin de comprendre l'apparemment simple. Car l'accès au complexe est aussi, en un sens, ce dont nous avons besoin pour déjouer les ruses du réel. Le complexe n'est pas seulement un obstacle, c'est aussi un atout, qui peut nous sauver de ce que le simple risque toujours d'avoir de tragiquement énigmatique. Si on ne s'arrête pas de regarder la Joconde, c'est parce qu'elle donne indéfiniment l'impression qu'elle va épuiser la totalité du sourire mais que cela n'arrive finalement jamais. C'est pour une raison analogue qu'une médecine et une pratique de soin qui ne se heurteraient pas à un moment donné à de la complexité auraient forcément quelque chose d'insatisfaisant, comme tout ce qui ne tente pas jusqu'au bout d'épuiser la totalité du réel. L'histoire de la médecine est riche d'exemples qui montrent comment le progrès est suspendu à la découverte du complexe derrière la simplicité dont on s'était trop vite, trop longtemps et je dirais trop facilement accommodé[10]. Le complexe exerce en ce sens ce que les Grecs appelaient la fonction dionysiaque : Dionysos est en effet le dieu qui vient estomper les catégories tranchées, obscurcir les évidences, dénoncer tout ce qui est trompeur dans le simple, bref perturber dans son propre intérêt la rationalité. Bien entendu, je laisse ici de côté ce qui dans un système de soins peut relever non du complexe mais du compliqué, par exemple les modalités d'organisation du soin dans des institutions ou dans des services, car cela renvoie évidemment au Boeing 747 et non à la bouchée de spaghetti.
Dans la confrontation entre le soin et la complexité va apparaître enfin un élément absent jusqu'ici, l'action. Avec le concept de soin, nous passons de la complexité en termes de poursuite de l'intelligible à la complexité en termes d'exploration du monde et d'intervention directe sur le devenir, sur le cours des choses. C'est toute la problématique de l'altérité et du lien qui se trouve alors activée. Je ne peux pas reprendre, ni même survoler, dans le cadre fixé ce matin, tout l'examen des figures du soin. L'inflation contemporaine de l'analyse du soin est d'ailleurs à elle seule révélatrice de ce que cette notion a d'infini, ce que manifeste aussi l'extension illimitée du domaine du soin à laquelle nous assistons aujourd'hui : la modernité est marquée par un désir collectif de soigner la vie en permanence, la vie de son apparition jusqu'à son extinction, d'une limite de l'existence à l'autre, le soin étant de plus en plus, mais historiquement cela a touché d'abord la natalité, une intervention sur les confins de la vie.
Comme le sourire de la Joconde, au premier abord, rien de plus simple que le concept de soin. Il se répartit selon deux lignes de partage. Première ligne, la classique distinction posée par la pensée grecque entre soigner quelqu'un, au sens de s'occuper de lui (épimeleia) et soigner quelque chose, un corps, une blessure, une maladie (thérapeia, qui correspondra au fil de l'évolution de la langue grecque à la spécialisation de l'art médical). Prendre soin, permettre de continuer à vivre, en nourrissant et en entretenant (épimeleia), d'un côté, et donner des soins, c'est-à-dire traiter, soulager, guérir par des moyens ad hoc (thérapeia) de l'autre côté, la thérapeia étant le soin en tant qu'il transforme le malade en patient. Cela recoupe en gros l'opposition que ferait un mécanicien entre maintenance et réparation. Seconde ligne de partage, la dualité des fonctions du soin, qui est à la fois intervention technique au nom d'un savoir-faire (thérapeutikè technè) et intervention auprès d'une personne au nom d'un savoir-être et d'un engagement dans une relation à l'autre d'un type particulier. La complexité va naître des variations incessantes de ces éléments, de leur infinie combinatoire et de leurs contradictions, toutes choses qui empêchent ce que j'appellerai la linéarité de l'action de soigner, car ce qui est non-linéaire est toujours par nature complexe.
Par exemple, la frontière qui sépare épiméleia et thérapeia, est poreuse. Les deux dimensions interfèrent souvent, parfois même elles se superposent ou elles s'intervertissent. La palliativité, si vous m'autorisez le néologisme que représente ce passage de l'adjectif au substantif, est une forme de subversion de la thérapeia par l'épiméleia, lorsque maintenance et réparation ne se distinguent presque plus, lorsque soigner correspond au projet non plus de guérir mais d'aider à vivre et que l'obstacle de la maladie ou du handicap n'est plus à franchir ou à supprimer mais à apprivoiser - et nous retrouvons ici le versant thérapeutique de cette notion d'apprivoisement qu'Edgar Morin utilisait, nous l'avons vu, dans sa dimension scientifique. Mais sans doute existe-t-il une palliativité intrinsèque du soin curatif et inversement une curativité indirecte, si je puis dire, du soin palliatif. Ces deux aspects renvoient, j'en dis un mot eu égard à votre spécialité, à des mécanismes que la Grèce ancienne rattachait à Kronos et Chronos. Selon le mythe platonicien du Politique, sous le règne très ancien de Kronos avec un K (kappa), le dieu du temps, en latin Saturne, le monde tournait dans le bon sens, selon une marche idéale : la nourriture était à profusion, la santé était parfaite, la jeunesse inaltérable. Puis dans la phase suivante, le monde a été abandonné à lui-même, livré au temps qui passe, Chronos cette fois avec Ch, en grec avec un Chi, mot qui désigne le temps lui-même, tempus en latin. Le monde s'est alors mis à tourner en sens inverse, ce qui a entraîné le désordre, la maladie, le vieillissement [11]. Dans ce système de référence, le soin se définit comme une tentative pour inverser le cours des évènements, pour favoriser un retour au moins partiel au premier règne de Kronos. On voit à travers ce mythe comment le soin prend son sens par rapport à l'idée d'une réversibilité et comment le soin palliatif, lui, revêt en partie la signification inverse parce qu'il s'inscrit dans l'irréversible, dans l'oubli du règne idéal de Kronos et dans un affrontement résolu avec l'autre Chronos, le temps dont jamais on ne peut triompher. Dans la palliativité, l'extrême complexité de la situation de soin tient au fait qu'il s'agit de conjuguer du réversible et de l'irréversible, d'agir dans une temporalité contradictoire où la construction d'un avenir doit tenir dans les étroites limites du présent.
J'ai évoqué ici l'axe de la temporalité, mais un référentiel de la complexité en situation de soin s'inscrit en fait autour de plusieurs autres axes, touchant l'ontologie, l'éthique, l'épisté-mologie. Je me limite, vu le temps dont je dispose, à l'énoncé de quelques pistes. Complexité ontologique, d'abord, avec la spécificité irréductible de l'acte soignant, accompli au nom de la nature et en même temps contre elle, et renvoyant également à la culture, à travers des valeurs, des signes, des symboles. C'est le soin avec l'absence de références absolues sur les résultats qu'il produit, avec son insertion dans une chaîne collective d'interventions qui fait de lui une uvre, hors de portée de toute saisie vraiment unitaire. De toute évidence, le contexte du soin - la souffrance, la détresse, l'angoisse, l'intimité, par exemple - ne renvoie pas à un découpage neutre de la réalité mais à une densité toute particulière de la vie, à une obscure pesanteur existentielle dont on n'aura jamais fini, justement, d'explorer la complexité.
Complexité éthique, ensuite. La situation de soin est une situation éthique par excellence, non seulement parce que plus que tout autre elle doit respecter des règles ou en forger, mais parce que le soin s'inscrit dans une perspective de fragilité et d'incertitude, dans le cadre de l'expérience de dépossession de soi que constitue la maladie et dans une dimension essentielle de la finitude humaine. Être soigné, ou soigner d'ailleurs, c'est toujours solliciter l'unité d'une rencontre, d'un geste et d'une parole. Même ce qui peut apparaître simple dans le soin dissimule du complexe, un sens symbolique et culturel, une création de lien humain, un rapprochement à la fois entre les personnes et avec le monde. La complexité est tapie aussi dans l'affrontement incertain entre une approche scientifique et technique et une dimension d'inter-subjectivité, dans le fait que le soin, rencontre entre deux soucis, dirait Heidegger, est l'expérience paradoxale d'une forme très particulière de mise en commun de l'altérité. C'est un autre rapprochement avec l'amour que nous pouvons faire ici : même si c'est dans des conditions terriblement particulières, la relation de soin est, comme l'amour, un de ces moments rares où le monde peut être vraiment expérimenté à deux [12].
Complexité épistémologique enfin, autour de la mobilisation conjointe, dans le soin, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir écouter, du savoir-dire. Le soin est un empire de savoirs. Il est significatif que le même mot soin désigne à la fois une action et la qualité de cette action, qu'on puisse dire à la limite, en frôlant le pléonasme mais sans tout à fait le commettre, soigner avec soin. Soigner nécessite, dans un univers incertain et changeant où rôdent la faute, l'erreur, l'aléa, une pratique permanente de la décision et requiert ce que Kant appelait des jugements réfléchissants. Peut-être ce concept nous sera-t-il plus que tout autre utile. Kant distingue le jugement déterminant qui part d'une règle déjà établie pour l'appli-quer à un cas particulier et le jugement réfléchissant qui suppose qu'on invente une règle pour le cas singulier qu'on a à traiter. Soigner implique toujours de juger ce qui est possible, ce qui renvoie à des jugements déterminants, mais souvent aussi ce qui est préférable dans des cas éminemment singuliers, ce qui suppose des jugements réfléchissants [13]. C'est au nombre des jugements réfléchissants qu'elle nécessite, c'est-à-dire à la place des inventions relevant d'une méthode au cas par cas, que peut être évaluée la complexité d'une situation de soin, parce que le jugement déterminant se fait au nom de ce que la situation a de simple et que le jugement réfléchissant, au contraire, se fait au nom de ce qu'elle a de complexe.
Cette approche trouve aussi son application au niveau des principes juridiques et des lois. D'une certaine façon, le débat sur la légalisation de l'euthanasie, par exemple, ramène à la distinction kantienne entre ces deux types de jugements. Accepter l'idée d'une euthanasie légale, quelles que soient les modalités de son encadrement, c'est considérer que la décision d'aider à mourir peut relever d'un jugement déterminant, c'est-à-dire d'une règle qui préexiste au cas particulier et possède une validité d'ensemble. Inversement, dire non à la légalisation de l'euthanasie, c'est poser qu'une décision de ce type doit toujours être suspendue à un jugement réfléchissant, à une règle instituée au cas par cas parce qu'elle concerne l'existence. L'existence est, dans tout ce qui touche au soin, le facteur de complexité par excellence, parce qu'elle est ce qui fait la différence fondamentale déjà posée par les Grecs, entre bios, la vie humaine, le bios de biographie, et zôè, la vie animale, comme dans zoologie. Et la vulnérabilité du soignant s'alimente de son exposition directe à l'existence d'autrui.
Mais arrivé au terme de cette liste de catégories que je voulais mettre à votre disposition, je m'aperçois que je n'ai pas vraiment apporté de réponse, du moins directement, à la question "peut-on faire simple ?", ce dont, il est vrai, je n'étais pas chargé, en tout cas pas à moi tout seul. Je pense que j'ai fait la part du plaisir que le rédacteur a dû trouver à jouer sur cette formule et que de ce fait je ne l'ai pas assez prise au sérieux, n'y voyant qu'un clin d'il, qu'une allusion à l'opposition traditionnelle entre "faire compliqué quand on peut faire simple" et "faire simple quand on peut faire compliqué". Mais vous allez avoir le temps de chercher une réponse à la question posée. Je soumets dès à présent à votre réflexion celle qu'avait un jour proposée Albert Einstein, et qui donne à penser. Il avait dit ceci : "Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples".
-
[
Notes :
2] Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 2005, p. 22.
[3] M. Crozier et H. Séryex, Du management panique à l'entreprise du XXIème siècle, Montréal, 1994.
[4] Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Seuil, 1990.
[5] Flammarion, Paris, 2009, pp. 42-43.
[6] La subjectivité radicale que semble exprimer le je t'aime recouvre en fait le constat d'un évènement du monde. Sur cet aspect, cf. Elena Janvier, Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas je t'aime, Paris, Arléa, 2011. Les Japonais disent non pas je t'aime ou tu me manques mais il y a de l'amour ou il y a de l'absence et de l'abandon.
[7] Georges Brassens, Les amours d'antan.
[8] Cf. Alain, Propos de littérature, 1934 : " la pensée ne doit pas avoir d'autre chez soi que tout l'univers".
[9] Dès la Renaissance on a insisté sur cet aspect de l'uvre. L'historien d'art que fut Vasari écrit en 1550 que "lorsque l'on regarde attentivement le creux de la gorge, on croit apercevoir le battement du pouls
".
[10] La clarté vient toujours plus ou moins par l'obscur, la lumière suppose de regarder au bout du tunnel, de la même manière que la démarche philosophique telle que la conduisait Socrate consistait principalement à "brouiller les cartes". C'est le terme fort approprié qu'utilise François Fédier dans son commentaire du Ménon de Platon, Le Ménon, quatre cours, Lettrage, Paris, 2011, p. 22.
[11] Sur l'aspect heuristique de l'inversion de la marche du temps, on pourra lire le texte remarquablement éclairant de Francis Scott Fitzgerald L'étrange histoire de Benjamin Button, Paris, Gallimard, 2008.
[12] Cf. sur cette distinction Alain Badiou, Le philosophe et l'évènement, Paris, Germina, 2001, p. 51 et suiv.
[13] Cf. sur ce point l'analyse d'Alain C. Masquelet, "Médecine contemporaine et disposition au soin", in La philosophie du soin, Éthique, médecine, société, Paris, P.U.F., 2010, pp. 214-217
La bientraitance, approche philosophique. Communication au Colloque "La bientraitance mythe ou réalité ?", La Réunion, septembre 2014
Ce colloque rassemblait les professionnels des ESMS, des représentants des usagers et des familles, des institutionnels, des étudiants de l'IRTS de la Réunion et des cadres du secteur social
Je suis très honoré que le rôle de philosophe de service m'ait été de nouveau confié et très heureux d'être ici avec vous, après les journées passionnantes auxquelles j'ai déjà eu le plaisir de participer à l'IRTS, par exemple sur l'altérité, sur la responsabilité et sur l'éthique de l'action sociale.
Autant commencer par un aveu : je rencontre d'entrée de jeu deux difficultés. La première est qu'en prenant la parole dans un colloque où d'une certaine façon tout va être dit sur la mise en place d'une politique de la bientraitance, je me demande comment ne pas donner l'impression que je ne suis venu que pour ajouter des problèmes à des solutions. Et c'est bien ce que je vais faire, en un certain sens. Mais au fond c'est une situation qui n'a rien d'exceptionnel et qui est caractéristique de la philosophie. Par définition, le philosophe est celui qui intervient sur un certain état des choses, sur une réalité déjà donnée qu'il appréhende pour y revenir par la pensée, ce qui s'appelle, comme chacun sait, réfléchir. D'où le fameux mot de Hegel sur la chouette, attribut de la déesse Minerve et emblème de la philosophie : "l'oiseau de Minerve, disait-il, ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit". Ce qui veut dire non pas qu'on ne peut pas philosopher le matin, je vous rassure, mais qu'il faut qu'il y ait eu d'abord, dans la journée donc, pour reprendre l'image de Hegel, des actions ou des paroles dont le philosophe, opérateur intellectuel de la cité, pourra assurer l'examen critique le soir venu, c'est-à-dire en prenant ses distances par rapport au système en place et au discours établi. On ne fait appel à lui, aujourd'hui encore, que lorsqu'il s'agit de chercher un sens aux incertitudes du quotidien, aux obscurités du vécu ou aux désordres du monde.
Et puis il y a une deuxième difficulté. En lisant et relisant le titre qui a été donné à cette journée, je m'interroge sur le rôle qui peut être le mien dans cette problématique de la bientraitance, dont vous possédez, en raison de votre expérience et de vos compétences, tous les éléments constitutifs d'un savoir, alors que j'en suis, par rapport à vous, relativement démuni. Entre nous, j'espère faire des progrès d'ici ce soir ; mais c'est vous seuls qui avez la réponse à la question posée ou qui avez de bonnes raisons de croire que vous l'avez. Pourtant, là aussi, c'est une situation habituelle pour le philosophe d'avoir à donner, de façon paradoxale, des avis à plus savant que lui sur ce dont il est question. Car philosopher, c'est toujours entreprendre une navigation dont le port d'attache est heureusement l'ignorance. Ce n'est pas distribuer un savoir tout fait mais tenir un discours où le savoir s'élabore à partir de la conscience de ne pas savoir, dans une démarche éminemment philoso-phique qui est la construction de concepts. C'est la définition que Gilles Deleuze a donnée de la philosophie : elle est, disait-il, "un art d'inventer, de fabriquer et d'utiliser des concepts"[1].
C'est justement à un travail du concept, modeste et ambitieux à la fois, que je voudrais vous inviter en vous proposant quelques catégories pour essayer de penser la bientraitance, à charge pour vous ensuite, au fil des tables rondes et des autres étapes prévues au cours de la journée, d'activer ou non ces catégories, de leur imprimer votre lecture de professionnels ou de personnes concernées à un titre ou à un autre, de les nourrir de votre expérience et de vos pratiques, de les modifier et de les articuler pour rationaliser ce que vous voulez vous donner à penser à travers elles. C'est une démarche difficile qui nous attend, mais comme le disait encore Deleuze dans une superbe formule,"les concepts ne nous attendent pas tout faits comme des corps célestes".
Je procèderai en trois temps, en considérant la bientraitance successivement comme concept émergent, puis comme concept à risques et enfin comme concept régulateur. Concept émergent, d'abord, avec une rapide ontologie : à quoi cette notion renvoie-t-elle, dans quel horizon s'inscrit-elle ? Nous savons bien qu'elle concerne des situations existentielles d'une densité particulière, qui s'exprime dans des notions complexes, fragilité, vulnérabilité, handicap, dépendance. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ces notions, mais il faudra avoir à l'esprit que c'est par rapport à elles que l'idée de bientraitance prend tout son sens. Concept à risques, ensuite, avec une rapide interrogation épistémologique sur le statut de la bientraitance, sur ce qui la rattache à deux univers divergents entre lesquels elle court le risque de se déchirer, et que j'indique dès à présent, celui de la norme et celui de la valeur. Concept régulateur enfin, avec une réflexion éthique, puisque la bientraitance s'applique à des situations qui sont éthiques par excellence, d'abord parce qu'elles conduisent nécessairement à choisir des règles ou à en forger, ensuite parce qu'elles prennent place dans des perspectives d'incertitude, de dépossession de soi et de finitude et qu'elles correspondent par consé-quent à une expérience très particulière de l'altérité et du rapport à l'autre.
L'ère de la bientraitance ou l'émergence d'une positivité
Je commence en partant d'un fait incontestable dont notre assemblée de ce matin témoigne par sa seule existence : nous sommes entrés dans l'ère de la bientraitance. Et nous nous sentons étourdis comme si nous arrivions d'un voyage interplanétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, je le déduis du document que vous avez sûrement lu vous aussi, puisque vous êtes là, la fiche de présentation de cette journée. La question mythe ou réalité qui est indiquée dès le titre a déjà de quoi surprendre, mais la fin du texte peut rendre le lecteur plus perplexe encore, puisqu'elle pose la question de savoir si une révolution - et une révolution est chose bruyante et peu discrète - a pu se produire sans même que nous nous en soyons seulement aperçus. Vous remarquerez que pour le moment nous prenons mythe en un sens mineur, car l'expression mythe ou réalité veut simplement dire, dans le langage courant : cette chose dont nous parlons, existe-t-elle ?
À ce stade, je supposerai connue dans ses grande lignes l'abondante littérature, fascinante par sa prolixité [2], que la bientraitance a inspirée, qu'il s'agisse des textes officiels ou bien des ouvrages et articles, techniques ou polémiques, qui ont souligné l'importance des enjeux sociétaux et moraux qui sont en cause. Cette période a été marquée par des débats passionnés et des prises de position fortes qui peuvent sembler étonnantes s'agissant d'un objectif qui est défini dans les textes officiels, qui est évalué régulièrement, qui se retrouve au centre de toute la politique sociale et qui en un sens peut paraître évident, personne n'ayant jamais rien à dire, par définition, contre la bientraitance.
Observons d'abord de l'extérieur le concept et sa dénomination. Bientraitance est un substantif créé par l'addition à une forme verbale du suffixe ance, exactement comme gouvernance, déviance ou croyance, et il a la propriété, comme tous les mots de ce type construits en ance, de désigner à la fois une action et son résultat. On voit qu'il correspond à une logique faussement binaire : il y a la maltraitance et il y a la bientraitance, les deux notions étant à la fois opposées et symétriques, mais, si je puis dire, il n'y a pas la traitance. En somme il n'existe pas de degré neutre, de la même façon que le mot santé désigne à la fois le pôle positif de l'échelle des biens et des maux du corps s'il est employé seul (dire la santé c'est dire la bonne santé, comme on le voit dans l'expression populaire avoir la santé) et sert aussi à désigner le pôle négatif et tous les degrés intermédiaires quand il est qualifié par un adjectif, par exemple quand on dit santé déclinante ou même santé publique. Ce parallèle avec la santé nous montre aussi que dans les deux cas le positif naît du négatif et non pas l'inverse. La recherche d'une définition de la santé a toujours dépendu de celle de son contraire, la maladie, parce que seule la maladie existe comme événement. C'est dans le rapport à sa négation la maladie, que la santé prend son sens. H.-G. Gadamer disait en ce sens que la santé "est muette et insaisissable", qu'elle est "tapie dans un lieu caché" [3].
Ce qu'il voulait dire, c'est que la santé est un concept en creux. Et la bientraitance est elle aussi un concept en creux : elle ne peut être pensée sans au moins l'ombre de la maltraitance, qui seule existe, elle aussi, comme évènement. La naissance consécutive des deux notions, apparues juste l'une après l'autre, est significative. Il y a toujours eu des enfants maltraités - pensons par exemple aux maltraitances absolues que sont les sacrifices d'enfants dans la Bible et à l'"exposition" des nourrissons dans le monde antique - mais très curieusement la notion de maltraitance elle-même n'est apparue dans le discours de l'Occident que très près de nous, à l'échelle du temps, au cours des années 1980 [4], sous l'effet de l'évolution de la législation, avec la loi du 10 juillet 1989 sur les signalements. Il est remarquable aussi que les grands éducateurs qu'ont été Piaget, Wallon ou Bettelheim, qui pourtant ont entendu beaucoup de récits d'enfants dans leur cabinet, n'aient pas abordé, du moins en tant que telle et sous ce nom, la maltraitance des enfants - et pas davantage Françoise Dolto avant 1980 [5]. Bien entendu, l'idée de bientraitance avait pu apparaître à d'autres époques. Un bientraitance avait affleuré en Grèce ancienne, avec la naissance de la douceur (praos, praotès) dans un monde de guerres, d'héroïsme et de tragédies, et Jacqueline de Romilly en a fait un très beau livre, La douceur dans la pensée grecque [6]. Mais justement cette première bientraitance antique n'a sans doute pas pu prendre appui sur une conceptualisation suffisante de la maltraitance.
Pour revenir à notre temps, on sait que l'idée d'une maltraitance des adultes et des personnes âgées avait été formalisée quelques années plus tôt que celle des enfants[7]. C'est en juin 1975 que la loi a supprimé l'hospice, défini jusque-là comme "un lieu d'enfermement des inutiles au monde", définition qui est à elle seule une première forme de maltraitance. Juste avant, dans la ville de Nanterre, un panneau interdisait encore l'accès d'un square "aux chiens et aux pensionnaires de l'hospice" et que suite à des protestations, on avait annulé l'interdiction aux chiens. Du point de vue de l'histoire des notions, la naissance de la bientraitance intervient donc juste après celle de la maltraitance, ce qui montre bien qu'elle en procède et même qu'elle en hérite : elle se rattache à un mouvement général qui, à toutes les époques, a mis les valeurs positives dans la dépendance des négations correspondantes et les a fait naître d'une conquête héroïque à partir des malheurs liés à leur absence. Pensons à l'exemple emblématique de l'idéal humanitaire que Henri Dunant avait littéralement extrait des horreurs de la bataille de Solférino pour en faire, en 1876, la Croix Rouge. Et la plupart des grands idéaux, y compris la liberté politique et ce que nous appelons maintenant la démocratie, ont été d'abord dissimulés dans une négativité avant de prendre vie dans ce qui les avait jusque-là nié et empêché d'exister. Le Serment d'Hippocrate, rédigé au IVème siècle avant J.-C. complètement à contre-courant des pratiques du temps[8], car la Grèce ancienne avortait et se suicidait allègrement, si j'ose dire, est resté à jamais le modèle de toute éthique, alors qu'il porte en lui une contradiction béante : il exprime des idéaux suprêmes, le respect de la vie par exemple, alors qu'en même temps il est constitué principalement d'interdits et de consignes négatives. En réalité, il en va ainsi de toute valeur : de la même façon que l'idée de la santé naît de l'expérience de la maladie[9], l'idéal de paix est le fils tardif de la guerre, la justice est une fille rebelle de l'injustice, l'idée de repos est enfantée par la fatigue et la recherche du loisir [10] est une descendante en ligne directe de la peine et du labeur. On a beaucoup écrit ces derniers temps pour démontrer que la bientraitance est autre chose - et davantage - que la non-maltraitance, mais si ce n'est pas du temps perdu, c'est en tout cas du temps consacré à démontrer une évidence, car toute valeur est toujours d'une certaine manière le contraire idéalisé de son contraire [11]. En ce sens, l'histoire de la bientrai-tance en tant que concept, histoire qui ne fait d'ailleurs que commencer, est d'abord l'émergence d'une positivité, un mouvement de rupture par rapport à une notion primitive inverse. Pour autant, le passage à la positivité n'est pas en lui-même une garantie de sa validité. Il ne manque pas de positivités apparentes qui recouvrent au moins partiellement un contenu négatif. Pour rester dans l'actualité, pensons à tout ce que la compétitivité, aujourd'hui si recherchée et si louée, mais objet de controverses parmi les économistes, porte en elle de négativité, dès qu'on l'examine en termes de salaires (diminués), d'emplois (perdus, supprimés ou déplacés), de conditions de travail (dégradées), de conséquences du jeu effréné de la concurrence dérégulée, c'est-à-dire dès qu'on la confronte à l'objectif du bonheur de la cité, dont elle est pourtant supposée donner la clé à travers la recherche d'un idéal qu'on appelle la prospérité. La proclamation d'un idéal à résonance positive n'est pas donc pas nécessairement une authentique positivité.
Entre valeur et norme : la bientraitance, un concept à risques
Quoi qu'il en soit, au moment où l'idée de bientraitance émerge de son contraire, elle est d'abord une chose quelque peu indistincte, d'où cette impression d'arriver sur une autre planète et d'être confronté à du jamais vu. Sous l'effet de la nouveauté, la bientraitance peut nous apparaître comme un jeu de miroir : à la fois elle miroite et elle fait miroiter quelque chose. Elle fait penser à un conte coréen du 18ème siècle [12] qui met en scène un pauvre marchand nommé Pak, dont l'épouse est dévorée par le désir de posséder un objet de luxe, très rare à cette époque, et qu'elle n'a donc jamais pu utiliser ni toucher ni même voir de près, un miroir de bronze. Mais un beau jour Pak, mari affectueux et généreux, parvient à offrir enfin à son épouse l'objet tant convoité. Elle prend en main pour la première fois de sa vie le miroir et elle y aperçoit un visage inconnu, celui d'une femme qui se tient à côté de son mari, car Pak est à côté d'elle. Alors elle se met en colère et s'en prend à lui, elle lui demande qui est cette femme auprès de lui, ne comprenant pas, puisque faute de miroir elle ne s'était encore jamais vue, que ce qu'elle voit c'est elle et son mari. Pak, sommé de s'expliquer, se saisit du miroir à son tour et pour les mêmes raisons, il y aperçoit un homme qu'il ne connaît pas et qu'il prend - juste retour des choses et terrible symétrie de l'altérité - pour l'amant de son épouse, alors qu'il s'agit évidemment de lui-même, à côté d'elle. D'où une vive dispute, qui conduit les époux chez le préfet de la province pour d'obtenir son arbitrage. Le préfet prend le miroir qui lui est tendu mais celui-ci lui renvoie l'image d'un fonctionnaire en uniforme : il se dit que son successeur est déjà arrivé et que lui-même a par conséquent été limogé. Et ainsi de suite. Leçon transposable à l'infini sur le rapport à soi et le rapport à autrui, sur l'identité et l'altérité. Le sujet du conte, c'est la manière dont l'autre peut naître du même par le seul effet d'un jeu de miroir. Et en ce qui nous concerne, nous pouvons y voir la difficulté qu'il y a à comprendre ce qui devient visible après avoir été longtemps invisible, ou caché, ou hors du regard, une fois passé le temps de l'éblouissement.
Car un concept émergent présente toujours un décalage par rapport aux choses familières et tout ce qu'il donne à comprendre apparaît d'abord comme une étrangeté. Si nous nous posons à nouveau la question la bientraitance mythe ou réalité ? nous pouvons la situer à un niveau différent, en nous demandant, une fois dissipée la brume de la nouveauté, s'il n'y aurait pas à présent une sorte de religion de la bientraitance, un nouveau dogme qui faute de miroir nous aurait échappé.
La réponse dépend évidemment de la manière dont la bientraitance est conçue et si on décide qu'elle a sa place dans le domaine des normes et des règles ou dans celui des idéaux et des valeurs. Ce sont en effet deux champs bien différents. Les normes et les règles déterminent des conduites, elles prescrivent directement ce qui doit être accompli en référence à des modèles. Elles sont de l'ordre de l'obligatoire (ou de l'interdit) et du relatif. En revanche, les valeurs et les idéaux, même s'ils peuvent quelquefois se dégrader dans des règles et des normes ou les inspirer, représentent très exactement le contraire : ils sont de l'ordre du désirable et de l'absolu. Une valeur n'est échangea-ble contre rien, elle n'est, au propre et au figuré, pas négociable. Jamais pleinement réalisées, insai-sissables objets d'une visée idéale, les valeurs sont une référence transcendante de l'action. Les deux ordres, celui de la norme et celui de la valeur, s'opposent donc sur presque tout. Dans la thématique que nous examinons ce matin, la conformité à des règles, la satisfaction de normes ou de critères précis se prêtent bien à l'évaluation, alors que l'aspect poursuite d'un idéal s'accommode plus difficilement, semble-t-il, de la mise en place d'"indicateurs de performance".
Les recommandations de bientraitance en tiennent compte : elles se défendent de proposer des "normes opposables" et des relevés de consignes. Elles présentent la bientraitance non pas comme un état mais comme une dynamique confiée à l'institution [13] et susceptible de mobiliser et de rassembler les acteurs. La bientraitance doit pouvoir trouver sa pleine réalisation, nous dit-on, le plus souvent, dans la réflexion collective, dans la formation continue, l'animation, la communica-tion, en vue de l'appropriation des "bonnes pratiques" qui sont proposées. Les valeurs sont constamment évoquées, directement ou indirectement (par exemple, le respect de la personne, la dignité, l'autonomie de l'usager, la sollicitude, l'échange, la responsabilité, la justice, etc.)[14]. D'autre part, les actions à conduire et la gestion des situations sont en général présentées non pas comme relevant de consignes à caractère directif mais plutôt comme des éléments d'une culture - et le mot culture est présent, sans doute l'aurez-vous remarqué, dans les intitulés des tables rondes qui vont suivre. Les recommandations et les autres textes de mise en uvre constituent une approche constructive de la bientraitance, elles en établissent une pédagogie, et elles sont, de ce point de vue, extrêmement utiles et bienvenues.
Pour autant, la difficulté de situer précisément la bientraitance dans le champ de la morale et de l'éthique n'en persiste pas moins, comme en témoignent des embarras de langage significatifs. Tel document, par ailleurs de bonne qualité et publié par un organisme respectable, a pour titre "petit guide à l'usage des professionnels bientraitants" [15], ce qui révèle une ambiguïté, pour le moins, car on ne sait pas s'il faut-il être bientraitant pour lire, pour comprendre et peut-être même pour mériter le petit guide, ou si c'est une fois convenablement orienté par le petit guide qu'on pourra devenir bientraitant ou plus bientraitant, si on peut dire, en écorchant la grammaire au passage avec cet étrange comparatif. Heureusement, professionnel bientraitant est théoriquement un pléonasme, et à l'inverse professionnel non bientraitant et a fortiori maltraitant serait, du moins peut-on l'espérer, une contradiction. Je pense également à un article [16] d'un organisme étranger, très respectable aussi, qui utilise l'expression "agir de façon bientraitante" comme s'il y avait une vertu de bientraitance incluse dans telle ou telle action ou dans telle ou telle façon d'agir, un peu de la même façon qu'il y avait pour les médecins de Molière une vertu dormitive de l'opium [17].
Néanmoins, ces difficultés, qu'on ne s'y trompe pas, ne tiennent pas seulement aux énoncés. Elles traduisent aussi des dérives susceptibles de transformer la bientraitance, selon l'usage qui en est fait, en un véritable concept à risque, à partir de ce qu'on pourrait appeler une chosification de la bientraitance, c'est-à-dire un processus par lequel elle devient une espèce de qualité en soi, qui peut s'ajouter (ou ne pas s'ajouter) à une démarche, à une action, à un soin, à un accompagnement, à un travail social, voire même à une institution toute entière ou à une politique d'ensemble. En réalité, il y a un triple risque lié au concept de bientraitance. D'abord il y a le risque de méconnaître l'unité de toute action d'accompagnement et de soin : c'est tout entière qu'elle est bientraitante ou non, de la même façon que l'humanisme ne vient pas s'ajouter, comme une espèce de "supplément d'âme", à la pratique médicale si celle-ci ne le porte pas déjà en elle comme une source, comme une intention originelle. "L'humanisme n'est pas une vertu qu'on appliquerait, superposée, à la médecine. C'est au contraire "la médecine qui doit constituer un modèle d'humanisme, car elle est [
] un art du Salut" - je cite la conclusion d'un rapport récent de l'Académie de Médecine[18]. Il existe ensuite un deuxième risque, celui de croire que la bientraitance est quelque chose qui pourrait, en vertu d'une conception mécaniste qui revient régulièrement, "contrecarrer la vulnérabilité des personnes", pour reprendre la formule employée par Habermas à propos de la morale. C'est en somme un risque de labélisation, j'emprunte ce mot au monde trompeur - et d'autant plus soucieux de rassurer - de la consommation. Enfin, il y a un troisième risque, qui est celui de s'en remettre aux garanties que semble donner la bientraitrance. C'est le risque de la bonne conscience, le risque qu'au terme d'une continuelle incantation, la bientraitance devienne performative, c'est-à-dire que son efficacité soit entièrement contenue dans son énoncé sans cesse répété, et au bout de compte s'y réduise. Je vous rappelle qu'est dit performatif ce qui réalise une action par le seul fait de l'énoncer, et qui se limite à cet énoncé lui-même, comme quand on dit je le jure ou je vous aime : on ne fera jamais rien d'autre que de le dire et en même temps c'est le fait de le dire qui fait qu'on le fait. Mais dire, sur le même modèle, je vous bientraite, ce serait inévitablement sous-entendre : que voulez-vous de plus ?
Éthique et déontologie : la bientraitance comme concept régulateur
Ces dérives peuvent être évitées, sans doute, mais on peut les redouter si "le déploiement de la bientraitance", comme dit un document [19] de la Haute Autorité de Santé, correspond à une prise de pouvoir de la déontologie, à une déontologie devenue folle. J'appelle folle une déontologie qui prétend se suffire à elle-même qui n'est plus sous le contrôle de l'éthique.
Autrement dit un système déontologique dans lequel sont sans cesse énoncées des positivités morales, comme le respect, la liberté, l'écoute, l'échange, mais sans référence à un questionnement éthique - qui seul pourrait en garantir le sens et la mise en uvre dans les circonstances concrètes de l'action[20] - d'où un risque de contribuer à une simple normalisation des conduites dans le métier concerné. Cette déontologie-là peut même apparaître comme l'instrument d'une représentation du champ de l'action sociale sur le modèle d'une entreprise, dont la gestion relèverait d'une idéologie purement économique. L'éthique peut alors, dans des cas extrêmes, tenter de reprendre ses droits et déclarer ce qu'on a appelé une "insurrection des consciences"[21].
Je reviens donc un instant, pour finir, sur la notion d'éthique, souvent mise en avant, pour la situer par rapport aux deux notions avec lesquelles elle possède des frontières communes, la morale et la déontologie. D'abord, la morale. Il y a, qu'on la situe dans le ciel ou sur la terre, une région du permis et du défendu, un ensemble de principes, de valeurs et d'idéaux, sur lesquels il peut y avoir débat mais auxquels nous nous sentons tous liés par un sentiment d'obligation et de respect, par-delà toutes les différences de cultures. C'est ce qu'on appelle la morale, tout ce que Paul Ricur nommait le royaume des normes, c'est-à-dire un réservoir commun d'éléments de référence.
La déontologie, à présent. On confond souvent déontologie et éthique, alors que ce sont deux démarches sont non seulement différentes mais à certains égards opposées. La déontologie est liée à une activité professionnelle. Elle est, pour un métier donné, une liste des devoirs positifs ou négatifs rassemblés dans un grand code de l'interdit et de l'obligatoire - les deux pôles qui, surtout dans le système de la modernité, encadrent et enserrent la liberté, la prenant en tenaille et ne la tolérant que résiduelle [22]. Une déontologie est un code fixe pour des situations définies, un système de choix préétablis, une liste d'injonctions qui, sur la conduite à tenir, donnent les réponses avant qu'on ait eu à se poser les questions. Déontologie est d'ailleurs un faux mot grec qu'on ne trouvera dans aucun dictionnaire de grec ancien. Il a été construit au 19ème siècle par un utilitariste anglais, Jeremy Bentham, à partir du grec déon, ce qu'il faut, pour désigner ce qui doit ou ne doit pas être fait.
L'éthique, elle, est tout autre chose. Elle est la consultation et l'interrogation du royaume des normes, du système de référence donc, pour définir les attitudes à adopter et les décisions à prendre dans une situation concrète et singulière. Elle est un questionnement, un usage critique de la raison, et en ce sens elle peut être également une forme de subversion. Lorsqu'il y a des hésitations sur les choix à faire, lorsqu'apparaît une interrogation sur les valeurs ou sur la mise en uvre de normes établies, lorsqu'il y a matière à mettre la déontologie en cause ou bien à la refuser, alors on entre dans la sphère de l'éthique. Les réponses qu'apporte l'éthique - et le mot est vraiment grec - ne seront ni valables à tout jamais, ni transférables, ni généralisables. Elles rebondiront inévitablement dans d'autres situations singulières et c'est ce qui fait que l'éthique ne peut jamais se réduire à un système codifiable [23].
Une activité professionnelle est toujours double à cet égard. Elle s'inscrit dans un espace qui est défini d'un côté par des objectifs, des normes ou des techniques, et d'un autre côté par des valeurs qui n'ont qu'une réalité idéale. Je ne prendrai, faute de temps, qu'un seul exemple, celui de la dignité, si souvent invoquée dans l'univers social et médico-social [24]. Elle renvoie à deux choses [25]. D'un côté à la réalité, aux conditions matérielles et psychologiques de l'accueil, de l'accompagne-ment ou du soin, et aux situations jugées plus ou moins dignes ou plus ou moins indignes qui en résultent. Je dirais que c'est la partie variable de la dignité. Et puis d'un autre côté, la dignité fait référence, tout au contraire, à une sorte d'invariant ontologique, l'idée de l'autre en tant que tel, qui n'est pas susceptible de plus et de moins et qui est indépendante de toute circonstance particulière. Cette fois je dirai que c'est la partie invariable de la dignité. Elle correspond au fait que dans toute relation d'aide, de soin, de soutien, etc., par-delà l'infinie diversité des situations, tous ceux qui sont pour nous les autres ont cette propriété étonnante : si on parle de la réalité, il n'y a en a pas deux identiques, et en même temps, si on parle de l'idéal, il n'y en a pas deux différents. Cette double nature se retrouve dans la mise en uvre de toute valeur, quelle qu'elle soit. Pour chaque valeur, il y a, face à un versant réel, un versant idéal, une ligne vers laquelle on se dirige sans jamais tout à fait l'atteindre, un horizon. Et l'horizon, chacun le sait, recule quand on avance. La distorsion qui en résulte et l'écart qui se creuse parfois jusqu'à la rupture entre le versant réel et le versant idéal de la poursuite de toute valeur génèrent des tensions, que vous vivez, dans vos fonctions, chaque jour : entre les moyens et les fins, entre l'intime et le collectif, entre la brièveté de l'instant et la longueur du temps, entre la singularité et l'universalité, entre la forme et le contenu, entre la répétition du quotidien et l'élan de l'existence, entre les choses et leur signification, entre la règle et la liberté, entre la rentabilité et la satisfaction, entre la vigilance de Prométhée et l'insouciance d'Epiméthée. Ce que j'énumère là mériterait une analyse plus attentive, mais c'est dans ce champ de tension que la bientraitance trouve sa place, à l'entrecroisement des idéaux et de la gestion.
Que nous dit, en fin de compte, une éthique de la bientraitance ? Qu'il ne faudrait pas accepter, sous le nom de bientraitance, la notion presque inerte qu'on trouve parfois dans ce que j'appellerai le discours bientraitant[26], lorsque les objectifs énoncés vont tellement de soi qu'ils finissent par se dissoudre dans leur propre évidence. En réalité, ce que nous pouvons appeler la bientraitance est quelque chose de beaucoup précis mais aussi de beaucoup plus vaste : d'un côté la bientraitance comme l'unité d'une diversité de situations et d'un système d'interventions normées, et en ce sens elle constitue ce que Michel Foucault appelait un dispositif, c'est-à-dire, je cite sa définition, "un ensemble [...] hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques" [27], des modes d'emploi aussi. C'est dans ce dispositif appelé bientraitance que s'inscrit l'action, actuelle ou future, de la plupart d'entre vous, c'est lui qui est l'objet de nos travaux d'aujourd'hui, parce que la généralisation de la politique de bientraitance s'impose et que son succès représente un enjeu majeur. Et d'un autre côté, la bientraitance n'a de signification qu'à la condition de ne pas être seulement un dispositif, de ne pas devenir un système clos dont il n'y aurait plus qu'à décliner les prescriptions, à la façon d'une procédure. Dans des métiers et des domaines de l'action où il s'agit de construire un monde commun tout en respectant des mondes particuliers, la bientraitance doit aussi, au-delà des dispositifs qu'elle inspire, demeurer une idée régulatrice, une sorte d'indicateur d'idéal qui se déplacerait comme un curseur sur un continuum entre deux extrêmes. Ces deux extrêmes sont ceux que d'une certaine manière, le pauvre Pak et son épouse émerveillée avaient eu tellement de mal à distinguer dans leur beau miroir, et ils sont aussi ceux que nous avons appelé mythe et réalité, car il importe que la bientraitance soit à la fois l'un et l'autre, au sens originaire où le mythe est une idéalité qui fonde une pratique sociale.
Notes :
1] G. Deleuze et F.Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, Les éditions de Minuit, Paris, 2005.
[2] Texte du Ministère de la Solidarité paru en 2000 sur la prévention et le repérage des violences à l'encontre des enfants et des jeunes dans les institutions sociales et médico-sociales, loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, circulaire du 3 mai 2002 sur la lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables (et pas encore la bientraitance à proprement parler), instruction ministérielle du 22 mars 2007 sur le développement de la bientraitance et le renforcement de la lutte contre la maltraitance (complétée et modifiée le 6 novembre 2007, renvoyant à la "démarche qualité" et aux "normes de pratiques optimales" et proposant d'intégrer le concept de bientraitance dans la gestion des établissements), déclaration en 2008 de la secrétaire d'Etat à la solidarité sur l'accueil et la bientraitance des personnes âgées dépendantes, plaçant la bientraitance au centre des politiques nationales, circulaire du 15 juillet 2009 sur l'accès aux soins des patients précaires, circulaire du 12 juillet 2011 sur le développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux, recommandations de bonne pratique de l'ANESM (notamment en juillet 2008), etc.
[3] H. G. Gadamer, Philosophie de la santé, Grasset - Fasquelle, Paris, 1998. Cf. p. 31 : "le médecin ne peut rien exhiber qui soit son oeuvre". Cf. également Kant, troisième section du Conflit des facultés : "on peut se sentir bien portant [...] mais "on ne peut jamais savoir qu'on est bien portant". En d'autres termes, la santé est un objet qui est placé "hors du champ du savoir", comme le notait Georges Canguilhem dans un des textes célèbres rassemblés dans les Écrits sur la médecine, Paris, Seuil, 1989, p. 52.
[4] Cf. F. Alföldi, Approches historiques et théoriques du concept de maltraitance, Paris, 2000. Le terme maltraitance apparaîtra dans les dictionnaires en 1996 (Robert), en 1998 (Larousse) et 1999 (Flammarion).
[5] La cause des enfants (Robert Laffont, Paris) paru cette année-là marque un tournant et il est l'occasion d'une interrogation sur les silences des époques précédentes.
[6] La douceur dans la pensée grecque, Paris, Belles Lettres, 2001.
[7] Cf. les articles synthétiques de P. Durning et J. Trincaze - B. Pujalon - C. Humbert dans le Dictionnaire de la violence sous la direction de Michela Marzano, Paris, P.U.F., 2011, pp. 847-858. On lira aussi, sur "les notions qui entourent et préparent le concept de bientraitance", les indications de La bientraitance : définition et repères pour la mise en uvre, brochure de l'A.N.E.S.M., 2008, pp. 12-13. L'entrée au Petit Larousse du terme bientraitance est intervenue en 2013.
[8] Sur le Serment d'Hippocrate et le modèle grec de l'éthique, cf. J. Lombard, Éthique médicale et philosophie, l'apport de l'Antiquité, L'Harmattan, Paris, 2009. Cf. notamment p. 18 et suiv. sur "la double nature" du Serment.
[9] Cf. la formule de G. Canguilhem "l'anormal logiquement second et existentiellement premier".
[10] C'est la distinction grecque du loisir (scholè, d'où l'école, occupation d'homme libre par opposition à la vie affairée, ce qu'exprime le latin avec le couple otium, d'où l'oisiveté, et negotium, d'où le négoce).
[11] "Il n'y a pas de coupure nette dans le continuum qui s'étend entre ne pas faire le mal et apporter des bienfaits", dit en ce sens l'ouvrage de Beauchamp et Childress Les principes de l'éthique biomédicale, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 239.
[12] "La tortue qui parle", in Contes de Corée, rassemblés par M. Coyaud, Fédérop, 1979.
[13] Cf. par exemple la brochure de l'A.N.E.S.M., déjà citée, p. 10.
[14] Id., pp. 12-37.
[15] CREAI Rhône Alpes, 2011.
[16] Bientraitance, tout un concept, ASPH, Belgique.
[17] Plaisanterie impérissable qui se trouve dans Le malade imaginaire, acte III : "Mihi a docto doctore/Demandatur causam et rationem quare/Opium facit dormire/A quoi respondeo/Quia est in eo/Vertus dormitiva/Cujus est natura/Sensus assoupire."
[18] Rapport de la commission "Humanisme médical" adopté dans la séance du 21 juin 2011, Bulletin de l'Académie nationale de Médecine, 2011, 195, n°6, pp. 1345-1368 (www.academie-medecine.fr/publication100036355/).
[19] Le déploiement de la bientraitance, guide à l'usage des professionnels en établissements de santé et EPHAD, 2012.
[20] La démarche qualité a été, comme la bientraitance, une "invitation à une reconquête du sens, à une redécouverte des valeurs fondatrices de la santé et du social" : cf. sur cette question Ph. Ducalet et M. Laforcade, Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales, Paris, Seli Arslan, 2008. À noter, chez le même éditeur, l'entrée "bientraitance" dans L'univers du soin, Idées reçues et propositions humanistes, 2013, pp. 24-26.
[21] Cf. sur ce point L'appel des appels, Pour une insurrection des consciences, sous la direction de Roland Gori, Barbara Cassin et Christian Laval, Paris, Mille et une nuits, 2009.
[22] Par ailleurs, les "recommandations de bonne pratique", formule de plus en plus utilisée, anticipent sur la réflexion éthique et sur les choix de l'agent au point de les remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel. Il est bon, sans doute, que de telles recommandations existent, pour le cas où l'éthique viendrait à être défaillante ou absente, et aussi parce qu'elles suffisent généralement aux besoins les plus courants de l'action.
[23] On peut emprunter un exemple à usage universel à la philosophie de Kant. Dire la vérité, note Kant, est un devoir inscrit dans le "royaume des normes". Mais dans une situation concrète, c'est-à-dire à la jonction des normes et du réel, il se peut qu'il semble préférable de dissimuler la vérité, par exemple quand une annonce véridique pourrait ajouter au mal - c'est ce que Kant appellera "mentir par humanité". Il pense bien sûr à un diagnostic médical sévère, mais cela vaut aussi bien pour toute vérité difficile et même dans le champ de toute valeur autre que la vérité, car au niveau éthique, et c'est même ce qui le caractérise, il est possible d'écarter une valeur ou d'y renoncer au nom d'une autre valeur jugée plus haute.
[24] Sur la dignité, cf. J. Lombard, "Dignité et soin. Quelques remarques sur digne et indigne", revue Perspectives soignantes, avril 2012, pp. 29-40, et "Aspects de la technè, l'art et le savoir dans l'éducation et dans le soin", revue Le Portique, 3-2006. Voir aussi J. Lombard et B. Vandewalle, Philosophie de l'altérité, Paris, Seli Arslan, 2012, p. 121 sq.
[25] On notera que dans le débat sur l'euthanasie, la dignité est invoquée autant par les partisans que par les adversaires.
[26] Cf. la "Charte de bientraitance" jointe aux "principes de bientraitance", Réseau Bas-Normand/REQUA, comme un exemple parmi tant d'autres du discours bientraitant.
[27] Michel Foucault, Dits et écrits, t. III, texte 206, Paris, Gallimard, 1994.
Dignité et soin. Quelques remarques sur "digne" et "indigne". Intervention à la Conférence de l'ASP (Soins Palliatifs) Sud Réunion, Saint-Pierre (Réunion), décembre 2011.
Dans les Dialogues de Platon, Socrate intervient le plus souvent alors que ses interlocuteurs ont déjà commencé à parler - de la vie et de la mort, du corps et de l'âme, de l'éducation, de la vertu, de la cité, etc. Et chaque fois ou presque, il leur dit : vous vous posez et vous me posez des questions sur telle ou telle chose, mais cette chose, qu'est-ce qu'elle est au juste ? Et le nom par lequel nous la désignons, cette chose, que signifie-t-il exactement ? Par exemple, dans les premières lignes du Ménon, dont le sujet est la vertu, Socrate dit en substance à Ménon qui vient de l'interroger : tu te demandes si la vertu peut s'enseigner et tu me consultes là-dessus, mais moi, je ne sais même pas ce qu'est que la vertu. Et il ajoute un détail complètement décourageant. Il lui dit : non seulement je ne sais pas ce qu'est la vertu mais je n'ai jamais rencontré personne qui l'ait su[1]. Ce qu'il veut lui dire, au fond, c'est que philosopher, c'est d'abord accepter de ne pas savoir, à condition de faire de ce non-savoir un atout, une promesse, une première phase de la démarche qui conduira au concept de la chose dont il s'agit : la philosophie consiste à mettre le monde en concepts.
La dignité est si fréquemment invoquée dans le discours éthique contemporain que nous pouvons considérer que le débat sur cette notion est largement engagé. Nous pouvons donc nous y joindre, conformément à l'enseignement socratique, en avançant notre ignorance et en disant : la dignité, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour être philosophique, un non-savoir doit être institué comme perspective donnée au champ de la pensée. Nous essayerons d'abord de mettre au jour quelques éléments d'analyse, puis nous aborderons deux aspects de l'usage qui est fait du concept de dignité, ce qui le rend risqué et ce qu'il a pourtant d'indispensable parce qu'il commande l'ensemble du champ éthique dans le domaine du soin.
Examinons dans un premier temps digne et indigne. Ce sont deux termes opposés et en partie symétriques - mais en partie seulement. Ils sont les chefs de file d'une famille de mots dont l'influence, depuis un certain temps, ne cesse d'augmenter, en raison du vaste champ éthique qu'entraîne avec elle la problématique de la fin de vie. Dans cette famille nombreuse, nous trouvons toute une série de parents, de frères et de surs, d'alliés, de collatéraux, de cousins qui au premier abord donnent l'impression d'être sagement rangés comme pour une photographie. Si on regarde en imagination cette photo de famille, on voit au premier rang, digne et indigne, et derrière eux, un peu plus solennels, plus matures peut-être, dignité et indignité. Puis, sur le côté, la rebelle de la famille, connue pour son sens du refus et pour les reproches qu'elle profère, celle qu'on appelle indignation. C'est d'elle que se recommandent ces Indignés qu'on voit assis sur les grandes places de Madrid, de Paris, de New-York et d'ailleurs. Ils dénoncent l'injustice du monde, ils disent qu'elle est une indignité, à laquelle ils opposent dignement, c'est bien le cas de le dire, toute leur force d'inertie. L'indignation est l'expression d'une dignité qui crie son absence.
Sur la photo de famille, on imagine aussi, bien en évidence et confortablement installés, les dignitaires, qui eux, ne s'indignent pas, évidemment, puisqu'ils bénéficient du système. S'ils paraissent haut perchés, c'est peut-être parce que ce sont de hauts dignitaires. Mais il faut noter que la dignité qui est contenue dans dignitaire - un mot qui veut dire digne de considération - présente cette particularité de n'avoir aucune dimension universelle : elle est au contraire un privilège, un attribut des grands de ce monde, quelque chose que par définition tous les autres n'ont pas. À la cour, la dignité du roi est contenue et exprimée par la codifi-cation des conduites qui s'appelle l'étiquette. Ce rappel historique souligne l'évolution extra-ordinaire du concept de dignité, qui part de l'idée d'une grandeur sociale, apanage de quelques uns - le mot a d'abord servi pour les sénateurs romains - pour arriver à terme à la dignité moderne, qui n'est plus du tout un attribut réservé à certains mais au contraire un dénominateur commun à tous les hommes, un élément de ce qui fait l'essence de l'humain. En somme, on est passé peu à peu d'une dignité élitiste à une dignité démocratique. Mais dans ce passage, quelque chose d'essentiel s'est produit : la dignité qui a été d'abord susceptible de degrés, puisqu'elle variait en fonction du statut social, a par la suite cessé de l'être : dans l'acception d'aujourd'hui, radicalement différente, du mot dignité, chaque homme la possède tout entière, qu'il l'ait ou qu'on la lui doive. Nous reviendrons, à propos de digne, sur cette irruption de l'absolu dans le relatif.
Quoi qu'il en soit, tous les termes de la famille, apparentés à digne et indigne, expriment, dans des proportions variables, les mêmes idées, de décence, de retenue, de respect de soi et des autres qui sont au centre de la racine indoeuropéenne dek, dont en latin le mot dignus et le verbe indignari (s'indigner) sont les toutes premières formes en Occident. On ne remonte pas plus loin que Rome, en effet, car la dignité n'est pas une notion grecque - ce qui a priori n'est pas très bon signe : en général, les notions qui n'ont pas été élaborées ou traitées par la philosophie grecque sont beaucoup plus difficiles à clarifier, c'est-à-dire à amener à la pleine lumière. Les Grecs n'ont pas eu l'équivalent exact de la notion de dignité mais ils ont posé trois jalons essentiels qui y conduisent. Le premier c'est, avec le Serment d'Hippocrate, au IVème siècle avant Jésus-Christ, cet étonnant prodige qu'a été l'irruption brutale de l'idée de respect absolu de la vie, à contre-courant des murs de la société antique. Le second jalon a été la construction par les Grecs de l'idéal de philanthropia, au sens grec du terme, l'amour de l'humanité, c'est-à-dire le respect de ce qui est humain dans l'autre. Et troisième jalon, ils ont défini la notion d'aidôs, qu'on traduit parfois par la honte, mais il faut comprendre une honte positive, en quelque sorte, à la fois respect humain dû à autrui et sentiment qui protège chacun de la déchéance qu'il pourrait s'infliger à lui-même en ne respectant pas l'autre, idée sur laquelle nous allons revenir. Ce sont là, très tôt, puisque la notion d'aidôs est déjà utilisée chez Homère [2], des avancées majeures vers ce qui sera plus tard la dignité. L'association de philanthropia et aidôs n'est finalement pas très éloignée des fondements que Kant donnera à l'idée de dignité au siècle des Lumières.
En jetant un dernier regard à la photographie de famille, nous voyons, en face de tous ceux que nous avons déjà aperçus, l'autre branche, celle qui semble avoir été, puisque nous parlons de photographie, un négatif de la première et qui a l'air d'être composée de frères et de surs fâchés et de cousins rancuniers, qui ne savent que s'opposer et qui expriment par principe tout ce qui est non-digne, indigne, c'est-à-dire vulgaire, commun, malfaisant, lâche, sordide, infâme, méprisable, immoral, malséant, mesquin, ignoble, etc. Cette énumération n'a pas de fin, parce qu'il existe toujours beaucoup plus d'antivaleurs que de valeurs. Ce qui confirme que tous ces frères ennemis sont bien de la même famille, c'est que même la dignité comporte presque toujours quelque chose d'une indignité empêchée ou inversée. Dans l'autre sens, l'indignité est souvent le relief en creux d'une dignité tragiquement oubliée, ou niée, ou piétinée.
Voilà donc une étonnante famille, où les liens de parenté sont plus complexes que prévu. Digne, par exemple, existe sous deux sortes différentes qui ne semblent même pas issues des mêmes parents. Il y a digne tout court (quand on dit rester digne dans l'épreuve) et il y a digne de (quand on dit digne de confiance ou digne d'éloge). C'est vrai aussi d'indigne, son contraire : on peut l'employer absolument c'est-à-dire sans complément, comme quand je dis "cette conduite est indigne". Indigne joue dans ce cas le rôle d'une négation absolue : un père indigne, c'est un père qui a cessé d'être un père, un non-père. Mais on peut également employer indigne avec un complément, c'est-à-dire de façon relative, comme dans le beau vers de Racine où Phèdre exprime à son époux Thésée sa honte d'être tombée amoureuse d'Hippolyte. Parlant d'elle-même, elle dit dans un bel alexandrin : "indigne de vous plaire et de vous approcher" [3]. Il y a donc deux manières distinctes d'être digne ou indigne : l'être de quelque chose - et on peut ou on doit dire de quoi - ou au contraire l'être dans l'absolu, c'est-à-dire être digne ou indigne de rien ou, ce qui revient au même, de tout.
C'est justement cette disparition du de quoi, cette absence de référence, cette plongée dans l'énigme en somme, qui caractérise le passage de l'adjectif digne au substantif dignité : quand on emploie le nom, on ne dit pas dignité de quoi ou indignation au nom de quoi. On reste dans le supposé, dans l'implicite, dans une visée à la fois imprécise et ambitieuse qui est le signe qu'on a quitté la réalité pour entrer dans le règne des valeurs. C'est à l'entrecroisement de la réalité et de l'idéal que la dignité trouve place.
Dans toute activité de soin, la notion de dignité renvoie en effet à deux choses : d'un côté à la réalité, aux conditions matérielles et psychologiques du soin et aux situations souvent très difficiles et jugées plus ou moins dignes ou plus ou moins indignes qui les accompagnent ou qui en résultent, et d'un autre côté à une sorte d'invariant ontologique qui est l'idée de l'être humain en tant que tel, qui n'est pas susceptible de plus et de moins et qui est indépendante de toute circonstance particulière. On voit qu'il y a une double nature de la dignité, avec un versant réel et un versant idéal, qui se conjuguent de manière différente selon les époques. Par exemple, dans l'hôpital du Moyen Âge, la situation matérielle du malade, accueilli dans des salles communes, le caractère rustique de la plupart des soins, la place très modeste de la lutte contre la douleur, ont des aspects qui sembleraient plutôt indignes selon notre jugement d'aujourd'hui. En revanche, dans ce monde médiéval, les soins sont placés sous une sorte de protection divine : l'hôpital s'appelle une maison-dieu (ou un hôtel-Dieu) et le personnel soignant est invité par les règlements de l'époque à recevoir le patient hospitalisé comme "s'il était le Christ en personne". Ce qui fait alors la véritable dignité du malade, c'est qu'il est une créature de Dieu dont il faut sauver si possible le corps mais surtout l'âme. Or la recherche du salut de l'âme n'est pas incompatible - au contraire - avec la souffrance infligée au corps, qui est certes facteur d'indignité mais qui alors est conçue comme pouvant faire gagner le ciel.
Il y aurait une longue et passionnante histoire de la notion de dignité à écrire, mais c'est surtout par la dimension d'invariant ontologique que le concept de dignité a pris une place de plus en plus grande. Ainsi, dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, les valeurs suprêmes étaient l'égalité et la liberté, qui avaient le plus fait défaut sous l'Ancien Régime. Dans la Déclaration universelle de 1948, c'est la dignité qui est érigée au rang de fondement de tous les autres droits. Au lendemain des tragédies de la seconde guerre mondiale, la valeur le plus mise à mal a été jugée prioritaire et c'était évidemment la dignité. La déportation, par exemple, avait été une entreprise de destruction par négation de la dignité. Négation et non privation, car l'égale dignité entre tous les humains entraîne que la dignité, "inhérente à tous les membres de la famille humaine", selon les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne peut être retirée à personne. On le voit bien en situation extrême : quels que soient les moyens qu'il emploie, le gardien de camp ne peut jamais faire perdre à sa victime sa dignité. Il peut la bafouer, l'outrager, lui porter atteinte, mais il n'a pas le pouvoir de l'annuler. Au contraire, à s'y essayer il perdra plutôt la sienne. Le propre du crime contre l'humanité, ce n'est pas d'exclure l'autre de l'humanité, car ce projet ne peut pas aboutir - on ne peut pas altérer un invariant ontologique - c'est de s'en exclure soi-même.
On sait avec quelle fréquence et quelle insistance le mot dignité est utilisé dans le vocabu-laire contemporain, qu'il s'agisse du discours éthique, juridique, politique, social ou, évidemment, médical. On se limitera à quelques exemples. La demande de légalisation de l'euthana-sie est associée à la dénomination droit de mourir dans la dignité. Lorsque le Conseil de l'Europe a décidé d'interdire, dans un texte de 1999, le clonage humain, il a motivé sa décision en le jugeant contraire à la dignité. Pour autant, la dignité n'est pas seulement une constante du discours bioéthique : elle a en fait envahi tous les domaines. Si on demande l'amélioration des conditions de travail, on évoquera la dignité des salariés. Si on veut faire interdire ou règlementer la prostitution ou la pornographie, on avance couramment, entre autres, la dignité de la femme. Pour parler des devoirs qu'on a envers soi-même, on fait appel à l'idée de dignité sous l'angle du respect de soi. En fin de compte, la dignité est utilisée dans tous les grands débats : sur le fameux lancer de nain [4], sur la liberté ou l'interdiction de vendre ou d'acheter des services sexuels, sur la question complexe de la gestation pour autrui, qui implique la déconstruction de toute la représentation humaine de la parenté, etc. En un sens, la dignité est devenue peu à peu un concept au contenu si large qu'il sert d'argument universel, de passe-partout valable pour tout débat éthique, presque de formule magique dont tout contenu effectif semble s'être absenté.
Du coup, la dignité sert à justifier tout et son contraire et c'est pourquoi c'est une notion à risque. Dans le débat sur l'euthanasie, par exemple, elle est utilisée pour plaider aussi bien la dépénalisation que l'interdiction, les deux camps en présence se servant de la même idée de respect de la dignité pour soutenir des thèses diamétralement opposées. Ceux qui refusent l'interruption volontaire de la vie entendent par dignité que la vie humaine est sacrée et que personne n'a à juger de sa valeur en vue d'y mettre ou non un terme. Ceux qui militent pour la légalisation de cette interruption disent au contraire que toutes les vies ne se valent pas, que seuls ceux qui les vivent peuvent juger de leur valeur et décider si elles sont dignes ou indignes d'être vécues.
Cette analyse vaudrait pour beaucoup d'autres sujets soumis au questionnement éthique. La notion de dignité sert à ceux qui veulent refuser aux prostituées le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps et de leur existence, et en particulier les monnayer. Mais dignité sert tout autant à ceux qui, au contraire, ne veulent pas que le droit d'exercer cette activité soit limité ou encadré : ils invoquent l'autonomie de la personne, la libre disposition par chacun de son corps, c'est-à-dire une liberté fondamentale, une forme de dignité considérée sous l'angle particulier de la possibilité de vivre sans entraves, à laquelle il serait indigne de porter atteinte. Dans cette perspective, l'État n'a pas à interdire des actes qui ne créent de dommage à personne. C'est notamment le cas du suicide et de tout ce qui est le fait d'adultes consentants et ne lèse pas autrui, qu'il s'agisse de pratiques sexuelles, de jeux, de loisirs, d'oisiveté ou d'ivresse, etc.
Ruwen Ogien en donne un exemple volontairement provoquant mais subtil et terriblement contemporain : faut-il ou non, en vertu d'une certaine idée qu'on se fait de la dignité, condam-ner moralement une pratique qui consisterait à rester des journées entières vautré sur son canapé à regarder des séries américaines à la télévision en se gavant de biscuits chocolatés ? Si on répond que ce n'est pas indigne, en tout cas pas plus qu'autre chose, on accepte une idée assez peu glorieuse de la liberté. Exactement comme quand un Mozart en herbe "gâche ses talents musicaux en préférant les jeux vidéos à la pratique du piano" [5]. Mais si on répond, inversement, qu'il n'est pas digne d'être aussi avachi, aussi improductif, aussi gourmand, et à terme peut-être aussi obèse, ce qui serait la position des philosophes qui, d'Aristote à Kant, se sont souciés de notre bien, on risque de nier tout simplement la liberté. Car si la liberté n'est pas posée comme infinie, au moins dans son principe, on ne saura jamais où il faut tracer la ligne à partir de laquelle elle doit faire l'objet de ce qu'on appelle si bien dans le vocabulaire actuellement à la mode un "total respect". L'appel à la dignité sert très souvent à pénaliser quantité d'actions ou de relations et il a plus souvent pour effet de restreindre ou de menacer les libertés que de les garantir. C'est en ce sens que Ruwen Ogien soutient que la notion de dignité, étendue sans précaution à la totalité du champ moral, est "inutile et dangereuse" [6]. On voit donc bien à quel point la dignité est une idée controversée, incertaine, fragile.
Pour autant elle ne cesse pas de nous être absolument nécessaire. Comment donc peut-elle être à la fois risquée et indispensable ? C'est que la dignité, en fait, n'est pas une chose : une chose peut être présente ou absente, réalisée ou manquée. La dignité, comme nous l'avons déjà entrevu, est une valeur qui, comme toute valeur, est toujours à la fois présente et absente. La valeur est toujours au-delà de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Le passage entre digne de (donc de quelque chose) et digne tout court, employé absolument, est, disions-nous, celui où on quitte la réalité pour entrer dans le règne des valeurs. La valeur, en effet, est ce qui est visé, mais elle n'existe pas en dehors de cette visée, qui par définition n'aura jamais de fin. La dignité est une valeur asymptotique. Elle n'a de réalité qu'idéale : elle est ce qu'on n'aura jamais fini d'atteindre et de réaliser et non ce qu'on peut brandir à un moment donné comme un trophée qu'on a gagné. Comme toute valeur, la dignité est un horizon, une ligne vers laquelle on se dirige mais que par définition on ne peut jamais tout à fait atteindre. L'horizon, comme chacun sait, recule quand on avance.
Mais la dignité est aussi une valeur très particulière : une valeur de ce qui n'a pas de prix, de ce qui est objet non d'échange ou de commerce mais seulement de respect. Il faut repren-dre ici l'analyse classique et fondatrice de Kant. "Dans le règne des fins, dit-il, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité"[7]. La dignité est donc ce qu'on appelle une valeur absolue, du fait qu'elle est attachée à l'humanité et que l'humanité est précisément une fin en soi qui ne relève ni de l'échange ni du commerce. La dignité est en somme une valeur intrinsèque absolue. La dignité d'un être humain, quelles que puissent être les circonstances, est "la part de lui qui n'est pas un moyen mais une fin, qui ne sert à rien mais qu'il faut servir"[8]. Servir, être servi : nous retrouvons là cet axe si particulier de la dignité, qui peut être parcouru par des mouvements allant dans les deux sens. Je suis comptable de la dignité de l'autre exactement de la même façon que j'exprime la mienne et aucune des deux ne peut être ni assurée ni compromise de façon complètement séparée, parce que l'obligation d'humanité, par nature, vaut toujours de part et d'autre, dans une relation de réciprocité. Paul Ricur disait que quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Sur ce modèle, on peut dire aussi que quelque chose est toujours dû au vivant du seul fait qu'il est vivant, au malade du seul fait qu'il est malade, à la personne souffrante du seul fait qu'elle est une personne souffrante. C'est pourquoi la médecine et le soin humain ne sortent pas de leur vocation lorsqu'ils font ce qu'on appelle de l'accompagnement : ils y font au contraire entrer de plain pied le souci terriblement humain de la vie inconfortable, de la souffrance, de l'angoisse et de la mort.
Quelle catégorie utiliser, finalement, pour penser la dignité ? La dignité n'est certainement pas un principe dont il n'y aurait plus qu'à décliner imperturbablement les prescriptions, à la façon d'une procédure. Elle est plutôt un idéal qui oriente le soin humain afin qu'il vise à maintenir autant que possible la vie que les Grecs appelaient bios (la vraie vie, comme dans biographie) de préférence à la vie nue, démunie, animale, la vie qu'ils appelaient zoê (comme dans zoologie). Elle est surtout une idée régulatrice et elle est même par excellence l'idée régulatrice du soin. Si nous sommes soignés, à quelque stade que ce soit, nous ne voulons pas être soignés par des robots ni comme des robots. Si nous sommes soignants, à quelque niveau que ce soit, nous ne voulons pas accomplir des gestes qui seraient réductibles à une pure technicité. La dignité, c'est ce lien à double sens et à double profit par lequel chacun fait droit à la dignité de l'autre au nom de la sienne et aussi au nom d'une mystérieuse valeur commune qui est l'humanité même.
Notes :
[1] Cf. Platon, Ménon, 71 a-c.
[2] Cf. par exemple Iliade, 5, 787.
[3] Racine, Phèdre, acte 3, scène 4.
[4] Le lancer de nain est une attraction d'origine américaine, pratiquée surtout dans les bars ou des discothèques. Elle consiste à lancer un nain, casqué et portant une tenue rembourrée, le plus loin possible sur des matelas. En France, le Conseil d'État a décidé qu'un maire peut interdire le lancer de nain, car cette activité porte atteinte à la "dignité de la personne humaine" et trouble l'ordre public (27 octobre 1995). On peut au contraire penser que la dignité du nain est dans sa liberté de se produire dans le rôle de son choix et de tirer avantage de sa condition. Cf. sur ce sujet l'article de Céline Husson, "Lancer de nain ou lancer de nains, variations sur un thème", L'Europe des libertés, 2005, n° 11.
[5] Cf. R. Ogien, L'éthique aujourd'hui, maximalistes et minimalistes, Paris, Gallimard, 2007, p. 11 et p. 130 sq.
[6] Id., p. 172. Cf., du même auteur, La vie, la mort, l'état, le débat bioéthique, Paris, Grasset, 2009, pp. 87-88.
[7] Kant, Fondements de la métaphysique des murs, II.
[8] A. Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, Paris, PUF, 2001, p. 174.