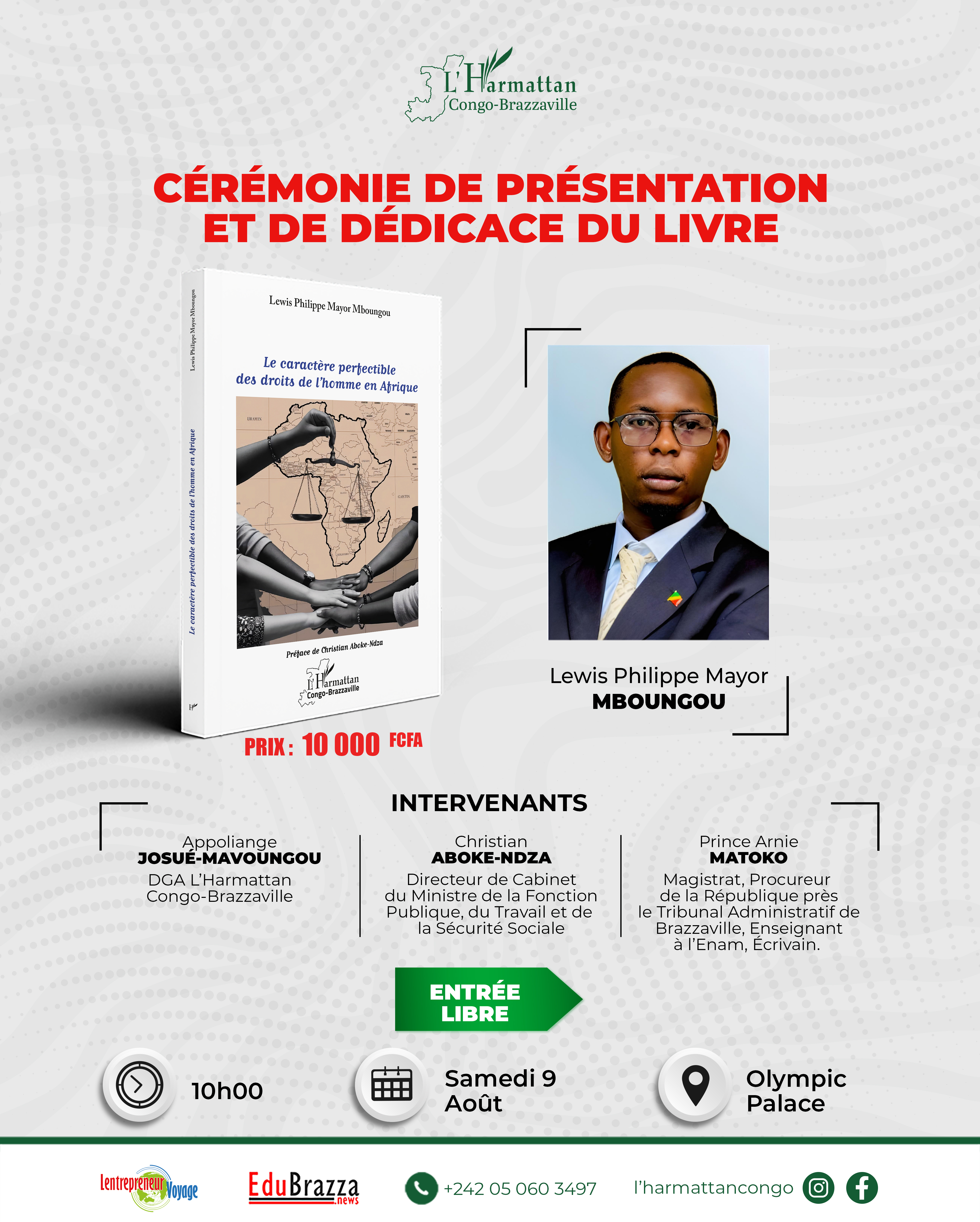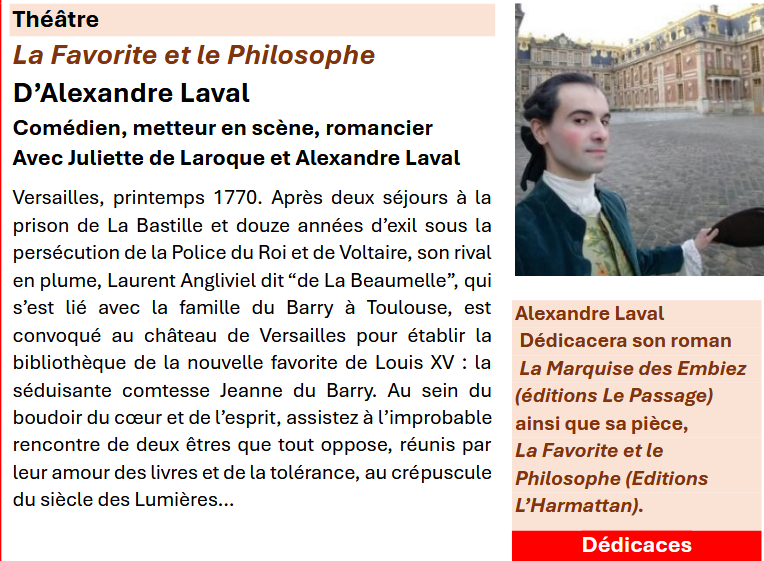Jean Patrice Ake
ContacterJean Patrice Ake
Descriptif auteur
On n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir
Ordonné prêtre depuis 1990, j'ai présenté ma thèse de Doctorat en 2003 et suis Professeur Titulaire de Philosophie depuis 2021 à l'UFR-SHS de l'Université Félix Houphouet Boigny ABIDJAN
Structure professionnelle : Université Félix Houphouet Boigny ABIDJAN 01 bp V 34 Abidjan 01 sinfuc@univ-cocody.ci
Titre(s), Diplôme(s) : PROFESSEUR TITULAIRE DE PHILOSOPHIE
Fonction(s) actuelle(s) : Prêtre Catholique
Vous avez vu 11 livre(s) sur 17
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
DE L'ETHNOGENÈSE À LA GÉNÉALOGIE CHEZ NIETZSCHE: QUELS ENSEIGNEMENTS POUR L'ETHNIE Le cahier philosophique d'Afrique Année 2008 n° 006 pp. 117-132
INTRODUCTION
Au XIXe siècle, Nietzsche, selon Henri Lefebvre, pense que "L'Homme est constitué avant tout par la Raison, (qu'il) est une raison individuelle."(1) Même si ce siècle va aussi montrer que l'homme ne se réduit pas seulement à la raison, mais qu'il est aussi, "un être sentant, agissant, volontaire et que l'individu pur et simple s'est révélé comme un être qui ne suffit pas, qui ne se trouve pas automatiquement en harmonie avec lui-même"(2), Nietzsche est trop marqué par cette époque qui découvre les sciences anthropologiques lesquelles lisent les groupes sociaux, dans les mêmes illères que la raison classificatrice. Ainsi, dans la première dissertation de la Généalogie de la morale, il répartit la société en deux groupes d'individus: d'un côté, il distingue les bons, les aristocrates, les nobles, les âmes supérieures, et de l'autre, les communs, les populaciers, les hommes du bas, les hommes simples et les mauvais.
Pour paraphraser Jean-Pierre Chrétien, nous affirmons que "la fausse clarté qui entoure ce type de classification provient en fait du regard extérieur et dominateur porté par les Européens sur l'Afrique au moins depuis l'époque de la traite et surtout durant la période coloniale.(3)" Nietzsche ne déroge pas à la règle et son regard ici est négateur d'histoire. Il arrête le film sur le passé de certains peuples (les Juifs, les Noirs) pour le remplacer par une collection de photos stéréotypées. Le projet colonial implique aussi une emprise sur les esprits et sur le passé même des dominés, il est accompagné par ce que Jean-Pierre Chrétien a appelé "un ethnicisme scientifique(4)". Le classement des peuples prolonge celui des plantes et des espèces animales et il ajoute, "les critères physiques, complétés par des marqueurs vestimentaires ou des coiffures, par des traits culturels et psychologiques, voire par l'invocation de classements bibliques, définissait autant de cellules étanches et immuables, ayant leurs défauts ou leurs vocations propres."(5)
Nietzsche emploie quatre fois le mot "ethnie" dans la Généalogie de la morale. En plus du passage précédent, il écrit: "Toute l'histoire des luttes, des victoires, des réconciliations, des fusions ethniques, tout ce qui précède la hiérarchie définitive et réunissant tous les éléments du peuple dans une grande synthèse raciale, se reflète dans l'imbroglio de la généalogie des dieux, dans les légendes qui nous content leurs luttes, leurs victoires et leurs réconciliations; la marche vers des divinités universelles, les despotisme qui supprime l'indépendance de l'aristocratie frayent toujours aussi le chemin à quelque monothéisme(6)." Parlant des "sportmen" de la sainteté et de leurs procédés d'hypnotisation systématique, il ajoute: "Aussi leur méthode compte-t-elle parmi les faits ethnologiques universels(7)". Pour terminer, un passage annonce "certaines bonnes cartes ethnographiques de l'Allemagne."(8)
Nietzsche utilise par contre, dans la Généalogie, la notion fourre-tout de race, où par exemple, "les Celtes, soit dit en passant, étaient une race absolument blonde.(9)" Ainsi, à la place du mot race employé par Nietzsche, nous lui préférons le terme d'ethnie qui est une notion complexe apparue en Europe à la fin du XVIIe siècle, avec la naissance de l'ethnologie, dont la vocation était d'étudier les sociétés autres que celles d'Europe et qui étaient considérées comme statiques et sans histoire. La première thèse que nous voulons défendre est que Nietzsche n'est pas un raciste, mais un ethnologue de son temps. Peut-être faudrait-il s'entendre sur le terme d'ethnie?
L'ethnie peut être définie "comme un ensemble stable d'êtres humains, constitué historiquement sur un territoire déterminé, possédant des particularités linguistiques, culturelles et psychiques communes et relativement stables, ainsi que la conscience de leur unité et de leur différence des autres formations semblables (conscience de soi), fixée dans l'auto-appellation (ethnonyme)."(10) Pour Jacques Maquet, l'ethnie évoque "des groupements naturels organiques, fondés sur le sang, enracinés en un certain terroir, aux origines lointaines et obscurs et correspondant en quelque sorte, à des sous-espèces du monde animal."(11) La définition la plus intéressante vient de Taylor. Selon cet ethnologue, "dans l'usage scientifique courant, le terme ethnie désigne un ensemble linguistique, culturel et territorial d'une certaine taille, le terme tribu, étant généralement réservé à des groupes de plus faible dimension."(12)
Pour affirmer leur identité, pour assurer la cohésion de leurs membres, surtout aux époques de crise, les ethnies produisent des mythes. Le mythe de l'arya que Nietzsche emploie dans la Généalogie, mythe de la pureté et de la supériorité naturelle se retrouve dans le groupe iranien et le groupe slave(13). Jean Varenne précise qu'arya est un mot sanskrit et s'écrit airya en avestique(14). Le sanskrit (le mot signifie parfait) est la langue des livres sacrés, de l'Inde: les Vedas; l'avestique, celle de l'Avesta, livre sacré de l'Iran. Ces deux langues dérivent directement du parler aryen et sont donc des frères jumeaux. L'appartenance à l'ethnie aryenne se décèle à certaines nouveautés techniques: la domestication du cheval, l'usage de chars de guerre, mais surtout à l'emploi d'une langue de la famille indo-européenne.
La deuxième thèse à démontrer, c'es que la préoccupation de Nietzsche n'est pas de gérer l'indigène, elle est plutôt d'ordre généalogique et c'est pourquoi il affirme que "toutes les tables de valeurs, tous les'tu dois' que connaît l'histoire ou l'ethnologie auraient besoin avant tout d'être éclairés et interprétés par la physiologie plus encore que par la psychologie: tous réclament la critique des sciences médicales.(15)" Nous verrons alors comment il passe de l'ethnogenèse à la généalogie. Nous démontrerons qu'une ethnie est sujet et objet d'une histoire idéologique, toujours et d'emblée. "L'histoire, nous rappelle M. Christophe Wondji, l'histoire se développe, quand un peuple prend conscience de lui-même(16)." Quand nous abordons une ethnie, nous trouvons, immédiate, une conscience de soi qui raconte et, en même temps, exalte "l'identité collective" du peuple. Le peuple est l'auteur de ce récit, de cette histoire idéologique en même temps que son objet.
Ces considérations théoriques peuvent être appliquées à la compréhension des ethnies dont parle Nietzsche dans la Généalogie de la morale.
1. De la Classification des ethnies
"Le vrai sujet de la philosophie" écrit Fabien Eboussi Boulaga, "celui qui la fait, c'est l'ethnie anonyme et éternelle.(17)" Et, bien entendu, seul l'ethnologue, sujet-supposé-savoir car détenteur de la langue philosophique sera en mesure de rendre explicite ce fondement ultime des significations culturelles que l'ethnie déploie sous son regard, et permettra à ceux qui ne se comprennent finalement pas eux-mêmes d'accéder ainsi à la connaissance de soi. Se reconnaissant maintenant dans nos mots, ceux qui ne parlent pas comme nous, acquiesceront et nous diront: "Vous nous comprenez maintenant, vous nous connaissez totalement, vous connaissez de la manière dont nous connaissons."(18)
Dans toute ethnie, nous enseigne M. Harris Memel Fôté, "une conscience de soi, pétrifiée dans des structures et animée par agents déterminés, raconte, en se référant à des catégories générales et particulières, la génèse et le devenir du peuple."(19) Parmi les récits idéologiques que cite notre auteur, figurent les légendes de Nengué pour les Sénoufo, de Boukani pour les Koulango, de Tan-Daté pour les Abron, d'Abra Pokou pour les Baul, ou d'Amlan pour les Agni-Sanwi. Qu'en est-il de Nietzsche?
Nietzsche, nous le savons, doit beaucoup à l'ethnographie britannique (Lubbock en particulier, Tylor également) au profit des sources allemandes (dont certaines jouent, il est vrai, un rôle incontestable. Nous pouvons citer les emprunts que Nietzsche fait aux travaux d'Hermann Post dans le paragraphe III, du second traité de la Généalogie de la morale.
En bon ethnologue, Nietzsche va procéder dans la Généalogie de la morale à une classification ethnique. La classification qu'il va faire est située dans le cadre sacerdotal. C'est le prêtre, missionnaire de tous les temps, qui est caché derrière l'ethnologie. Et cela Nietzsche le sait. Alors qu'à l'origine, il n'y avait pas d'ethnies, le prêtre est venu installer une dichotomie entre les groupes de personnes, afin de pouvoir les évangéliser. L'ethnicisme est devenu un jeu et parfois ce jeu a eu de très graves conséquences génocidaires en Afrique (Rwanda, Burundi).
Dans cette description Nietzsche note d'abord l'ethnie aryenne composée de puissants, de maîtres, de riches et de possédants. Leur trait de caractère typique est que les Aryens disent toujours la vérité. A ce propos, ils sont des hommes véridiques. Ils ont la tête blonde. La langue gaëlique appelle les aristocrates des Fin-Gal, de fin, nom distinctif de la noblesse. Dans cette ethnie, Nietzsche range, par exemple, les Celthes, les Goths. Il souligne qu'au fond de toutes les races aristocratiques, il y a le fauve, la superbe brute blonde avide de proie et de victoire.(20). De temps à autre, ce fauve se manifeste, ce fond caché a besoin de se libérer. Il faut qu'il sorte, qu'il retourne dans son pays sauvage. Pour nous cette bête blonde est un mythe de l'ethnie. En effet, l'analyse que Nietzsche fait ici du comportement des aristocraties guerrières est intégralement construite sur le modèle animal du fauve et les variations terminologiques destinées à le mettre est uvre: d'où la référence à la bête, puis enfin à la bête blonde. C'est toujours sur ce modèle différencié de l'animal et des diverses races animales que s'appuiera Nietzsche à la fin du paragraphe 11 de la Généalogie, pour décrire, par opposition au type d'homme caractéristique des aristocraties guerrières, l'Européen moderne rapporté quant à lui au modèle de l'animal domestique.
Ce mythe de l'ethnie a conduit de nombreux commentateurs de Nietzsche à voir en lui un raciste et un antisémite flagrants: en lui faisant signifier, en d'autres termes, une allusion au portrait idéaliste et fantasmatique de l'Aryen blond, ce qui irait dans le sens d'un enthousiasme germanophile nationaliste de Nietzsche. D'ailleurs dans un entretien entre Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Hans-Georg Gadamer, lors du cinquantième anniversaire de la mort de Nietzsche, Adorno affirme que "Nietzsche a été confisqué par les Nationaux-Socialistes et on a littéralement fait de lui l'avocat de la brute blonde, l'avocat de l'impérialisme allemand; on a ainsi cru pouvoir déduire de son uvre que seule la puissance, la volonté de puissance pouvait valoir comme norme de conduite humaine, et on a ainsi cru pouvoir l'utiliser pour justifier ce genre d'arbitraire et de violence." (21) Les remarques du paragraphe 5 au sujet de la blondeur des Celtes, et de manière plus générale la critique des valeurs du judaïsme et d'Israël comme peuple sacerdotal (notamment dans les paragraphes 7 et 16 du premier traité), ainsi que la virulence de ton adopté dans l'ensemble de ce traité, constitueraient des éléments supplémentaires renforçant la présomption de racisme.
Dans la partie finale de la phrase qui fait apparaître la formule de "bête blonde"(22), Nietzsche donne six exemples de cette bête: l'ethnie romaine, l'ethnie arabe, l'ethnie germanique, l'ethnie japonaise, l'ethnie grecque (héros homériques) et l'ethnie viking. Il nous semble pour le moins difficile de faire coïncider la totalité de ces exemples avec la blondeur au sens littéral. Si en outre l'idée même d'une signification mythique est rejetée, il nous semble que la signification de "bête" pour désigner un type d'humanité n'offre guère de sens. A cela il faudrait ajouter un troisième élément: Nietzsche soulignera bientôt qu'il n'existe pas de rapport de sang entre les anciens Germains et les Allemands contemporains. Enfin il faudrait mentionner un quatrième point: la condamnation énoncée dans les textes posthumes de 1888, à propos des Lois de Manou: "Nous avons le modèle classique, spécifiquement aryen: nous pouvons donc rendre l'espèce d'homme la mieux équipée et la plus réfléchie responsable du mensonge le plus radical qui fut jamais fait...On a imité cela, presque partout: l'influence aryenne a perverti le monde entier(23)..." A quoi il faut ajouter la présence constante, dans la Généalogie de la morale II,12, par exemple, d'une condamnation explicite de l'antisémitisme, si constante dans les textes de Nietzsche que l'on peut citer aisément d'innombrables autres exemples.
Il demeure que s'il ne vise pas à travers son expression de bête blonde l'incarnation d'un mythe ethnique ou d'un mythe de la pureté raciale aryenne à la mode chez les antisémites de son temps, ou d'autres, Nietzsche ne nous paraît pas pour autant à l'abri de la critique; pour la raison suivante: c'est une chose que de se rendre expressément coupable de déclarations racistes, et une chose grave; c'en est une autre que de prendre le risque de la mésinterprétation de ses propos en un sens éventuellement raciste, et elle ne nous paraît guère moins grave. Que ce soit par maladresse ou par inconscience, Nietzsche nous paraît prendre indubitablement un tel risque. Il ne cesse de répéter qu'il sait ne pouvoir être compris avant longtemps, en raison de la radicalité du bouleversement des habitudes de pensée instaurées par son questionnement nouveau, en raison aussi et surtout (c'en est la conséquence) du bouleversement des habitudes d'expression instaurées par son nouveau langage, et notamment la logique d'enchaînements et de déplacements métaphoriques multiples et mythiques qui le constitue. Nietzsche sait fort bien par conséquent, il s'ouvre parfois à son lecteur du reste, qu'il sera non pas incompris, mais compris de travers, que sa pensée sera mésinterprétée et déformée. On peut juger que la mésinterprétation sera sans grande conséquence lorsqu'elle portera sur la critique des procédures de pensée métaphysique, problème qui ne captivera guère que le cercle étroit des spécialistes. Il en va tout autrement quand il s'agit d'un problème aussi sensible que celui du racisme, particulièrement dans une atmosphère réceptive comme l'est celle de l'Allemagne (et généralement de l'Europe) de la fin du XIXe siècle.
A côté du premier groupe constitué par l'ethnie aryenne, il y a un second: l'ethnie nègre. Cette ethnie est composée d'hommes du commun, d'hommes de couleurs. Ce sont des hommes aux cheveux noirs. Ces indigènes, foncés aux cheveux noirs, préaryens du sol, italique tranchent nettement par leur couleur. L'ethnie juive, caste sacerdotale (24), peut se ranger dans cette catégorie. Leur trait typique est qu'ils ne disent pas la vérité. De façon explicite, Nietzsche soutient que "l'homme du commun (est) homme de couleur foncée, surtout...homme aux cheveux noirs puisque l'indigène préaryen du sol italique tranche le plus nettement par sa couleur sur la race blonde des conquérants aryens, devenus ses maîtres...le bon, le noble, le pur, désignait à l'origine la tête blonde en opposition aux indigènes foncés aux cheveux noirs." (25). Hic niger est, c'est-à-dire celui-là est noir, est une formule que Nietzsche a déjà utilisée pour en faire le titre du paragraphe 203 du Gai savoir, et qu'il emprunte aux Satires d'Horace (I, 4, vers 85: Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto ""Celui-là est noir, prend garde à lui, Romain!"). Le passage s'applique au faux ami, traître et hypocrite. Les conséquences que Nietzsche en tire pour l'ethnie nègre est que le nègre est un menteur, un homme peu digne de confiance.
Nietzsche ne s'arrête pas à cette classification car entre les deux groupes il y a un métissage des ethnies. Il parle alors de "mélange des races." (26) Devant ce problème, nous pensons avec Nietzsche que l'unité ethnique est une unité de façade. Et nous soutenons que l'affirmation ethnique, telle qu'il nous la présente, dans des formations sociales inachevées et dans une historicité écartelée, est l'ultime repli culturel. L'identité est une totalité décomposable.
2. De la Généalogie de l'ethnie.
Nietzsche ne se contente pas de faire l'ethnogenèse des peuples, il va nous montrer qu'il est aussi un généalogiste. Qu'en est-il de la généalogie? Un nouveau point de départ est indispensable: c'est à travers l'introduction du concept de généalogie que Nietzsche détaille les processus et les enjeux de l'ethnogenèse, en affinant et en synthétisant les analyses de Par-delà le bien et le mal et du Gai savoir.
Faire une généalogie, c'est avant tout mettre en uvre un questionnement régressif, c'est remonter vers l'origine, ou plutôt vers les origines en tant qu'elles sont sources productrices d'une interprétation, mode d'investigation qui se veut plus profond que la recherche de la cause, du principe ou du fondement: le déplacement de l'interrogation n'est pas un simple redoublement de l'interrogation: il ne s'agit pas de chercher la cause de la cause, ou le fondement du fondement, mais d'abandonner l'idée-même d'une enquête sur la cause et sur la raison. A travers les conditions d'émergence propres à une interprétation de la réalité, Nietzsche vise très précisément en réalité les pulsions qui commandent cette interprétation. La généalogie représente ainsi le contraire du dogmatisme, en cela que le dogmatisme consiste à ne plus interroger son questionnement, à faire comme si les questions allaient de soi, à admettre sans aucun recul critique une certaine valorisation. Le dogmatisme recouvre la pensée oublieuse de ses origines, en d'autres termes la pensée qui cherche à se couper de ses conditions de constitution et d'émergence pour se présenter comme autonome et objective.
Pour bien comprendre l'origine de la pensée généalogique de l'ethnie, nous disons que cette pensée prend son origine dans la pensée ecclésiastique. En effet selon Taylor, "dérivée du grec ethnos, néo-latinisée puis francisée et anglicisée, l'expression ethnie, reste longtemps d'usage exclusivement ecclésiastique. Elle dénote, par opposition aux chrétiens, les peuples païens ou'gentils', qu'en langage séculier on appellera d'abord nations ou peuples, puis, à partir du XIXe siècle, races et tribus, alors même que la science en charge de leur description s'appelle depuis la fin du XVIIIe siècle ethnologie ou ethnographie." (27). Au début du XXe siècle, les termes (ethnologie, ethnographie) sont progressivement concurrencés ou supplantés, selon notre auteur, par divers néologismes, comme le français ethnie (ré)inventé par Vacher de Lapouge en 1896, ou les termes allemands ethnicum et ethnikos. Leur apparition est concomitante avec le déplacement sémantique des substantifs jadis utilisés: nation est désormais réservé aux Etats "civilisés" de l'Occident, peuple, en tant que sujet d'un destin historique, est trop noble pour des sauvages (du moins en français), race, centré maintenant sur des critères purement physiques, est trop général, sorte de "nation" au rabais, l'ethnie se définit par une somme de traits négatifs. Son émergence répond aussi aux exigences d'encadrement administratif et intellectuel de la colonisation. N'est-ce pas cette définition qui a inspiré Nietzsche lorsqu'il s'intéresse à l'ethnie juive?
Pour Nietzsche, l'ethnie juive est une caste sacerdotale. Une caste est un ensemble de personnes qui sont séparées des autres de part leur origine. Cette ethnie juive est fondée sur le mythe de la pureté raciale. Sa classe sociale est la classe pure et les autres sont la classe impure. Le juif n'est à l'origine qu'un homme "qui se lave, qui s'interdit certains aliments entraînant des maladies de la peau, qui ne fréquente pas les femmes malpropres du bas peuple et qui a horreur du sang (28)." Mais Nietzsche trouve quelque chose de malsain dans cette aristocratie sacerdotale.
Cette aristocratie est malade car frappée d'une neurasthénie, d'une débilité intestinale. Le remède qu'elle a inventé pour guérir est de s'interdire de manger de la viande, de jeûner et de s'abstenir sexuellement. Contre ces aristocrates juifs, Nietzsche recommande les cures du Docteur Silas Weir Mitchell. Ce dernier est un médecin américain spécialiste du traitement des affections neurologiques. Ses cures de repos, accordant une importance primordiale à l'isolement du patient, lui apportèrent une grande notoriété.
Le juif est un prêtre, ennemi des sens, un fakir et un brahmane. Il est orgueilleux, revanchard, perspicace, débauché, amoureux, assoiffé de pouvoir, vertueux et malade. Il est l'ennemi le plus méchant. L'impuissance a fait naître en lui une haine féroce, monstrueuse, haineuse et venimeuse.(29)Le juif accroît sa domination sur les âmes d'élite, les nobles, les puissants par sa narcose mystique.
En face de l'ethnie juive, se dresse l'ethnie chrétienne. Dans le célèbre passage que lui a fourni son ami et collègue de Bâle, Franz Overbeck, spécialiste du christianisme primitif, Nietzsche pointe l'hostilité violente de Tertullien à l'égard des Juifs(30), comme pour souligner la présence d'une composante antisémite appuyée dans le christianisme primitif. Cette idée sera reprise et développée dans l'Antéchrist (31): le ressentiment animant le mouvement de révolte qu'est le christianisme naissant vise en premier lieu le clergé juif institué.
Le conflit historique entre le monde romain catholique et le judaïsme n'est que l'une des manifestations du conflit axiologique dessiné par Nietzsche. La netteté de l'opposition confère à coup sûr à ce cas particulier une valeur paradigmatique, révélatrice de l'enjeu réel de la rivalité par-delà l'apparence d'une rivalité politique, mais il ne s'agit néanmoins que d'un cas particulier, d'une traduction historique du combat entre valeurs parmi bien d'autres traductions historiques dont la suite du paragraphe 16 du premier traité de la Généalogie va du reste donner des exemples. Nietzsche n'identifie pas la faiblesse au judaïsme, pas plus qu'il n'accorde à Rome le monopole de la force. Le christianisme originaire, la Réforme ou encore la culture de la Révolution française sont isomorphes à la faiblesse sans relever du judaïsme, ni au point de vue doctrinal, ni au point de vue historique; la Renaissance italienne ou la culture incarnée par Napoléon sont de valeur équivalente à la culture de la Rome antique sans lui appartenir pour autant. Loin d'épuiser par eux-mêmes la situation analysée par Nietzsche, Rome et le judaïsme fournissent tout au contraire des modèles d'intelligibilité applicables à d'autres séquences historiques. Ce paragraphe, on le voit, fournit un bon exemple du caractère typologique de la réflexion nietzschéenne et de son souci de mettre en évidence des lignes isochroniques de culture.
Finalement Nietzsche affirme "qu'il suffit de comparer avec les Juifs des peuples aux dons analogues, par exemple les chinois ou les Allemands, pour discerner ce qui est premier et ce qui est de cinquième ordre.(32)." Dans ce passage, Nietzsche affirme clairement que loin de constituer une sorte d'antithèse des Juifs (ce que vise la notion d'aryanité chez les théoriciens racistes et nationalistes de l'Allemagne par leurs dispositions spécifiques; la seule différence que Nietzsche relève n'est pas à l'avantage de ses compatriotes: elle tient à ce que ces dispositions demeurent chez les Allemands embryonnaires, peu élaborées, et dépourvues de la génialité qui caractérise en revanche les Juifs.
M. Boa Thiémélé Léon Ramsès s'est interrogé sur la question des origines chez Nietzsche et Cheick Anta Diop. Nous soulignons cette réflexion de notre auteur: "Nietzsche veut d'une Europe aristocratique façonnée dans du granit et par la force. La force, la violence ou la guerre aident un nouveau type à se fixer. Cette nouvelle race ainsi créée par la grande santé sera tout l'opposé des médiocres puisque les membres auront des caractères très accusés, en somme une race d'hommes sévères, belliqueux, taciturnes, fermes et secrets. Ces hommes seront libres, d'autant plus libres qu'ils auront été guerriers.(33)" A l'origine de cette Europe, notre auteur soutient que "contre l'Allemagne des royaumes et du nationalisme, Nietzsche glorifie la Grèce(34)."
Conclusion
Dans cette présente étude, nous avons voulu interroger Nietzsche sur ce qu'il avait à dire sur l'ethnie dans son livre la Généalogie de la morale. Nous sommes partis de l'ethnie, de sa naissance. Des auteurs comme Amselle ont affirmé que: "La cause paraît donc entendue: il n'existait rien qui ressemblât à une ethnie pendant la période précoloniale. Les ethnies ne procèdent que de l'action du colonisateur qui, dans sa volonté de territorialiser le continent africain, a découpé des entités ethniques qui ont été elles-mêmes ensuite réappropriées par les populations. Dans cette perspective, l'ethnie, comme de nombreuses institutions prétendues primitives, ne serait qu'un faux archaïsme de plus.(35)".
Nietzsche, en homme du XIXe siècle, a bénéficié du classement des peuples de son époque. Cette ethnogenèse que nous avons traitée dans notre première partie, nous a fait découvrir que l'ethnie est sujet et objet d'une histoire idéologique. Mais Nietzsche ne se contente pas de jouer à l'ethnologue, il interprète aussi en généalogue. C'est le sujet de notre deuxième partie. Son langage abscons a été diversement interprété car la question raciale est un sujet sensible. Notre position est claire là-dessus: Nietzsche n'est pas un raciste, mais il continuera toujours de nous faire frissonner. Avec Gadamer, voici une anecdote qui nous fait penser à l'origine de Nietzsche: "Je ne sais pas, Messieurs, si vous êtes déjà allés sur la tombe de Nietzsche...Je suis allé là-bas une fois, à Röcken, le petit village où il est né, aux environs de Leipzig, dans une région désolée à laquelle l'Histoire du monde, on le sait, ne s'est intéressée que pour y livrer des batailles. Des oies sur le chemin aux abords du village, trois monumentales plaques funéraires en fonte: Nietzsche entouré de ses parents. On ne peut pas les regarder sans qu'un certain frisson vous gagne et sans penser qu'un fils de pasteur de saxe a dit un jour: Je suis de la dynamite", et qu'il n'a pas eu absolument tort.(36)"
Bibliographie
(P.J. AKE, "Nietzsche et la critique du Prêtre". Thèse de Doctorat Unique en Philosophie (Mai 2003), sous la direction du Prof. NIAMKEY Koffi Robert.
(De J.-L.) AMSELLE et (E.) M'BOKOLO (éd.)- Au cur de l'ethnie (PARIS, La Découverte, 1985)
(T.L.R.) BOA, "Convergences de vue entre Cheick Anta Diop et Nietzsche à propos des origines" dans Annales Philosophiques de l'UCAO n° 1, 2004
(J.-P.) CHRÉTIEN et (G.) PRUNIER (Sous la direction de).- Les ethnies ont une histoire (Paris, Karthala, 2003)
(F.) EBOUSSI-BOULAGA.- La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie (Paris, Présence Africaine 1977)
(H.-G.) GADAMER.- Nietzsche l'antipode. Le drame de Zarathoustra. Suivi de Nietzsche et nous, entretien entre Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Hans-Georg Gadamer (Paris, Allia, 2000)
(H.) LEFEBVRE.- Nietzsche (Paris, Editions Syllepse, 2003)
(J.) MAQUET "ethnie" dans Dictionnaire des civilisations africaines, Fernand Hazan 1968
(F. H.) MEMEL, "L'ethnie et son histoire. A propos de l'histoire culturelle des Odjoukrou dans Kasa Bya Kasa, Institut d'ethnosociologie, Université d'Abidjan n° 11 avril 1977
(F.) NIETZSCHE.- Humain trop Humain II- Fragments Posthumes, traduction par Robert Rovini (Paris, Gallimard 1968)
(F.) NIETZSCHE.- La Généalogie de la morale (Paris, Gallimard, 1971)
(A.) KOUANDA.- Processus ethniques en Urss, (éditions du progrès, Moscou 1983) in la Religion musulmane: facteur d'intégration ou d'identification ethnique. Le cas des Yarse du Burkina Faso
(A.C.) TAYLOR "ethnie" sous la direction de (P.) BONTE & (M.) IZARD.- Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie (Paris, PUF 1991)
(P.) TEMPELS.- La philosophie Bantoue (Paris, Présence africaine 1959)
(J.) VARENNE.- Zarathushtra et la tradition mazdéenne (Paris, Seuil, 1966)
(C.) WONDJI.- Le peuple et son histoire dans Godo Godo, Bulletin de l'IHAAA n° 1, octobre 1975.
Notes :
NOTES
1. LEFEBVRE (Henri) Nietzsche (Paris, Editions Syllepse, 2003), p. 29
2. Ibid. p. 30
3. CHRETIEN(Jean-Pierre) et PRUNIER(Gérard) (Sous la direction de).- Les ethnies ont une histoire (Paris, Karthala, 2003), p. VIII
4. Ibid.
5. Ibid.
6. NIETZSCHE (Friedrich).- La Généalogie de la morale (Paris, Gallimard, 1971), p. 102
7. Ibid., p. 158
8. Ibid., p. 27
9. Ibid.
10. KOUANDA (Assimi) Processus ethniques en URSS, (MOSCOU, 1983), p. 10
11. MAQUET (Jacques) "Ethnie" dans Dictionnaire des civilisations africaines, P. 159
12. TAYLOR (A.C.) "ethnie" sous la direction de BONTE (P.) et IZARD(M.) Dictionnaire de l'ethnologie et de l'athropologie (Paris, PUF, 1991), p. 242
13 NIETZSCHE.- o.c. p. 26
14. VARENNE (Jean).- Zarathushtra et la tradition mazdéenne (Paris, Seuil 1966), p. 17
15. NIETZSCHE.- o.c., p. 56
16 WONDJI (Christophe).- Le peuple et son histoire dans Godo Godo, Bulletin de l'IHAAA n° 1 octobre 1975, p. 20
17 EBOUSSI BOULAGA (F.) La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie (Pris, Présence africaine 1977), p. 30
18 TEMPELS (P.) La philosophie Bantoue (Paris, Présence africaine 1959), p. 36
19 MEMEL (H.F.).- L"ethnie et son histoire. A propos de l'histoire culturelle des Odjoukrous dans Kasa Bya Kasa, Institut d'ethnosociologie Universitéd'Abidjan n° 11 avril 1977, p. 46
20. NIETZSCHE (F.) o.c., p. 40
21 GADAMER (H.G.).- Nietzsche l'antipode. Le drame de Zarathoustra. Suivi de Nietzsche et nous. Entretien entre T. Adorno, M. Horkheimer et HG Gadamer (Paris, Allia, 2000), pp. 51-52
22. NIETZSCHE, o. c., p. 40
23 NIETZSCHE.- Humain trop humain II, FP XIV, 15(45)
24 NIETZSCHE.- Généalogie de la morale, p. 28
25. Ibid., p. 26-27
26 Ibdi. p. 34
27. TAYLOR. o.c., p. 242
28 NIETZSCHE. o. c., p. 28
29 AKE (J.P.).- Nietzsche et la critique du prêtre. Thèse de Doctorat sous la direction du Prof. NIAMKEY Koffi 2003) tome 1, p. 6ss
29. NIETZSCHE. o.c., p. 50
30. NIETZSCHE.- L'Antéchrist, P. 35
31. NIETZSCHE.- La Généalogie...P. 54
32. BOA (T.L.R).- Convergence de vue entre Cheick Anta Diop et Nietzsche in Annales Philosophiques de l'UCAO n° 1, 2004, p. 42
33. Ibid., p. 39
34. AMSELLE (De Jean-Loup) et MBOKOLO (Elikia). Au coeur de l'ethnie (Paris La découverte 1985), p. 23
36 GADAMER. o.c., p. 68
AU COMMENCEMENT ETAIT LE LOGOS DU LOGOS D'HERMES AU LOGOS D'HERACLITE
INTRODUCTION GENERALE
La philosophie, depuis l'Antiquité grecque, veut savoir ce qu'est tout être en réalité et en vérité. N'est donc pas philosophique, aux dires de Gigon, "l'opinion des hommes qui se contentent d'impressions superficielles, qui effleurent à peine les problèmes les plus difficiles et demeurent dans un étonnement naïf devant les phénomènes les plus bénins(1)." Est philosophique, ce qui est de l'ordre de la totalisation du savoir, ce qui concerne la conduite de la vie, grâce à une connaissance intellectuelle de soi et de l'univers. La philosophie, ainsi que le souligne Jean Seidengart, "répond à un besoin d'accumuler le savoir que de le comprendre. Elle est une mise en ordre systématique des connaissances sous une unité architectonique où l'idée du tout détermine l'ensemble des relations possibles, entre les parties(2)."
La philosophie de la nature, quant à elle, est incluse et englobée dans les tâches proprement philosophiques. Elle est aussi philosophie naturelle, au sens où l'entend Ambacher, "car (elle) rassemble donc tous les détails empiriques qui entrent dans la vision aristotélicienne du monde(3) ". Dès l'Antiquité, un divorce s'est opéré entre la philosophie de la nature, appartenant à la philosophie, soucieuse de déterminer la véritable nature des choses, et l'astronomie qui est une technique opératoire et artificielle mais efficace. La philosophie veut connaître ce qu'est la nature, "car (elle) est devenue un problème(4)." Aussi la philosophie de la nature cherche à découvrir le véritable "système du Monde". Elle a pour objet, selon Maritain, " dans toutes les choses de la nature sensible, non pas le détail des phénomènes, mais l'être intelligible lui-même en tant que mouvant, ou encore les différences de l'être qu'elle peut déchiffrer, en visant la nature intelligible, mais sans élaguer les données du sens, dans le monde de la mutabilité ontologique5(5)."
Comme tous les Présocratiques, Héraclite d'Ephèse s'est aussi intéressé à la nature et Diogène Laërce atteste bien que "le livre qu'on attribue à Héraclite parle de la nature d'un bout à l'autre, mais se divise en trois parties, sur le tout, sur la politique, sur la théologie(6)." Dans cette nature, Héraclite a proposé le feu comme l'élément primitif à partir duquel le monde a pris naissance. Mais Héraclite a été considéré comme philosophe par l'histoire quand il a affirmé que ce feu primordial est aussi le logos.
L'objet de cet article est de montrer que le logos d'Héraclite ne peut pas échapper à Hermès-logos. Il est muthos parce qu'il ne se définit mieux que dans la symbolique. Parce qu'il dit tout à la fois, il devient inaudible et silencieux. Et parce qu'il est silence, il se laisse contempler et finalement le logos devient objet de contemplation, donc philosophie.
1. HERMES-LOGOS OU LE DIEU DE LA SAGESSE ET DE LA RAISON
L'idée de partir d'Hermès m'a été suggéré par Michel Serrès qui écrit à son sujet qu'il est "(le) dieu des carrefours et chemins, des marchands et des messages, (et il) porte des ailes aux chevilles, le caducée à la main ; il vole, vite, sait les secrets, invente, met en communication(7)." Michel Serrès l'a choisi comme l'emblème d'une philosophie qui ne cesse de parler de lui. A la suite de cet auteur, notre démarche serait de partir d'Hermès, comme symbole du logos, et avec lui découvrir toutes les caractéristiques et toute la symbolique du logos qui pourrait par la suite éclairer celui d'Héraclite.
Sur sa naissance, nous avons plusieurs versions de mythes. Une première version de mythes selon Robert Graves le fait naître sur le mont Cyllène. Et il ajoute que "sa mère Maïa le déposa dans ses langes sur un van d'osier, mais il grandit et devint un petit garçon avec une surprenante rapidité, et dès qu'elle eut le dos tourné, il s'esquiva et partit en quête d'aventures(8)." Il est le fils de Zeus(Jupiter). Les Grecs le nommaient Hermès, c'est-à-dire interprète ou messager. Son nom latin venait du mot Merces, marchandise. Et Commelin de conclure : "Le mercredi, jour de la semaine, lui est consacré'Mercurii dies'. (9)"
Une autre version de Graves, atteste qu'Hermès est "né en tant que dieu, des phallus de pierres qui étaient des centres locaux d'un culte de fertilité préhellénique du dieu égyptien Thoth, le dieu de l'intelligence, et d'Anubis, guide des âmes dans le monde souterrain.(10)"
A ces deux versions de mythes correspondent aussi plusieurs caractéristiques d'Hermès. Hermès est, selon Jacques Chevalier et Alain Gheerbrant, "(l') un des symboles de l'intelligence industrieuse et réalisatrice ; il préside au commerce. Il a pour attribut des sandales ailées, qui signifient la force d'élévation et l'aptitude aux déplacements rapides ; mais c'est une force limitée à un niveau quelque peu utilitaire et facilement corruptible(11)."
En outre, nos auteurs ajoutent qu'Hermès "inventa la lyre en tendant sur la carapace d'une tortue des cordes fabriquées avec les intestins des bufs qu'il avait sacrifiés. Ce fut la première lyre qu'Apollon adopta, après en avoir entendu les accords provenant du fond d'une grotte où s'était réfugié Hermès. Il inventa ensuite la flûte, dont il fit présent à Apollon, en échange de leçons de magie divinatoire et du caducée d'or(12)."
Hermès est aussi le messager de Zeus auprès des dieux des Enfers, Hadès et Perséphone. Felix Buffière précise qu'il est le messager des dieux en trois grandes circonstances : "dans l'Iliade, il conduit Priam auprès d'Achille ; dans l'Odyssée, il est dépêché à la nymphe Calypso pour lui intimer l'ordre de laisser partir Ulysse ; il remet enfin à Ulysse le moly, l'herbe magique qui le protégera des enchantements de Circé(13)."
Hermès est surtout l'interprète et son nom est rattaché à herméneus. Félix Buffière nous en donne l'exégèse en se référant au Cratyle de Platon : "Les caractères d'interprète, de messager, d'adroit voleur, de trompeur en paroles et d'habile marchand, c'est au pouvoir du discours (logos) que se rattache toute cette activité(14) ". Et il ajoute : "Hermès est'le dieu qui imagina le langage et le discours' : c'est le dieu de la parole et de là découlent toutes les autres attributions(15)." Comme nous le faisons observer, la polyphonie du logos correspond aussi à la multiplicité des tâches d'Hermès. L'une des conséquences que nous voulons déduire est celle de la parole qui lutte contre l'oubli. En Théomachie, Hermès a pour adversaire Létô.
Sur ce point, nous nous remettons à l'érudition de Félix Buffière qui souligne que "'Devant Létô se dresse Hermès : c'est normal, puisqu'il n'est autre chose que la parole, servant à traduire nos sentiments intérieurs : or à toute parole s'oppose Létô ou l'oubli (il suffit de changer une lettre, Léthô ou Léthé pour Létô). Ce dont on perd le souvenir ne saurait être proclamé' La victoire de Létô s'explique : car'l'oubli triomphe des plus clairs souvenirs en les ensevelissant dans le silence(16) ".
Le logos montre sa puissance étrange dans un grand moment de l'Iliade, lorsque Priam aux genoux d'Achille s'écrit : "Souviens-toi de ton père, Achille, pareil aux dieux. Il a mon âge, il est tout comme moi au seuil maudit de la vieillesse(17)." Le logos a fait surgir ici devant les yeux du héros le souvenir d'un vieux père attendant son enfant, et ce cur intraitable s'attendrit.
C'est Hermès-Logos qui a fait le miracle. Dans la nuit, il a mené Priam jusqu'à la baraque d'Achille. avant de le quitter, il lui a suggéré le thème de sa prière que nous reproduit Buffière en ces termes : "Supplie-le au nom de son père(18) ". Hermès incarne ici, la force merveilleuse du logos, l'arme des faibles et leur seule arme.
Le logos personnifie aussi l'éloquence, chez Hermès, le messager aux clairs rayons. Dans l'Odyssée, au chant V, Hermès-logos vient porter à Calypso un ordre de Zeus : elle ne doit plus s'opposer au départ d'Ulysse. Buffière interprète pour nous cette allégorie : "C'est l'éloquence d'Ulysse qu'Homère a ainsi matérialisée. Ulysse a réussi à convaincre la tendre nymphe de lui laisser reprendre la mer et l'aventure, et la route d'Itaque. Ulysse s'y connaît en éloquence : il sait mieux que personne manier ces mots ailés que le vol d'Hermès symbolise. Le dieu rayonnant qui plonge de l'azur et court sur les flots tel un goéland en chasse, c'est l'envol rapide sur les lèvres de l'orateur, des mots au pouvoir magique(19)."
Le logos peut aussi devenir logismos, c'est-à-dire, la voix intime de la raison. Suivons ensemble cet autre épisode de la vie d'Hermès. Ulysse va pénétrer dans la grande demeure de Circé ; Hermès lui apparaît, tenant sa baguette d'or : "Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux, tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas(20) ?" Le logos n'est pas descendu du ciel ; il était dans l'âme même d'Ulysse. Ulysse est parti chez la drogueuse dans un moment d'exaltation, dans un moment de douleur et de colère, lorsqu'il a su la terrible aventure : ses compagnons changés en bêtes par Circé. Mais peu à peu cette exaltation tombe, et le logos froid se fait jour, avec le sens des réalités. C'est cette voix intime du logos, devenu ici logismos, qui reproche à Ulysse son inutile empressement. Le logos devient alors raison et non plus parole.
Nous verrons un peu plus loin l'extension du mot logos en grec qui exprime aussi bien la notion de langage que celle de raison ou raisonnement. D'après le témoignage de Buffière, "les Stoïciens consacreront cette distinction dans leur vocabulaire philosophique : ils appelleront'parole intérieure' la réflexion intime, et'parole extériorisée', celle qui traduit tout haut la pensée(21) ". Et il ajoute : "Les dieux, par exemple, ignorent le langage sonore : ils ne connaissent que le logos silencieux(22)." Ainsi nous assistons à un dédoublement du logos. Hermès-logos se dédouble en une divinité chthonienne et en une divinité céleste. Hermès-logos chthonien, c'est la parole intérieure, invisible et enveloppée d'ombre, dans les profondeurs de la pensée ; Hermès-logos céleste, c'est la parole exprimée, perceptible à distance.
Hermès-logos donne à Ulysse une herbe magique, qui le protégera des enchantements de Circé : le moly, dont la racine est noire et la fleur est de couleur blanche. Cette plante qui désigne la sagesse (phronésis), fait dire à Buffière que "noire est la racine, parce que les premiers pas de cette voie sont toujours pénibles, mais si l'on a le courage de persévérer, on voit bientôt s'épanouir dans la lumière la précieuse fleur(23)." En fait, ce moly est le symbole du logos et de sa vertu pacifiante, puisque la raison (ou le raisonnement) calme les élans et les passions de l'âme.
La baguette d'Hermès dans l'Iliade(24) charme à son gré les yeux des mortels ou réveillent ceux qui dorment. Elle lui servira à endormir les gardes achéens, quand l'attelage arrivera près du mur et du fossé qui protègent les nefs. Rendant compte du commentaire de ces vers homériques, Félix Buffière écrit que la baguette d'Hermès-logos ne s'applique pas "aux yeux du corps, mais au monde de la pensée(25)." Car ajoute-t-il "rien n'est plus facile au logos que d'exciter les esprits indolents, de calmer au contraire les esprits trop excités(26)."
Cette baguette magique est le véritable sceptre de l'orateur ; elle traduit le caractère royal du logos, sa puissance souveraine. Le logos a ces deux effets contraires, d'éveiller et d'endormir : il tient éveillés ceux qui ont compris sa beauté ; il endort ceux qui ne sont pas dignes de lui et ne saisissent pas sa grandeur. On peut dire aussi que le logos sait éveiller les passions, lorsqu'il se fait accusateur, au tribunal ; mais qu'il peut à l'inverse calmer les colères, par ses pathétiques appels, et même opérer de véritables incantations.
Hermès-logos est couramment nommé chrysorrapis, "à la baguette d'or" : c'est que les coups de baguette du logos - ses remontrances, ses réprimandes - sont précieux comme de l'or à qui sait en tenir compte.
La baguette d'Hermès-logos symbolise aussi ses conseils, capables d'apaiser les âmes troublées, de réveiller les curs abattus. Elle symbolise encore la ligne droite que le logos nous fait suivre, telle une règle.
Hermès-logos est aussi appelé argeïphontès, "meurtier d'Argos(27)". Argeïphontès désigne une qualité du logos. Il est celui qui fait voir les choses sous de brillantes couleurs et a pour objet de traduire la pensée et de la rendre claire. Mais Argeïphontès signifie aussi, "le meurtrier de la presse", "celui qui détruit les raisonnements paresseux et inefficaces" ou encore "blanc et pur de tout crime". Car le logos est pacifique est pacifique, ennemie du sang ; il s'efforce de verser dans les âmes accord et harmonie. Cette nouvelle idée est illustrée par Félix Buffière lorsqu'il écrit : "Losqu'Egisthe s'apprêtait à tuer Agamemnon, les dieux, pour l'en détourner, lui envoyèrent Hermès, le messager argeïphontès ". Il s'agit du logos, dont le ciel a fait don à la terre, pour que le bien y règne et que le mal en disparaisse.
Porte-parole de Zeus, son héraut, son interprète, Hermès-logos n'a pas eu de peine à s'identifier à la parole : et il est devenu presque automatiquement la raison, parce que le mot logos avait l'un et l'autre sens. Mais le logos, dans la philosophie du Portique, joue un rôle considérable : il est la raison divine, immanente au monde et qui en parcourt toutes les parties comme le frémissement de l'eau se communique d'une ride à l'autre. Cette raison s'identifie à la loi du monde, à la Providence, au Destin. Une autre philosophie dans laquelle le logos est la pierre angulaire est celle d'Héraclite d'Ephèse. Nous allons en parler à présent, mais avant essayons de définir ce qu'il faut entendre par logos.
2. LE LOGOS CHEZ HERACLITE D'EPHESE
LES MULTIPLES SIGNIFICATIONS DU LOGOS
Logos désigne beaucoup de choses. Dans le Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paul Chantraine nous apprend que le terme logos vient du verbe "lego" dont le sens originel est "rassembler", "cueillir", "choisir", d'où "compter", "dénombrer"(28). Donaldo Schüler poursuit la réflexion en attestant que "Homère emploie le verbe lego, de la même racine que logos, pour le processus de recueillir des aliments, des armes et des os, pour réunir des hommes. Chacune de ces opérations implique un comportement judicieux ; on ne réunit pas des armes, par exemple, sans les distinguer d'autres objets(29) ".
La valeur originelle de logos est bien conservée dans les thèmes à préverbes, "dia", ou "ek". "Dialego" a donné les verbes "trier", "choisir", tandis que "eklego" a donné les verbes "choisir", "trier". On l'emploie notamment pour les soldats dans le sens de "lever une taxe". "Lego" signifie parfois "énumérer", "débiter des injures", "bavarder", "discourir". Ainsi est né l'emploi au sens de "raconter", "dire".
Comme noms d'action, lego a donné "lexis", qui signifie "parole", "mot", "style" également avec les préverbes. Il a aussi donné "legma".
Avec le vocalisme "o", logos est une forme de type ancien de très grande importance qui signifie "propos", "parole(30) ". Selon le dictionnaire des Notions Philosophiques, logos est l'un des termes qui, dans la pensée grecque, ont la plus grande polyvalence, voit très tôt ses emplois spéculatifs déborder son acceptations ordinaires(31). Ainsi le dictionnaire grec-français Bailly, trouve dix significations à logos, qui est tout à la fois, dans le premier sens où logos signifie parole "la parole, une parole, un mot, une mention, un bruit qui court, un entretien, un récit, une composition en prose, des belles-lettres, des sciences, des études, un sujet d'entretien, d'étude ou de discussion".
Dans le second sens où logos signifie raison, il est "la faculté de raisonner, la raison l'intelligence, le bon sens, la raison intime d'une chose, le fondement, le motif, l'exercice de la raison, le compte-rendu d'une justification, l'opinion au sujet d'une chose à venir, la présomption, l'attente."
LE LOGOS HERACLITEEN
Selon Héraclite, l'homme devrait chercher à appréhender la cohérence sous-jacente des choses : elle est exprimée dans le logos, la formule ou élément d'agencement commun à toutes les choses. Le fragment 1 nous présente le logos comme la parole originaire.
Ecoutons ce fragment : "Au sujet du logos qui est tel que je le décris, les hommes se sont toujours avérés incapables de le comprendre, aussi bien avant qu'ils ne l'aient entendu, qu'une fois qu'ils l'ont entendu. Car bien que toutes choses se déroulent en accord avec ce logos, les hommes sont comme des gens sans expérience, même lorsqu'ils expérimentent des mots et des actes tels que je les explique, quand je distingue chaque chose selon sa nature et que je déclare qu'il en est ainsi ; mais les autres hommes n'arrivent pas à s'apercevoir de ce qu'ils font après qu'ils se soient réveillés, tout comme ils oublient ce qu'ils font lorsqu'ils dorment(32)." Nous savons, grâce à Aristote, que le fragment premier ouvre effectivement le livre originaire de Héraclite. Il constitue de fait l'introduction à la pensée héraclitéenne. C'est la raison de l'importance que nous conférons à ce passage et surtout à ce premier terme "logos". Cependant, même pour Aristote, la lecture de Héraclite est rendue difficile par l'absence de ponctuation, ce qui explique, selon les termes de Deramaix, "que le terme grec'aei' peut être traduit par'toujours' s'il s'accorde à'vrai' et par'jamais' s'il se réfère à la forme négative du verbe comprendre(33)." Reconnaissons, sans cependant se prononcer sur la validité philologique de l'une ou l'autre traduction, que "Axelos confère au logos la signification d'un sens originaire du monde." (34)
Axelos, se prononçant sur le logos chez Héraclite affirme que "le logos est ce qui lie les phénomènes entre eux, en tant que phénomène d'un univers UN et ce qui lie le discours au phénomène ; le logos est un lien. Il est l'âme et l'esprit de la dialectique héraclitéenne qui fait corps avec le monde. Sa puissance est celle de l'universalité et sa lumière éclaire les ténèbres(35)." Le mot grec signifie ici, le discours de Héraclite et le "sens" de l'Univers. Plus loin Axelos continue : "Le logos est chez Héraclite ce qui constitue, éclaire et exprime l'ordre et le cours du monde. Il ne peut être saisit que si nous entrons en dialogue avec lui. Il fonde le discours et le dialogue, et anime la dialectique."(36)
Ouvrant le fragment premier, le logos se situe à l'origine de la pensée humaine. Et dès cette origine, le rapport que l'homme entretient avec lui est avant tout une mécompréhension. Héraclite dresse un constat amer : les hommes ne comprennent pas le logos "aussi bien que avant qu'ils ne l'aient entendu, qu'une fois qu'ils l'ont entendu". La philosophie sera donc une tentative sans cesse renouvelée de dépasser cette mécompréhension qui rend le "logos" obscur. Pourtant, selon le philosophe d'Ephèse, les hommes en ont entendu parler ; m'empêche qu'ils ne le comprennent point. Mais, ce que nous pouvons d'ores et déjà savoir, c'est que le logos existe, sinon on n'en entendrait point parler.
Héraclite critique l'échec des hommes à comprendre le logos dans plusieurs autres fragments(37). Mais on n'y trouve rien de plus concluant que ce qui est déjà exprimé dans le fragment premier, le fragment deuxième et le fragment cinquantième. Il crible de reproches analogues des individus précis : Homère, Hésiode, Xénophane, Hécatée, Archiloque et Pythagore. Ecoutons Diogène Laërce qui témoigne en faveur de Héraclite: "Avec l'âge, son caractère(Héraclite) devint exceptionnellement hautain et dédaigneux, ainsi que le démontre son livre dans lequel il écrit :<
L'affirmation du fragment premier, celui du fragment deuxième(39), ainsi que le fragment cinquantième(40) démontrent clairement que Héraclite était conscient d'avoir connaissance d'une vérité primordiale qu'il essayait en vain de propager, connaissance ayant trait à la constitution du monde dont les hommes font partie. La grande majorité des gens passent, sans la reconnaître, à côté de cette vérité qui est commune - simultanément valable pour toutes choses et accessible à tous les hommes, pour peu qu'ils sachent utiliser leur sens de l'observation et de la compréhension, au lieu de s'inventer un entendement particulier et trompeur. Cette compréhension, d'ailleurs Héraclite va la préciser au fragment cinquante-cinquième, lorsqu'il écrit : "Les choses dont on a une vision, une audition et une perception, celles-ci sont mes préférées." (41)
Mais l'observation doit être vérifiée par la compréhension, "noos" ou "phronésis" : ceci est démontré non seulement par le fragment cent quatorze, "Ceux qui parlent avec intelligence, doivent s'appuyer sur ce qui est commun à tous, de même qu'une cité doit compter sur ses lois, et avec une plus grande confiance encore. Car toutes les lois des hommes se nourrissent d'une seule loi, la loi divine ; car elle a autant de pouvoir qu'elle en veut, suffit pour tous et il lui reste encore (42).", mais aussi au fragment cent sept, de Héraclite cité par Sextus dans l'ouvrage cité plus haut où il écrit : "Les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes dont les âmes ne comprennent pas le langage (43)". Ici, les "âmes barbares" sont celles qui ne peuvent comprendre le langage, ni interpréter correctement les messages des sens, mais sont induites en erreur par la seule apparence des choses.
Pour Kirk, Démocrite a fait plus tard une distinction analogue entre la simple sensation et l'interprétation intelligente des phénomènes perçus. Voici ce qu'il écrit : " Le scepticisme de Démocrite n'allait pas si loin qu'il dénie aux sens toute participation effective dans l'épistémologie. Son titre Confirmations fait penser que, s'il avait envisagé une réponse aux doléances des sens se plaignant de leur rejet total, il l'aurait formulé comme suit : <
Pour revenir à Héraclite, cet Ephésien pense que ce que les hommes devraient apprendre à reconnaître, c'est le logos qui pourrait être interprété comme une formule unificatrice ou une méthode mesurée de l'agencement des choses, en d'autres termes, ce qui pourrait être leur structure au plan individuel aussi bien que collectif. Le sens technique de logos chez lui se rattache probablement au sens plus général de "mesure", "calcul" ou "proportion". Il n'est pas possible de penser que seul le "récit" de Héraclite soit concerné (car alors la distinction entre "emou" et "tou logou" du fragment cinquantième, c'est-à-dire entre "moi" et "le logos" n'a plus de sens), bien que le logos se révèle dans ce récit et d'une certaine façon, coïncide avec lui.
Cet agencement conforme à une mesure et un plan communs a le résultat suivant : toutes les choses, bien que multiples en apparence et complètement distinctes, sont en fait réunies en un tout cohérent dont les hommes eux-mêmes font partie. Donc logiquement, les hommes doivent comprendre la cohérence du tout s'ils veulent pouvoir agir efficacement sur le déroulement de leurs vies. Et pourtant, "formule", "arrangement mesuré" et autres mots sont des abstractions trompeuses du sens technique de logos. Probablement, Héraclite devait-il parfois concevoir le logos comme le véritable constituant des choses et sous bien des aspects, il le représente comme coïncidant avec l'élément cosmique primordial, c'est-à-dire le feu.
LE LOGOS COMME FEU CHEZ HERACLITE
Le fragment soixante quatrième de Héraclite, "la foudre gouverne toutes choses (45)", démontre que le feu de Héraclite - de la sorte la plus pure et la plus brillante, c'est-à-dire l'égal de la foudre de nature éthérée et divine - possède un pouvoir directeur. Ceci traduit partiellement la nature divine assignée à l'éther par la conception populaire.
Plus important encore est le fait que tout feu, aussi petit et vulgaire soit-il, consomme du carburant et émet de la fumée de façon régulière, tout en maintenant une sorte de stabilité entre les deux : donc, le feu réalise de manière flagrante la règle de mesure dans le changement, règle qui est inhérente à l'évolution du monde et qui s'exprime par le logos. Ainsi, le feu est-il conçu naturellement comme l'élément constitutif par excellence qui détermine de façon active la structure et le comportement des choses - ce qui permet de réaliser non seulement l'opposition des contraires, mais aussi leur unité qui découle de la "lutte".
Le cosmos est formé, en gros, de masse de terre (entremêlée de substances ignées dérivées, comme dans les volcans) et de masse de mer, le tout étant enveloppé du scintillement du feu ou éther. Sur la base du fragment trente et unième qui stipule ceci : "Tours du feu : d'abord la mer, et de cette mer, une moitié est terre, l'autre moitié <
Ce point semble être à l'origine de la pluie qui finit par nourrir la mer, et le feu lui-même qui consume l'humidité, est à son tour alimenté par l'évaporation de l'eau qui s'élève de la mer. Comme l'a démontré Xénophane, selon une affirmation de Kirk, "la mer se change en terre, et la terre, en d'autres lieux et à d'autres moments, se dissout dans l'eau. de la sorte, le feu cosmique ou éther'se tourne' soit en mer, soit en terre."(47)
D'après la recherche érudite de Kahn, "la question de "l'échange en" dans le fragment quatre-vingt-dixième de Héraclite qui affirme que "Toutes les choses peuvent s'échanger à mesures égales en feu et le feu en toutes choses, de même qu'il en va pour des biens contre de l'or et de l'or contre des biens.", tend à invalider la thèse soutenue par les Stoïciens qui attribuent à Héraclite l'idée d'une "ekpurosis" périodique ou consomption du monde par le feu."(48)
L'ordre du monde est et demeurera un feu éternellement vivant, s'allumant et s'éteignant au fur et à mesure (c'est-à-dire simultanément). Dans l'image de l'échange entre des biens et de l'or, il ne pourrait se produire une situation dans laquelle tous les biens (c'est-à-dire le monde dans sa diversité) puissent être en une seule fois transformé en or (c'est-à-dire le feu), de manière à ce qu'il n'y ait plus que de l'or, et plus un seul bien. A ce propos, Kirk écrit "après avoir mentionné cette image, Théophraste ajoute : <
Cette opinion s'apparente probablement à la remarque d'Aristote disant : "qu'Empédocle et Héraclite faisaient fluctuer le monde entre sa condition présente et la destruction(50)." Mais Aristote aurait pu penser au grand cycle de 10800 ans qu'Héraclite a, selon Kirk, mentionné(51) ; ce cycle aurait concerné le cycle des âmes privilégiées, ou plus probablement le temps nécessaire pour qu'une part de feu franchisse toutes les étapes sucessives. Ces deux versions auraient, de toute façon, été une source d'erreur, si elles n'avaient pas été exposées dans leur intégralité.
Platon dans le Sophiste(52) a fait une nette distinction entre l'unité et la pluralité simultanées du cosmos de Héraclite et les phases distinctes de l'Amour et de la Lutte chez Empédocle. Mais les deux auteurs se retrouvent dans la même citation à cause de leur croyance commune en l'unité et la pluralité du cosmos. Le fait qu'Aristote ait associé Héraclite et Empédocle pourrait trouver sa raison d'être dans le fait que l'école platonicienne les ait comparés, en négligeant l'importante distinction qui les différencie.
Pour conclure sur la question des échanges chez Héraclite, disons que ceux-ci entre les trois différentes masses composant le monde se déroulent simultanément de manière à ce que la somme de chaque masse demeure constante. Si une certaine quantité de terre se dissout dans la mer, une quantité équivalente de mer se solidifie ailleurs et devient de la terre; il en va de même pour les échanges entre la mer et "l'embrasement" (c'est-à-dire le feu). Il semble que ce soit le sens à donner au fragment trente-et-unième.
La proportion ou logos reste la même - c'est de nouveau la mesure et la régularité du changement qui sont soulignées, mais cette fois il s'agit d'un changement à l'échelle cosmique. Le seul aspect surprenant de cette cosmologie héraclitéenne réside dans le manque évident d'analyse en fonction de la théorie dans le manque évident d'analyse en fonction de la théorie des opposées et de relation au sujet des opposés dans le cadre feu-eau-terre. On peut trouver une explication dans le feu que les opposés sont évoqués au cours de l'analyse logique du changement, et que lorsque l'on considère le changement à si grande échelle, on peut se contenter d'une description plus empirique, d'autant plus que le logos s'apparente de si près au feu. Le concept sous-jacent de mesure et de proportion relie ces deux types d'analyses, mais comme le fait remarquer Guthrie "le feu en soi est un extrême(53) " et non un intermédiaire en puissance comme le sont l'eau, l'Illimité ou l'air pour les Milésiens.
CONCLUSION
Dans son essai de fondation métaphysique, Deramaix nous donne une excellente synthèse lorsqu'il écrit : "La pensée hérclitéenne porte sur ce que nous pourrions appeler trois modalités de l'Etre. L'Etre comme donné : le monde "physique" qui nous englobe, et se manifeste comme totalité. Le logos qui permet de rendre compte du monde et qui se manifeste comme universalité. Et le lieu d'émergence du logos qui n'est autre que l'homme, le Disant(54)."
A la suite de notre illustre prédécesseur, nous avons essayé de fonder une métaphysique sur le logos. D'abord, nous l'avons arraché au mythe d'Hermès, par l'interprétation que nous avons donnée à chaque occasion. Ensuite la philosophie de la nature nous a permis de voir l'importance du logos du point de vue du feu comme élément ordonnateur de l'univers. Cette philosophie de la nature s'est distingué aussi de la religion parce que le feu n'est plus un être divin(Hermès), mais un élément de la nature.
Héraclite, en bon physiocrate, a fixé son regard sur deux prodigieux spectacles de la nature : le mouvement éternel, négation de la durée et de l'immobilité, et la loi unique qui règle ce mouvement. Il a eu deux intuitions prodigieuses : la voie des sciences de la nature était sans doute alors très brève et peu sûre; mais ce sont des vérités auxquelles l'esprit se sent tenu de croire, l'une aussi effrayante que l'autre est rassurante
L'Obscur a traité d'erreur et de sottise la croyance au permanent, mais a ajouté cette pensée que tout ce qui est soumis au devenir est en perpétuelle métamorphose, et la loi de cette éternelle métamorphose le logos présent dans les choses, c'est justement cet élément unique, "to pyr", le feu. Ainsi, la seule chose qui soit en devenir est à elle-même sa propre loi; le fait qu'elle devient, la façon dont elle devient, dépendent également d'elle seule. Voilà pourquoi Nietzsche pense que la philosophe Héraclite a eu le droit de s'interroger : "Pourquoi le feu n'est-il pas toujours le feu, pourquoi est-il tantôt eau, tantôt terre(56) ?" Et il a répondu : "C'est un jeu, ne le prenez pas au tragique et surtout n'en faites pas un problème moral(57) !"
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
(Sous la direction de André Jacob).- Les Notions Philosophiques II, tome 1, (Paris, P.U.F. 1990)
AMBACHER(Michel).- Les philosophies de la nature, (Paris, Que Sais-je n°1589, P.U.F. 1974).
ARISTOTE.- Du ciel, (Paris, Belles Lettres, 1965), traduit par Paul Moraux.
AXELOS(Kostas).- Héraclite et la philosophie. La première saisie de l'être en devenir de la totalité. (Paris, Editions de Minuit, 1962) cité dans DERAMAIX.- O.c., p.1 note 11
BUFFIERE(Félix).- Les mythes d'Homère et la pensée grecque, (Paris², Belles-Lettres, 1973), p. 289
CHANTRAINE(Paul).- Dictionnaire étymologique de la langue grecque, histoire des mots. (Paris, Klincksieck, 1984), article logos.
CHEVALIER(Jean) et GHEERBRANT(Alain).- Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. (Paris, Robert Laffont/Jupiter 1982), p. 499
COMMELIN.- Mythologie grecque et romaine, (Paris, Garnier, 1960).
DERAMAIX(Patrice).- "Sur quelques fragments de Héraclite", in Logos et Totalité in http://membres.lycos.fr/patderam/physis.htm.
KIRK(G.S.) - RAVEN(J.E.) - SCHOFIELD (M.).- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes, (Suisse, Editions Universitaires Fribourg, 1995).
GIGON(Olof).- Les grands problèmes de la philosophie antique, (Paris, Payot, 1961).
GRAVES(Robert).- Les mythes grecs, tome I, (Paris, Fayard, 1967).
HEISENBERG(Werner).- La nature dans la physique contemporaine, (Paris, Idées/Gallimard, 1962).
HOMERE.- Iliade, (Paris, Belles Lettres 1945), traduit par Paul Mazon.
HOMERE.- L'Odyssée, "poésie homérique", (Paris, Belles Lettres, 1924), texte établi et traduit par Victor Bérard,
KAHN(Charles, H.).- The Art and Thought of Heraclitus. (Cambridge, Cambridge University Press, 1979).
LAËRCE(Diogène).- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, (Paris, Garnier-Flammarion).
MARITAIN(Jacques).- La philosophie de la nature. Essai critique sur ses frontières et son objet, (Paris, Tequi, non daté).
NIETZSCHE(Friedrich).- La Naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, (Paris, Idées, Gallimard, 1938).
PLATON.- uvres Complètes, tome VIII - 3è partie (Le Sophiste), (Paris, Belles Lettres 1955), traduit par Auguste Diès.
SCHÜLER(Donaldo).- "Héraclite : le discours dans le discours" in http://www.schulers.com/donaldo/herac-fr.htm. Copyright, 1996, trad. Pascal Lelarge.
SEIDENGART(Jean).- "La philosophie et la cosmologie" dans Le Dictionnaire Philosophique, Dictionnaire, (Paris, P.U.F., 1998).
SERRES(Michel).- Hermès I. La communication, (Paris, Minuit, 1969).
Notes :
1) GIGON(Olof).- Les grands problèmes de la philosophie antique, (Paris, Payot, 1961), p. 11
2) SEIDENGART(Jean).- "La philosophie et la cosmologie" dans Le Dictionnaire Philosophique, Dictionnaire, (Paris, P.U.F., 1998), p. 2123
3) AMBACHER(Michel).- Les philosophies de la nature, (Paris, Que Sais-je n°1589, P.U.F. 1974), p. 14
4) HEISENBERG(Werner).- La nature dans la physique contemporaine, (Paris, Idées/Gallimard, 1962), p. 11, titre 1.
5) MARITAIN(Jacques).- La philosophie de la nature. Essai critique sur ses frontières et son objet, (Paris, Tequi, non daté), p. 132.
6) LAËRCE(Diogène).- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, (Paris, Garnier-Flammarion), p. 164
7) SERRES(Michel).- Hermès I. La communication, (Paris, Minuit, 1969), présentation de l'ouvrage au dos de couverture.
8) GRAVES(Robert).- Les mythes grecs, tome I, (Paris, Fayard, 1967), p. 72
9) COMMELIN.- Mythologie grecque et romaine, (Paris, Garnier, 1960), p. 63.
10) GRAVES(Robert).- O.c., p. 76, note 2.
11) CHEVALIER(Jean) et GHEERBRANT(Alain).- Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. (Paris, Robert Laffont/Jupiter 1982), p. 499
12) CHEVALIER et alii.- O.c., p. 499
13) BUFFIERE(Félix).- Les mythes d'Homère et la pensée grecque, (Paris², Belles-Lettres, 1973), p. 289
14) Ibidem, p. 289.
15) Ibidem, pp. 289-290.
16) Ibidem, p. 290.
17) HOMERE.- Iliade, tome IV chant XXIV, 486 sq, (Paris, Belles Lettres 1945), traduit par Paul Mazon.
18) BUFFIERE.- O.c., p. 291
19) Ibidem, p. 291
20) HOMERE.- L'Odyssée, "poésie homérique", tome 2 Chant X, 281, texte établi et traduit par Victor Bérard, (Paris, Belles Lettres, 1924)
21) BUFFIERE.- O.c., p. 292
22) Ibidem, p. 292.
23) Ibidem, p. 292.
24) HOMERE.- O.c., chant XXIV, 343 sq. Trad. Mazon.
25) BUFFIERE.- O.c., chant XXIV, 445.
26) Ibidem, p. 293.
27) BUFFIERE.- O.c., p. 294
28) CHANTRAINE(Paul).- Dictionnaire étymologique de la langue grecque, histoire des mots. (Paris, Klincksieck, 1984), article logos.
29) SCHÜLER(Donaldo).- "Héraclite : le discours dans le discours" in http://www.schulers.com/donaldo/herac-fr.htm. Copyright, 1996, trad. Pascal Lelarge, p. 3
30) HOMERE.- Iliade, chant XV, 393 ; Odyssée, chant I, 56.
31) (Sous la direction de André Jacob).- Les Notions Philosophiques II, tome 1, (Paris, P.U.F. 1990)
32) EMPIRICUS (Sextus).- Adversus Mathematicos, (que nous abrégerons Adv. Math.) livre VII, 132, éd. Mutschmann, Leipzig, Teubner, 1914, cité dans KIRK(G.S.) - RAVEN(J.E.) - SCHOFIELD (M.).- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes, (Suisse, Editions Universitaires Fribourg, 1995), p. 199.
33) DERAMAIX(Patrice).- "Sur quelques fragments de Héraclite", in Logos et Totalité in http://membres.lycos.fr/patderam/physis.htm, p. 11, note 1
34) DERAMAIX.- O.c., p. 11, note 1.
35) AXELOS(Kostas).- Héraclite et la philosophie. La première saisie de l'être en devenir de la totalité. (Paris, Editions de Minuit, 1962) cité dans DERAMAIX.- O.c., p.1 note 11
36) AXELOS.- O.c., cité dans http://www.college-heraclite.org/Documents/r_histo :heraclite_2.htm, p.2
37) KIRK.- O.c., p. 200, note 6
38) LAERCE(Diogène).- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, tome 2, (Paris, GF-Flammarion 1965), p. 163.
39) Le fragment 2, SEXTUS.- Adv. math., VII, 133 : "C'est pourquoi il est nécessaire de suivre le commun; mais bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils jouissaient d'un entendement particulier". Traduction de Kirk.- O.c., p. 199
40) Le fragment 50, HIPPOLYTE.- Réfutation à toutes les hérésies (que nous abrégerons par Ref.) IX, 9, 1 : "A l'écoute, non de moi mais du logos, il est sage de convenir que toutes les choses sont un." Traduction de Kirk.- O.c., p. 199.
41) HIPPOLYTE.- O.c., IX, 9, 5.
42) STOBEE(Jean).- Anthologium, (que nous abrégeons Anth.) III,1,179, éd. Wachsmuth et Hense, Berlin, 1884-1909, cité dans KIRK.- O.c., p. 225
43) SEXTUS.- O.c., VII, 126, cité dans KIRK.- O.c., p. 200, note 7.
44) KIRK.- O.c., p. 444.
45) Fr. 64, HIPPOLYTE.- Ref. IX, 10, 6, cité par KIRK.- O.c., p. 211
46) Fr. 31, CLEMENT d'ALEXANDRIE.- Stromates (que nous abrégeons Strom.) V, 104, 3, cité dans KIRK.- O.c., p. 211
47) KIRK.- O.c., pp. 212-213
48) KAHN(Charles, H.).- The Art and Thought of Heraclitus. (Cambridge, Cambridge University Press, 1979), p. 134ss.
49) SIMPLICIUS.- In (Aristotetelis) Physicorum libros (Comment. In Aristot., graeca, éd. de l'Académie de Berlin, 24, 4ss, par H. Diels, 1882 (DK 22A5). cité par KIRK.- O.c., pp. 212-213, note 20
50) ARISTOTE.- Du ciel A 10, 279b14, DK 22A10
51) KIRK.- O.c., p. 213, note 20
52) PLATON.- Sophiste 242d, DK 22 A 10
53) GUTHRIE(W.K.C).- A History of Greek Philosophy, tome I, p. 457 par KIRK.- O.c., p. 213.
54) DERAMAIX.- O.c., p. 79
55) NIETZSCHE(Friedrich).- La Naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, (Paris, Idées, Gallimard, 1938), p. 57
56) Ibidem, p. 57.
EPICURE ET LA VIEILLESSE
INTRODUCTION
Pour Andrée Catrysse(1), le XXè siècle revendique, parmi ses exploits, celui d'avoir augmenté, dans des proportions considérables, la longévité moyenne, tant des femmes que des hommes. Mais depuis la révolution néolithique, il a toujours dû y avoir des "vieux". La démographie historique et la paléodémographie s'intéressent bien à la Grèce ancienne, mais elles ont dû, jusqu'ici, renoncer à établir la durée moyenne de vie de ses habitants, faute de disposer d'échantillons suffisants et de solides hypothèses démographiques. Rien ne nous permet donc d'évaluer la proportion de vieillards que comptaient les populations grecques pendant la période que nous étudions. Cependant, ces populations ne manquaient pas d'hommes de soixante ans et plus. En effet, Andrée Catrysse soutient que les Athéniens et les Spartiates avaient des obligations militaires jusqu'à 60 ans(2). A cet âge, les Athéniens étaient encore astreints à servir la cité-Etat, pendant un an en qualité d'arbitres publics. Rien d'ailleurs ne les obligeait, même âgés, à se retirer de la politique, s'ils conservaient la faveur du peuple.
Epicure, à qui nous allons nous intéresser, dans cet article, fait partie de ces nombreux philosophes, dont le biographe Diogène Laërce dit qu'il mourut, à l'âge de soixante-douze ans(3). Ce philosophe a fait l'éloge de la vieillesse dans ses Lettres et Maximes(4) quand il distingue le jeune et le vieux. Le préambule de la Lettre introduit une différence entre eux - que la Sentence 17 met davantage en lumière : "Ce n'est pas le jeune qui est bienheureux (μακαριος) mais le vieux qui a bien vécu : car le jeune, plein de vigueur, erre, l'esprit égaré par le sort(τύχή), tandis que le vieux, dans la vieillesse, comme dans un port, a ancré ceux des biens, qu'il avait auparavant espérés dans l'incertitude, les ayant mis à l'abri par le moyen sûr de la gratitude.
Jeunes et vieux ne sont pas mis à égalité devant le bonheur. Le jeune homme se trouve devant un avenir incertain. Il espère et il craint. Il y a donc une crainte dont il a à se délivrer pour atteindre l'aphobie, et que n'éprouve pas le vieillard. Celui-ci, s'il a "bien vécu" et mené à bien sa navigation sur la haute mer de la vie, ne craint plus de perdre les biens que jadis il espérait, car il les possède maintenant en sûreté dans le magasin de la mémoire. Il n'est pas seulement heureux, comme le jeune, au moyen de la philosophie peut l'être, mais "bienheureux" grâce à la mémoire qui lui permet de puiser dans ses souvenirs heureux comme dans une réserve de bonheur. Le plaisir joui, et de plus recueilli, médité, approprié par la gratitude, est principe d'une suite illimitée de plaisirs.
La joie que donne le souvenir permet au vieillard de contre-battre(5) les douleurs du corps, si vives soient-elles. Mais le vieux oublieux du bien passé et ingrat est "dans l'état de quelqu'un qui est né aujourd'hui"(6). Les plaisir n'ont fait que glisser sur lui sans profit durable ; il n'a pas su les intérioriser pour se constituer avec eux une puissance de bonheur qui survive à leur écoulement. Au vieil homme, la philosophie enseigne la réminiscence.
La vieillesse permet-elle à l'homme d'être apte à la philosophie au détriment de la jeunesse ? Notre thèse, quoique formulée de façon interrogative, nous conduira à définir d'abord la vieillesse et à discuter notre problématique avec Epicure et son uvre. Ainsi, une première question : qu'est-ce que la vieillesse ?
1. QU'EST-CE QUE LA VIEILLESSE ?
Robert Hugonot(7) pense que le parcours de l'homme aboutit inexorablement à la vieillesse. Il suit un trajet discontinu, irrégulier, parsemé d'obstacles, avec des accélérations et des ralentissements : il atteint ainsi insensiblement un autre état, différent du précédent, différent aussi de ceux qui le suivront et qui le rapprocheront chaque jour des ténèbres.
Les peintres dans leurs comparaisons avec les saisons attribuent le printemps à l'enfance, l'été à la plénitude, l'automne à la maturité et l'hiver à la vieillesse. Mais notre auteur pense qu'il y a plus de vieillesses que d'hivers(8). La vieillesse n'est pas une, mais une infinité. Si nous puisons dans le florilège de ceux qui apprécient la leur ou celle de leurs proches, nous voyons à quel point la vieillesse est plurielle, plus encore que les vies, et représente le miroir souvent déformant des humanités diverses.
Michel Philibert dans son texte "le vieillissement vu à travers la littérature française(9) " fait remarquer que les Français ont, tous, une approche toute différente de la vieillesse. Certains la vivent douloureusement, ou la redoutent avant de la vivre, pour l'avoir observée auprès d'eux. Elle est "abominable" pour François Mauriac, c'est un "naufrage" pour Charles de Gaulle. Montaigne trouve "qu'elle nous attache plus de rides en l'esprit qu'au visage" et "qu'il ne se voit point d'âmes, ou fort rares, qui en vieillissant ne sentent à l'aigre et au moisi". Certains trouvent injuste que le destin de l'homme n'ait pas d'autres alternatives, telle Benoîte Groult : "Les arbres n'ont jamais l'air trop vieux, ni les poissons, ni les bêtes sauvages, pourquoi les humains seuls sont-ils affligés de ces longues et laides vieillesses qui s'étendent sur la moitié de leur vie" ?
A l'opposé Saint-John Perse s'écrie : "Grand âge, vous mentiez : route de braise et non de cendres " et certains chantent alors les qualités nouvelles qu'ils observent en eux-mêmes. George Sand écrivait à l'âge de 64 ans dans son journal intime : "On a tort de croire que la vieillesse est une pente de décroissement : c'est le contraire. On monte et avec des enjambées surprenantes". De même pour Jouhandeau dans ses Réflexions sur la vieillesse et la mort(10) : "Vieillesse, ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Ce n'est pas tout diminuer, mais grandir". Ou encore Franz Hellenz : "Cet âge est vraiment grand. Le seul grand La plus belle saison, c'est l'hiver L'hiver est le temps du statuaire qui n'atteint au chef-d'uvre que dans le nu Le grand âge n'est pas ce que l'on croit."
Le discours des hommes de lettres n'est que le reflet de nos observations quotidiennes, dans nos familles, dans les lieux où nous vivons ou que nous traversons.
Ainsi il est des vieillesses individuelles, multiples, aussi nombreuses que les êtres humains. Mais pour étudier et décrire, puis pour mieux cerner et comprendre le vieillissement et la vieillesse, il conviendrait aussi de disposer de multiples regards pour suivre cette évolution depuis les cellules qui composent les organes jusqu'à la société que composent les hommes. Nous allons faire appel maintenant à différents regards du vieillissement, celui du philosophe du corps, puis du biologiste, du psychologue, de l'anatomiste, du physiologiste, du médecin, du sociologue, du géographe et enfin du géographe. Ce sera notre première partie que nous intitulons le regard des différentes sciences. Dans la seconde partie, nous donnerons la parole à Héraclite pour nous parler de la vieillesse. Venons-en à présent au regard du philosophe du corps.
1ère PARTIE : LE REGARD DES DIFFERENTES SCIENCES SUR LA VIEILLESSE
1. LE REGARD DU PHILOSOPHE DU CORPS
Nous étudierons la vieillesse, du point de vue du philosophe du corps(11), dans un premier temps. Ainsi, de ce point de vue, la vieillesse, avec son cortège de maladies, d'impotences et de déchéances, est la situation même du corps objet. Dans le processus de sénescence, le corps nous rapproche insensiblement de la minéralisation qui caractérise le cadavre. La souplesse, la beauté, la fraîcheur du corps s'altèrent de plus en plus et entraînent une métamorphose générale qui peut aller jusqu'à l'altérité quasi-totale. Le vieillissement me fait devenir autre objectivement : il suffit de comparer des photographies prises à quelques décennies de distance. "On a le cur serré, écrit Simone de Beauvoir, quand à côté d'une belle jeune femme on aperçoit son reflet dans le miroir des années futures : sa mère.(12) " Dans cet ouvrage Simone de Beauvoir dénonce des injustices, des scandales et qui ne peut guère rassurer. Depuis sa jeunesse, elle a lutté pour le droit des femmes et des personnes âgées(13). Parlant des vieillards, elle affirme ceci : "Vous ne pouvez rien faire pour les vieillards si vous n'avez pas déjà commencé à faire quelque chose pour eux pendant leur jeunesse. Ce qui traumatise les gens âgés - les ouvriers en particulier - c'est qu'ils sont à bout de force, usés. Leur condition de travail a été trop rude(14)." En effet, poursuit-elle, "lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, ils sont très, très âgés, bien plus âgés en réalité que ceux qui n'ont pas travaillé durant leur vie. Et ils ne sont pas vieux uniquement dans leur corps. Ils n'ont pas la force, ni la possibilité de lire, de s'intéresser à des choses extérieures(15)." La plupart d'entre eux n'ont pas eu de culture, ajoute-t-elle, et ne savent que faire de leur temps libre. C'est encore pire pour les hommes en ville. Les femmes, elles peuvent toujours s'occuper de leur cuisine ou de leur ménage. Les hommes quand ils n'ont plus de travail sont perdus. Ils ne sont plus des êtres humains à part entière. C'est affreux.
C'est d'ailleurs précisément l'image spéculaire qui nous renvoie notre propre vieillesse. Au sens propre : le miroir qui nous donne à voir notre vieillissement ou au sens figuré : les autres qui nous font sentir, presque physiquement, notre sénescence "C'est ainsi qu'une beauté découvre subitement, en se regardant dans la glace, la petite ride révélatrice au coin de l'il : un beau matin la frivole en tête-à-tête avec soi-même est ramenée par le miroir à l'amère vérité de son âge[ ] Et tout le monde sait également à quoi fait allusion une ride : la ride est une allusion à la mort", écrit Jankélévitch(16).
2. LE REGARD DU BIOLOGISTE
Quelles sont les théories de vieillissement, les plus récentes basées sur les études modernes que nous offrent la biologie ? Il y a d'abord la théorie du "déterminisme génétique" ou du "vieillissement programmé" qui repose sur la constatation d'une longévité potentielle ou maximale spécifique de chaque espèce animale, sur l'observation de vieillissements parallèles et de vieillissements comparables chez des jumeaux homozygotes et sur les images de vieillissement précoce présentes dans quelques maladies typiquement génétiques(17). L'argument biologique repose sur les expériences de Hayflick, puisque le potentiel de renouvellement des cellules est in vitro relativement fixe, essentiellement fonction du type et de l'âge des cellules.
La seconde théorie est celle de "l'accumulation catastrophique d'erreurs" et elle a été développée par Orgel(18). Après deux décennies de grande vogue, elle n'est guère admise aujourd'hui, mais le doute subsiste et il faut donc la décrire. Une cellule âgée, selon Holliday(19) et Tanant fait plus d'erreurs, par exemple dans le choix de ses nutritions, qu'une cellule jeune. Ce vieillissement, selon Orgel, serait le résultat d'un trouble du métabolisme cellulaire : les acides nucléides (ADN et ARN) remplissent alors mal leurs fonctions, des erreurs dans la structure des protéines à la synthèse desquelles elles participent, et ces protéines anormales sont la cause de la mort de la cellule.
Il est à noter que les acides nucléides détiennent le "code génétique" au sein du noyau cellulaire et qu'ainsi ces deux théories semblent fort bien se conjuguer. On parle alors d'un vieillissement réglé par une horloge biologique génétiquement programmée.
La théorie immunologique complète les précédentes. Elle repose sur la constatation de la plus grande fréquence avec l'âge des maladies auto-immunes. Un certain nombre de cellules de l'organisme lui deviennent étrangères et sont le point de départ d'une réaction immunitaire du type de celle qui rejette les greffes. L'organisme s'auto-détruit par production d'auto-anticorps. Mais qui détermine l'étrangeté cellulaire, point de départ des erreurs cumulées ? En fait, l'explication du vieillissement cellulaire reste encore à trouver. Sans doute les gènes sont-ils responsables aussi la vie, avec tout son cortège d'événements et son environnement. Le vieillissement est aussi sensible aux facteurs écologiques.
3. LE REGARD DU PSYCHOLOGUE
Chez le vieillard, le psychologue(20) note et mesure une plus grande labilité de l'attention, aggravée et favorisée par la diminution des perceptions visuelles et auditives. Il note aussi un fléchissement des fonctions intellectuelles variable selon les secteurs : fort et rapide pour l'abstraction, l'aptitude à découvrir des relations nouvelles, la vitesse d'exécution des exercices, plus faible pour le vocabulaire, l'information, les opérations.
Ce sont les troubles de la mémoire qui affectent le plus les vieillards et leur entourage. La mémoire des faits des anciens est en général bien conservée, la fixation des faits récents est altérée. L'apprentissage est ainsi beaucoup plus difficile et demande davantage de répétitions. Le trouble le plus fréquemment observé se situe au niveau de l'évocation : difficulté à trouver le mot exact, à mémoriser des noms, un récit, un événement.
Chez le vieillard, ces troubles de la sphère cognitive peuvent souvent être considérés comme "normaux pour l'âge", ce qu'un psychologue détermine par un bilan des fonctions opératoires. Ils peuvent aussi être la traduction d'une anxiété ou d'une dépression sous-jacentes ou le signe prémonitoire d'une détérioration mentale plus importante de type démentiel.
Un certain désinvestissement affectif est parfois la conséquence des perturbations intellectuelles précédentes. Plus souvent encore, il s'inscrit dans l'évolution du caractère du vieillard qui devient rigide, méfiant, moins attentif aux autres, dans la mesure même où ses intérêts se focalisent sur sa santé, ses ressources, ses besoins vitaux. En l'absence d'apports nouveaux, il se raccroche au passé et aux acquis dans un univers rétréci. Est-ce une manière inconsciente de couper peu à peu les liens qui rattachent l'individu aux autres ? A l'inverse, certains vieillards illuminent leur vie et celle des autres par leur don de soi, leur mansuétude, leur compréhension et leur richesse intérieure : on les cite en exemple, car ils sont rares.
4. LE REGARD DE L'ANATOMISTE
Il n'est pas besoin d'être un spécialiste pour sentir que la vieillesse imprime sur l'homme des marques qui permettent de juger que son âge est déjà grand et chacun de nous d'un coup d'il évalue l'âge de son prochain en admirant ceux qui ne paraissent pas leur âge. Il est inutile de rappeler ici quels sont les stigmates de la vieillesse, mais l'enveloppe extérieure est le reflet des modifications bien réelles de texture et d'armature du corps humain.
Si la taille se réduit et si le dos se courbe, c'est que la colonne vertébrale se déforme sous la double influence de l'ostéoporose et de l'amincissement des disques cartilagineux intervertébraux. Si les mains deviennent noueuses, c'est que l'arthrose y est plus visible qu'ailleurs. L'involution musculaire explique que les circonférences brachiales et jambières se réduisent et que les membres paraissent plus grêles.
5. LE REGARD DU PHYSIOLOGISTE
La plupart des organes du vieillard présentent une réduction parfois importante de leur fonction, en dehors de tout épisode pathologique. Cette réduction a parfois commencé dès que leur développement a été pleinement atteint, par exemple dès l'âge de 15 ans pour la vision et l'audition. Plus tard d'autres. Mais ainsi insensiblement certains organes de l'homme âgé se sont rapprochés du moment où le physiologique frôle le pathologique. La vieillesse est ainsi caractérisée par une réduction de la marge de sécurité.
Il suffit alors d'une diminution de l'apport liquidien pour qu'apparaisse une insuffisance rénale fonctionnelle ou de l'atteinte d'une portion du parenchyme pulmonaire par un processus infectieux pour qu'apparaisse une insuffisance respiratoire. La vieillesse est ainsi caractérisée par une plus grande fragilité.
L'organisme humain devant toute agression ou tout déséquilibre met en jeu des processus chargés de la défendre ou de rétablir l'équilibre. Chez le vieillard la réaction est plus lente, elle est parfois insuffisante. La vieillesse est ainsi caractérisée par une diminution des facultés d'adaptation.
6. LE REGARD DU MEDECIN
Selon les médecins, les vieillards sont, avec les très jeunes enfants, les principaux utilisateurs des instruments sanitaires qui sont à notre disposition et plus particulièrement de ceux qui font appel à l'hospitalisation et à l'usage des médicaments. A partir de 65 ans, la proportion des malades ne cesse de croître et plusieurs maladies atteignent le même individu : cette polypathologie est une des caractéristiques de la vieillesse.
Ces maladies distinctes ou associées ne sont pas le plus souvent propres au vieillard, mais elles présentent dans la vieillesse certains aspects particuliers qui font que l'on peut décrire une pathologie du grand âge.
Certaines maladies ont une fréquence telle dans la vieillesse qu'elles sont souvent considérées comme typiquement gériatriques : la maladie de Horton, affection inflammatoire associée à une atteinte vasculaire (artérite temporale) et à des manifestations rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde) ou encore la fracture du col du fémur, ou encore le zona (herpès zoster)
D'autres se prolongent ou surviennent dans la vieillesse avec des traits propres, tels que l'on décrit après des formes préséniles, des formes tardives ou séniles, ainsi la démence sénile, certaines artérites des membres inférieurs, certaines cardiopathies ou affections oculaires
D'autres se rencontrent dans la vieillesse comme dans les décennies précédentes mais il est habituel de constater le caractère fruste de leurs symptômes (infarctus du myocarde ou ulcère gastrique presqu'indolores) et leur évolution torpide.
D'autres ne sont que les complications de cette pathologie (troubles nutritionnels, syndrome confusionnel) ou de la thérapeutique médicamenteuse qu'on leur applique. Ces maladies que l'on dit iatrogènes se rencontrent en effet avec une fréquence inusitée dans le grand âge en fonction de la polythérapie qu'entraîne cette polythérapie et d'une pharmacocinétique souvent très différente de celle de l'âge jeune ; en effet en raison en particulier de l'élimination tardive de certains médicaments ou de leurs métabolites le seuil de toxicité est plus rapidement atteint. Cette intolérance est une autre des caractéristiques de la vieillesse.
Cette pathologie enfin évolue chez le vieillard souvent vers la chronicité en raison des atteintes renouvelées qui altèrent alors la fonction d'un organe. Il s'en suit qu'il est fréquent alors la fonction d'un organe. Il s'en suit qu'il est fréquent que des incapacités subsistent après la guérison d'un état aigu, capables de se traduire en termes de handicap puis de dépendance.
7. LE REGARD DU SOCIOLOGUE
Selon certains sociologues(21), certains vieillards vivent dans un isolement total : ce sont le plus souvent des femmes, veuves âgées sans enfants ou à famille dispersée. Cet isolement peut être considéré comme un réel fléau social, dans la mesure où il atteint un très grand nombre d'individus et comporte un risque important de placement en institution. D'autres, au contraire, sont entourés par une descendance nombreuse : il n'est pas exceptionnel d'observer de nos jours des familles à quatre, voire cinq générations. Certains vivent dans le dénuement, ne recevant que le "minimum vieillesse" grâce au "Fonds national de Solidarité", image d'un Tiers Monde qui serait parmi nous. D'autres au contraire vivent dans l'aisance, voire la richesse, possédant à eux tous la plus grande part du patrimoine national, et sont la cible privilégiée des Instituts de Jouvence et du marché de l'âge d'or.
Ces deux extrêmes font cependant partie de ce peuple de troisième âge, dont la présence sociale s'est considérablement développée depuis les années 60, dans le sens des loisirs(clubs, tourisme, activités physiques) et de la formation(éducation à la retraite, universités du troisième âge) débouchant par là-même sur une attitude préventive.
8. LE REGARD DU GEOGRAPHE
Tantôt, avec Françoise Cribier(22), le géographe analyse les migrations des retraités à l'approche de la vieillesse, retour vers les racines ou transhumance vers les pays du soleil(héliotropisme), migration modifiant parfois fondamentalement la configuration humaine d'une ville ou d'une région, entraînant un vieillissement "par surcroît" des zones d'accueil. Tantôt il s'agit du départ des adultes en quête de travail (exode rural des années 50 par exemple) ou à la recherche de lieux plus hospitaliers laissant au pays des vieillards solitaires, et aggravant alors encore le vieillissement "in situ" de nos campagnes.
9. LE REGARD DU DEMOGRAPHE
Abandonnant le vieillissement individuel, le démographe manie les chiffres des recensements et les tables de mortalité, et analyse le vieillissement collectif. Il dégage alors la notion de longévité moyenne ou d'espérance de vie aux divers âges. Calculée depuis la naissance, elle a presque doublé en deux siècles, passant de 35 ans à 70 ans, en raison de la réduction massive de la mortalité infantile.
Elle a augmenté dans une proportion moindre aux âges plus avancés, en passant par exemple dans le même temps de 10 à 15 ans à l'âge de 65 ans. Elle est surtout marquée par des différences considérables selon les catégories socio-professionnelles.
A 35 ans, il reste encore à vivre en moyenne 41ans à l'instituteur contre 33 seulement au manuvre sans spécialité. Ces différences sont encore plus nettes selon le sexe, puisque dès la naissance l'espérance de vie de la femme est de huit ans, supérieure à celle de l'homme et garde encore trois ans d'écart à l'âge de 65 ans. Associé à un âge moyen supérieur chez l'homme de deux ans celui de la femme, ce dernier phénomène explique que parmi les vieillards les femmes représentent le sexe dominant.
Dans tous les pays industrialisés, la réduction de la natalité, et dans une moindre mesure les progrès de la prévention puis de la médecine à l'âge avancé, ont entraîné une augmentation lente, progressive de la proportion des plus âgés dans la population.
Ce phénomène, appelé "vieillissement démographique", est le reflet des irrégularités de nombre des générations précédentes, classes creuses pendant les guerres, naissances accrues avant et après elles ; il est actuellement caractérisé par l'augmentation relative plus importante des octogénaires et des nonagénaires. Cette montée du grand âge aboutit à une vieillesse démographique.
Que conclure, de cette première partie ? Que la vieillesse n'est pas une maladie, mais elle est la période de la vie où celles-ci sont nombreuses et où d'autres maladies cependant fort peu médicales guettent le vieillard. Ensuite, la vieillesse est une maladie de l'adaptation. Il y a dans la vieillesse cette sensibilité aux changements d'habitudes, d'alimentation, de rythmes de vie, de lieux, de climats, de saisons, d'altitude, de personnes, d'environnement affectif et social. Cette hypersensibilité des vieillards peut aussi se traduire en termes de fragilité, tant sur le plan social que psychologique ou physique.
La vieillesse dans la société industrialisée est la période de la vie où les facteurs de risques s'accumulent. L'isolement, la pauvreté, la maladie sont le sort de la plupart. Pour l'OMS, le principal risque devant la vieillesse est d'être une femme. Seules et pauvres souvent, elles abordent le grand âge nombreuses et dans un état de santé plus précaire que les hommes du même âge. Mais le principal risque devant la vie est d'être un homme puisque sa longévité est plus courte, mais l'homme aborde plus solidement le grand âge parce qu'il est le fruit d'une sélection rigoureuse.
La vieillesse est aussi la période de la vie où les facteurs de stress ont le pouvoir pathogène le plus grand, parfois mortel. Le décès du conjoint ou d'un proche, un accident, une hospitalisation d'urgence, un cambriolage sont dangereux par leur soudaineté, débordant toute compensation. Les facteurs de stress deviennent ici très vite des facteurs de détresse. Hans Selye(23) comparait à la vieillesse la phase d'épuisement de son syndrome d'adaptation.
La vieillesse est une maladie de l'afférentation. Dans la préface de l'ouvrage de L. Israël, Robert Hugonot écrit : "La vieillesse est la période de sa vie, où l'homme se rend compte que de tous ses organes, le cerveau est le seul qui ait quelque peu d'importance(24)." Il est au centre de toute commande, mais il est surtout l'organe de sa fonction intellectuelle. Les cinq sens sont les antennes qui permettent son afférentation à l'environnement. De tous, l'ouïe et la vue sont les plus précocement touchés par le vieillissement. En leur absence, le cerveau peut certes restituer ses acquis et ses pensées, mais il cesse d'être nourri de nouveaux apports et glisse peu à peu dans un état d'hypostimulation qui altère gravement sa fonction.
La vieillesse est une maladie de l'autonomie, par accumulation des dépendances. Dépendance économique, des organismes de pensions, de retraites, dépendance éventuelle des siens, par le biais de l'obligation alimentaire. Dépendance psychologique, qui restreint les espaces moteur, célébral ou sensoriels. Dépendance sociale, des services et des institutuions.
C'est dans la vieillesse que ces dépendances sont le plus étroitement associées, qu'elles sont aussi le plus difficile à évaluer, et nécessitent des instruments nombreux et fiables, dont Liliane Israël(25) vient d'analyser le plus grand nombre.
Enfin, la vieillesse est une maladie de la tolérance. Car elle a maintenant le tort d'être banalisée et celui de ne pas toujours être belle. On voit naître un sentiment de refus, de rejet, d'exclusion. Peur d'être vieux et peur des vieux s'expliquent à la fois par le sentiment que la vieillesse est un rivage malsain pour soi-même et pour la société qu'elle risque de submerger. La vieillesse peut en effet poser désormais aux sociétés industrialisées le problème important de leur histoire. Venons-en à présent à Epicure.
2IÈME PARTIE : EPICURE ET LA VIEILLESSE
1. LA VIEILLESSE SELON HOMERE
Selon Andrée Catrysse(26), l'importance de l'âge dans le système social et politique des Grecs se lit dans leur langue même. Ce système, en effet, est formé sur le modèle de la cellule sociale initiale, la famille, qui est régie dans la forme monarchique par le mâle le plus âgé. L'âge donne le pouvoir et l'autorité, garantit l'obéissance et le respect des marques d'honneur. Le spectre qui est l'attribut du roi, mais aussi des personnes revêtues, par nature et par occasion d'autorité, est un bâton. Ce bâton qui est le bâton de vieillesse, montre le lien entre l'âge et le pouvoir. Ainsi le père peut utiliser sa canne pour frapper le fils et le petit-fils désobéissants et le bâton est le symbole de l'autorité.
Les Grecs de l'époque archaïque voyaient dans le vieillard une sorte de privilégié. Le mot vieillard vient du grec gerôn et du latin vetus, le diminutif est vetulus. Vetulus a une nuance péjorative. A ce mot, nous avons ajouté un suffixe - ard, souvent aussi péjoratif. Vieillard définit une "personne d'un âge avancé".
Les Achéens, partant pour une expédition punitive contre la ville de Troie en Asie mineure, est embarqué des vieillards pour la simple raison que ceux-ci étaient des conseillers attitrés du chef de chaque contingent ; ils forment le Conseil des Anciens dont chaque roitelet prend les avis avant l'action à laquelle tous vont participer. Ce sont les gérontes ou anciens. Parmi ces vieillards, Homère cite le vieux Pélée, le père d'Achille. Il est resté en Thessalie, "couché dans son palais, tout affaibli par la vieillesse amère(27) ", entouré de voisins qui sans doute lui font des misères, sans personne près de lui pour écarter le malheur et la mort(28). Son fils, quand il parle de lui, ignore s'il est encore vivant à l'heure qu'il est. Ne parlons pas non plus de Priam. Comme pour d'autres vieux cités par l'épopée, "l'âge pour lui a mis fin à la guerre(29) ", mais il reste le chef, le roi qui règne sur troie. Il a encore toute sa tête et est toujours capable de conduire son char. Il est dit être "au seuil de la vieillesse", ses forces sont amoindries et son courage affaibli. La peur facilement "fait se dresser on poil sur ses membres tordus(30) " ; nous dirions sans doute "déformés par les rhumatismes", car il est exclu qu'il ait été contrefait de naissance. C'est sans ménagement que dans un moment de presse, un héraut le pousse à partir(31). Au chant XXIV, nous le voyons se jeter aux pieds d'Achille qui a tué presque tous ses fils, lui baiser les mains, le supplier de lui rendre la dépouille d'Hector en échange d'une immense rançon, pauvre vieil homme anéanti par les malheurs(32).
Voyons plutôt le cas de Nestor, le vieux meneur de chars, roi de Pylos, à qui obéissent les quatre-vingt-dix navires mis en ligne par les peuples de la région. Certes il est âgé, probablement septuagénaire, puisqu'il a déjà vu passer deux générations et règne sur la troisième(33), mais quelle vitalité ! Signalons qu'il rend de grands services sur le champ de bataille. Ce n'est jamais lui qui traîne près des nefs, tout vieux guerrier qu'il est(34). C'est le médecin Machaon, gravement blessé(35) ou dans sa barque, s'armant à la hâte d'une lance et d'un bouclier pour courir en direction d'un vacarme, venant du front qui lui fait craindre la déroute des Grecs(36).
Il n'est évidemment plus question pour lui de se mesurer aux héros troyens en combat singulier, ni de participer à la mêlée du corps à corps. Le jour où les circonstances l'ont obligé à intervenir de trop près dans le combat, le bouillant Diomène a dû courir à son secours et il l'apostrophe ainsi : "Ah ! Vieillard, les jeunes combattants te donnent bien du mal Ta vigueur est brisée, la fâcheuse vieillesse t'accompagne. Allons, apprête-toi à montrer à mon char(37)."Et, continue Homère, "Nestor n'a garde de dire non". C'est un prix symbolique qu'Achille offre à Nestor lors des jeux funèbres en l'honneur de Patrocle. En lui remettant la coupe qui constitue le cinquième prix pour la course de chars à laquelle le roi de Pylos n'a pas pris part, il lui dit : "Tiens, toi aussi, vieillard, conserve cette pièce en mémoire des funérailles de Patrocle Je te donne ce prix d'office : tu n'auras à combattre ni au pugilat ni à la lutte, tu n'entreras pas dans le tournoi des javelots, tu ne prendras pas de part à la course. La vieillesse fâcheuse désormais te presse(38)."A quoi Nestor répond : "Tout ce que tu dis là, mon enfant, est fort bien dit. Non, mon cher, mes membres n'ont plus la même assurance, ni mes pieds ni mes bras : on ne voit plus ceux-ci jaillir, à droite, à gauche, de mes épaules A de plus jeunes maintenant de s'offrir pour telles épreuves. Je dois, moi, obéir à la triste vieillesse, moi qui brillais alors entre tous les héros ! Mais je reçois ce présent volontiers, et mon cur est en joie de voir que tu te soucies encore de mes bontés et que tu n'oublies pas l'hommage qui m'est dû parmi les Achéens(39)."
Passons au cas d'Ulysse. Ulysse qui, la guerre de Troie terminée, mettra dix ans pour rentrer chez lui après une odyssée modèle, à savoir une série impressionnante d'aventures de toutes sortes, y compris des aventures amoureuses avec d'enchanteresse immortelles, nous semble - à plus forte raison dans l'Iliade - un homme encore jeune, en tout cas dans toute la force de l'âge. Pourtant, aux yeux d'Antiloque, le fils cadet de Nestor, Ulysse est un "vieillard encore vert". Nous l'apprenons lors des jeux funèbres en l'honneur de Patrocle, où Ulysse remporte le premier prix à la course. En fin de parcours, Ulysse et Ajax dans une bouse de buf pour que gagne son favori. Antiloque est troisième et il s'adresse en souriant aux spectateurs : "Vous savez tous déjà déjà ce que je vais dire, amis : c'est aux vieux que cette fois encore va la faveur du Ciel. Ajax est un peu mon aîné, mais celui-là est d'une génération antérieure, de l'âge des ancêtres : on dit de lui qu'il est un vieillard encore vert. Et pourtant, il n'est pas aisé de lutter à la course avec lui, quand on n'est pas Achille(40)."Déjà chez Homère, les très jeunes gens ont vite fait de traiter leurs aînés de "vieux" !
Prenons maintenant Idoménée, le chef des Crétois. Le chant XIII de l'Iliade résonne de ses exploits. Il collectionne "les piques troyennes qu'il arrache à ceux qu'il a tués(41)" et lance le javelot avec une terrible efficacité. Jamais il n'est apostrophé du terme de "vieillard", comme Nestor, Prima, Phénix et d'autres encore.
Felix Buffière, dans son ouvrage remarquable, Les mythes d'Homère et la pensée grecque écrit à propos des vieillards et du pouvoir qu' "un souverain n'a pas le droit de suivre son bon plaisir : il doit se conformer à la loi et à la raison, qui le dominent. Cette loi et cette raison sont personnifiées par Nestor, qu'Homère a placé près d'Agamemnon. Un roi doit rendre des comptes, expier s'il a commis des fautes ; c'est ainsi que le trop superbe Agamemnon s'humiliera pour racheter son insolence envers Achille." Dans la note (42) qui suit ce passage notre auteur se réfère à Dion Chrysostome LVI, Agamemnon aut de regno. A propos de Nestor, il se reporte au traité de Plutarque : Si un vieillard doit prendre part au gouvernement, ch 8. Plutarque estime que le vieillard est fait pour les conseils, plus que pour l'action, mais qu'il ne doit pas rester oisif : "C'est ce qu'enseigne parfaitement Homère, à ceux qui savent entendre ce poète". Homère montre en effet Nestor, qui prend part à l'expédition contre Troie, respecté et honoré ; Pélée et Laërte, restés au logis, n'essuient que rebuts.
En effet, à 60 ans, les Athéniens étaient astreints à servir la cité-Etat pendant un an en qualité d'arbitres public. Rien d'ailleurs ne les obligeait, même âgés, à se retirer de la politique, s'ils conservaient la faveur du peuple. Périclès a soixante-cinq ans quand il prononce la fameuse oraison funèbre du livre II de Thucydide en l'honneur des premiers morts de la guerre du Péloponnèse. Parlant de l'empire athénien et de la part qu'y ont prise les générations successives, il dit : "Pour ce qui est venu en plus, c'est à nous personnellement, la génération encore en pleine maturité, qu'en revient le développement (Thucydide II,36) (43).
Soixante ans ne sonnent pas irrémédiablement l'heure de la retraite pour tous les militaires. Nous lisons dans Plutarque, Vie d'Eumène, que les troupes de ce dernier, avant la bataille, l'exhortaient à être confiant, car ses adversaires reculeraient quand ils sauraient qu'ils avaient devant eux les plus anciens de l'équipe de Philippe et d'Alexandre, des guerriers professionnels, invaincus et jusqu'ici infaillibles : "beaucoup avaient soixante-dix ans et aucun n'avait moins de soixante ans. C'est pourquoi, en chargeant contre les troupes d'Antigone, ils criaient : "Vous péchez contre vos pères, mauvaises têtes(44) !"
Ensuite, quelques observations tirées du Corpus hippocratique prouvent qu'il y avait à l'époque classique suffisamment de vieillards pour que la médecine savante s'intéressât à eux. Elle observe que les personnes âgées ne sont pas nécessairement fragiles et, au contraire, résistent mieux que les jeunes dans de nombreux cas. "Les vieillards supportent plus aisément le jeûne (Aphorismes, I, 13). Pour la même raison les fièvres ne sont pas aussi aiguës chez les vieillards, car le corps est froid(Ibidem). Les personnes faites à supporter des travaux journaliers les tolèrent, quoique faibles ou âgées, mieux que des gens forts et jeunes qui n'y sont pas faits (Aphorismes II,49). (L'arthrite avec fièvre) attaque plus volontiers les jeunes que les vieux (Affections, 30) Il faut redouter, jusqu'à ce que les 60 ans soient de beaucoup dépassés, des maladies comme les favus, les cancers cachés et souterrains, les herpès Chez les vieillards, on ne voit aucune tumeur de ce genre, mais ils sont affectés de cancers cachés et superficiels qui ne finissent qu'avec leur vie.(Prorrheticon, II,11) (45)
2. LA VIEILLESSE SELON EPICURE
Dans cette partie, nous utiliserons le texte d'Epicure, Lettres et maximes, établi et traduit par Marcel Conche(46) ou indifféremment celui de Jean-François Balaudé. Nous ne nous attarderons pas sur la Lettre à Hérodote qui perle surtout de la nature, mais sur la lettre à Ménécée qui nous fait connaître les conditions de la vie heureuse. La doctrine d'Epicure, en principe, s'adresse à tout le monde, et de fait, Epicure accueillait dans son école, le Jardin, tous les hommes indistinctement, y compris les femmes, parmi lesquelles des courtisanes et des esclaves, qui aspiraient à le suivre sur la voie de la sagesse.
La Lettre à Ménécée est un traité de la méthode du bonheur : si tu veux être heureux, que dois-tu faire à l'égard de tes opinions, de tes craintes, de tes désirs, de tes plaisirs et de tes douleurs, de tes vertus ? La lettre analyse les conditions du bonheur. Il y a toutefois une condition qui, qu'elle apparaisse ou non explicitement, est constamment présupposée : la condition sans laquelle les autres conditions ne peuvent être remplies (la condition des conditions) - l'étude et la science de la nature.
L'épicurisme n'est pas un simple retour, du "monde clos" des platoniciens, en particulier d'Aristote, à l' "univers infini" de Démocrite Quelle est donc cette méthode du bonheur ?
L'épicurisme, selon André Bonnard, dans la civilisation grecque(47) est une sagesse très pratique qui va droit au but, le bonheur de l'individu. La philosophie n'est pas chez cet homme un jeu d'intellectuels, un luxe de professeurs : c'est un travail sur le plus urgent des problèmes. Le bonheur est un besoin pressant qui n'attend pas. Pour trouver et donner le bonheur, il faut d'abord comprendre que les hommes sont très malheureux et pourquoi ils le sont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Il faut chasser cette peur, cette angoisse permanente, logée au fond de chaque être humain. Quand elle aura été délogée, par une vue plus juste de la réalité, alors seulement le bonheur pourra naître.
Dans le préambule de la Lettre à Ménécée, nous pouvons déduire que nous sommes, dans toutes nos actions, orientés vers le bonheur. Le bonheur est le sens de toute notre conduite. Or ce bonheur, nous ne l'obtenons pas : nous laissons la vie se perdre en délais, et chacun de nous meurt accablé d'occupations. Il faut opérer une révolution dans la méthode : au lieu d'aller au bonheur spontanément, se demander si l'on suit le bon chemin, s'interroger sur la voie suivie, et à suivre.
La philosophie est une activité "energeia "(48) ; donc, comme toutes les activités, elle vise au bonheur. Mais elle diffère des autres activités en ce que, au lieu d'aller de l'avant, de courir "de pointe", elle fait réflexion sur ces autres activités. Elle substitue à une mauvaise méthode pour aller vers le bonheur, une bonne méthode, et c'est pourquoi, à la différence des autres activités, elle "procure la vie heureuse" : "la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse(49) " "par des dsicours et des raisonnements", autrement dit non par la conquête de tel objet, mais par une modification profonde de notre vie dans sa méthode même, cela en modifiant le discours que nous tenons à nous-mêmes au sujet de ce qui est à rechercher ou à fuir.
Si la philosophie nous donne le bonheur, il faut philosopher tout de suite : il y a urgence à philosopher. Car, si je ne philosophe pas, je fais autre chose, mais, dans cette autre activité, je cherche ce que je puis obtenir par la philosophie seulement. Différer de philosopher, c'est différer d'être heureux. Mais, pendant que le non-philosophe retarde le moment du bonheur, le temps passe ; et il meurt pour toujours : "Nous sommes nés une fois, il n'est pas possible de naître deux fois, et il faut n'être plus pour l'éternité : toi, pourtant, qui n'es pas de demain, tu ajournes la joie ; la vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé(50)."
On le voit : Epicure cerne l'essentiel d'un trait sobre et décisif. Nous serons morts demain, n'étant que la créature d'un jour - et la mort signifie non une autre vie, mais une éternité de non-vie. Il faut donc se convertir au bonheur dès la minute même : la conversion est la philosophie.
Il ne s'agit pas d'atermoyer, de se préparer indéfiniment, à philosopher par des études préalables. Je vais mourir : ce n'est pas le moment de faire des mathématiques, ni la stéréométrie
Dans la suite de la a Lettre adressée à Ménécée, Epicure invite un jeune homme à continuer à philosopher même dans sa vieillesse : "Il faut philosopher lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est vieux, dans un cas pour qu'en vieillissant l'on reste jeune avec les biens, par la reconnaissance que l'on ressent pour ce qui est passé, dans l'autre cas, pour que l'on soit à la fois jeune et vieux en étant débarrassé de la crainte de ce qui est à venir(51)."
Le vieillard ou le sage, selon Epicure, est celui qui ne "craint pas la non-vie, car la vie ne l'accable pas, et il ne pense pas que la non-vie soit un mal ; et tout comme il ne choisit pas la nourriture qui est absolument copieuse, mais la plus agréable, de même aussi il cueille les fruits du temps non pas le plus long, mais le plus agréable(52)."Pour Epicure, en effet, le vieillard ne doit pas craindre la mort, qui est certes déprimante et absurde. La mort, pour lui, n'est rien, rigoureusement rien. Nous ne pouvons même pas en avoir conscience, pas plus que d'un simple évanouissement. Les particules de notre être, de notre conscience d'exister se décomposent, comme tout composé arrive à la décomposition. Mais c'est un événement parfaitement naturel. Et d'ailleurs quand il se produit nous ne sommes plus là pour en prendre conscience. Aussi écrit-il dans cette même lettre : "Le plus terrifiant des maux, la mort n'a donc aucun rapport avec nous, puisque précisément, tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et une fois que la mort est là, alors nous ne sommes plus (53)."
Une remarque s'impose cependant : "celui qui exhorte le vieillard à bien s'éteindre" est stupide(54)." Epicure invite plutôt le vieillard à bien vivre. Quand on aura ajouté que la doctrine épicurienne exige de ses adeptes une extrême frugalité, on comprendra que les "vieux" ont tout intérêt à l'adopter. D'ailleurs, parmi les Sentences Vaticanes, on peut citer une qui semble indiquer la particulière adéquation de l'épicurisme au dernier âge de la vie : "Ce n'est pas l'homme jeune qui est enviable, mais le vieillard (gerôn) qui a vécu parfaitement bien. Car le jeune, fort de sa vigueur, se déroute, violemment agité par la fortune, tandis que le vieillard a jeté l'ancre dans la vieillesse, comme dans un port, et, avec une joie sûre, a saisi parmi les biens ceux qu'auparavant il espérait à peine." C'est assurément une folie encore plus grande de vanter une mort prématurément, que l'on est d'ailleurs toujours à même de se donner. Comme le conclut excellemment Lange "Il n'y a plus de mal dans la vie pour celui qui s'est réellement convaincu que ne pas vivre n'est plus un mal (55)." Epicure, lui-même a su donner à sa vie l'assaisonnement d'une sage piété, sans s'éloigner du but principal de sa philosophie : atteindre cette tranquillité d'âme qui a pour fondement unique et inébranlable l'absence de toute superstition insensée.
Terminons par la force du vieillard. Le paragraphe 133 nous en parle. Il est celui qui vit comme un dieu parmi les hommes. Car "il ne ressemble en rien à un animal mortel, l'homme vivant dans les biens immortels(56) ". Il nous paraît évident qu'Epicure assurait à ses authentiques adeptes la belle vieillesse qu'avait méritée leur sagesse et où la chance ne devait pas nécessairement intervenir. Même s'ils souffraient, ils ne maudissaient pas la vie et ne souhaitaient pas la quitter.
CONCLUSION
En concluant cette étude, sur Epicure et la vieillesse, nous nous sommes rendus compte que nous avons parlé surtout des hommes âgés de condition libre ayant vécus à Athènes ou à Sparte, mais nous sommes restés fort discrets, sinon muets sur les femmes âgées et la masse des vieux esclaves des deux sexes qui habitaient le monde grec pendant la période que nous avons envisagée. Toutefois, à la suite de Andrée Catrysse, nous nous permettons quelques observations s'ordonnant autour d'une confrontation entre un passé vieux de plus de deux millénaires et le présent.
L'âge que les Grecs appelaient la vieillesse se situe entre cinquante-six et soixante-trois ans. Pour Solon, à cet âge, les fonctions de l'intellect sont toujours puissantes, mais elles ne sont plus aussi vigoureuses : elles accusent donc une légère baisse : le déclin a déjà commencé chez celui que Solon, sans doute, appelait encore comme Homère, un géronte.
Pour Hippocrate, l'homme devient un géronte à partir de cinquante-six ans. Dans l'hebdomade précédente, soit de quarante-neuf à cinquante-six ans, il lui donne le nom de presbutès, "homme âgé". le médecin grec juge nécessaire d'intercaler entre "l'homme fait" (de trente-cinq à quarante-neuf ans) et le "géronte" (le vieillard) un intermédiaire, le presbutès, l'homme âgé, qui relie la maturité à la vieillesse proprement dite sans hiatus. De telles évaluations concordent avec les études récentes sur la sénescence(57). Mais le géronte, qu'on lui donne ce nom plus tôt ou plus tard, ne devient pas pour autant un inutile, un invalide ou un dément. Il rend encore de grands services. Car toutes les fonctions physiologiques et psychologiques ne déclinent pas ; certes, il y a des organes plus sensibles que d'autres aux effets de l'âge, essentiellement les organes et les tissus effecteurs. Mais la gérontologie contemporaine, riche en épreuves et tests physiologiques et psychométriques, montre "qu'au niveau du système nerveux les modifications chez l'adulte vieillissant sont mineures, pour autant qu'il soit indemne de troubles pathologiques Les capacités intellectuelles nécessaires à la solution de problèmes nouveaux déclinent précocement et fortement avec les années, tandis que celles qui font intervenir l'expérience ne se modifient guère ou ne font que tardivement." Nous retrouvons ainsi cette expérience dont nos textes font tant de cas, qui enrichit l'individu de savoir, tempère les effets de sa vigueur juvénile - souvent trop pressée de s'exercer - et construit lentement la "prudence". l'ennui, c'est que l'homme d'expérience, prebutès ou géronte, comme disent les Grecs, quand il se trouve placé devant une situation nouvelle, inédite, a tendance à ne rien tenter ou risquer, à différer la décision et à freiner les initiatives : sa grande expérience ne compense pas forcément le déclin de ses facultés d'adaptation.
BIBLIOGRAPHIE
1. Andrée CATRYSSE.- Les Grecs et la vieillesse : d'Homère à Epicure (Paris, Harmattan 2003)
2. Christophe de JAEGER.- La Gérontologie (Paris, Que sais-je, PUF 1992)
3. Claudine Monteil.- Modernité et engagement (Paris, l'Harmattan 2009).
4. Diogène LAERCE.- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, Tome 2(Paris, Garnier/Flammarion 1967), p. 219
5. EPICURE.- Lettres et Maximes (Librio Philosophie 2004)
6. EPICURE.- Lettres et maximes par Marcel Conche, (Paris, P.U.F 1987)
7. Félix BONNARD.- La civilisation grecque (Paris, Albert Mermoud 1980)
8. Felix Buffière.- Les mythes d'Homère et la pensée grecque (Paris, Belles Lettres 1973)
9. François BOURLIERE.- la gérontologie. Sénescence physiologique. In Encyclopedia universalis
10. Françoise CRIBIER.- Regards croisés sur la protection sociale de la vieillesse (Comité d'histoire de la sécurité sociale 2005)
11. Friedrich-Albert LANGE.- Histoire du matérialisme. Critique de son importance à notre époque (Coda 2004)
12. Hans SELYE.- The Stress of Life (Schaum Outline Series 1978)
13. HOMERE.- Iliade (Paris, Gallimard 1975)
14. Jean Marie BROHM "Philosophies du corps : quel corps ?" in Encyclopédie philosophique universelle 1 L'univers philosophique (Paris, PUF 1989)
15. Liliane HOLLIDAY WILLEY.- Vivre avec le syndrome d'Asperger ; un handicap invisible au quotidien (De Boeck 2010)
16. Liliane Israël.- Source Book of Geriatric Assessment Evaluations in Gerontology Evaluations en gérontologie (Karger 1985)
17. Marcel JOUHANDEAU.- Réflexion sur la vieillesse et sur la mort (Paris, Grasset 1956)
18. Marie-Louis le ROUZO.- La personne âgée. Psychologie du vieillissement (Bréal 2007)
19. Revue gérontologie et société 74 numéro 14 et 16 numéro spécial "art et vieillissement 1998
20. Robert HUGONOT.- "La vieillesse" in Encyclopédie philosophique universelle 1 L'univers philosophique (Paris, PUF 1989)
21. Simone de Beauvoir.- La vieillesse (Paris, Gallimard 1970)
22. Vincent CARADEC et François de SINGLY.- Sociologie de la vieillesse et du vieillissement (Paris, Armand Collin 2005)
23. Vladimir JANKELEVITCH.- La mort (Paris, Flammarion 2008)
Notes :
1) Andrée CATRYSSE.- Les Grecs et la vieillesse : d'Homère à Epicure (Paris, Harmattan 2003), p. 7
2) Ibid., p. 8
3) Diogène LAERCE.- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, Tome 2(Paris, Garnier/Flammarion 1967), p. 219
4) EPICURE.- Lettres et Maximes (Librio Philosophie 2004), p. 43
5) D.L. X,22
6) S.V.19
7) Robert HUGONOT.- "La vieillesse" in Encyclopédie philosophique universelle 1 L'univers philosophique (Paris, PUF 1989), p. 1407
8) Ibid., p. 1407
9) Revue gérontologie et société 74 numéro 14 et 16 numéro spécial "art et vieillissement 1998
10) Marcel JOUHANDEAU.- Réflexion sur la vieillesse et sur la mort (Paris, Grasset 1956)
11) Jean Marie BROHM "Philosophies du corps : quel corps ?" in Encyclopédie philosophique universelle 1 L'univers philosophique (Paris, PUF 1989), p. 403.
12) Simone de Beauvoir.- La vieillesse (Paris, Gallimard 1970), p. 15
13) Claudine Monteil.- Modernité et engagement (Paris, l'Harmattan 2009), p. 9.
14) Simone de Beauvoir "propos recueillis en oct. 1970" in Claudine Monteil.- Modernité et engagement (Paris, l'Harmattan 2009), p. 250.
15) Simone de Beauvoir "propos recueillis en oct. 1970" in Claudine Monteil.- Modernité et engagement (Paris, l'Harmattan 2009), p. 250
16) Vladimir JANKELEVITCH.- La mort (Paris, Flammarion 2008), p. 214
17) Progeria ou syndrome de Hutchison-Gilford : affection observée chez des enfants (parfois jumeaux) qui à l'âge de 10 ans, tout en ayant le QI de leur âge, présentent les caractères d'un vieillard de 70-80 ans et meurent d'athérome cérébral ou coronaire avant l'âge de 15 ans. Maladie de Werner : d'apparition plus tardive (20-30 ans) qui associe canitie, calvitie, nanisme, cataracte, diabète, athérosclérose et ostéoporose. Il en est de même du mongolisme ou syndrome de Down (trisonomie 21) plus répandu et plus connu. Dans ces affections, le taux des doublements cellulaires est très inférieur aux valeurs normales.-
18) Christophe de JAEGER.- La Gérontologie (Paris, Que sais-je, PUF 1992), p. 16.
19) Liliane HOLLIDAY WILLEY.- Vivre avec le syndrome d'Asperger ; un handicap invisible au quotidien (De Boeck 2010)
20) Marie-Louis le ROUZO.- La personne âgée. Psychologie du vieillissement (Bréal 2007)
21) Vincent CARADEC et François de SINGLY.- Sociologie de la vieillesse et du vieillissement (Paris, Armand Collin 2005)
22) Françoise CRIBIER.- Regards croisés sur la protection sociale de la vieillesse (Comité d'histoire de la sécurité sociale 2005)
23) Hans SELYE.- The Stress of Life (Schaum Outline Series 1978)
24) Liliane Israël.- Source Book of Geriatric Assessment Evaluations in Gerontology Evaluations en gérontologie (Karger 1985)
25) Liliane Israël.- Source Book of Geriatric Assessment Evaluations in Gerontology Evaluations en gérontologie (Karger 1985)
26) Andrée CATRYSSE.- Les Grecs et la vieillesse : d'Homère à Epicure (Paris, Harmattan 2003), p. 21
27) HOMERE.- Iliade XVIII, 434,5
28) HOMERE.- Iliade XXIV, 487-89
29) HOMERE.- Iliade III, 150
30) Iliade XXIV, 358-60
31) Iliade III, 249
32) Iliade XXIV, 477-506
33) Iliade I, 250-2.
34) Iliade X, 548-9
35) Iliade XI, 511-18
36) Iliade XIV, 9-15
37) Iliade VIII,102-103,105 et 112
38) Illiade XXIII, 618-23
39) Iliade XXIII, 626-30 et 643-9
40) Illiade XXIII,787-92
41) Iliade XIII, 261-2
42) Felix Buffière.- Les mythes d'Homère et la pensée grecque (Paris, Belles Lettres 1973), p. 348 note 31
43) Andrée CATRYSSE.- Les Grecs et la vieillesse : d'Homère à Epicure (Paris, Harmattan 2003), p. 8
44) Ibid, pp. 8-9
45) Ibid ;, p. 9
Paris, P.U.F. 1987
46) Félix BONNARD.- La civilisation grecque (Paris, Albert Mermoud 1980), p. 847
47) SEXTUS EMPIRICUS.- Adversus mathematicos XI, 169 cité dans Epicure.- Lettres et maximes par Marcel Conche, (Paris, P.U.F 1987), p. 40
48) Ibid., p. 41
49) EPICURE.- Sentences Vaticanes 14 cité dans Lettres et maximes par Marcel Conche, (Paris, P.U.F 1987), p. 41
50) EPICURE.- Lettres, maximes, sentences (Librairie Générale Française 1994), p. 191
51) EPICURE.- Lettre à Ménécée & 126, p. 193 (Balaudé).
52) EPICURE.- Lettre à Ménécée & 126, p. 193 (Balaudé).
53) EPICURE.- Lettre à Ménécée & 126, p. 193 (Balaudé).
54) Friedrich-Albert LANGE.- Histoire du matérialisme. Critique de son importance à notre époque (Coda 2004), p. 77
55) EPICURE.- Lettre à Ménécée & 135, p. 198 (Balaudé).
56) François BOURLIERE.- la gérontologie. Sénescence physiologique. In Encyclopedia universalis
LE PEUPLE DOIT DEFENDRE LA LOI COMME LE MUR DE SA CITE
Heidegger a imputé à la métaphysique moderne de la subjectivité la plus extrême oubli de ce qu'il nomme l' "Etre" : en résumant la réalité du réel (l'être de tout étant) à sa représentabilité et à sa manipulabilité par le sujet comme raison et comme volonté, cette dimension d'irréductible "différence" inscrite au cur du réel, même de l'Etre. Le geste du penseur averti des périls auxquels expose, à travers la technicisation du monde, un tel "oubli de l'être", consistera donc à tenter le "pas de recul" qui, par le "dépassement" ou l' "évitement de la métaphysique", préparera une libération à l'égard de la lutte planétaire pour la domination technique de l'étant.
Par une pensée renouvelée du NOMOΣ, la pensée heideggérienne converge vers une autre idée du droit, qui s'alimente davantage aux représentations de la Grèce archaïque, celle des Présocratiques, qu'à la conception moderne du droit comme valeur posée par la subjectivité et pour elle. Ainsi la notion du nomos est-elle, de ce point de vue, l'objet d'une analyse soutenue, qui engage une réflexion sur ce qu'il pourrait en être du droit hors de l'horizon de l'humanisme et de la subjectivité. Venons à présent à la notion de nomos.
1. LA DEFINITION DE LA LOI
Enoncé général de ce qui doit être, au double sens de ce qui ne peut pas ne pas être et de ce qui correspond à une obligation, telle est la loi. La loi a, dans un premier sens, le sens de l'obligation juridique : le latin lex (de lego, recueillir, lire) désigne d'abord une motion faite par un magistrat devant le peuple. Lucrèce utilise le mot foedus, qui signifie pacte, convention, pour désigner les lois du destin ou de la nature (fati foedera(1) ; foedera naturai(2)). C'est aux stoïciens que l'on doit le passage de la notion du domaine juridique à travers l'univers physique, par l'intermédiaire d'une législation universelle de Dieu. La conception platonicienne ou aristotélicienne des nécessités naturelles, qui utilise les notions d'idées ou de forme dans leur rapport à la matière, est d'une tout autre nature puisqu'elle n'a pas ce rapport à un édit. La médiation divine qui unit les deux types de légalité se retrouve encore chez Spinoza : "Les lois universelles de la nature suivant lesquelles tout se produit et est déterminé ne sont pas autre chose que les décrets éternels de Dieu qui enveloppent toujours une vérité et une nécessité éternelles. Que nous disions donc que tout se fait suivant les lois de la nature ou s'ordonne par le décret ou le gouvernement de Dieu, cela revient au même"(3). L'apparition de la physique mathématique (loi galiléenne de la chute des corps) a pourtant chez Spinoza déjà changé le contenu même de la notion de loi. Une loi physique exprime la constance d'un rapport numérique (comme celle découverte par le cartésien Mariote exprime l'existence d'une relation numérique constante entre la pression, le volume et la température d'un gaz). C'est ce modèle qui permettra à Montesquieu - bien qu'il s'intéresse au domaine juridique - de définir la loi comme l'expression de "rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses(4).". En fait, le concept de la loi acquiert deux contenus inconciliables : 1) formule (pour la physique classique, il s'agit essentiellement de fonctions analytiques de variables réelles, mais on peut soit étendre ce modèle à d'autres domaines que la physique, soit conserver le terme de loi pour des relations non numériques) exprimant une nécessité universelle (par là, elle n'est pas exactement une constatation puisqu'il est posé qu'elle doit valoir pour le futur) ; 2) prescription qui s'adresse à un sujet libre (d'où la contingence de l'acte prescrit). Chacun de ces contenus requiert une analyse épistémologique distincte. Ainsi, nous nous appesantirons sur la loi juridique et la loi politique.
1.1 LA LOI JURIDIQUE
Il y a essentiellement deux façons de considérer la loi du point de vue du droit(5). Elle peut apparaître comme le produit d'une situation historique ou bien, au contraire, relever d'un projet d'action sur la société. Au sens strict, la loi est la règle de droit écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement. La loi impérative est la loi qui ne peut être éludée par celui auquel elle s'applique. La loi supplétive (ou interprétative) est la loi qui ne s'impose à un individu qu'à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part. Au sens large, la loi est la règle de droit, d'origine étatique, qu'elle soit d'origine parlementaire (loi au sens strict) ou non (ordonnances, décrets, arrêtés). Dans la terminologie de F.A. Hayek(6), cette opposition devient celle de nómos, "le droit de la liberté" et thésis, "la loi du législateur". Sans préjuger du point de vue de Hayek qui voit dans l'opinion que toute loi doit être le produit de la libre intervention du législateur (ce qu'on nomme positivisme juridique) l'illusion intentionnaliste et la conclusion erronée d'un rationalisme constructiviste, quant au contraire "le droit de la liberté" dérive des conditions d'un ordre spontané que l'homme n'a pas créé (ce qui est finalement retrouver la position de l'Ecole de droit historique allemande de G. Hugo et F.K. von Savigny(7)), la distinction est sans doute pertinente pour présenter la conception moderne de la loi.
Jusqu'au XVIIè siècle en effet, jusqu'à ce que la loi naturelle soit comprise comme le dessein de la raison naturelle, le droit était à découvrir bien plus qu'à confectionner. Si dans la démocratie athénienne, semble-t-il, apparurent à la fin du Vè siècle avant J.-C(8). les premiers conflits entre la volonté sans entrave du peuple et la tradition de la suprématie du droit, cette idée devait rester en sommeil jusqu'à la fin du Moyen Age, le droit civil classique des Romains, sur lequel la compilation finale de Justinien fut fondée, étant presque entièrement le produit de l'activité des juristes à la recherche de ce qui est juste, et très peu le produit de la législation. Mais le droit romain devait consacrer la loi comme source presque exclusive du droit (les autres ne lui étant que supplétives, ou interprétatives) ce qui semble implicitement entraîner qu'il y ait un législateur suprême dont le pouvoir ne peut être borné. La loi apparaît comme un instrument de pouvoir au service d'un seul homme ou d'une majorité. La philosophie antique avait situé la naissance de la tyrannie dans un divorce entre la légalité - comme instrument de pouvoir - et la justice. Au début du siècle, E. Faguet fera la distinction entre le libéral - qui croit à la liberté - et le démocrate, croyant lui, au pouvoir de la majorité(9). Distinction qui résume en fait la position de l'anarchie individualiste et libéral anglo-saxon des XVIIè et XIXè siècles de théoriciens comme Goodwin(10), B. Tucker(11), A Herbert(12) ou L. Spooner(13), ou, de nos jours R. Nozick qui écrit ceci : "Nos principales conclusions se résument à ceci : Un Etat minimal, qui se limite à des fonctions étroites de protection contre la force, le vol, la fraude, à l'application de contrats, et ainsi de suite, est justifié ; tout Etat un tant soit peu plus étendu enfreindra les droits des personnes libres de refuser d'accomplir certaines choses, et il n'est donc pas justifié ; enfin, l'Etat minimal est aussi vivifiant que juste L'Etat ne saurait user de la contrainte afin d'obliger certains citoyens à venir en aide aux autres, ni en vue d'interdire aux gens certaines activités pour leur propre bien ou leur protection(14). " Plus loin il ajoute : "En gardant le monopole de l'usage de la force et en protégeant tous les ressortissants qui peuplent son territoire, l'Etat empiète nécessairement sur les droits de l'individu et, à ce titre, il est intérieurement immoral Ainsi, l'Etat naîtrait de l'anarchie(15)" Il est certain que, dans la tradition du droit coutumier anglais où longtemps la loi n'a joué qu'un rôle secondaire - le droit anglais étant essentiellement jurisprudentiel -, la loi, formulant moins des principes qu'elle ne corrige ou développe ceux qui se dégagent de la tradition, a pu davantage fonctionner comme une barrière contre tout pouvoir, y compris celui du roi. C'est cet aspect que rappelleront E. Coke contre Jacques 1er et Bacon, et M. Hale contre Hobbes. De toute façon, quelle que soit la place de la loi dans les différents systèmes juridiques, la loi est une règle posée par l'autorité souveraine. La question est donc : le pouvoir peut-il ériger en loi toute règle ? Peut-on s'opposer aux lois au nom d'un droit plus fort, comme Antigone s'oppose à Créon pour obéir à un impératif qu'aucune loi humaine ne saurait transgresser ? L'idée selon laquelle la loi trouve son fondement dans les principes supérieurs du législateur inspire tout le droit moderne.
Avec l'Ecole du droit naturel, en même temps que la loi se laïcise (ce n'est plus dans la Révélation que l'on doit chercher ses préceptes), elle trouve un fondement rationnel supérieur : l'agencement de l'univers physique et moral que la raison découvre. Depuis les sophistes grecs jusqu'à Montaigne et Pascal, la diversité des lois avait nourri les doutes sceptiques sur la stabilité de la justice humaine, témoignant du caractère conventionnel de la loi. La solution était peut-être de rechercher l'unité des lois dans un droit naturel commun à tous. Solution qui perd son sens avec Montesquieu qui affirme : "Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses(16)". Entre les lois positives, il y a des relations naturelles d'exclusion, d'inclusion, commandées non par l'arbitraire d'un homme, d'une assemblée, mais par la nécessité des choses. On lit dans l'Encyclopédie "La loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre(17)" la "nature des choses" a disparu ; ne reste, comme substance législatrice, que la raison humaine. Cette conception inspirera en Côte d'Ivoire, les rédacteurs du Code Civil. Expression de la raison, la loi doit être générale, impersonnelle, permanente. Elle participe au "droit naturel universel et immuable(18)". La loi met ainsi un terme au règne du bon plaisir, de la soumission à une autorité personnelle. Son objet est en fait de rendre les hommes meilleurs(19), elle est appelée à devenir la morale universelle(20). Ce qui est retrouver la pensée des matérialistes d'Holbach ou Helvétius : "la science de la morale n'est pas autre chose que la science de la législation"(21).
Pourtant, c'est la formule rousseauiste que retient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 5 : "La loi est l'expression de la volonté générale(22)". Certes, pour Rousseau la volonté générale ne peut formuler qu'un impératif rationnel. Elle est la raison qui habite chaque homme. Elle n'est pas la majorité : les suffrages ne la créent pas, ils la constatent. La représentation est comme un filtre entre le peuple et la loi. La souveraineté appartient à la nation (être distinct de la somme des individus qui la composent). Un organe législatif parlera en son nom. "Les lois sont faites pour Titus et Cassius et non pour le corps de l'Etat", disait Hobbes(23). Il n'en est pas question dans la théorie rousseauiste. Les lois émanent du seul corps représentant la nation. Les mesures d'exécution de ces lois dès qu'elles concernent des individus, ne sont plus des lois, mais des décrets relevant du seul gouvernement. Ce qui suit de cette inflexion dans le sens des thèses rousseauistes, c'est l'idée que l'Assemblée législative en tant que souveraine ne peut être limitée dans l'élaboration des lois. De fait, la Constitution ivoirienne, adoptée au Référendum du 23 au 24 juillet 2000, en son titre V, art. 71, stipule que "l'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi." Et l'article 76 de préciser : "Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale. En cas de contestation, le Conseil constitutionnelle, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des députés, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine." Car, l'article suivant ajoute que les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires. Comme nous le constatons, il n'y a vraiment pas un contrôle sur le travail de l'Assemblée, pas même un contrôle de constitutionnalité ; alors même qu'à travers les distinctions "droit objectif"-"règle constructive"(24) ou "droit social"- "réglementation"(25) se maintenait le dualisme loi positive/ loi naturelle, et derrière lui la nécessité de tenir le législateur subordonné à une règle supérieure. En effet, si la loi est faite par le peuple ou ses représentants, comment comprendre que des juges - qui ne sont pas des représentants du peuple - puissent examiner, et peut-être annuler, ce qui émane du peuple ? (On reconnaît là une conception subjectivée des valeurs. Il n'y a pas de valeurs objectives à préserver. Les valeurs sont l'expression de la volonté générale.)
Il faut toutefois remarquer que, si nous avons là une conception très volontariste de la loi, cela n'empêche pas celle-ci de jouer comme protection des libertés au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de 1793 : "la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.(26)" De fait, il existe des tribunaux pouvant être saisis par les particuliers d'une action, c'est-à-dire d'un recours engageant un procès, dirigée contre les actes illégaux du gouvernement ou de l'administration, et tendant à leur annulation (on appelle cette action "recours en annulation". Ce contrôle de la légalité confère aux juridictions un rôle très important dans le fonctionnement de l'Etat. C'est dans la mesure où ce contrôle est effectif que l'on peut parler du pouvoir judiciaire comme d'un "troisième pouvoir".
A cette "sacralisation" de la loi, le XXè siècle a vu succéder une prolifération des lois, dans tous les pays. Des lois de plus en plus entièrement novatrices, commandées par une visée politique, quand dans le même temps, le pouvoir législatif tendait à devenir une simple chambre d'enregistrement des décisions du pouvoir exécutif. (Dans la Constitution Ivoirienne de 2000, les articles 42, 44,52, en définissant ce qui relève du règlement, limitent même l'emprise de la loi sur l'activité publique.) Ce que l'on peut appeler la "socialisation du droit" est apparu en Allemagne au XIXè siècle avec la Sozialpolitik. La loi relève d'un plan d'action destiné à corriger l'ordre social. Elle émane d'une volonté transformatrice, constructive, politique. Les règles qu'elle édicte peuvent ne pas préexister à son application (dans le droit des pays socialistes, la loi est ainsi vue comme un instrument de transformation de portée révolutionnaire).
Dans le temps même où l'on voyait le gouvernement se faire législateur, on aboutissait à un critère purement formel de la loi : est loi toute règle édictée en forme législative par l'autorité habilitée à cet effet. Pour Weber(27), K. Schmidt, le droit, décidément libéré de la morale, ne tire plus sa légitimation que du respect des règles de procédure dans son énonciation et son application(28).
La loi a cessé d'être règle générale pour traiter de cas d'espèce, pour devenir une réglementation détaillée. On peut citer comme exemple de loi devenue règle spéciale pour des groupes particuliers le Trade Disputes Act anglais, dès 1906, sur les conflits professionnels qui accorde quelques privilèges aux syndicats de salariés. La loi est devenue solution plus que principe de solution, et l'on aboutit à la juxtaposition d'un grand nombre de statuts particuliers en fonction des conditions de faits. Liée à la conjoncture, la durée des lois est fugace. La loi appelle la loi, un texte corrige les incidences du précédent. La loi connaît de nos jours un déclin, concurrencée par des procédés de réglementation tels que les décrets, les ordonnances, etc.,. Mais peut-être la suprématie et la fixité de la loi supposent-elles une société stable et des croyances fermes, des préceptes de morale sociale fermement établis.
1.2. LA LOI POLITIQUE
Du point de vue de la science politique(29), la loi est le texte adopté par le parlement selon la procédure législative et dans le respect de la constitution, puis promulgué par le président de la république. En Côte d'Ivoire(30), la loi peut résulter du dépôt d'une "proposition de loi" (initiative de la chambre unique) ou d'un "projet de loi" (dont l'initiative appartient au gouvernement. Rousseau, puis la Déclaration de 1789 et, plus tard la tradition républicaine française voyaient dans la loi "l'expression de la volonté générale", ce qui lui permettait d'être au sommet de l'édifice juridique. Mais depuis que le contrôle de constitutionnalité a été introduit, la loi n'exprime la volonté générale que "dans le respect de la Constitution". Elle n'existe que dans un Etat de droit.
A la définition organique (la loi est un texte adopté par le parlement), procédurale (la loi est un texte adopté selon la procédure législative) et formelle (la loi est le texte législatif tel qu'il a été promulgué par le chef de l'Etat), la Constitution de 2000 a ajouté un critère matériel, rompant ainsi avec la tradition républicaine. Ne sont des lois, d'une part, que les textes qui interviennent dans l'un des domaines qui lui assigne la Constitution (art. 71), d'autre part, que les textes qui respectent des exigences (clarté, intelligibilité), elles-mêmes déduites de la Constitution.
A cela s'ajoute encore l'obligation de respecter l'ensemble des engagements internationaux régulièrement souscrits par la Côte d'Ivoire, au premier rang desquels le droit communautaire dans ses diverses manifestations, faute de quoi n'importe quel juge a le pouvoir et même le devoir d'écarter l'application de la loi, à défaut de pouvoir l'annuler.
L'idée de loi de nature occupe une place cardinale dans la philosophie politique classique. Elle est apparue dans l'Antiquité où elle désignait une législation supérieure à toutes les lois écrites de la cité, intangible et sacrée qui, quoique non écrite, s'imposait à l'homme, afin de guider sa conduite dans le droit chemin : telle est la loi à laquelle, selon Sophocle, obéit Antigone en défiant les ordres du roi Créon. Dans cette lignée, nous voulons, à présent, nous tourner vers Héraclite.
1.3. HERACLITE
Les conseils d'Héraclite concernant l'éthique se présentent sous forme de sentences et la plupart renferment une teneur peu différente de celle émise par ses prédécesseurs et ses contemporains ; quelquefois, ses tournures sont plus pittoresques et souvent brutales. Héraclite était indubitablement d'un tempérament très porté à la critique et ses insultes n'ont pas contribué à le rendre populaire auprès de ses infortunés concitoyens. Par exemple, il affirme, "Les meilleurs choisissent une seule chose, à la place de toutes les autres, la gloire'éternelle' parmi les mortels ; mais la majorité est gavée comme du bétail(31)." Ses idées politiques ne sont guère démocratiques, bien qu'elles trouvent leurs origines dans des causes plus empiriques qu'idéologiques. "Un seul homme en (vaut) dix mille pour moi, s'il est le meilleur", dit-il au fragment 49 et il vitupère contre les Ephésiens qui ont exilé son ami Hermodore parce que celui-ci possédait une intelligence exceptionnelle (fragment 121). Le philosophe était d'ascendance noble, mais il refusa les privilèges traditionnellement attachés à sa caste.
Héraclite, en revanche, insiste sur le respect de la loi, dans le fragment qui a servi de titre à cette étude et qui s'énonce ainsi : "Le peuple doit se battre en faveur de la loi comme s'il s'agissait du rempart de la cité." En grec, le terme utilisé pour loi est "νόμος". Il s'agit du fragment 44, selon Diogène Laërce IX,2. Cette insistance quoiqu'exprimée à nouveau de façon conventionnelle, prend une signification bien plus grande et trouve sa justification profonde à la lumière du fragment suivant : "Ceux qui parlent avec intelligence, doivent s'appuyer sur ce qui est commun à tous, de même qu'une cité doit compter sur ses lois, et avec une plus grande confiance encore. Car toutes les lois des hommes se nourrissent d'une seule loi, la loi divine ; car elle a autant de pouvoir qu'elle en veut, suffit pour tous et il lui en reste encore(32)." (qui doit être comparé aux fragment 1 qui s'énonce ainsi : "Au sujet du Logos qui est tel que je le décris, les hommes se sont toujours avérés incapables de le comprendre, aussi bien avant qu'ils ne l'aient entendu, qu'une fois qu'ils l'ont entendu. Car bien que toutes choses se déroulent en accord avec ce Logos, ces hommes sont comme des gens sans expérience, même lorsqu'ils expérimentent des mots et des actes tels que je les explique, quand je déclare qu'il en est ainsi ; mais les autres hommes n'arrivent pas à s'apercevoir de ce qu'ils font après qu'ils se soient réveillés, tout comme ils oublient ce qu'ils font lorsqu'ils dorment(33)." Ou encore au fragment 2 de Sextus(34) qui dit ceci : "C'est pourquoi il est nécessaire de suivre le commun ; mais bien que le Logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils jouissaient d'un entendement particulier". Il y a encore un troisième fragment qui complète le précédent. Je le cite : "A l'écoute, non de moi mais du Logos, il est sage de convenir que toutes les choses sont un(35). "
Ces affirmations démontrent clairement qu'Héraclite était conscient d'avoir connaissance d'une vérité primordiale qu'il essayait en vain de propager, connaissance ayant trait à la constitution du monde dont les hommes font partie. La grande majorité des gens passent, sans la reconnaître, à côté de cette vérité qui est'commune' - simultanément valable pour toutes choses et accessible à tous les hommes, pour peu qu'ils sachent utiliser leur sens de l'observation et de la compréhension, au lieu de s'inventer un entendement particulier et trompeur. Ce que les hommes devraient apprendre à reconnaître, c'est le logos qui pourrait être interprété comme une formule unificatrice ou une méthode mesurée de l'agencement des choses, en d'autres termes, ce qui pourrait être leur structure au plan individuel aussi bien que collectif. Le sens technique de λόγος chez Héraclite se rattache probablement au sens général de'mesure','calcul' ou'proportion'. Il n'est pas possible de penser que seul le'récit' d'Héraclite soit concerné (car alors la distinction entre'moi' et'le logos' au troisième fragment cité plus haut n'a plus de sens), bien que le Logos se révèle dans ce récit et d'une certaine façon, coïncide avec lui. Cet agencement conforme à une mesure et au plan commun a le résultat suivant : toutes les choses, bien que multiples en apparence et complètement distinctes, sont en fait réunies en un tout cohérent dont les hommes eux-mêmes font partie. Donc, logiquement, les hommes doivent comprendre la cohérence du tout s'ils veulent pouvoir agir efficacement sur le déroulement de leurs vies. Et pourtant,'formule'','arrangement mesuré' et autres mots sont des abstractions trompeuses du sens technique de logos. Probablement, Héraclite devait-il parfois concevoir le Logos comme le véritable constituant des choses et sous bien des aspects, il le représente comme coïncidant avec l'élément cosmique primordial, c'est-à-dire le feu qui est en soi un extrême et non un intermédiaire en puissance.(36)
Pour conclure cette partie, nous dirons que les lois humaines sont alimentées par la loi divine universelle ; elles sont en accord avec le Logos, l'élément-formule du cosmos. Le participe "nourri" (cf. les hommes se nourrissent d'une seule loi, la loi divine) du fragment 114 cité plus haut, n'est pas totalement pris dans un sens métaphorique : la relation entre les lois humaines et le Logos se fait indirectement, bien qu'elle ne soit pas dénuée de fondement matériel ; car les bonnes lois sont produites par des hommes sages aux âmes de feu qui ont compris, comme Héraclite lui-même, la véritable relation qui existe entre les hommes et le monde.
1.4. HEIDEGGER
A suivre l'introduction à la métaphysique, la loi (le nomos) ou la constitution de la polis (= ce qui la constitue comme telle), ce serait, pour Héraclite, ce qui en pose ensemble les éléments (car'con-stituer, c'est poser ensemble', soit : ce que le fragment 114 nomme'τω ξυυώ''ce qui est com-mun', l'Adjoignant, l'Unifiant recueillant le divers(37). Or, cet Adjoignant qu'est la loi pour la cité, ce n'est pas, précise Heidegger,'le général', mais'ce qui rassemble toutes choses en soi et les tient ensemble','la structure interne de la Polis, non pas quelque chose de général qui plane au-dessus de tout et ne touche personne'(à la façon, on le devine, du droit normatif des Modernes), "mais bien l'unité originairement unifiante du divergeant". Bref : la loi serait pour la cité ce qu'est, vis-à-vis de tous les étants, l'Un, dont Héraclite suggère qu'il ajointe du plus intime d'eux-mêmes les multiples, - cet Un dont selon le fragment 50(38), le sage sait qu'en lui tout se recueille, même ce qu'opposent les pires tensions(39). De cet Un, où le multiple s'accorde en une "harmonie inapparente", "plus puissance que l'harmonie visible" (fragment 54)(40) l'autre nom serait, explique Heidegger, le logos, qu'il faudrait entendre à partir du sens originaire du verbe legein, - non pas "raisonner", mais "relier", "réunir"(41) : l'Un comme logos, en ce sens, ne serait donc autre que le site d'une recollection de tous les étants dans le Même, et par conséquent l'être lui-même, en tant que cette dimension de surgissement par quoi il y a de la présence est bien "commune" (comme-une) à tous les étants, y compris les plus opposés (raison pour laquelle, selon Heidegger, Héraclite désigne aussi l'Etre par le terme de physis, non pas "nature" mais, entendu à partir du verbe physein, "déploiement", "surgissement". Heidegger explique volontiers (par exemple que de ce point de vue, Parménide ne disait pas autre chose qu'Héraclite lorsqu'il désignait l'Etre comme aléthéia, à entendre moins comme "vérité" au sens moderne (adéquation ou certitude) que comme "dévoilement" ou "surgissement".
Pensée ainsi dans l'horizon de l'Etre (et non dans celui du sujet), la loi de la cité, comme unité originairement unifiante du divers, une serait donc pas une norme posée par la subjectivité pour réunir, comme "après coup", les volontés multiples et divergentes en une communauté : la loi constituerait bien plutôt ce qui relie du plus intimes d'eux-mêmes les éléments de la cité dans la communauté de l'Etre. Mais la loi n'est telle (et la cité n'est conforme à une telle loi), précise Heidegger en des lignes essentielles pour cerner sa représentation du droit(42), que si chacune des composantes de la cité occupe la place et la fonction qui lui reviennent en vertu de ce qu'elle est, "en tant que par exemple les poètes sont seulement des poètes, mais vraiment des poètes, les penseurs sont seulement des penseurs, mais vraiment des penseurs, en tant que les prêtres sont seulement prêtres, mais vraiment des prêtres, les rois seulement des rois, mais vraiment des rois"(43). Comprendre : la cité est conforme à la loi (elle est "juste") quand chaque élément s'y tient à l'intérieur de la dimension de présence qui lui est propre, c'est-à-dire est présent (seulement, mais pleinement) comme l'étant qu'il est (= avec le type de présence et dans le champ de présence qui lui reviennent) ; dans ce cas, la cité devient ce qu'Héraclite nomme un cosmos, un bel agencement, et non pas, "un tas d'ordures jetées au hasard". Ce qui fonde la loi et l'ordre juste transcende donc ici, radicalement, les volontés humaines : le soubassement de l'ordre juste n'est autre que l'Etre lui-même comme cette donation de présence qui assigne à chaque étant (humain ou non) les limites à l'intérieur desquelles il a à être ce qu'il est. Ainsi, la loi, nomos, retrouve-t-elle son sens originaire de partage (nemein= partager) - un "partage" dont, ici aussi, le fondement se trouve moins dans la subjectivité que dans ce logos qui désigne ce en quoi la présence des choses présentes se produit" : soit : dans l'Etre comme "dispensation de tout ce qui est dispensé(44)". Il revient sans doute à la lettre sur l'humanisme d'avoir dégagé le plus pleinement la portée de cette redéfinition de la loi.
"C'est seulement en tant que l'homme existant en direction de la vérité de l'Etre appartient à l'Etre, que de l'Etre lui-même peut venir l'assignation de ces consignes qui deviendront pour l'homme normes et lois. Assigner se dit en grec nemein. Le nomos n'est pas seulement la loi, mais plus originairement l'assignation cachée dans le décret de l'Etre. Cette assignation seule permet d'enjoindre l'homme à l'Etre. Et seule une telle injonction permet de porter et de lier. Autrement, toute loi n'est que le produit de la raison humaine. Plus essentielle que l'établissement des règles est la découverte de l'homme du séjour en vue de la vérité de l'Etre.
A travers une telle pensée du nomos, se dessinerait donc une tout autre idée du droit et de la loi, capable de fournir une alternative à la conception moderne : certes le logos humain qui va instituer la loi, mais il n'en serait pas pour autant le fondement ultime, au sens du droit subjectif des Modernes, puisque "le legein mortel se conforme au logos", c'est-à-dire à l' "En panta, et que c'est dans cet homologein, dans cette correspondance avec le logos, que, le logos mortel se soumettant au Partage, "quelque chose de bien disposé a lieu", c'est-à-dire proprement une cité(45).
CONCLUSION
En concluant cet article, comment ne pas avouer qu'à la suite de Martin Heidegger, nous avons voulu critiquer la loi, telle que le droit constitutionnel moderne nous le présente. En cela nous pensons qu'Heidegger n'est pas allé loin dans sa critique. Car il faudrait une critique qui dégagerait le droit de ses présupposés métaphysiques et théologiques du droit occidental démocratique. Cela explique en partie notre incapacité à comprendre pourquoi ce droit semble échouer dans la mission principale qu'il s'est donnée : sortir l'humanité de l'état de nature. La loi, à la suite du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme annonçait une ère où les êtres humains seraient libérés de la terreur et de la misère. Pourtant, aujourd'hui, malgré nos nombreuses lois, nous sommes bien entrés dans une ère barbare, marquée par la répétition des génocides ou épurations ethniques, la généralisation du terrorisme, la radicalisation de l'intégrisme religieux ou encore la radicalisation de l'extrême pauvreté. Celui qui, dans l'antiquité grecque, a eu une vie publique fondée sur le respect de la loi et du droit, ne pourrait-il pas nous être d'un précieux secours ? Pourquoi a-t-l refuser de légiférer pour les Ephésiens et gouverner avec eux ? Pourquoi a-t-il préférer à la clameur de la foule, ou même à l'expression populaire par le nombre des voix, le sage jugement d'un seul ?
Signature :
Dr AKE PATRICE JEAN pakejean@yahoo.fr
Notes :
1)De nat. Rer. II, v. 254
2) Ibid., v. 302
3) Benedictus de SPINOZA.- uvres Complètes II. Traité Théologico-politique, chap. III, De la vocation des Hébreux. Et si le don de prophétie leur appartint en propre. p. 149 (Paris, PUF/Epiméthée 1999), p. 149
4) MONTESQUIEU.- De l'Esprit des Lois tome I, 1(Paris, Garnier/Flammarion 1993)
5) Sous la dir. De Serge GUINCHARD.- "loi" in Lexique des termes juridiques Dalloz 2010, p. 440
6) HAYEK(F.A.).- Droit, législation et liberté : une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d'économie politique (Paris, PUF 2007) p.1
7) HUGO G. Nutini.- The mexican aristocraty, an expressive ethnography 1910-2000 ; Karl von Savigny.- System of the Modern Law, nov. 1980
8) Gustave GLOTZ.- La cité grecque(Parisᶟ1986)
9) E. FAGUET.- Le libéralisme (Paris, Société française d'imprimerie et de librairie, 1902), p. 249-250
10) GOODWIN.- Mondialisation, migration et droits de l'homme : le droit international en question (Emile Buylant ed. 2007)
11) IRVIN B. TUCKERT.- Microeconomics for Today's Word (South-Western Division of Thomson Learning 2010)
12) Alexander HERBERT SIMON.- Administrative Behavior. A study of decision making processes in adminsitrative organisation(The free press 1997)
13) Lysander SPOONER.- Outrages à chefs d'Etat (Paris, Belles Lettres, 1991)
14) R. NOZICK.- Anarchie, Etat et Utopie, (Paris, P.U.F. 1988), p. 9
15) R. NOZICK.- Anarchie, Etat et Utopie, (Paris, P.U.F. 1988), p. 11
16) MONTESQUIEU.- L'Esprit des lois I, chap. I (Paris, Gallimard 1995)
17) L'Encyclopédie : ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772,(Fernand Nathan 2007)
18) Titre I, article 1er, du premier projet de Code civil.
19) Joseph Etienne-Marie PORTALIS.- De l'usage et de l'abus de l'Esprit Philosophique (Nabu Press 2010)
20) Jean Pierre GRENIER.- La réparation des atteintes à l'honneur et à la considération dans les droits civils français et suisse (L'Université de Lausanne 1943)
21) Claude Adrien HELVETIUS.- De l'Esprit (Elibron Classics 2005), p. 123
22) Jean jacques ROUSSEAU.- Le contrat social ou principes du droit politique Livre III, chap. XVII, discours 21(Editions Garnier-Flammarion 2001), p. 186
23) Thomas HOBBES.- De Cive ou les fondements de la politique (Sirey 1981), p. 12
24) Léon DUGUIT.- L'Etat, le droit objectif et la loi positive (Dalloz 2003)
25) Georges GURVITCH.- La déclaration des droits sociaux (Dalloz-Sirey 2009)
26) Denis BARANGER.- Le droit constitutionnel (Paris, PUF⁵2010), p.100
27) Max WEBER.- Sociologie du droit (Paris/Quadridge 2007)
28) Jürgen HABERMAS.- Théorie de l'agir communicationnelle. Rationalité de l'action, et rationalisation de la société tome 1, chap. 4 (Fayard 1987)
29) Sous la dir. D'Olivier NAY.- "loi" in Lexique de Science politique Dalloz, 2008, p. 296
30) Constitution de 2000, Titre V, article 71
31) Fragment 29, Clément d'ALEXANDRIE.- Stromates V, 59, 5 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 225
32) Fragment 114, Jean STOBEE.- Anthologium, éd. Wachsmuth et Hense, Berlin, 1884-1909 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 225
33) Fragment 1, Sextus EMPIRICUS.- Adversus Mathematicos VII, 132 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 199
34) Fragment 2, Sextus EMPIRICUS.- Adversus Mathematicos VII, 133 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 199
35) Fragment 50, Hippolyte.- Réfutations de toutes les hérésies IX, 9,1 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 199
36) G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 213
37) Martin HEIDEGGER.- Introduction à la métaphysique (Tel/Gallimard 1980), p. 139
38) "A l'écoute, non de moi mais du Logos, il est sage de convenir que toutes les choses sont un." Fragment 50, Hippolyte, Refutations IX,9,1 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 199
39) Martin HEIDEGGER.- Essais et conférences (Tel/Gallimard 1980), p. 268
40) "Un ajustement non-apparent est bien plus fort que celui, apparent" Fragment 54, Hippolyte.- Refutations IX, 9,5 cité dans G.S. KIRK - J.E. RAVEN- M. SCHOFIELD.- Les philosophes présocratiques. Une histoire critique avec un choix de textes (Suisse, Editions des Presses Universitaires de Fribourg 1995), p. 204
41) Martin HEIDEGGER.- Essais et conférences (Tel/Gallimard 1980), p. 275
42) Martin HEIDEGGER.- Introduction à la métaphysique (Tel/Gallimard 1980), p. 159
43) Martin HEIDEGGER.- Essais et conférences (Tel/Gallimard 1980), p. 275
44) Martin HEIDEGGER.- Essais et conférences (Tel/Gallimard 1980), p. 271
45) Martin HEIDEGGER.- Essais et conférences (Tel/Gallimard 1980), p. 268.