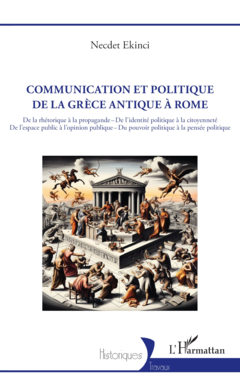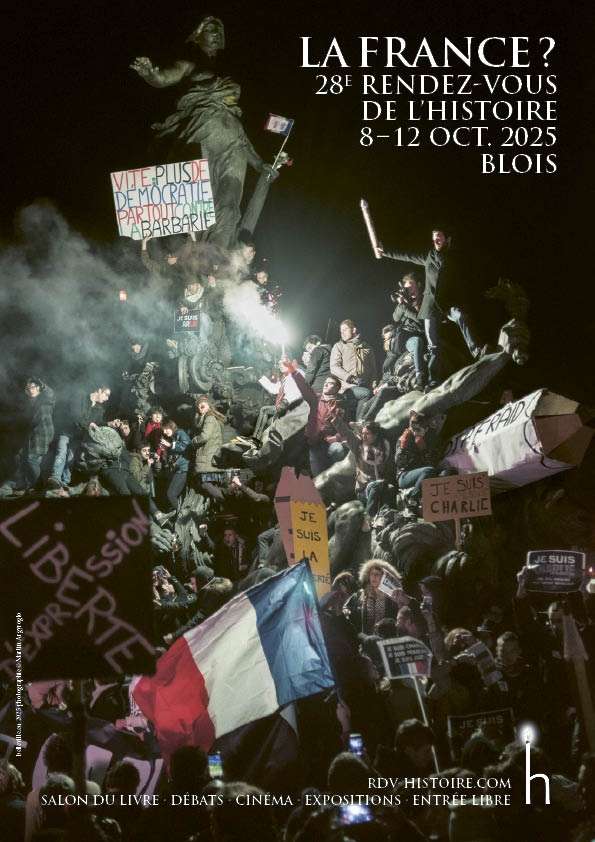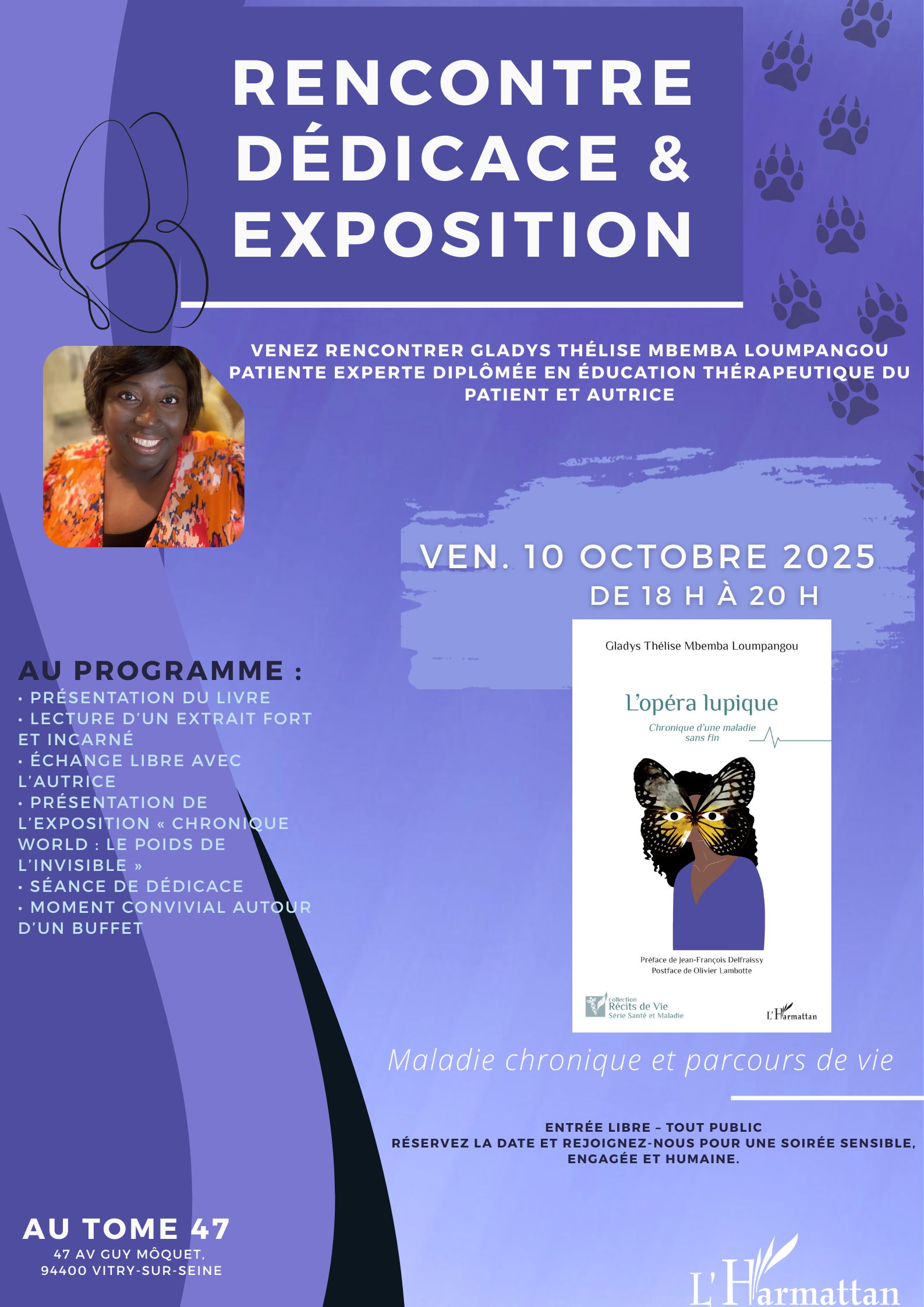Jonathan Louli
ContacterJonathan Louli
Descriptif auteur
De formation sociologue et anthropologue, j'ai travaillé plusieurs années comme travailleur social et formateur en travail social
Fonction(s) actuelle(s) : Sociologue, anthropologue, travailleur social
Vous avez vu 11 livre(s) sur 1
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
"Reconnaître et valoriser le travail social"
Pour un point détaillé sur le processus des Etats Généraux du Travail Social (EGTS) et les contestations qu'ils ont engendré, voir l'article : https://pagesrougesetnoires.wordpress.com/2015/08/31/travailleurs-sociaux-reforme-metiers-jonathan-louli/
Dans le cadre des EGTS impulsés par le gouvernement, des réunions thématiques régionales sont organisées, dont la teneur est restituée par 5 rapports rendus au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé[1] en février 2015. Devant la polémique engendrée par le rapport de la Commission Professionnelle Consultative du travail social et de l'intervention sociale (CPC)[2] au sujet de la réforme des formations (Rapport "Métiers et complémentarité"), Manuel Valls demande à la députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon[3], de lui faire un rapport pour remettre les choses au clair et chercher un consensus.
De toute cette usine à gaz est issu le Rapport "Reconnaître et valoriser le travail social"[4], plus connu sous le nom de Rapport Bourguignon. Ce qui est premièrement intéressant, c'est l'allocution que Manuel Valls a prononcé le 2 septembre 2015, jour où Bourguignon a remis son rapport[5] : Manuel y livre sa vision du travail social et c'est particulièrement affligeant.
En substance, cette allocution commence par reconnaître le "rôle immense" des travailleurs sociaux dont l'engagement est basé sur des "valeurs républicaines" et de solidarité. Cependant, le contexte actuel se complexifie : il faut "combattre avec force" les "abus" en matière d'aides sociales (p.1) et faire de la prévention de la radicalisation (p.2). Manuel appuie ensuite en disant qu'à ce titre le travail social compte beaucoup pour le gouvernement, la preuve étant que ce dernier a mis en place les EGTS, qui se concrétisent avec ce rapport Bourguignon. Manuel estime ensuite qu'au nom de ces efforts de "fraternité" et d' "égalité" incarnés par le travail social, il faut avant tout favoriser le travail en réseau et simplifier les dispositifs. Pour illustrer son propos volontariste, Manuel donne quelques exemples frappants des mesures phares du gouvernement en matière de social :
- La prime d'activité a été créée pour remplacer la PPE et le RSA Activité.
- Un simulateur d'aides a été mis en place sur internet.
- Un dispositif d'aide à la complémentaire santé a été mis en place.
- Des efforts ont été faits pour favoriser l'accès aux outils numériques.
"C'est ainsi, en simplifiant les démarches, que nous renforcerons l'accès à l'emploi, aux soins de santé, aux prestations existantes" (p.4). Wouah, merci Manu. On voit bien à travers les exemples choisis à quel point la politique sociale de cet État est pauvre, et à quel point elle prend bêtement le travail social comme un instrument pour réduire certaines inégalités : le gouvernement imagine les travailleurs sociaux comme des rouages d'une machine à insérer les gens dans des dispositifs pour favoriser l'accès à ceci ou à cela. Quid des dimensions sociale, humaine, psychique, éducative ? Quid de l'émancipation des gens, tout simplement ? Cet point de vue étriqué transparaît aussi clairement dans le rapport Bourguignon : le personnel politique imagine que le travail social c'est essentiellement des assistantes sociales derrière des guichets qui font remplir des formulaires.
Le rapport Bourguignon n'est pas catastrophique, il est en partie décevant et en partie inquiétant. Comme le demande Manuel Valls dans sa lettre de mission[6], la première partie du rapport dresse un état des lieux du travail social et de ses problématiques, et la seconde partie étudie des pistes de réformes - notamment des formations - pour adapter l'action sociale à l'époque actuelle.
Dans la première partie donc, le rapport pointe d'abord une "crise" du travail social, du fait notamment des mutations sociales profondes, et des reconfigurations gestionnaires de l'action sociale. Le rapport reconnait certains dysfonctionnements des politiques publiques (empilement des dispositifs et complexité d'accès, "bureaucratisation", évaluations peu adaptées ). Ces problématiques engendrent un "morcellement", une "perte de sens" et une usure professionnelle forte chez les travailleurs sociaux. Pour remédier à ces troubles dans les métiers, le rapport propose notamment d'inscrire la définition du travail social proposée par l'IASSW dans le Code de l'Action Sociale et des Familles :
"définition du travail social approuvée par l'assemblée générale de l'International Association of Schools of Social Work le 10 Juillet 2014 à Melbourne : l'IASSW définit le travail social comme "une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités, sont au coeur du travail social. Etayé par les théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des connaissances autochtones, le travail social encourage les personnes et les structures à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous."" (p.14).
La définition est sympa, mais rassurez-vous : il est juste question de l'inscrire dans la loi, ça mange pas de pain, quand on sait à quel point l'État, les collectivités et les hiérarchies s'arrangent avec le droit comme un toréador avec un taureau essouflé.
La première partie du rapport se poursuit en montrant le point de vue étriqué du travail social qu'a le gouvernement. Tout d'abord, la députée ne cache même pas vouloir prendre en compte de préférence "la vision des employeurs", titre d'une sous-partie (p.15). Et la vision des travailleurs de terrain ? la vision des syndicats ? la vision des familles ? la vision des chercheurs et journalistes indépendants ? la vision des gens ? Non, on devra se contenter du plus important pour le gouvernement : la vision des employeurs. Les employeurs donc ont été pleurnicher à la mère Brigitte qu'il y avait "des incompréhensions, tenant à une méconnaissance par les travailleurs sociaux de leur environnement" (p.15). Hé oui les travailleurs sociaux sont des cons qui ne font pas attention au monde qui les entourent. Les employeurs ont également pleurniché à la mère Brigitte "les difficultés de lisibilité du secteur" (p.15). Ils demandent à se faire payer des lunettes, en plus ! Rappelez vous la prochaine fois qu'on vous dit que votre boulot n'est pas assez "lisible" : cette revendication vient des patrons. Et en plus ils insistent, parce que ça c'est juste l'entrée : le plat de résistance c'est "la mobilité et l'adaptabilité des travailleurs sociaux" (p.15 toujours !). Le patronat est donc favorable à la réingénierie (p.16) - qui doit donc permettre "mobilité et adaptabilité" des professionnels. Rappelez vous la prochaine fois qu'on vous dit "mais non, la réforme des formations ne va pas libéraliser le marché du travail social et rendre les professionnels interchangeables" : en fait, si ! c'est mêmes les patrons qui le disent et le demandent. Normal, du coup, que les patrons du social demandent aussi à ce que les travailleurs sociaux s'ouvrent au "monde économique" (p.16). Enfin, une petite perle pour terminer, en dessert :
"les liens entre les instituts de formation et les employeurs sont perçus comme devant se renforcer. En effet, la distance se creuse entre les besoins des employeurs et les référentiels des organismes de formation. Les employeurs se disent souvent insatisfaits de la formation des travailleurs sociaux qui leur paraît éloignée du terrain" (p.16)
Les patrons ne sont pas satisfaits des diplômes d'État établis par un gouvernement démocratique ? vite, prosternons-nous devant leur colère et sacrifions les métiers historiques du travail social. Après tout cela, les patrons désirent-ils un petit massage des pieds ou un rafraîchissement ? Non sérieusement si les patrons demandent à ce que les travailleurs sociaux soient eunuques, ça apparaîtra dans les rapports publics et ça sera débattu en commission parlementaire, ou c'est comment ? bref, on laisse Brigitte conclure : il faut "travailler la simplification en s'appuyant sur les initiatives émergeantes afin de leur donner plus de force et de visibilité. Comme les entreprises, les politiques sociales ont besoin d'un "choc de simplification", afin de centrer les compétences en direction des personnes accompagnées, des citoyens." (p.18). Et c'est pas moi qui met en gras, c'est Brigitte, alors attention ! Remplacez "personnes accompagnées" par "clients". Bref, quelle poésie !
Le rapport insiste ensuite sur l'importance des actions collectives avec le public, l'importance de développer l'autonomie des travailleurs sociaux, de passer à une posture de "faire avec", faire du développement social On se demande si la mère Brigitte elle a pas l'impression d'inventer l'eau tiède ? Plusieurs des aspects qui sont pointés sont des tendances déjà en cours dans le social. Faut-il vraiment réformer les formations pour ça ? Ah non c'est vrai, il y a aussi et surtout les exigences patronales. C'est la question qui est posée à l'entrée de la seconde partie du rapport.
"Faut-il modifier la structure des formations sociales actuelles dans la perspective d'un accompagnement de qualité des publics ?" Sans déconner c'est le titre de la seconde partie du rapport. Pour que les accompagnements soient "de qualité" (sous entendu actuellement ils ne le sont pas, les travailleurs sociaux sont des cons), il faut réformer les formations ? et le système économique, les politiques publiques, le système politique et démocratique, l'éducation nationale, les inégalités, etc., non ? ça joue pas un peu dans les situations des publics ? Le rapport Bourguignon considère que non : cette partie de son rapport s'évertue à prouver par A + B que réformer les formations c'est la panacée, ou presque, pour réhabiliter le travail social.
Réformer les formations certes mais pas dans le sens du premier projet de la CPC, qui était pas mal d'après Bourguignon, mais qui a déclenché des grèves et des manifestations des travailleurs sociaux parce que la CPC a manqué de "pédagogie et de communication", que les "positions contestataires" de certains ont connu une "radicalisation" (p.27). C'est beau comme du Gattaz qui traite les syndicalistes de "terroristes". Du coup, craignant probablement un attentat d'Avenir'Educs ou de la CGT, Bourguignon met de côté le projet initial de la CPC, qui était de saborder les diplômes en travail social pour en garder un par niveau de qualification : à ça, raconte Brigitte : (c'est elle qui met en gras) "les professionnels ne sont pas prêts culturellement" (p.28). Hé, les travailleurs sociaux, bande de cons arriérés, il faudrait voir à vous moderniser et à vous rationnaliser un peu, bande de mollusques ! le New Public Management ça vous dit quelque chose ou pas ? Nan mais allo !
Après être revenu sur le fait que les formations doivent être adaptées aux besoin des employeurs (p.30), la suite du rapport est un détail de propositions plus techniques autour du potentiel contenu des nouvelles formations (socle commun, modules de spécialisation, "alternance intégrative", reconnaissance au niveau II des actuels diplômes de niveau III, remettant en cause à l'avenir les CAFERUIS ) dont on peut retrouver l'essentiel dans les nombreuses propositions listées à la fin du rapport avec une synthèse (p.54-59).
Conclusion
Le rapport Bourguignon a remis pas mal de choses à plat et bien que plusieurs constats soient partagés (perte de sens du travail social, bureaucratisation ), il y a plusieurs inquiétudes qui perdurent quant notamment au poids attribué au patronat du social, surtout quand on sait qu'il vient en partie de se rassembler dans le syndicat Nexem, et a tendance à remettre en cause la Convention Collective de 1966, qui garantit des droits appréciables aux salariés ; et quand on sait qu'un nombre croissant de patrons du social ne sont que des patrons de grandes entreprises : la Fondation Serge Dassault, régulièrement en conflit avec les syndicats (comme à Corbeil-Essonnes en 2016), Pierre Coppey, directeur général adjoint de VINCI et Président de VINCI Autoroutes, également président de l'association Aurore, etc., sans compter tous les directeurs et administrateurs qui viennent directement du privé et attendent en se frottant les mains que le marché du travail social soit totalement libéralisé et investi par les Contrats à Impacts Sociaux et appels à projets financiarisés entre autres.
Second point d'inquiétude : le rapport Bourguignon suggère des pistes et ouvre des portes à la réforme des formations historiques du travail social. Il y aurait certains intérêts : mieux reconnaître statutairement les travailleurs, donc leur garantir de meilleurs droits, mettre en débat de nouvelles thématiques durant les formations, etc. Mais le rapport Bourguignon semble en attendre trop de ce levier que représente la réforme des formations, et par ailleurs le projet de réforme se construit de manière anti-démocratique dans des groupes de travail gouvernementaux du type CPC. En somme, en produisant une nouvelle espèce de travailleurs sociaux, le rapport espère régler davantage de problèmes sociaux. C'est exactement comme quand ils viennent vous repeindre les bâtiments dans les banlieues défavorisées. Pour un temps ça fait plus propre, mais ça n'atteint pas la source des problèmes.
Signature :
Gagny, Novembre 2016
Notes :
[1] http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/travail-social/article/rapports-des-egts
[2] http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/travail-social/article/cpc-commission-professionnelle-consultative-du-travail-social-et-de-l
[3] http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA608083
[4] http://www.gouvernement.fr/partage/5068-rapport-reconnaitre-et-valoriser-le-travail-social
[5] http://guadeloupe.drjscs.gouv.fr/sites/guadeloupe.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/discours_manuel_valls.pdf
[6] p.60-63. La lettre de mission est la "commande" passée par Valls à Bourguignon en mars 2015, à l'origine de ce rapport.
"Radicaux, réveillez-vous!"
Site de l'éditeur : https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/reeditions/radicaux-reveillez-vous.html
Connu pour les "méthodes" de mobilisation qu'il a mises au point dans la première moitié du XXème siècle, l'activiste américain Saul Alinsky (1909-1972) connaît une nouvelle actualité, en France, notamment avec le regain d'attention accordé à la pratique dite du community organizing (organisation communautaire). C'est ce que suggèrent de nombreuses publications récentes sur Alinsky, dans Contretemps, dans Ballast, mais aussi sur le community organizing, notamment un n° de la revue Mouvements sur ce sujet, ou encore les travaux de Julien Talpin, chercheur français parti aux Etats-Unis étudier cette pratique. Lors de son université d'été en 2017, la France Insoumise elle-même débattait de cette "méthode Alinsky", qu'elle espère vraisemblablement utiliser dans ses combats électoraux, comme le relatait Le Parisien.
Dans ce renouveau des discussions sur le community organizing, on appréciera le travail du Passager Clandestin, qui rééditait début 2017 le premier ouvrage d'Alinsky, paru en 1946, offrant aux lecteurs français la première traduction française de celui-ci. Elle est agrémentée d'une préface de la chercheuse spécialiste des questions urbaines Marie-Hélène Bacqué, et d'une postface d'une association française pratiquant le community organizing, l'Alliance Citoyenne. L'ouvrage se découpe en deux parties que je présenterai de façon linéaire.
La première partie, intitulée Appelez-moi rebelle, est la partie que je qualifierai d'idéologique parce qu'Alinsky y présente sa vision de la société américaine et des principales problématiques qui la minent. Cette partie est plutôt décevante car l'idéologie d'Alinsky relève d'une espèce de mysticisme citoyenniste, progressiste, voire réformiste : c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvertement anticapitaliste et prône une révolution qui n'a pas grand chose à voir avec celles auxquelles songent les anarchistes ou les communistes anti-autoritaires. Alinsky mise davantage sur la "foi démocratique" et la foi en le peuple américain, autant qu'en la spiritualité et le patriotisme des citoyens. Pas étonnant, avec ce fond idéologique, que sa pensée soit récupérée aussi bien par J.-L. Mélenchon que B. Obama ou H. Clinton.
La seconde partie, sobrement nommée La construction des organisations du peuple, est beaucoup plus longue et intéressante. Alinsky y détaille la solution aux principaux problèmes de société qu'il a énumérés dans la 1ère partie : les organisations du peuple. C'est une partie qui comporte un très grand nombre d'indications tactiques et pragmatiques destinées à mobiliser les classes populaires à travers des organisations plus ou moins autogérées. Le langage est très accessible et recèle de nombreux concepts pratiques qui feront écho aux militants de terrain. Le propos d'Alinsky est appuyé sur une multitude d'exemples de terrain tirés pour la plupart de son expérience de sociologue à Chicago dans les années 1920 (il a rencontré l'entourage d'Al Capone) puis organisateur dans des quartiers populaires, dans les années qui ont suivi.
La suite de cet écrit rend compte des parties et sous-parties qui composent le livre d'Alinsky. Si tu es pressé tu peux aller directement à la conclusion générale, ci-dessous
Compte-rendu détaillé :
Préface
La préface de M.-H. Bacqué apporte de très intéressantes informations de contextualisation. Tout d'abord, concernant le parcours d'Alinsky, à Chicago, ses débuts comme organisateur. Mais aussi concernant sa vision du "radical", c'est-à-dire celui qui doit apporter le changement dans la démocratie américaine :
Il n'est ni socialiste ni révolutionnaire [ ] Si Alinsky critique les effets du capitalisme et les inégalités et formes d'oppression qui lui sont liées, il ne remet pas en cause le système.
Bacqué évoque également le développement et l'institutionnalisation du community organizing, sa définition qui se complexifie en arrivant en France et en se confrontant à la notion de communauté. Pour Alinsky, le community organizing est une sorte de "syndicalisme de quartier". Ce qui explique que l'activiste américain éprouve :
"une forte méfiance vis-à-vis de l'action publique et du travail social, vus comme une forme de charité, d'assistance ou d'encadrement, opposée à l'accès au pouvoir du peuple et aux libertés individuelles."
La préfacière revient également sur les critiques adressées au community organizing à la sauce Alinsky : le leadership des "organisations du peuple" est trop souvent individuel, blanc et masculin, et son approche trop "pragmatique", trop centrée sur les problèmes concrets et quotidiens, risque de s'éloigner des enjeux proprement politiques et du changement de société.
2. Appelez-moi rebelle
Qu'est-ce qu'un radical ? p. 27
Il y a beaucoup de diversité dans la société américaine, ce qui peut amener beaucoup de ségrégations et de divisions, commence par rappeler Alinsky, en s'adressant directement au lecteur. Les radicaux sont ceux qui "aiment les gens" et se battent pour les droits de tous. Après avoir cité en exemple différents personnages historiques (dont des religieux et des acteurs de la Révolution américaine), l'auteur propose une définition idéale du radical (p. 44-56) : c'est celui qui lutte pour l'égalité, contre les oppressions, pour la liberté socioéconomique, politique et spirituelle, et qui se distingue du libéral, qui, lui, est un démocrate plus modéré et plus éloigné de l'action de terrain.
Où sont les radicaux aujourd'hui ? p. 57
En réponse au développement du capitalisme de monopole, les ouvriers se sont organisés en syndicats, et les radicaux se sont saisis de cette opportunité. Cependant les syndicats américains sont devenus des espèces de corporations, très excluantes, et certains sont racistes. Pour que les syndicats redeviennent les "champions du peuple", comme dit Alinsky, il faut que les radicaux contribuent à les changer de fond en combles, à les "démocratiser" et les amener à lutter non seulement pour améliorer les conditions de travail et de salaire des travailleurs et travailleuses, mais pour une "amélioration générale de tous les aspects de la vie" (p. 95).
La crise p. 97
Alinsky pointe ici, de manière presque mystique, le paroxysme du blocage des institutions. Il faut se détacher du passé et savoir regarder l'avenir droit dans les yeux pour prendre conscience des occasions qui se présentent de changer les choses. Il faut revivifier la "foi démocratique" en s'appuyant sur les gens pour trouver des solutions.
3. La construction des organisations du peuple
Le programme p. 115
Construire un programme populaire de changement social nécessite une organisation du peuple, et vice versa. Il faut que des organisateurs locaux catalysent le mouvement, mais c'est au peuple qu'il revient de formuler les idées et revendications. Il faut bien garder à l'esprit que pour ces organisations tous les problèmes locaux sont connectés entre eux et à ceux de la vie de la société. Le peuple et ses organisateurs doivent pouvoir s'organiser eux-mêmes pour traiter leurs problèmes à la racine, et ne pas se laisser "adapter" (on dirait actuellement "insérer") par des porteurs de "bienveillance" et de "bonté" qui veulent simplement occuper les gens et canaliser les colères : ceux-là incarnent la pire forme de "trahison sociale"
Leaders locaux p. 129
Alinsky détaille dans ce chapitre quelques enjeux relatifs aux leaderships : les structures officielles qui s'implantent ou se font parachuter localement sont antidémocratiques et ne représentent personne. Pour ancrer une action sur un territoire il faut identifier les leaders locaux par des observations poussées, et passer par eux pour faire fonctionner l'organisation du peuple en lui garantissant des relais.
Traditions et organisations des communautés p. 145
Une organisation du peuple doit se nourrir des traditions locales (y compris religieuses, ethniques, etc.) et les respecter, ainsi que tous les collectifs locaux auxquels les gens appartiennent. L'organisation doit fédérer ces différents groupements et appartenances quitte à être au départ une "organisation d'organisations", pour affronter un problème commun que chacun isolément ne peut affronter.
Tactiques organisationnelles p. 161
Le radical ne doit pas se laisser abattre par l'égoïsme et l'individualisme, il sait qu'ils sont dûs aux conditions sociales dans lesquelles vivent les gens. Il faut garder à l'esprit que cet individualisme peut devenir un atout, selon Alinsky. Il est en effet fondamental, selon lui, de saisir les individus dans toute la complexité de leurs interactions et liens sociaux, ainsi que l'image qu'ils se font de leur place dans les différents collectifs d'appartenance. La notion d'identification personnelle joue beaucoup dans cette approche, de même que l'effort de l'organisateur pour se situer dans les différentes factions existantes, pour ne pas apparaître comme rattaché à l'une d'entre elle en particulier ("pour être aux côtés de tous, ne soit aux côtés de personne", énonce Alinsky un peu plus loin, p. 274).
Tactiques de conflit p. 211
Comme on peut s'en douter, Alinsky précise qu'une organisation du peuple est une organisation de conflit, et il faut s'y préparer. Il donne différents exemples stratégiques, et insiste à nouveau sur l'idée que les tactiques doivent s'inspirer des traditions locales.
Education populaire p. 237
L'auteur annonce que le but final de l'organisation du peuple et de la démocratie est l'éducation populaire. Elle passe par la compréhension mutuelle et la rencontre, mais aussi par le développement de savoirs vivants, impliqués dans la vie des gens, développés par eux-mêmes.
Considérations psychologiques sur l'organisation des masses p. 259
Alinsky fait observer que les gens en général préfèrent jouir de quelque chose qui est le fruit de leurs efforts, auquel ils ont été engagés, quelque chose à eux, plutôt que quelque chose qu'on leur donne gratuitement, sans tenir compte de leur avis, et qui semble de fait n'avoir que peu de valeur. L'auteur livre ensuite quelques observations sur les organisations du peuple. Tout d'abord, une participation électorale de 5 à 7% de la population aux organisations semble faible, mais par rapport à l'état de la démocratie américaine moderne, cela paraît tout de même non négligeable. Il annonce ensuite que l'organisation ne doit pas se fixer de "plafond", de limites dans son programme ou action, sinon elle risque fort de produire des frustrations, et à terme, de retourner contre elle-même les colères et agressivités qu'elle devait canaliser et transformer en énergie. De même, l'organisation promeut de nouvelles façons de voir, de penser : il y a toujours des périodes de transition, de "désorganisation".
Radicaux, réveillez-vous ! p. 279
Alinsky commence par revenir sur une sorte de storytelling national de façon pour le moins lyrique, présentant les Etats-Unis comme une terre de liberté, avant de pointer que "le mode de vie démocratique" est en déclin :
"Si la démocratie meurt en Amérique, elle meurt partout dans le monde."
Pour palier à cette dangereuse chute de la participation il préconise la création d'organisations du peuple, seules à même de dépasser les divisions et de redonner pouvoir à tous les citoyens : "une démocratie privée de participation populaire meurt de paralysie". Il faut palier à l'inertie des institutions qui à l'origine devaient servir le peuple (Eglise, syndicats ) en refaisant l'union de toutes ces organisations et institutions, en développant l'éducation du peuple et la "participation" :
L'éducation doit être présentée à notre peuple afin qu'elle ait du sens pour lui. Mais les éducateurs doivent d'abord s'éduquer dans l'art de l'enseignement démocratique en démocratie. Ils doivent apprendre à enseigner aux gens et à travailler aux eux. L'importance de la fonction des éducateurs dans la concrétisation d'une destinée démocratique prime sur tout le reste [ ] Ceux qui craignent que la construction d'organisations du peuple ne soit une révolution perdent de vue qu'il s'agit du développement ordonné de la participation, de l'intérêt et de l'action de la masse des gens. C'est vrai qu'il s'agit peut-être d'une révolution, mais alors d'une révolution ordonnée
L'ouvrage d'Alinsky s'achève avec un exemple de statuts associatifs pour une organisation du peuple (à adapter nécessairement car l'exemple donné est celui d'une organisation d'une très grande agglomération), ainsi qu'une brève postface de l'Alliance citoyenne évoquant des idées et ressentis sur les débuts de leur association et leur fonctionnement.
Conclusion générale
Une "révolution ordonnée", c'est finalement ce que propose Alinsky, à travers le développement d'une forme d'éducation populaire citoyenne et d'une participation aux processus de décision. Pour Alinsky donc c'est en priorité l'esprit démocratique et ses règles de fonctionnement qu'il faut préserver et ré-insuffler parmi "les masses", la conscience du pouvoir du peuple uni, pour contrer les injustices, la perte d'intérêt et la déconnexion entre dirigeants et citoyens.
Si sur le fond on est aux antipodes d'une logique de luttes de classes, Alinsky estimant qu'il faut collaborer avec tous les notables locaux en vue de créer une union populaire, la "méthode Alinsky" a néanmoins le mérite de proposer une tactique quasi-autogestionnaire. C'est-à-dire que le fond de l'action qu'Alinsky propose vise à redonner sa grandeur à la démocratie américaine en redonnant au peuple son pouvoir : il n'envisage pas de dépasser le système capitaliste, le patriarcat, le néo-colonialisme, les obscurantismes spirituels et religieux, etc. Mais ce qui est intéressant c'est que la forme d'action qu'il propose se rapproche d'une revendication d'autogestion des classes populaires face à leurs problèmes immédiats, pouvant déboucher, si l'organisation fonctionne, à affronter des problèmes plus larges.
Théoriquement il n'est donc pas exclu que ces formes encore "simplistes" et "citoyennes" d'autogestion débouchent sur la volonté populaire de mettre un terme aux monopoles des banques, patrons et actionnaires, ou à l'invisibilisation subie par des nombreux et nombreuses opprimés Si pour ma part je préfère le travail sur la "conscience de classe" plutôt que celui sur la "foi démocratique", ces deux formes d'activités politiques liées à la vie, comme dit Wilhelm Reich, peuvent se rejoindre dans l'idée que l'autogestion collective au travail et dans la vie, sera bientôt la solution la plus logique, au fur et à mesure que les systèmes représentatifs, autoritaires, et autres, se sont discrédités aux yeux des "masses".
Signature :
Jonathan Louli
Travail social engagé, travail social enragé
Le travail social est un reflet d'un bon nombre de contradictions de notre système. Il est sans cesse confronté aux marges de la société, et permet ainsi d'observer différemment le fonctionnement de cette dernière. Confrontés à cette conscience différente de la vie sociale, les travailleurs sociaux n'en développent pas pour autant massivement une conscience politique. Le secteur ne connaît donc pas de mobilisations aussi retentissantes que celles des transports en commun ou de l'Éducation Nationale par exemple. Néanmoins, à défaut d'être très visibles, les mobilisations de travailleurs sociaux sont anciennes : elles remontent au moins à mai 68, soit à peu près à l'époque de l'apparition même des multiples métiers modernes du travail social. À cette époque d'état social encore généreux, tout le secteur était porté par le développement des politiques sociales à destination des personnes vulnérables.
Depuis le dernier quart du XXe siècle cependant, comme beaucoup de secteurs dépendants des finances publiques, les paramètres de base du travail social ont été sérieusement remis en question par le développement des politiques néo-libérales. Les motifs de mobilisations pour les travailleurs sociaux n'ont alors pas manqué, confrontés à l'invasion de dogmes individualistes et libéraux. La récente actualité confirme à nouveau ce triste principe : le travail social permet, également du point de vue des politiques publiques, de mener des observations révélatrices.
La récente actualité, c'est ce qui ressemble en tout point de vue à un processus d'industrialisation du travail social - comme c'est le cas dans beaucoup de services publics. Par industrialisation, on peut entendre une transformation de ce secteur en une vaste usine à offre relationnelle et de conseils ; cela à travers trois processus massifs qui, en provenance des politiques publiques, tordent profondément le travail social.
Le premier processus, c'est un formatage des pratiques professionnelles, qui s'observe à travers la multiplication des grilles de codification des actes et des pratiques, telles que les "démarches qualité" ; telles que les évaluations en vogue, basées trop souvent sur les seuls arguments quantitatifs, et sur la correspondance des résultats reportés par les salariés avec des critères administratifs et technocratiques insensés. Cette lecture gestionnaire de l'activité est imposée de façon autoritaire par des agents bureaucratiques qui ne voient les réalités humaines de terrain qu'à travers les consultants de boîtes privées et les cadres reconvertis dans l'administration d'État.
Ce formatage des pratiques professionnelles se déploie également à travers les réformes des formations. Ce processus a des effets d'uniformisation et de standardisation des pratiques professionnelles : il se profile des formations réformées et appauvries, laissant moins de place aux sciences humaines et aux spécificités historiques des professions, des formations qui inculqueront à tous les mêmes savoirs, les mêmes méthodes, les mêmes façons de traiter les problèmes du quotidien, bref, des formations qui préparent au travail à la chaîne. Cela, surtout que les conventions collectives du secteur sont régulièrement mises en danger par les prises de position des syndicats patronaux, et que, par conséquent, avec des qualifications au rabais, beaucoup de futurs professionnels risquent d'être très bas dans les grilles salariales, ce qui dégradera leurs conditions matérielles de travail et d'existence : le travail social risque de devenir un travail mal fait, par des gens moins heureux de le faire.
Le second processus est clairement une marchandisation croissante du secteur, à la fois préparée et prolongée par les dynamiques de formatage des pratiques professionnelles. On peut aisément l'observer à travers le développement de la sous-traitance par le secteur marchand de diverses activités qui devraient relever des services publics ou de l'économie sociale et solidaire ; par l'apparition d'établissements privés et lucratifs, ayant les mêmes missions que les secteurs associatifs ou publics, et qui leur font donc une concurrence acharnée et mortifère ; par la diminution des budgets publics alloués aux secteurs associatifs ou publics ; par l'appel, en conséquent, à des financements privés, tels les Contrats à Impacts Sociaux (voir le dossier web du Collectif des Associations Citoyennes et le numéro du Progrès Social du 8 septembre, date de la dernière mobilisation de travailleurs sociaux). L'ensemble de ces mécanismes, corollaires les uns des autres, de marchandisation des secteurs sanitaires et sociaux, est renforcé notamment par les logiques portées par les traités internationaux de libre-échange, qui préparent la libéralisation des secteurs associatifs et publics (notamment l'Accord sur le Commerce des Services, voir à ce sujet l'article de Raoul Marc Jennar "Cinquante États négocient en secret la libéralisation des services" paru dans le Monde diplomatique de septembre 2014).
Le troisième processus qui traverse le travail social est la forte prolétarisation des professionnels qui se développe à divers niveaux. Les étudiants en travail social, souvent issus de familles populaires ou moyennes, accèdent de plus en plus difficilement à des stages de qualité et doivent trouver d'autres sources de revenus ; une fois devenus jeunes professionnels, ils gagnent généralement moins que le salaire net médian en France, qui en 2013 était de 1772 euros d'après l'INSEE. Si par malheur le travailleur social s'avère être une travailleuse sociale, ce qui est le cas pour une écrasante majorité d'entre eux, s'ensuivent d'autres situations d'inégalités socioprofessionnelles entre hommes et femmes au travail. Enfin, une des principales dimensions de ce processus de prolétarisation est une forme d'aliénation, une souffrance au travail, résidant dans la perte de sens du travail effectué, sous le coup notamment du formatage et de la marchandisation du secteur.
Ainsi, la combinaison spécifique de ces trois dynamiques peut nous amener à considérer que les travailleurs sociaux sont face à une vaste logique d'industrialisation du cadre et de la signification de leurs activités : ils deviennent des ouvriers de la relation. Cette logique d'industrialisation est bien entendu en contradiction totale avec les fondements de ces "métiers de l'humain", comme disent les professionnels, artisans de la relation sociale, du soin et de l'accueil, métiers qui imposent au professionnel de s'adapter à chaque personne accueillie, différemment, de l'écouter, de prendre le temps de la rencontre, de la compréhension et de la confiance mutuelle. Refonder ces métiers sous une logique industrielle ordonnant un travail standardisé, marchandisé et dénué de sens, risque de mener à des catastrophes humaines et sociales.
Face à ces logiques cependant, un grand nombre de travailleurs sociaux se mobilisent à travers des organisations ou réseaux militants. Ces derniers sont nombreux à fleurir ces temps-ci, comme preuve que l'adversité peut pousser à l'organisation : l'intersyndicale des États Généraux Alternatifs du Travail Social, les collectifs tels qu'Avenir Educs, ou la Commission Action Travail Social - Nuit Debout Paris, le Collectif Dessalariesdusocial à Rouen, etc., ainsi qu'une multitude de collectifs locaux. En effet, selon certains points de vue, le développement des conditions ouvrières de vie et de travail peut mener à des prises de conscience collectives de la situation, et susciter un changement social. Pour des politiques sociales de qualité, pour les cultures professionnelles, pour les métiers qualifiés, et pour une certaine forme de service public, c'est une question de vie ou de mort
Signature :
Jonathan Louli
Prévention spécialisée : à propos du nouveau rapport (de forces)
La Mission d'information sur l'avenir de la prévention spécialisée a été constituée en juin 2016 avec la fonction suivante : "La prévention spécialisée a considérablement évolué en soixante-dix ans et la mission d'information s'est fixé pour objectifs d'étudier ses missions et ses moyens compte tenu des objectifs que l'on souhaite atteindre sur le terrain au bénéfice de l'enfance en danger ". Elle était présidée par Denis Jacquat, médecin devenu député UMP de Moselle, et la rapporteure était Kheira Bouziane-Laroussi, professeure d'économie et gestion, députée PS de Côte-d'Or, proche d'A. Montebourg. Il est intéressant de prendre 15mn pour visionner la prise de parole de K. Bouziane-Laroussi le jour de la remise du rapport.
Le résultat de ma lecture est très mitigé et voit plusieurs inquiétudes. La première partie du rapport pose des constats globalement intéressants (malgré plusieurs imprécisions ou maladresses). La seconde partie en revanche présente le terrain miné des propositions. Au fond, comme le répète le rapport à plusieurs reprises, la volonté qui se dégage est de faire de la prévention spécialisée "une politique publique à part entière". C'est-à-dire : permettre meilleure reconnaissance institutionnelle et financière, mais au prix de diverses réformes qui permettraient à la puissance publique d'augmenter son emprise sur le secteur (notamment à travers la nouvelle thématique en vogue : la "prévention de la radicalisation religieuse").
Par conséquent, autant le dire tout de suite : le rapport passe totalement à côté de tout ce qui pourrait faire de la prévention spécialisée une praxis, comme dit Castoriadis, c'est-à-dire une pratique émancipatrice qui vise à augmenter l'autonomie d'autrui et qui pour cela s'appuie principalement sur l'autonomie même des individus, sur ce qu'ils sont. Il n'y a donc aucune dimension politique ou critique dans la définition de la prévention spécialisée présentée dans ce rapport : les concepts de justice sociale et de lutte contre les inégalités sont quasiment absents (À part très poliment à travers la lutte contre les inégalités "entre territoires". Les inégalités entre classes bourgeoises et classes prolétariennes, entre sexes, entre âges, entre étiquettes raciales, entre religions, etc. ? Nada). Finalement, c'est la question du sens du travail de prévention spécialisée que le rapport oublie totalement. La prévention spécialisé est vue de façon très instrumentale par ce rapport, comme si elle n'était qu'un outil et qu'elle ne servait qu'à orienter les jeunes rencontrés vers des partenaires. Je vais essayer de rendre compte du rapport de façon linéaire, de mon point de vue de sociologue-anthropologue et d'éducateur de rue.
L'introduction pose de bons constats relatifs à la situation de la prévention spécialisée, malgré quelques formulations douteuses, comme par exemple dire dès les premières lignes que la prév' est "destinée à permettre aux jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement". La prév' est un peu plus variée que ça, quand même, elle travaille avec un tout un quartier pour améliorer, notamment, la situation des jeunes.
Ce qu'il est intéressant d'observer c'est la méthode de travail de la mission parlementaire : audition de plus d'une centaine de personnes, dont seulement une dizaine est constituée d'acteurs de terrain de la prévention spécialisée (éducateurs et chefs de service). Le reste ce sont le CNLAPS, la CNAPE, l'UNIOPSS (des organismes consultatifs qui dialoguent avec les pouvoirs publics), quelques chercheurs, et surtout, énormément d'élus, de directeurs associatifs, d'acteurs institutionnels des services de l'État. Il n'y a aucun représentant des travailleurs de terrain : pas de syndicat auditionné, pas de collectif militant, pas d'organisation professionnelle de travailleurs sociaux. Pourquoi noyer à ce point la parole des acteurs de terrain dans le flot des auditions ? Parce que, comme on verra tout au long de ce commentaire, il me semble que la principale question que se pose le rapport, au final, c'est bien : "qu'est-ce qu'on va faire de la prévention spécialisée ?". Cette question ne regarde évidemment pas les acteurs de terrain, d'après les pouvoirs publics.
Par ailleurs, la mission a effectué quatre déplacements : à Dijon où sur une trentaine de personnes, une éducatrice est auditionnée, à Metz où sur une quarantaine de personnes, il n'y aucun acteur de terrain auditionné à part une cheffe de service, à Molenbeek où sont auditionnés des acteurs publics et de la prévention de la radicalisation, et enfin à Marseille où sont auditionnés 8 chefs de service et éducateurs sur une vingtaine de personnes auditionnées. Alors oui, de ce fait, sur la douzaine d'acteurs de terrain auditionnés au total, 8 sont marseillais, la plupart à l'ADDAP13. L'association marseillaise est très souvent citée en exemple tout au long du rapport.
Cette focalisation sur l'ADDAP13 peut paraître singulière. Cette association est souvent prise en élève modèle de la prévention spécialisée dans les discours alors qu'elle n'est pas une association de prévention spécialisée. C'est un "groupe" de plusieurs centaines de salariés, dit son site internet, qui ne fait pas que de la prévention spécialisée. Les projecteurs sont braqués sur l'ADDAP13 car visiblement le hasard a fait qu'il y a quelques années, cette association a commandé à Véronique Le Goaziou un rapport sur les liens entre prévention spécialisée et prévention de la délinquance. Le Goaziou est une sociologue proche de Laurent Mucchielli, spécialiste des questions de violences urbaines, d'insécurité, de banlieues. Elle a rendu son rapport en février 2014, et cela a pas mal attiré l'attention car ça répondait à des attentes des élus locaux qui cherchaient des outils pour renforcer leurs politiques de prévention de la délinquance. Beaucoup d'acteurs publics se sont engouffrés dans cette vision en se disant que la prévention spécialisée pouvaient leur servir. Le bouquin de Le Goaziou tiré de son rapport a apporté à celle-ci un succès monstre notamment dans le contexte d'après les attentats, car l'enquête qu'elle a mené à l'ADDAP13 montrait une façon de lier prévention spécialisée et prévention de la délinquance. Beaucoup d'élus se sont emparés de ces analyses pour dire que désormais la prévention spécialisée aurait intérêt à travailler comme le fait l'ADDAP13.
Le dernier paragraphe de l'intro résume assez bien le contenu de cette entrée en matière :
"Le présent rapport entend ainsi tirer toutes les conséquences d'un constat fondamental : la prévention spécialisée, bien qu'elle ne soit pas à l'origine une initiative des pouvoirs publics, est devenue, à mesure qu'elle faisait la preuve de son utilité dans les quartiers difficiles, une politique publique à part entière. Dès lors, il est absolument essentiel qu'elle dispose des moyens juridiques, financiers et humains pour remplir correctement sa mission dans tous les territoires où elle est utile. Conforter l'avenir de la prévention spécialisée participera utilement de l'investissement que nous devons faire dans notre jeunesse." (p. 9).
Je tiens quand même à signaler une petite pépite : l'idée selon laquelle serait "indispensable un véritable renforcement de la formation initiale et continue" en y intégrant les "nouveaux défis de notre société", à savoir : "agir sur un nouvel espace comme internet ou encore prévenir la délinquance ou la radicalisation" (p. 9). Les États Généraux Alternatifs du Travail Social vont être enchantés.
La prévention spécialisée fragilisée.
La première partie du rapport commence avec un assez bon historique de la prévention spécialisée, quoiqu'un peu léger en ce qui concerne l'emprise croissante des modes d'évaluations inadaptés de la prévention spécialisée. En revanche, les auteurs du rapport restituent assez bien l'idée que la prévention spécialisée est en tension du fait des processus d'institutionnalisation et la montée des politiques sécuritaires depuis les années 1980. On peut simplement regretter que cette partie n'aborde pas les résistances à ces processus.
Le rapport présente ensuite assez bien les principes de la prévention spécialisée mais dérape quelque peu en notant : "Les principes qui gouvernent la prévention spécialisée ne constituent pas un dogme mais le cadre de l'intervention des éducateurs de rue. Ils doivent être adaptés à la diversité des situations rencontrées." Bref : les principes, en prévention spécialisée, c'est relatif. Lentement s'immisce une forme de révisionnisme des principes de la prévention spécialisée, qui reste incompréhensible : pourquoi les principes des textes promulgués de 1972 à 1975 sont-ils si souvent attaqués, remis en cause, "adaptés", alors que la Constitution de notre République date de 1958, qu'il y a par exemple une loi de 1803 qui autorise encore les parents ou aïeuls à s'opposer au mariage de "leurs enfants et descendants, même majeurs" ? Il y a bien des lois et des mesures réglementaires encore en vigueur aujourd'hui qui datent d'avant 1972.
C'est le principe d'anonymat qui est le plus durement remis en cause par le rapport, appuyé en cela sur une contribution écrite du CNLAPS.
Petit rappel sur ce qu'est le CNLAPS :
Le CNLAPS apparaît avec l'arrêté fondateur de 1972, avec pour but de fédérer les structures de prév'. En janvier 2016, il comptait 130 adhérents, dont plus de 120 étaient des structures de prévention spécialisée, et dont 8 seulement étaient des individus Cela veut dire que le CNLAPS ne fédère que certains directeurs et administrateurs de la prévention spécialisée, pour faire du "lobbying", comme cela est expliqué dans son Rapport d'activité 2015.
Cela signifie qu'il y a de réelles questions à se poser en termes de légitimité du CNLAPS à représenter la prévention spécialisée et à parler pour elle avec les acteurs publics et institutionnels. Seulement la moitié des 250 organismes publics ou privés ayant une activité de prévention spécialisée sont adhérents au CNLAPS. Les 3000 salariés que compte la prévention spécialisée pourraient donc rêver d'une meilleure représentation auprès des pouvoirs publics que celle du CNLAPS, qui ne représente finalement que les directeurs et administrateurs de 50% des structures de prév'. Une sorte de MEDEF de la prévention spécialisée.
Sur le principe d'anonymat, le CNLAPS a écrit ceci aux auteurs du rapport :
"un jeune peut nous rencontrer en restant anonyme, cependant la majorité des jeunes que nous connaissons et accompagnons aujourd'hui sont connus de nombreux services. Le principe d'anonymat peut sans doute valoir quelquefois, mais il a perdu de la vigueur au fil des évolutions sociétales et de nombreux jeunes ont brisé leur anonymat dès l'âge de onze ans par le biais des réseaux sociaux notamment. Nous observons, dans une écrasante majorité de cas, que ce n'est plus là leur demande lors de nos premières rencontres"
En gros, pour le CNLAPS, on peut se passer la plupart du temps du principe légal d'anonymat puisque les jeunes sont déjà connus de nombreux services et ont "brisé leur anonymat" précocement sur les réseaux sociaux. Cette vision rétrograde du concept d'anonymat, et donc de secret professionnel, est totalement aberrante pour au moins deux raisons. Tout d'abord elle occulte totalement le fait que l'anonymat n'est pas un confort pour l'éducateur, mais une protection des personnes accompagnées car la prévention spécialisée refuse massivement de devenir un rouage de plus de l'appareil de surveillance de masse de l'État (voir l'exemple du Val-de-Marne). Par ailleurs, cette vision est absurde car elle ne voit pas qu'elle peut contribuer à mettre en danger les jeunes ou à nuire au respect de leur vie privée (article 9 du Code civil) : c'est exactement comme dire "Les jeunes passent leur temps à se battre entre eux, et en plus à la maison ils se prennent des claques dès l'âge de 11 ans, donc les professionnels peuvent tout à fait recourir à la violence avec les jeunes ". C'est illégal, c'est absurde et c'est malsain.
Le rapport se poursuit en montrant que les méthodes de la prévention spécialisée reposent sur la souplesse, les horaires atypiques et la capacité à s'"adapter" (le rapport martèle littéralement ce terme tout au long du texte). Il précise que les territoires sont variés mais essentiellement urbains, voire en politique de la ville. Vient ensuite la question de l'évaluation du travail, amenée à travers de bons constats, mais qui débouchent sur une interprétation pas très imaginative : il serait impossible, selon les auteurs, d'évaluer la prévention spécialisée en dehors des méthodes, très imparfaites, que l'on possède actuellement. La première proposition du rapport est de produire un "guide national d'évaluation de la prévention spécialisée" (p. 26). Il me semble qu'il n'est pas impossible d'évaluer la prévention spécialisée, il suffit d'inventer de nouvelles méthodes, réellement qualitatives et puisant dans les sciences humaines et sociales, seule approche à même de saisir la subtilité du travail socioéducatif. Le rapport reste étriqué sur la question de l'évaluation, et obsédé par les critères administratifs et quantitatifs : il pointe que la prévention spécialisée permet de réduire les dépenses publiques, coûte peu chère, et peut être évaluée à travers des fiches et des référentiels.
Le rapport pointe ensuite les diminutions drastiques de financements et suppressions de postes dans divers territoires, déplorant même que dans certains départements, la prévention spécialisée a clairement disparu à cause de décisions politiques délibérées. Il faut donc selon le rapport revoir le caractère facultatif du financement départemental. Cela d'autant plus que les problématiques des jeunes se complexifient et "la demande de prévention spécialisée" ne cesse d'augmenter, ce qui justifierait d'attribuer davantage de moyens à la prévention spécialisée. Le secteur a en effet affaire à des "bandes violentes", à un "communautarisme religieux ou culturel", des "discours idéologiques extrémistes ou complotistes", des "problèmes au regard des principes de laïcité et de mixité", à une "montée du radicalisme", des "problèmes de santé, notamment mentale" (p. 30). Difficile de dire ce qui relève de la réalité et ce qui relève du fantasme dans ces nouveaux objets, mais il est intéressant de constater que ce sont les thèmes qui actuellement tiennent le plus à cur à la puissance publique.
Cette partie est celle où le rapport avance la plupart de ses propositions, après avoir constaté qu'il manquait un "pilotage efficace" et des orientations pour la prévention spécialisée (p. 35). Cette partie commence donc par discuter la question des instances représentatives qui ont été supprimées et celles dans lesquelles il reste des acteurs représentant la prévention spécialisée. La 2ème proposition du rapport consiste à faire une place à la prév' dans le nouveau Conseil National de Protection de l'Enfance.
Le rapport déplore ensuite que le dernier texte de cadrage sur la prév' est l'arrêté de 1972 et il signale qu'actuellement doivent paraître des guides et référentiels auxquels travaillent entre autres la CNAPE et le CNLAPS. Le rapport renvoie aussi à la Convention de partenariat relative à la prévention spécialisée signée en octobre 2016 entre, notamment, plusieurs ministères, acteurs institutionnels représentants les collectivités territoriales, la CNAPE et le CNLAPS (Pour rappel, cette convention redonne quelques définitions au sujet de la prévention spécialisée, puis établit dans quelle mesure l'État peut financer des actions de prév', à savoir : pour se rapprocher de la prévention de la délinquance et de la prévention de la radicalisation). La 3ème proposition du rapport est donc de promulguer un "texte réglementaire définissant les orientations doctrinales fondamentales et précisant le positionnement de la prévention". Positionnement par rapport aux "nouveaux défis" sécuritaires notamment.
Les auteurs soulignent ensuite la richesse des partenariats avec lesquels travaillent les équipes de prévention spécialisée, même si la représentation institutionnelle du secteur reste à améliorer. Ils estiment que préserver et développer ces partenariats passe par une meilleure orientation politique pour surmonter les blocages. Sur conseil de Laurent Mucchielli, directeur de l'Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux à Aix-en-Provence, le rapport estime que les associations de prévention spécialisée gagneraient à "atteindre une taille critique" (p. 43), partant de l'idée que si les associations deviennent grosses, cela leur permettra d'être mieux entendues par les institutions, de plus facilement "s'adapter et prendre en charge les problématiques nouvelles" (p. 43). Le rapport est donc favorable à la constitution de "trusts" ou super-associations qui pourraient devenir des partenaires directs des pouvoirs publics, comme c'est le cas pour l'ADDAP13 dans les Bouches-du-Rhône, qui compte plusieurs centaines de salariés. J'ai bien expliqué dans un autre article dans quelle mesure ces méga-structures sont inadaptées et dangereuses pour la prévention spécialisée, car elles entraînent une uniformisation du travail et une désadaptation aux quartiers d'intervention.
Le rapport aborde ensuite la fonction de la tutelle départementale dans le secteur de la prévention spécialisée. Pour les auteurs, il faut réaffirmer le rôle moteur du département dans le déploiement des actions de prévention spécialisée, car c'est le bon échelon pour mener cette politique. D'ailleurs la question n'est pas celle de l'échelon, disent les auteurs du rapport, soulignant que plusieurs départements ont récemment renforcé leurs financements à la prévention spécialisée, prenant l'exemple entre autres du Val-de-Marne. C'est donc l'appréciation que les services départementaux ont de la prévention spécialisée qui joue le plus.
L'exemple du Val-de-Marne
Il est tout à fait révélateur que le rapport prenne en exemple le 94 pour illustrer la bonne volonté des instances départementales. En effet, le Val-de-Marne, qui a longtemps été réputé pour sa bienveillance à l'égard de la prév', et a créé plusieurs postes ces dernières années, vient maintenant de prendre une décision extrêmement dangereuse, à savoir imposer un logiciel informatique de gestion et de fichage des personnes accompagnées. Comme nous le révélions dans Rézo Social 93, un immense flou entoure ce logiciel, et beaucoup d'inquiétudes et de résistances (parfaitement légitimes) des acteurs de terrain. Le Val-de-Marne illustre assez bien les dangers du processus d'institutionnalisation de la prévention spécialisée : cette dernière bénéficie de financements, de postes, d'une représentation institutionnelle (le Conseil Technique Départemental de la Prévention Spécialisée), mais à condition qu'elle accepte, notamment, de nouvelles orientations politiques sécuritaires, et une évaluation du travail basée sur une base de données informatiques potentiellement nominatives.
Le rapport appelle à la "vigilance" sur le processus de métropolisation en cours (dans quinze métropoles au 1er janvier 2016) et dit qu'il faudra évaluer précisément son impact en temps voulus. C'est la 4ème proposition. De même, les financements de l'État doivent être renforcés selon les auteurs du rapport, qui reconnaissent à cette occasion que la prévention spécialisée peut être financée au titre de sa participation à la prévention de la délinquance. L'optique est la même pour la collaboration avec les mairies et notamment les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : des rapprochements doivent être pensés, dit le rapport.
Pour refonder les moyens de financement, le rapport appelle dans sa cinquième proposition à faire usage des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) plutôt qu'aux appels d'offre à durée limitée. Les CPOM sont des outils de gestion importés du monde entrepreneurial, qui visent à fixer des objectifs comme condition de financement d'une structure par les instances de tutelle, pour une durée de plusieurs années. Ils sont certes préférables aux appels d'offre qui mettent en concurrence les structures entre elles, mais demeurent porteurs d'une forte institutionnalisation de l'action et des liens avec les instances de tutelle.
Le rapport admet enfin que la prévention spécialisée nécessite un "financement particulier" mais insiste sur le fait qu'une fois une association habilitée par le département, ce dernier est dans l'obligation de la financer. Cela remet donc en question ce qu'on appelle le caractère "facultatif" de la prévention spécialisée comme compétence départementale, bien que le rapport admette que sur ce point le droit est plutôt flou et permet des interprétations. D'où sa 6ème proposition de réécrire les dispositions du Code de l'action sociale et des familles pour rendre clairement obligatoire la compétence de prévention spécialisée pour le département, et permettre aux équipes victimes de refus d'habilitation ou de financement de se défendre juridiquement.
Je ne sais pas si tu as remarqué mais jusqu'ici le rapport est très ambivalent quant à l'avenir de la prévention spécialisée : de bons constats sont posés au début pour amener l'idée que la prévention spécialisée a été bien comprise par les auteurs, puis au fur et mesure qu'on avance dans la lecture du rapport, on voit des propositions de plus en plus inquiétantes apparaître. Je fais donc une partie spécifique sur les vingt dernières pages du rapport, qui amènent les propositions les plus iconoclastes.
Préventions de la délinquance et de la radicalisation
Les auteurs montrent d'abord que grâce aux travaux du CNLAPS et de la CNAPE, on voit se dessiner des possibilités de collaboration avec la prévention de la délinquance, en respectant le cadre de la protection de l'enfance. Des articulations sont à penser, dit le rapport, entre prévention spécialisée et prévention de la délinquance, mais l'optique retenue par les auteurs prête largement le flan à la critique.
Les auteurs du rapport s'appuient notamment sur une interview du chercheur François Chobeaux des CEMEA, dont ils gardent seulement les extraits, plutôt caricaturaux, qui les intéressent :
"il existe une vieille garde (parfois chez de jeunes éducateurs) qui défend une prévention spécialisée "pure", qui voudrait qu'on ne parle pas aux flics, pas à la médiation de rue C'est aujourd'hui difficilement défendable [ ] Quand on a d'un côté des équipes de prévention qui ne sont pas des intégristes anti-flics, et de l'autre des polices municipales qui ne sont pas dans le tout répressif, ça peut très bien fonctionner". (p. 55-56).
Contrairement à ce que peut laisser penser cet extrait, les propos de Chobeaux sont très intelligents dans le reste de l'interview. Le fait que ces extraits sont mis en avant dans le rapport appelle tout de même un regard critique. D'abord préciser qu'effectivement les polices municipales ne sont pas le principal souci, mais que Chobeaux oublie que c'est la police nationale et les Brigades Anti-Criminalité (BAC) qui sont les plus grosses sources de tension sur les quartiers.
Pourquoi cette obsession pour le sécuritaire et le travail avec les flics ?
Pourquoi les discours publics n'insisteraient-ils pas autant sur la nécessité de travailler avec les médecins, pharmaciens, infirmiers pour faire face aux problématiques de santé ? Avec les entreprises et services publics qui coordonnent les travaux de rénovation urbaine et pourraient embaucher des jeunes du coin ? Avec les juges pour enfants et avocats auxquels sont parfois confrontés les jeunes accompagnés par la prév' ? Avec les auto-écoles, sociétés de transports en commun et Régions pour remédier aux problématiques de mobilité des jeunes ? Tu vois où je veux en venir ?
Cette obsession de vouloir faire travailler les éducateurs avec les flics et les politiques sécuritaires a quelque chose de malsain et d'étrange. Le rapport répète sans cesse que la prévention spécialisée doit s'adapter aux problématiques des territoires et aux demandes, pour "offrir des prises en charge adaptées", mais, bizarrement, quand il est question de sécuritaire, non : on dénonce les "intégristes anti-flics", on veut "articuler" prévention spécialisée et prévention de la délinquance D'autant plus qu'on répète partout que les travailleurs sociaux sont des casse-pieds qui refusent de travailler avec les flics, qu'il faudrait qu'ils s'adaptent, mais on ne demande jamais à l'institution policière de se remettre en question et de s'adapter aux travailleurs sociaux. Ce qui pourrait être intéressant, quand on sait que plus de 50% des policiers qui ont voté en 2015 ont voté Front National, et que la répression qui s'abat dans les quartiers populaires ou dans les mouvements sociaux à travers les violences policières est de plus en plus mal vécue par les diverses victimes et la population. Et puis, acceptons d'analyser de façon critique la fonction des forces de l'ordre dans notre système : elles sont largement instrumentalisées au service d'un ordre colonial et bourgeois, comme le montre cet excellent documentaire d'Usul. Et finalement, toutes ces injonctions à participer aux politiques sécuritaires et à travailler avec les flics sont faites sans lien avec le sens du travail : pourquoi travailler avec les forces de l'ordre ? Le rapport ne le dit pas, comme beaucoup de discours publics sur ce thème.
Le rapport se poursuit en insistant sur le fait que pour renforcer la dimension éducative de la prévention spécialisée, celle-ci devrait pouvoir intervenir dès l'école primaire, comme c'est le cas à Molenbeek, en Belgique (il est là aussi intéressant de voir que cette préconisation s'appuie sur la rencontre des auteurs du rapport avec des acteurs de la prévention de la radicalisation). L'argument des auteurs est que passé un certain âge, on ne peut plus accomplir de travail socioéducatif avec les radicalisés. Pour cela, il faut renforcer également le travail avec les familles, dit le rapport, et penser une "coopération institutionnalisée" avec l'Éducation Nationale. La 7ème proposition met donc l'accent sur la nécessiter d'élaborer une "convention cadre nationale" (p. 62) entre l'Éducation Nationale et la prévention spécialisée. La proposition suivante est de développer le travail éducatif via Internet et les réseaux sociaux à la manière des Promeneurs du Net (là aussi difficile de ne pas lire entre les lignes l'obsession pour les processus de "radicalisation", dont les experts estiment qu'il se fait beaucoup à travers la propagande extrémiste sur Internet). Le rapport préconise ensuite dans sa 9ème proposition de rapprocher les acteurs de la politique sanitaire (notamment ceux de la santé mentale) et la prévention spécialisée pour mieux accompagner les "publics communs" (p. 66).
Enfin, le rapport exhorte à poursuivre les rapprochements de la prévention spécialisée avec la prévention de la radicalisation, et s'appuie pour cela sur les fiches d'un guide publié par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR), dont le CNLAPS et la CNAPE sont bien entendu partenaires. La 10ème proposition du rapport est particulièrement piquante : "Répertorier les bonnes pratiques en matière de prévention de la radicalisation pour mieux les diffuser dans les territoires où la prévention spécialisée n'est pas encore sollicitée." (p. 68). Comme avec la prévention de la délinquance, on voit ici une étrange ambivalence : là où la prév' n'est "pas encore sollicitée" sur les questions de prévention de la radicalisation, il faut diffuser des "bonnes pratiques" sur ces questions. Où est la fameuse adaptation aux besoins et aux demandes des territoires ? Quel est le sens d'un tel rapprochement ? La "radicalisation" est-elle vraiment une nouvelle priorité pour les publics de la prév' ?
Qu'en est-il de la prévention de la radicalisation de la pauvreté, la prévention de la radicalisation des idéologies fascistes et racistes, la prévention de la radicalisation des violences sexistes et patriarcales ? Et, au-delà de la prévention spécialisée, qu'en est-il de la prévention de la radicalisation patronale, la prévention de la radicalisation de la concentration des richesses, la prévention de la radicalisation des détournements d'argent public par les élus, etc. ?
Réforme des formations d'éducateurs
Les dernières pages du rapport s'inscrivent assez clairement dans la lignée des préconisations de la Commission Consultative Professionnelle du Travail Social et de l'Intervention Sociale (CPC) en matière de réforme des formations en travail social. En effet le rapport estime que les formations doivent se présenter sous la forme d'un "tronc commun" suivi par une "spécialisation" en fin de cursus (p. 68). Les auteurs estiment par ailleurs qu'il est nécessaire de mieux former au travail de rue et à la prévention spécialisée en formation initiale (proposition n°11, p. 73), de mieux intégrer les concepts du développement social et du travail social d'intérêt collectif, et de garantir la formation continue sur des fonds de l'État (proposition n°12, p. 74) pour que les éducateurs puissent continuer à s'adapter aux "nouveaux défis" : prévention de la radicalisation et travail éducatif sur Internet, notamment. L'optique du rapport rejoint donc celle du rapport Bourguignon, dont j'ai fait une lecture critique il y a quelques temps : on rejoint des volontés de "modernisation" et de "décloisonnement" des formations (pp. 70, 71 et 72).
Le souci que pose cette optique de réforme c'est qu'elle considère la formation des professionnels comme une sorte de panacée, une solution miracle. Les conditions de recrutement, de travail, de salaires, le sous-effectif chronique, les droits des éducateurs, la qualité de la Convention Collective, tout cela ne joue-t-il pas également sur l'"attractivité" (p. 72) du secteur ? Pourtant le rapport n'en dit rien. Quant aux problématiques des publics, n'y-a-t-il pas autre chose que la formation qui joue dans la façon dont ils se présentent : le système économique, les politiques publiques, le système politique et démocratique, l'éducation nationale, les inégalités, etc.? Réformer les formations rejoint d'autres intentions : répondre aux "attentes des employeurs" comme il est dit dans le rapport Bourguignon, et mettre le travail social sur la voie d'une industrialisation pour mieux le contrôler et mieux l'exploiter.
Le rapport s'achève sur ces questions, et est suivi d'annexes qui reprennent à l'écrit les échanges oraux qui sont en vidéo sur le site de la mission d'information.
Sans reprendre tout ce que j'ai raconté, on voit clairement ici, à travers la volonté de faire de la prévention spécialisée une "politique publique à part entière", des opportunités et des risques sérieux pour le métier. C'est à mes yeux un renforcement de l'institutionnalisation de la prévention spécialisée, une actualisation de "la tension entre institutionnalisation et rupture" qui existe au moins depuis 1959 (Peyre, V., Tétard, F., 1985, "Les enjeux de la prévention spécialisée : 1956 - 1963" in Bailleau, F., Lefaucheur, N., Peyre, V. (dir.), 1985, Lectures sociologiques du travail social, Paris, Les Éditions Ouvrières / Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, pp. 116 - 132).
Le rapport préconise d'assurer des financements stables à la prévention spécialisée, de mieux former les professionnels à celle-ci, d'améliorer sa reconnaissance institutionnelle, de la défendre juridiquement, de moderniser ses principes, d'élargir ses champs d'action, etc. Tout cela aura pour effet, je l'espère, de stabiliser un peu le cadre d'intervention des équipes de prévention spécialisée, mais au risque de profondément dénaturer ce travail. Le risque est d'envahir la prév' de procédures et d'objectifs, par-là d'en uniformiser le travail dans le sens d'une plus grande participation aux démarches de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Tout cela est totalement contradictoire avec les principes de la prévention spécialisée. En fin de compte, le rapport préconise de changer la forme de la prév', d'en changer les principes et le cadre réglementaire Sans notre vigilance et notre résistance, il ne restera bientôt plus qu'à en changer le nom.
Signature :
Jonathan Louli, le 19 février 2017
Histoire de la prévention spécialisée Intervention orale à un débat organisé par le CTDPS94, le 15/11/16
On a tous déjà entendu l'expression "les arrêtés fondateurs de 1972", mais en fait ils ne sont pas exactement fondateurs : la prévention spécialisée n'est pas apparue en 1972.
Dès les années 1940 des acteurs locaux (magistrats pour enfants, médecins, travailleurs sociaux ) s'inquiètent du sort des enfants errants, conséquence de la Seconde guerre mondiale. On préconise des approches alternatives aux prises en charge institutionnelles, et on expérimente notamment l'idée d'aller vers les enfants dans la rue.
Dans les années 1950 et 1960, des témoignages et expertises se développent sur ce qu'on commence rapidement à appeler de la prévention spécialisée, et le premier financement ministériel officiel est également mis en place à cette époque. Il y avait d'ailleurs déjà des oppositions parmi les acteurs de la prévention spécialisée à l'idée d'être financé par la puissance publique, cela étant pour ces opposants un synonyme de perte d'indépendance.
Dans les années 1960 cette dynamique s'intensifie car nous sommes au cur d'une période de croissance économique et d'État social fort :
de nombreux diplômes du travail social apparaissent à cette époque (notamment le diplôme d'état d'éducateur spécialisé), ce qui soumet le secteur à une forte institutionnalisation ;
les politiques sociales précisent de plus en plus leurs objets et réaffirment que la jeunesse déviante et errante (ex : blousons noirs) est le public type de la prévention spécialisée
les constructions de logements collectifs et logements sociaux se développent avec frénésie en périphérie des agglomérations : ces quartiers deviendront les "banlieues" ou quartiers populaires visés plus tard par les politiques de la ville.
L'objet de la prévention spécialisée se précise et le secteur se professionnalise rapidement.
Dans les années 1970 s'ouvre une période très différente :
l'arrêté de 1972 et les multiples circulaires d'application qui le suivent ne sont donc pas l'acte fondateur de la prévention spécialisée, mais une des principales étapes de son institutionnalisation à travers le développement des réglementations imposées par la puissance publique
les chocs pétroliers des années 1970 marquent le début d'une période de récession économique que nous subissons encore en partie, à travers les reconfigurations politiques et économiques qui s'entament
parallèlement à cette entrée dans une période de crise économique se développent des discours de plus en plus inquiets ou hostiles à l'immigration, aux banlieues (rodéos des Minguettes), aux pauvres (on commence à critiquer l' "assistanat")
En réponse au début de la crise économique, des politiques néolibérales se développent dans les années 1980. Les principes de celles-ci sont :
rendre l'intervention de l'État moins étendue pour tenter de la rendre plus efficace : il y a de fortes évolutions dans la gestion des services publics et des secteurs sociaux, associatifs ou solidaires qui dépendent des fonds publics, ceux-ci étant contraints à être plus efficaces, à rendre plus souvent des comptes, à se plier à des critères de gestion devant faciliter leur lecture par les décideurs, etc. C'est par le secteur hospitalier notamment que s'introduisent ces nouveaux modes de management.
Recentrer l'action de l'État sur des fonctions dites "régaliennes" : armée, police, justice, notamment, d'où le développement des politiques sécuritaires (émergence du "problème des banlieues" dans les discours publics, début de la percée du Front National, inquiétudes relatives au terrorisme )
Parallèlement, les lois sur la décentralisation concernent très directement la prévention spécialisée, placée dans le champ de la protection de l'enfance, qui se retrouve directement sous la tutelle du Département, plus proche que l'État[1].
L'ensemble de ces processus entraînent le développement progressif d'un nouveau mode de gestion du travail social dans son ensemble, et donc de la prévention spécialisée, d'autant plus que les postures militantes régressent au fur et à mesure que la professionnalisation augmente, et les exigences des instances de tutelle se précisent et se renforcent.
Ces évolutions se poursuivent jusqu'à actuellement, et ont notamment débouché sur la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui impose les évaluations interne et externe, la démarche qualité, le droit de l'usager, la culture du projet cette logique est très influencée par les théories néolibérales qui estiment que le social peut être lu selon une logique marchande et économique, à travers des gadgets gestionnaires tels que la démarche qualité ou la culture du projet, et qu'on doit placer l'"usager" au centre de cette logique, comme le serait un client au milieu d'un magasin.
Contre ces diverses formes d'institutionnalisation et de formatage des pratiques, comment continuer à transmettre les principes de base de la prévention spécialisée, et comment continuer à leur conférer du sens ? il faut garder à l'esprit que la prévention spécialisée peut être comparée à une activité artisanale, une production de sens : la prévention spécialisée est telle un artisanat des significations sociales.
Et pourtant où en est-on aujourd'hui ? la prévention spécialisée est remise en question depuis quelques années dans la France entière : Loiret, Seine Maritime, Drôme, Lyon, Lille, et dans toute une partie de l'Île-de-France : Yvelines, Seine-et-Marne, Paris, et maintenant dans le Val-de-Marne.
Au nom de quoi une telle remise en question ?
On considère souvent que c'est en raison du coût que représente la prévention spécialisée, pourtant celle-ci représentait en 2014 en moyenne 0,3% du budget des départements[2]. À titre de comparaison, à l'échelle d'un individu gagnant 1500 , 0,3% de son budget mensuel représente un kébab.
Pour être plus précis, on devrait dire que la prévention spécialisée est remise en cause du fait de son efficience, c'est-à-dire, aux yeux des politiques publiques, du fait grosso modo de son rapport qualité/prix. On reproche en effet souvent à la prévention spécialisée de manquer de "lisibilité", et les pouvoirs publics qui nous financent depuis plusieurs décennies réalisent soudainement qu'ils ne comprennent pas, ou ne voient pas bien ce que fait la prévention spécialisée, en fin de compte. Il est intéressant d'observer que, d'un autre point de vue, ce n'est pas la prévention spécialisée qui est devenue illisible, c'est tout simplement les décideurs qui n'arrivent plus à lire ce qu'elle représente et ce qu'elle produit : du lien social, de la solidarité, des prises de conscience, une certaine émancipation Le regard des décideurs politiques est trop calqué sur celui des employeurs, qui sont les premiers à déplorer ce manque de lisibilité, comme le révèle le rapport Bourguignon.
C'est donc la question du sens du travail en prévention spécialisée qui est posée, la question de savoir comment dégager, comment dire, comment discuter de ce sens, comment en rendre compte, autrement dit : c'est la question d'une évaluation de la prévention spécialisée, dont on débattra dans la seconde partie de la soirée/débat.
Signature :
Jonathan Louli
Bibliographie :
Andrieu, P., Groupe de travail interinstitutionnel sur la prévention spécialisée, 2004, La prévention spécialisée : enjeux actuels et stratégies d'action. Rapport du groupe de travail interinstitutionnel, Paris, Délégation interministérielle à la famille, en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000187/index.shtml
Becquemin, M., 2007, "Pour une critique de la prévention. À travers le prisme des réformes" in Informations Sociales, n° 140, p. 74 - 87
Berlioz, G., 2002, La prévention dans tous ses états. Histoire critique des éducateurs de rue, Paris, L'Harmattan
Chauvière, M., 2010, "Quel est le "social" de la décentralisation ?" in Informations Sociales, n°162, p. 22 - 31, accessible à l'adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-6-page-22.htm
Louli, J., 2014, "Sur quelques acceptions de la mise en ordre de soi-même", in Implications Philosophiques, dossier : La confiance, accessible à l'adresse suivante : http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/sur-quelques-acceptions-de-la-mise-en-ordre-de-soi-meme/
Louli, J., 2016, "La prévention spécialisée francilienne en voie de disparition ?", in Mouvements, en ligne : http://mouvements.info/la-prevention-specialisee-francilienne-en-voie-de-disparition/
Peyre, V., Tétard, F., 1985, "Les enjeux de la prévention spécialisée : 1956 - 1963" in Bailleau, F., Lefaucheur, N., Peyre, V. (dir.), Lectures sociologiques du travail social, Paris, Les Éditions Ouvrières / Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, p. 116 - 132.
Peyre, V., Tétard, F., 2006, Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée, Paris, La Découverte
Notes :
[1] Chauvière, M., 2010, "Quel est le "social" de la décentralisation ?" in Informations Sociales, n°162, p. 22 - 31, accessible à l'adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-6-page-22.htm
[2] http://mouvements.info/la-prevention-specialisee-francilienne-en-voie-de-disparition/