Vous avez vu 11 livre(s) sur 1
AUTRES PARUTIONS
📚 Publications :
2024 – Histoire du Soldat – Charles-Ferdinand Ramuz, Igor Stravinsky – Éd. L’Harmattan
2018 – Lalibèté ka Vini! Décrets d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 – Victor Schoelcher – Éd. Scitep
2015 – Traité sur la tolérance / Asou Latolérans – Voltaire – Éd. Idem
2014 – Misyé Tousen / Monsieur Toussaint – Édouard Glissant – Éd. Mémoires d’Encrier
2014 – Le Chevalier de Saint-Georges / Chèvalyé Sen Joj – Alain Guédé, Serge Hochaïn – Éd. Dagan Jeunesse / MAT Éditions
2010 – Trajédi Rwa Kristof – Aimé Césaire – Éd. CaraïbEditions
2008 – Yé Krik – Yé Krak, Bouladjel (Contes et légendes autour de la mort et des rites funéraires) – Ouvrage collectif – Éd. Desnel
2005 – Les Indes / Lézenn – Édouard Glissant – Éd. Le Serpent à Plumes / Du Rocher
LES ARTICLES DE L'AUTEUR

La pan-créolité ou la dynamique d’une identité créole internationale : Le rôle des grandes capitales
Introduction
Le court exposé qui suit s’inscrit en droite prolongation des arguments énoncés en préface de l’ouvrage Les Indes/Lézenn, traduction créole de Les Indes d'Edouard Glissant, publié en version bilingue français/créole, aux Editions "Le Serpent à Plumes" en septembre 2005.
Il s'attache à démontrer le rôle des grandes capitales dans la pleine valorisation de l'identité pan-créole.
Qu'est-ce que la pan-créolité ou créolité internationale ?
Quand on parle de pan-créolité ou de créolité internationale, il s'agit de définir une démarche globale, tendant à intégrer les différentes cultures créoles du Monde dans une dynamique de relation et de rapprochement, synonyme d'un vaste projet d'unification de ces
identités et des traits spécifiques qui les caractérisent. Envisager toutes les identités créoles, réunies autour d'une identité unique ramifiée, rhizomique, avec un but commun, une volonté
affirmée, c'est définir explicitement la notion de pan-créolité. Idéalement, il s'agirait de réaliser ou d’envisager une matrice singulière dans laquelle viendrait se fondre et se mêler les
différentes cultures créoles : celles de la mer Caraïbe (Grandes et Petites Antilles : Haïti, Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Lucie, Trinidad, etc), des Amériques (Guyane, Brésil, Colombie (Carthagène)), Etats-Unis (Nouvelle-Orléans), de l'Océan Indien (Réunion, Ile Maurice, Rodrigues, Seychelles, Madagascar…) et de leurs diasporas établies aux quatre coins du Monde.
Il nous semble pertinent également de préciser que les grandes capitales du Monde, notamment Paris, Londres, Montréal ou Sydney, pour citer celles qui aujourd'hui apparaissent comme les plus créolisées, représentent des lieux dynamiques pour l'élaboration et la pleine expression d'une volonté, d'une démarche ou d'un mouvement de rapprochement des identités créoles.
Le rôle des grandes capitales
Il est incontestable que les grands centres urbains, les grandes capitales, permettent, grâce à un pouvoir d'attraction qu'il serait vain de leur dénier, la rencontre des diverses communautés créoles du Monde. Alors peut-on se demander si Londres est aussi dynamique
que Sydney, Paris ou Montréal ? Posant les interrogations en parallèle, il nous semble pertinent également de recenser les communautés créoles spécifiques qui composent ces différentes capitales ?
Paris est l’un des cas les plus intéressants ! La capitale française attire, à cause des liens qui unissent la « Métropole » à ses anciennes colonies, Départements ou Territoires d'Outre-Mer, toutes les communautés créoles francophones, d'ailleurs presque exclusivement ! En ce qui concerne Paris, il est difficile d'affirmer qu'une dynamique pan-créole est en œuvre, sinon sous une forme larvée, voire embryonnaire. Les échanges formels sont souvent anecdotiques entre les communautés. Et si, à long terme, ce mouvement de valorisation identitaire propre à chaque communauté peut être favorable à toutes les identités créoles, leur évolution
spécifique servant à l'ensemble ; à court terme, il tend à les segmenter, à les différencier, à les exclure les uns par rapport aux autres. Ce repli, cet enfermement doit être pleinement
envisagé et analysé pour ne pas être un frein définitif au plein développement d'une volonté pan-créole, qui ne saurait, à Paris ou ailleurs, s'envisager dans l'exclusif, voire l’exclusion…
Londres, un peu pour les mêmes raisons que Paris vis-à-vis des communautés créoles francophones, attire les différents groupes créoles anglophones de la Caraïbe. Il semblerait, et le constat est tragique, que chez les anglophones l'attachement à la culture créole et, singulièrement, à la langue créole, ne soit pas aussi manifeste que chez les francophones.
D'ailleurs, dans la zone caraïbe, les cas particuliers de Sainte-Lucie et plus encore de la Dominique sont significatifs. Seules îles anglophones de la Caraïbe où la langue créole est encore pratiquée, celle-ci apparaît menacée dans bien des domaines, notamment celui de la littérature. Et ce, malgré les efforts de certains pour soutenir sa diffusion. La journée internationale du créole au mois d'octobre est d'ailleurs, souvent, le seul prétexte reconnu par les autorités pour traiter des questions liées au développement de l’identité créole. A SainteLucie et à la Dominique, la langue est aujourd'hui encore, figée dans l'oralité, ne se risquant que trop rarement à la littéralité. Cette situation alarmante pénalise conséquemment les créoles anglophones par rapport aux créoles francophones, qui, pourtant, cohabitent dans la même zone géographique. L’exemple de Trinidad et de la perte quasi irréversible du patrimoine créole est aussi malheureusement éloquent. Il nous semble utile également de
noter la "force d’attraction" de l'anglais, avec son statut de langue internationale et de première langue commerciale du Monde. Pour ces diverses raisons, le créole, plus encore que dans les îles francophones, est considéré dans les îles anglophones, comme une langue subalterne, véritablement en marge, frein à une réelle intégration.
A Londres donc, les choses ne se passent pas mieux qu'à Paris ! Pour autant, assiste-t-on depuis peu à un résurgence en matière de valorisation de l’identité créole, soutenue par des volontés nouvelles, issues soit du bassin indien, soit encore du bassin américain francophone.
Un véritable et durable engagement, qui se traduirait à travers des individualités fortes est essentiel dans la capitale anglaise pour dynamiser la diffusion de l’identité créole dans la sphère anglophone et atteindre les objectifs de la créolité internationale.
Certainement est-ce la ville de Montréal qui offre le meilleur panorama en matière de développement des langues et identités créoles, dans le cadre des grandes capitales. D'abord, Montréal apparaît comme un véritable centre, sinon le centre des communautés créoles du Monde. A mi-chemin entre les îles de la Caraïbe et celles de l'Océan Indien, relayée par la capitale australienne Sydney, Montréal accueille toutes les communautés créoles du Monde, dans un mouvement incessant de rencontres favorables à l'émergence d'un courant de pensée pan-créole. Sans nul doute, la présence d'une forte communauté haïtienne, très attachée à ses valeurs créoles, favorise-t-elle ce dynamisme, renforcé par la démarche d'ouverture intellectuelle des Québécois. Par son attitude d'ouverture, la ville la plus peuplée du Québec
dynamise les relations entre les communautés. Une situation que l'on ne retrouve ni à Paris, ou plus généralement, en France, ni à Londres ou en Angleterre. En soutenant cet engagement, par l'organisation de rendez-vous autour des identités créoles, réunissant toutes les communautés créoles issues des quatre coins du Monde, ainsi mises en relation, Montréal manifeste son grand intérêt pour les problématiques créoles et la valorisation de l’identité pan-créole.
A Sydney, en Australie, le phénomène est nouveau d’une volonté de revalorisation très manifeste des identités créoles. Et là aussi, les échanges entre les communautés (Seychelles, Rodrigues, Maurice, Madagascar) est éloquent. De nombreuses manifestations rassemblent les créoles autour d’une dynamique de partage très significative. Sans nul doute que Sydney représente un creuset nouveau pour la pan-créolité. Et même si beaucoup reste encore à faire, de telles prémisses sont prometteuses.
Un peu d’histoire
En soi, l’affirmation d’une volonté pan-créole n’a rien de nouveau. En 1950 déjà, pour parler de la Martinique, le créoliste Gilbert Gratiant auteur de Fab Compè Zicaq (Désormeaux. 1976) affirmait sa volonté (son rêve !) de voir un jour « tous les créoles du Monde réunis ». Plus tard, à la suite de Gilbert Gratiant (qui n’a d’ailleurs jamais cessé d’être un militant pan-créole), la pan-créolité et les réflexions qu'elle soutient ont mobilisé de nombreux créolistes, engagés dans des études avisées en matière d’identité créole. On peut citer Lambert Félix-Prudent comme l'un des principaux auteurs ayant redéfini
cette notion. Dans Des baragouins à la langue antillaise, (Editions Caribéennes. 1980), il présente déjà un large panorama des langues créoles dans la sphère Caraïbe. Il publiait ensuite Anthologie de la nouvelle poésie créole (Editions Caribéennes. 1984), qui poursuivait sur la voie de la diversité, en analysant la langue créole de la Caraïbe à l'Océan Indien. Cet ouvrage annonçait une nouvelle perception de la créolité, considérée non plus dans un exclusif
régional mais bien dans sa dimension internationale.
A la suite de Lambert Félix Prudent, beaucoup d’autres poursuivront dans la même voie, jusqu’à la reconnaissance de l’identité pan-créole comme un véritable acquis des identités créoles du Monde.
Au rang des éminences pan-créoles, on peut citer, toujours pour la Martinique, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant comme autres pionniers de la démarche vers la rencontre créole. Avec Eloge de la créolité (Gallimard. 1989), non seulement grâce à
leur rayonnement d’auteur mais également grâce à la modernité des thèses créoles qu’ils défendaient, la créolité atteignait une dimension nouvelle, véritablement internationale. Cet espace qui s’offrait alors à elle n’a cessé d’être exploré et d’évoluer.
On ne saurait non plus taire l’immense contribution d’Edouard Glissant, notamment à travers ses concepts de Tout Monde ou encore de Créolisation ou de Relation. Et même si son rôle a été minimisé, on ne saurait non plus taire l’apport fondamental d’Aimé Césaire en matière de valorisation de l’identité créole, dans la revue « Tropiques », publié en Martinique sous le gouvernement de Vichy.
A l’orée des années 90, avec le travail réalisé par des groupes engagés, comme au sein de Bannzil Kréyol, réunissant des créolistes du Monde, on a assisté à l’émergence d’une véritable dynamique, que l’on pourrait aisément assimilé à « un réveil identitaire créole ».
Grâce à ce mouvement, dont les actions ont été concrètes et manifestes (Journée Internationale du Créole – Festivals créoles internationaux – Enseignement du créole, diffusion d’ouvrages en langues créoles, etc), l’identité pan-créole n’a cessé d’être une réalité
constante.
Conclusion
Au-delà des intérêts évidents d'une démarche pan-créole en matière de valorisation des identités créoles dans leur sphère respective, il s'agit également pour nous, Peuples Créoles du Monde, d'affirmer plus largement notre diversité, diversité qui nous aide à nous construire en commun et à nous affirmer dans le Monde, de manière fière et digne, tenant compte de nos valeurs patrimoniales. Ensemble pour Demain : voilà donc dorénavant notre crédo !
Rodolf Etienne (2013)

Trois Questions à…
Rodolf ETIENNE, traducteur créole
1/Pourquoi avoir traduit l’Histoire du Soldat ?
J’ai découvert l’Histoire du Soldat à travers l’œuvre du musicien Igor Stravinsky dont j’admire la musique depuis les années 90. Cette découverte a été pour moi comme une révélation : Le Sacre du Printemps, L’Oiseau de Feu, Petrouchka, Pulcinella, etc. Toute cette musique a été un véritable enrichissement, au même titre que celle de Georges Gershwin (Porgy and Bess), de Miles Davis ou John Coltrane dans un autre registre. Stravinsky est un compositeur résolument moderne et terriblement audacieux dont les œuvres ont bouleversé toute l’histoire musicale du XXème siècle et qui aujourd’hui encore résonne d’une pertinence particulière. Cette modernité se retrouve incontestablement dans l’Histoire du Soldat, véritable collaboration entre deux grands artistes, deux grands novateurs, Igor Stravinsky et Charles Ferdinand Ramuz. J’ai été littéralement fasciné par l’Histoire du Soldat, qui sur un plan musical, poétique, philosophique, artistique et esthétique m’a interpellé dès la première écoute. Cette œuvre est d’une force étonnante et entraîne vraiment l’auditeur ou le spectateur dans un univers singulier d’innovation musicale et littéraire où les émotions sont au premier plan. L’histoire en elle-même est fascinante, palpitante, inspirée du mythe de Faust, interrogeant la dualité, l’ambivalence et la complexité des notions de Bien et de Mal, et réadaptée depuis l’œuvre d’Alexandre Affanassiev, lui qui a tant consacré au conte populaire russe… L’Histoire du Soldat qui, aujourd’hui, peut être perçue comme une œuvre classique a véritablement bousculé les canons de la musique et de la littérature de son époque. Cette dimension d’innovation a été également une raison de la traduction, par pure admiration.
2/Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette traduction ?
Pour cette traduction, il n’y a pas eu de difficultés particulières. Le texte est relativement simple dans son approche linguistique et ne présente pas d’obstacles particuliers sur le plan syntaxique ou même au niveau du vocabulaire. Il ne s’est donc pas agi ici d’inventer des mots ou des expressions. L’adaptation en créole a été relativement simple à élaborer, la difficulté essentielle étant de coller à la métrique inspirée bien évidemment par la musique sous-jacente. Je me suis d’ailleurs abondamment inspiré du livret musical, avec les partitions et le texte, et non pas du texte seul. Une fois la musique assimilée, rythmique et mélodies intégrées, le reste du travail a suivi assez facilement. L’idée étant, au final, de faire résonner la musique à travers le texte, de coller au plus près à la phrase musicale tout autant qu’au texte à proprement parler dans sa syntaxe. Il s’agissait, en clair, de faire entendre la musique à travers le texte, de faire chanter le texte, tout en suivant ces intonations particulières. C’était là tout l’exercice, si je puis dire, coller à la musicalité du texte. L’autre exercice étant de donner à lire une langue créole des plus fluides, rendre simple l’assimilation et rendre le texte « accessible », tentant par là de garder toute l’émotion initiale, toute l’émotion originelle intact. Donc, une recherche permanente de fluidité. Mais, là encore, la musicalité du texte est une aide, un canevas, un modèle à suivre.
Et la musique ?
A l’origine, il s’agissait d’un projet plus complexe qui devait intégrer également la musique, en l’adaptant, notamment à partir du patrimoine classique et traditionnelle haïtien.
Cette traduction a pour modeste ambition de jeter des ponts. Entre la littérature et la musique, pour commencer. Mais également entre deux univers culturels, l’européen et ses traditions et le créole et les siennes. Mais effectivement, il faudrait aller plus loin encore et adapter texte et musique. Pour l’heure, il est déjà bien d’avoir pu publier le texte traduit. Ne reste plus qu’à mettre le texte en scène. Le texte peut se vivre aussi sans la musique originale, c’était aussi le pari.
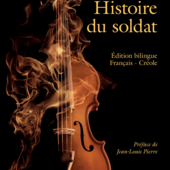
Extraits
Français
LE LECTEUR,
pendant la musique.
Entre Denges et Denezy,
un soldat qui rentre chez lui...
Quinze jours de congé qu'il a.
Marche depuis longtemps déjà.
A marché, a beaucoup marché.
S’impatiente d’arriver,
parce qu’il a beaucoup marché.
Le rideau se lève. La musique (batterie) continue.
Le décor représente les bords d'un ruisseau.
Le soldat entre en scène.
Le soldat s’arrête.
Fin de la musique.
LE LECTEUR
Il n’y a pas, c’est un joli endroit...
Le soldat s’assied au bord du ruisseau.
Mais le fichu métier qu'on a !
Le soldat ouvre son sac.
Toujours en route, jamais le sou...
C'est ça ! Mes affaires sens dessus dessous !
Mon Saint-Joseph qui est perdu !
(c’est une médaille en argent doré avec saint Joseph, son patron, dessus),
non, tant mieux !... Va toujours fouillant,
sort des papiers avec des choses dedans,
sort des cartouches, sort un miroir,
(tout juste si on peut s'y voir),
mais le portrait, où est-ce qu'il est ?
(un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait).
Il l'a retrouvé, il va plus profond,
il sort un petit violon.
LE SOLDAT,
accordant le violon.
On voit que c'est du bon marché,
il faut tout le temps l'accorder...
Créole
LEKTE A,
toupandan mizik la ka jwé.
Asou Danj ek Dénézi,
an solda ki ka viré kay li…
Tjenz jou konjé i ni.
Ka maché za ni lontan.
I maché, i maché anpil.
I présé rivé,
pas i za maché anpil.
Rido a ka lévé. Mizik (batri a) ka pousuiv jwé.
Dékò a sé an bodaj larivyè.
Solda a ka antré asou senn an.
Solda a ka rété doubout.
Mizik la ka fini.
LEKTE A
I pa ni, sé an bel ti koté…
Solda a ka asiz asou bodaj larivyè a.
Men mi kalté travay nou ni la a !
Solda a ka ouvè sak li a.
Toujou asou chimen, janmen san an sou…
Sé sa ! Tout zafè mwen ki méli mélo !
Sen Jozef mwen an ki jis pèdi !
(sé an méday lajan-doré épi sen Josef, patron’y, asou’y),
non, an bonnè !... Ka fouyé toujou,
ka sòti yonn-dé papyé épi bagay adan,
ka tiré kartouch, ka tiré an mirwa,
(tou jis si ou pé wè kò’w adan),
men pòtré a, éti i yé ?
(an pòtré an bon zanmi’y ki ba’y pòtré’y).
I viré touvé’y, i ka chèché pli fon,
i ka sòti an ti vyolon.
SOLDA A,
ka fè vyolon an sonnen.
Yo ka wè sé bon maché,
fodé’w viré fè’y sonnen toulong…
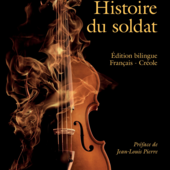
PREFACE HISTOIRE DU SOLDAT
Une étrange rencontre
Jean-Louis PIERRE, Président de l'association "Les amis de Ramuz"
C’est à l’été 1915 que Ramuz rencontre Igor Stravinsky, par l’entremise du chef d’orchestre Ernest Ansermet désireux de lui faire connaître le « grand musicien » qu’il admire et dont il a déjà dirigé des œuvres. Cette rencontre se produit à un moment particulier de leurs vies et de leurs recherches esthétiques.
Stravinsky est déjà considéré comme un musicien de premier plan, novateur et audacieux, auréolé par sa collaboration aux Ballets russes et par le succès de L’Oiseau de feu (1910), Petrouchka (1911) et par le scandale même suscité à Paris, le 29 mai 1913, lors de la création du Sacre du printemps. Il n’est plus ce jeune musicien qui venait depuis 1910 en villégiature sur les bords du Léman pour se reposer et pour la santé de sa femme : la Grande Guerre, et un peu plus tard, en 1917, la Révolution russe, en font un résident permanent en Suisse jusqu’en 1920, date à partir de laquelle il résidera en France avant de parcourir le monde.
Ramuz, lui, bénéficie également d’une certaine notoriété et du prestige parisiens. Il a séjourné une douzaine d’années dans la capitale (1902-1914), rentrant au pays aux beaux jours. À son actif, il a déjà publié quelques œuvres marquantes et il s’impose comme le chef de file naturel d’un groupe de jeunes intellectuels et artistes qui vont former l’équipe des Cahiers vaudois ; il a rédigé Raison d’être le manifeste du groupe qui compose le premier de ces Cahiers vaudois. Fin mai 1914, il est rentré dans son « Pays de Vaud » - plus vaudois que jamais - dont il ne sortira quasiment jamais.
Les deux créateurs sont, en ces années 1914-1915 à un moment de remise en cause de leur esthétique et ils s’adonnent à différentes recherches. Stravinsky, sans totalement abandonner les grands ensembles orchestraux, entend explorer dans des œuvres brèves, intenses, toutes les ressources des instruments, même les plus inattendues, et ce, dans de petits ensembles. Il se ressource dans la richesse de la poésie et des chants populaires russes. Ramuz vient de faire paraître Adieu à beaucoup de personnages : le titre même de ce recueil exprime clairement son souhait de renouvellement. Il est à la recherche d’une écriture plus authentique, plus ancrée dans la terre vaudoise et son parler. il compose de septembre à décembre de cette année, un ensemble de chansons ; la forme brève de ce genre, s’il impose une grande économie de moyens, laisse une grande liberté et permet de jouer sur les rythmes, les sonorités, les tonalités, les registres de langue. En particulier, les raccourcis donnent souvent une fraîcheur naïve au propos. Le travail pour Chansons n’est pas sans rapport avec les œuvres que Stravinsky composait à peu près au même moment. On a pu écrire, d’ailleurs, qu’elles étaient, ces chansons, « la meilleure préparation à l’Histoire du soldat ».
Une certaine communauté d’intérêts rapproche donc, en ces années 1914-1915 ces deux personnalités si différentes par ailleurs, mais le musicien et l’écrivain sont également amoureux de la vie dans ce qu’elle a d’authentique ; ils vont apprendre à se connaître et s’apprécier en travaillant ensemble. « Durant la seconde partie de l’année 1916, Ramuz adapte en français – plutôt qu’il ne traduit- les textes russes des Berceuses du chat, des Priabaoutki et de Renard. Travail que Stravinsky lui paie, grâce notamment à Mme de Polignac, mécène française qui soutient le compositeur. En 1917, l’écrivain et le musicien travaillent au texte français de Noces, d’abord en mai et juin, puis fin octobre et début novembre ».
Au début de l’année 1918, sans doute, naît l’idée d’un projet qui va mener à l’Histoire du soldat, comme le rapporte Ernest Ansermet : « […] les deux amis se rencontraient volontiers chez moi, à mi-chemin de leurs demeures, à l’heure du thé. C’est là qu’un jour surgit l’idée fantasque d’un spectacle ambulant, très simple, très direct, pouvant donc être présenté dans n’importe quelle ville ou village […]. Car tous deux souffraient de l’espèce d’arrêt que la guerre avait provoqué dans l’activité artistique et dans la diffusion des œuvres d’art. […]. L’idée ne tarda pas à se concrétiser, car Stravinsky connaissait une foule d’histoires populaires russes souvent représentées dans son pays sur des tréteaux de foire, ou dites par un barde ambulant. »
C’est un conte populaire tiré d’un recueil d’Alexandre Afanassiev, Le Déserteur et le Diable qui sera retenu par les deux artistes. De longs mois de gestation seront nécessaires à la réalisation de cette œuvre qui se voulait fort simple, -mais qui se révèle bien plus complexe et délicate à interpréter ! La première eut lieu à Lausanne le septembre 1918 avec un certain succès. Malheureusement la grippe dite espagnole arrêta net la diffusion de cette œuvre. La France des années 20 boudait généralement l’œuvre de Ramuz. Et, si, aujourd’hui, l’Histoire du soldat est considérée comme un repère incontournable de la modernité esthétique de la première moitié du XXe siècle, et comme une réussite exceptionnelle, pendant longtemps, ce ne fut pas le cas. De nos jours, il n’est guère d’années où, ici ou là, ne soit monté ce spectacle, avec plus ou moins de bonheur : les réalisations prestigieuses n’étant pas toujours les meilleures ; de nombreux enregistrements sont disponibles.
Peu à peu les deux artistes se sont éloignés : Stravinsky a couru le monde et connu une réussite éclatante, Ramuz est resté dans sa terre vaudoise, reconnu par ses pairs mais bien méconnu par le plus grand nombre et a souffert de l’éloignement de son ami. Chacun a repris l’œuvre commune un peu à son compte. Ramuz a publié le texte dans le 8e Cahier vaudois en 1920, mais ce texte diffère déjà de celui qui fut joué lors de la création et du tapuscrit donné à Werner Reinhart, le généreux mécène qui finança l’entreprise et à qui l’œuvre sera dédiée ; Stravinsky en a donné une version encore différente aux éditions Chester, en 1924. Comme l’écrit Marcel Marnat, « perdus dans ce dossier devenu inextricable, les interprètes actuels en viennent à « monter » leur propre texte, en général à partir de l’édition Chester ».
« Étrange rencontre » que celle de ces deux immenses créateurs ; profitable à l’un comme à l’autre. Précieuse pour Stravinsky à une étape particulièrement difficile de sa vie, marquante pour Ramuz dont l’écriture va se faire encore plus audacieuse et novatrice comme en témoignent les textes écrits entre 1917 et 1920. Nul doute, la grande prose poétique de Chant de notre Rhône (1920), les Morceaux qui formeront le recueil de Salutation paysanne et qui feront scandale en 1920, ont bénéficié de la rencontre avec le musicien, de leurs recherches communes.
Dans les dernières lignes de ses Souvenirs sur Igor Stravinsky Ramuz, nostalgique, raconte qu’il va en glisser le manuscrit dans une bouteille qu’il confiera au grand fleuve aimé, le Rhône, pour qu’elle parvienne à l’ami lointain, qui habite alors à Nice.
Lointain, dans tous les sens du terme...










