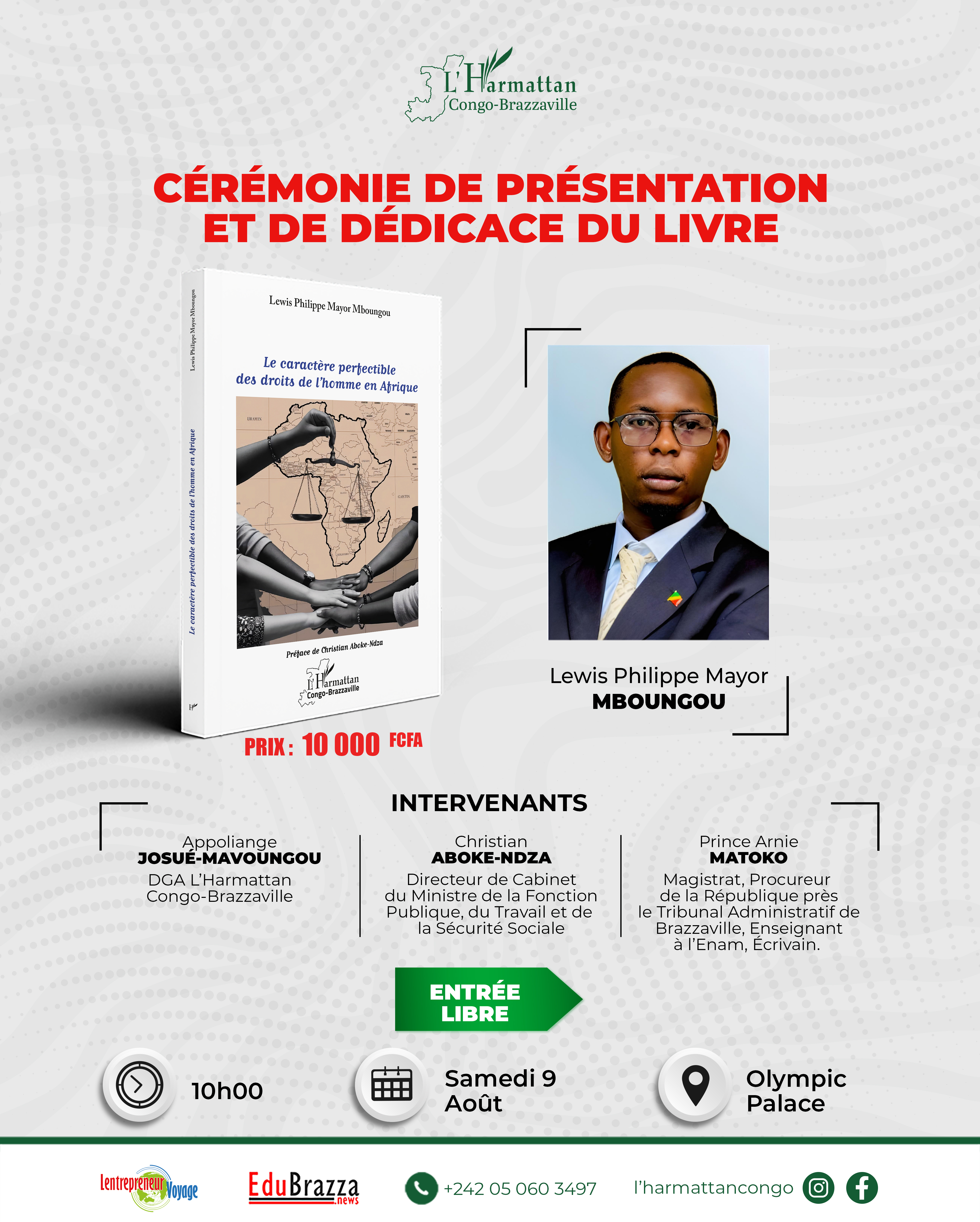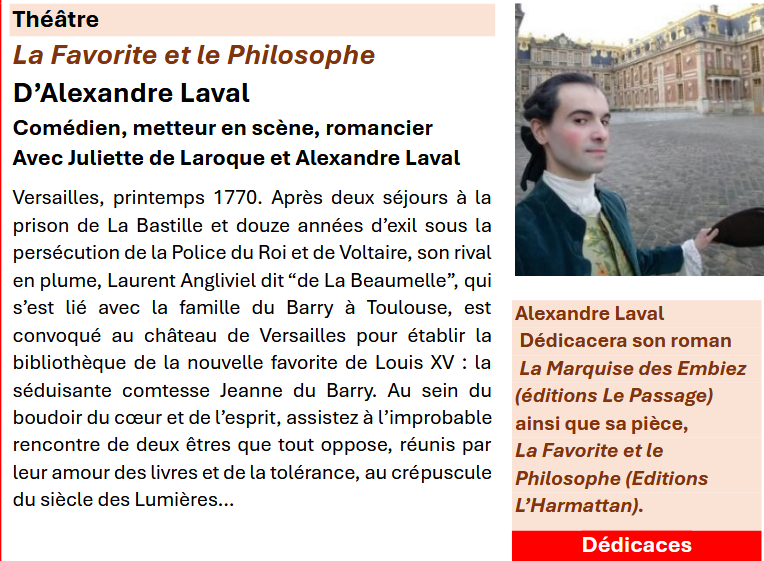Roland Techou
ContacterRoland Techou
Descriptif auteur
Le travail philosophique est essentiellement conceptuel. C'est à partir d'un concept approprié que s'élabore une pensée philosophique. La philosophie contemporaine, notamment la phénoménologie en montre le chemin. En tant qu'opération de retour aux choses, la phénoménologie loin de s'attarder sur les doctrines philosophiques, procède par dégagement d'horizon conceptuel afin de faire accéder la pensée à la chose même. S'intéresser donc à la phénoménologie c'est souscrire à la rigueur philosophique de l'époque.
Docteur en Phénoménologie et en Philosophie de la Religion
DEA en Droit de l'homme et Démocratie
Structure professionnelle : Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire à Cotonou
Titre(s), Diplôme(s) : Maître de Conférence
Fonction(s) actuelle(s) : Enseignant-Chercheur en Anthro-phénoménologie
Vous avez vu 11 livre(s) sur 4
AUTRES PARUTIONS
- La foi du Jeune Heidegger, Eilivre, Paris, 2016
- Etant configuré, essai sur l'histoirque du Dasein heideggerien. Connaissance et Savoirs, Paris, 2017.
Phénoménologie du transcendant, Essai sur la finitude humaine, Flamboyant, Cotonou, 2018
- Phénoménologie de la finitude, Essai sur l'être humain, Ids, Cotonou, 2018
- Penser l'Afrique d'aujourd'hui avec Paulin Hountondji, 2022
- Gbètonyinyi, Logique et rationalité du vivre ensemble au Bénin, 2023
- Gbèto à l'épreuve du Gbètonyinyi, au -delà de la Béninoiserie, 2023
-Enjeux Philosophiques du Gbètonyinyi. Editions Le Perroquet, Cotonou, 2025
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
METAPHYSIQUE DE LA FINITUDE : DE HEIDEGGER A HOUNTONDJI
Nous sommes à l'ère du Tournant Phénoménologique de la Métaphysique. Étant donné qu'il n'y a de métaphysique que du sujet métaphysicien par excellence, l'être humain lui-même, Être humain, c'est consentir à sa finitude ontologique.
CORONAVIRUS, La théraphie de la Philosophie Penser et non Philosopher : Conversion du Regard
La finitude n'est pas la fin encore moins la limite. C'est notre fragilité ontologique ; c'est-à-dire la vulnérabilité constitutive de notre être-au-monde et d'où il faut trouver la raison de vivre
Grand Séminaire Philosophât
CORONAVIRUS : LA THERAPIE DE LA PHILOSOPHIE
Penser et non Philosopher : Conversion du Regard
"Aimons-nous assez le monde pour en assumer la responsabilité" ?
La singularité profonde de l'être humain est d'avoir une vie finie et de le savoir. Entre le "Connais-toi, toi-même" de Socrate et le "Il faut avoir le goût de la mort" de Montaigne surgit le sens de la Vie dont le Coronavirus révèle la finitude. La finitude n'est pas la fin encore moins la limite. C'est notre fragilité ontologique ; c'est-à-dire la vulnérabilité constitutive de notre être-au-monde et d'où il faut trouver la raison de vivre. On ne sait encore rien de la fin de la crise ou comment elle impacterait notre monde. Prophétiser c'est même s'exposer à la vulnérabilité. En dépit du connaissable qu'est l'homme, l'inconnaissable nous échappe. L'inconnaissable est existentiel car l'humain n'est pas de la pure matérialité. Il échappe à la possession et au possédable. Cette inquiétude humaine à ne pas tout maitriser y compris soi-même est la manifestation de l'être humain expression de sa fragilité. N'est-ce pas plutôt de cette fragilité révélée que sourdent l'essence de la pensée philosophique à comprendre la pandémie comme une "descendante dans l'abîme" (1) et à indiquer la cause de cette descente (2) comme sa thérapie (3) ? En cela, la philosophie n'a pas attendu la catastrophe mondiale pour inciter les humains à se rendre attentifs à l'écho du millénaire ; autrement dit à faire de toute pensée un "se" penser.
1- "UNE DESCENTE DANS L'ABIME" A PEINE EBAUCHEE
"Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites".
Parmi les thèmes de réflexion philosophique les plus marquants de ces dernières années, celui de la finitude bénéficie d'un éclat particulier : étroitement associé au courant phénoménologique, il est apparenté à une certaine relecture de l'histoire de la métaphysique et à un recentrement du questionnement philosophique à partir de l'expérience de l'existence humaine. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de la substitution en anthropologie philosophique de la question : "Qu'est-ce que l'homme ?" en "Qui est l'humain ?". La réponse à cette interrogation sur l'homme, fait entrevoir au sein des sciences humaines, les modalités de cette finitude qui se déclinent en fragilité humaine, vulnérabilité de l'homme. Pour qui sait voir d'un voir phénoménologique, la philosophie ayant fait depuis le début du siècle dernier le deuil de la métaphysique positiviste, ressuscite sur des cendres renouvelées de la pensée que Hannah Arendt contre le totalitarisme et au profit de la culture reprend en mots si simples mais non simplistes : "une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites". Remplaçons ici Crise par pandémie et redisons avec Arendt que "la pandémie qui s'abat à l'instant sur toute la planète terre et qui atteint presque toutes les branches de l'activité humaine - la raison - la logique - la politique du marché - l'économie - la démocratie - la religion - la laïcité - la morale - le vivre - ensemble - n'est qu'une descente dans l'abîme à peine ébauchée". C'est donc un évènement, un signal imprévu qui s'éclaire en avertissement voire en appel "à faire la peau aux préjugés pour mieux penser ce qui nous arrive".
C'est parti. La fragilité humaine, la modalité la plus obvie de la finitude humaine devient le concept référentiel qui doit sortir l'humanité de l'arrogance du "Cogito" pour retrouver sa lettre de noblesse celle d'être humain (Je suis). Toutefois, humain n'est pas humanisme et finitude n'est pas immanentisme : il est remarquable en effet, qu'en s'installant au cur du questionnement philosophique face au Coronavirus, la condition de l'existence humaine devait se décentrer en même temps d'elle-même pour pointer, par delà son immanence, une transcendance qui en est comme le corollaire et la condition de possibilité à la fois. Mais "(...) Ce qu'est essentiellement la finitude de la réalité-humaine, écrit Heidegger, cela ne se révèle que dans la transcendance en tant que celle-ci est liberté-pour-fonder". Ou comme l'écrit un de ses commentateurs : "(...) exister, selon Sein und Zeit, c'est se tenir dans l'ouvert, dans l'apérité de la transcendance finie, dans l'entre-deux de l'être et de l'étant". Ces citations se justifient par le fait que c'est évidemment pour une large part à Heidegger et à son analytique du Dasein (l'être-là humain) que l'on doit la réévaluation contemporaine des questions philosophiques à l'aune d'une phénoménologie de l'existence qui prend au sérieux la finitude au fondement. Pour le philosophe c'est donc désormais évident. La finitude est le commencement de toute pensée de sortie de crise.
Jusque-là, cette finitude n'est pas comprise comme telle. Elle sera enfin écoutée grâce au Coronavirus car : "C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet". La descente dans l'abîme est à peine ébauchée. Alors que nous sommes encore en plein cur de l'annonce pandémique, des voies de résolutions se creusent à nouveau autour du capitalisme rationaliste et consumériste dans l'oubli total de celui pour et par qui le scandale est advenu à savoir "l'oubli de l'humain au profit de l'homme". Contre Jean-François Bryant dans Servitude Moderne, les décideurs refusent d'écouter le sens de la crise et pourtant elle se fait claire : "Les nations sont bloquées ; l'économie est bloquée. Confinement total, crise financière, les nations entières ont fermées les frontières, entreprises fermées, écoles fermées, commerces fermés, restaurants fermés, églises fermées. Les évènements sont annulés, plus de rassemblements. Des deuils solitaires. Des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance". C'est en réalité parce qu'en fait, le Coronavirus qui nous coupe du monde, ne nous coupe pas des choses mais de nous-mêmes. L'oubli de soi engendre donc un oubli plus fondamental ; l'oubli du sens de ce que nous sommes. Il y a là la mise en évidence, dans la finitude de l'existence humaine, d'un nud ou d'une tension qu'on ne peut trancher ou résoudre qu'au prix d'une négation dogmatique ou réductrice de l'ouverture radicale de l'homme sur son origine, le sens qui l'habite, et sa finalité. Ce n'est pas un piège sans fin (Olympe Bhêly Quenum) encore moins un chemin qui ne mène nulle part (Heidegger). C'est une "descente en abîme" l'ab-grund (le fond) de notre endlichekeit (fin). Pour le percevoir, il faut emprunter un autre chemin : Andere Denken (une autre pensée). Car, "une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites" (H. Arendt).
2- SORTIR DU RATIONALISME CONSUMERISTE : ANGOISSE ET AFFECTIVITE
"Il faut revenir aux questions avant d'apporter des réponses"
Le confinement, de préférence "établissement du Cordon sanitaire" pour spécifier la mesure béninoise de la situation, ne dicte qu'une expérience, celle philosophique la plus profonde de l'humain. En effet, la philosophie, "de quelque manière qu'on la fasse est la possibilité finie d'un étant fini". L'expérience de notre finitude originaire dicte la loi au rationalisme consumériste dont l'hégémonie nous a fait oublier notre fragilité existentielle. Frédéric Lenoir dans La guérison du monde à la suite de Pierre Bahir dans Sobriété heureuse, rappellent que seul le "repli sur soi" et non la dispersion imposée par le monde moderne capitaliste et libéral, permet de rester lié aux autres et accroché au monde : "Saisissons ce moment, préconise, Roger-Pol Droit, pour réfléchir et repenser notre rapport à la vie quitte à loger dans un ennui qui sera, au bout du compte, salutaire". Il est donc évident, la pandémie du Coronavirus nous amène à repenser notre monde. La situation inédite de l'existence humaine actuellement apparaît pour les habitués de la logique mercantile et du capitalisme consumériste un saut dans l'inconnu. C'est dans cette angoisse qui reste existentielle qu'il faut trouver le sens de l'abîme.
Pour Roger-Pol, nous en apprenons philosophiquement en même temps que la philosophie nous en apprend : "Cette situation dit de nous que nous n'arrêtons pas de bouger d'abord dans nos têtes. Que nous n'arrêtons pas de nous divertir, de nous occuper à l'écran, avec des jeux vidéo, avec des séries. Mais cela change aussi nos cartes mentales. Autrement dit, c'est une sorte d'expérience philosophique absolument gigantesque où notre vie quotidienne change. Cela nous oblige à réfléchir à des choses que, d'habitudes, nous ne voulions pas voir : le hasard qui peut tout bouleverser, la vulnérabilité de nos vies et de nos corps, le rapport étrange que nous avons entre notre solitude dans le confinement et la solidarité. Tout ça aussi doit faire réfléchir. Il y a énormément de choses qui sont en train de bouger dans les têtes alors que nous ne bougeons plus dans la réalité".
C'est la réalité qui va, au sortir du confinement et avec la levée des barrières du cordon sanitaire, recevoir une nouvelle appréciation voire compréhension. La remise en cause de nous-mêmes à travers l'effondrement des certitudes stipule que ce que nous savons en réalité, c'est que nous ne savons pas. Sur les réseaux sociaux beaucoup jouent aux charlatans, une nouvelle manière de se divertir au sens pascalien du terme. Ils savent exactement ce qui est arrivé et comment cela est arrivé et ils s'efforcent d'informer les autres. Il n'y a pas meilleur aveuglement que celui dans lequel "la raison suffisante" a plongé l'humanité depuis trois millénaires. A l'heure de "l'insuffisance de la raison suffisante" (Jean-Luc Marion) ce n'est pas seulement la "pluralité de la rationalité" que l'on découvre avec Paulin Hountondji mais un juste "combats pour le sens" pour rester dans le champ lexical du penseur qui ne cesse de nous engendrer. La mort du rationalisme et de ses corollaires se fera dans l'angoisse et seule l'affectivité l'autre nom de la sensibilité ouvrira la voie à la compréhension du nouveau principe que nous venons à peine d'introduire en phénoménologie, philosophie de notre temps : "Raison sensible pure". Il en va du sens de notre existence, de notre être-au-monde et partant du "pour quoi" nous vivons". Homme ! D'où es-tu et où vas-tu ? La raison jusque-là tenue pour "le bon sens" fléchit l'échine devant cette double interrogation dont la réponse pourtant est unique : "Je suis ma finitude".
Pour sortir du "au jour le jour" auquel la raison rationalisante nous aura habitués, il faut opérer l'épochè phénoménologique, soit la mise entre parenthèse de nos anciennes certitudes. Nos certitudes se sont révélées fragiles. Cette fragilité qui fait peur est pourtant ce qui nous a rendus fous donnant plutôt raison à Nietzsche : "Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude". Hölderlin n'a pas trouvé mieux à nous enseigner quand il confirme que : "Là où croît le péril, là aussi ce qui sauve". L'homme ne peut se penser en cherchant à penser son monde en dehors de lui-même, le sujet pensant. Ce n'est donc pas la pensée qui pose problème mais le refuge de celle-ci dans la seule logique rationaliste qu'aura entériné au cours de l'histoire jusqu'à influencer tous les domaines de l'agir humain le logocentrisme d'un certain Descartes venant d'Aristote à travers "Principe du tiers exclu ; Principe de non contradiction, Principe d'identité". Coronavirus n'a pas dicté sa loi. Il rappelle le principe jusque-là oublié pour ne pas dire délaissé, celui de l'affectivité. La rationalité de la sensibilité est ce qui affecte la condition humaine, depuis l'apparition de l'espèce humaine sur la terre jusqu'à l'avènement de Coronavirus qui éveille l'humanité à sa propre loi, celle de l'empathie et de la solidarité. Il s'agit d'ailleurs non pas d'une épidémie mais d'une pandémie. Son envergure dépasse l'apitoiement pour ouvrir la voie à la pitié au sens rousseauiste. Nous sommes chez nous ; mais nous ressentons directement le malheur et la peur des autres. Disons-le une fois encore avec Roger-Pol :
"Nous sommes chez nous en bonne santé, (peut-être) très protégés pour la plupart (peut-être). Nous voyons des gens qui souffrent, qui sont malades, qui meurent en masse de façon incompréhensible ou sans raison apparente à cause de ce virus. C'est cela le lien humain fondamental. C'est le fait que nous partageons des peurs, des émotions, des solidarités. Lorsque nous avons le sentiment que des semblables, même inconnus, sont en danger de mort, nous nous portons à leur secours sans réfléchir".
Cette logique est simplement humaine ; elle n'est pas une logique de raison encore moins rationaliste voire calculante. C'est d'ailleurs pourquoi Roger-Pol ajoute : "Ce n'est pas une histoire d'argument, de démonstration. C'est un lien humain de solidarité, de sursaut, pour aider les autres". On l'aura compris, en face de Coronavirus "l'homme n'existe plus ; c'est l'humain qui préexiste". Face à cette double attitude concomitante, celle de l'humain qu'est le bien portant et qu'il cherche à sauvegarder dans l'autre qui n'est pas lui, mais le malade, l'angoissé en face de la mort, subsiste non plus l'individualisme mais la logique du "vivant-mortel" que nous sommes. Nous sommes des êtres finis et seul notre état d'être nous sauve de la mort voire du néant et du péril. Dans Totalité et infini, Levinas aura indiqué comment l'affectivité est cette "faillibilité" de la conscience qui se prétend spéculative et reste en réalité toujours incapable d'accomplir de l'intérieur d'elle-même un retour hermétique sur soi. Cet attachement à soi toujours déficient devant autrui se trouve décrit par de nombreuses métaphores dont le point commun est "l'affectivité ou la sensibilité comme passivité et souffrance" et qui mettent en évidence l'inquiétude du moi en face d'autrui lorsque la conscience se pense sur le mode d'une forteresse imprenable. L'impossibilité radicale de l'attachement de soi à soi a pour corollaire l'ouverture éthique à autrui ; la finitude se surmonte en transcendance pour ramener l'inquiétude humaine au sujet inquiété. L'audace d'emprunter au cur de l'angoisse le chemin de l'affectivité est le courage d'être et de retrouver le sens de l'humain que nous sommes.
3- RETROUVER LE SENS DE L'HUMAIN : DU COGITO A LA FINITUDE
"L'homme est un être spirituel appelé à vivre humainement"
Les promesses d'aides financières pour remonter la pente ont déjà commencé. L'argent s'empresse de s'accaparer à nouveau de la commande du monde postmoderne. C'est là la nouvelle catastrophe à l'échelle cette fois-ci non plus mondiale mais planétaire qui va se reproduire. Mais, heureusement c'est pourquoi d'ailleurs il y a le Coronavirus ; le troisième millénaire ne compte plus "des magiciens de l'enfer". L'esprit du siècle n'est pas celui du cartésianisme débridé encore moins de la métaphysique asthmatique. Le Cogito est blessé (Paul Ricur) et l'âge herméneutique de la raison (Jean Greisch) amorcé depuis la fin du siècle dernier impose d'éviter dorénavant une philosophie politique et morale qui n'adule que la valeur argent dans la fusion de l'être et du devoir -être contemporain. Les analyses d'Olivier Depré sur la relation philosophique entre politique et morale méritent d'être relayées comme le chemin de conversion qu'impose le Coronavirus à l'hégémonie occidentale qui jusque-là s'est refugiée dans la production économique comme le tout de l'existence. Celle-ci aura profondément influencé notre rapport aux choses déstabilisant l'être organique de l'africain pour le réduire à du mécanique. Le rapport holistique avec le monde perdu, les valeurs s'effritent et l'éthique devient une étiquette.
Dans l'article Finitude et transcendance, Depré relaye pour le compte de la philosophie politique et morale ce que Amartya Sen, économiste indien et prix Nobel de l'économie n'a pas cessé d'évoquer dans Liberté et Développement de même que dans Rationalité et liberté en économie, à savoir repartir du facteur humain pour donner sens à l'agir humain qu'il soit économique, politique ou moral. Dans chacun de ces domaines, le monde entier a jusque-là évolué suivant le modèle occidental. Le Coronavirus exige de dépasser un tel modèle devenu ruinant et asphyxiant pour l'occident lui-même. On perçoit dès lors que dans la quête de solution c'est une vision renouvelée du monde et de nous-mêmes qui s'offre. C'est dans cette donation originaire qu'il faut inscrire les nouvelles possibilités de la pensée à se penser comme pensée pour le/du monde. Avec John Rawls et Robert Nozick, comme le souligne l'article de Depré, on peut retrouver une autre manière de faire de la philosophie politique et morale surtout dans l'espace géographique qui est le nôtre du fait que "les vrais problèmes des vrais philosophes sont ceux qui tourmentent et gênent la vie" (Valéry) et que la première tâche du philosophe est de "clarifier nos concepts". L'absence de concept ou le défaut de conceptualisation retarde l'émergence de la politique et de la morale. Le tournant conceptuel de la philosophie africaine s'énonce dès lors nécessaire pour sortir de l'ethnophilosophie car la philosophie est essentiellement questionnement critique ou elle ne l'est pas.
L'exercice en Afrique de la philosophie politique et morale, paradigme le plus attrayant dans le cercle des spécialistes béninois de la philosophie, doit se libérer de son lieu de réception qui est l'Occident. Il s'agit par exemple pour contrecarrer désormais l'utilitarisme économique dont l'enjeu est de "maximiser la somme des utilités qui doit permettre de résoudre les problèmes de société" d'abandonner toute approche positiviste. L'uvre de John Rawls dressée bien évidemment contre cette morale métaphysique qui pose l'utilitarisme au fondement, formule deux principes à assumer : le "principe d'égale liberté" et le "principe de différence et d'égalité des chances". Il n'est pas question, avec ces principes, d'utilité, mais de "biens sociaux primaires". De même, John Rawls introduit dans cette théorie des considérations distributives qui faisaient ordinairement défaut à l'utilitarisme, tout en justifiant certaines inégalités (principe de différence). Il nous propose donc "un compromis élégant et attrayant entre un égalitarisme absurde et un utilitarisme inique". Une telle approche à découvrir introduit l'autonomie de l'individu contre toute intervention au nom de motifs sociaux supérieurs. Parmi les réactions qu'a suscitées cette théorie de la justice de John Rawls, il convient de citer celle de Robert Nozick. L'originalité de cet auteur est de concevoir la justice autrement que dans les termes des principes configurationnels "A chacun selon..." ou synchroniques principes "dont la réalisation peut être vérifiée sur la seule base d'informations relatives à l'état présent de la société" des théories habituelles. Il s'agit selon Depré de la défense d'une conception purement historique de la justice".
L'histoire n'est pas à délaisser. Mais elle doit être constamment pensée au risque d'un oubli historial. Dans une conception renouvelée de la justice, il devient "impossible de dire a priori à quoi va ressembler une situation juste, quelle configuration, quel état synchronique. Est juste tout ce qui résulte du libre exercice des droits inviolables de chacun". Là s'énonce une morale à la mesure de l'humain loin des normes métaphysiques prédéterminées qu'on assimile en contexte de moralisme à des préjugés. C'est ce que réfute Korzybsky qui au regard des inégalités persistantes entre les humains déclare qu'à notre époque le monde est anticonstitutionnel. Pendant que sur la base des droits de l'homme nous confessons que "tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité", l'injustice entre citoyens est active dans la société. Cette brève analyse de ce que doit être pour nous la nouvelle vision politique, morale et sociale n'éloigne pas de l'actualité du Coronavirus. Elle justifie que personne n'est détendeur des biens de la terre pour se prévaloir d'en distribuer à d'autres. Et la démocratie que nous avons choisie pour vivre est en attente d'élargissement de sa rationalité.
C'est pourquoi le "principe d'acquisition originelle" et le "principe de transfert" ont permis à Robert Nozick de déterminer ce dont il est légitime d'être propriétaire, le sujet métaphysique lui-même. Seul le respect du sous-sol de chaque délimitation du monde en continent, délimitation opérée et effectuée conventionnellement par l'humain lui-même pourra favoriser une logique de développement authentique. De plus, il n'y a pas de morale désincarnée. Toute morale doit être incarnée. Nous devons rechercher d'autres perspectives morales en mesure de lier "être et devoir-être". C'est ce qui suscite actuellement le questionnement de J. Etienne au sujet d'Éthique formelle et morales historiques: entre l'universel de l'éthique formelle et le pluralisme relativisant des morales historiques, quelle attitude concrète l'homme peut-il choisir?
Pour Depré revenant sur l'interrogation " Les morales historiques constituent toujours pour l'individu un fait social et culturel qui s'impose à lui et qui, éventuellement, peut être mis en question à l'occasion de la découverte d'autres valeurs morales et d'autres régulations sociales. L'éthique formelle, quant à elle, "transcende les morales historiques en ce sens qu'elle désigne au cur de celles-ci l'intentionnalité éthique en sa radicalité. Toute morale historique donne contenu à l'éthique formelle, et celle-ci à son tour est la seule à même de découvrir "la racine de l'attitude morale" indépendamment de tout relativisme".
Si l'éthique formelle est nécessaire, elle doit néanmoins éviter les deux pièges de l'indétermination si elle reste vide de contenu ou de la surdétermination si elle absolutise des propositions particulières. Entre ces deux pôles s'esquisse une troisième voie que nous pouvons caractériser à trois niveaux : la discussion, la personne et le consentement au donné. Autant de critères proposés par l'éthique formelle à l'adhésion des morales historiques. L'appel à la discussion est le fait de l'éthique formelle, dont l'exigence interne ne peut s'accommoder de la "pression" qu'exerce toute morale concrète : il faut que puisse s'engager un dialogue susceptible d'acheminer vers la vérité tout en évitant que celle-ci devienne tyrannique. Habermas le père de l'éthique de la discussion nous l'a insinuée et on ne peut pas se voiler la face de constater qu'elle peine à intégrer notre horizon social. C'est pourtant la condition de suivie. Le dialogue des cultures doit s'exercer entre des personnes qui ne sont jamais seulement le moyen d'un dialogue hypostasié, mais qui ont droit au respect, et dont la fin selon laquelle il faut les traiter est leur capacité à agir librement et rationnellement entendu raisonnablement. C'est le sens éthique vers lequel nous oriente le Coronavirus. Ce tournant est incontournable au moment où nous écrivons puisque la problématique de laquelle furent déduites jusque-là les valeurs éthiques est devenue elle-même vieillotte à la limite absurde. Le 03 Avril dernier, RFI analyse l'impact géopolitique de Coronavirus en termes de chute de l'Occident :
" Alors que 169 pays sont touchés par le Coronavirus sur tous les continents, la plus grande surprise aux yeux du monde est l'effondrement de l'occident. Personne aussi bien les habitants des pays occidentaux eux-mêmes que ceux du monde émergents ou en voie de développement, personne n'aurait pu croire possible il y a seulement quelques semaines les scènes auxquelles on assiste actuellement dans le Nord de l'Italie, l'est de la France ou encore les hôpitaux de New York. Mais il s'agit d'un phénomène sans précédent mais pas tout à fait inattendu après plusieurs alertes d'épidémies biologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins ils le montrent quotidiennement des systèmes de santé sophistiqués des hôpitaux de classes internationales. Et pourtant ils ont été bousculés par l'arrivée du Covid 19 pénurie de masques et d'équipements de protection, tests impossibles parce que l'industrie pharmaceutique a été délocalisée, des cafouillages dans les prises de décision malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt et une impossible coordination internationale même en Europe où elle semblait naturelle. L'Occident est tombé de son piédestal, la suprématie qui reposait en parie sur l'image de société performante, technologie avancée et de gouvernement plus transparent qu'ailleurs en a pris un coup. Après la vielle Europe, ce sont les Etats-Unis qui gagné à leur tour par la course folle du virus révèlent au grand jour le dysfonctionnement de l'administration Trump, au lieu de leadership, l'Amérique de Trump a d'abord choisi le déni puis le repli national et elle compte ses masques comme n'importe quel pays au monde qui découvre ses vulnérabilités et ses impasses".
La première leçon de Coronavirus est de penser désormais le monde dans l'oubli de l'Occident. On le comprend, l'oubli n'est pas l'a-ban-don. L'Occident n'est pas un lieu d'être c'est ce qui jusque-là a servi d'horizon à l'esprit de notre pensée. Dans Gbèto et Gbèdoto Jacob Agossou, théologien, anthropologue et philosophe béninois précise :
"Il faut tirer au clair l'ambiguïté dont sont chargés les termes''occidental'' et''occidentalisé''et reconnaitre ce qui, dans l'occidental, est commun parce qu'universellement humain d'une part et de l'autre ce qui est marqué du cachet occidental ; nous voulons parler de cette tournure d'esprit, de cette tendance plus ou moins accentuée, caractéristique de l'homme de cette partie du monde que l'on appelle l'Occident. C'est à ce niveau que se situe l'originalité propre à chaque peuple".
L'originalité propre de l'homme occidental est donc ce qui jusque-là a servi de mesure à l'homme, le confinement de l'humain dans le Res Cogitans à telle enseigne qu'on s'oublie en se croyant occidental et on s'ignore de ne pas en reconnaître l'influence voire l'hégémonie depuis l'avènement de ce que nous avons appelé Modernité. Or, l'humain, à en croire le dénominateur commun des hommes, n'est pas parce qu'il pense (cogito) mais c'est parce qu'il est, que la pensée devient sa possibilité d'être. Il ne saurait en être autrement puisque c'est la pensée qui nous fait être : "Ich bin also denke ich". La crise de l'humain qui jusque-là s'est reçu du Cogito est sans précédant puisqu'il s'agit d'une substitution de la réalité humaine au fantasme de l'esprit. L'esprit, s'il est humain est enclin à l'imagination ; sa seule possibilité d'ailleurs. On parle du pouvoir de l'entendement humain. La raison ne s'élucide comme raison humaine que lorsque l'entendement se combine avec l'intuition pour laisser apparaître une troisième faculté, l'imagination qui en réalité n'est pas distincte des deux autres, l'entendement et la sensibilité (l'intuition). C'est alors qu'on parle du pouvoir de l'entendement humain, le lieu d'où proviennent toute connaissance y compris et en premier de l'humain lui-même. D'où la sensibilité n'est plus un ajout conditionnel à la raison discursive ; elle y est intégrée.
En conséquence, on appréhende le caractère bien fini de la raison humaine grâce auquel on peut parvenir au seuil de la résolution complexe des problèmes connexes de la métaphysique et de la raison. C'est là qu'on découvre que toute connaissance se fonde à partir du sujet connaissant. Ceci nous permet d'illustrer la possibilité de connaissance de la finitude pour rendre explicite "la raison sensible pure". Il en résulte que la raison humaine en dehors du confinement dans lequel le Cogito l'a jusque-là maintenue "peut aller au-delà de ses possibilités pour peu qu'elle franchisse le seuil de la sensibilité". C'est ici que le pouvoir de l'entendement humain s'énonce en termes d'imagination transcendantale. Aucune connaissance ne tombe du ciel et n'est inscrite dans le marbre. Elle est conditionnée par l'être humain qui l'engendre. C'est à cette révolution dans l'ordre de la connaissance que la pensée en Afrique doit souscrire en introduction la sensibilité, dont le mode de connaissance jusque-là a été arbitrairement supposé comme infection à la rationalité, au cur même de l'entendement. C'est notre thèse et nous la défendons dans nos écrits montrons que le Cogito est un raccourci intellectuel qui refuse d'assumer la finitude humaine, refus contre lequel Pascal, le Père des Pensées n'a pas manqué d'éveiller : "L'homme est un roseau un roseau pensant ; mais le plus faible des roseaux". C'est surmonter des siècles d'illusions que de revenir à la faveur du Covid 19 à la réalité de notre finitude originaire comme "retour au commencement de toute pensée, la finitude qui contrarie l'existence à être sereinement vécue.
4- RETOUR AU COMMENCEMENT : LA SERENITE
"Les grandes civilisations naissent dans la décadence.
Elles surgissent de la ruine des anciennes et fleurissent par leur cendre"
La crise est mondiale on le sait. Mais la solution doit rester régionale. Car il s'agit d'un "retour à soi", au "soi humain tout court" sans provincialisme et loin de tout déni de soi. L'Occident le sait désormais l'Afrique doit en prendre conscience immédiatement. Car le Coronavirus n'est qu'une descente dans l'abime à peine ébauchée. On ne s'en sortira pas en évitant l'abîme où nous sommes plongés. A la question de savoir si cette situation (Coronavirus) laissera des traces durables, Pierre Hashi, l'Invité de l'émission du 03 Avril sur Rfi, citée plus haut répond :
"Elle a déjà un impact d'abord parce que d'autres puissances se sont déjà engouffrés dans le vide laissé par un Occident en état d'incinération. Très durement touchée, l'Italie reçoit une aide médicale de la Chine, de la Russie et même de Cuba et cette aide contraste cruellement avec la capacité de l'Europe à lui porter assistance. Ça laissera des traces évidemment. Tout se passe comme si le déclin de l'Occident comme un ensemble cohérent qui a surmonté avec succès le début de la guerre froide et créé des normes qui se sont diffusées dans le monde était aujourd'hui visible à l'il nu et plus encore qu'avec son éclipse au Moyen-Orient. Les chinois se sont passionnés il y a quelques années pour les études sur les déclins des grands empires pour y trouver quelques signes de l'affaiblissement de celui qui a dominé le 20ème siècle. Ils risquent de voir dans ce virus pourtant parti de chez eux et qu'ils ont initialement caché au monde le signe que l'erreur est arrivée. C'est en tout cas le sens du tapis de propagandes en provenance de Pékin. Il est évidemment trop tôt pour prédire à quel rythme et dans quel état nous sortirons de cette crise et quelle leçon les occidentaux en tireront. L'une de celle-ci néanmoins devrait en être l'humilité, descendre de son piédestal peut avoir des vertus à condition de reconnaître qu'une page d'histoire se tourne".
Et une nouvelle s'ouvre bien évidemment. Nous n'hésiterons pas à l'appeler celle de l'Aufklärung africaine. On adhèrera à ce concept si et seulement en analysant à fond et avec sérénité intellectuelle le texte ci-dessus on y perçoit que le Cogito occidental a trahi l'humanité. C'est pourtant de ce désir "d'être maitre et possesseur" qu'on s'est reçu jusque-là" au fondement d'une anthropologie devenue refus de soi. L'intervenant vers la fin ramène à la porte de sortie : "L'une des solutions néanmoins devrait en être l'humilité, descendre de son piédestal peut avoir des vertus". La vertu du siècle la finitude, celle de notre-être-au-monde et celle que nous sommes ontologiquement et qui ne peut être appréhendée qu'en s'éveillant du "sommeil anthropologique" (Michel Foucault) dans lequel le Cogito a plongé l'humanité depuis son invention au 17ème siècle seulement. L'humilité en assume le sens dans la mesure où la racine commune de l'Anthropos (né de la terre) et de l'humanitas (humanisme) reste l'humus, ce dont l'humain est originairement pétri et qui dit tout son être. On le dit mieux dans une perspective chrétienne qui aussi a à apprendre d'elle-même en ce temps de crise : " Souviens-toi que tu es poussière et tu redeviendras poussière". Le souvenir de soi est la seule possibilité pour réaliser ce que l'on est. L'anthropologie de la méfiance et du soupçon ajoutée à la logique de concurrence qui caractérisent le béninois n'est donc pas un déni de soi à l'interne. Elle assume dramatiquement les conséquences de l'esclavage et de la colonisation pour se révéler à l'échelle planétaire comme un refus d'être. Car jusque-là, tous les humains vivent en chien de faïence.
La belle preuve, un vaccin semble être trouvé et la terre d'expérimentation est de nouveau indiquée : l'Afrique. Les plus atteints dont la population va diminuant sont en Europe. Le bon sens s'il était le sens du bon voudrait qu'avec le vaccin on s'empresse de maintenir encore en vie les populations non encore décimées au sein des peuples les plus exposés. Essoufflé au regard de l'hégémonie et de la domination impérialiste, un africain s'exclame : "Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme prières pour que le Bon Dieu ne veuille pas enfin lever la malédiction de Cham qui s'est impérialement prononcée sur notre race ?". Il n'y a pas de réponse à une telle question qui malheureusement ou justement révèle l'idée du Dieu vengeur dans laquelle végète le continent africain. Cette idée est plus du reçu que du penser. Envisagée la question du Coronavirus dans la logique du Dieu vengeur c'est n'avoir pas compris qu'une telle logique est aliénante et pire c'est se refuser d'intégrer le déplacement de sens du divin lui-même qu'assume son incarnation. A côté de l'être éternel il y a toujours un devenir être qu'on ne saurait ignorer depuis Parménide et Héraclite tout au moins.
La naïveté de l'interrogation provient cependant de l'ajout du qualificatif au divin en "Bon Dieu" qui s'est opérée dans la mentalité africaine lors de la rencontre Afrique-Occident. On se demande même si ce n'est pas dans cette pseudo-théologie que végète la foi en Afrique, toute religiosité impliquée. Les implications sont obvies dans les pastorales actuelles toutes confessions religieuses interpellées. Celles-ci, pérennisent la mentalité coloniale et l'hégémonie occidentale sans s'en rendre compte. Les plus disposées à prendre des décisions intellectuellement responsables pour sortir de la léthargie spirituelle s'en refusent au risque de bousculer leurs conforts. Il y a là à notre avis une indécision qui pourrait encore faier rater à l'Afrique son essor théologique. Car, encore une fois, il faut le rappeler avec Emmanuel Falque :
"L'Occident se meut aujourd'hui dans un monde hors de l'évidence de la foi, et c'est à partir de lui, qu'il convient maintenant de penser. D'où la juste opposition de l'âge sécularisé" (Taylor) au "Dieu déjà donné" (Thomas d'Aquin), et l'impérieuse sortie d'un "cartésianisme" quelque peu usé et tenant pour acquis l'opposition du religieux et de la rationalité".
C'est donc le moment plus que jamais de passer à une foi pensée car seule la foi pensée rend le vécu authentique. La décision pour un Islam africain ou un Christianisme africain ou encore une pratique justifiée des religions endogènes, n'est pas un luxe. C'est une nécessité qui maintient sauve la foi authentique voire la foi dans son authenticité, celle qui fait découvrir le tuilage "humain et divin". Mieux dit, il s'agit dans un engagement pastoralement théologique de " sonder les profondeurs dernières de l'âme en découvrant en elle le point mystérieux où le divin et l'humain se pénètrent". Alors seulement les religions révélées cesseront d'être vues en Afrique comme "religion des blancs" et joueraient davantage leur partition celle d'ouvrir la voie à une pastorale de la "commune humanité". Tout comme la philosophie, la religion n'a ni couleur ni nationalité. Elle est inhérente au fond même de l'esprit humain (Rudolf Otto). C'est en cela que le vu secret de toute religion reste la libération de l'être humain et la sauvegarde (assurance) de son aspiration à plus de liberté. Le Coronavirus n'aura pas assez enseigné que la religion est la vie et que toute religiosité doit se déployer dans l'ultime logique de la vie du vivant : "Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance" (Jn 10,10).
La fermeture des églises, des mosquées, des lieux de cultes divers, ne renvoient pas d'abord les croyants à eux-mêmes pour que "les vrais adorateurs de Dieu soient ceux qui l'adorent en esprit et en vérité" ; à moins que la foi jusque-là se soit limitée à une religion rituelle. Ce qui fausserait une fois encore le sens du religare. C'est parce qu'on "a" la foi qu'on en vit et qu'on peut venir la célébrer en communauté au cur d'une assemblée religieuse. D'ailleurs l'auxiliaire avoir est pauvre en contenu pour exprimer la phénoménalité de la foi. La foi authentique est une manière d'être qui se révèle à travers la "conversion transformant" du croyant notamment de celui qui a adhéré au message de foi que sa religion l'aide à sauvegarder. La foi n'est pas de l'ordre de l'avoir ou de la possession mais de l'être. Elle est donation originaire. C'est donc pour sauver l'humain que les grands rassemblements ont été suspendus. Et pour épargner ceux qui se réfugient dans la croyance institutionnelle de ne pas se retrouver naïvement dans les lieux de cultes sans précautions, ceux-ci furent fermés. Suspension ou fermeture sont des adresses à l'égard de la théo-logie, non du discours sur Dieu. Notre langage humain de part sa finitude ne peut rien prétendre dire du divin qui ne soit ce que le Dieu a révélé de lui-même. Dieu d'ailleurs n'est pas connaissable ; il reste pensable et ce en fonction de notre finitude originaire puisque Dieu ne peut venir d'ailleurs. Mais c'est le plus difficile à nous faire comprendre actuellement. Même avant Coronavirus, le problème de l'africain, ce sont ses propres Représentations reçues ou forgées comme des absolues. Vivement que la situation qui questionnent les grandes certitudes de l'humanité soit l'occasion pour l'Afrique de se questionner en interrogeant son "Imaginaire collectif" dans le souci de "penser par soi-même" et donc avec les autres.
La théo-logie peut et doit y contribuer. Pour ce faire, elle reste le discours sur la foi du croyant et pour être conséquente elle doit tenir compte du caractère fini de ce dernier. Cela, aucun pasteur n'est censé l'ignorer et la pastorale sous quelle que forme qu'on la mène doit sortir de la logique de concurrence et de séparation pour cette fois-ci embrasser l'ultime logique de l'incarnation ; celle de la vie voire de la "sauvegarde de la dignité inaliénable du fidèle". Toutes les croyances en sont concernées car c'est à la "commune humanité" qu'on s'éveille désormais. La méditation du rapport "finitude et Incarnation" pourrait servir de repense à cet nouvel horizon théologique en Afrique pour peu que celle-ci se décide à retrouver les horizons renouvelés pour l'universalité d'un christianisme catholique en situation de crise ou de pandémie. Ceci n'est pas à ignorer. Dans un esprit d'cuménisme, de dialogue interreligieux et de liberté religieux, il faut rester tout de même confessant. Le christianisme n'a jamais été en crise étant donné qu'il est une religion de crise. C'est lui qui met le monde en crise incitant ce dernier à se comprendre. Il est vrai comme le souligne Mircea Eliade :
"Nous vivons une époque où on ne peut pas éviter les rouages de l'Histoire que par un acte audacieux d'évasion. Or, l'évasion est interdite au vrai chrétien. Pour lui, il n'existe aucune autre issue : puisque l'Incarnation a eu lieu dans l'histoire, puisque la Venue du Christ marque la dernière et la plus haute manifestation de la sacralité dans le monde - le chrétien ne peut plus se sauver que dans la vie concrète, historique, la vie qui a été choisie et vécue par le Christ".
Le chrétien lui-même l'ignore ajoute Mircea Eliade car il lui est difficile de rester incarné. Pourtant il n'ignore pas ce qui l'attend : "frayeur et angoisse, sueur comme de grosses gouttes de sang, l'agonie, la tristesse jusqu'à la mort (Lc 22, 44 ; Mc 14, 34). Le moment qui passe est donc celui de la "foi authentique". Et puisque "tout concoure au bien de celui qui aime Dieu", le temps pascal et la semaine sainte qui l'ouvrent incitent à ce rapport provoquant entre Coronavirus- Existence humaine dans sa vulnérabilité et la Passion-Mort-Résurrection. La théologie doit se mettre au travail pour l'Afrique. Il en va de la catholicité de la chrétienté, un chemin d'inculturation encore inédit. De toute évidence la leçon du Coronavirus à notre vie de foi est désormais indépassable.
On l'aura d'ailleurs mieux compris dans le maintien des fidèles chrétiens à travers les réseaux sociaux et tous les moyens virtuels auxquels nous contraint les nouvelles technologies. uvres humaines, elles réconcilient le matériel et l'immatériel que nous sommes. L'être humain est numérique pendant que l'homme reste mécanique. Sortir l'homme de nos structures pour y faire entrer l'humain c'est comprendre avec Teilhard de Chardin que "l'homme est un être spirituel appelé à vivre humainement". Coronavirus enseigne à entretenir avec le numérique non plus seulement un rapport utilitariste ou mécanique mais une proximité existentielle. Stéphane Vial le suggère actuellement grâce à ses travaux en philosophie contemporaine de l'art où il montre que "le numérique est ontophanique" c'est-à-dire manifestation de l'être humain. L'Eucharistie ou toute autre forme de prière vécue via YouTube, télévision, radio etc.. a même sens que celle vécu en présentiel puisque dans l'un ou l'autre des situations il est question "du fruit de la terre et du travail des hommes" que nous présentons en offrande d'agréable odeur "pour être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité". Il faut s'en tenir désormais à cette connexion entre la "matière et la non-matière" en sachant que la structure humaine l'emporte sur les infrastructures de l'homme. On le savait mais le dualisme occidental l'a occulté. Et nous avons vite fait de végéter dans un grand folklore qui accompagne nos célébrations barrant la voie à la véritable méditation, celle de notre existence humaine qui se joue au cours de la célébration eucharistique au travers des croyances chrétiennes d'Incarnation, de Passion-Mort, de Résurrection et du Viatique eucharistique lui-même et qui sont autant de métamorphoses de la finitude. Grâce au Coronavirus, le numérique, signe de l'ingéniosité humaine va ré-concilier l'humain avec lui-même en lui faisant redécouvrit la phénoménalité de la prière et de la relation avec la transcendance hors de toute artificialité.
On le voit, penser en Afrique dans l'oubli de l'Occident n'est pas un délaissement de ce qu'on aura reçu des autres. Le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Mais au cur de l'abime comme celle qui s'abat actuellement sur nous, il faut voir la révolution qui s'impose comme une évolution qui concerne même le "Nouvel ordre mondial" qui ne peut se rétablir sans Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on ? Et dans quelle logique l'invoque-t-on ? Telle est la vraie question que croyants et non croyants doivent se poser sereinement dans un univers commun en quête de sens. L'ultime voie de réponse à l'ère des "droits de l'homme", de la laïcité et du pluralisme théologique est que la question soit traitée avec "raison et passion". La possibilité de combiner "passion et raison" pour une rationalité efficiente est à élaborer à l'aune du principe déjà énoncée, la "raison sensible pure". Il serait suicidaire que face au déclin on ne se sente pas en mesure de cette audace intellectuelle.
L'Aufklärung africaine, l'éveil qui décidera de l'avenir du continent n'a pas pour tâche d'embrasser un domaine spécifique du vivre ensemble qui serait seulement, la politique, la religion, l'éthique, l'anthropologie Elle partira de l'humain intégral le seul qui donne sens et existence à tout ce qui existe. Hors de toute logique de l'avoir, celle qui actuellement décime l'humanité, la révolution africaine doit conjuguer l'auxiliaire être. Face à l'auxiliaire être qui bascule toutes les certitudes de l'humanité dans l'évidence de l'incertitude, l'inobjectivable être humain doit s'efforcer d'être. Cette directive ne sera pas plus africaine qu'universelle. Il s'agira de rester chez soi.
"Être soi, chez soi" : Se Concentrer
La thérapie philosophique en face du Coronavirus est de repartir de notre finitude originaire. Cette finitude qui n'est pas le fini n'est pas non plus la limitation. C'est la limite existentielle qui, contre toute idée de manque, rend certaine l'évidence de l'existence. Loin du manque, la finitude est "possibilité et ouverture". Une fois le sens de la philosophie assumée non plus comme une répétition béate de pensées venues d'ailleurs alors seulement l'Africain et le monde bien évidemment comprendront qu'on "ne peut qu'être soi chez soi". Être soi chez soi, c'est habiter le monde en lieu-tenant du Rien. L'homme n'est rien, on le dit mais on ne l'a jamais intégré. Justement parce qu'il n'est pas rien du tout mais le tout de Rien (J Greisch). Le Coronavirus rappelle que nous sommes-là en face du néant non anéantissant, cette vulnérabilité originaire dont seule l'éducation favorise la compréhension et l'acception comme le suggère si bien Hannah Arendt :
"L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et de plus, pour le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre, quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun".
C'est la tâche de la pensée et de la pensée par soi-même Elle est méditation sur la condition humaine et ne commence vraiment "que lorsque nous avons éprouvé que la raison tant magnifiée depuis des siècles, est l'adversaire la plus opiniâtre de la pensée". Car la philosophie n'est qu'un moyen pour accéder à la pensée de ce que nous sommes.
Référence Bibliographique
AGOSSOU, J. Gbɛtɔ́ et Gbɛɖotɔ́''l'homme et le dieu créateur'', selon les sud-dahoméens, de la dialectique de participation vitale a une théologie anthropocentrique". 1971
FALQUE, E. Parcours d'embûches. S'expliquer. Editions franciscaines, Paris, 2016.
HEIDEGGER, M. Vom Wesen des Grundes; trad. fr. sous le titre Ce qui fait l'être- essentiel d'un fondement ou raison, in Questions I, Paris, Gallimard, 1968, p. 158.
OLIVIER, D. Finitude et transcendance. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530
TAMINIAUX, J. Lectures de l'ontologie fondamentale. Essais sur Heidegger, Grenoble, Millon, 1989, p. 13.
Roland TECHOU, "Raison sensible pure" pour comprendre la phénoménologie de Martin Heidegger, Eme, Bruxelles, 2020.
-, Phénoménologie du transcendant, essai sur l'analytique de la finitude humaine, Flamboyant, Cotonou, 2018.
Notes :
Cf. O. DEPRE, Finitude et transcendance. In : Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530.
A. Van REETH, Penser la crise avec Hannah Arendt, dans émission France culture du 3 Avril 2020.
M. HEIDEGGER, Vom Wesen des Grundes ; trad. fr. sous le titre Ce qui fait l'être- essentiel d'un fondement ou raison, in Questions I, Paris, Gallimard, 1968, p. 158.
J. TAMINIAUX, Lectures de l'ontologie fondamentale. Essais sur Heidegger, Grenoble, Millon, 1989, p. 13.
Document conciliaire Gaudium Spes, n°18.
P. NEXEUX, Roger-Pol Droit, Le confinement est une expérience philosophique gigantesque, dans France culture du 30 Mars, 2020.
Idem.
R. TECHOU, "Raison sensible pure" pour comprendre la phénoménologie de Martin Heidegger, Eme, Bruxelles, 2020.
P. NEXEUX, Roger-Pol Droit, Le confinement est une expérience philosophique gigantesque, dans France culture du 30 Mars, 2020.
Idem.
Cf. O. DEPRE, Finitude et transcendance. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530.
Cf. O. DEPRE, Finitude et transcendance. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530.
R. TECHOU, "Paulin Hountondji et le tournant conceptuel de la philosophie africaine". Article inédit.
O. Depré, Finitude et transcendance. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530.
Idem.
Idem.
Idem.
Cf. O. DEPRE, Finitude et transcendance. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 87, n°75, 1989. pp. 516-530.
P. HASHI interviewé par Nicolas, sur RFL le 03 Avril 2020.
J. AGOSSOU, Gbɛtɔ́ et Gbɛɖotɔ́''l'homme et le dieu créateur'', selon les sud-dahoméens, de la dialectique de participation vitale a une théologie anthropocentrique". 1971.
Cf. R. TECHOU, Phénoménologie du transcendant, essai sur l'analytique de la finitude humaine, Flamboyant, Cotonou, 2018.
R. TECHOU, "Heidegger et la nouvelle tonalité affective de l'être humain", Revue Respeth, Abidjan, 2019.
E. FALQUE, Parcours d'embûches. S'expliquer. Editions franciscaines, Paris, 2016, p.102..
A. JUNDT, traducteur de Rudolph Otto, Le Sacré, Payot, 2001.
M. ELIADE, Mythes, rêves, mystères, Gallimard, Paris, 1957, p. 191.
Formule d'offertoire.
A. Van REETH, Penser la crise avec Hannah Arendt, dans émission Franc culture du 3 Avril 2020.
M. HEIDEGGER, Chemins qui ne mènent nulle part. p. 322
L'a priori factuel : Lecture phénoménologique de la "Critique de la Raison pure"
"Jusqu'ici on admettait que toute notre connaissance devait se régler sur les objets ; mais, dans cette hypothèse, tous les efforts tentés pour établir sur eux quelque jugement a priori par concepts, ce qui aurait accru notre connaissance, n'aboutissaient à rien. Que l'on essaie donc enfin de voir si nous ne serons pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que les objets doivent se régler sur notre connaissance, ce qui s'accorde déjà mieux avec la possibilité désirée d'une connaissance a priori".
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, 1ère Edition, 1781 (A), §§10 et 11.
RESUME
S'il y a un penseur qui connaît Kant plus que Kant lui-même ne se connaît, c'est bien Martin Heidegger. Dans le présent article nous voulons donner une lecture phénoménologique de la philosophie transcendantale présentée par le penseur du sens de l'être. L'enjeu de lecture est la détermination de l'a priori. Le philosophe de Königsberg entend par a priori, toute connaissance objective indépendamment de l'expérience. Elle s'oppose de fait à l'a posteriori qui s'est de fondement à tout ce qui est empirique. L'apriori s'opposant ainsi à l'expérimentable réfute toute factualité. Déjà chez Descartes qui en aura fait un large usage hérité des médiévaux chez qui l'apriori fit école comme essence substantielle du connaissable, la notion est à comprendre comme un rapport de cause à effet au sens leibnizien. De l'apriori on déduit la preuve de l'évidence de la réalité parce que ce qui est causé produit ses effets. L'essence est déduite de l'existence. C'est en ce sens que Descartes en est arrivé à déterminer à partir de l'a priori l'existence de Dieu.
Mots clés : Critique-Métaphysique-"Raison pure sensible"-Ontologie fondamentale- a priori- Connaissance - Schème- transcendantal.
Introduction
En sortant toute connaissance du rapport dualiste muable et immuable, sujet et objet, Heidegger s'inscrit dans la ligne kantienne de l'apriori, mais à la différence que pour l'ontologie fondamentale, la "chose en soi" est connaissance. L'en-soi est inhérent à l'expérience et le fonde comme telle. Dans ce contexte, l'a priori qui fonde toute connaissance ne détermine plus simplement une connaissance théorique mais est empirique parce qu'il ne peut y avoir de connaissance qui ne soit de l'ordre de l'expérience. L'uvre de 1929, Kant et le problème de la métaphysique en supposant la Critique de la raison pure comme "Raison sensible pure" relance le questionnent du jugement à la fois synthétique et analytique comme conception de l'apriori en a priori factuel. En nous y intéressant il nous faut expliciter la problématique heideggérienne selon laquelle il n'y a de connaissance qu'une précompréhension : toute connaissance ontique est une connaissance ontologique.
Dans une première approche nous posons le problème de la connaissance métaphysique comme une ontologie phénoménologique (1). Nous analyserons par la suite ce fondement phénoménologique tel que présent dans la Critique de la raison pure (2) de façon à en déduire qu'avec Heidegger la question de la connaissance ne se pose pas en termes de "Que puis-je connaitre ?" mais plutôt "Comment savons-nous que nous savons quelque chose ?". (3). C'est là que le pouvoir de toute connaissance que réalise l'imagination transcendantale s'impose aprioriquement comme connaissance du suprasensible factuellement fondé.
I- Le problème de la connaissance métaphysique
Kant lui-même voulut refonder la métaphysique. Ce fut le projet qu'il fit porter à la Critique de la raison pure, celui d'une re-fondation de la métaphysique comme science. L'hypothèse heideggérienne de lecture qui part d'une explicitation de la thématique même de : "Critique de la raison pure" atteste que pour Kant "la philosophie est essentiellement métaphysique". Il s'ensuit que "La critique de la raison pure" n'est rien d'autre que la refondation (Grundlegung) de la métaphysique comme science, et ainsi de la "philosophie pure" en général. "Critique de la raison pure" veut dire : refondation de la métaphysique en science". Qu'est-ce en réalité la métaphysique et pourquoi la refondation de celle-ci doit nécessiter une "critique de la raison", alors que celle-ci est la faculté censée fondée toute connaissance ?
1-1- La métaphysique en question
Considérant que le thème de métaphysique, qui fut donné à un ensemble de livres d'Aristote n'est qu'une simple uvre de "Bibliothécaire", Heidegger tranche en faveur de l'unité de ces uvres. Il distingue en fonction de leur contenu, celles qui posent la question du fondement ultime de l'étant et qui chez Aristote lui-même portait le nom de théologie, celles qui avaient pour axe de recherche le tout de l'étant en tant qu'étant (l'être de l'étant) que Aristote nommait philosophie première. A travers l'objectif commun de ces deux disciplines (la philosophie première et la théologie) "de dépasser l'étant donné dans l'expérience", une quête de l'étant comme étant, elles en sont arrivées à "transgresser" la signification "méta" à laquelle le concept bibliothécaire les assignait : "Il ne veut plus dire post, c'est-à-dire postérieur dans une séquence d'écrits, mais trans, c'est-à-dire en dépassement de ce que considère la physique".
Ayant ambitionné de rechercher un étant qui dépasse le "physique", l'expérience sensible, la métaphysique est devenue "la science du suprasensible". Kant répond bien à cette approche puisqu'il notifie que "la métaphysique traite donc du suprasensible- de l'étant qui n'est pas accessible à l'expérience, cet étant intramondain qui est au centre de tout questionnement, à savoir l'homme lui-même, et ce qui en lui ne peut pas être expérimenté : de Dieu, de la totalité du monde et de l'âme". Cet ensemble, formé par les sciences rationnelles comme Dieu, la totalité du monde et l'âme, traite respectivement de la théologie philosophique, de la cosmologie et de la psychologie. Ce sont des sciences par raison. Elles relèvent d'une métaphysique spéciale qui reste distincte de la métaphysique générale, celle qui traite de l'étant en générale : l'ens in communi (l'étantité) et qui se retrouve aussi dans la collection des uvres d'Aristote traitant de l'étant comme étant : l'ens inquantum ens.
Mais l'ensemble fut élaboré jusqu'à Kant comme une théologie rationnelle notamment au Moyen-âge. Et l'enseignement qu'a donné Kant lui-même de la métaphysique visait à une métaphysique comme "science des principes de l'étant et non pas des principes de la connaissance". Il reste évident pour Heidegger que la métaphysique a toujours eu pour viser de rechercher ce qui fait l'étant en général non pas "le pouvoir de connaitre mais ce qui est connaissance et connu par raison pure par l'homme, à savoir l'étant". Mais la connaissance de cet étant doit aussi s'exclure désormais de l'élan d'une métaphysique de la subjectivité au risque d'une objectivation de l'étantité. Cette tâche que se donne l'ontologie fondamentale fait appréhender dès lors la métaphysique comme le dynamisme existential que déploie l'existence humaine en s'opposant à toutes barrières à l'être. Dans cet horizon de l'être, l'étant métaphysique ne recouvre son sens qu'à partir du passage au-delà (de l'étant) vers le rien où la connaissance métaphysique devient authentifiée. Elle serait passée alors d'une science du suprasensible à une possibilité de transgression accordée à l'étant en mesure de trans-gresser son état présent ; d'aller au-delà des possibilités à lui supposées. Il serait lui-même la méta-physique. Qu'en est-il alors du fondement de la connaissance et dans quelle mesure toute connaissance métaphysique est une ontologie phénoménologique.
1-2-La philosophie transcendantale comme ontologie fondamentale
Seul celui qui est en mesure de créer un objet détient une capacité de connaitre. Le pouvoir de la raison humaine est de créer le cadre d'accueil favorable à l'expérience de l'objet reçu, du phénomène. Cette limite de l'intuition réceptive et incapable de créer est une finitude à double impuissance : celle de ne pouvoir pas connaitre les choses en soi et celle de ne pouvoir pas créer l'être des objets. Heidegger pense avoir entrepris "la présente interprétation de la Critique de la raison pure afin de mettre en lumière la nécessité, pour l'instauration du fondement de la métaphysique, de poser le problème fondamental de la finitude dans l'homme". C'est pour dépasser cette conception kantienne de la finitude et en fait l'enjeu déterminant voire le questionnement ultime au sens de questionnement capital. La finitude s'éveille, non plus comme simple mode de définition de l'homme, mais comme l'être même de l'homme
L'interprétation de Heidegger part de la première édition divisée en deux parties principales : la Doctrine transcendantale des Eléments et la Doctrine transcendantale de la Méthode. La première partie est axée sur la connaissance pure a priori. En tant que doctrine des Eléments, elle est dite transcendantale parce qu'elle traite de la "pièce fondamentale de toute connaissance de l'étant". Il s'agit de ce qui rend possible la détermination ontologique de l'ontique. Cette même première partie est aussi subdivisée en Esthétique transcendantale et la Logique transcendantale. L'Esthétique transcendantale prend en compte l'analytique de l'Espace et du Temps. La Logique de son côté, deuxième partie de la Doctrine des Eléments se subdivise en Analytique transcendantale et en Dialectique transcendantale.
La lecture de Heidegger s'appuie sur le "Schématisme transcendantal" dans lequel il trouve toutes les justifications de sa problématique et qui d'ailleurs n'aurait pas été retouchée par Kant lors de la deuxième édition de la critique de 1787. L'Esthétique transcendantale, qui accorde la préséance au temps et à l'espace, s'impose par sa "signification autonome et centrale dans le tout de la critique, c'est-à-dire dans le tout du problème de la connaissance ontologique ou de la métaphysique". Si Heidegger s'y accroche plus qu'à la Logique et ce contre l'option interprétative de l'école de Marbourg, ce n'est pas parce que la Logique de laquelle découle les catégories de la pensée n'est pas le centre de la Critique. Elle l'est comme le confirme Paul Natorp (Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften) mais non pas en tant que Logique précise Heidegger. Kant en effet n'y traite pas seulement de la pensée mais aussi de l'usage de la connaissance tout entier. Que la Logique implique alors aussi l'intuition pensante, atteste que, ni Esthétique ni Logique ne forment le tout de la Critique mais qu'en tenant chacune dans l'autonomie de son élaboration, devrait être trouvé un principe d'unité qui soit le fondement originaire de la philosophie transcendantale.
La recherche de ce fondement-originaire qui a échappé à Kant lui-même et qui est resté jusque-là la cause des contre-sens de son entreprise est la tâche principale que s'assigne la présente interprétation phénoménologique. Le problème qui se pose est donc celui de la connaissance philosophique. Loin d'être une remise en cause de la philosophie transcendantale l'entreprise heideggérienne aura contribué à montrer que transcendance et métaphysique vont de pair à la seule condition que toutes deux débouchent sur une "ontologie fondamentale" voire une phénoménologie ontologique. Quels en seraient les enjeux pour la connaissance philosophique ?
1-3- L'ontologie phénoménologique
Par là il faut comprendre que la métaphysique "vise l'étant dans sa totalité et parle de l'Être". Dans la démarche de toute métaphysique, c'est l'Être qui est déterminé comme "propriété commune à tous les étants qui, dès lors, deviennent identiques en leur fond par la présence de cette propriété commune". Il est ainsi représenté comme le "ce que" général et universel suscite chaque étant et lui sert de fondement. Ainsi, la métaphysique identifie l'être avec l'être-étant des étants (étantité) allant jusqu'à l'oubli de la différence ontico-ontologique dans son assimilation de l'ontique à l'ontologique. Dans cette supposition de l'Être celui-ci est ontiquement réduit à des représentations qui oublient qu'il n'est rien d'étant. Sitôt qu'il est représenté à la base de tout étant comme fondatif "Grund", l'être doit se dédoubler nécessairement vers l'ultime sommité qui le réalise pour échapper à toute objectivation de l'étantité. De Platon (le Bien ou l'Un) à Thomas d'Aquin (l'absolu, l'ens increatum) en passant par Aristote (le divin) et Leibniz (archè, telos), on a assisté à son assimilation à un étant en premier constitué comme causa prima et ultima ratio. La critique heideggérienne à ce sujet est connue. Sous ce "trait fondamental", on assiste à "une onto-théo-logie , une pensée qui partout approfondit l'étant comme tel et le fonde en raison dans le Tout, à partir de l'être comme fond (logos)". Par cette logique qui suppose l'être comme fond, et donc comme la "causa prima", jusqu'à en fait "l'ultima ratio", l'être de l'étant n'a pu être nommé que comme causa sui, barrant la voix à toute démarche vers le fond pour se substituer à la métaphysique de Dieu. Foncièrement alors la métaphysique au lieu de précéder la théologie en aura accidentellement procédé. L'être de l'étant, ainsi rapporté, la métaphysique devient "une technique d'explication par les causes ultimes". L'ambition qui s'ensuit et qui consiste en un désir de maitriser la vérité va dégrader toute connaissance métaphysique laissant droit à un "anthropocentrisme viscérale qui passe par une certitude de soi, de la présence à soi à laquelle se mesure finalement l'ensemble du monde". La métaphysique dégradée dans son ontologie ne dé-livre qu'une connaissance étriquée de la réalité, celle de la raison pure considérée comme pouvoir de domination "Grund". C'est là qu'apparait la totalité d'une logique close où la mêmété s'installe au profit de la métaphysique de la présence qui craignant toute différence s'érige contre la mort.
Pour en revenir à fonder la connaissance à partir de la métaphysique, il faut tenir compte de l'être de l'étant en considérant en premier que toute métaphysique, qu'elle soit generalis ou specialis, doit se réaliser comme metaphysica naturalis. Entendu que c'est le Dasein figure métaphysique par excellence qui réalise l'ontologie de toute métaphysique. C'est là que s'atteste la "différence ontologique", celle de l'être et de l'étant grâce à laquelle devient manifeste l'oubli oublié de l'enjeu de toute métaphysique. Dans la figure ontologique du Dasein métaphysique, "ce qui est" et que l'être est, atteste de "l'être que l'étant est". Nous n'allons pas établir cette métaphysique du Dasein dans sa possibilité d'énoncer la finitude de toute connaissance métaphysique. Mais nous allons identifier par la suite comment doit s'énoncer, dès lors que la métaphysique est ramenée à son socle, celui d'être une préoccupation de l'être de l'étant, une connaissance métaphysique phénoménologique.
II- La connaissance en phénoménologie
La métaphysique comme nous venons de le voir est née comme science ontique parce qu'elle traite du "Ov". Le nom d'ontologie qui lui sera attribué à partir de Descartes n'affaiblit nullement l'objet qui reste l'étant suprasensible. Ce qui fait que l'ontologie traditionnelle reste aussi une science ontique puisqu'elle traite de l'étant général même si elle aboutit à des obscurcissements sur l'être de l'étant. En clarifiant le concept d'ontologie Kant repensait à nouveaux frais la métaphysique. Sa réforme qui maintient la métaphysique comme "science ontique de l'étant suprasensible" énonce la métaphysique non pas comme une connaissance par l'expérience mais comme une connaissance par la raison et qui transgresse le sensible pour chercher à atteindre le non-sensible. Il n'est plus seulement question du suprasensible mais de cet au-delà du sensible dont l'ontologie aussi reste préoccupée.
2-1- Ontologie et Ontologie fondamentale
En posant le problème en direction de l'ontologie métaphysique traditionnelle Heidegger entend nettement se démarquer de toute ontologie dont on pense à tort que l'ontologie fondamentale serait tributaire. Or, la métaphysique aussi bien que la philosophie transcendantale exige de transgresser ce qui est "physique". D'où la dynamique fondamentale de toute métaphysique est l'horizon ontologique. Ce qui la maintient comme une question, comme tente de l'exprimer Être et temps dont les première lignes, qui évoquent une "métaphysique du Dasein" n'auront d'intérêt que pour l'article partitif "du" en vue d'une métaphysique en l'homme pour atteindre l'essentiel en l'homme c'est-à-dire la transcendance du Dasein.
Mais l'impossibilité à trancher par l'affirmatif ou par la négative le questionnement sur le mode de connaissance du connaissable a laissé dégénérer toute la métaphysique dans une dogmatique (théorico-dogmatique) où la possibilité même de sa connaissance ne fut plus envisageable. La critique ontothéologie brièvement évoquée ci-dessus le confirme. La reforme kantienne consiste alors à repartir de cette métaphysique traditionnelle (classique), à rechercher le point de départ à partir duquel la raison -qui reste le critérium - fait redécouvrir à la métaphysique sa possibilité qui devra la constituer comme "die eigentliche Metaphysika". C'est à ce "retour au fondement de la métaphysique" opéré par Kant que Heidegger applique une "vue phénoménologique" notamment à ce que "science" pourrait dire et " à comment la ré-fondation d'une science reste possible". La démarche n'est rien d'autre qu'une interprétation phénoménologique de l'essence de la science. Elle aboutit à la connaissance ontologique comme préexistante à toute connaissance ontique. Car elle se pose comme intuition dans la dimension originaire de l'espace et du temps qui restent des concepts de l'entendement fini. S'impose dorénavant l'analyse des facultés de la raison comme des facultés finies par lesquelles seulement la connaissance est possible. Cette possibilité qui outrepasse la métaphysique classique reste la métaphysique du Dasein et donc atteint le projet de l'ontologie fondamentale : celui de constituer le Dasein métaphysiquement. Or constituer le Dasein métaphysiquement c'est le reconstituer en tant qu'il est "la chose" à connaître qui se pose la question de sa connaissance. La métaphysique est une science, celle du sujet qui se pose la question de sa possibilité de connaître ; elle est le sujet connaissant lui-même.
C'est pourquoi la connaissance synthétique a priori ne peut être de l'ordre de la métaphysique théorique. Elle devient impossible comme science théorique du suprasensible et se constitue plutôt comme une science suprasensible du sensible. Il s'agit avant tout du fait que le champ de la connaissance de l'étant est un champ réduit. La raison pure étant limitée dans ses possibilités d'atteindre la connaissance, la "Critique" consiste aussi à consigner à la métaphysique les limites qui sont les siennes. La refondation envisagée atteste de l'inaccessibilité de toute connaissance théorique a priori c'est-à-dire de toute connaissance ontologique. Cette apparente impossibilité fait découvrir à la métaphysique théorico-dogmatique ses bornes en même temps qu'elle rend évidente la métaphysique comme pratico-dogmatique.
Dès lors, le sens de la Critique de la raison pure est de redonner une signification à toute la métaphysique comme Kant l'explicite dans la Doctrine transcendantale de la Méthode. Il en ressort une philosophie de la raison pure qui se veut la métaphysique parce que la Critique de la raison pure n'est qu'une "propédeutique qui examine le pouvoir de la raison par rapport à toute connaissance philosophique". La métaphysique se voit même délimitée comme système à la fois spéculative et pratique dont la tâche est de "présenter toute connaissance pure a priori en son unité systématique". A la partie théorique Heidegger rapporte la connaissance de l'étant sous-la-main c'est-à-dire la métaphysique de la nature montrant que la métaphysique de l'étant "en tant qu'il est" est la métaphysique de la nature. Cette nature formelle (physique) reste le fondement de la philosophie transcendantale ou l'ontologie à laquelle Kant assimile la métaphysique de la nature en ce sens que par nature, il identifie un domaine précis de l'étant sous-la-main (Vorhandenheit). Ainsi pré-ordonnée à toute la métaphysique, la critique au-delà d'une simple théorie de la connaissance des sciences est "la re-fondation de la discipline fondamentale de la métaphysique, la re-fondation de la philosophie transcendantale, c'est-à-dire de l'ontologie, de la science de la constitution d'être de l'étant en général, de la nature au sens formel". L'entreprise kantienne à sa base est porteuse de la fondation d'une ontologie universelle de l'étant sous-la-main. Elle ne saurait dans aucun cas être comprise comme une théorie de la connaissance de la science mathématique. Car son objet n'est pas une ontologie de la nature matérielle mais "l'étant sous-la-main en général". Or un tel étant reste ontologiquement prédéterminé de façon à montrer qu'au sujet de la connaissance de l'étant, l'ontologique précède l'ontique.
2-2- De la métaphysique comme science suprasensible du sensible
La possibilité kantienne de déterminer le fondement préalable par lequel les concepts d'entendement peuvent s'accorder à des objets sans que le fondement ne provienne de l'expérience, s'est instituée comme une philosophie transcendantale. L'objectif de cette philosophie transcendantale fut "la détermination ontologique d'un domaine ou de tous les domaines de l'étant (Ontologie régionale)". La philosophie transcendantale apparait ainsi comme une ontologie et qui se donne pour tâche de repenser l'ontologie traditionnelle.
Or la "critique" mise en uvre pour sonder la possibilité des jugements synthétiques se pose comme la méthode grâce à laquelle la re-fondation de la science de l'étant en général est possible. Elle se pose comme la pièce maitresse de l'entreprise de la refondation en ce sens que c'est par elle que se réalise la connaissance synthétique a priori. Par l'instauration de sa critique Kant secoue l'ontologie métaphysique traditionnelle pour la redynamiser comme le nouveau commencement métaphysique qui ouvre au questionnement jusque-là délaissé à savoir la question du sens de l'être. C'est ce à quoi Heidegger limite la "Critique" qui pour lui reste un traité de la méthode, un traité de l'élaboration de la connaissance synthétique a priori. Il cherche dès lors à comprendre pourquoi "cette refondation de la connaissance aux fins de la métaphysique devrait constituer à faire de la raison un tribunal qui assigne à la métaphysique ses limites propres" Autrement dit, pourquoi recourir à une critique de la raison (la faculté métaphysique elle-même) pour assigner à l'entreprise métaphysique qu'elle déploie des limites qui la ramène à une compréhension de soi ?
La réponse apparaît dans Kant et le problème de la métaphysique soit en 1929, uvre dont l'Interprétation phénoménologique de Kant est la propédeutique la plus éloquente. Le Kantbuch non seulement ouvre le débat Phénoménologie et Métaphysique mais il suggère thématiquement un au-delà de la philosophie transcendantale sous la catégorie aprioritique de la "Raison sensible pure". Dans cette vision temporalisante de toute connaissance, l'imagination transcendantale est saisie comme le pôle unitaire de toute connaissance où sont fondés le temps et l'être comme horizon fini de toute métaphysique.
Dans le § 29 notamment il rapporte l'entendement à la finitude, jusque-là exempté par les critiques kantiennes de toute finitude parce que spontanée. Pour Heidegger, la spontanéité de l'entendement est aussi une marque de l'imagination transcendantale qui le rapporte à la finitude. Et le fait même que l'entendement se rapporte à la finitude reste fondamental pour la connaissance en même tant que la relation sort la finitude de sa connotation négative. L'entendement puisqu'il est structurellement synthétique, reste nécessairement fini. De lui on peut tout tirer comme on le dit de l'entendement divin qui est analytique. Comment l'entendement se fonde-t-il alors dans l'imagination ?
L'entendement est la faculté des sens et l'imagination faculté sensible. L'imagination est inférieure à l'entendement et par conséquent ne saurait le fonder. Heidegger en surmontant cette objection dès le début du §29, rejette toute distinction entre supérieur et inférieur puisqu'il est question d'ontologie et non d'empirisme. Le fait que le sensible soit affecté d'infériorité lui vient de l'extérieur et non de son essence. Or, dans la mesure où la finitude et la sensibilité elle-même sont désormais définies comme non empiriques, leur réceptivité devient pure. Ce n'est plus les sens qui provoquent la sensibilité mais c'est par le fait que les sens sont finis qu'ils sont affectés. Il s'agit alors d'une sensibilité pure qui ne saurait être considérée comme inférieure tout comme l'imagination transcendante quoique liée à la sensibilité. Comment l'entendement se déduit-il alors de l'imagination ? La réponse vient du fait que "la pensée et l'intuition, quoique distinctes, ne sont point séparées l'une de l'autre comme deux choses de nature absolument différente". Ce qui maintient l'objection qu'il n'est pas question de vouloir déduire l'un de l'autre mais de remonter à leur fondement commun, à ce qui fait d'eux des représentations. Il faut "ordonner" l'entendement à l'intuition pour comprendre que cette ordination -par laquelle l'ordre du concept rejoint l'ordre temporel- est l'être même de l'entendement. Cet "être" qui est cette ordination n'apparaît véritablement qu'à partir de cette synthèse pure de l'imagination où l'entendement tout en s'inscrivant dans l'ordre du temps ne cesse pas d'être un ordre du concept. L'entendement n'est "ce qu'il est" que dans l'imagination pure. Cependant malgré cette implication de l'entendement dans le temps, reste posée la question de sa structure transcendantale qui n'est point affectée mais demeure transcendantale parce que logique. Pour Heidegger, ce primat logique de l'entendement n'est qu'apparent. Kant part toujours de la logique non pour y fonder la réalité mais pour y comprendre la logique en elle-même. On note là une logique transcendantale qui ne traite pas des concepts entre eux mais de leur possibilité. Pour Jacques Rivelaygues "Chaque fois qu'est abordé ce problème, qui est celui de la logique transcendantale, nous remontons à l'imagination transcendantale, puisque c'est par synthèse que nous produisons ces concepts et qu'il n'y a de synthèse que par la synopsis et par le schème". Il se pose alors le problème du schème de la connaissance qui doit désormais régir toute connaissance métaphysique. A partir de quoi peut-on envisager un fondement de l'imagination posée comme source de la connaissance ? Pour y répondre il faut revenir à notre problématique de détermination de l'apriori ontologique comme fondement de toute connaissance ontique.
III- De la connaissance de l'apriori
Comment envisager une connaissance ontologique préalable à toute connaissance ontique ? La "critique de la raison" qui s'est voulue une refondation de la métaphysique en tant que science s'est préoccupée de la raison. Le problème qui s'y est posé est celui de la connaissance théorique. La Critique se préoccupe donc de la raison théorique humaine. Or à la raison Kant associe aisément l'entendement au point où raison et entendement viennent à désigner les concepts déterminants du pouvoir de penser : "penser c'est se représenter quelque chose par concept". Le concept aussi général qu'il soit demeure le principe spéculatif à partir duquel des singularités sont codifiées. La raison quant à elle reste "le pouvoir des principes" et par opposition à la sensibilité, "elle reste le pouvoir supérieur de connaitre" et "même le pouvoir de connaitre les principes de la connaissance a priori". Nous venons de voir comment la "raison sensible pure" formée par le pouvoir de l'imagination transcendantale y répond.
Pour envisager donc une connaissance ontologique préalable à toute connaissance ontique dans de tel cas, il suffit de ramener l'ordre de la connaissance à nos pensées, de régler l'objet sur notre entendement contrairement à la métaphysique traditionnelle qui posait la connaissance à partir de l'objet. Car la connaissance ontologique étant un principe de causalité, il n'y aurait aucune distinction possible entre jugements synthétiques et jugements analytiques.
3-1- De l'unité de la connaissance a priori
Par connaissance a priori, on entend une connaissance par concepts c'est-à-dire la possibilité spéculative que l'homme peut déployer indépendamment de toute expérience. Toute connaissance acquise comme telle et pour elle-même est dite connaissance a priori. Tout ce qui est rationnel relève de la connaissance a priori. La raison est en ce sens "le pouvoir des principes de la connaissance a priori" parce qu'elle est en même temps pouvoir des concepts et pouvoir des règles. Une raison est dite pure par le fait qu'elle détermine une connaissance pure exemptée de toute expérience.
La Critique visait avant tout à faire de la raison la possibilité de la connaissance théorique, c'est-à-dire de la science en général. Par raison, Kant entend le pouvoir de penser dont dispose la personne humaine qu'il assimile à l'entendement et qu'il oppose à tout empirisme. On y voit un "pouvoir supérieur de connaître" indépendamment de toute sensibilité comme il l'affirme : "Or la raison est le pouvoir qui fournit les principes de la connaissance a priori". Il s'ensuit que la raison est le pouvoir de juger des principes a priori en même temps qu'elle rend évidents sous le même rapport et concomitamment des jugements synthétiques a priori. Mais Kant définit aussi la raison comme "notre pouvoir de juger d'après des principes a priori" ; ce qui transpose la raison pure comme un pouvoir humain, c'est-à-dire un pouvoir de porter des jugements. Ces jugements, distingués selon deux ordres : jugements synthétiques et jugements analytiques, rendent possibles une compréhension ontologique de l'être. La possibilité de juger repose sur la pensée et donne droit à un jugement dit analytique en ce sens que le jugement qui est une analyse me permet de clarifier par concept le contenu d'un sujet, d'extraire le contenu par l'analyse (la clarification) que je pose sur le sujet. Ce qui reste visé dans ce jugement est le contenu conceptuel du terme-sujet autrement explicité. Dans la mesure où l'analyse ne contredit pas le prédicat on peut conclure que tous les jugements analytiques sont a priori. C'est une restitution de la forme de l'énoncé tenant ferme de ne pas opposer le prédicat au sujet. Cette "règle des jugements analytique est le principe logico-formel de contradiction".
Les jugements analytiques restent logiquement conceptuels donc a priori. Par contre, lorsque le jugement doit aller au-delà du cadre conceptuel du sujet avant de fonder sa véracité, il y a recours à l'expérience sensible qui fournit le prédicat qui ne saurait advenir par la simple analyse du sujet. Ce prédicat ajouté au sujet réalise une synthèse. Il s'agit là d'un jugement synthétique par le fait qu'il étend la connaissance au-delà du rapport concept-sujet par recours à un prédicat non compris dans le concept-sujet et qui y advient par intuition (ou par expérience) de l'étant lui-même. Une telle connaissance qui advient par expérience et qui est "connaissance non a priori" est une connaissance a posteriori. Mais il reste que l'espace de distinction entre jugements analytiques et synthétiques reste peu considérable. Cela s'en tient plutôt au sens du fondement par lequel on accède à ces jugements.
Dans ce cas est-il nécessaire de maintenir une différentiation ? La réponse apparaît lorsqu'on considère que, pour Kant, les connaissances qui entrent en ligne de compte pour la science de l'étant peuvent élargir notre connaissance de l'étant (synthétique) sans dépendre de l'expérience. Mais elles constituent le fondement de toute expérience de l'étant et restent des jugements synthétiques a priori. C'est là qu'apparait l'ingéniosité de Kant qui confirme que la compréhension préontologique de l'être de l'étant et toute connaissance ontologique rend possible une extension de la connaissance de l'étant sans que celle-ci ne dépende de l'expérience. Ce sont des jugements synthétiques a priori qui pour Kant constituent le point de départ de sa recherche. La recherche de la possibilité d'avènement de telles connaissances ontologiques reste le leitmotiv de la "Critique de la raison pure". La critique de la raison pure est la réponse à la question kantienne : Comment les jugements synthétiques a priori sont-elles possibles ?
3-2- Des jugements synthétiques a priori
Comment un jugement peut-il dans le même temps et sous le même rapport être synthétique et a priori ? Alors que Kant fait advenir un jugement analytique a priori sur un principe de contradiction et l'oppose au jugement synthétique a postériori qui nécessite une expérience, Heidegger affirme la possibilité des jugements synthétique a priori, qu'il pose comme question cruciale pour la refondation de la science de l'étant dont la critique serait le déploiement. Et dans la mesure où il s'agit d'un jugement qui transpose la possibilité de l'expérience au sein de la connaissance, Heidegger repose la question à son compte comme un questionnement sur la possibilité de la compréhension préontologique de la scientificité de l'étant. Posée clairement par Kant dans l'Introduction à la deuxième édition de la "Critique" la question devient déterminante pour s'apercevoir de la situation actuelle de la métaphysique et pour envisager une possibilité de sa refondation :
"Or le vrai problème de la raison pure, dit Kant, tient dans cette question : comment des jugements synthétiques a priori sont-il possibles ? Si la métaphysique est restée jusqu'ici dans un état si chancelant d'incertitude et de contradiction, il faut en attribuer uniquement la cause à ce qu'on n'a pas songé plus tôt à ce problème, ni peut-être non plus à la différence des jugements analytiques et des jugements synthétiques. De la solution de ce problème, ou d'une démonstration satisfaisante que la possibilité de le résoudre, dont elle voudrait bien avoir une explication, nous est en réalité interdite, dépendent le salut ou la ruine de la métaphysique".
Kant recherche à coup sûr l'essence de la métaphysique c'est-à-dire le fondement de la relation de la représentation à l'objet qui pour Heidegger est le fondement de la possibilité de la synthèse dans les jugements synthétiques a priori. Heidegger formule radicalement qu'un étant n'est accessible sans une compréhension d'être préalable. Tout étant avant de nous paraitre reste compréhensible dans sa constitution d'être. Il notifie également que : "cette compréhension d'être de l'étant, cette connaissance synthétique a priori est ce qui donne la mesure à toute expérience de l'étant". Il fait de cette position radicale l'enjeu final de la "révolution copernicienne" et qu'il suppose avoir jusque-là été non comprise. Ce que Kant a voulu faire (sa révolution copernicienne sur laquelle le Kantbuch dans ses §§ 2et 3 reviendra) et qui consiste à ramener les objets à notre connaissance, fait de celle-ci les jugements synthétiques a priori (connaissance préontologique) c'est-à-dire la constitution d'être de l'étant : "La révolution copernicienne signifie que la connaissance ontique de l'étant doit toujours déjà être orientée sur une connaissance ontologique". Toute connaissance ontique reste supposée par une connaissance ontologique. De là se détermine le schème ontologique de toute connaissance.
3-3- Le schème ontologique de la connaissance
Deux textes font nettement référence à la thématique de "Schème" dans la pensée de Heidegger. Le § 69 de Sein und Zeit et Les problèmes fondamentaux de la métaphysique sont liés par la question de la "temporalité transcendantale du monde". Le premier texte, en évoquant le "problème temporel de la transcendance du monde", souligne l'évidence du monde qui se tient dans l'horizon de l'unité ekstatique de la temporalité (Zeitlichkeit). Les ekstases temporelles, reflets de la structure trilogique du temps, en forment le "schème horizontal" déployé comme futur (l'a-venir), passé (l'avoir-été) et présent (l'être-jeté). Le second texte qui se reporte aux "schèmes horizontaux de la temporalité ekstatique", montre également que la possibilité de la transcendance au monde provient du fait que les ekstases ont chacune un schème.
Les ekstases temporelles ne sont pas seulement en vue du néant, mais sont détentrices d'une fonction rendue évidente à l'horizon voulu par l'ekstase. C'est à une réappropriation phénoménologique du concept de schème chez Kant que procède ainsi Heidegger tel que l'insinue la première section de la seconde partie annoncée de SuZ (§8) qui devrait être titrée : "La doctrine kantienne du schématisme et du temps comme pierre d'attente pour une problématique de la temporalité". Ce projet phénoménologique, loin de jeter le discrédit sur la théorie transcendantale de la connaissance, pense la réaliser pour l'accomplir.
Ainsi par schème ontologique de la temporalité il faut noter la démarche ébauchée depuis 1925 et qui consiste à cerner l'originalité kantienne du temps introduit entre la catégorie et l'intuition. Cherchant à constituer l'immanence à la transcendance, Heidegger évoque les limites de la conception kantienne du temps. Pour lui, la temporalité kantienne serait encore dépendante du "dogmatisme" du primat "ontologique de l'Ego cogito" cartésien. Selon Paul-Etienne Atger, Heidegger relève ainsi chez Kant une "intrication spécifique de sa façon de procéder, qui entremêle la rigueur phénoménologique et l'argumentation dogmatico-constructrice". Pour y restituer le schème ontologique de la temporalité comme existentiale, il met en place des "structures phénoménologiques du temps" comme auto-affection du "Je pense". Brisant la dualité de la pensée et de l'intuition et celle de la sensibilité et de l'entendement pour en faire la source homogène de la connaissance, Heidegger accède à l'unité structurante du schématisme. Par l'unité du schème de penser, s'éclaire "la synthèse figurative opérée par l'imagination productrice" et qui "consiste à former (bilden) une "image" (Bild)". Nous l'avons vu plus haut, l'image schématisante qui ne saurait être une image directe du concept ni sa représentation, précise Atger, "doit être telle qu'elle se forme eu égard à la règle d'unité qu'est le concept, en tant que réglée en sa formation par un tel égard, et doit ainsi être en mesure d'indiquer cette règle en sa fonction régulatrice". Ce fut déjà la tâche de la troisième section du Hauptwerk "Zeit und Sein" de mettre en lumière cette occurrence de l'imagination transcendantale qui tente de combiner le schématique empirique et le schématique théorique en schématisme transcendantale. Dans cette reconstruction d'un schématisme transcendantal où le schème temporal apparaît comme l'esquisse formelle de ce en direction de quoi l'étant est projeté, la question, comme la pose Atger est de savoir si "Désigner les trois dimensions de la temporalité ekstatico-horizontale comme esquisses schématiques de l'horizon, n'est-ce pas dire, au bout du compte, qu'il n'y a qu'un seul schème, celui du Praesenz ?".
Toute cette approche qui lie la raison à l'imagination formant ainsi l'unité des facultés cherche à relever un non-dire de Kant, en ce sens que l'aperception ne peut être jointe à la réflexion sans qu'il y ait un rapport préalable entre tous les éléments. Ce lien va s'étendre de la raison théorique à la raison pratique et Heidegger montre dans le § 30 de Kant et le problème de la métaphysique que c'est l'imagination transcendantale qui tient le lien entre les deux instances. Il prend appui sur la liberté qui caractérise la raison pratique. Elle serait la source de l'autonomie de l'imagination transcendantale. Faut-il conclure que la raison théorique elle-même est pratique parce que libre ? L'analyse que donne Heidegger du respect, fondé par la loi morale supposée par une "conscience de soi" dans le §30 confirme que : "Cette interprétation du respect ne montre pas seulement en quelle mesure ce sentiment constitue la raison pratique, mais fait comprendre que la conception du sentiment, comme faculté empirique de l'âme, est éliminée et remplacée par une structure transcendantale et fondamentale de la transcendance du soi éthique.
L'ouverture sur la finitude de la raison pratique devient évidente dès lors que le moi pratique situé au niveau de la conscience du temps, prend figure de personnalité morale pour laquelle la loi se pose comme un devoir. Le respect devient cette forme de la loi morale qui se laisse percevoir à travers une conscience finie comme "devoir-être" et la personne elle-même devient un "devoir-être lié au temps". La loi morale elle-même serait-elle liée à l'imagination ? Elle reste pour Heidegger la racine commune que Kant aurait évoqué dans la première édition de la critique. Devenue la fonction "subalterne" entre l'entendement et l'intuition elle est le fondement absolu à partir duquel tout se définit étant donné que Heidegger fait poser la finitude dans le rationnel lui-même. Il en découle bien des conséquences. Celle de percevoir l'imagination comme pouvoir de former (Bildende Kraft) et capacité de former toute connaissance qui reste intuitivement finie. C'est pourquoi précise Heidegger, l'Esthétique transcendantale, l'Analytique transcendantale, et la dialectique transcendantale, partent de l'étude de la connaissance ontologique fondée sur l'intuition. Ainsi, la connaissance ontologique qui procède par concepts est axée sur la raison et justifie pour Heidegger la critique kantienne de la raison pure.
Conclusion
Avec Heidegger lisant Kant, la question n'est plus "Que sais-je ?" ou "Que puis-je savoir ?" mais "Comment savons-nous que nous savons ?" C'est pourquoi à la suite de Kant qui pose le processus de la connaissance à partir de l'expérience, maintenant toutefois celui-ci à distance de la "Chose en soi", Heidegger se montre plus catégorique en désignant "la raison sensible pure" comme l'absolu de toute connaissance. Celle-ci est dorénavant rendue évidente à partir du point unificateur des facultés de sensibilité et de l'entendement que réalise l'imagination transcendantale.
Ainsi la représentation de tout objet se définit à partir de l'unité de l'entendement et de l'intuition dont seule une imagination transcendantale réalise la possibilité. Directement liée à l'intuition, l'imagination transcendantale se soustrait de tout empirisme et se pose comme le principe qui construit tout objet sans besoin d'un objet préalable. Cette imagination productrice pure parce que capable de produire et de se représenter non pas l'image d'un objet mais un schème (condition de possibilité de l'objet), montre que ce n'est pas la présence de l'objet qui en détermine la représentation mais plutôt c'est parce que le temps reste préalablement déterminé qu'un objet peut être présentement représenté. Par ce socle de toute connaissance Kant pourra dire : "nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes". Il n'y a donc de connaissance que de cet a priori c'est-à-dire "universelle et nécessaire" par laquelle toute la Critique devient "l'examen du pouvoir de la raison par rapport à toute connaissance pure a priori".
BIBLIOGRAPHIE
- ATGER Paul-Etienne, "Phénomène, schème, figure. L'origine de l'ontologie figurale de Heidegger", Les Études philosophiques 1/2006 (n° 76), p. 29-46
- BALAZUT Joël, "La critique de la raison pure comme préfiguration de l'ontologie fondamentale", Le portique (en ligne), 26 /2011, mis en ligne le 11 février 2013, consulté le 18 janvier 2016 URL : http://leportique.revues.org/2522.
- DUFOUR-KOWALSKA, Gabrielle, L'art et la Sensibilité, de Kant à Michel Henry, Vrin, Paris, 1996
- HEIDEGGER Martin, Martin Heidegger, Interprétation phénoménologique de la "critique de la raison pure" de Kant, trad. E. Martineau, Gallimard, 1982.
- -, Kant et le Problème de la métaphysique, trad.w ; Biemel, A. de Waehlens, Paris, Gallimard, coll. "Tel", 1981.
- -, Être et temps, trad. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986.
- -, Identité et différence in Questions I, Gallimard, Paris, 1976..
- -, Le retour au fondement de la métaphysique, Questions I. Gallimard, Paris, 1976
- -, Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24 ; Vittorio Klostermann, Francfort-sur-le-Main,, 1975
- KANT Emmanuel, Critique de la raison pure, in uvres philosophiques, Paris, Gallimard, NRF, Pléiade en 3 vol. (1980-1986)
- -, Lettre à Markus Herz du 21 février 1772.
- RIVELAYGUES Jacques, Leçons de métaphysique allemande, T2. Kant, Heidegger, Habermas. Grasset, Paris, 1992.
- SCHWEIDLER Walter, Au-delà de la méta-physique, trad. Line Soryano, Ed. Hermann, Paris, 2015.
LA METAPHYSIQUE RENVERSEE
Cet article veut situer sur la base d'approches récentes comment une métaphysique phénoménologique, déjà énoncée par Patocka, est enfin envisageable. Il cherche à rallier l'élan de toute phénoménologie à la philosophie transcendantale kantien d'inspiration heideggerienne. (Kant et le problème de la métaphysique 1929).
Depuis 1900-1, date de naissance de la phénoménologie avec la publication des Recherches logiques de Husserl, la métaphysique comme philosophie première est entrée dans une phase critique. Si en notre époque la philosophie s'écrit en termes de phénoménologie comme le souligne Jean-Luc Marion, il ne faut pas ignorer qu'il est du dessein de cette métaphysique d'être transgressée comme l'affirme le même Marion. La question est alors de savoir à quoi tient la polémique métaphysique et phénoménologie. La critique ontothéologique lancée par Heidegger à l'égard de toute la métaphysique occidentale n'est-elle pas aujourd'hui surmontée par les historiens de la philosophie pour que ceux-ci en y voyant une aporie comme Marion, puissent ouvrir à un renouveau herméneutique du rapport que la philosophie a toujours entretenu avec ses mutations historiques ? Notre lecture de cette polémique voudrait faire constater que le geste de Husserl qui en aura appelé à un dépassement de la métaphysique est une fin offerte pour le commencement de la philosophie comme quête du "sens des choses".
Dans une première investigation, nous soutiendrons un tournant phénoménologique de la métaphysique sous la base de déconstruction-reconstruction de la philosophie (1). Celle-ci prolongée dans une deuxième approche nous fera justifier de la pertinence d'une herméneutique métaphysique toujours en acte dans la philosophie contemporaine (2), de façon à montrer en une troisième considération un retour à l'analytique de la "fonction méta" comme exigence phénoménologique qui ouvre à l'ontologie donatrice à concevoir aujourd'hui comme modèle pour le dynamisme de la pensée philosophique (3). L'intérêt de cette présentation de l'histoire de la philosophie est de présenter l'actualité du rapport phénoménologie et métaphysique au-delà de toute polémique.
I- De la déconstruction à la reconstruction
Kant fut le premier à initier la nécessité de déconstruire l'ontologie traditionnelle (métaphysique) pour lui redonner son ambition de science première. Après la Critique de la raison pure qui a en réalité échoué dans la restauration aristotélicienne de la philosophie, c'est Husserl qui au début du 20 -ème a rêvé de la philosophie comme "science rigoureuse". Dans quelle mesure la philosophie fondée sur le principe des mathématiques est-elle encore une métaphysique ? C'est là toute l'inquiétude de Heidegger qui n'entrevoir aucune philosophie indépendamment de l'être comme objet. En s'accordant au geste de Husserl contre une phénoménologie transcendantale, Heidegger annonce que si la phénoménologie est la méthode la plus décisive offerte à la philosophie, elle ne peut l'être qu'en étant une phénoménologie ontologique. Plutôt que de voir cette décision comme un éloignement du fondement enfin posée par Husserl, nous allons supposer dans le parricide heideggérien l'atout d'un tournant accordé à la métaphysique (1) de façon à montrer que sa fin supposée par les deux penseurs est un appel à se dépasser (2). De quel dépassement s'agit-il ?
1-1- L'évidence d'un tournant pour la philosophie
La tâche de la philosophie contemporaine est de penser annonce Heidegger. Mais il faut souligner que le penseur du sens de l'être, l'a annoncé comme un défi à l'élaboration contemporaine de la philosophie telle que celle-ci cherche à se démarquer de la stagnation métaphysique de la pensée. C'est à Ludger Honnefelder que nous devons l'une des prises au sérieux de cette aporie heideggérienne. Honnefelder envisage la possibilité de la métaphysique dans ce régime de critique radicale. Dans la sixième de ses leçons données en 2000, "La possibilité de la métaphysique en régime de critique radicale" il sonde les "projets métaphysiques des temps modernes jusqu'à aujourd'hui" comme lieu où la critique reste inévitable sans que l'enjeu "transcendantal" de la science métaphysique soit abandonné ou délaissé. Depuis l'empirisme de Hume et Locke en effet jusqu'à celui du cercle de Vienne en passant par l'acte fondateur de la critique métaphysique moderne : La critique de la raison pure de Kant, la métaphysique est toujours entrée dans des phases de critique sans que jamais sa fin, toujours annoncée, soit effective ou effectuée. Ceci est évident pour Honnefelder dans la mesure où "aussi longtemps que la philosophie se plie à la double exigence de la justification et de la critique, les questions d'une philosophie première, c'est-à-dire d'une philosophie fondamentale, ne se laissent pas consumer".
Donc en notre siècle "où la phénoménologie assume toute la philosophie" (Jean-Luc Marion), il faut remarquer que ce n'est pas la philosophie qui se consume au gré de la critique mais plutôt la métaphysique qui connaît un tournant phénoménologique visant à en fonder l'essence. Il en résulte que toute critique reste une critique qui ne vise qu'à fonder la métaphysique comme science première au sens de l'essentiel (essence) de la philosophie. En réorientant la compréhension des questions métaphysiques sur le questionné lui-même (l'homme en tant que métaphysique) par "la nature de la raison elle-même", Kant situe la métaphysique comme une "disposition naturelle de la raison" dont il faut dorénavant questionner la "possibilité" et la "disposition".
Quel est le pouvoir de la raison par rapport à la connaissance pure apriori ? Loin d'être "prolégomènes" à la possibilité de connaissance, cet effort de questionner le pouvoir de la raison en est déjà la connaissance qui n'éveille à rien d'autre qu'à la métaphysique elle-même. On entend à juste titre la critique comme "l'idée d'une science particulière, qui peut s'appeler la critique de la raison pure".
Cette science transcendantale qui a vu le jour avec Kant et dont les relents se sont imposés à l'histoire de la pensée depuis les médiévaux, tels Scot et Suarez jusqu'à la phase scolaire de la métaphysique, n'a jamais "fait appel à un premier Etant en soi, mais à un premier connu". Et le pouvoir transcendantal ne peut se conférer qu'à ce "premier connu" qui se sachant connu, s'interroge sur son sens d'être. En ce qui concerne Kant, il faut le préciser, sa critique reprochait à l'ancienne philosophie de faire "sans circonspection, de ces critères de la pensée des propriétés des choses en soi" : "J'appelle transcendantale dit-il toute connaissance qui s'occupe en général, non pas tant d'objets, que de nos concepts a priori en général". C'est donc des conditions de possibilité de notre connaissance des objets en général que traite la métaphysique. Mais qu'en est-il de cette réalité objective ? C'est à ce sujet qu'il faut affirmer, à travers les diverses approches se focalisant sur le concept abstrait "d'étant" comme objet de métaphysique ou le concept de "l'étant" comme premier objet de l'intellect ou même le concept de l'Etant infini, que le moment kantien est celui d'un éveil à la métaphysique. Tout projet de dépassement de la métaphysique s'inscrit alors dans la fin de celle-ci.
1-2- La métaphysique entre fin et dépassement
Le problème est de savoir comment dans l'avènement de la phénoménologie, la métaphysique a substitué ses schèmes à la nouvelle philosophie. Dans Essais et Conférences, publiés entre 1936 et 1946 se situe le texte sur le "Dépassement de la métaphysique". Heidegger y affirme explicitement que : "Le dépassement de la métaphysique, est pensé dans son rapport à l'histoire de l'être. Il est un signe précurseur annonçant la compréhension commençante de l'oubli de l'être. Ce qui se montre dans le signe est antérieur au signe, quoique aussi plus en retrait que lui. C'est l'achèvement (Ereignis) lui-même Le dépassement (de la métaphysique) ne mérite d'être pensé que lorsqu'on pense à l'appropriation-qui-surmonte l'oubli de l'être".
On le voit clairement, dans la pensée de Heidegger, les types classiques de la métaphysique, specialis et generalis sont réduits à une uniformité métaphysique qui si elle donne l'apparence d'une métaphysique générale n'est en réalité qu'une metaphysica naturalis. Nous le verrons plus loin au sujet du fondement métaphysique de l'ontologie fondamentale. Il importe pour l'instant de rappeler que dans ce même texte sur le dépassement de toute métaphysique, il soutient toutefois que "la métaphysique même surmontée ne disparaît point. Elle revient sous une autre forme et conserve sa suprématie, comme la distinction, toujours en vigueur qui de l'étant différencie de l'être". Heidegger réhabilitant la métaphysique surmonte de fait sa propre critique ontothéologique pour supposer la possibilité toujours accordée à la métaphysique générale de se poser comme constante quête de sens au-delà de tout objet qui se poserait comme transcendance. Les démarches métaphysiques encore en cours dans la pensée contemporaine soutiennent cette tendance herméneutique de toute métaphysique.
II- Une herméneutique toujours en acte
Dans sa série de conférences déjà évoquées, Ludger Honnefelder se fonde sur Dun Scot pour illustrer "la métaphysique comme science transcendantale". Honnefelder entend ici présenter un témoin de la métaphysique dont la vision reste l'effort d'atteindre la transcendance au-delà de tout absolu. Il le montre notamment dans la deuxième leçon intitulée "La question de la portée de la raison humaine : métaphysique comme science transcendantale".
2-1- Science transcendantale
La métaphysique perçue comme "science transcendantale" doit sa notoriété à Jean Duns Scot, qui dans le second commencement de la métaphysique situé au Moyen-Âge, donc après Aristote, tente de redonner à cette science "sa conception de philosophie première" et qui durera jusqu'au seuil de la modernité. Ce que réalise Scot c'est d'avoir conduit la "scientia transcendens" à passer du questionnement de l'Étant premier à la constitution de la "Première connaissance". Puisque l'influence de Duns Scot, qui va s'étendre jusqu'à la modernité n'a vraiment connu d'actualité qu'à partir de 1950, l'année "qu'a commencé l'édition critique des écrits de Scot", on se rend compte à présent que cette métaphysique n'eut d'autre relent qu'ontologique. L'influence de Scot, le Doctor subtilis se note dans "son exigence de précision dans l'art de la distinction et de l'argumentation qui est guidée par la théorie de science et par la logique aristotélicienne".
Dans cette rigueur d'élaboration métaphysique en vue de la connaissance première, Scot s'inscrit dans la répartition distinctive entre philosophie et théologie et ce à la suite d'Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Ce qui énonce que pour lui "la théologie ne peut s'exercer comme science que si la portée des concepts qu'elle utilise peut-être démontrée par une science qui dépasse la physique". Par exemple, la Révélation ne peut être intelligible que dans la mesure où les mots auxquels elle fait référence sont explicites pour la nature (humaine) qui en fait usage. Ainsi, savoir si la théologie peut se constituer comme science, nécessite avant tout que soit clarifiée une question préalable à savoir : "comment la métaphysique est-elle possible ?". Car "ce qui est capable d'être le premier sujet d'une métaphysique qui soit à notre portée dépend de la question de ce qui doit être tenu pour l'objet premier de notre raison".
Si cette raison ne remplace pas chez Duns Scot le premier objet de la métaphysique, il fait néanmoins "précéder les déterminations des objets de la théologie et de la métaphysique d'une détermination de la portée et des limites de notre faculté de connaître, c'est-à-dire d'une critique de la raison". Il résulte de cette critique qu'avec Duns Scot le premier objet qui peut se donner le monopole de tout ce qui est connaissable, loin d'être un Étant éminent, encore moins un objet particulier, est "la détermination commune d'étant". Cet étant n'est évident que dans la mesure où il reste accessible à notre intellect. Et seul "ce concept d'étant, occupe chez Scot la place du premier objet de la métaphysique, qui nous soit accessible sous les conditions actuelles de la connaissance".
Peut-on envisager avec Duns Scot que cet "étant" devra se constituer lui-même comme métaphysique au point d'être aussi tenue comme ontothéologique ? Plus distinctement posée par Honnelfeld, la question est de savoir si la "philosophie première" est la science de l'étant en tant qu'étant, si la raison théorique l'interprète théoriquement selon la série - ce qui ramène à l'onto-théologie - ou l'interprète-t-elle théoriquement selon le tout - ce qui ramène à l'ontologie ?
On ne peut souscrire avec Scot à une interprétation sérielle. Car la métaphysique de Scot ne suppose aucunement une "connaissance préalable non démontrée du Premier éminent". C'est pourquoi sa métaphysique apparaît plutôt comme l'option à "fonder la possibilité de la métaphysique sur une critique de la raison". Il procède dans ses uvres à une détermination de cet étant de façon à en élucider le principe : "Si en effet nous essayons de répondre à la question du "quid est" d'un objet par une définition, nous utilisons des concepts distinctifs qui indiquent le quoi et le comment de l'objet. Normalement ces concepts distinctifs par exemple le concept d'homme, sont composés d'un concept partiel indiquant le "quoi" (quid) et d'un concept partiel indiquant le "comment" d'une part, et rationnel d'autre part".
Il s'ensuit une "théorie de l'étant comme premier connu" soumis à une "primauté irréductible" : "Rien n'est connu distinctement sans être connu comme étant". Et un tel étant ne se laisse connaître par quelque chose d'antérieur (Avicenne). Seul ce qui est distinct est connu comme étant. Le caractère imparfait de l'étant lui vaut d'être un "univocum transcendens" (Pierre d'Aquila) dont la conséquence pour Scot reste que : "L'intellect humain doit renoncer au point de vue divin. Il n'existe pas de connaissance- possible à l'homme dans l'état actuel, ou accessible selon sa nature- du premier Etant éminent, tel qu'il est selon son essence . La connaissance humaine n'est capable que de former le concept d'étant par le moyen de la connaissance abstractive".
C'est déjà à cette "capacité de former" propre à l'humain que Heidegger exige de ramener la connaissance elle-même. On peut comprendre l'intérêt qu'a suscité la théorie scotienne de l'étant chez le jeune Heidegger dont la thèse d'habilitation en porte les traces. Le concept d'étant comme premier connu qui s'applique à tout, fait accéder à un "concept qui dépasse (transcendit)" toute catégorisation parce que hors de toute portée : "Ce concept abstractif d'étant qui comprend l'étant en tant qu'étant dans la mesure où il n'a pas d'autre contenu que la ratio entis tout simplement simple, est en même temps l'objet recherché de la métaphysique qui est possible pour nous".
Scot ramenant l'objet de la métaphysique à la possibilité de la condition humaine en livre une définition qui peut bien exempter sa tradition de la critique heideggérienne. Il réfute toute idéalisation de la science et notifie que "la métaphysique en nous (metaphysica in nobis) sous forme de la philosophie première, qui est accessible à notre intellect, est au contraire la science du concept d'étant gagné abstractivement en tant qu'il "dépasse" toute connaissance catégoriale". Si avec Scot la métaphysique reste la science première parce qu'elle est une science transcendantale et que cette caractéristique lui vient du fait qu'elle traite des "concepts transcendantaux", le concept transcendantal par excellence reste pour Heidegger le Dasein.
On peut dire du projet de la métaphysique comme philosophie première qu'il n'a pas pris fin depuis lors, malgré les contestations récurrentes de sa possibilité. Comme on pourrait le montrer en détail, ces contestations concernant la fécondité de l'approche qui est à chaque fois choisie, et la validité de la prétention qui est alors élevée, mais non pas la possibilité du projet comme tel. La preuve en est le fait que les nouvelles approches de la philosophie- comme par exemple au XXe siècle les approches de la phénoménologie et de la philosophie analytique du langage- montrent eux aussi que le projet d'une philosophie première est à nouveau possible et même nécessaire.
On dirait en clair, que la possibilité de métaphysique se répète dans de nouvelles conditions. Il reste évident dans l'ordre de la critique ontothéologique que dans la mesure où la métaphysique ne serait possible que du point de vue de Dieu, est voué à l'échec la possibilité de toute métaphysique. On peut alors affirmer une fois encore avec Honnelfeld que : "S'il est possible d'élever une prétention de vérité non épistémique sans être obligé d'affirmer pour chaque proposition que sa prétention de vérité peut recevoir une réponse, un réalisme est également possible-même si c'est réalisme faible- qui ne suppose pas le point de vue de Dieu, et qui prouve que la possibilité de la métaphysique n'est pas suspendue à ce point de vue".
Heidegger qui ne vise pas à la réalisation d'un projet de la métaphysique comme science première a voulu identifier une décision catégoriale de la connaissance comme ontologique. On en arrive ainsi à une formulation de la métaphysique comme ontologie. Dans ce réalisme heideggérien s'énonce une nouvelle théorie métaphysique dont déjà Quine explicite la portée en signifiant qu'"une théorie est fixée à ces entités, et seulement à celles auxquelles les variables liées doivent pouvoir référer, pour que les propositions de cette théorie soient vraies". On en conclut que :
Le Tout auquel la métaphysique se réfère, n'est pas un objet de la connaissance, et la métaphysique ne disposant pas d'une source privilégiée de connaissance, elle n'est possible que d'une façon indirecte. Elle n'est pas une théorie qui explique les choses directement, mais une hypothèse qui essaye de justifier de façon finale les théories explicatives et qui possède, à cause de cela, un statu sui generis, à savoir celui d'une connaissance qui concerne le concept limitatif (Grenzbegriff) et non l'objet.
Ce Grenzbegriff pour toute objectivité métaphysique est ce que soutient Jean Grondin pour qui la métaphysique découle de cet effort à restituer "le sens des choses". Jean Grondin l'atteste en développant une herméneutique métaphysique qu'il faut entendre comme Métamétaphysique.
2-2- Métamétaphysique
Si pour Grondin, la métaphysique doit sa date de naissance à l'inquiétude humaine et qui s'applique aux choses de façon à en déterminer le sens, l'essentiel de la métaphysique nécessite une herméneutique de la pensée métaphysique elle-même. D'où à l'heure de la déconstruction (Kant-Heidegger), l'acte de déconstruire fait partir du sens intrinsèque de la chose métaphysique. Nous nous référons aux conférences annuelles de la Chaire Gilson en 2010 données par Jean Grondin dont le texte paru en 2013 sous le titre Du sens des choses. L'idée de la métaphysique".
La problématique d'ensemble de ces six leçons met l'accent sur la vocation métaphysique de l'homme, que Platon aura mis en exergue en démocratisant l'intelligence humaine qui fait de "tout homme un homo sapiens, un être doué de raison, du moins en puissance, et dès lors investi d'une dignité intrinsèque dans la hiérarchie des êtres". Grondin accède à un sens de la vérité qui soit la vérité des choses que l'herméneutique de toute métaphysique permet d'atteindre. Le point de départ posé par Grondin comme nous le signifions tantôt est qu'il y a un principe de tous les principes déterminants d'une "herméneutique métaphysique". Ce principe au-delà de tout principe énonce que "l'homme est un être de compréhension et que ce qu'il cherche à comprendre, c'est le sens des choses" y compris sa propre raison d'être. La démarche adoptée par Grondin pose d'entrée de jeu une réciprocité entre métaphysique et herméneutique, entendu à la fois comme substantif et comme adjectif : "C'est à la fois la métaphysique qui est herméneutique et l'herméneutique qui est métaphysique".
Un tel itinéraire trace clairement la défense d'une herméneutique métaphysique qui évite de considérer la métaphysique comme un "bloc de doctrines herméneutiques" sans ignorer toutefois qu'il n'y a pas de métaphysique non doctrinale. Grondin fait comprendre que la compréhension du sens des choses qui reste intrinsèque à l'acte métaphysique suppose que le sens visé est ce qui est recherché en même temps qu'il le dépasse. Seule l'herméneutique de la chose métaphysiquement constituée permet d'en saisir le sens.
C'est pourquoi, la notion de "sens des choses" explicitée seulement dans la troisième leçon s'entend comme "le sens de l'être". "Ce sens, c'est d'abord celui des choses elles-mêmes, Ce sens, ce n'est pas la compréhension qui l'introduit dans les choses Elle le découvre...". On y retrouve avant tout le sens de la philosophie elle-même : "Si l'herméneutique définit sa méthode, celle d'une interprétation du réel à l'affût de son sens, la métaphysique la caractérise quant à son objet". Le sens de la philosophie reste donc une herméneutique métaphysique ou une métaphysique herméneutique : "L'herméneutique consiste, précise Grondin, en un effort de comprendre et la métaphysique en une tentative de comprendre l'être à partir de ses raisons". Une telle aspiration commune à l'herméneutique et à la métaphysique, témoigne qu'aucune philosophie ne peut se déployer sans porter le souci d'élucider le "sens des choses" à travers "l'effort vigilant (métaphysique) de la pensée humaine de comprendre (herméneutique)".
La première leçon "Herméneutique de la situation présente de la métaphysique" s'inscrit en effet dans l'actualité de la métaphysique après sa déconstruction pour remettre en rapport les perspectives de Kant et de Heidegger comme réalisation "d'une métaphysique portée par une métaphysique en acte". En présentant la figure de Pierre Aubenque qui se demande lui-même s'il fallait déconstruire la métaphysique est un appui pour Grondin inscrit dans la ligne kantienne à constater que "la métaphysique demeurait malgré tout la respiration même de la pensée" : "La métaphysique est l'air que respire la philosophie et donc, compte tenu de sa condition asthmatique de finitude, elle n'a jamais fini de faire l'herméneutique". Les traits actuels de la déconstruction de la métaphysique montrent que loin d'être une destruction, toute déconstruction vise à "faire ressortir le sens des choses".
Dépasser la métaphysique c'est donc chercher à revenir à l'unité métaphysique en recherchant dans les métaphysiques (les systèmes) le sens unificateur des choses. Car comme le souligne Grondin, "ce sens de la différence ne saurait faire ombrage à l'unité présumée de la métaphysique, laquelle doit être préservée s'il doit rester sensé de parler de métaphysique". La critique heideggérienne de l'ontothéologie à ce titre ne concerne qu'une certaine métaphysique entendu quelques systèmes qui n'ont toujours pas eu la même thématique de l'étant absolu pour référent. Mais dans le sens des choses qu'ils cherchent à faire ressortir, la substance, l'absolu, la cause première, l'être, Dieu et bien d'autres phénomènes ont été envisagés comme fondements à la prima philosophia. Ceci pour montrer qu'afin d'atteindre le sens originaire de la phénoménologie qui n'a pas d'objet parce que ne s'occupant pas d'un sujet, même pas du Dasein, seul un au-delà de la métaphysique s'impose. Celle-ci si nous l'envisageons à partir de la métaphysique du Dasein, laquelle consacre l'essence de la connaissance la finitude de toute pensée, il faut en revenir à l'analytique de la "fonction méta" de toute métaphysique pour saisir le sens de celle-ci.
III- La métaphysique du Dasein
La phénoménologie accomplit la philosophie transcendantale par le dépassement du questionnement du statut métaphysique de la philosophie qu'elle provoque. La philosophie n'a pas pour enjeu de se réaliser comme métaphysique mais d'être cette métaphysique qui se regarde elle-même en face à partir du regard phénoménologique que lui prête dorénavant la nouvelle philosophie : l'ontologie fondamentale. C'est l'exigence d'un retour au fondement du phénomène originaire de toute métaphysique de façon à saisir l'objet métaphysique comme une donation originaire que seule la "fonction méta" permet d'entrevoir.
3-1-Retour au fondement du phénomène originaire
Le retour au fondement énoncé par Heidegger est sans aucun doute un retour au fondement de la métaphysique c'est-à-dire au sens d'être "du" métaphysique lui-même. Comment "l'ontologie fondamentale" assume-t-elle ce retour comme commencement métaphysique ? Nous avons déterminé dans notre lecture du Kantbuch que le principe méthodologique qui soutient l'élaboration de la métaphysique du Dasein, n'est plus la phénoménologie, mais une "raison sensible pure". Ce qui permet de distinguer l'ontologie fondamentale comme une "sortie de l'être". La sortie de l'être provoquée par Heidegger est une sortie de la métaphysique de la présence, de cette "chose-sous-la-main" que la pensée peut manipuler parce que considérée comme effectivité. Or, la possibilité est toujours advenant. L'ontologie fondamentale en ouvrant à une sortie de l'être fait entrer l'être en métaphysique par la voie de la finitude. La finitude fixe la limite de toute phénoménalité et fait de l'être une donation ontologique.
Dans sa conférence sur Les limites de la phénoménalité, Marion y revient en soulignant que la philosophie détient l'ultime droit de se déterminer elle-même en tant qu'elle se fixe les conditions de la pensée de tout expérience comme finitude. La possibilité des objets de la connaissance doit se rendre compatible avec la condition de l'expérience. Les conditions des objets d'expérience sont dès lors établies par notre finitude, la finitude de l'homme, celle qui conditionne toute expérience. La finitude décide ainsi de toute possibilité. Marion atteste sans détour que l'histoire de la philosophie n'a été jusque-là que l'approfondissement du statut de la finitude. Il y est question avant tout de la finitude de l'homme énoncée depuis le "Je" du Cogito cartésien en passant par le "Je" transcendantal comme intuition sensible de Kant pour en arriver à l'analytique de la finitude avec Heidegger qui radicalise par la suite la finitude de l'être lui-même. Reste posée alors la question de savoir si la sortie de l'être est effectivement la sortie que l'être réalise de lui-même voire le génitif subjectif au point de consacrer toute donation comme une donation ontologique.
Pour ce, c'est à la question de l'être reposée sous l'égide de la métaphysique qu'il faut renouer la démarche. Si Qu'est-ce que la métaphysique (1929) constitue l'infrastructure littéraire mise en place pour y répondre, c'est dans Kant et le problème de la métaphysique (1929) que s'est mise en place la structure de cette métaphysique envisagée dorénavant comme "une réflexion sur la condition temporelle de notre intelligence de l'être". Grondin confirme donc que la définition de cette "métaphysique du Dasein" doit s'entendre comme : "Une ontologie de cet étant qui comprend l'être de manière temporelle parce qu'il est lui-même transi par une mortalité inexorable, qu'il sait mais ne veut pas voir". Une telle approche qui confère le privilège de la quête de l'être au Dasein est transversale à l'uvre de Heidegger.
Ce qu'il contestera plus tard de la métaphysique n'est point celle naturalis, mais l'hégémonie persistante d'une certaine métaphysique qui continue à empêcher de penser l'être, monopolisant celui-ci sous le couvert d'un quelconque étant. Grondin lui-même parle d'une "rage de rationalisation" qui "gomme le mystère primordial de l'être" et par conséquent met en cause la transcendance du Dasein, la seule habileté à questionner l'être. Ce fut aussi l'oubli de l'être qui a occasionné l'oubli de la finitude. Or la pensée ne compte qu'avec celle-ci. C'est pourquoi souligne à nouveau Grondin : "Si la métamétaphysique que Heidegger déploie promet de laisser derrière elle la métaphysique, c'est pour mieux penser ou pour enfin penser l'être". Ce qui se justifie dans les derniers écrits du penseur à travers l'écrit du mot Être sans graphie particulière (Seyn ou estre) sans que cela cède pour autant à une pensée antimétaphysique. Sauf si on tient strictement à ce type de métaphysique dont Heidegger cherche à raturer l'être comme pour sauver celui-ci de tout "verrouillage systématique" pour le ramener à la mesure du Da-sein. Il y a là une "métaphysique" à la manière de n'en être pas une, qui ramène non seulement la question métaphysique à la compréhension du sens des choses mais fait exclusivement de la temporalité de l'être la chose par excellence dont il faut comprendre le sens. Une telle compréhension se passe de toute connaissance. Grondin le dit explicitement :
Dans ce nouveau procès intenté à la métaphysique, une chose ne peut manquer de frapper l'observateur attentif : pour une pensée qui prétend s'affranchir de toute volonté d'explication, la métamétaphysique heideggérienne explique finalement beaucoup de chose ! Elle prétend, d'une part, rendre perceptible la trame secrète de toute l'histoire de la pensée occidentale, honorablement résumé sous le nom de métaphysique, et, d'autre part, prépare un tout autre commencement à la pensée, le seul qui soit porteur de salut, car c'est un espoir auquel Heidegger ne renonce jamais.
L'espoir de ce renouveau de la pensée est porté par la métaphysique du Dasein dont la transcendance restituée accomplit tout le projet de l'ontologie fondamentale. Ainsi s'énonce sa métaphysique en acte, qui va permettre par la suite de renouveler aussi la question du divin, (donc aura aussi été dans la structure ontothéologique de la métaphysique) en prenant soin de ratisser tous les concepts pour en faire une pensée postphilosophique. On peut donc dire que "comme Kant, Heidegger ne cherche pas à critiquer ou dépasser la métaphysique que pour mieux la penser Si pour Kant la métaphysique n'est pas assez "science", pour Heidegger elle n'est pas assez pensée (Denken, Andenken)". Comment penser alors phénoménologiquement la métaphysique de façon à lui restituer la rigueur de sa pensée (l'être) ?
3-2- Par l'analytique de la fonction méta
L'idée directrice des deux déconstructeurs de la métaphysique se situe dans cet effort à prouver qu'on ne peut dépasser la métaphysique en tant "qu'effort vigilant de la pensée humaine à comprendre l'ensemble de la réalité et ses raisons" sans réussir à en élaborer une qui soit la coïncidence "du" métaphysique avec toute métaphysique. Le chemin de l'ontologie phénoménologique est fondamentalement la provocation d'un problème métaphysique qui s'est voulu "méditation métaphysique" posée par le Kantbuch et réalisée dans la leçon inaugurale "Qu'est-ce que la métaphysique ?" (1929). Pour Greisch la pertinence de cette métaphysique en acte comme le distingue Grondin, ne doit pas pousser à endommager "la texture délicate de tout ce qui, en Occident, s'est appelé métaphysique".
La critique ontothéologique n'a été pour celle-ci qu'une "essoreuse". L'analytique du "méta" s'ouvre ainsi à la métamétaphysique (Grondin) comme sens de la chose métaphysique. C'est pourquoi précise encore Greisch, par "fonction méta" : "J'entends une enquête phénoménologico-herméneutique, et non simplement sémantique, sur les différents usages du préfixe "méta''". On s'en rend bien compte : "Il est impossible de dépasser la métaphysique sans défendre une conception qui se prétende plus juste de ce que la philosophie doit être. Mieux dire, il est impossible de dépasser la métaphysique sans présupposer une autre métaphysique qui prétend mieux savoir et ce que la philosophie doit être et ce que sont censées être les choses elles-mêmes.
C'est ce que Jean Greisch ne manque pas de confirmer lorsqu'il en appelle depuis peu et ce à la suite de Stanislas Breton, dans la même ligne que Jean-Luc Marion, à un retour à l'analytique de "la fonction méta". Le retour au "méta" devra révéler que le dépassement est intrinsèque au substantif de métaphysique en même temps que c'est par la déconstruction du physique (Vorhandenheit) qu'une laborieuse métaphysique a lieu. Greisch est l'un des exégètes les plus fidèles de l'herméneutique métaphysique de Heidegger. Dans la conférence, désormais publiée dans l'ouvrage collectif "Christianisme et Métaphysique" paru à l'occasion du Vingtième anniversaire de la Chaire Etienne Gilson aux Editions Presse Universitaire de France (Puf) en 2015, il annonce la rédaction d'un ouvrage sur la "fonction méta et la métaphysique du Dasein". Il désigne celle-ci comme la "clarification de l'infrastructure du penser métaphysique". Et l'évidence de la métaphysique n'est prouvée que pour "autant qu'il y a du transcender". Il fait référence à Heidegger lui-même qui dans Concepts fondamentaux de la métaphysique du semestre d'hiver 1929/1930, invite à "nous mettre nous-mêmes en route" et à "regarder la métaphysique en face, pour ne plus la perdre de vue". Si le regard que Heidegger lui-même jette sur la métaphysique de face, en a appelé effectivement à un regard d'en face, c'est en constatant que son interrogation métaphysique s'est voulue une enquête sur l'origine du mot et l'histoire de la discipline.
Le résultat décevant (le concept scolaire traditionnel est superficiel, confus et "insouciant du véritable problème qu'il doit désigner") ne fut jamais une perte de confiance à la possibilité métaphysique. Ce fut plutôt une décision à penser, à "repenser la signification originelle de ce qu'Aristote désignait comme "philosophie première" et emboîtant le pas de Kant "d'ériger en problème la métaphysique elle-même".
On s'inscrit dans l'intuition d'un retour à l'analytique de la "Fonction méta" que Greisch évoque comme clé herméneutique de restauration de l'actualité de la métaphysique. Bien évidemment la formulation provient de Stanislas Breton mais sa mise en pratique reste une touche personnelle de Greisch et dont les enjeux tentent de montrer le "principe d'interdépendance universelle" que livre l'art de la métaphysique. Ce qui sous-entend que la philosophie notamment la métaphysique n'a pas le monopole du "méta". Cependant, comme souligner dans l'article "Fonction méta dans l'espace contemporain", Jean Greisch en arrive à la conclusion que la "fonction méta" laisse ouverte une "stratégie de pluralisation qui oblige à s'interroger sur les multiples usages, aussi bien extra qu'intraphilosophiques de la particule meta". Ce qui permet de comprendre que la philosophie notamment la métaphysique ne peut s'exclure du dialogue entre les rationalités, entre philosophie et sciences humaines. Il y a là un pari herméneutique (Paul Ricur) jamais conquis et qui maintient l'assise jamais dépassée des philosophies du passé, en ce sens que ces métaphysiques restent ouvertes à la réinterprétation et à la réappropriation. L'enjeu de l'ontologie heideggérienne aura été d'y avoir convoqué toute la pensée quoiqu'en des termes qui en éloignerait : "La fin de la métaphysique".
La phénoménologie comme méthode d'élucidation de la "fonction méta" ouvre à la transcendance recherchée par tout projet métaphysique. Ainsi dans la métaphysique du Dasein, "Ce qu'il s'agit de cerner, c'est le "phénomène transcendance" et les modes de sa phénoménalisation. Elle peut être dite "herméneutique" parce qu'il y va de la manière dont le Dasein comprend son être-au-monde". À ce niveau Greisch redonne toute prééminence au Kantbuch de 1929 qui aura pris pour fil conducteur la question de l'homme mais en prenant soin de la "désanthropologiser", en lui donnant la forme : "Qui sommes-nous ?". C'est là que se constate la mise en uvre de l'horizon d'une "métaphysique du Dasein" qui "exauce le vu kantien d'une renaissance de la métaphysique selon un plan entièrement inconnu jusqu'ici".
Conclusion
Le projet de la Critique de la raison pure s'est nettement dessiné comme une interrogation "sur la pierre de touche d'une métaphysique afin de la rendre enfin crédible". Face à la nature dogmatique qu'a imposé la métaphysique de l'époque kantienne, il faut inéluctablement procéder à une enquête sur les fondamentaux de mise en évidence d'une connaissance métaphysique afin que celle-ci soit possible. L'examen critique des prétentions légitimes de la raison pure a donné droits à une métaphysique de la nature (humaine) par laquelle il faut justifier chez lui la possibilité de la métaphysique. Elle l'est bel et bien pour Kant aussi bien en possibilité qu'en effectivité dès lors qu'elle "se borne à être une connaissance des "conditions a priori de l'expérience", théorique et pratique, ou des objets d'une expérience possible".
La subtilité d'une telle métaphysique vient du fait qu'elle reste fondée sur l'expérience en tant qu'aucune connaissance ne peut extrapoler cette censure du monde empirique. Cependant elle transgresse toute limitation notamment de l'expérience par le fait qu'elle en questionne les conditions a priori. C'est pourquoi le penseur du sens de l'être, ne se préoccupant pas de réaliser une philosophie première, maintient l'élan d'une première philosophie c'est-à-dire celle qui ne peut se délaisser de l'être. Face à ce dynamisme métaphysique, la phénoménologie de la donation avec Jean-Luc Marion aura attesté que l'ontologie donatrice ne peut être une donation ontologique qu'en tenant la métaphysique comme "transgression". Car, si l'être métaphysique n'est pas identifié, la métaphysique perd de son être.
BIBLIOGRAPHIE
BRETON Stanislas, "Réflexions sur la fonction méta" in Dialogue, 21, 1982.
GREISCH Jean, La "fonction méta" dans l'espace contemporain du pensable", in Le statut contemporain de la philosophie première. Centenaire de la Faculté de Philosophie. Collectif, Institut catholique de Paris, 1997.
-, Le Cogito herméneutique. L'herméneutique philosophique et l'héritage cartésien, Paris, Vrin, 2000.
GRONDIN Jean, Du sens des choses. L'idée de la métaphysique, Paris, Puf, 2013
HONNEFELDER Ludge, La métaphysique comme science transcendantale, Paris, Puf, 2002.
HUSSERL Edmund, Recherches logiques (Logische Untersuchungen), 1ère édition, Halle, 1900-1901
HEIDEGGER Martin, Die Kategorien-und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1915), Gesamtausgabe,I.Abteilung, Band 1, Francfort-sur-le-Main, 1978.
-, Concepts fondamentaux de la métaphysique du semestre d'hiver 1929/1930, GA 29/30, 19.
KANT Emmanuel, Critique de la raison pure, KrV A VIII.
MARION Jean-Luc, Les Limites de la phénoménalité, Conférence Bucarest, Mis en ligne le 4 Décembre 2015.
-, "La fin de la métaphysique comme possibilité", in Heidegger, Les Cahiers d'histoire de la philosophie, Cerf, Paris, Avril, 2006.
Notes :
Husserl, Recherches logiques (Logische Untersuchungen), 1ère édition, Halle, 1900-1901
Jean-Luc Marion "Pour une part essentielle, la phénoménologie assume, en notre siècle, le rôle même de la philosophie".
Ludger Honnefelder, La métaphysique comme science transcendantale, Paris, Puf, 2002.
Ibid, p.99.
Cf., Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, KrV A VIII.
Idem.
Ludger Honnefelder, op.cit. p. 102.
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, KrV B114.
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, KrV A 11.
Martin Heidegger, Essais et Conférences, in Questions III, Paris, Gallimard,1958, p.90
Ibid., p.82.
Ludger Honnefelder, op.cit., p.24.
Ibid., p.25.
Idem.
Ibid., p.28.
Ibid., p.29.
Ibid., p.30.
Ibid., p.32.
Ludger Honnefelder, op.cit. p.32.
Martin Heidegger, Die Kategorien-und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1915), Gesamtausgabe (cité GA),I.Abteilung, Band 1, Francfort-sur-le-Main, 1978.
Ludfer Honnefelder, op. cit., p. 36.
Idem.
Ludger Honnefelder, op. cit., p. 115
Cf W. S. O. Quine, From a Logical Point of View. Cité par Ludger Honnefelder, op. cit., p. 111
Ludger Honnefelder, op. cit., p. 117.
Jean Grondin, Du sens des choses. L'idée de la métaphysique, Paris, Puf, 2013
Ibid., p. 119
Ibid.Avant-Propos, VI.
Idem.
Ibid., p. 51.
Ibid., Avant-propos, VII.
Idem.
Ibid., p. 51
Cf., Pierre Aubenque, Faut-il déconstruire la métaphysique, Paris, Puf, 2009.
Jean Grondin, op.cit., p.1.
Idem., p. 5.
Roland Techou, De la finitude. Lecture du Kantbuch de Martin Heidegger. Thèse inédite, Paris, ICP, 2017.
Jean-Luc Marion, Les Limites de la phénoménalité, Conférence Bucarest, 2015.
Cf., Martin Heidegger, Qu'est-ce que la métaphysique ? 1929.
Jean Grondin, op.cit., p. 5.
Idem.
Jean Grondin, op.cit., p.7.
Jean Greisch, La "fonction méta" dans l'espace contemporain du pensable", in Le statut contemporain de la philosophie première. Centenaire de la Faculté de Philosophie. Collectif, Institut catholique de Paris, 1997
Jean-Grondin, op. cit., p. 6
Cf Stanislas Breton, "Réflexions sur la fonction méta" in Dialogue, 21, 1982.
Jean-Luc Marion, "La fin de la métaphysique comme possibilité", in Heidegger, Les Cahiers d'histoire de la philosophie, Cerf, Paris, p. 17 et 22 : "Paradoxalement (la fin de la métaphysique, loin d'interdire la philosophie, lui rend donc son terrain La lecture phénoménologique (autrement dit par destruction) de l'histoire de la métaphysique, exige une double tâche. D'abord interpréter les doctrines selon leur constitution ontothéologique, ensuite lire, dans ces figures de l'ontothéologie ce qu'elles laissent impensé et comment elles le laissent impensé- l'être comme tel".
Jean Greisch, Le Cogito herméneutique. L'herméneutique philosophique et l'héritage cartésien, Vrin, Paris, 2000.
Martin Heidegger, Concepts fondamentaux de la métaphysique du semestre d'hiver 1929/1930, GA 29/30, 19.
GA 29/30, 77.
Cf Stanislas Breton, "Réflexions sur la fonction méta" in Dialogue, 21, 1982.
Jean Greisch, La "fonction méta" dans l'espace contemporain du pensable", in Le statut contemporain de la philosophie première. Centenaire de la Faculté de Philosophie. Collectif, Institut catholique de Paris, 1997
Ibid., p. 20.
La fin n'en serait que le commencement. La réplique de Husserl et de Heidegger à Étienne Gilson en est une belle illustration "Ce dont notre temps a besoin, c'est d'une phénoménologie conçue comme prolégomènes à toute métaphysique de l'être" disaient-ils contre Gilson qui affirma dans L'être et l'essence, que "Ce dont notre temps a besoin, c'est d'une métaphysique de l'être conçue comme prolégomènes à toute phénoménologie", L'être et l'essence, Vrin, Paris, 1972, p. 22.
Jean Greisch, La "fonction méta" dans l'espace contemporain du pensable", in Le statut contemporain de la philosophie première. Centenaire de la Faculté de Philosophie. Collectif, Institut catholique de Paris, 1997
Emmanuel Kant, Ak IV, 259.
Ibid., p. 20.
Emmanuel Kant, Ak IV, 259. KrV A711/B739.