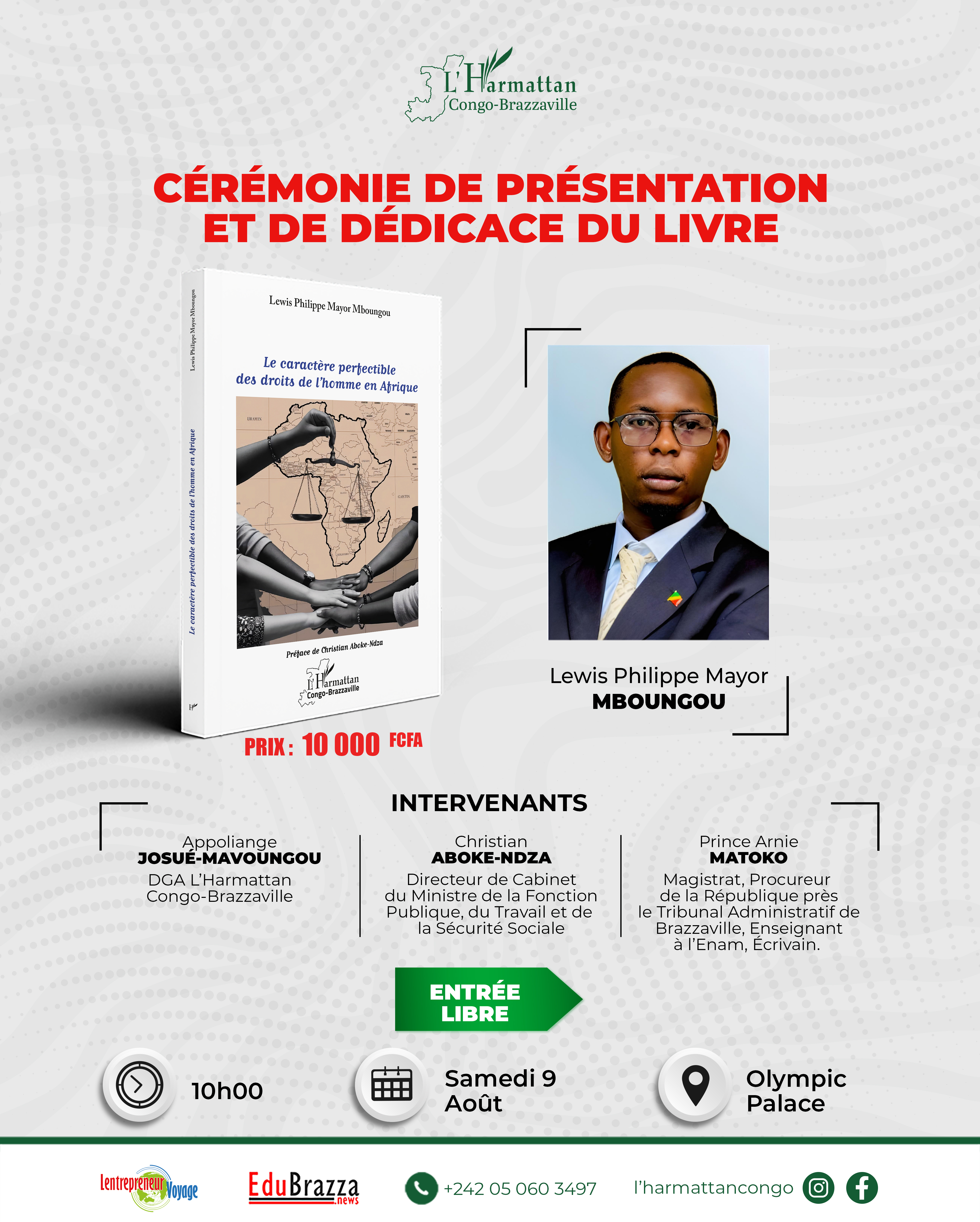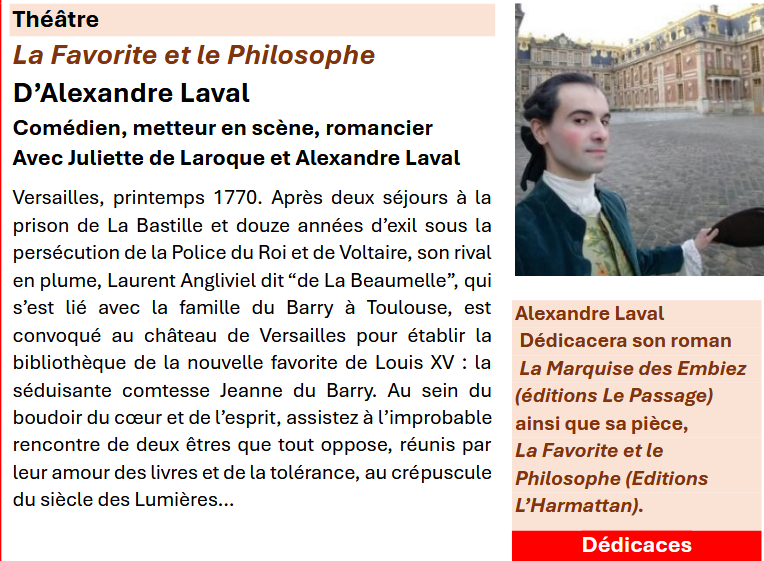5
livres
Vous avez vu 11 livre(s) sur 5
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Un retour à Saïs avec Bachelard, Spinoza, Novalis et quelques autres pour lever le Voile sur la Nature et l'Esprit
Citation :
Le chercheur véritable
ne devient jamais vieux.
Novalis,
Les Disciples à Saïs
On ne sait, à chaque pas qu'on fait,
si on marche sur une semence ou un débris.
Alfred de Musset
Confession d'un enfant du siècle
Permettez-moi de revenir exactement soixante-dix ans en arrière. Nous sommes aujourd'hui en 2023. En l'année 1953, j'étais étudiant à l'université. J'ambitionnais de devenir géologue, ou trouver un autre métier proche, pour me permette de m'aventurer dans le vaste monde et y vivre, loin de la société poussiéreuse et compassée dans laquelle je me trouvais, aux premières années de l'après deuxième guerre mondiale. Il me fallait donc étudier la géologie et/ou autres sciences connexes, ce qui n'interdisait pas de pratiquer une certaine culture. Je lisais beaucoup, un peu de tout, et écoutais de la musique, classique cela va de soi. Les Quatre saisons de Vivaldi et les derniers quatuors de Beethoven, découverts à cette époque grâce aux "Jeunesses musicales de France" et à la "Tribune des critiques de disques," ont laissé en moi une empreinte durable.
C'est dans ce contexte de 1953 qu'un ami, étudiant en psychologie et philosophie, m'a parlé d'un certain Gaston Bachelard (1884-1962). Je me suis précipité sur deux de ses livres, "L'Eau et les rêves," et "La Terre et les rêveries de la volonté," qui appartenaient à la seconde partie de son uvre, celle consacrée à "l'imagination de la matière." Il s'y réfère parfois à l'"idéalisme magique" de Novalis" et cite surtout son "Henri d'Ofterdingen." Le nom de Novalis apparaît ainsi imprimé 29 fois dans "L'eau " et 9 fois dans "La Terre " Depuis les lectures de 1953, Novalis a occupé un petit coin de ma mémoire, causant toujours un vif plaisir lorsque de nouvelles recherches ranimaient son souvenir. Je précise que (dans les deux livres lus en 1953) Bachelard s'intéressait à Novalis sous l'angle de l'imaginaire et du langage poétique, négligeant "Les Disciples à Saïs," texte plus proche du problème de la connaissance et du savoir en général. J'y reviendrai plus loin.
La vie estudiantine achevée n'a pas mis fin à mes explorations culturelles. Très vite je suis passé du Bachelard analyste des rêves et de la poésie au Bachelard antérieur, philosophe des sciences et père fondateur de l'épistémologie. Après de longues années à étudier les sols tropicaux, j'ai soutenu en 1976 mon Doctorat d'État à la Faculté des Sciences de Dijon, celle précisément où Bachelard est devenu professeur d'Université, avant de passer à la Sorbonne. J'avais pris Bachelard dont je connaissais par les livres et le journalisme toute la vie, presque picaresque à ses débuts, pour emblème auquel me référer. Ma thèse s'intitulait "Une épistémologie des sciences du sol," elle donnait en bibliographie trois ouvrages du Bachelard écrivain, maître à penser de l'intelligentsia française, "Le nouvel esprit scientifique" (Alcan, 1934), "La philosophie du non : essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique" (1940, PUF), "Le matérialisme rationnel" (1953 PUF). Mon jury voyait en moi le disciple direct de l'ancien universitaire dijonnais. La soutenance et les mondanités qui ont suivi sont parmi les meilleurs moments de ma vie professionnelle, et la thèse a été éditée dans la série des Mémoires aux Éditions de l'ORSTOM.
En réalité, il n'y avait pas que du Bachelard en arrière-plan de cette thèse. Démarche inattendue pour un spécialiste du sol, j'avais parcouru aussi la philosophie médiévale, celle que l'on dénomme scolastique, et qui a généré la "Querelle des universaux." Dans les années 1960, il n'en était guère question que chez les médiévistes et jamais à propos des sciences modernes, chez les maîtres de l'épistémologie, de l'histoire et philosophie des sciences, les Bachelard, Thomas Kuhn, Alexandre Koyré. Seul Bertrand Russel avait édifié des catégories y ressemblant. Quant à moi, j'avais bien étudié la question, et je vais tenter de l'exposer très simplement. Les "universaux" sont les éléments fondamentaux de nos pensées, nos raisonnements, nos discours. S'ils ont une existence en soi, nous vivons dans le "réalisme." S'ils ne sont que de simples mots, exprimant les concepts de notre esprit, nous sommes dans le "nominalisme." Je garde les noms de Thomas d'Aquin pour les réalistes, et de Guillaume d'Ockam pour les nominalistes.
J'ai pris le risque d'introduire réalisme et nominalisme dans mon épistémologie des sciences du sol. Il me semblait que cela correspondait à deux attitudes fondamentales expliquant bien, en autres, les divergences de plusieurs "écoles" de la pédologie de l'époque. La pédologie américaine (USDA), avec sa taxonomie des sols, était du coté nominaliste. La science russe marxisante et soviétique était le pôle réaliste. Quant aux équipes coloniales et européennes de la pédologie tropicale, elles cherchaient leur équilibre, plus réaliste pour les Français (ORSTOM), plus nominaliste pour les Belges de l'INEAC à Yangambi, etc. Toujours est-il que mon analyse a été bien acceptée par mon jury de thèse, et notamment par la Professeure universitaire de philosophe qui en faisait partie, Jeanne Parain-Vial. Les mots "réalisme," "réaliste" ont été mis à toutes les sauces au cours du temps, je ne les conserve ici qu'au sens donné par la scolastique et en l'appliquant à la compréhension des sciences.
Il n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la scolastique des 12e et 13e siècles à la philosophia naturalis de la Renaissance, sa teinture d'alchimie, de magie, d'astrologie, d'imagination, de rêve, et surtout sa prétention, de pénétrer la vraie nature de tout ce qui existe, Lâchons le mot : il s'agit d'une forme de panthéisme. Paracelse (1493-1541) est le premier théoricien de ce "Grand Tout" (une expression moderne) pas très différent de la "Substance" de Spinoza (voir plus loin). Il n'y a rien au ciel et sur la terre, disait Paracelse, qui ne soit dans l'homme. Le problème est que le mix panthéiste doit inclure Dieu, si on lui donne une existence, quelque soit le mot employé, surtout celui des religions. Giordano Bruno (1548-1600) en a fait la triste expérience. Il est resté célèbre pour avoir été envoyé au bûcher par l'Inquisition qui le taxait d'athéisme démoniaque. Plus explicitement que Paracelse, il voyait Dieu, ou mieux dit l'Esprit divin, dans tout ce que nous appelons la Nature, l'Univers, la Création. Et l'Homme, bien entendu. Troisième panthéiste par ordre chronologie, retenons aussi Jacob Böehme (1575-1624). Il était cordonnier mais sujet à des illuminations lui permettant d'atteindre "le fond et le sans fond" de toutes choses et êtres vivants, et Dieu aussi qui imbibait le tout. Son travail d'artisan lui laissait le temps de mettre par écrit le résultat de ses illuminations et réflexions. Ce cordonnier panthéiste théosophe plaisait à Novalis qui ne l'a pas mentionné explicitement dans "Les Disciples à Saïs," mais utilisé largement dans "Henri d'Ofterdingen" sous le couvert d'un personnage romanesque.
C'est en chercheur scientifique moderne que je me suis autrefois intéressé au panthéisme et à ses trois représentants ci-dessus. Étant moi-même devenu agnostique depuis longtemps, je ne pensais pas comme eux trouver le Dieu des religions monothéistes dans tout ce qui existe. Je pressentais seulement l'unité fondamentale de l'Univers, permettant (sans que l'on puisse l'expliquer davantage) une bonne adéquation entre la science et ses objets. Très intuitivement, c'est ce que l'on perçoit aussi dans la belle formule d'Hubert Reeves, à savoir que nous, les hommes, ne sommes que des "poussières d'étoiles" (Le Seuil, 1984). Avec presque les mêmes mots, "Nous devons être des étoiles," disait déjà Novalis, dans ses "Hymnes à la nuit."On verra plus loin qu'en penser aujourd'hui.
J'ai délaissé la scolastique, le panthéisme et même l'épistémologie après la soutenance de 1976. D'autres sujets m'ont mobilisé, au cours du temps, surtout après la retraite prise le 31 mai 1995 qui me donnait une totale liberté. J'ai toujours eu un certain intérêt pour la philosophie lorsqu'elle s'applique au problème de la connaissance. Souvent ai-je dit que je travaillais la nuit, car les bonnes idées surgissent pour moi au réveil. Voilà donc qu'un matin de juin 2019 j'ai mis pied à terre avec la décision de prendre Spinoza, philosophe sépharade du siècle d'or hollandais, comme nouveau sujet de travail. Je ne connaissais pas grand-chose au 17e siècle, rien sur les Juifs, leur histoire et leur culte, rien sur les Pays-Bas, pas beaucoup sur Spinoza, n'étant pas moi-même philosophe de profession, mais j'ai persisté dans ma décision. Ont suivi six mois d'une documentation acharnée, puis une année calendaire pleine, consacrée à l'écriture assortie d'un complément documentaire, quand nécessaire, au fil des pages.
Quelques mois ont ensuite été nécessaires pour que mon merveilleux éditeur, L'Harmattan, sorte de presses à la mi-2021 "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Je dirais aujourd'hui que ce n'est ni une biographie, ni un traité philosophique, mais un exercice littéraire sur Spinoza (au lieu d'un récit univoque, on y trouve une pluralité de locuteurs, points de vue, modes d'expression). La préparation puis la publication du livre, à ce stade de la vie, étaient pour moi une aventure au résultat incertain, ce qui explique le choix des deux citations en exergue ci-dessus (n'être jamais vieux accepter de toute recherche débutante d'être semence ou débris ). J'ai ensuite complété mon travail d'écriture par 62 mind maps formalisant l'uvre du philosophe, sur Coggle.it, disponibles librement en ligne, jusqu'à leur disparition par inadvertance de ma part (non renouvellement d'abonnement). Les mind maps ne sont plus que des images archivées sur mon ordinateur.
L'uvre majeure de Spinoza s'intitule ‟L'Éthique," il y déploie une philosophie rationnelle et déductive, suivant ‟une méthode géométrique" fondée sur des définitions, axiomes, postulats. Ouvrons cet ouvrage. La Première Partie est titrée d'un ‟De Deo" facile à comprendre sans être grand latiniste. Spinoza se met à parler de Dieu, d'emblée, après avoir seulement posé 8 définitions et 7 axiomes. Son raisonnement se développe par des propositions géométriquement enchaînées. Il n'est pas question de donner des ‟preuves" de l'existence de Dieu, à la manière des Chrétiens, mais de démontrer et d'analyser son existence. Il apparaît dans ‟L'Éthique" à la 11e proposition, et se trouve défini ainsi : ‟Dieu, autrement dit une Substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." Chaque mot doit être soigneusement pesé. Retenons aussi la quinzième proposition, ‟Tout ce qui est, est en Dieu, et rien, sans Dieu, ne peut être ni être conçu."
Dans l'"L'Éthique", l'homme surgit seulement dans la Deuxième partie, avec le 1er axiome ‟L'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence " suivi du 2e axiome ‟L'homme pense." Il faut ensuite parvenir à la 10e proposition pour apprendre que ‟la Substance ne constitue pas la forme de l'homme." On est rassuré ‟L'Éthique" peut ensuite se déployer géométriquement, jusqu'à découvrir et analyser toutes ces petites choses dont parlent tant de philosophes, désir, joie, tristesse, espoir, pitié, amour, haine, miséricorde, orgueil etc. Il faut parvenir à la 4e Partie, sous le titre "De l'esclavage de l'Homme, ou de la force des affects" pour que Spinoza énonce enfin dans un langage clair ce qu'il avait démontré (géométriquement !) dans les deux premières Parties. Il s'agit du fameux Deus sive Natura, que l'on traduit par Dieu est la Nature, ou Dieu c'est-à-dire la Nature. Retenons au moins ces deux phrases, "Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou Nature agit comme il existe, avec une égale nécessité" et "La raison ou la cause par laquelle Dieu, c'est-à-dire la Nature, agit, et la raison ou la cause par laquelle il existe, sont une seule et même chose." Pour changer de langage, convenons qu'il s'agit d'une parfaite définition du panthéisme.
Dans un texte mis en ligne par L'Harmattan, j'ai posé la question : "Spinoza a-t-il été bon géomètre ?" En d'autres termes, parvient-il à la démonstration rationnelle et rigoureuse de ses propositions, et de la plus importante d'entre elles, le Deus sive Natura ? Le grand philosophe Francis Kaplan a prouvé, sur des cas partiels, que Spinoza n'est pas toujours logique. Sans verser dans le scepticisme et le criticisme, et en s'appuyant sur Kaplan, on peut douter de la perfection de la méthode géométrique spinozienne. Dès lors, Spinoza n'aurait-il pas eu, sans l'avouer, l'intuition fondamentale de l'unité de tout ce qui existe, n'aurait-il pas été panthéiste (sans employer le mot), avant de mettre en uvre ses prétendues démonstrations ? Cette place d'une intuition première, initiale, rapproche, plus encore que leur panthéisme, le philosophe rationaliste et cartésien à l'origine qu'a été Spinoza du poète romantique et philosophe appelé Novalis.
Venons-en à la plus récente de mes inspirations matinales. À ce moment, je connaissais bien Spinoza et beaucoup plus légèrement Novalis, depuis mon temps bachelardien et les lectures épisodiques ultérieures. Il m'est néanmoins venu à l'idée de faire un parallèle entre leurs idées sur la Nature et, d'un même mouvement, sur Dieu. Les deux personnages Spinoza et Novalis, se ressemblant si peu, l'entreprise m'a paru hasardeuse et, avant d'aller plus loin, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle. J'ai posé à Chatgpt la question : "Quelqu'un a-t-il exploré le lien entre les pensées de Spinoza et de Novalis ?" Voici les éléments marquants de la réponse obtenue : " Bien que Spinoza et Novalis aient vécu à des époques différentes et aient développé des idées distinctes, il y a eu des discussions et des analyses qui ont exploré les liens possibles entre leurs pensées. " Je retiens aussi cette remarque : "Spinoza a développé l'idée d'amour intellectuel de Dieu, dans lequel la connaissance de la Nature conduit à l'amour de Dieu compris comme Substance infinie. Novalis a également exploré des thèmes mystiques et spirituels, et certains chercheurs ont noté des similitudes entre l'approche de Novalis envers l'amour et la spiritualité et l'idée d'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza."
Malgré ma demande, Chatgpt s'est refusé à en dire plus et donner ses références. J'ai alors entamé mes propres recherches et n'ai pas tardé à tomber sur Jane Kneller. Professeure émérite (c'est-à-dire retraitée) de la Colorado State Université (CSU), à Fort Collins (CO), elle est une grande spécialiste de Kant et l'idéalisme allemand (Fiche, Schelling, Novalis). Les liens intellectuels entre Spinoza et Novalis ne sont pas des éléments philosophiques majeurs, mais ils ont été perçus et analysés par elle mieux que par quiconque d'autre. Je retiens donc son papier "Novalis, Spinoza and the Realization of Nature," (International Yearbook of German Idealism 2019, De Gruyter EBooks). J'ajoute seulement que Jane Kneller a clairement justifié un rapprochement entre Spinoza et Novalis, et je reconnais être dans ce qui suit beaucoup plus simple qu'elle, véritable philosophe de haut rang. Bien que l'université de l'État y soit implantée, Fort Collins est une ville d'importance moyenne, sertie dans de magnifiques paysages, au bord de la rivière Cache-la-poudre dont le nom rappelle les trappeurs français d'un lointain passé. En plus de l'université, la ville héberge un Museum of Discovery. J'ai autrefois parcouru l'État du Colorado, visitant sa capitale Denver et sa deuxième ville Boulder, mais pas Fort Collins.
On ne peut pas imaginer personnage plus romantique que Novalis, de son vrai nom Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, dont la vie terrestre a duré moins de 28 ans pleins, de mai 1772 à mars 1801. Il était l'un des rejetons d'une famille de très vieille noblesse allemande, de Saxe plus précisément. Un petit musée dans sa maison natale et une statue auprès de sa tombe honorent sa mémoire à Weißenfels, sur la rivière Saale. Le jeune Friedrich (Frédéric en français) était certainement un surdoué, il a fréquenté plusieurs universités, à Iéna, Leipzig, Wittenberg (ville natale de Martin Luther) étudiant presque toute les disciplines, philosophie, droit, mathématique, et enfin la géologie à Freiberg. Dans cette dernière spécialité, il a eu pour professeur Abraham Gottlob Werner, le maître du neptunisme, théorie voyant dans un océan primordial l'origine de toutes les roches rencontrées dans nos paysages superficiels. Adolescent, Friedrich était déjà auteur d'un grand nombre de textes, poèmes, contes, scènes de théâtres, essais théoriques. Il a pris Novalis comme nom de plume pour éditer sa première uvre, "Grains de pollen," alors qu'il n'avait que 17 ans.
Sans doute était-il, jusqu'en amour, de la même espèce que les étoiles filantes. Lui-même âgé de 22 ans, il est tombé follement amoureux d'une certaine Sophie qui avait à peine 13 ans. Hélas, fiancée à Novalis et attendant le mariage, Sophie est morte de la tuberculose deux ans plus tard. "La douleur soulève ma poitrine, je veux baigner mon front dans la rosée et me jeter dans la cendre des cimetières." Cette déclaration ouvre les "Hymnes à la nuit" dont Sophie a été la grande inspiratrice, peu après sa mort. Autre invocation à retenir : "L'amour t'envoie à moi, oh, ma douce bien-aimée !" Ces hymnes, écrits suite à la mort de Sophie mais publiés seulement en 1800, sont une sorte de poème en vers libres (puis en prose pour publication) d'un lyrisme débridé et d'une beauté étrange. Bien que célébrant le culte de son premier amour, Novalis s'est fiancé une deuxième fois, avec une certaine Julie, fille d'un professeur de mathématiques. Il s'est éteint avant d'arriver au mariage, étant lui-même d'une santé fragile et incapable de surmonter la tuberculose. De ses deux amours, il a élaboré le personnage de Mathilde, rencontrée par son Henri d'Ofterdingen, éponyme romanesque de lui-même.
L'uvre de Novalis peut sembler aujourd'hui déroutante. Il faut remarquer d'abord qu'elle a la spontanéité de la jeunesse et qu'elle est restée inachevée ou au moins à remanier. Texte pourtant majeur pour connaître cet auteur, "Henri d'Ofterdingen" comprend ainsi une intégrale Première partie (L'attente), et une Deuxième (L'accomplissement) qui devrait se conclure par les plus importants messages, mais qui est arrêtée après une quinzaine de pages. Ajoutons que Novalis mélange tous les genres, scolies (simples notes qu'il appelle Fragments), récits romanesques, réflexions philosophiques, invocations poétiques, déclarations mystiques. S'agissant du panthéisme dont poursuivons la trace chez différents auteurs, il ne faut pas s'attendre à en trouver chez lui une claire et concise définition. Il faudra l'interpréter, par compréhension de son "langage intime reposant sur les tréfonds de son cerveau et de sa pensée."
Novalis n'a pas clairement explicité le choix de son titre "Les Disciples à Saïs." Par l'histoire et la littérature, il savait que Saïs était une ville prospère et de haute civilisation lors de l'antiquité égyptienne (Hérodote lui-même en a parlé). Elle était située dans le vaste delta du Nil. Du temps de notre auteur, les vestiges étaient masqués par les dépôts éoliens, les constructions villageoises, les terres agricoles. Des fouilles récentes ont exhumé les restes de nombreux édifices architecturaux prestigieux, mais Novalis n'en a rien su, évidemment. La ville antique avait Neith pour déesse tutélaire. Selon les cas, cette Neith apparaît identique à la déesse Isis, ou à la déesse Athéna. Retenant Saïs dans le titre de son ouvrage (inachevé), Novalis ne s'est pas embarrassé d'expliquer le choix de cette cité. On trouve dans son texte les rapides allusions que voici. Se dirigeant vers Saïs, les voyageurs imaginaires du récit sont attirés par "l'antiquité de son temple" dont "des sages gardaient les archives." Celui qui ne voudrait pas chercher la connaissance intime du Monde "n'est pas un véritable disciple à Saïs."
Le voyage à Saïs décrit par Novalis est une aventure initiatique. Le procédé narratif est comparable à celui expliqué plus haut pour "Henri d'Ofterdingen," tenant à la fois du roman, de l'essai et du rêve. Trois personnages sont à retenir. Le jeune homme qui représente Novalis en sa quête mystique s'appelle ici Hyacinthe, c'est surtout lui qui parle, mais il laisse aussi les autres s'exprimer. La jeune fille, image de la féminité et l'amour, est Rosenblütchen (pétale de rose). Le plus important est évidemment le Maître, toujours désigné ainsi parce que privé de patronyme. Novalis fait volontiers appel à des vieillards comme initiateurs, car ils sont supposés avoir acquis sagesse et connaissance, s'étant approchés de l'âge d'or, "des temps anciens où les bêtes, les arbres et les rochers conversaient, dit-on, avec les hommes." Le Maître des "Disciples à Saïs" a été inspiré à Novalis par son professeur de géologie, Abraham Gottlob Werner.
La déesse de référence pour Novalis ne s'appelle pas Neith mais Isis. "Hyacinthe à travers les vallées et les déserts, par les torrents et les montagnes, se hâta vers la sainte demeure d'Isis la déesse sacrée." On sait qu'à l'origine c'était une déesse égyptienne, mais elle a été adoptée par les Grecs puis les Romains et son personnage s'est ainsi beaucoup enrichi. Elle est devenue "mère des étoiles, parente des saisons et maîtresse du monde entier" (Apulée, 2e siècle de notre ère). On l'appelle aussi "déesse voilée," ou "déesse au voile bleu," et on lui doit l'expression "soulever le voile" qui signifie accéder à un savoir caché. En réalité, dans "Les disciples à Saïs" les références textuelles à Isis sont rarissimes, réduites à quelques mots, mais il ne faut pas demander à Novalis une précision et un langage d'entomologiste. On trouve aussi "le voile de la vierge éternelle" dans ses "Fragments," En définitive, on ne peut contester le symbole qu'apporte Isis dans le choix de Saïs, par Novalis. Je prétends être plus clair que lui, proposant de "lever le Voile sur la Nature et l'Esprit" (titre ci-dessus).
Maurice Maeterlinck (1895) a été le traducteur et grand analyste de Novalis, dont il dit ceci. "Peut-être est-il celui qui a pénétré le plus profondément la nature intime et mystique et l'unité secrète de l'univers." Ouvrons "Les Disciples à Saïs" à sa première page. On y découvre "cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout : sur les ailes, sur la coque des ufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poix lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les attouche : dans les limailles qui entourent l'aimant, et dans les étranges conjonctures du hasard..." La grande écriture chiffrée de Novalis est celle qui forme "l'unité secrète de l'univers" selon Maeterlinck. Plus simplement dit, sans poésie ni mystère, c'est l'affirmation du panthéisme que nous recherchons.
Novalis a quitté un monde terrestre poétique, romantique, enchanté, à l'orée du 19e siècle. Si la déesse Isis existe encore depuis l'époque antique et a conservé tous ses pouvoirs, elle a eu l'occasion de lever son voile à maintes reprises. Un de ses gestes les plus féconds a permis à Albert Einstein (grand admirateur de Spinoza) d'affirmer l'équivalence de la masse et de l'énergie, et de l'exprimer par la formule E=mc2. Depuis tout a continué à changer dans la science fondamentale. Je suis incapable d'en comprendre tous les développements mais tente de les suivre par les médias de vulgarisation. Voici ce que j'en retiens pour alimenter ma présente démarche. Selon certains scientifiques d'avant-garde, l'information devient, après l'énergie, une nouvelle forme de la matière. L'univers pourrait se décrire ainsi comme une simple simulation (cf. Melvin Vopson, University of Porthmouth, GB). Patrick Ruiz l'a bien expliqué le 13 octobre 2023 (www.developpez.com, radio, réseaux sociaux). Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle prétend atteindre des états de conscience que l'on croyait une exclusivité humaine. La science de notre 21e siècle, dans toutes ses avancées, fait rebondir le panthéisme intuitif des Paracelse, Bruno, Böehme, Spinoza, Novalis.
Heureusement, il nous reste la Poésie dont Novalis prétendait que c'est (avec l'intuition qui lui est liée) la forme ultime de la connaissance de la Nature. "Nul ne la comprendra qui, spontanément, ne la distingue et ne la reconnaît en toutes choses, et qui grâce à une joie innée d'engendrer, et se sentant une intime et multiple affinité avec tous les corps, ne se mêle à tous les êtres de la Nature, et ne se retrouve pour ainsi dire, en eux." Ainsi trouve-t-on au fil des pages de Novalis les astres, les roches, les fleurs, les animaux en intime connexion avec l'homme. Pour clore mon texte dans cet esprit, j'ai choisi un poème-chanson de Bob Dylan (Prix Nobel de littérature, 13 octobre 2016). Les "êtres de la Nature" sont ici le soleil, la nuit, le vent, la mer, le rivage, la marée, les rochers, les sables, les poissons, les oiseaux, et "the whole wide world." Ils sourient, rient, se dressent, s'exaltent à l'unisson des hommes, comme cela se passait aux temps lointains de "l'âge d'or" selon Novalis.
Oh, the time will come up
When the winds will stop
And the breeze will cease to be breathin'
Like the stillness in the wind
Before the hurricane begins
The hour that the ship comes in
And the seas will split
And the ship will hit
And the sands on the shoreline will be shaking
Then the tide will sound
And the wind will pound
And the morning will be breaking
Oh, the fishes will laugh
As they swim out of the path
And the seagulls they'll be smiling
And the rocks on the sand
Will proudly stand
The hour that the ship comes in
And the words that are used
For to get the ship confused
Will not be understood as they're spoken
For the chains of the sea
Will have busted in the night
And will be buried at the bottom of the ocean
A song will lift
As the mainsail shifts
And the boat drifts on to the shoreline
And the sun will respect
Every face on the deck
The hour that the ship comes in
Then the sands will roll
Out a carpet of gold
For your weary toes to be a-touchin'
And the ship's wise men
Will remind you once again
That the whole wide world is watchin'
Oh, the foes will rise
With the sleep still in their eyes
And they'll jerk from their beds and think they're dreamin'
But they'll pinch themselves and squeal
And know that it's for real
The hour when the ship comes in
Then they'll raise their hands
Sayin' we'll meet all your demands
But we'll shout from the bow your days are numbered
And like Pharaoh's tribe
They'll be drownded in the tide
And like Goliath, they'll be conquered.
Les commentateurs actuels disent et répètent que cette chanson (comme la plus célèbre Blowin' in the Wind), écrite au début des années 1960, est un acte militant en faveur des droits des minorités en Amérique. Soutenu par l'engagement d'intellectuels et artistes comme Dylan, le Civil Rigths Act a été signé un an ou deux plus tard. Cela n'explique pas beaucoup l'imagerie de la chanson When the ship comes in (ci-dessus, et adaptée par Hugues Aufray, Le jour où le bateau viendra). Bob Dylan lui-même dit s'être inspiré de la Bible (ou la Torah des familles juives, ashkénaze pour lui et sépharade pour Spinoza) et de l'Apocalypse (celle de Saint Jean, très probablement.) Acceptons cette assertion un peu surprenante.
Mais d'où vient le bateau de la chanson, où atterre-t-il ? Il existe dans la culture occidentale de nombreuses versions d'un vaisseau mystérieux qui va accoster sur une terre lointaine, ou une île perdue dans l'océan. Ces contes et légendes sont considérés comme de lointains dérivés de l'Atlantide de Platon (Timée, Critias). Or l'histoire de l'Atlantide, bien que formulée par Platon, aurait son origine dans le récit d'un prêtre de la déesse Neith à Saïs. Beaucoup de questions s'ouvrent à nous. Novalis devait connaître Platon, mais a-t-il lu l'Apocalypse, s'est-il inspiré de son imagerie, le rêve attribué à Henri d'Ofterdingen est-il en rapport avec celui de Saint Jean dans l'île appelée Patmos ? Qui sont les hommes de la chanson de Bob Dylan, ceux du bateau, ceux qui attendent au rivage ? Je laisse à d'autres le soin de recherches approfondies, sur les précédentes questions et bien d'autres que l'on peut se poser. Mais enfin, pour moi, après le renvoi à Platon et la déesse Neith, le retour à Saïs se trouve bouclé.
Lire plus
Le chercheur véritable
ne devient jamais vieux.
Novalis,
Les Disciples à Saïs
On ne sait, à chaque pas qu'on fait,
si on marche sur une semence ou un débris.
Alfred de Musset
Confession d'un enfant du siècle
Permettez-moi de revenir exactement soixante-dix ans en arrière. Nous sommes aujourd'hui en 2023. En l'année 1953, j'étais étudiant à l'université. J'ambitionnais de devenir géologue, ou trouver un autre métier proche, pour me permette de m'aventurer dans le vaste monde et y vivre, loin de la société poussiéreuse et compassée dans laquelle je me trouvais, aux premières années de l'après deuxième guerre mondiale. Il me fallait donc étudier la géologie et/ou autres sciences connexes, ce qui n'interdisait pas de pratiquer une certaine culture. Je lisais beaucoup, un peu de tout, et écoutais de la musique, classique cela va de soi. Les Quatre saisons de Vivaldi et les derniers quatuors de Beethoven, découverts à cette époque grâce aux "Jeunesses musicales de France" et à la "Tribune des critiques de disques," ont laissé en moi une empreinte durable.
C'est dans ce contexte de 1953 qu'un ami, étudiant en psychologie et philosophie, m'a parlé d'un certain Gaston Bachelard (1884-1962). Je me suis précipité sur deux de ses livres, "L'Eau et les rêves," et "La Terre et les rêveries de la volonté," qui appartenaient à la seconde partie de son uvre, celle consacrée à "l'imagination de la matière." Il s'y réfère parfois à l'"idéalisme magique" de Novalis" et cite surtout son "Henri d'Ofterdingen." Le nom de Novalis apparaît ainsi imprimé 29 fois dans "L'eau " et 9 fois dans "La Terre " Depuis les lectures de 1953, Novalis a occupé un petit coin de ma mémoire, causant toujours un vif plaisir lorsque de nouvelles recherches ranimaient son souvenir. Je précise que (dans les deux livres lus en 1953) Bachelard s'intéressait à Novalis sous l'angle de l'imaginaire et du langage poétique, négligeant "Les Disciples à Saïs," texte plus proche du problème de la connaissance et du savoir en général. J'y reviendrai plus loin.
La vie estudiantine achevée n'a pas mis fin à mes explorations culturelles. Très vite je suis passé du Bachelard analyste des rêves et de la poésie au Bachelard antérieur, philosophe des sciences et père fondateur de l'épistémologie. Après de longues années à étudier les sols tropicaux, j'ai soutenu en 1976 mon Doctorat d'État à la Faculté des Sciences de Dijon, celle précisément où Bachelard est devenu professeur d'Université, avant de passer à la Sorbonne. J'avais pris Bachelard dont je connaissais par les livres et le journalisme toute la vie, presque picaresque à ses débuts, pour emblème auquel me référer. Ma thèse s'intitulait "Une épistémologie des sciences du sol," elle donnait en bibliographie trois ouvrages du Bachelard écrivain, maître à penser de l'intelligentsia française, "Le nouvel esprit scientifique" (Alcan, 1934), "La philosophie du non : essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique" (1940, PUF), "Le matérialisme rationnel" (1953 PUF). Mon jury voyait en moi le disciple direct de l'ancien universitaire dijonnais. La soutenance et les mondanités qui ont suivi sont parmi les meilleurs moments de ma vie professionnelle, et la thèse a été éditée dans la série des Mémoires aux Éditions de l'ORSTOM.
En réalité, il n'y avait pas que du Bachelard en arrière-plan de cette thèse. Démarche inattendue pour un spécialiste du sol, j'avais parcouru aussi la philosophie médiévale, celle que l'on dénomme scolastique, et qui a généré la "Querelle des universaux." Dans les années 1960, il n'en était guère question que chez les médiévistes et jamais à propos des sciences modernes, chez les maîtres de l'épistémologie, de l'histoire et philosophie des sciences, les Bachelard, Thomas Kuhn, Alexandre Koyré. Seul Bertrand Russel avait édifié des catégories y ressemblant. Quant à moi, j'avais bien étudié la question, et je vais tenter de l'exposer très simplement. Les "universaux" sont les éléments fondamentaux de nos pensées, nos raisonnements, nos discours. S'ils ont une existence en soi, nous vivons dans le "réalisme." S'ils ne sont que de simples mots, exprimant les concepts de notre esprit, nous sommes dans le "nominalisme." Je garde les noms de Thomas d'Aquin pour les réalistes, et de Guillaume d'Ockam pour les nominalistes.
J'ai pris le risque d'introduire réalisme et nominalisme dans mon épistémologie des sciences du sol. Il me semblait que cela correspondait à deux attitudes fondamentales expliquant bien, en autres, les divergences de plusieurs "écoles" de la pédologie de l'époque. La pédologie américaine (USDA), avec sa taxonomie des sols, était du coté nominaliste. La science russe marxisante et soviétique était le pôle réaliste. Quant aux équipes coloniales et européennes de la pédologie tropicale, elles cherchaient leur équilibre, plus réaliste pour les Français (ORSTOM), plus nominaliste pour les Belges de l'INEAC à Yangambi, etc. Toujours est-il que mon analyse a été bien acceptée par mon jury de thèse, et notamment par la Professeure universitaire de philosophe qui en faisait partie, Jeanne Parain-Vial. Les mots "réalisme," "réaliste" ont été mis à toutes les sauces au cours du temps, je ne les conserve ici qu'au sens donné par la scolastique et en l'appliquant à la compréhension des sciences.
Il n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la scolastique des 12e et 13e siècles à la philosophia naturalis de la Renaissance, sa teinture d'alchimie, de magie, d'astrologie, d'imagination, de rêve, et surtout sa prétention, de pénétrer la vraie nature de tout ce qui existe, Lâchons le mot : il s'agit d'une forme de panthéisme. Paracelse (1493-1541) est le premier théoricien de ce "Grand Tout" (une expression moderne) pas très différent de la "Substance" de Spinoza (voir plus loin). Il n'y a rien au ciel et sur la terre, disait Paracelse, qui ne soit dans l'homme. Le problème est que le mix panthéiste doit inclure Dieu, si on lui donne une existence, quelque soit le mot employé, surtout celui des religions. Giordano Bruno (1548-1600) en a fait la triste expérience. Il est resté célèbre pour avoir été envoyé au bûcher par l'Inquisition qui le taxait d'athéisme démoniaque. Plus explicitement que Paracelse, il voyait Dieu, ou mieux dit l'Esprit divin, dans tout ce que nous appelons la Nature, l'Univers, la Création. Et l'Homme, bien entendu. Troisième panthéiste par ordre chronologie, retenons aussi Jacob Böehme (1575-1624). Il était cordonnier mais sujet à des illuminations lui permettant d'atteindre "le fond et le sans fond" de toutes choses et êtres vivants, et Dieu aussi qui imbibait le tout. Son travail d'artisan lui laissait le temps de mettre par écrit le résultat de ses illuminations et réflexions. Ce cordonnier panthéiste théosophe plaisait à Novalis qui ne l'a pas mentionné explicitement dans "Les Disciples à Saïs," mais utilisé largement dans "Henri d'Ofterdingen" sous le couvert d'un personnage romanesque.
C'est en chercheur scientifique moderne que je me suis autrefois intéressé au panthéisme et à ses trois représentants ci-dessus. Étant moi-même devenu agnostique depuis longtemps, je ne pensais pas comme eux trouver le Dieu des religions monothéistes dans tout ce qui existe. Je pressentais seulement l'unité fondamentale de l'Univers, permettant (sans que l'on puisse l'expliquer davantage) une bonne adéquation entre la science et ses objets. Très intuitivement, c'est ce que l'on perçoit aussi dans la belle formule d'Hubert Reeves, à savoir que nous, les hommes, ne sommes que des "poussières d'étoiles" (Le Seuil, 1984). Avec presque les mêmes mots, "Nous devons être des étoiles," disait déjà Novalis, dans ses "Hymnes à la nuit."On verra plus loin qu'en penser aujourd'hui.
J'ai délaissé la scolastique, le panthéisme et même l'épistémologie après la soutenance de 1976. D'autres sujets m'ont mobilisé, au cours du temps, surtout après la retraite prise le 31 mai 1995 qui me donnait une totale liberté. J'ai toujours eu un certain intérêt pour la philosophie lorsqu'elle s'applique au problème de la connaissance. Souvent ai-je dit que je travaillais la nuit, car les bonnes idées surgissent pour moi au réveil. Voilà donc qu'un matin de juin 2019 j'ai mis pied à terre avec la décision de prendre Spinoza, philosophe sépharade du siècle d'or hollandais, comme nouveau sujet de travail. Je ne connaissais pas grand-chose au 17e siècle, rien sur les Juifs, leur histoire et leur culte, rien sur les Pays-Bas, pas beaucoup sur Spinoza, n'étant pas moi-même philosophe de profession, mais j'ai persisté dans ma décision. Ont suivi six mois d'une documentation acharnée, puis une année calendaire pleine, consacrée à l'écriture assortie d'un complément documentaire, quand nécessaire, au fil des pages.
Quelques mois ont ensuite été nécessaires pour que mon merveilleux éditeur, L'Harmattan, sorte de presses à la mi-2021 "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Je dirais aujourd'hui que ce n'est ni une biographie, ni un traité philosophique, mais un exercice littéraire sur Spinoza (au lieu d'un récit univoque, on y trouve une pluralité de locuteurs, points de vue, modes d'expression). La préparation puis la publication du livre, à ce stade de la vie, étaient pour moi une aventure au résultat incertain, ce qui explique le choix des deux citations en exergue ci-dessus (n'être jamais vieux accepter de toute recherche débutante d'être semence ou débris ). J'ai ensuite complété mon travail d'écriture par 62 mind maps formalisant l'uvre du philosophe, sur Coggle.it, disponibles librement en ligne, jusqu'à leur disparition par inadvertance de ma part (non renouvellement d'abonnement). Les mind maps ne sont plus que des images archivées sur mon ordinateur.
L'uvre majeure de Spinoza s'intitule ‟L'Éthique," il y déploie une philosophie rationnelle et déductive, suivant ‟une méthode géométrique" fondée sur des définitions, axiomes, postulats. Ouvrons cet ouvrage. La Première Partie est titrée d'un ‟De Deo" facile à comprendre sans être grand latiniste. Spinoza se met à parler de Dieu, d'emblée, après avoir seulement posé 8 définitions et 7 axiomes. Son raisonnement se développe par des propositions géométriquement enchaînées. Il n'est pas question de donner des ‟preuves" de l'existence de Dieu, à la manière des Chrétiens, mais de démontrer et d'analyser son existence. Il apparaît dans ‟L'Éthique" à la 11e proposition, et se trouve défini ainsi : ‟Dieu, autrement dit une Substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." Chaque mot doit être soigneusement pesé. Retenons aussi la quinzième proposition, ‟Tout ce qui est, est en Dieu, et rien, sans Dieu, ne peut être ni être conçu."
Dans l'"L'Éthique", l'homme surgit seulement dans la Deuxième partie, avec le 1er axiome ‟L'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence " suivi du 2e axiome ‟L'homme pense." Il faut ensuite parvenir à la 10e proposition pour apprendre que ‟la Substance ne constitue pas la forme de l'homme." On est rassuré ‟L'Éthique" peut ensuite se déployer géométriquement, jusqu'à découvrir et analyser toutes ces petites choses dont parlent tant de philosophes, désir, joie, tristesse, espoir, pitié, amour, haine, miséricorde, orgueil etc. Il faut parvenir à la 4e Partie, sous le titre "De l'esclavage de l'Homme, ou de la force des affects" pour que Spinoza énonce enfin dans un langage clair ce qu'il avait démontré (géométriquement !) dans les deux premières Parties. Il s'agit du fameux Deus sive Natura, que l'on traduit par Dieu est la Nature, ou Dieu c'est-à-dire la Nature. Retenons au moins ces deux phrases, "Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou Nature agit comme il existe, avec une égale nécessité" et "La raison ou la cause par laquelle Dieu, c'est-à-dire la Nature, agit, et la raison ou la cause par laquelle il existe, sont une seule et même chose." Pour changer de langage, convenons qu'il s'agit d'une parfaite définition du panthéisme.
Dans un texte mis en ligne par L'Harmattan, j'ai posé la question : "Spinoza a-t-il été bon géomètre ?" En d'autres termes, parvient-il à la démonstration rationnelle et rigoureuse de ses propositions, et de la plus importante d'entre elles, le Deus sive Natura ? Le grand philosophe Francis Kaplan a prouvé, sur des cas partiels, que Spinoza n'est pas toujours logique. Sans verser dans le scepticisme et le criticisme, et en s'appuyant sur Kaplan, on peut douter de la perfection de la méthode géométrique spinozienne. Dès lors, Spinoza n'aurait-il pas eu, sans l'avouer, l'intuition fondamentale de l'unité de tout ce qui existe, n'aurait-il pas été panthéiste (sans employer le mot), avant de mettre en uvre ses prétendues démonstrations ? Cette place d'une intuition première, initiale, rapproche, plus encore que leur panthéisme, le philosophe rationaliste et cartésien à l'origine qu'a été Spinoza du poète romantique et philosophe appelé Novalis.
Venons-en à la plus récente de mes inspirations matinales. À ce moment, je connaissais bien Spinoza et beaucoup plus légèrement Novalis, depuis mon temps bachelardien et les lectures épisodiques ultérieures. Il m'est néanmoins venu à l'idée de faire un parallèle entre leurs idées sur la Nature et, d'un même mouvement, sur Dieu. Les deux personnages Spinoza et Novalis, se ressemblant si peu, l'entreprise m'a paru hasardeuse et, avant d'aller plus loin, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle. J'ai posé à Chatgpt la question : "Quelqu'un a-t-il exploré le lien entre les pensées de Spinoza et de Novalis ?" Voici les éléments marquants de la réponse obtenue : " Bien que Spinoza et Novalis aient vécu à des époques différentes et aient développé des idées distinctes, il y a eu des discussions et des analyses qui ont exploré les liens possibles entre leurs pensées. " Je retiens aussi cette remarque : "Spinoza a développé l'idée d'amour intellectuel de Dieu, dans lequel la connaissance de la Nature conduit à l'amour de Dieu compris comme Substance infinie. Novalis a également exploré des thèmes mystiques et spirituels, et certains chercheurs ont noté des similitudes entre l'approche de Novalis envers l'amour et la spiritualité et l'idée d'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza."
Malgré ma demande, Chatgpt s'est refusé à en dire plus et donner ses références. J'ai alors entamé mes propres recherches et n'ai pas tardé à tomber sur Jane Kneller. Professeure émérite (c'est-à-dire retraitée) de la Colorado State Université (CSU), à Fort Collins (CO), elle est une grande spécialiste de Kant et l'idéalisme allemand (Fiche, Schelling, Novalis). Les liens intellectuels entre Spinoza et Novalis ne sont pas des éléments philosophiques majeurs, mais ils ont été perçus et analysés par elle mieux que par quiconque d'autre. Je retiens donc son papier "Novalis, Spinoza and the Realization of Nature," (International Yearbook of German Idealism 2019, De Gruyter EBooks). J'ajoute seulement que Jane Kneller a clairement justifié un rapprochement entre Spinoza et Novalis, et je reconnais être dans ce qui suit beaucoup plus simple qu'elle, véritable philosophe de haut rang. Bien que l'université de l'État y soit implantée, Fort Collins est une ville d'importance moyenne, sertie dans de magnifiques paysages, au bord de la rivière Cache-la-poudre dont le nom rappelle les trappeurs français d'un lointain passé. En plus de l'université, la ville héberge un Museum of Discovery. J'ai autrefois parcouru l'État du Colorado, visitant sa capitale Denver et sa deuxième ville Boulder, mais pas Fort Collins.
On ne peut pas imaginer personnage plus romantique que Novalis, de son vrai nom Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, dont la vie terrestre a duré moins de 28 ans pleins, de mai 1772 à mars 1801. Il était l'un des rejetons d'une famille de très vieille noblesse allemande, de Saxe plus précisément. Un petit musée dans sa maison natale et une statue auprès de sa tombe honorent sa mémoire à Weißenfels, sur la rivière Saale. Le jeune Friedrich (Frédéric en français) était certainement un surdoué, il a fréquenté plusieurs universités, à Iéna, Leipzig, Wittenberg (ville natale de Martin Luther) étudiant presque toute les disciplines, philosophie, droit, mathématique, et enfin la géologie à Freiberg. Dans cette dernière spécialité, il a eu pour professeur Abraham Gottlob Werner, le maître du neptunisme, théorie voyant dans un océan primordial l'origine de toutes les roches rencontrées dans nos paysages superficiels. Adolescent, Friedrich était déjà auteur d'un grand nombre de textes, poèmes, contes, scènes de théâtres, essais théoriques. Il a pris Novalis comme nom de plume pour éditer sa première uvre, "Grains de pollen," alors qu'il n'avait que 17 ans.
Sans doute était-il, jusqu'en amour, de la même espèce que les étoiles filantes. Lui-même âgé de 22 ans, il est tombé follement amoureux d'une certaine Sophie qui avait à peine 13 ans. Hélas, fiancée à Novalis et attendant le mariage, Sophie est morte de la tuberculose deux ans plus tard. "La douleur soulève ma poitrine, je veux baigner mon front dans la rosée et me jeter dans la cendre des cimetières." Cette déclaration ouvre les "Hymnes à la nuit" dont Sophie a été la grande inspiratrice, peu après sa mort. Autre invocation à retenir : "L'amour t'envoie à moi, oh, ma douce bien-aimée !" Ces hymnes, écrits suite à la mort de Sophie mais publiés seulement en 1800, sont une sorte de poème en vers libres (puis en prose pour publication) d'un lyrisme débridé et d'une beauté étrange. Bien que célébrant le culte de son premier amour, Novalis s'est fiancé une deuxième fois, avec une certaine Julie, fille d'un professeur de mathématiques. Il s'est éteint avant d'arriver au mariage, étant lui-même d'une santé fragile et incapable de surmonter la tuberculose. De ses deux amours, il a élaboré le personnage de Mathilde, rencontrée par son Henri d'Ofterdingen, éponyme romanesque de lui-même.
L'uvre de Novalis peut sembler aujourd'hui déroutante. Il faut remarquer d'abord qu'elle a la spontanéité de la jeunesse et qu'elle est restée inachevée ou au moins à remanier. Texte pourtant majeur pour connaître cet auteur, "Henri d'Ofterdingen" comprend ainsi une intégrale Première partie (L'attente), et une Deuxième (L'accomplissement) qui devrait se conclure par les plus importants messages, mais qui est arrêtée après une quinzaine de pages. Ajoutons que Novalis mélange tous les genres, scolies (simples notes qu'il appelle Fragments), récits romanesques, réflexions philosophiques, invocations poétiques, déclarations mystiques. S'agissant du panthéisme dont poursuivons la trace chez différents auteurs, il ne faut pas s'attendre à en trouver chez lui une claire et concise définition. Il faudra l'interpréter, par compréhension de son "langage intime reposant sur les tréfonds de son cerveau et de sa pensée."
Novalis n'a pas clairement explicité le choix de son titre "Les Disciples à Saïs." Par l'histoire et la littérature, il savait que Saïs était une ville prospère et de haute civilisation lors de l'antiquité égyptienne (Hérodote lui-même en a parlé). Elle était située dans le vaste delta du Nil. Du temps de notre auteur, les vestiges étaient masqués par les dépôts éoliens, les constructions villageoises, les terres agricoles. Des fouilles récentes ont exhumé les restes de nombreux édifices architecturaux prestigieux, mais Novalis n'en a rien su, évidemment. La ville antique avait Neith pour déesse tutélaire. Selon les cas, cette Neith apparaît identique à la déesse Isis, ou à la déesse Athéna. Retenant Saïs dans le titre de son ouvrage (inachevé), Novalis ne s'est pas embarrassé d'expliquer le choix de cette cité. On trouve dans son texte les rapides allusions que voici. Se dirigeant vers Saïs, les voyageurs imaginaires du récit sont attirés par "l'antiquité de son temple" dont "des sages gardaient les archives." Celui qui ne voudrait pas chercher la connaissance intime du Monde "n'est pas un véritable disciple à Saïs."
Le voyage à Saïs décrit par Novalis est une aventure initiatique. Le procédé narratif est comparable à celui expliqué plus haut pour "Henri d'Ofterdingen," tenant à la fois du roman, de l'essai et du rêve. Trois personnages sont à retenir. Le jeune homme qui représente Novalis en sa quête mystique s'appelle ici Hyacinthe, c'est surtout lui qui parle, mais il laisse aussi les autres s'exprimer. La jeune fille, image de la féminité et l'amour, est Rosenblütchen (pétale de rose). Le plus important est évidemment le Maître, toujours désigné ainsi parce que privé de patronyme. Novalis fait volontiers appel à des vieillards comme initiateurs, car ils sont supposés avoir acquis sagesse et connaissance, s'étant approchés de l'âge d'or, "des temps anciens où les bêtes, les arbres et les rochers conversaient, dit-on, avec les hommes." Le Maître des "Disciples à Saïs" a été inspiré à Novalis par son professeur de géologie, Abraham Gottlob Werner.
La déesse de référence pour Novalis ne s'appelle pas Neith mais Isis. "Hyacinthe à travers les vallées et les déserts, par les torrents et les montagnes, se hâta vers la sainte demeure d'Isis la déesse sacrée." On sait qu'à l'origine c'était une déesse égyptienne, mais elle a été adoptée par les Grecs puis les Romains et son personnage s'est ainsi beaucoup enrichi. Elle est devenue "mère des étoiles, parente des saisons et maîtresse du monde entier" (Apulée, 2e siècle de notre ère). On l'appelle aussi "déesse voilée," ou "déesse au voile bleu," et on lui doit l'expression "soulever le voile" qui signifie accéder à un savoir caché. En réalité, dans "Les disciples à Saïs" les références textuelles à Isis sont rarissimes, réduites à quelques mots, mais il ne faut pas demander à Novalis une précision et un langage d'entomologiste. On trouve aussi "le voile de la vierge éternelle" dans ses "Fragments," En définitive, on ne peut contester le symbole qu'apporte Isis dans le choix de Saïs, par Novalis. Je prétends être plus clair que lui, proposant de "lever le Voile sur la Nature et l'Esprit" (titre ci-dessus).
Maurice Maeterlinck (1895) a été le traducteur et grand analyste de Novalis, dont il dit ceci. "Peut-être est-il celui qui a pénétré le plus profondément la nature intime et mystique et l'unité secrète de l'univers." Ouvrons "Les Disciples à Saïs" à sa première page. On y découvre "cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout : sur les ailes, sur la coque des ufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poix lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les attouche : dans les limailles qui entourent l'aimant, et dans les étranges conjonctures du hasard..." La grande écriture chiffrée de Novalis est celle qui forme "l'unité secrète de l'univers" selon Maeterlinck. Plus simplement dit, sans poésie ni mystère, c'est l'affirmation du panthéisme que nous recherchons.
Novalis a quitté un monde terrestre poétique, romantique, enchanté, à l'orée du 19e siècle. Si la déesse Isis existe encore depuis l'époque antique et a conservé tous ses pouvoirs, elle a eu l'occasion de lever son voile à maintes reprises. Un de ses gestes les plus féconds a permis à Albert Einstein (grand admirateur de Spinoza) d'affirmer l'équivalence de la masse et de l'énergie, et de l'exprimer par la formule E=mc2. Depuis tout a continué à changer dans la science fondamentale. Je suis incapable d'en comprendre tous les développements mais tente de les suivre par les médias de vulgarisation. Voici ce que j'en retiens pour alimenter ma présente démarche. Selon certains scientifiques d'avant-garde, l'information devient, après l'énergie, une nouvelle forme de la matière. L'univers pourrait se décrire ainsi comme une simple simulation (cf. Melvin Vopson, University of Porthmouth, GB). Patrick Ruiz l'a bien expliqué le 13 octobre 2023 (www.developpez.com, radio, réseaux sociaux). Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle prétend atteindre des états de conscience que l'on croyait une exclusivité humaine. La science de notre 21e siècle, dans toutes ses avancées, fait rebondir le panthéisme intuitif des Paracelse, Bruno, Böehme, Spinoza, Novalis.
Heureusement, il nous reste la Poésie dont Novalis prétendait que c'est (avec l'intuition qui lui est liée) la forme ultime de la connaissance de la Nature. "Nul ne la comprendra qui, spontanément, ne la distingue et ne la reconnaît en toutes choses, et qui grâce à une joie innée d'engendrer, et se sentant une intime et multiple affinité avec tous les corps, ne se mêle à tous les êtres de la Nature, et ne se retrouve pour ainsi dire, en eux." Ainsi trouve-t-on au fil des pages de Novalis les astres, les roches, les fleurs, les animaux en intime connexion avec l'homme. Pour clore mon texte dans cet esprit, j'ai choisi un poème-chanson de Bob Dylan (Prix Nobel de littérature, 13 octobre 2016). Les "êtres de la Nature" sont ici le soleil, la nuit, le vent, la mer, le rivage, la marée, les rochers, les sables, les poissons, les oiseaux, et "the whole wide world." Ils sourient, rient, se dressent, s'exaltent à l'unisson des hommes, comme cela se passait aux temps lointains de "l'âge d'or" selon Novalis.
Oh, the time will come up
When the winds will stop
And the breeze will cease to be breathin'
Like the stillness in the wind
Before the hurricane begins
The hour that the ship comes in
And the seas will split
And the ship will hit
And the sands on the shoreline will be shaking
Then the tide will sound
And the wind will pound
And the morning will be breaking
Oh, the fishes will laugh
As they swim out of the path
And the seagulls they'll be smiling
And the rocks on the sand
Will proudly stand
The hour that the ship comes in
And the words that are used
For to get the ship confused
Will not be understood as they're spoken
For the chains of the sea
Will have busted in the night
And will be buried at the bottom of the ocean
A song will lift
As the mainsail shifts
And the boat drifts on to the shoreline
And the sun will respect
Every face on the deck
The hour that the ship comes in
Then the sands will roll
Out a carpet of gold
For your weary toes to be a-touchin'
And the ship's wise men
Will remind you once again
That the whole wide world is watchin'
Oh, the foes will rise
With the sleep still in their eyes
And they'll jerk from their beds and think they're dreamin'
But they'll pinch themselves and squeal
And know that it's for real
The hour when the ship comes in
Then they'll raise their hands
Sayin' we'll meet all your demands
But we'll shout from the bow your days are numbered
And like Pharaoh's tribe
They'll be drownded in the tide
And like Goliath, they'll be conquered.
Les commentateurs actuels disent et répètent que cette chanson (comme la plus célèbre Blowin' in the Wind), écrite au début des années 1960, est un acte militant en faveur des droits des minorités en Amérique. Soutenu par l'engagement d'intellectuels et artistes comme Dylan, le Civil Rigths Act a été signé un an ou deux plus tard. Cela n'explique pas beaucoup l'imagerie de la chanson When the ship comes in (ci-dessus, et adaptée par Hugues Aufray, Le jour où le bateau viendra). Bob Dylan lui-même dit s'être inspiré de la Bible (ou la Torah des familles juives, ashkénaze pour lui et sépharade pour Spinoza) et de l'Apocalypse (celle de Saint Jean, très probablement.) Acceptons cette assertion un peu surprenante.
Mais d'où vient le bateau de la chanson, où atterre-t-il ? Il existe dans la culture occidentale de nombreuses versions d'un vaisseau mystérieux qui va accoster sur une terre lointaine, ou une île perdue dans l'océan. Ces contes et légendes sont considérés comme de lointains dérivés de l'Atlantide de Platon (Timée, Critias). Or l'histoire de l'Atlantide, bien que formulée par Platon, aurait son origine dans le récit d'un prêtre de la déesse Neith à Saïs. Beaucoup de questions s'ouvrent à nous. Novalis devait connaître Platon, mais a-t-il lu l'Apocalypse, s'est-il inspiré de son imagerie, le rêve attribué à Henri d'Ofterdingen est-il en rapport avec celui de Saint Jean dans l'île appelée Patmos ? Qui sont les hommes de la chanson de Bob Dylan, ceux du bateau, ceux qui attendent au rivage ? Je laisse à d'autres le soin de recherches approfondies, sur les précédentes questions et bien d'autres que l'on peut se poser. Mais enfin, pour moi, après le renvoi à Platon et la déesse Neith, le retour à Saïs se trouve bouclé.
Rendre l'Histoire vivante par les manières de la raconter
L'Histoire est l'affaire de tout le monde. Certains, comme, Gandhi y voient un moyen d'alimenter et justifier les luttes sociales (et surtout anticoloniales, dans son cas). Je considère plus volontiers,(Note 1) avec bien d'autres personnages plus autorisés que moi, le rôle de l'Histoire auprès d'un public cultivé, lequel a deux exigences principales : l'exactitude et la lisibilité. Ceci étant rappelé, je vais me permettre quelques souvenirs et anecdotes, en introduction à mes manières de raconter l'Histoire.
-------
Note 1 - J'ai pourtant publié un jour "Science et développement. L'Histoire peut-elle recommencer ?" Revue Tiers-Monde, 1986, vol. 27, n° 105, pp 5-24.
-------
Premiers jalons
L'exactitude, la véracité tout d'abord : une qualité peut-être inatteignable tout à fait, comme le pensent beaucoup de sceptiques. Oublions les grossiers mensonges et déformations, à la manière d'un Jules César, acteur et chroniqueur de la Guerre des Gaules L'Histoire sera cependant ré-écrite indéfiniment, parce qu'elle aura toujours de nouveaux faits anciens à découvrir et surtout parce que ceux qui la racontent sont inévitablement imprégnés des philosophies, idéologies, préjugés de leur époque.
Un autre Jules me vient à l'esprit. Avec Michelet pour auteur, on a vu apparaître en plein 19ème siècle une "Histoire de France" à prétention encyclopédique (en 17 tomes, de 1833 à 1867), imprégnée de romantisme, dont la grande valeur tient au style, aux qualités descriptives, au pouvoir évocateur et émotionnel. Jules Michelet est lisible non seulement par les spécialistes mais aussi par un grand public cultivé. À certains moments, je me suis intéressé à ses évocations de la Nature (surtout "La république des oiseaux," 1856, "Histoire d'un ruisseau" 1869). Autre mérite, il a passé une grande partie de sa vie au château de Vascil, à petite distance du Rouen familial de ma jeunesse.
C'est à l'époque de ma jeunesse justement, qu'est apparue l'uvre qui, à mes yeux, a le plus développé cette attractivité que l'on doit accorder à l'Histoire. Je veux parler de la série des "Rois maudits," sous la signature de Maurice Druon. Celui-ci en était l'incontestable rédacteur, ayant la plume alerte, et il s'appuyait sur la collaboration de plusieurs historiens spécialisés. Toujours est-il que le souvenir des "Rois maudits" (7 volumes, de 1955 à 1977) m'imprègne encore et qu'on peut y voir l'origine du goût que je développe actuellement pour l'Histoire.
La petite Histoire, comme la grande, a ses imprévus. Il se trouve que, venant de publier chez France-Empire une biographie du grand artiste naturaliste Audubon, auteur des inestimables "Oiseaux d'Amérique," j'ai eu l'idée de présenter mon livre à quelques personnalités et journalistes. Cela s'est fait le samedi 23 mars 2002, dans la bibliothèque centrale de l'Institut de France qui possède un jeu complet de ces 435 gravures aquarellées d'oiseaux. Pour l'autorisation nécessaire, il fallait la présence de deux Académiciens. Eh bien, l'un d'eux a été Maurice Druon ! Il a été des plus aimables, sachant montrer qu'il avait lu mon texte, au moins en partie, car il est au format 21 x 29,7 et compte 465 pages de texte serré ! J'ai quelques photos sur lesquelles apparaissent les gravures que je feuillette en les commentant, Maurice Druon parmi les spectateurs, et moi-même. Un bon souvenir
Les locuteurs
Des centaines, des milliers d'autres écrivains que Michelet et Druon, aussi doués qu'eux ou non, ont produit des montagnes de textes historiques. Dans un premier cas, il s'agit d'archives ou de documents qui y ressemblent, dans lesquels s'accumulent des données factuelles, brutes ou presque. Plus souvent, dans le deuxième cas, les "bons auteurs" (ou tenus pour tels) enrichissent leurs documents de commentaires, interprétations, évaluations, jugements. C'est comme cela que l'on acquiert une grande réputation dans le monde des lettres. À leurs manières, Michelet et Druon procédaient ainsi, avec un peu d'excès peut-on penser.
La musique, par son vocabulaire, nous permet de catégoriser et nommer les styles et procédés suivis. Dans le premier cas, une seule voix s'exprime, c'est celle du passé, de personnages individuels ayant laissés souvenirs et témoignages, de documents indirects mais d'époque. C'est ce qu'on peut appeler monologue et qui, pour les musiciens est la monodie, le chant à une seule voix.
Au deuxième cas, dans lequel se rangeraient les Michelet et Druon, il y a bien entendu la voix de l'époque, mais les auteurs y ajoutent la leur, avec plus ou moins de force, de présence, de puissance dans l'imagerie et l'émotionnel. Dans le langage courant, c'est une sorte de dialogue, et pour les musiciens, un contrepoint.
Si de nouvelles voix viennent se faire entendre, au troisième cas, cela devient de la polyphonie pour les musiciens. Transposant cette notion à un texte historique, il faut que s'expriment davantage que deux locuteurs. Dans les nombreux documents que j'ai consultés (constituant un échantillonnage que je pense représentatif ), cela ne semble jamais le cas. Au mieux, trouve-t-on l'auteur attribuant ses propres interprétations à divers personnages du passé, aux documents bibliographiques, aux ouvrages de ses prédécesseurs, collègues ou rivaux du moment. Ce n'est pas encore la vraie polyphonie, dont je parlerai plus loin.
Un long chemin
"Aller droit au but" est une maxime du 18ème siècle qui s'applique assez mal à mon cas personnel. On peut s'en rendre compte en consultant ma fiche de présentation sur le site de l'Harmattan. J'ai longtemps suivi une carrière de chercheur professionnel dans les sciences de la terre, plus précisément en pédologie ou science du sol. Je suis passé ensuite à une branche de la sociologie, celle étudiant les sciences et leurs communautés d'acteurs. Ce n'est qu'arrivé à la retraite, ne disposant d'aucun laboratoire, service de documentation et autre soutien, que je me suis vraiment plongé dans l'Histoire, parce qu'on peut la pratiquer en free lance. J'ai commencé par l'Histoire de naturalistes célèbres (Bartram, Humboldt, Audubon et quelques autres).
Voyons cela de plus près. En 1972, pleinement engagé dans le travail pédologique, j'ai publié mon tout premier livre sous le titre "Les sols ferrallitiques. Historique. Développement des connaissances et formation des concepts actuels" (Éditions de l'Orstom). Mon but était de préparer un dépassement aux pratiques du moment, en initiant ce qui pouvait devenir un nouveau paradigme, orienté vers un langage transdisciplinaire, et plus généralement vers ce que Lévi-Strauss appelait la "science du concret." Considéré aujourd'hui, j'y vois déjà un pas vers l'Histoire.
Le deuxième pas est survenu vingt ans plus tard, en 1992, avec la publication de "Le voyage de William Bartram (1773-1776) Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain" (éditions Karthala). Le sous-titre indique clairement la thématique visée. Actuellement, il me semble devoir insister davantage sur la structure du livre et le traitement des données historiques. Une alternance de chapitres donnait la parole à Bartram (des extraits traduits par moi de son Travels) et au biographe (moi-même en l'occurrence). C'était du dialogue, du contrepoint, entre monodie et polyphonie.
Le plus gros et plus illustré, le mieux diffusé et vendu de mes livres est "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (2001). On y remarquera les libertés prises avec la chronologie. Tout d'abord, il débutait par la mort d'Audubon, avant de prendre le déroulé de sa vie depuis sa naissance. L'enchaînement chronologique était de plus interrompu par un chapitre intitulé "Des oiseaux, des hommes et quelques autres espèces." C'était le premier de mes bouquins écrits en toute liberté. J'étais parvenu à la retraite et pouvais travailler à ma guise.
Polyphonie(Note 2)
En dehors de causeries nombreuses, purement orales, j'ai beaucoup pratiqué Audubon. Je retiens les textes informels sur le site de l'Harmattan, et ceux publiés dans des catalogues d'exposition des Muséums d'histoire naturelle de Nantes et La Rochelle. Ce qui m'intéresse davantage est mon deuxième livre sur le même naturaliste portant le titre "Audubon raconté par ceux qui l'on connu." Il n'a pas été édité et reste jusqu'à présent un ebook chez KDP Amazon, en attendant mieux. Par son style, il est humoristique et gentiment satirique.
Audubon est dépeint par différents locuteurs, le titre le fait clairement comprendre. Le personnage attire ce genre d'exercice car de son vivant il a été aimé et détesté. Autrefois, ses adversaires étaient surtout des naturalistes en compétition avec lui. Par la suite, il a été célébré sans retenue, dans le domaine des sciences et des arts, pendant un bon siècle et demi. Aujourd'hui, il est voué aux gémonies par les woke lui reprochant d'avoir eu quelques esclaves, bien avant la Guerre civile américaine et leur émancipation. Les locuteurs de son temps qui l'ont connu et le mettent en perspective dans le livre sont variés. On y trouve la nounou Noire de son enfance, une marquise ayant fui la Révolution française, une Quakeresse amoureuse de lui, and the like. Et même un chien qui l'assistait dans la chasse aux oiseaux Peut-on faire plus polyphonique ?
Sur un registre beaucoup plus sérieux, j'ai repris mes réflexions sur le philosophe juif-sépharade-néerlandais Baruch Spinoza (1632-1677). Il arrive qu'on me demande combien de temps il m'a fallu (étant un ancien pédologue) pour produire un livre sur lui. J'ai deux réponses. La première est cinquante ans, parce que je me suis longtemps intéressé à sa conception de la Nature. La seconde est un an et demi. Ayant soudainement décidé d'uvrer sur Spinoza, j'ai complété mes informations pendant 6 mois puis consacré un an à écrire. Cela s'est passé entre juin 2019 et décembre 2020. Le livre a été publié quelques mois plus tard par l'Harmattan sous le titre "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Ma grande fierté est d'avoir reproduit en couverture le portrait gravé de Spinoza, avec la mention "Collection personnelle de l'Auteur." J'avais en effet acheté un exemplaire de la gravure pour 40 euros
La polyphonie y est plus riche que pour Audubon. Le livre se compose de 7 parties comprenant 3 ou 4 chapitres, faisant alterner les locuteurs et rythmant l'ensemble. On trouve dans ces chacune de ces parties Spinoza ranimant ses souvenirs, un ou deux personnages l'ayant connu, parlant de lui et de son uvre, et systématiquement un "modérateur" pour conclure. Parmi ceux qui s'expriment ainsi, apparaissent notamment son père, un rabbin sépharade, un savant de l'époque, un aristocrate prussien, etc. Quant au modérateur, il s'agit évidemment de moi-même voulant pondérer et compléter les propos des précédents locuteurs, parce qu'ils ont des perspectives variées, souvent bien différentes, ou insuffisantes.
-------
Note 2 - Nølke, Henning. "La polyphonie : analyses littéraire et linguistique",, in Le regard du locuteur 2. Pour une linguistique des traces énonciatives, sous la direction de Nølke Henning. Éditions Kimé, 2001, pp. 59-73.
-------
Diachronie
Le linguiste Ferdinand de Saussure (1857-1913) a créé avec "diachronie"(Note 3) le mot et le concept dont je vais user pour caractériser une nouvelle manière de traiter l'Histoire. Il s'agit ni plus ni moins que de casser le Temps, celui de l'Histoire, en la racontant ! Reconnaissons d'abord l'avoir déjà fait un peu, dans "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (voir plus haut) mais ce n'était qu'une petite coquetterie de style que je suis loin d'être le seul à avoir pratiquée. Il faut aller plus loin.
Voici près d'une dizaine d'années j'ai rédigé "L'artiste et le Révérend. Les derniers jours de Thomas Cole." Ce texte a la taille d'un livre normal, mais il est resté jusqu'à présent sous la forme d'un ebook chez KDP Amazon. L'artiste dont il est question est Thomas Cole (1801-1848), reconnu comme le premier vrai paysagiste américain et fondateur de la Hudson School of Painting. Le Révérend est son ami et premier biographe, Louis Noble. Le récit s'étend du samedi 5 février, jour auquel un coup de froid a rendu Cole malade, au vendredi 11 février, à l'instant de sa mort.
Chacun des 7 chapitres évoque un jour, un moment, un lieu précis. Les personnages mis en scène sont Thomas Cole, son épouse et sa famille proche, le pasteur épiscopalien Noble, un médecin et divers habitants du village. Les plus importants s'expriment, les autres sont des figurants muets, ou presque. La totalité de la vie de Thomas Cole, la description de ses uvres majeures, sont ainsi racontées, par fragments dissociés de la suite du temps et mêlés aux petits événements de chacune des 7 journées. Thomas Cole réfléchit à lui-même, se raconte pour ses proches, lesquels ajoutent détails et remarques. L'auteur (moi-même) remplit les vides. La diachronie s'accommode ainsi d'une certaine polyphonie.
J'ai repris récemment le procédé dans "Douze journées de Thomas Jefferson, maître d'esclaves," livre sorti des presses de l'Harmattan le 5 avril 2023. Les douze journées sont choisies à des dates précises, en raison des événements survenus, entre le moment où Jefferson (1743-1826), ayant achevé sa carrière politique, est revenu chez lui à Monticello, et celui de son décès. Toute la vie de Jefferson apparaît néanmoins, fragmentée et sans suivre la chronologie, au gré de moments de réflexion, de rencontres, de discussions. Une large part de l'histoire américaine se trouve aussi évoquée, quand de grands personnages viennent visiter l'ermite de Monticello. Retenons surtout Andrew Jackson, 7ème Président des États-Unis, et Lafayette, le "héros de deux mondes."
-------
Note 3 - Mot forgé par Ferdinand de Saussure, du grec ancien, composé de διά, diá (à travers) et de χρόνος, khrónos (temps). [Wikipedia]
-------
Conclure ?
Des livres comme ceux sur Spinoza et Jefferson ne sont pas des biographies, au sens strict. Je les considère comme des "biographies romancées," avec l'inconvénient que cela ne correspond pas à une catégorie utilisée dans l'édition. Ainsi peuvent-ils se trouver rangés parmi les romans, ce que je dois accepter tout en le déplorant. Pour moi, ils sont tout simplement de l'Histoire, dans une mise en forme amusante à composer et distrayante pour le lecteur. Le caractère "romancé" n'introduit rien de contraire à la vérité historique.
À n'importe quelle prétendue "nouveauté," on peut toujours trouver des antécédents, des précurseurs. Cela doit être le cas pour mes tentatives de polyphonie et diachronie en Histoire, mais je n'en ai vraiment pas rencontrés. J'ai lu au contraire un nombre incroyable de biographies savantes, dans lesquelles l'auteur tente seulement de mettre un peu d'élégance et d'animation par le style, mais selon un mode d'exposition rabâché des milliers de fois. Sans autre originalité
Toutefois, je ne vais pas me "monter le bourrichon,"(Note 4) à attendre je ne sais quelle reconnaissance, ou la gloire littéraire peut-être ! À mes polyphoniques et diachroniques personnages, Audubon, Cole, Jefferson et quelques autres, pour terminer, je souhaite seulement d'être un peu mieux connus par le public qui lit.
-------
Note 4 - Gustave Flaubert utilisait cette expression, pas dans ses romans, mais dans sa correspondance, et sans doute aussi de vive voix.
-------
Signature :
Yvon Chatelin
Lire plus
-------
Note 1 - J'ai pourtant publié un jour "Science et développement. L'Histoire peut-elle recommencer ?" Revue Tiers-Monde, 1986, vol. 27, n° 105, pp 5-24.
-------
Premiers jalons
L'exactitude, la véracité tout d'abord : une qualité peut-être inatteignable tout à fait, comme le pensent beaucoup de sceptiques. Oublions les grossiers mensonges et déformations, à la manière d'un Jules César, acteur et chroniqueur de la Guerre des Gaules L'Histoire sera cependant ré-écrite indéfiniment, parce qu'elle aura toujours de nouveaux faits anciens à découvrir et surtout parce que ceux qui la racontent sont inévitablement imprégnés des philosophies, idéologies, préjugés de leur époque.
Un autre Jules me vient à l'esprit. Avec Michelet pour auteur, on a vu apparaître en plein 19ème siècle une "Histoire de France" à prétention encyclopédique (en 17 tomes, de 1833 à 1867), imprégnée de romantisme, dont la grande valeur tient au style, aux qualités descriptives, au pouvoir évocateur et émotionnel. Jules Michelet est lisible non seulement par les spécialistes mais aussi par un grand public cultivé. À certains moments, je me suis intéressé à ses évocations de la Nature (surtout "La république des oiseaux," 1856, "Histoire d'un ruisseau" 1869). Autre mérite, il a passé une grande partie de sa vie au château de Vascil, à petite distance du Rouen familial de ma jeunesse.
C'est à l'époque de ma jeunesse justement, qu'est apparue l'uvre qui, à mes yeux, a le plus développé cette attractivité que l'on doit accorder à l'Histoire. Je veux parler de la série des "Rois maudits," sous la signature de Maurice Druon. Celui-ci en était l'incontestable rédacteur, ayant la plume alerte, et il s'appuyait sur la collaboration de plusieurs historiens spécialisés. Toujours est-il que le souvenir des "Rois maudits" (7 volumes, de 1955 à 1977) m'imprègne encore et qu'on peut y voir l'origine du goût que je développe actuellement pour l'Histoire.
La petite Histoire, comme la grande, a ses imprévus. Il se trouve que, venant de publier chez France-Empire une biographie du grand artiste naturaliste Audubon, auteur des inestimables "Oiseaux d'Amérique," j'ai eu l'idée de présenter mon livre à quelques personnalités et journalistes. Cela s'est fait le samedi 23 mars 2002, dans la bibliothèque centrale de l'Institut de France qui possède un jeu complet de ces 435 gravures aquarellées d'oiseaux. Pour l'autorisation nécessaire, il fallait la présence de deux Académiciens. Eh bien, l'un d'eux a été Maurice Druon ! Il a été des plus aimables, sachant montrer qu'il avait lu mon texte, au moins en partie, car il est au format 21 x 29,7 et compte 465 pages de texte serré ! J'ai quelques photos sur lesquelles apparaissent les gravures que je feuillette en les commentant, Maurice Druon parmi les spectateurs, et moi-même. Un bon souvenir
Les locuteurs
Des centaines, des milliers d'autres écrivains que Michelet et Druon, aussi doués qu'eux ou non, ont produit des montagnes de textes historiques. Dans un premier cas, il s'agit d'archives ou de documents qui y ressemblent, dans lesquels s'accumulent des données factuelles, brutes ou presque. Plus souvent, dans le deuxième cas, les "bons auteurs" (ou tenus pour tels) enrichissent leurs documents de commentaires, interprétations, évaluations, jugements. C'est comme cela que l'on acquiert une grande réputation dans le monde des lettres. À leurs manières, Michelet et Druon procédaient ainsi, avec un peu d'excès peut-on penser.
La musique, par son vocabulaire, nous permet de catégoriser et nommer les styles et procédés suivis. Dans le premier cas, une seule voix s'exprime, c'est celle du passé, de personnages individuels ayant laissés souvenirs et témoignages, de documents indirects mais d'époque. C'est ce qu'on peut appeler monologue et qui, pour les musiciens est la monodie, le chant à une seule voix.
Au deuxième cas, dans lequel se rangeraient les Michelet et Druon, il y a bien entendu la voix de l'époque, mais les auteurs y ajoutent la leur, avec plus ou moins de force, de présence, de puissance dans l'imagerie et l'émotionnel. Dans le langage courant, c'est une sorte de dialogue, et pour les musiciens, un contrepoint.
Si de nouvelles voix viennent se faire entendre, au troisième cas, cela devient de la polyphonie pour les musiciens. Transposant cette notion à un texte historique, il faut que s'expriment davantage que deux locuteurs. Dans les nombreux documents que j'ai consultés (constituant un échantillonnage que je pense représentatif ), cela ne semble jamais le cas. Au mieux, trouve-t-on l'auteur attribuant ses propres interprétations à divers personnages du passé, aux documents bibliographiques, aux ouvrages de ses prédécesseurs, collègues ou rivaux du moment. Ce n'est pas encore la vraie polyphonie, dont je parlerai plus loin.
Un long chemin
"Aller droit au but" est une maxime du 18ème siècle qui s'applique assez mal à mon cas personnel. On peut s'en rendre compte en consultant ma fiche de présentation sur le site de l'Harmattan. J'ai longtemps suivi une carrière de chercheur professionnel dans les sciences de la terre, plus précisément en pédologie ou science du sol. Je suis passé ensuite à une branche de la sociologie, celle étudiant les sciences et leurs communautés d'acteurs. Ce n'est qu'arrivé à la retraite, ne disposant d'aucun laboratoire, service de documentation et autre soutien, que je me suis vraiment plongé dans l'Histoire, parce qu'on peut la pratiquer en free lance. J'ai commencé par l'Histoire de naturalistes célèbres (Bartram, Humboldt, Audubon et quelques autres).
Voyons cela de plus près. En 1972, pleinement engagé dans le travail pédologique, j'ai publié mon tout premier livre sous le titre "Les sols ferrallitiques. Historique. Développement des connaissances et formation des concepts actuels" (Éditions de l'Orstom). Mon but était de préparer un dépassement aux pratiques du moment, en initiant ce qui pouvait devenir un nouveau paradigme, orienté vers un langage transdisciplinaire, et plus généralement vers ce que Lévi-Strauss appelait la "science du concret." Considéré aujourd'hui, j'y vois déjà un pas vers l'Histoire.
Le deuxième pas est survenu vingt ans plus tard, en 1992, avec la publication de "Le voyage de William Bartram (1773-1776) Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain" (éditions Karthala). Le sous-titre indique clairement la thématique visée. Actuellement, il me semble devoir insister davantage sur la structure du livre et le traitement des données historiques. Une alternance de chapitres donnait la parole à Bartram (des extraits traduits par moi de son Travels) et au biographe (moi-même en l'occurrence). C'était du dialogue, du contrepoint, entre monodie et polyphonie.
Le plus gros et plus illustré, le mieux diffusé et vendu de mes livres est "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (2001). On y remarquera les libertés prises avec la chronologie. Tout d'abord, il débutait par la mort d'Audubon, avant de prendre le déroulé de sa vie depuis sa naissance. L'enchaînement chronologique était de plus interrompu par un chapitre intitulé "Des oiseaux, des hommes et quelques autres espèces." C'était le premier de mes bouquins écrits en toute liberté. J'étais parvenu à la retraite et pouvais travailler à ma guise.
Polyphonie(Note 2)
En dehors de causeries nombreuses, purement orales, j'ai beaucoup pratiqué Audubon. Je retiens les textes informels sur le site de l'Harmattan, et ceux publiés dans des catalogues d'exposition des Muséums d'histoire naturelle de Nantes et La Rochelle. Ce qui m'intéresse davantage est mon deuxième livre sur le même naturaliste portant le titre "Audubon raconté par ceux qui l'on connu." Il n'a pas été édité et reste jusqu'à présent un ebook chez KDP Amazon, en attendant mieux. Par son style, il est humoristique et gentiment satirique.
Audubon est dépeint par différents locuteurs, le titre le fait clairement comprendre. Le personnage attire ce genre d'exercice car de son vivant il a été aimé et détesté. Autrefois, ses adversaires étaient surtout des naturalistes en compétition avec lui. Par la suite, il a été célébré sans retenue, dans le domaine des sciences et des arts, pendant un bon siècle et demi. Aujourd'hui, il est voué aux gémonies par les woke lui reprochant d'avoir eu quelques esclaves, bien avant la Guerre civile américaine et leur émancipation. Les locuteurs de son temps qui l'ont connu et le mettent en perspective dans le livre sont variés. On y trouve la nounou Noire de son enfance, une marquise ayant fui la Révolution française, une Quakeresse amoureuse de lui, and the like. Et même un chien qui l'assistait dans la chasse aux oiseaux Peut-on faire plus polyphonique ?
Sur un registre beaucoup plus sérieux, j'ai repris mes réflexions sur le philosophe juif-sépharade-néerlandais Baruch Spinoza (1632-1677). Il arrive qu'on me demande combien de temps il m'a fallu (étant un ancien pédologue) pour produire un livre sur lui. J'ai deux réponses. La première est cinquante ans, parce que je me suis longtemps intéressé à sa conception de la Nature. La seconde est un an et demi. Ayant soudainement décidé d'uvrer sur Spinoza, j'ai complété mes informations pendant 6 mois puis consacré un an à écrire. Cela s'est passé entre juin 2019 et décembre 2020. Le livre a été publié quelques mois plus tard par l'Harmattan sous le titre "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Ma grande fierté est d'avoir reproduit en couverture le portrait gravé de Spinoza, avec la mention "Collection personnelle de l'Auteur." J'avais en effet acheté un exemplaire de la gravure pour 40 euros
La polyphonie y est plus riche que pour Audubon. Le livre se compose de 7 parties comprenant 3 ou 4 chapitres, faisant alterner les locuteurs et rythmant l'ensemble. On trouve dans ces chacune de ces parties Spinoza ranimant ses souvenirs, un ou deux personnages l'ayant connu, parlant de lui et de son uvre, et systématiquement un "modérateur" pour conclure. Parmi ceux qui s'expriment ainsi, apparaissent notamment son père, un rabbin sépharade, un savant de l'époque, un aristocrate prussien, etc. Quant au modérateur, il s'agit évidemment de moi-même voulant pondérer et compléter les propos des précédents locuteurs, parce qu'ils ont des perspectives variées, souvent bien différentes, ou insuffisantes.
-------
Note 2 - Nølke, Henning. "La polyphonie : analyses littéraire et linguistique",, in Le regard du locuteur 2. Pour une linguistique des traces énonciatives, sous la direction de Nølke Henning. Éditions Kimé, 2001, pp. 59-73.
-------
Diachronie
Le linguiste Ferdinand de Saussure (1857-1913) a créé avec "diachronie"(Note 3) le mot et le concept dont je vais user pour caractériser une nouvelle manière de traiter l'Histoire. Il s'agit ni plus ni moins que de casser le Temps, celui de l'Histoire, en la racontant ! Reconnaissons d'abord l'avoir déjà fait un peu, dans "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (voir plus haut) mais ce n'était qu'une petite coquetterie de style que je suis loin d'être le seul à avoir pratiquée. Il faut aller plus loin.
Voici près d'une dizaine d'années j'ai rédigé "L'artiste et le Révérend. Les derniers jours de Thomas Cole." Ce texte a la taille d'un livre normal, mais il est resté jusqu'à présent sous la forme d'un ebook chez KDP Amazon. L'artiste dont il est question est Thomas Cole (1801-1848), reconnu comme le premier vrai paysagiste américain et fondateur de la Hudson School of Painting. Le Révérend est son ami et premier biographe, Louis Noble. Le récit s'étend du samedi 5 février, jour auquel un coup de froid a rendu Cole malade, au vendredi 11 février, à l'instant de sa mort.
Chacun des 7 chapitres évoque un jour, un moment, un lieu précis. Les personnages mis en scène sont Thomas Cole, son épouse et sa famille proche, le pasteur épiscopalien Noble, un médecin et divers habitants du village. Les plus importants s'expriment, les autres sont des figurants muets, ou presque. La totalité de la vie de Thomas Cole, la description de ses uvres majeures, sont ainsi racontées, par fragments dissociés de la suite du temps et mêlés aux petits événements de chacune des 7 journées. Thomas Cole réfléchit à lui-même, se raconte pour ses proches, lesquels ajoutent détails et remarques. L'auteur (moi-même) remplit les vides. La diachronie s'accommode ainsi d'une certaine polyphonie.
J'ai repris récemment le procédé dans "Douze journées de Thomas Jefferson, maître d'esclaves," livre sorti des presses de l'Harmattan le 5 avril 2023. Les douze journées sont choisies à des dates précises, en raison des événements survenus, entre le moment où Jefferson (1743-1826), ayant achevé sa carrière politique, est revenu chez lui à Monticello, et celui de son décès. Toute la vie de Jefferson apparaît néanmoins, fragmentée et sans suivre la chronologie, au gré de moments de réflexion, de rencontres, de discussions. Une large part de l'histoire américaine se trouve aussi évoquée, quand de grands personnages viennent visiter l'ermite de Monticello. Retenons surtout Andrew Jackson, 7ème Président des États-Unis, et Lafayette, le "héros de deux mondes."
-------
Note 3 - Mot forgé par Ferdinand de Saussure, du grec ancien, composé de διά, diá (à travers) et de χρόνος, khrónos (temps). [Wikipedia]
-------
Conclure ?
Des livres comme ceux sur Spinoza et Jefferson ne sont pas des biographies, au sens strict. Je les considère comme des "biographies romancées," avec l'inconvénient que cela ne correspond pas à une catégorie utilisée dans l'édition. Ainsi peuvent-ils se trouver rangés parmi les romans, ce que je dois accepter tout en le déplorant. Pour moi, ils sont tout simplement de l'Histoire, dans une mise en forme amusante à composer et distrayante pour le lecteur. Le caractère "romancé" n'introduit rien de contraire à la vérité historique.
À n'importe quelle prétendue "nouveauté," on peut toujours trouver des antécédents, des précurseurs. Cela doit être le cas pour mes tentatives de polyphonie et diachronie en Histoire, mais je n'en ai vraiment pas rencontrés. J'ai lu au contraire un nombre incroyable de biographies savantes, dans lesquelles l'auteur tente seulement de mettre un peu d'élégance et d'animation par le style, mais selon un mode d'exposition rabâché des milliers de fois. Sans autre originalité
Toutefois, je ne vais pas me "monter le bourrichon,"(Note 4) à attendre je ne sais quelle reconnaissance, ou la gloire littéraire peut-être ! À mes polyphoniques et diachroniques personnages, Audubon, Cole, Jefferson et quelques autres, pour terminer, je souhaite seulement d'être un peu mieux connus par le public qui lit.
-------
Note 4 - Gustave Flaubert utilisait cette expression, pas dans ses romans, mais dans sa correspondance, et sans doute aussi de vive voix.
-------
Signature :
Yvon Chatelin
L'affaire "Sally Hemings et Thomas Jefferson" : Grand ou petit scandale ?
En leur temps déjà, Thomas Jefferson et Sally Hemings ont suscité une indignation qui pouvait, sur le moment, apparaître diffamatoire et relevant de rumeurs malveillantes et non de faits prouvés. Comment admettre, en effet, que Jefferson, rédacteur célébré de la Déclaration d'indépendance américaine, Président des États-Unis pendant deux mandats, fondateur de l'Université de Virginie, écrivain et moraliste politique, grand intellectuel, musicien, un peu agronome, architecte, inventeur ait pu prendre pour concubine Sally, beaucoup plus jeune que lui, juridiquement son esclave, demi-sur biologique au sang-mêlé de sa défunte épouse ?
Mais après leurs disparitions, en 1826 à l'âge de 83 ans pour Jefferson, en 1835 à l'âge de 62 ans pour Sally, les confirmations se sont accumulées. Il n'est plus possible aujourd'hui de nier la réalité de leur union, la grande édition, les médias numériques, les réseaux sociaux s'en sont largement emparés. Retenons ici seulement deux produits médiatiques emblématiques et de large audience.
Barbara Chase-Riboud, femme de lettres et artiste afro-américaine de haute valeur et réputation, a publié en 1979 aux éditions "The Viking Press" de New York un volumineux roman intitulé "Sally Hemings." Il a été traduit deux ans plus tard chez Albin Michel sous l'appellation "La Virginienne."
Toujours aux États-Unis, en 2000, Charles Haid a réalisé pour la télévision une série sous le titre clairement engagé de "Sally Hemings : an American scandal." Ses interprètes étaient Carmen Ejogo pour Sally et Sam Neill pour Jefferson.
S'ajoutant à ces produits-phares, on imagine aisément la quantité des communications et discussions hébergées depuis des décennies par le Web et particulièrement Youtube. Thomas Jefferson y est portraituré en tant que "slave owner" de façon générale, ou plus particulièrement comme maître et amant de la demi-sur de son épouse décédée. Tout n'a pas la même valeur, mais donne une image des centres d'intérêt et courants d'opinion parcourant la société. Émergeant de cet océan médiatique, les descendants actuels du couple Jefferson/Sally ont apporté honnêtement leurs voix, retraçant leur histoire familiale, clarifiant la question. Il faut leur en rendre hommage.
En réalité, tout a commencé en 1873 lorsqu'un journaliste nommé S.F. Wetmore a publié dans un journal de l'État de l'Ohio, le "Pike County Republican," les confidences de Madison Hemings. Celui-ci était l'un des quatre enfants naturels incontestables du couple historique défrayant la chronique. Il y avait une fille, Harriet, et trois garçons, Madison et ses frères Beverly et Eston. Tous portaient le patronyme de leur mère, Hemings et étaient encore vivants en 1873, Madison ayant à ce moment environ 68 ans. Il s'est exprimé dans un langage dépassionné et sobre, affirmant de Thomas Jefferson que "son tempérament général était doux et égal ; il était très peu démonstratif. Il était uniformément gentil avec tous ceux qui l'entouraient." C'est bien ainsi qu'on l'imagine, après tous les travaux des historiens.
Madison a mentionné le séjour de Jefferson à Paris comme ministre plénipotentiaire américain, d'abord en la seule compagnie de sa fille aînée, Patsy. La cadette, Polly, est venue plus tard rejoindre son père, accompagnée de Sally, comme compagne et servante. Madison ajoute que durant ce séjour parisien, sa mère (Sally) "devint la concubine de Mr. Jefferson" et qu'elle est tombée "enceinte de lui." Toujours selon Madison, "peu après leur retour [en Amérique, en 1790], elle donna vie à un enfant qui ne vécut qu'un temps court." Le nom de cet enfant n'est pas donné dans le texte du "Pike County Republican," mais ce devait être le Tom des anciennes rumeurs.
Fait historique incontestable, Jefferson a été, dans ses plantations et sa résidence de Monticello, maître de plusieurs centaines d'esclaves. Le témoignage de Madison est pris aujourd'hui très au sérieux. On comprend ainsi, sans nécessairement les approuver, certaines réactions publiques envers le célèbre Jefferson. L'Université de Virginie à Charlottesville a retiré en 2021 de la cour centrale du campus, la statue de son fondateur. La municipalité de la ville de New York, en 2022, a de même banni de sa City Hall une autre statue de Jefferson. Après ceux de Charlottesville et New York, il faut s'attendre à de nouveaux rejets de statues ou portraits, et à de multiples condamnations verbales moralisantes.
Avec tout son talent de romancière, Barbara Chase-Riboud a retracé la vie commune de Jefferson et Sally, la faisant débuter à Paris, et acceptant la naissance de Tom. Selon la romancière, dès le départ, Sally se sentait destinée à devenir la maîtresse de Jefferson, et même le désirait. Leur première nuit d'amour, heureuse et complaisamment décrite, se serait passée en mars 1788, à la veille d'un court voyage de Jefferson aux Pays-Bas et en Rhénanie. Jusqu'à leur fin, les relations de Sally et Jefferson ont pris, aux yeux de la romancière, des allures d'amours romantiques, teintées de respect, d'affection, de complicité et de partage. Peut-être est-ce une manière, pour Barbara Chase-Riboud, de valoriser les femmes de couleur acceptant ou contraintes de partager leur couche avec un maître Blanc, comme cela s'est produit tant de fois au cours de l'Histoire. Le plus important est que la romancière ait accepté la précocité de ces amours et leur conséquence, un premier enfant prénommé Tom.
Dans le livre "Douze journées de Thomas Jefferson, maître d'esclaves" publié par L'Harmattan en mars 2023, évitant toute apparence de polémique, de façon voilée, nous avons donné aux relations de Jefferson et Sally une tout autre nature que celle décrite par Barbara Chase-Riboud. Reconnaissons à celle-ci de grands talents d'écriture, et une connaissance approfondie de l'époque et des personnages décrits. Elle a, comme chacun, le droit de ses interprétations et convictions personnelles face à l'Histoire, et de plus celui d'imaginer, sans quoi le genre romanesque n'existerait pas. C'est donc en refusant le moindre conflit que nous exposerons ici les différences d'interprétation nous séparant d'elle.
Commençons par l'existence de Tom (que réfutent beaucoup d'historiens). Le principal argument pour la nier est que Jefferson, maniaque de l'archivage, n'ait pas noté sa naissance, comme il le faisait pour tous les nouveaux membres de sa maisonnée, simples esclaves compris. Il n'y a par ailleurs aucun indice de vie d'un certain Tom Hemings dans l'état civil, les documents légaux, les correspondances, archives et souvenirs personnels connus. Il faut supposer que le Madison Hemings vieillissant ait été abusé par le souvenir confus de lointaines confidences maternelles, ou par les rumeurs malveillantes traversant la société, ou même poussé par S.F. Wetmore qui l'a interviewé et était notoirement contempteur de l'esclavage sous toutes ses formes.
Il faut savoir qu'un certain Thomas Woodson, cultivateur noir dans l'État de l'Ohio, aurait été le fantomatique Tom, fils de Jefferson, selon les dires de sa famille. Rien n'est venu confirmer cette allégation. Rappelons que l'identité de certains personnages mystérieux de l'Histoire a souvent été revendiquée par supercherie. On pense immédiatement au cas de l'enfant sauvé du Temple, Louis XVII, et à celui de la grande-duchesse Anastasia supposée avoir échappé au massacre de la famille impériale russe. Il y a peut-être eu de la duplicité chez Thomas Woodson, mais il se peut aussi qu'il ait sincèrement cru être fils de Jefferson. Ce sont parfois les familles qui inventent ou croient à une identité cachée. Mentionnons les petites-filles du peintre naturaliste Jean-Jacques (John James) Audubon qui ont vu en leur grand-père un Louis XVII exfiltré du Temple et conduit jusqu'au Canada !
Ajoutons que le prénom de Tom, diminutif de Thomas, ajoute une invraisemblance. Il était de tradition dans les familles de répéter les mêmes prénoms d'une génération à l'autre, et celui de Tom (c'est-à-dire Thomas) eut inévitablement fait penser au maître de Monticello, ce qu'il fallait éviter. Au contraire, Beverly, Harriet, Madison, Eston, enfants certains de Sally, ont des prénoms et un patronyme (Hemings) sans aucune apparence de rattachement à la famille des Jefferson légitimes.
Venons-en maintenant au séjour parisien. Arrivée à Paris, Sally avait 14 ans, et paraissait encore fort juvénile aux yeux du capitaine de bateau l'ayant amenée. Elle apparut "quite a child" à Abigail Adams qui l'a réceptionnée. Quand elle a quitté Paris, elle était tout juste dans sa quinzième année. Elle avait vécu avec les filles de Jefferson, moitié compagne de jeu, moitié domestique. Patsy était plus âgée qu'elle d'un an, et Polly plus jeune de 5 ans. Les amies des deux surs étaient aussi celles de Sally, ce que l'on comprend par la correspondance ultérieure d'une autre jeune Américaine, une certaine Kitty Church.
Jefferson vivait alors une grande passion amoureuse pour Maria Cosway, et cette passion est restée platonique. Il s'en est expliqué dans un texte célèbre, un "dialogue entre sa tête et son cur" (lettre à Maria Cosway, 12 octobre 1786). La tête avait beaucoup d'importance chez lui, il avait un penchant pour les femmes de bonne éducation et culture, artistes et musiciennes. Imaginer que cet homme "doux" et "gentil," comme décrit par Madison, se soit comporté en prédateur, sortant une gamine de la nurserie de ses propres filles pour la mettre dans son lit, nous semble impensable.
L'hôtel de Langeac se trouvait au bas des actuels Champs-Élysées. Jefferson l'a loué pour abriter sa famille, ses activités diplomatiques, pour recevoir amis et visiteurs. C'était une ruche grouillante de monde. William Short, secrétaire du ministre plénipotentiaire, y logeait en permanence, de même que plusieurs domestiques, dont James, frère de Sally devenu cuisinier. Des personnalités y faisaient de longs séjours, comme le grand peintre américain, John Trumbull. Il serait difficile de faire le compte aujourd'hui de tous les individus ayant franchi le seuil de l'hôtel de Langeac. Retenons Condorcet, le marquis de La Fayette, Gouverneur Morris, parce qu'ils sont bien connus. William Short y recevait Rosalie de Rohant-Chabot (de la grande famille des La Rochefoucauld), dont il était follement amoureux, et Jefferson son amie de cur Maria Cosway. Il y avait aussi les domestiques, parmi lesquels James, frère de Sally amené d'Amérique comme cuisinier. Imaginer que dans le confinement de sa résidence l'ambassadeur ait pu se permettre une concubine juste sortie de l'enfance ne procède-t-il pas d'un véritable aveuglement, ou du désir de fabriquer une histoire belle et sulfureuse ? Cité par Claude Folhen ("Jefferson à Paris," Perrin, 1995) l'historien américain Noble Cunningham (1987) a conclut que "toute aventure à Paris entre Jefferson et Sally Hemings relève du roman."
Il nous reste à comprendre comment a pu s'établir et se développer la réelle et longue liaison entre nos deux personnages, après leur retour en Amérique le 23 novembre 1789. Sally est devenue une jeune femme pleine de santé, cependant il lui a fallu attendre assez longtemps pour accéder à la maternité. Ce n'est qu'en 1795, âgée de 22 ans, 6 ans après le retour de France, qu'elle a eu une fille, laquelle a peu vécue. Les 4 enfants ayant atteint l'âge adulte sont venus plus tard. En ce temps-là, la vie était généralement courte. Dans les groupes sociaux riches ou pauvres, les filles ne tardaient guère autour des 18 ans à contracter leur première union.
La position sociale de Sally pouvait lui donner de la difficulté pour accepter un partenaire sexuel ou conjugal. Elle n'était ni Blanche, ni Noire. Ni libre, ni complète esclave. Sans avoir fréquenté d'école, elle n'était pas analphabète. Elle vivait un pied dans la "grande maison" de Monticello, un autre dans les logements des serviteurs. Quel partenaire, de quelle origine et de quel statut social, eut-elle pu accepter ?
Sans déployer autant d'imagination que Barbara Chase-Riboud, il est permis d'avancer quelques suppositions. Les demoiselles Jefferson ont eu de moins en moins besoin de Sally. L'aînée, Patsy, s'est mariée à l'âge ordinaire de 18 ans, en février 1790, et l'année suivante elle était mère. Pour Polly, ce fut un peu plus long, mais en 1800 elle était unie elle aussi et quittait le foyer paternel. Sally grandissant et mûrissant a été promue chambrière et lingère du maître. Ils étaient l'un et l'autre dans une situation de manque, Jefferson ayant des besoins masculins surtout sexuels, Sally n'enviant pas l'état de vieille fille et préférant avoir des enfants qui l'accompagnent dans l'immédiat et dans le reste de sa vie. Ils eurent tout le temps de s'observer, se rapprocher plus intimement. Ils pouvaient se comprendre réciproquement et s'accepter.
Toujours est-il que Sally a mis au monde, pour la première fois au début de 1796, presque 6 ans après le retour de France, un enfant qui n'a pas vécu. Les quatre mentionnés plus haut, qui ont atteint l'âge adulte, sont apparus en 1798 pour Berverly l'aîné et en 1808 pour Eston le benjamin.
Selon Madison, dès Paris, Jefferson aurait promis d'affranchir de l'esclavage les enfants qu'il pouvait avoir avec Sally. L'information a semblé acceptable aux historiens et spécialistes. Seul rectificatif devant être rapporté, selon nous, cela s'est produit vraisemblablement plus tard, en Virginie. Dans la réalité les 4 enfants du couple devenus adultes ont mené une vie libre. Jefferson a accepté "to give their time," en d'autres termes les laisser prendre d'eux-mêmes leur liberté, aux deux premiers. Les deux plus jeunes ont été affranchis par testament, à l'âge de la majorité. Deux sont devenus de petits artisans, Madison a été cultivateur propriétaire, Eston est devenu musicien et animateur de fêtes populaires. Les enfants de Sally maniaient le violon, ce qui est un indice de bonne relation avec leur père, grand violoniste. Quant à Sally, sans avoir été légalement émancipée, elle a finit sa vie, une fois passée celle de Jefferson, en étant libre. Elle a vécu dans une maison indépendante, éloignée de Monticello, avec ses fils Madison et Eston.
Considérée ainsi, la liaison de Sally et Jefferson relève plus d'une entente pratique, raisonnée, que de l'amour spontané et romantique décrit par Barbara Chase-Riboud. Malgré son asymétrie, elle n'exclut pas une certaine affection partagée, mais le fossé culturel entre les deux partenaires était trop grand pour permettre mieux. Un mariage légalisé et affiché était totalement inadmissible dans leur milieu et à leur époque. Peut-on aujourd'hui condamner leur union si elle était libre, consciente et réciproque ? Elle reste surprenante et quelque peu choquante, certainement, mais sans plus, nous semble-t-il. Le scandale de "l'affaire Sally Hemings" change de taille et de portée. Il était grand, autrefois et le reste aujourd'hui, aux yeux de qui est peu informé ou prompt à condamner. Il n'est plus qu'un scandale très petit pour un esprit évolué, porté à la compréhension, de notre vingt-et-unième siècle, lequel tolère bien pire. Le vrai scandale reste celui de l'esclavage, un fléau multiforme de l'histoire humaine qui traverse les siècles et les continents.
Terminons par les deux références essentielles :
Reminiscenses of Madison Hemings. Pike County Republican, March 13, 1873.
https://ohiomemory.org/digital/collection/p267401coll36/id/12067
Report of the Research Committee on Thomas Jefferson and Sally Hemings. The Thomas Jefferson Foundation. January 2000. The Thomas Jefferson Monticello, 1050 Monticello Loop, Charlottesville, VA 22902; USA.
https://www.monticello.org/thomas-jefferson/jefferson-slavery/thomas-jefferson-and-sally-hemings-a-brief-account/research-report-on-jefferson-and-hemings/
Lire plus
Mais après leurs disparitions, en 1826 à l'âge de 83 ans pour Jefferson, en 1835 à l'âge de 62 ans pour Sally, les confirmations se sont accumulées. Il n'est plus possible aujourd'hui de nier la réalité de leur union, la grande édition, les médias numériques, les réseaux sociaux s'en sont largement emparés. Retenons ici seulement deux produits médiatiques emblématiques et de large audience.
Barbara Chase-Riboud, femme de lettres et artiste afro-américaine de haute valeur et réputation, a publié en 1979 aux éditions "The Viking Press" de New York un volumineux roman intitulé "Sally Hemings." Il a été traduit deux ans plus tard chez Albin Michel sous l'appellation "La Virginienne."
Toujours aux États-Unis, en 2000, Charles Haid a réalisé pour la télévision une série sous le titre clairement engagé de "Sally Hemings : an American scandal." Ses interprètes étaient Carmen Ejogo pour Sally et Sam Neill pour Jefferson.
S'ajoutant à ces produits-phares, on imagine aisément la quantité des communications et discussions hébergées depuis des décennies par le Web et particulièrement Youtube. Thomas Jefferson y est portraituré en tant que "slave owner" de façon générale, ou plus particulièrement comme maître et amant de la demi-sur de son épouse décédée. Tout n'a pas la même valeur, mais donne une image des centres d'intérêt et courants d'opinion parcourant la société. Émergeant de cet océan médiatique, les descendants actuels du couple Jefferson/Sally ont apporté honnêtement leurs voix, retraçant leur histoire familiale, clarifiant la question. Il faut leur en rendre hommage.
En réalité, tout a commencé en 1873 lorsqu'un journaliste nommé S.F. Wetmore a publié dans un journal de l'État de l'Ohio, le "Pike County Republican," les confidences de Madison Hemings. Celui-ci était l'un des quatre enfants naturels incontestables du couple historique défrayant la chronique. Il y avait une fille, Harriet, et trois garçons, Madison et ses frères Beverly et Eston. Tous portaient le patronyme de leur mère, Hemings et étaient encore vivants en 1873, Madison ayant à ce moment environ 68 ans. Il s'est exprimé dans un langage dépassionné et sobre, affirmant de Thomas Jefferson que "son tempérament général était doux et égal ; il était très peu démonstratif. Il était uniformément gentil avec tous ceux qui l'entouraient." C'est bien ainsi qu'on l'imagine, après tous les travaux des historiens.
Madison a mentionné le séjour de Jefferson à Paris comme ministre plénipotentiaire américain, d'abord en la seule compagnie de sa fille aînée, Patsy. La cadette, Polly, est venue plus tard rejoindre son père, accompagnée de Sally, comme compagne et servante. Madison ajoute que durant ce séjour parisien, sa mère (Sally) "devint la concubine de Mr. Jefferson" et qu'elle est tombée "enceinte de lui." Toujours selon Madison, "peu après leur retour [en Amérique, en 1790], elle donna vie à un enfant qui ne vécut qu'un temps court." Le nom de cet enfant n'est pas donné dans le texte du "Pike County Republican," mais ce devait être le Tom des anciennes rumeurs.
Fait historique incontestable, Jefferson a été, dans ses plantations et sa résidence de Monticello, maître de plusieurs centaines d'esclaves. Le témoignage de Madison est pris aujourd'hui très au sérieux. On comprend ainsi, sans nécessairement les approuver, certaines réactions publiques envers le célèbre Jefferson. L'Université de Virginie à Charlottesville a retiré en 2021 de la cour centrale du campus, la statue de son fondateur. La municipalité de la ville de New York, en 2022, a de même banni de sa City Hall une autre statue de Jefferson. Après ceux de Charlottesville et New York, il faut s'attendre à de nouveaux rejets de statues ou portraits, et à de multiples condamnations verbales moralisantes.
Avec tout son talent de romancière, Barbara Chase-Riboud a retracé la vie commune de Jefferson et Sally, la faisant débuter à Paris, et acceptant la naissance de Tom. Selon la romancière, dès le départ, Sally se sentait destinée à devenir la maîtresse de Jefferson, et même le désirait. Leur première nuit d'amour, heureuse et complaisamment décrite, se serait passée en mars 1788, à la veille d'un court voyage de Jefferson aux Pays-Bas et en Rhénanie. Jusqu'à leur fin, les relations de Sally et Jefferson ont pris, aux yeux de la romancière, des allures d'amours romantiques, teintées de respect, d'affection, de complicité et de partage. Peut-être est-ce une manière, pour Barbara Chase-Riboud, de valoriser les femmes de couleur acceptant ou contraintes de partager leur couche avec un maître Blanc, comme cela s'est produit tant de fois au cours de l'Histoire. Le plus important est que la romancière ait accepté la précocité de ces amours et leur conséquence, un premier enfant prénommé Tom.
Dans le livre "Douze journées de Thomas Jefferson, maître d'esclaves" publié par L'Harmattan en mars 2023, évitant toute apparence de polémique, de façon voilée, nous avons donné aux relations de Jefferson et Sally une tout autre nature que celle décrite par Barbara Chase-Riboud. Reconnaissons à celle-ci de grands talents d'écriture, et une connaissance approfondie de l'époque et des personnages décrits. Elle a, comme chacun, le droit de ses interprétations et convictions personnelles face à l'Histoire, et de plus celui d'imaginer, sans quoi le genre romanesque n'existerait pas. C'est donc en refusant le moindre conflit que nous exposerons ici les différences d'interprétation nous séparant d'elle.
Commençons par l'existence de Tom (que réfutent beaucoup d'historiens). Le principal argument pour la nier est que Jefferson, maniaque de l'archivage, n'ait pas noté sa naissance, comme il le faisait pour tous les nouveaux membres de sa maisonnée, simples esclaves compris. Il n'y a par ailleurs aucun indice de vie d'un certain Tom Hemings dans l'état civil, les documents légaux, les correspondances, archives et souvenirs personnels connus. Il faut supposer que le Madison Hemings vieillissant ait été abusé par le souvenir confus de lointaines confidences maternelles, ou par les rumeurs malveillantes traversant la société, ou même poussé par S.F. Wetmore qui l'a interviewé et était notoirement contempteur de l'esclavage sous toutes ses formes.
Il faut savoir qu'un certain Thomas Woodson, cultivateur noir dans l'État de l'Ohio, aurait été le fantomatique Tom, fils de Jefferson, selon les dires de sa famille. Rien n'est venu confirmer cette allégation. Rappelons que l'identité de certains personnages mystérieux de l'Histoire a souvent été revendiquée par supercherie. On pense immédiatement au cas de l'enfant sauvé du Temple, Louis XVII, et à celui de la grande-duchesse Anastasia supposée avoir échappé au massacre de la famille impériale russe. Il y a peut-être eu de la duplicité chez Thomas Woodson, mais il se peut aussi qu'il ait sincèrement cru être fils de Jefferson. Ce sont parfois les familles qui inventent ou croient à une identité cachée. Mentionnons les petites-filles du peintre naturaliste Jean-Jacques (John James) Audubon qui ont vu en leur grand-père un Louis XVII exfiltré du Temple et conduit jusqu'au Canada !
Ajoutons que le prénom de Tom, diminutif de Thomas, ajoute une invraisemblance. Il était de tradition dans les familles de répéter les mêmes prénoms d'une génération à l'autre, et celui de Tom (c'est-à-dire Thomas) eut inévitablement fait penser au maître de Monticello, ce qu'il fallait éviter. Au contraire, Beverly, Harriet, Madison, Eston, enfants certains de Sally, ont des prénoms et un patronyme (Hemings) sans aucune apparence de rattachement à la famille des Jefferson légitimes.
Venons-en maintenant au séjour parisien. Arrivée à Paris, Sally avait 14 ans, et paraissait encore fort juvénile aux yeux du capitaine de bateau l'ayant amenée. Elle apparut "quite a child" à Abigail Adams qui l'a réceptionnée. Quand elle a quitté Paris, elle était tout juste dans sa quinzième année. Elle avait vécu avec les filles de Jefferson, moitié compagne de jeu, moitié domestique. Patsy était plus âgée qu'elle d'un an, et Polly plus jeune de 5 ans. Les amies des deux surs étaient aussi celles de Sally, ce que l'on comprend par la correspondance ultérieure d'une autre jeune Américaine, une certaine Kitty Church.
Jefferson vivait alors une grande passion amoureuse pour Maria Cosway, et cette passion est restée platonique. Il s'en est expliqué dans un texte célèbre, un "dialogue entre sa tête et son cur" (lettre à Maria Cosway, 12 octobre 1786). La tête avait beaucoup d'importance chez lui, il avait un penchant pour les femmes de bonne éducation et culture, artistes et musiciennes. Imaginer que cet homme "doux" et "gentil," comme décrit par Madison, se soit comporté en prédateur, sortant une gamine de la nurserie de ses propres filles pour la mettre dans son lit, nous semble impensable.
L'hôtel de Langeac se trouvait au bas des actuels Champs-Élysées. Jefferson l'a loué pour abriter sa famille, ses activités diplomatiques, pour recevoir amis et visiteurs. C'était une ruche grouillante de monde. William Short, secrétaire du ministre plénipotentiaire, y logeait en permanence, de même que plusieurs domestiques, dont James, frère de Sally devenu cuisinier. Des personnalités y faisaient de longs séjours, comme le grand peintre américain, John Trumbull. Il serait difficile de faire le compte aujourd'hui de tous les individus ayant franchi le seuil de l'hôtel de Langeac. Retenons Condorcet, le marquis de La Fayette, Gouverneur Morris, parce qu'ils sont bien connus. William Short y recevait Rosalie de Rohant-Chabot (de la grande famille des La Rochefoucauld), dont il était follement amoureux, et Jefferson son amie de cur Maria Cosway. Il y avait aussi les domestiques, parmi lesquels James, frère de Sally amené d'Amérique comme cuisinier. Imaginer que dans le confinement de sa résidence l'ambassadeur ait pu se permettre une concubine juste sortie de l'enfance ne procède-t-il pas d'un véritable aveuglement, ou du désir de fabriquer une histoire belle et sulfureuse ? Cité par Claude Folhen ("Jefferson à Paris," Perrin, 1995) l'historien américain Noble Cunningham (1987) a conclut que "toute aventure à Paris entre Jefferson et Sally Hemings relève du roman."
Il nous reste à comprendre comment a pu s'établir et se développer la réelle et longue liaison entre nos deux personnages, après leur retour en Amérique le 23 novembre 1789. Sally est devenue une jeune femme pleine de santé, cependant il lui a fallu attendre assez longtemps pour accéder à la maternité. Ce n'est qu'en 1795, âgée de 22 ans, 6 ans après le retour de France, qu'elle a eu une fille, laquelle a peu vécue. Les 4 enfants ayant atteint l'âge adulte sont venus plus tard. En ce temps-là, la vie était généralement courte. Dans les groupes sociaux riches ou pauvres, les filles ne tardaient guère autour des 18 ans à contracter leur première union.
La position sociale de Sally pouvait lui donner de la difficulté pour accepter un partenaire sexuel ou conjugal. Elle n'était ni Blanche, ni Noire. Ni libre, ni complète esclave. Sans avoir fréquenté d'école, elle n'était pas analphabète. Elle vivait un pied dans la "grande maison" de Monticello, un autre dans les logements des serviteurs. Quel partenaire, de quelle origine et de quel statut social, eut-elle pu accepter ?
Sans déployer autant d'imagination que Barbara Chase-Riboud, il est permis d'avancer quelques suppositions. Les demoiselles Jefferson ont eu de moins en moins besoin de Sally. L'aînée, Patsy, s'est mariée à l'âge ordinaire de 18 ans, en février 1790, et l'année suivante elle était mère. Pour Polly, ce fut un peu plus long, mais en 1800 elle était unie elle aussi et quittait le foyer paternel. Sally grandissant et mûrissant a été promue chambrière et lingère du maître. Ils étaient l'un et l'autre dans une situation de manque, Jefferson ayant des besoins masculins surtout sexuels, Sally n'enviant pas l'état de vieille fille et préférant avoir des enfants qui l'accompagnent dans l'immédiat et dans le reste de sa vie. Ils eurent tout le temps de s'observer, se rapprocher plus intimement. Ils pouvaient se comprendre réciproquement et s'accepter.
Toujours est-il que Sally a mis au monde, pour la première fois au début de 1796, presque 6 ans après le retour de France, un enfant qui n'a pas vécu. Les quatre mentionnés plus haut, qui ont atteint l'âge adulte, sont apparus en 1798 pour Berverly l'aîné et en 1808 pour Eston le benjamin.
Selon Madison, dès Paris, Jefferson aurait promis d'affranchir de l'esclavage les enfants qu'il pouvait avoir avec Sally. L'information a semblé acceptable aux historiens et spécialistes. Seul rectificatif devant être rapporté, selon nous, cela s'est produit vraisemblablement plus tard, en Virginie. Dans la réalité les 4 enfants du couple devenus adultes ont mené une vie libre. Jefferson a accepté "to give their time," en d'autres termes les laisser prendre d'eux-mêmes leur liberté, aux deux premiers. Les deux plus jeunes ont été affranchis par testament, à l'âge de la majorité. Deux sont devenus de petits artisans, Madison a été cultivateur propriétaire, Eston est devenu musicien et animateur de fêtes populaires. Les enfants de Sally maniaient le violon, ce qui est un indice de bonne relation avec leur père, grand violoniste. Quant à Sally, sans avoir été légalement émancipée, elle a finit sa vie, une fois passée celle de Jefferson, en étant libre. Elle a vécu dans une maison indépendante, éloignée de Monticello, avec ses fils Madison et Eston.
Considérée ainsi, la liaison de Sally et Jefferson relève plus d'une entente pratique, raisonnée, que de l'amour spontané et romantique décrit par Barbara Chase-Riboud. Malgré son asymétrie, elle n'exclut pas une certaine affection partagée, mais le fossé culturel entre les deux partenaires était trop grand pour permettre mieux. Un mariage légalisé et affiché était totalement inadmissible dans leur milieu et à leur époque. Peut-on aujourd'hui condamner leur union si elle était libre, consciente et réciproque ? Elle reste surprenante et quelque peu choquante, certainement, mais sans plus, nous semble-t-il. Le scandale de "l'affaire Sally Hemings" change de taille et de portée. Il était grand, autrefois et le reste aujourd'hui, aux yeux de qui est peu informé ou prompt à condamner. Il n'est plus qu'un scandale très petit pour un esprit évolué, porté à la compréhension, de notre vingt-et-unième siècle, lequel tolère bien pire. Le vrai scandale reste celui de l'esclavage, un fléau multiforme de l'histoire humaine qui traverse les siècles et les continents.
Terminons par les deux références essentielles :
Reminiscenses of Madison Hemings. Pike County Republican, March 13, 1873.
https://ohiomemory.org/digital/collection/p267401coll36/id/12067
Report of the Research Committee on Thomas Jefferson and Sally Hemings. The Thomas Jefferson Foundation. January 2000. The Thomas Jefferson Monticello, 1050 Monticello Loop, Charlottesville, VA 22902; USA.
https://www.monticello.org/thomas-jefferson/jefferson-slavery/thomas-jefferson-and-sally-hemings-a-brief-account/research-report-on-jefferson-and-hemings/
Dinosaures, Oiseaux et Mère Nature Un conte philosophique
Les monstres avaient envahi toute la Terre, il y a de cela deux cent millions d'années. Il y en avait des petits, des gros, d'énormes qui pesaient des tonnes, avec des queues et des cous d'une prodigieuse longueur, certains auraient pu passer leur tête à la fenêtre d'un quatrième étage de nos immeubles, les uns marchaient à quatre pattes, les autres se dressaient sur leurs membres postérieurs, sautillaient et bondissaient de manière grotesque. Ils pondaient des ufs énormes dans des nids de boue, car ces monstres étaient des reptiles, et se reproduisaient à grande vitesse. Ils dévoraient tout, la végétation ne leur suffisant plus, ils menaçaient de tout ravager et s'auto-détruisaient en se mangeant les uns les autres. La Terre était incapable de les supporter, il n'y avait pas d'avenir, pas de solution à cette démence, et ce fut finalement une météorite gigantesque qui mit fin à l'horreur. En percutant la Terre, la météorite déclencha une catastrophe qui fit périr les dinosaures, puisque c'est ainsi que l'homme appela ces monstres par la suite.
En réalité, bien avant cet imprévisible cataclysme final, la Nature, notre Mère à tous, cherchait une solution, et elle l'avait trouvée ! La surface terrestre proprement dite devenant invivable, il fallait aller ailleurs. Plus haut, dans les airs ! C'est ainsi que Mère Nature inventa, il y a environ cent cinquante millions d'années, à la pire époque des monstres, un petit appareil qui est connu aujourd'hui sous le nom de "plume". Rien de plus simple ni de plus ingénieux ! La plume est formée d'une matière cornée constituant la hampe (que l'on appelle aussi tuyau, ou calamus), laquelle se prolonge par le rachis plus fin sur lequel viennent se ranger les barbules et barbicelles (ou vexilles), lui donnant sa légèreté légendaire. Légèreté, mais aussi souplesse et résistance mécanique, isolation au chaud et au froid, portance dans l'air. Et jusqu'à la capacité d'aller dans l'eau, pour peu que la plume soit équipée à sa base de petites glandes sébacées qui l'enduisent d'une matière grasse et hydrofuge ! En même temps, la plume était peu coûteuse en termes biologiques, facile à produire, elle pouvait être remplacée dès qu'elle commençait à s'user, elle pouvait aussi être changée comme un habit, suivant les saisons.
Les inventions de Mère Nature sont si prodigieuses que l'on a du mal à concevoir leur apparition, à supposer qu'elles ne fussent que le résultat d'une évolution aveugle, dépourvue d'intention, le fruit d'un étrange hasard et de la nécessité. Le professeur Pierre-Paul Grassé ne croyait guère à cette sorte d'évolution darwinienne, purement biologique, il cherchait une volonté, un dessein derrière le paravent du "hasard et de la nécessité". Et pourtant, Grassé était un grand scientifique, et même, pendant de longues années, le mandarin que toute une génération de biologistes français dut accepter... ou subir (car il était assez dominateur, mais c'est une autre histoire). "Donnez-moi l'il, disait-il, et je vous accorde tout le reste." Il voulait dire par là que si l'on pouvait le convaincre, lui démontrer que l'il était né de mécanismes darwiniens, il accepterait tout en bloc, l'évolution des espèces par sélection, "le hasard et la nécessité" comme raison d'être du monde vivant. L'il, il est vrai, est bien extraordinaire, il fallait toute l'ingéniosité de Mère Nature pour l'inventer, mais la plume l'est tout autant !
Voici comment Mère Nature procéda. Elle avait d'abord eu l'idée de transformer le plus simplement possible ses monstres en machines volantes. Il y eut ainsi le Campylognathus, l'Eudimorphodon, et bien d'autres dont nos savants firent, par la suite, l'Ordre des Ptérosaures. Aucun d'entre nous n'en a connu, heureusement ! Ils étaient lourds et laids, leurs ailes n'étaient qu'une peau nue tendue entre corps et pattes, ils ont disparu avec les autres dinosaures, ceux qui piétinaient la surface terrestre. Mère Nature avait compris que les monstres, qu'ils marchent, planent ou volent, n'étaient pas la solution. La plume, voilà qui allait tout changer ! Mère Nature commença par en garnir le corps d'un petit dinosaure créé par elle spécialement dans cette intention, à titre expérimental, qui fut appelé plus tard Archéopteryx. Elle put tester le comportement de la plume dans les airs, mais seulement en vol plané car l'Archéopteryx n'était capable de rien d'autre, il devait grimper d'abord et se laisser aller en glissades. La suite ne présenta pas de difficulté pour Mère Nature. Il fallait régler le squelette, et surtout préparer des membres qui se replient pour devenir ensuite des ailes, ce qui a été fait avec l'Unengalia dont on dit aujourd'hui qu'il était un demi-oiseau. Le reste, un simple équilibre à trouver dans la musculature des pattes et des ailes, une mâchoire à débarrasser de ses dents et à équiper d'un bec, ne fut plus qu'un jeu d'enfant. L'oiseau était né !
Les monstres une fois disparus dans la grande catastrophe d'il y a soixante-cinq millions d'années, les oiseaux devinrent de plus en plus nombreux et diversifiés, ils prirent possession du monde, ils en furent les Maîtres, non pour envahir, ravager, détruire et devenir de nouveaux despotes, mais pour regarder, parcourir, voyager, jouir de la planète entière, pour donner l'exemple de la beauté, de l'ordre, et de l'harmonie. On peut dire que, quinze mille ans avant ce jour, la grande perfection était atteinte. Les oiseaux contemplaient librement le soleil couchant quand il s'abîme "dans son sang qui se fige", ils saluaient la lune lorsqu'elle monte de l'Orient et déploie ses "orbes scintillantes" sur les forêts de Combourg, ou d'ailleurs. Rien ne leur échappait, ni sur la terre ferme, ni sur les océans.
Contrairement aux autres catégories d'animaux qui vivent chacune selon des modalités peu variables et s'auto-détruisent en devenant dominantes, les oiseaux s'adaptaient à tout, et se complétaient admirablement. Il y avait ceux qui se nourrissaient de poisson, ceux qui mangeaient de la viande, ceux qui faisaient le nettoyage des charognes et autres déjections, ceux aimant le froid polaire et ceux préférant la chaleur tropicale, les sédentaires et les voyageurs, les oiseaux de terre et les oiseaux d'eau ou de mer, les nageurs de surface et les plongeurs, ceux qui avaient appris à casser des noix, ceux qui ouvraient les coquillages, ceux qui fendaient les os, ceux qui mangeaient des vers, ceux qui gobaient des insectes en plein vol, ceux dont le bec perçait des trous dans le bois, ceux qui construisaient des nids de brindilles ou de boue, ceux nichant au sol et ceux préférant les arbres, ceux dont le bec fouillait la vase, ceux qui filtraient l'eau et ses suspensions, ceux dont le bec s'introduisait au plus profond des fleurs, les diurnes et les nocturnes, ceux qui limitaient la reproduction des autres en mangeant leurs ufs, et les grands rapaces pour surveiller le tout, éliminer les défaillants, mettre un terme aux proliférations excessives.
Mère Nature fit peu d'erreurs. On ne voit guère à lui reprocher que quelques oiseaux devenus par leur gigantisme incapables de voler. Les moas de Nouvelle-Zélande, les autruches géantes de Madagascar qui atteignaient trois, quatre et même cinq mètres de hauteur ! Mais cette erreur fut corrigée d'elle-même, car ces sortes de faux oiseaux disparurent rapidement, et seuls restèrent cloués au sol leurs cousins, malgré tout plus petits, que sont l'émeu, l'autruche des savanes africaines, le nandou, le casoar. Ces exceptions mises à part, les oiseaux restèrent de taille modeste. Les plus gros d'entre eux, comme les cygnes, continuèrent à voler et ceux dont les ailes étaient insuffisantes, comme le pingouin, se convertirent aux milieux aquatiques. Les plus nombreux restèrent voués au milieu aérien. Les uns utilisaient le vol plané, profitant des ascendances d'air pour surveiller de haut ce qui se passe au sol, ce qui est la fonction habituelle des aigles, vautours et condors, ou se laissant emporter, comme les pétrels, albatros et oiseaux marins, dans la violence des vents pour aller très loin sans effort. D'autres pratiquaient un vol battu pour suivre inflexiblement leur propre route, ou aller comme la pie avec son allure de marionnette mécanique d'un point précis à l'autre, ou comme l'hirondelle associant vol plané et vol battu. Beaucoup de petits oiseaux choisirent le vol ondulé, comme les fauvettes ou les moineaux, faisant alterner le battement et l'immobilité des ailes. Les colibris apprirent le battement d'aile tourbillonnaire, qui permet un vol immobile, sur place, comme un hélicoptère, et c'est ainsi qu'ils parvinrent à se nourrir du suc des fleurs.
On dit parfois que les oies sont des animaux stupides. Quelle erreur ! Oie rieuse, oie cendrée, oie des neige, bernache cravant (car la bernache est une oie marine), bernache nonnette, bernaches des Andes, du Canada ou de Hawaii, toutes ont un comportement admirable. Elles ont un grand esprit de famille, forment des couples qui ne divorcent guère, et sont toujours des parents attentifs. Les oies se signalent aussi par un grand esprit de discipline, suivant toujours leur chef, et sachant monter la garde et se protéger quand elles vivent en groupe. Les unes et les autres sillonnent le monde dans leurs migrations, volant tantôt en ligne oblique, et tantôt en angle obtus (en V), mais toujours en bon ordre, les forts et les expérimentés devant, les jeunes et les faibles dans le confort du sillage des premiers. Quelle force mystérieuse les conduit, battant inlassablement l'air, se guidant sur le soleil, le champ magnétique, ou simplement par la vue du paysage, le cou projetant la tête loin en avant, image énigmatique d'une inflexible volonté !
Il est d'autres migrateurs prodigieux. Qui aurait pensé que le colibris à gorge rubis qui ne pèse pas dix grammes, serait capable de traverser d'un seul vol tout le Golfe du Mexique ! Ou que l'aigle des steppes pourrait relier l'Asie Centrale et l'Afrique tous les ans ! Ou que le pélican, jamais "lassé de ses longs voyages", aurait étendu ses colonies sur tous les continents ! Et que dire de la sterne arctique, cet oiseau maladroit quand il est posé, ailes, cou et tête timidement repliés et composant une silhouette sans grâce. Mais quelle allure en vol ! La sterne arctique semble investie d'une mission de surveillance de la planète. Comme certains de nos satellites placés en orbite polaire, elle relie inlassablement les confins des deux pôles. Chaque année, avec la "légèreté d'une sylphide" ainsi que le disait joliment Audubon, elle parcourt près de quarante mille kilomètres, portée par vents et tempêtes. Chaque année elle choisit sa route, survole les océans, longe les côtes de l'Amérique, ou passe sur celles de l'Afrique, entre Arctique et Antarctique.
Mère Nature permit à ces nouveaux Maîtres du Monde de développer en toute liberté la beauté des formes, l'harmonie des couleurs, la variété de parures toujours changeantes. Les jeunes, les femelles, les mâles eurent des plumages différents les uns des autres. A l'âge adulte, tous durent en changer plusieurs fois par an. La variété devint immense et mit souvent beaucoup de perplexité ou de confusion dans l'esprit des hommes qui, par la suite, prétendirent être des ornithologues. Judicieusement disposées, les plumes parvinrent à modifier leur couleur instantanément, en quelque sorte, devenant diaphanes, chatoyantes, irisées, en décomposant la lumière à la manière du prisme newtonien. Plus étonnant que tout, alors que les êtres vivants n'avaient produit jusqu'alors que de tristes beuglements, des oiseaux spécialement éduqués par Mère Nature inventèrent le chant, la mélodie, et en firent des messages d'amour entre eux, des hymnes d'hommage au soleil quand il se lève, des symphonies à la gloire de Mère Nature et du Monde. Le rossignol en Eurasie, l'oiseau moqueur et la grive des bois en Amérique, devinrent des artistes incomparables.
Quinze mille ans avant ce jour, tout était pour le mieux, dans les apparences. Mais hélas ! Les oiseaux avaient assisté à l'arrivée de leur grand ennemi, sans comprendre ce qui allait se passer. Ils l'avaient vu dresser sa taille chétive, grandir en taille, en habileté, gagner en puissance, en intelligence, mais aussi en outrecuidance, en présomption, en exigence, en méchanceté, en bêtise souvent. Ils le virent tailler des pierres, puis inventer des armes mécaniques et bruyantes, s'avancer dans des contrées que l'on aurait pu croire inaccessibles à qui est sans aile ni plume. Le combat était inégal, ou plutôt il n'y eu pas de combat, car les oiseaux étaient incapables de se défendre contre les hommes. Les Maîtres du Monde d'un moment succombèrent par millions, victimes de la voracité des nouveaux venus. Pendant ces quatre derniers siècles, plus de quatre-vingt espèces d'oiseaux tombèrent en extinction. Le pigeon migrateur américain, si abondant qu'il réussissait à voiler la lumière du soleil en volant en groupes serrés, fut l'un d'eux. Ceux qui ne disparurent pas diminuèrent en nombre, et l'on sait que la population des hirondelles fut divisée par cinq. Certains oiseaux, comme les gypaètes barbus, ne comptent plus aujourd'hui que quelques individus ! Pendant plus de vingt ans, aucun pic à bec ivoire ne se montra, l'espèce fut portée disparue, jusqu'à ce que quelques rescapés fussent signalés dans les forêts cubaines !
Si tous n'ont pas encore péri, c'est que, parmi les hommes, certains comprirent que les oiseaux étaient aussi respectables, et peut-être meilleurs qu'eux. L'un des premiers à s'engager dans cette réflexion fut un très modeste Quaker vivant en Pennsylvanie il y a plus d'un siècle et demi. Il s'appelait William Bartram et n'avait jamais pris femme, trop occupé par les autres beautés que Mère Nature offrait à sa contemplation. En fait, il ne parlait jamais de Mère Nature et invoquait souvent le Créateur, ou Dieu, mais peut-être s'agit-il de la même personne, sous des noms différents. Ayant beaucoup vécu, voyagé et regardé, il était convaincu que les oiseaux étaient pourvus de sentiments analogues aux siens. Une corneille qui fut son amie des années durant, lui parut capable, à défaut de pouvoir rire (ce qui est "le propre" d'une autre espèce), de ruse, de malice et de drôlerie. Bartram écrivit longuement, patiemment, parce qu'il n'avait rien d'un auteur prolifique ou inconséquent, et qu'il ne cherchait pas la notoriété. Il produisit un seul et unique livre, de belle taille il faut dire, et quantité de notes inédites. Il vécut jusqu'à quatre vingt cinq ans, et quelques instants avant sa mort, soudaine autant que tardive, il consignait encore ses observations et ses idées. Mais avec quoi croyez-vous donc qu'il écrivait, lui qui ne pouvait disposer ni du clavier d'une machine à écrire ni d'un ordinateur ?
Eh bien ! Avec ce que Buffon, grand écrivain s'il en fût, disait être "l'instrument de nos pensées" ! Une plume d'oie !
31 mai à Noirmoutier
et 6 juin 2003 au Pays d'Auge
Signature :
Yvon Chatelin
Post-scriptum :
Il n'est pas ordinaire de joindre une bibliographie à un conte écrit pour les enfants, même prétendument philosophique. Néanmoins, pour le cas où un adulte viendrait à lire ce texte, je lui propose deux références : de Pierre-Paul Grassé, "Toi ce petit dieu", publié par Albin Michel, et de moi-même, "Le voyage de William Bartram", publié par Karthala. Les citations ou paraphrases entre guillemets sont empruntées à P.P. Grassé, Démocrite, Jacques Monod, Baudelaire, Chateaubriand, Audubon, A. de Vigny, Bergson, Buffon.
Lire plus
En réalité, bien avant cet imprévisible cataclysme final, la Nature, notre Mère à tous, cherchait une solution, et elle l'avait trouvée ! La surface terrestre proprement dite devenant invivable, il fallait aller ailleurs. Plus haut, dans les airs ! C'est ainsi que Mère Nature inventa, il y a environ cent cinquante millions d'années, à la pire époque des monstres, un petit appareil qui est connu aujourd'hui sous le nom de "plume". Rien de plus simple ni de plus ingénieux ! La plume est formée d'une matière cornée constituant la hampe (que l'on appelle aussi tuyau, ou calamus), laquelle se prolonge par le rachis plus fin sur lequel viennent se ranger les barbules et barbicelles (ou vexilles), lui donnant sa légèreté légendaire. Légèreté, mais aussi souplesse et résistance mécanique, isolation au chaud et au froid, portance dans l'air. Et jusqu'à la capacité d'aller dans l'eau, pour peu que la plume soit équipée à sa base de petites glandes sébacées qui l'enduisent d'une matière grasse et hydrofuge ! En même temps, la plume était peu coûteuse en termes biologiques, facile à produire, elle pouvait être remplacée dès qu'elle commençait à s'user, elle pouvait aussi être changée comme un habit, suivant les saisons.
Les inventions de Mère Nature sont si prodigieuses que l'on a du mal à concevoir leur apparition, à supposer qu'elles ne fussent que le résultat d'une évolution aveugle, dépourvue d'intention, le fruit d'un étrange hasard et de la nécessité. Le professeur Pierre-Paul Grassé ne croyait guère à cette sorte d'évolution darwinienne, purement biologique, il cherchait une volonté, un dessein derrière le paravent du "hasard et de la nécessité". Et pourtant, Grassé était un grand scientifique, et même, pendant de longues années, le mandarin que toute une génération de biologistes français dut accepter... ou subir (car il était assez dominateur, mais c'est une autre histoire). "Donnez-moi l'il, disait-il, et je vous accorde tout le reste." Il voulait dire par là que si l'on pouvait le convaincre, lui démontrer que l'il était né de mécanismes darwiniens, il accepterait tout en bloc, l'évolution des espèces par sélection, "le hasard et la nécessité" comme raison d'être du monde vivant. L'il, il est vrai, est bien extraordinaire, il fallait toute l'ingéniosité de Mère Nature pour l'inventer, mais la plume l'est tout autant !
Voici comment Mère Nature procéda. Elle avait d'abord eu l'idée de transformer le plus simplement possible ses monstres en machines volantes. Il y eut ainsi le Campylognathus, l'Eudimorphodon, et bien d'autres dont nos savants firent, par la suite, l'Ordre des Ptérosaures. Aucun d'entre nous n'en a connu, heureusement ! Ils étaient lourds et laids, leurs ailes n'étaient qu'une peau nue tendue entre corps et pattes, ils ont disparu avec les autres dinosaures, ceux qui piétinaient la surface terrestre. Mère Nature avait compris que les monstres, qu'ils marchent, planent ou volent, n'étaient pas la solution. La plume, voilà qui allait tout changer ! Mère Nature commença par en garnir le corps d'un petit dinosaure créé par elle spécialement dans cette intention, à titre expérimental, qui fut appelé plus tard Archéopteryx. Elle put tester le comportement de la plume dans les airs, mais seulement en vol plané car l'Archéopteryx n'était capable de rien d'autre, il devait grimper d'abord et se laisser aller en glissades. La suite ne présenta pas de difficulté pour Mère Nature. Il fallait régler le squelette, et surtout préparer des membres qui se replient pour devenir ensuite des ailes, ce qui a été fait avec l'Unengalia dont on dit aujourd'hui qu'il était un demi-oiseau. Le reste, un simple équilibre à trouver dans la musculature des pattes et des ailes, une mâchoire à débarrasser de ses dents et à équiper d'un bec, ne fut plus qu'un jeu d'enfant. L'oiseau était né !
Les monstres une fois disparus dans la grande catastrophe d'il y a soixante-cinq millions d'années, les oiseaux devinrent de plus en plus nombreux et diversifiés, ils prirent possession du monde, ils en furent les Maîtres, non pour envahir, ravager, détruire et devenir de nouveaux despotes, mais pour regarder, parcourir, voyager, jouir de la planète entière, pour donner l'exemple de la beauté, de l'ordre, et de l'harmonie. On peut dire que, quinze mille ans avant ce jour, la grande perfection était atteinte. Les oiseaux contemplaient librement le soleil couchant quand il s'abîme "dans son sang qui se fige", ils saluaient la lune lorsqu'elle monte de l'Orient et déploie ses "orbes scintillantes" sur les forêts de Combourg, ou d'ailleurs. Rien ne leur échappait, ni sur la terre ferme, ni sur les océans.
Contrairement aux autres catégories d'animaux qui vivent chacune selon des modalités peu variables et s'auto-détruisent en devenant dominantes, les oiseaux s'adaptaient à tout, et se complétaient admirablement. Il y avait ceux qui se nourrissaient de poisson, ceux qui mangeaient de la viande, ceux qui faisaient le nettoyage des charognes et autres déjections, ceux aimant le froid polaire et ceux préférant la chaleur tropicale, les sédentaires et les voyageurs, les oiseaux de terre et les oiseaux d'eau ou de mer, les nageurs de surface et les plongeurs, ceux qui avaient appris à casser des noix, ceux qui ouvraient les coquillages, ceux qui fendaient les os, ceux qui mangeaient des vers, ceux qui gobaient des insectes en plein vol, ceux dont le bec perçait des trous dans le bois, ceux qui construisaient des nids de brindilles ou de boue, ceux nichant au sol et ceux préférant les arbres, ceux dont le bec fouillait la vase, ceux qui filtraient l'eau et ses suspensions, ceux dont le bec s'introduisait au plus profond des fleurs, les diurnes et les nocturnes, ceux qui limitaient la reproduction des autres en mangeant leurs ufs, et les grands rapaces pour surveiller le tout, éliminer les défaillants, mettre un terme aux proliférations excessives.
Mère Nature fit peu d'erreurs. On ne voit guère à lui reprocher que quelques oiseaux devenus par leur gigantisme incapables de voler. Les moas de Nouvelle-Zélande, les autruches géantes de Madagascar qui atteignaient trois, quatre et même cinq mètres de hauteur ! Mais cette erreur fut corrigée d'elle-même, car ces sortes de faux oiseaux disparurent rapidement, et seuls restèrent cloués au sol leurs cousins, malgré tout plus petits, que sont l'émeu, l'autruche des savanes africaines, le nandou, le casoar. Ces exceptions mises à part, les oiseaux restèrent de taille modeste. Les plus gros d'entre eux, comme les cygnes, continuèrent à voler et ceux dont les ailes étaient insuffisantes, comme le pingouin, se convertirent aux milieux aquatiques. Les plus nombreux restèrent voués au milieu aérien. Les uns utilisaient le vol plané, profitant des ascendances d'air pour surveiller de haut ce qui se passe au sol, ce qui est la fonction habituelle des aigles, vautours et condors, ou se laissant emporter, comme les pétrels, albatros et oiseaux marins, dans la violence des vents pour aller très loin sans effort. D'autres pratiquaient un vol battu pour suivre inflexiblement leur propre route, ou aller comme la pie avec son allure de marionnette mécanique d'un point précis à l'autre, ou comme l'hirondelle associant vol plané et vol battu. Beaucoup de petits oiseaux choisirent le vol ondulé, comme les fauvettes ou les moineaux, faisant alterner le battement et l'immobilité des ailes. Les colibris apprirent le battement d'aile tourbillonnaire, qui permet un vol immobile, sur place, comme un hélicoptère, et c'est ainsi qu'ils parvinrent à se nourrir du suc des fleurs.
On dit parfois que les oies sont des animaux stupides. Quelle erreur ! Oie rieuse, oie cendrée, oie des neige, bernache cravant (car la bernache est une oie marine), bernache nonnette, bernaches des Andes, du Canada ou de Hawaii, toutes ont un comportement admirable. Elles ont un grand esprit de famille, forment des couples qui ne divorcent guère, et sont toujours des parents attentifs. Les oies se signalent aussi par un grand esprit de discipline, suivant toujours leur chef, et sachant monter la garde et se protéger quand elles vivent en groupe. Les unes et les autres sillonnent le monde dans leurs migrations, volant tantôt en ligne oblique, et tantôt en angle obtus (en V), mais toujours en bon ordre, les forts et les expérimentés devant, les jeunes et les faibles dans le confort du sillage des premiers. Quelle force mystérieuse les conduit, battant inlassablement l'air, se guidant sur le soleil, le champ magnétique, ou simplement par la vue du paysage, le cou projetant la tête loin en avant, image énigmatique d'une inflexible volonté !
Il est d'autres migrateurs prodigieux. Qui aurait pensé que le colibris à gorge rubis qui ne pèse pas dix grammes, serait capable de traverser d'un seul vol tout le Golfe du Mexique ! Ou que l'aigle des steppes pourrait relier l'Asie Centrale et l'Afrique tous les ans ! Ou que le pélican, jamais "lassé de ses longs voyages", aurait étendu ses colonies sur tous les continents ! Et que dire de la sterne arctique, cet oiseau maladroit quand il est posé, ailes, cou et tête timidement repliés et composant une silhouette sans grâce. Mais quelle allure en vol ! La sterne arctique semble investie d'une mission de surveillance de la planète. Comme certains de nos satellites placés en orbite polaire, elle relie inlassablement les confins des deux pôles. Chaque année, avec la "légèreté d'une sylphide" ainsi que le disait joliment Audubon, elle parcourt près de quarante mille kilomètres, portée par vents et tempêtes. Chaque année elle choisit sa route, survole les océans, longe les côtes de l'Amérique, ou passe sur celles de l'Afrique, entre Arctique et Antarctique.
Mère Nature permit à ces nouveaux Maîtres du Monde de développer en toute liberté la beauté des formes, l'harmonie des couleurs, la variété de parures toujours changeantes. Les jeunes, les femelles, les mâles eurent des plumages différents les uns des autres. A l'âge adulte, tous durent en changer plusieurs fois par an. La variété devint immense et mit souvent beaucoup de perplexité ou de confusion dans l'esprit des hommes qui, par la suite, prétendirent être des ornithologues. Judicieusement disposées, les plumes parvinrent à modifier leur couleur instantanément, en quelque sorte, devenant diaphanes, chatoyantes, irisées, en décomposant la lumière à la manière du prisme newtonien. Plus étonnant que tout, alors que les êtres vivants n'avaient produit jusqu'alors que de tristes beuglements, des oiseaux spécialement éduqués par Mère Nature inventèrent le chant, la mélodie, et en firent des messages d'amour entre eux, des hymnes d'hommage au soleil quand il se lève, des symphonies à la gloire de Mère Nature et du Monde. Le rossignol en Eurasie, l'oiseau moqueur et la grive des bois en Amérique, devinrent des artistes incomparables.
Quinze mille ans avant ce jour, tout était pour le mieux, dans les apparences. Mais hélas ! Les oiseaux avaient assisté à l'arrivée de leur grand ennemi, sans comprendre ce qui allait se passer. Ils l'avaient vu dresser sa taille chétive, grandir en taille, en habileté, gagner en puissance, en intelligence, mais aussi en outrecuidance, en présomption, en exigence, en méchanceté, en bêtise souvent. Ils le virent tailler des pierres, puis inventer des armes mécaniques et bruyantes, s'avancer dans des contrées que l'on aurait pu croire inaccessibles à qui est sans aile ni plume. Le combat était inégal, ou plutôt il n'y eu pas de combat, car les oiseaux étaient incapables de se défendre contre les hommes. Les Maîtres du Monde d'un moment succombèrent par millions, victimes de la voracité des nouveaux venus. Pendant ces quatre derniers siècles, plus de quatre-vingt espèces d'oiseaux tombèrent en extinction. Le pigeon migrateur américain, si abondant qu'il réussissait à voiler la lumière du soleil en volant en groupes serrés, fut l'un d'eux. Ceux qui ne disparurent pas diminuèrent en nombre, et l'on sait que la population des hirondelles fut divisée par cinq. Certains oiseaux, comme les gypaètes barbus, ne comptent plus aujourd'hui que quelques individus ! Pendant plus de vingt ans, aucun pic à bec ivoire ne se montra, l'espèce fut portée disparue, jusqu'à ce que quelques rescapés fussent signalés dans les forêts cubaines !
Si tous n'ont pas encore péri, c'est que, parmi les hommes, certains comprirent que les oiseaux étaient aussi respectables, et peut-être meilleurs qu'eux. L'un des premiers à s'engager dans cette réflexion fut un très modeste Quaker vivant en Pennsylvanie il y a plus d'un siècle et demi. Il s'appelait William Bartram et n'avait jamais pris femme, trop occupé par les autres beautés que Mère Nature offrait à sa contemplation. En fait, il ne parlait jamais de Mère Nature et invoquait souvent le Créateur, ou Dieu, mais peut-être s'agit-il de la même personne, sous des noms différents. Ayant beaucoup vécu, voyagé et regardé, il était convaincu que les oiseaux étaient pourvus de sentiments analogues aux siens. Une corneille qui fut son amie des années durant, lui parut capable, à défaut de pouvoir rire (ce qui est "le propre" d'une autre espèce), de ruse, de malice et de drôlerie. Bartram écrivit longuement, patiemment, parce qu'il n'avait rien d'un auteur prolifique ou inconséquent, et qu'il ne cherchait pas la notoriété. Il produisit un seul et unique livre, de belle taille il faut dire, et quantité de notes inédites. Il vécut jusqu'à quatre vingt cinq ans, et quelques instants avant sa mort, soudaine autant que tardive, il consignait encore ses observations et ses idées. Mais avec quoi croyez-vous donc qu'il écrivait, lui qui ne pouvait disposer ni du clavier d'une machine à écrire ni d'un ordinateur ?
Eh bien ! Avec ce que Buffon, grand écrivain s'il en fût, disait être "l'instrument de nos pensées" ! Une plume d'oie !
31 mai à Noirmoutier
et 6 juin 2003 au Pays d'Auge
Signature :
Yvon Chatelin
Post-scriptum :
Il n'est pas ordinaire de joindre une bibliographie à un conte écrit pour les enfants, même prétendument philosophique. Néanmoins, pour le cas où un adulte viendrait à lire ce texte, je lui propose deux références : de Pierre-Paul Grassé, "Toi ce petit dieu", publié par Albin Michel, et de moi-même, "Le voyage de William Bartram", publié par Karthala. Les citations ou paraphrases entre guillemets sont empruntées à P.P. Grassé, Démocrite, Jacques Monod, Baudelaire, Chateaubriand, Audubon, A. de Vigny, Bergson, Buffon.
Spinoza a-t-il été bon géomètre ?
Un philosophe au siècle d'or du pays néerlandais
Faut-il présenter Spinoza, alors que, à ce jour, l'Harmattan lui a consacré, au moins partiellement, plus d'une vingtaine de livres ? En quelques lignes, rappelons cependant que ce philosophe répondait selon les moments et les lieux aux prénoms de Bento parce que sa famille venait du Portugal, de Baruch chez les Juifs sépharades de son premier environnement, et de Benedictus en tant qu'écrivain. Pour les Français qui ont commencé à vraiment s'intéresser à lui au 18e siècle, son prénom s'est transposé en Benoît. Toute sa courte vie s'est déroulée aux Pays-Bas, en plein milieu du siècle d'or. Il est né à Amsterdam en 1632 et il est décédé à La Haye en 1677, après avoir séjourné peu de temps dans les petites localités proches de Rijnsburg et de Vooburg. Ce Baruch était un grand sédentaire !
Comme beaucoup de philosophes de son temps, Spinoza écrivait en latin. L'uvre qu'il a laissée à la postérité est hétérogène et même inachevée, puisque, étant de faible santé, il est mort brusquement à un âge peu avancé. De son vivant, il n'a publié que deux ouvrages, le premier sous son nom et le deuxième anonymement. D'autres que lui ont mis de l'ordre dans la masse de ses écrits encore inédits, avec sans doute des choix, corrections, suppressions discutables. L'essentiel a été publié dès l'année suivant son décès, c'est-à-dire en 1778, à Amsterdam, sous le titre Opera posthuma.
Spinoza est devenu aujourd'hui un maître à penser. Tout ce qu'il a produit, y compris ce qui subsiste de sa correspondance, mérite d'être analysé, discuté, médité. Dans ce panorama général, il est communément admis que son ouvrage fondamental, irréductible cur de sa philosophie, est son "Éthique," au titre primitif complet de Ethica, Ordine Geometrico demonstrata et in quinque Partes distincta, in quibus agitur, tel qu'il est apparu dans le recueil Opera posthuma. Notons dès à présent la proclamation, dès le titre, d'un ordre ou d'une méthode dite "géométrique." De nos jours, le mot géométrie évoque trop exclusivement des figures spatiales. Bien que l'usage en soit conservé s'agissant de Spinoza, nous préférerons l'expression méthode "euclidienne," par référence à Euclide d'Alexandrie, le mathématicien de la Grèce antique auteur des Éléments.
D'Aristote à Descartes, en passant par Maïmonide
La première question que l'on pose pour l'uvre de Spinoza est celle de la place qu'il donne à Aristote qui a été pendant des siècles au fondement de tous les discours philosophiques, chez les Juifs (Maïmonide, Abranel, Delmenigo), les Musulmans (Avicenne, Averroès), les Chrétiens (la scolastique médiévale). Spinoza ne pouvait l'ignorer ou le négliger, et il suffit, pour s'en convaincre, d'un coup d'il aux premières pages de son Éthique. La première "définition" donnée par notre philosophe amstellodamois s'énonce ainsi : "Par cause de soi, j'entends " et la troisième "Par substance, j'entends " Or c'est chez le Stagirite que la notion philosophique de substance a son origine (sous le terme ousia, voir l'article de Suzanne Mansion, ci-dessous dans les Références), ainsi que la définition de quatre types de causes (matérielle, formelle, efficiente, finale).
Pourtant, Spinoza aurait pu aller plus loin. Il ne semble pas s'être imprégné de la logique d'Aristote, telle que présentée dans un ensemble de textes (Analytiques, De l'interprétation, etc.) réunis sous le titre de Organon. La raison en est simple. À l'époque de Spinoza, en plein 17e siècle, le monde universitaire et savant était profondément divisé en deux camps. Les traditionnalistes voulaient que l'on s'en tienne à Aristote. Voetius, recteur de l'université de Leyde que fréquenta Spinoza, avait lancé un décret comminatoire en ce sens. L'agressivité de ce premier camp était grande. Les progressistes formaient le deuxième camp. Ils se réclamaient de Descartes (1596-1650), dont nous rappelons qu'il a vécu et travaillé sous les mêmes cieux que Spinoza alors que celui-ci était alors trop jeune pour l'avoir rencontré.
Devenu adulte et philosophe, rejeté par la communauté Sépharade, Spinoza s'est pleinement engagé dans le cartésianisme. Il en a même adopté l'exigence extrême, celle de pousser le raisonnement jusqu'à la rigueur mathématique. En fait, Descartes lui-même, au-delà de ses pétitions de principe, n'allait pas très loin en ce sens. Après lecture des Méditations métaphysiques (1641), le Père Mersenne l'y a incité. "Ce serait, écrivait-il dans ses Secondes objections, une chose fort utile si, à la fin de vos solutions, après avoir premièrement avancé quelques définitions, demandes et axiomes, vous concluiez le tout selon la méthode des géomètres." Descartes a réagi en livrant quelques "définitions," "axiomes," et "propositions." Il y ajoutait, à titre d'exemples, deux "démonstrations" rapides de l'existence de Dieu (Objections et réponses, 1642). Spinoza n'avait alors qu'une dizaine d'années et fréquentait une yeshiva, école hébraïque.
Émergence d'une philosophie nouvelle
Parvenu à l'âge de commencer une uvre personnelle, initié au cartésianisme notamment par le francophone Franciscus Van den Enden (1602-1674), Spinoza a entrepris de faire mieux que son maître Descartes, en recomposant l'essentiel de Principia philosophiae (1644) sous forme euclidienne. Dès 1663, il publiait, sous son propre nom, Renati Descartes Principiorum philosophiae (ou Principes de la philosophie de Descartes, par Benedictus de Spinoza). Il s'agissait de reconsidérer les écrits de Descartes selon la méthode déployée par Euclide dans les quinze livres de ses Éléments (Στοιχεία).
Spinoza se devait ensuite de constituer sa propre philosophie selon les principes qu'il venait d'appliquer aux dépens de Descartes. C'est ce qu'il a réalisé dans cette Éthique mentionnée plus haut et qui fait notre objet ici. Dès 1665, il était prêt à la publier, mais en raison de la surveillance hostile de la majorité des élites savantes et politiques, au siècle d'or d'un pays pourtant catalogué tolérant, il l'a retirée de chez l'éditeur. Sans doute remaniée après 1665, l'Éthique n'est apparue qu'en 1678 dans Opera posthuma, comme dit plus haut. Pour le lecteur, même le plus averti, c'est un ouvrage d'une lourdeur extraordinaire. En quelques 264 pages de l'édition originale en latin, il déroule 26 définitions, 16 axiomes, quelques postulats, des lemmes et 259 propositions.
La méthode euclidienne en philosophie
Comment lire et assimiler tout cela ? Les "propositions" de Spinoza sont exprimées en des longueurs variables. Ainsi, on appréciera la brièveté de : "Il appartient à la substance d'exister" (E 1 p 7), mais il faudra plus d'attention pour : "L'idée d'une chose singulière existant en acte a pour cause Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il est considéré comme affecté d'une autre idée de chose singulière existant en acte, dont Dieu est aussi la cause en tant qu'il est affecté d'une troisième idée, et ainsi à l'infini" (E 2 p 9). Et il y a pire Spinoza fait suivre chaque proposition d'une ou de plusieurs "démonstrations." À la suite de Descartes, il voit ainsi plusieurs manières de prouver l'existence de Dieu, nous le verrons plus loin. Ces démonstrations sont au principe même de sa méthode euclidienne. Elles renvoient à des définitions, axiomes, démonstrations précédemment établis. On imagine la complexité éventuelle d'une proposition venant après une dizaine, une cinquantaine, une centaine ou même deux centaines d'autres.
Dans la réalité, il est aisé de cultiver le spinozisme sans s'attarder sur sa construction logique ou mathématique supposée. D'admirables philosophes, Léon Brunswick, Gilles Deleuze, Robert Misrahi et tant d'autres, le font ainsi, expliquant, commentant chaque idée, chaque mot. Les esprits les moins avertis s'approprient une image simplifiée, et s'en font, disent-ils, une règle de vie. Pour ces derniers, Spinoza est le philosophe du Désir, de la Joie, de la Béatitude, et cela leur suffit. Il est vrai qu'il n'est pas besoin de longue analyse formelle de ces "longues chaînes de raisons" (selon la formule élégante de Descartes), pour comprendre, notamment, que Spinoza plaide pour la toute puissance de la Raison, qu'il croit tout Déterminé dans l'univers, que Dieu et la Nature sont pour lui la même chose, Deus sive Natura. Certaines propositions elles-mêmes, certains passages de démonstrations et scolies, sont fort bien rédigés et explicites. La plupart des lecteurs de l'Éthique se contentent de ces extraits les plus signifiants et en débattent à leur aise.
Entre doutes et contestations
À notre connaissance, un seul philosophe, et non des moindres, a mis sérieusement en question la rigueur euclidienne dont se prévalait Spinoza. Professeur de philosophie à l'université, auteur prolixe et fécond, le regretté Francis Kaplan a publié en 1988 "L'Éthique de Spinoza et la méthode géométrique." La modestie du sous-titre, "Introduction à la lecture de Spinoza," ne fait pas oublier qu'il s'agit d'un travail original et fécond. Voyons, sur un exemple, comment Kaplan a opéré. Il s'agit de la proposition 11 de la Partie 1 de l'Éthique. Rappelons que cette première partie traite de Dieu, De Deo. Elle est la plus importante des cinq Parties de l'ouvrage, puisque tout le reste, Joie et Béatitude comprises, est censé en découler.
Spinoza énonce sa onzième proposition ainsi. "Dieu, autrement dit une substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." On remarque immédiatement le nombre de notions invoquées : nécessité, substance, essence, attribut, éternité, infini. Avec ce contenu, Spinoza se fait fort de démontrer la nécessité de l'existence de Dieu, de quatre manières (trois démonstration et un scolie). Mais quelle est cette nécessité, par rapport à quoi s'exerce-t-telle ? Esprit philosophique aiguisé et pourvu d'une bonne mémoire, Kaplan rappelle que Spinoza a précédemment écrit : "Par Dieu, j'entends un être absolument infini " (E 1 déf. 6). Alors, ou bien Dieu existe puisque Spinoza l'avait déjà défini, ou bien s'il faut vraiment démontrer son existence, ce n'est qu'après cette démonstration qu'il peut être défini. Première faute logique de Spinoza.
Une à une, Kaplan a effectué le démontage des quatre démonstrations de Spinoza. Nous nous attarderons seulement sur le scolie qui prétend que "plus il y a de réalité dans la nature d'une chose, plus elle a par elle-même de forces pour exister." Le scolie se poursuit et affirme : "Dieu a par soi-même une puissance absolue d'exister et par la suite il existe nécessairement." Pour Kaplan, cela couvre une ambiguïté. La "réalité" relève-t-elle de la "chose," ou de la "nature de la chose" ? Les deux concepts, "nature" et "chose," sont-ils identiques ? Et pour Kaplan, si la chose en question est un mode, il n'y a pas de réalité dans sa nature, elle n'a pas de force pour exister, et si c'est une substance elle a par sa définition même la force d'exister. Le scolie de Spinoza, quatrième preuve de l'existence de Dieu, s'effondre totalement.
Que le lecteur nous excuse de condenser trop brièvement l'argumentation de Kaplan. De fait, au fil de son ouvrage, sa critique s'applique à l'ensemble de la Première Partie de l'Éthique, et elle est dévastatrice. Si la Première Partie n'a pas la validité supposée, les Parties suivantes s'appuyant sur la Première en seront encore plus douteuses, bien que Kaplan ne les ait pas analysées. La prétention de Spinoza à une rigueur mathématique (ou euclidienne) s'écroule. Sans doute Spinoza ne mesurait-il pas le risque encouru par l'usage des mots d'un langage trop humain. Peut-être aussi a-t-il masqué le fond de sa pensée par des mots couramment employés et ne choquant personne (Gerrit H. Jongeneelen, référence ci-dessous). Intuitivement, on peut penser que tous les grands spécialistes de Spinoza ne se bercent pas d'illusion et qu'ils ont raison de considérer et discuter le spinozisme comme une autre philosophie, non comme une forme particulière des mathématiques, et sans faire trop de sémantique.
Apparition du "mind mapping"
Francis Kaplan s'appuyait sur une bonne mémoire personnelle et sur le feuilletage répétitif de livres en papier. Le mind mapping informatique nous offre aujourd'hui un nouveau moyen de travailler et de voir plus clair dans un ensemble conceptuel aussi compliqué que celui soutenu par Spinoza. Parmi d'autres applications possibles, nous avons utilisé coggle.it pour représenter l'Éthique, en établissant un diagramme pour les définitions, un autre pour les axiomes, et surtout un pour chacune des propositions. L'entreprise couvre actuellement les Parties 1 et 2 de l'Éthique et sera étendue éventuellement aux trois Parties restantes. Les diagrammes du mind mapping, consultés sur ordinateur et même sur smartphone, sont d'une très grande souplesse. Ils peuvent être largement étendus, à charge pour l'utilisateur de faire "glisser" la partie visualisée.
Nous avons choisi d'établir des diagrammes assez compacts, de manière que chacun d'eux puisse être lu sur un écran, sans glissement, et qu'il puisse être transposé dans une autre application bureautique, au format PDF ou PWT notamment, et même reproduit sur une feuille de papier. Pour rester lisible ainsi, un diagramme ne peut pas accepter une masse excessive d'information. L'intitulé complet de chaque proposition tient aisément dans le cadre central. Des liens raccordent celui-ci aux éléments ayant servi à son édification par Spinoza. Cela peut être très simple, pour une proposition reposant, par exemple, sur deux ou trois définitions ou axiomes. Mais la ramification peut s'étendre considérablement si une proposition appelle une proposition précédente, laquelle à son tour repose sur une autre, laquelle implique encore d'autres éléments, définitions, axiomes, ou même encore propositions. Cela devient déjà complexe quand il s'agit de modéliser les propositions de la Parties 2 qui font souvent renvoi à des éléments de la Partie 1.
Voilà la raison pour laquelle dans certains cas tous les éléments du diagramme donnent les textes in extenso, ou en raccourci et prolongés par des points de suspension, ou simplement représentés par les abréviations couramment utilisées pour l'Éthique par tous les auteurs. À savoir E 1,2,3,4,5 pour les différentes Parties, p ou prop. suivi d'un numéro pour les propositions, déf. et ax. numérotés pour définitions et axiomes. L'abréviation (p.m.) signifie, pour mémoire, elle indique que l'élément a déjà été présenté dans un diagramme antérieur. Ainsi E 1 p 5 désigne-t- il la cinquième proposition de l'Éthique dont l'intitulé pourra être reproduit, dans un futur diagramme, complètement ou par ses premiers mots. Autre exemple, E 1 ax. 4 (p.m.) désigne le quatrième axiome de la Première Partie, lequel a déjà été exposé et ne sera pas répliqué entièrement faute de place.
Deux simples exemples
Deux diagrammes seulement vont être commentés ici. Le premier, Spinoza E 1 p 6, représente la proposition 6 de la Première Partie. Son intitulé (Une substance ne peut être produite par une autre substance) est donné dans le cadre central. Des liens colorés conduisent du cadre central aux divers éléments sur lesquels Spinoza a basé sa proposition 6. Ces éléments de référence sont hiérarchisés. Ceux sur lesquels la proposition 6 est directement basée, constituent ce que nous appellerons le premier cercle. À leur tour, les éléments du premier cercle sont liés aux éléments antérieurs ayant servis à leur édification et qui constituent le deuxième cercle. Le troisième cercle est formé de la même manière. On remarquera que, sur ce diagramme représentant la proposition 6, le premier cercle fait apparaître E 1 déf. 3, E 1 ax. 4, E 1 prop. 2,3,5. Au deuxième cercle figurent E 1 déf. 3, E 1 ax. 3,4,6, prop. 1,4. Le troisième cercle est formé par E 1 déf. 1,5 et E 1 déf. 3,4,5 et E 1 ax. 1 qui sont à la base des deux propositions du cercle précédent.
Notre deuxième exemple, E 1 p 11, porte sur la onzième proposition, pour laquelle nous avons résumé plus haut la critique acerbe de Francis Kaplan. Pour varier les présentations, nous avons choisi cette fois d'établir un diagramme plus aéré, esthétiquement plus agréable que le précédent, en remplaçant les énoncés d'importance secondaire par des renvois (p.m.). Néanmoins, le diagramme fait sauter aux yeux l'analogie, sinon l'équivalence, des énoncés de la proposition 11 (Dieu, autrement dit une substance constituée d'une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement) et de la définition 6 (Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie) censée être une de ses racines.
Les propositions venant d'être présentée (E 1 p 6 et E 1 p 11) sont parmi les premières de l'Éthique et elles sont déjà quelque peu complexes. On imagine la difficulté que doit surmonter qui prétend vérifier, ou simplement comprendre, exemplifier, illustrer la méthode euclidienne de Spinoza. Soulignons que Francis Kaplan s'est borné aux 26 définitions de la Première Partie, alors que la totalité de l'Éthique en contient plus de 250.
Ajoutons qu'Aaron Garrett est venu récemment alimenter la critique de Spinoza (référence ci-dessous) Il pose la question de voir l'Éthique selon un "ordre" (arrangement pédagogique du savoir) ou selon une "méthode" (procédé de production du savoir). Ou encore par la dualité "analyse" et "synthèse." Malgré un usage répété de l'expression "méthode géométrique," par lui-même, ses proches et successeurs, il est difficile de décider ce qu'entendait exactement Spinoza. Garrett ajoute à cette interrogation l'inventaire de la pensée "mathématique" chez les philosophes antérieurs ou contemporains de Spinoza, les Hobbes, Descartes, Leibniz, Samuel von Pufendorf (né la même année que Spinoza). L'approche de Garrett est théorique et philosophique, elle ne procède pas, comme envisagé par Kaplan et nous, à la déconstruction des propositions de Spinoza, l'une après l'autre. Néanmoins, elle sera du plus grand intérêt à qui voudra reprendre le problème. On consultera aussi avec profit Gerrit H. Jongeneelen (référence ci-dessous), pour mieux appréhender l'origine et la complexité du lexique employé par Spinoza.
En guise de conclusion
La visualisation opérée par le mind mapping conduit à se poser quelques questions impertinentes. Où Spinoza a-t-il trouvé (pour la seule Première Partie) ses 8 définitions et ses 7 axiomes, ces derniers sont-ils réellement évidents ? Aurait-il été lui-même surpris par ce que sa dite "géométrie" allait établir implacablement ? Ou plutôt n'avait-il pas au départ en tête ce qu'il allait prétendre démontrer en dehors de toute idée préconçue, l'existence de Dieu, le déterminisme général, et le reste ?
Comme déjà dit, nous présentons en ces deux exemples des diagrammes compacts, pour les rendre facilement reproduits. Dans Spinoza raconté (référence ci-dessous) on trouvera une comparaison entre graphes traditionnels, établis à la planche à dessin ou avec une application bureautique comme PowerPoint, et les diagrammes beaucoup plus performants du mind mapping. Pour qui veut approfondir l'examen de l'Éthique spinozienne et de sa méthode euclidienne, ces diagrammes peuvent être développés, élargis, complétés, faisant apparaître tous les énoncés intégraux des définitions, axiomes, propositions, quitte à visualiser le tout seulement en faisant glisser la fraction visible. Cela doit s'effectuer en ligne sur le site https://coggle.it/
À présent, seules les deux premières Parties de l'Éthique ont été traitées par nous en mind mapping. Chacun peut les consulter depuis son ordinateur aux adresses :
Spinoza Ethique Première Partie - Coggle
(https://coggle.it/folder/604f5467aca91d3d50e36759)
Spinosa Ethique Deuxième Partie - Coggle
(https://coggle.it/folder/60775a1956e34b00003a05b3)
Il est possible aussi de chercher directement l'une ou l'autre des propositions de Spinoza telles que nous les représentons sur le site coggle.it. Elles ont toutes la même structure et débutent par la même formule : "Spinoza E 1 p 1 " ou "Spinoza E 2 p 1 " etc. Par exemple, pour obtenir les deux propositions discutées plus haut, on frappera dans son moteur de recherche "Spinoza E 1 p 6" et "Spinoza E 1 p 11." On obtiendra définitions et axiomes en appelant, pour la Première Partie, "Spinoza E 1 Les définitions," "Spinoza E 1 Les axiomes" et de même pour la Deuxième Partie, E 2.
Rien ne nous interdit de poursuivre l'opération de mise en forme par coggle.it jusqu'à couvrir la totalité de l'Éthique, ce n'est qu'une question de travail et de temps. Il est clair que les diagrammes ainsi créés ne prétendent qu'à être des outils pour d'éventuelles et futures études. Rappelons qu'ils peuvent être disposés comme des arborescences simples (visualisables sur un écran ou une feuille de papier), ou au contraire étendues, complexifiées (visualisables par glissement sur écran, ou par découpage). Le but de ces diagrammes est de faciliter la localisation et la recension des multiples vocables dont se sert Spinoza. Certains éléments sont réutilisés en quasi permanence, comme cela est le cas de E 1 ax. 4, "la connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe." D'autres sont beaucoup moins employés. Qu'entend notre philosophe, ici et là, par des mots d'usage commun et facilement polysémiques comme chose, nature, conçu, enveloppe, genre, affection etc. ? Comment définit-il, construit-il, enrichit-il, d'une proposition à l'autre, les grandes notions de son système, substance, attribut, mode, cause, éternité, infini, vérité, existence etc. ? Y aurait-il des ambiguïtés, des redondances, des contradictions ? L'inventaire du positif est à faire, la chasse à ce qui est douteux est ouverte. Voilà un beau sujet de thèse à entreprendre !
Références
Audié, Fabrice Spinoza et les mathématiques, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005.
Chatelin, Yvon Spinoza raconté par lui-même et par ceux qui l'ont connu, à paraître.
Garrett, Aaron The virtues of geometry, in Michael Della Rocca, éd., The Oxford Handbook of Spinoza's Ethics, 2017.
Jongeneelen, Gerrit H. Semantic change and the semantics of Spinoza, Lexicon Philosophicum, 11 (pp11-128), 2001.
Kaplan, Francis L'Éthique de Spinoza et la méthode géométrique, Flammarion, 1998.
Mansion, Suzanne La première doctrine de la substance, Revue Philosophique de Louvain, 44, 3, 1946.
Manzini, Frédéric Spinoza, une lecture d'Aristote, PUF, 2009.
Lire plus
Faut-il présenter Spinoza, alors que, à ce jour, l'Harmattan lui a consacré, au moins partiellement, plus d'une vingtaine de livres ? En quelques lignes, rappelons cependant que ce philosophe répondait selon les moments et les lieux aux prénoms de Bento parce que sa famille venait du Portugal, de Baruch chez les Juifs sépharades de son premier environnement, et de Benedictus en tant qu'écrivain. Pour les Français qui ont commencé à vraiment s'intéresser à lui au 18e siècle, son prénom s'est transposé en Benoît. Toute sa courte vie s'est déroulée aux Pays-Bas, en plein milieu du siècle d'or. Il est né à Amsterdam en 1632 et il est décédé à La Haye en 1677, après avoir séjourné peu de temps dans les petites localités proches de Rijnsburg et de Vooburg. Ce Baruch était un grand sédentaire !
Comme beaucoup de philosophes de son temps, Spinoza écrivait en latin. L'uvre qu'il a laissée à la postérité est hétérogène et même inachevée, puisque, étant de faible santé, il est mort brusquement à un âge peu avancé. De son vivant, il n'a publié que deux ouvrages, le premier sous son nom et le deuxième anonymement. D'autres que lui ont mis de l'ordre dans la masse de ses écrits encore inédits, avec sans doute des choix, corrections, suppressions discutables. L'essentiel a été publié dès l'année suivant son décès, c'est-à-dire en 1778, à Amsterdam, sous le titre Opera posthuma.
Spinoza est devenu aujourd'hui un maître à penser. Tout ce qu'il a produit, y compris ce qui subsiste de sa correspondance, mérite d'être analysé, discuté, médité. Dans ce panorama général, il est communément admis que son ouvrage fondamental, irréductible cur de sa philosophie, est son "Éthique," au titre primitif complet de Ethica, Ordine Geometrico demonstrata et in quinque Partes distincta, in quibus agitur, tel qu'il est apparu dans le recueil Opera posthuma. Notons dès à présent la proclamation, dès le titre, d'un ordre ou d'une méthode dite "géométrique." De nos jours, le mot géométrie évoque trop exclusivement des figures spatiales. Bien que l'usage en soit conservé s'agissant de Spinoza, nous préférerons l'expression méthode "euclidienne," par référence à Euclide d'Alexandrie, le mathématicien de la Grèce antique auteur des Éléments.
D'Aristote à Descartes, en passant par Maïmonide
La première question que l'on pose pour l'uvre de Spinoza est celle de la place qu'il donne à Aristote qui a été pendant des siècles au fondement de tous les discours philosophiques, chez les Juifs (Maïmonide, Abranel, Delmenigo), les Musulmans (Avicenne, Averroès), les Chrétiens (la scolastique médiévale). Spinoza ne pouvait l'ignorer ou le négliger, et il suffit, pour s'en convaincre, d'un coup d'il aux premières pages de son Éthique. La première "définition" donnée par notre philosophe amstellodamois s'énonce ainsi : "Par cause de soi, j'entends " et la troisième "Par substance, j'entends " Or c'est chez le Stagirite que la notion philosophique de substance a son origine (sous le terme ousia, voir l'article de Suzanne Mansion, ci-dessous dans les Références), ainsi que la définition de quatre types de causes (matérielle, formelle, efficiente, finale).
Pourtant, Spinoza aurait pu aller plus loin. Il ne semble pas s'être imprégné de la logique d'Aristote, telle que présentée dans un ensemble de textes (Analytiques, De l'interprétation, etc.) réunis sous le titre de Organon. La raison en est simple. À l'époque de Spinoza, en plein 17e siècle, le monde universitaire et savant était profondément divisé en deux camps. Les traditionnalistes voulaient que l'on s'en tienne à Aristote. Voetius, recteur de l'université de Leyde que fréquenta Spinoza, avait lancé un décret comminatoire en ce sens. L'agressivité de ce premier camp était grande. Les progressistes formaient le deuxième camp. Ils se réclamaient de Descartes (1596-1650), dont nous rappelons qu'il a vécu et travaillé sous les mêmes cieux que Spinoza alors que celui-ci était alors trop jeune pour l'avoir rencontré.
Devenu adulte et philosophe, rejeté par la communauté Sépharade, Spinoza s'est pleinement engagé dans le cartésianisme. Il en a même adopté l'exigence extrême, celle de pousser le raisonnement jusqu'à la rigueur mathématique. En fait, Descartes lui-même, au-delà de ses pétitions de principe, n'allait pas très loin en ce sens. Après lecture des Méditations métaphysiques (1641), le Père Mersenne l'y a incité. "Ce serait, écrivait-il dans ses Secondes objections, une chose fort utile si, à la fin de vos solutions, après avoir premièrement avancé quelques définitions, demandes et axiomes, vous concluiez le tout selon la méthode des géomètres." Descartes a réagi en livrant quelques "définitions," "axiomes," et "propositions." Il y ajoutait, à titre d'exemples, deux "démonstrations" rapides de l'existence de Dieu (Objections et réponses, 1642). Spinoza n'avait alors qu'une dizaine d'années et fréquentait une yeshiva, école hébraïque.
Émergence d'une philosophie nouvelle
Parvenu à l'âge de commencer une uvre personnelle, initié au cartésianisme notamment par le francophone Franciscus Van den Enden (1602-1674), Spinoza a entrepris de faire mieux que son maître Descartes, en recomposant l'essentiel de Principia philosophiae (1644) sous forme euclidienne. Dès 1663, il publiait, sous son propre nom, Renati Descartes Principiorum philosophiae (ou Principes de la philosophie de Descartes, par Benedictus de Spinoza). Il s'agissait de reconsidérer les écrits de Descartes selon la méthode déployée par Euclide dans les quinze livres de ses Éléments (Στοιχεία).
Spinoza se devait ensuite de constituer sa propre philosophie selon les principes qu'il venait d'appliquer aux dépens de Descartes. C'est ce qu'il a réalisé dans cette Éthique mentionnée plus haut et qui fait notre objet ici. Dès 1665, il était prêt à la publier, mais en raison de la surveillance hostile de la majorité des élites savantes et politiques, au siècle d'or d'un pays pourtant catalogué tolérant, il l'a retirée de chez l'éditeur. Sans doute remaniée après 1665, l'Éthique n'est apparue qu'en 1678 dans Opera posthuma, comme dit plus haut. Pour le lecteur, même le plus averti, c'est un ouvrage d'une lourdeur extraordinaire. En quelques 264 pages de l'édition originale en latin, il déroule 26 définitions, 16 axiomes, quelques postulats, des lemmes et 259 propositions.
La méthode euclidienne en philosophie
Comment lire et assimiler tout cela ? Les "propositions" de Spinoza sont exprimées en des longueurs variables. Ainsi, on appréciera la brièveté de : "Il appartient à la substance d'exister" (E 1 p 7), mais il faudra plus d'attention pour : "L'idée d'une chose singulière existant en acte a pour cause Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il est considéré comme affecté d'une autre idée de chose singulière existant en acte, dont Dieu est aussi la cause en tant qu'il est affecté d'une troisième idée, et ainsi à l'infini" (E 2 p 9). Et il y a pire Spinoza fait suivre chaque proposition d'une ou de plusieurs "démonstrations." À la suite de Descartes, il voit ainsi plusieurs manières de prouver l'existence de Dieu, nous le verrons plus loin. Ces démonstrations sont au principe même de sa méthode euclidienne. Elles renvoient à des définitions, axiomes, démonstrations précédemment établis. On imagine la complexité éventuelle d'une proposition venant après une dizaine, une cinquantaine, une centaine ou même deux centaines d'autres.
Dans la réalité, il est aisé de cultiver le spinozisme sans s'attarder sur sa construction logique ou mathématique supposée. D'admirables philosophes, Léon Brunswick, Gilles Deleuze, Robert Misrahi et tant d'autres, le font ainsi, expliquant, commentant chaque idée, chaque mot. Les esprits les moins avertis s'approprient une image simplifiée, et s'en font, disent-ils, une règle de vie. Pour ces derniers, Spinoza est le philosophe du Désir, de la Joie, de la Béatitude, et cela leur suffit. Il est vrai qu'il n'est pas besoin de longue analyse formelle de ces "longues chaînes de raisons" (selon la formule élégante de Descartes), pour comprendre, notamment, que Spinoza plaide pour la toute puissance de la Raison, qu'il croit tout Déterminé dans l'univers, que Dieu et la Nature sont pour lui la même chose, Deus sive Natura. Certaines propositions elles-mêmes, certains passages de démonstrations et scolies, sont fort bien rédigés et explicites. La plupart des lecteurs de l'Éthique se contentent de ces extraits les plus signifiants et en débattent à leur aise.
Entre doutes et contestations
À notre connaissance, un seul philosophe, et non des moindres, a mis sérieusement en question la rigueur euclidienne dont se prévalait Spinoza. Professeur de philosophie à l'université, auteur prolixe et fécond, le regretté Francis Kaplan a publié en 1988 "L'Éthique de Spinoza et la méthode géométrique." La modestie du sous-titre, "Introduction à la lecture de Spinoza," ne fait pas oublier qu'il s'agit d'un travail original et fécond. Voyons, sur un exemple, comment Kaplan a opéré. Il s'agit de la proposition 11 de la Partie 1 de l'Éthique. Rappelons que cette première partie traite de Dieu, De Deo. Elle est la plus importante des cinq Parties de l'ouvrage, puisque tout le reste, Joie et Béatitude comprises, est censé en découler.
Spinoza énonce sa onzième proposition ainsi. "Dieu, autrement dit une substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." On remarque immédiatement le nombre de notions invoquées : nécessité, substance, essence, attribut, éternité, infini. Avec ce contenu, Spinoza se fait fort de démontrer la nécessité de l'existence de Dieu, de quatre manières (trois démonstration et un scolie). Mais quelle est cette nécessité, par rapport à quoi s'exerce-t-telle ? Esprit philosophique aiguisé et pourvu d'une bonne mémoire, Kaplan rappelle que Spinoza a précédemment écrit : "Par Dieu, j'entends un être absolument infini " (E 1 déf. 6). Alors, ou bien Dieu existe puisque Spinoza l'avait déjà défini, ou bien s'il faut vraiment démontrer son existence, ce n'est qu'après cette démonstration qu'il peut être défini. Première faute logique de Spinoza.
Une à une, Kaplan a effectué le démontage des quatre démonstrations de Spinoza. Nous nous attarderons seulement sur le scolie qui prétend que "plus il y a de réalité dans la nature d'une chose, plus elle a par elle-même de forces pour exister." Le scolie se poursuit et affirme : "Dieu a par soi-même une puissance absolue d'exister et par la suite il existe nécessairement." Pour Kaplan, cela couvre une ambiguïté. La "réalité" relève-t-elle de la "chose," ou de la "nature de la chose" ? Les deux concepts, "nature" et "chose," sont-ils identiques ? Et pour Kaplan, si la chose en question est un mode, il n'y a pas de réalité dans sa nature, elle n'a pas de force pour exister, et si c'est une substance elle a par sa définition même la force d'exister. Le scolie de Spinoza, quatrième preuve de l'existence de Dieu, s'effondre totalement.
Que le lecteur nous excuse de condenser trop brièvement l'argumentation de Kaplan. De fait, au fil de son ouvrage, sa critique s'applique à l'ensemble de la Première Partie de l'Éthique, et elle est dévastatrice. Si la Première Partie n'a pas la validité supposée, les Parties suivantes s'appuyant sur la Première en seront encore plus douteuses, bien que Kaplan ne les ait pas analysées. La prétention de Spinoza à une rigueur mathématique (ou euclidienne) s'écroule. Sans doute Spinoza ne mesurait-il pas le risque encouru par l'usage des mots d'un langage trop humain. Peut-être aussi a-t-il masqué le fond de sa pensée par des mots couramment employés et ne choquant personne (Gerrit H. Jongeneelen, référence ci-dessous). Intuitivement, on peut penser que tous les grands spécialistes de Spinoza ne se bercent pas d'illusion et qu'ils ont raison de considérer et discuter le spinozisme comme une autre philosophie, non comme une forme particulière des mathématiques, et sans faire trop de sémantique.
Apparition du "mind mapping"
Francis Kaplan s'appuyait sur une bonne mémoire personnelle et sur le feuilletage répétitif de livres en papier. Le mind mapping informatique nous offre aujourd'hui un nouveau moyen de travailler et de voir plus clair dans un ensemble conceptuel aussi compliqué que celui soutenu par Spinoza. Parmi d'autres applications possibles, nous avons utilisé coggle.it pour représenter l'Éthique, en établissant un diagramme pour les définitions, un autre pour les axiomes, et surtout un pour chacune des propositions. L'entreprise couvre actuellement les Parties 1 et 2 de l'Éthique et sera étendue éventuellement aux trois Parties restantes. Les diagrammes du mind mapping, consultés sur ordinateur et même sur smartphone, sont d'une très grande souplesse. Ils peuvent être largement étendus, à charge pour l'utilisateur de faire "glisser" la partie visualisée.
Nous avons choisi d'établir des diagrammes assez compacts, de manière que chacun d'eux puisse être lu sur un écran, sans glissement, et qu'il puisse être transposé dans une autre application bureautique, au format PDF ou PWT notamment, et même reproduit sur une feuille de papier. Pour rester lisible ainsi, un diagramme ne peut pas accepter une masse excessive d'information. L'intitulé complet de chaque proposition tient aisément dans le cadre central. Des liens raccordent celui-ci aux éléments ayant servi à son édification par Spinoza. Cela peut être très simple, pour une proposition reposant, par exemple, sur deux ou trois définitions ou axiomes. Mais la ramification peut s'étendre considérablement si une proposition appelle une proposition précédente, laquelle à son tour repose sur une autre, laquelle implique encore d'autres éléments, définitions, axiomes, ou même encore propositions. Cela devient déjà complexe quand il s'agit de modéliser les propositions de la Parties 2 qui font souvent renvoi à des éléments de la Partie 1.
Voilà la raison pour laquelle dans certains cas tous les éléments du diagramme donnent les textes in extenso, ou en raccourci et prolongés par des points de suspension, ou simplement représentés par les abréviations couramment utilisées pour l'Éthique par tous les auteurs. À savoir E 1,2,3,4,5 pour les différentes Parties, p ou prop. suivi d'un numéro pour les propositions, déf. et ax. numérotés pour définitions et axiomes. L'abréviation (p.m.) signifie, pour mémoire, elle indique que l'élément a déjà été présenté dans un diagramme antérieur. Ainsi E 1 p 5 désigne-t- il la cinquième proposition de l'Éthique dont l'intitulé pourra être reproduit, dans un futur diagramme, complètement ou par ses premiers mots. Autre exemple, E 1 ax. 4 (p.m.) désigne le quatrième axiome de la Première Partie, lequel a déjà été exposé et ne sera pas répliqué entièrement faute de place.
Deux simples exemples
Deux diagrammes seulement vont être commentés ici. Le premier, Spinoza E 1 p 6, représente la proposition 6 de la Première Partie. Son intitulé (Une substance ne peut être produite par une autre substance) est donné dans le cadre central. Des liens colorés conduisent du cadre central aux divers éléments sur lesquels Spinoza a basé sa proposition 6. Ces éléments de référence sont hiérarchisés. Ceux sur lesquels la proposition 6 est directement basée, constituent ce que nous appellerons le premier cercle. À leur tour, les éléments du premier cercle sont liés aux éléments antérieurs ayant servis à leur édification et qui constituent le deuxième cercle. Le troisième cercle est formé de la même manière. On remarquera que, sur ce diagramme représentant la proposition 6, le premier cercle fait apparaître E 1 déf. 3, E 1 ax. 4, E 1 prop. 2,3,5. Au deuxième cercle figurent E 1 déf. 3, E 1 ax. 3,4,6, prop. 1,4. Le troisième cercle est formé par E 1 déf. 1,5 et E 1 déf. 3,4,5 et E 1 ax. 1 qui sont à la base des deux propositions du cercle précédent.
Notre deuxième exemple, E 1 p 11, porte sur la onzième proposition, pour laquelle nous avons résumé plus haut la critique acerbe de Francis Kaplan. Pour varier les présentations, nous avons choisi cette fois d'établir un diagramme plus aéré, esthétiquement plus agréable que le précédent, en remplaçant les énoncés d'importance secondaire par des renvois (p.m.). Néanmoins, le diagramme fait sauter aux yeux l'analogie, sinon l'équivalence, des énoncés de la proposition 11 (Dieu, autrement dit une substance constituée d'une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement) et de la définition 6 (Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie) censée être une de ses racines.
Les propositions venant d'être présentée (E 1 p 6 et E 1 p 11) sont parmi les premières de l'Éthique et elles sont déjà quelque peu complexes. On imagine la difficulté que doit surmonter qui prétend vérifier, ou simplement comprendre, exemplifier, illustrer la méthode euclidienne de Spinoza. Soulignons que Francis Kaplan s'est borné aux 26 définitions de la Première Partie, alors que la totalité de l'Éthique en contient plus de 250.
Ajoutons qu'Aaron Garrett est venu récemment alimenter la critique de Spinoza (référence ci-dessous) Il pose la question de voir l'Éthique selon un "ordre" (arrangement pédagogique du savoir) ou selon une "méthode" (procédé de production du savoir). Ou encore par la dualité "analyse" et "synthèse." Malgré un usage répété de l'expression "méthode géométrique," par lui-même, ses proches et successeurs, il est difficile de décider ce qu'entendait exactement Spinoza. Garrett ajoute à cette interrogation l'inventaire de la pensée "mathématique" chez les philosophes antérieurs ou contemporains de Spinoza, les Hobbes, Descartes, Leibniz, Samuel von Pufendorf (né la même année que Spinoza). L'approche de Garrett est théorique et philosophique, elle ne procède pas, comme envisagé par Kaplan et nous, à la déconstruction des propositions de Spinoza, l'une après l'autre. Néanmoins, elle sera du plus grand intérêt à qui voudra reprendre le problème. On consultera aussi avec profit Gerrit H. Jongeneelen (référence ci-dessous), pour mieux appréhender l'origine et la complexité du lexique employé par Spinoza.
En guise de conclusion
La visualisation opérée par le mind mapping conduit à se poser quelques questions impertinentes. Où Spinoza a-t-il trouvé (pour la seule Première Partie) ses 8 définitions et ses 7 axiomes, ces derniers sont-ils réellement évidents ? Aurait-il été lui-même surpris par ce que sa dite "géométrie" allait établir implacablement ? Ou plutôt n'avait-il pas au départ en tête ce qu'il allait prétendre démontrer en dehors de toute idée préconçue, l'existence de Dieu, le déterminisme général, et le reste ?
Comme déjà dit, nous présentons en ces deux exemples des diagrammes compacts, pour les rendre facilement reproduits. Dans Spinoza raconté (référence ci-dessous) on trouvera une comparaison entre graphes traditionnels, établis à la planche à dessin ou avec une application bureautique comme PowerPoint, et les diagrammes beaucoup plus performants du mind mapping. Pour qui veut approfondir l'examen de l'Éthique spinozienne et de sa méthode euclidienne, ces diagrammes peuvent être développés, élargis, complétés, faisant apparaître tous les énoncés intégraux des définitions, axiomes, propositions, quitte à visualiser le tout seulement en faisant glisser la fraction visible. Cela doit s'effectuer en ligne sur le site https://coggle.it/
À présent, seules les deux premières Parties de l'Éthique ont été traitées par nous en mind mapping. Chacun peut les consulter depuis son ordinateur aux adresses :
Spinoza Ethique Première Partie - Coggle
(https://coggle.it/folder/604f5467aca91d3d50e36759)
Spinosa Ethique Deuxième Partie - Coggle
(https://coggle.it/folder/60775a1956e34b00003a05b3)
Il est possible aussi de chercher directement l'une ou l'autre des propositions de Spinoza telles que nous les représentons sur le site coggle.it. Elles ont toutes la même structure et débutent par la même formule : "Spinoza E 1 p 1 " ou "Spinoza E 2 p 1 " etc. Par exemple, pour obtenir les deux propositions discutées plus haut, on frappera dans son moteur de recherche "Spinoza E 1 p 6" et "Spinoza E 1 p 11." On obtiendra définitions et axiomes en appelant, pour la Première Partie, "Spinoza E 1 Les définitions," "Spinoza E 1 Les axiomes" et de même pour la Deuxième Partie, E 2.
Rien ne nous interdit de poursuivre l'opération de mise en forme par coggle.it jusqu'à couvrir la totalité de l'Éthique, ce n'est qu'une question de travail et de temps. Il est clair que les diagrammes ainsi créés ne prétendent qu'à être des outils pour d'éventuelles et futures études. Rappelons qu'ils peuvent être disposés comme des arborescences simples (visualisables sur un écran ou une feuille de papier), ou au contraire étendues, complexifiées (visualisables par glissement sur écran, ou par découpage). Le but de ces diagrammes est de faciliter la localisation et la recension des multiples vocables dont se sert Spinoza. Certains éléments sont réutilisés en quasi permanence, comme cela est le cas de E 1 ax. 4, "la connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe." D'autres sont beaucoup moins employés. Qu'entend notre philosophe, ici et là, par des mots d'usage commun et facilement polysémiques comme chose, nature, conçu, enveloppe, genre, affection etc. ? Comment définit-il, construit-il, enrichit-il, d'une proposition à l'autre, les grandes notions de son système, substance, attribut, mode, cause, éternité, infini, vérité, existence etc. ? Y aurait-il des ambiguïtés, des redondances, des contradictions ? L'inventaire du positif est à faire, la chasse à ce qui est douteux est ouverte. Voilà un beau sujet de thèse à entreprendre !
Références
Audié, Fabrice Spinoza et les mathématiques, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005.
Chatelin, Yvon Spinoza raconté par lui-même et par ceux qui l'ont connu, à paraître.
Garrett, Aaron The virtues of geometry, in Michael Della Rocca, éd., The Oxford Handbook of Spinoza's Ethics, 2017.
Jongeneelen, Gerrit H. Semantic change and the semantics of Spinoza, Lexicon Philosophicum, 11 (pp11-128), 2001.
Kaplan, Francis L'Éthique de Spinoza et la méthode géométrique, Flammarion, 1998.
Mansion, Suzanne La première doctrine de la substance, Revue Philosophique de Louvain, 44, 3, 1946.
Manzini, Frédéric Spinoza, une lecture d'Aristote, PUF, 2009.
L'oiseau, la fleur, le paysage Réflexion sur Audubon et Thomas Cole
"J'ai l'il", avait coutume de dire Audubon. Rien ne lui échappait, mais il n'avait pas pour autant l'aptitude (ni le temps) de tout décrire par des mots, de tout peindre ou dessiner. À ses débuts, lorsqu'il était en voyage, il lui arrivait de faire un croquis de sites spectaculaires, falaises de bord de fleuve, confluences de rivières, chutes d'eau, mais cela n'avait rien de systématique. Il semble même qu'il ne l'ait pas fait pour les chutes du Niagara que tant de visiteurs pourtant moins doués pour le dessin se sont plu à représenter. En plusieurs décennies de travail sur le sol américain, il a produit une masse énorme de papiers, lettres, carnets de notes, feuilles dessinées ou aquarellées, mais tout n'a pas été conservé. On ne connaît aujourd'hui que très peu de croquis de paysages effectués par lui sur le terrain. Si l'on veut caractériser brièvement l'artiste Audubon, on dira qu'il était un peintre d'oiseau génial, et on ajoutera peut-être qu'il était aussi un bon peintre de fleurs, tant celles-ci sont fréquemment et somptueusement associées à ses portraits de The Birds of America.
Pourtant, à un certain moment, désespérant de se faire reconnaître comme artiste naturaliste, il pensait se consacrer à la peinture de sites réputés et attractifs pour le public. Il n'est pas allé loin dans cette voie, ne réalisant qu'une seule toile à l'huile, Natchez, Mississippi, in 1822 qui se trouve aujourd'hui entre des mains privées mais dont on peut voir une image numérique sur le site Flick.com ou des reproductions sur papier (Mississippi Department of Archives and History). Elle montre de manière très réaliste la ville de Natchez bien connue d'Audubon, vue depuis le plateau où sa partie haute est installée. Le Mississippi n'y est donc pas visible. Au contraire on y distingue des bâtiments précis comme les restes de Fort Rosalie au premier plan, la résidence Clifton dont la propriétaire lui avait commandé le tableau, ou celle du Gouverneur Holmes qui, par la suite, a appartenu à Jefferson Davis, le président de la Confédération à l'époque de la Guerre civile. La peinture est celle d'un bon coloriste auquel le désir de coller à la réalité (grande caractéristique d'Audubon peintre des oiseaux, avec celle du culte de la beauté) a conféré un style assez naïf.
Longtemps, suivant en cela la tradition du dessin ornithologique, Audubon a donné à ses oiseaux un décor végétal et floral qui devait, autant que possible, correspondre à leur habitat et à leurs habitudes alimentaires. Il serait fastidieux d'énumérer tous les types de plantes que l'on trouve dans les gravures de The Birds of America, mais je voudrais tout de même donner une idée de leur diversité. Audubon a représenté quantité d'arbres. Parmi les feuillus, on trouve souvent des chênes (dont les live oaks), mais aussi des érables, noyers (walnut, hickory), magnolias, tulipiers, peupliers, bouleaux, châtaigniers, sassafras, copalmes, houx etc. Les conifères sont nombreux aussi, cèdres, tsugas du Canada, pins divers. Parmi les plantes arbustives, retenons les lauriers, kalmies, rhododendrons, azalées, franklinia, gordonias, cornouillers, hibiscus. Audubon aimait beaucoup les lianes et plantes grimpantes, sumacs, bignones, jasmins, salsepareilles. Enfin, moins spectaculaires, apparaissent aussi quantité de plantes herbacées et annuelles, comme les iris, sarracénies, verveines. Bien entendu, il n'ignorait pas la fameuse mousse espagnole, il l'a représentée à trois reprises. Par facilité souvent, Audubon reproduisait des plantes sans grande signification écologique mais qui permettaient un beau décor. Les bignones aux belles fleurs se prêtaient particulièrement à ces répétitions, car ce sont des lianes qui permettaient d'entourer l'oiseau, sujet principal de la gravure, et que les collaborateurs d'Audubon (comme Maria Martin et le graveur Robert Havell) pouvaient ajouter par eux-mêmes. Au total, si Audubon ne peut pas être pris pour un grand botaniste, il avait cependant de bonnes connaissances en la matière. Qu'il s'agisse d'observer puis de dessiner un oiseau ou d'une plante, ce sont les mêmes aptitudes qui sont nécessaires, le goût du détail et de l'objet que l'on tient dans la main. Allons jusqu'à dire que les mêmes dispositifs techniques servent dans les deux cas, pour Audubon c'était la position board, pour un autre le coin de n'importe quelle table. Et la loupe, pas la longue-vue ! Le décimètre, pas le décamètre ni le théodolite !
Il en va bien autrement à une dimension du milieu naturel plus grande, celle du paysage. Les oiseaux volent, tout le monde le sait, ils planent, plongent, migrent, passent d'un arbre à l'autre, mais les portraits de The Birds of America ne donnent guère d'importance à l'espace et au monde aérien. Les gravures étaient numérotées, jusqu'à 435, et ont été délivrées au cours d'une douzaine d'années par fascicules de cinq. Il faut arriver à la planche 181 pour voir le décor végétal remplacé par un paysage. Le portrait est celui de l'aigle royal, l'aquarelle utilisée pour la gravure a été exécutée à Boston en 1833. L'aquarelle est superbe, l'aigle part d'un vol puissant en portant un lapin dans ses serres, mais le paysage de montagne est totalement imaginaire et fantaisiste, il montre un chasseur (éliminé de la gravure) traversant un précipice sur un tronc d'arbre jeté en travers, l'homme étant vraisemblablement une évocation de l'artiste lui-même. Peu après, la planche 186, celle des tétras cupidon, est la deuxième de l'ouvrage à présenter un paysage. Les prairies et, au lointain, les fortes collines sont probablement une image du Kentucky sans localisation précise. Le premier paysage réel bien identifiable apparaît à la planche 331, celle montrant deux harles bièvres, l'un nageant et l'autre debout au premier plan. Au-delà se déploient les Cohoes Falls, les chutes de la rivière Mohawk dans l'État de New-York, presque aussi impressionnantes et aussi célèbres que celles du Niagara. Toutefois, il n'est pas sûr que le dessin de ces chutes soit de la main d'Audubon car l'aquarelle originale des deux canards ne fait apparaître qu'un plan d'eau à peine esquissé. Il est possible que le graveur ait assemblé une aquarelle et un dessin d'Audubon qui avait visité les chutes lors de son voyage vers les Grands Lacs, ou que le paysage ait été copié sur l'uvre d'un autre artiste.
Au cours de son voyage dans le golfe et sur la rive nord du Saint-Laurent qu'il considérait comme partie du Labrador, en 1833, Audubon a souvent eu recours à des éléments paysagés pour servir de fond à ses portraits d'oiseaux, peut-être simplement parce qu'un décor floral devenait problématique dans des pays froids. Le premier site qu'il a dessiné, au cours de son voyage, est Bird Rock, un modeste îlot rocheux situé en pleine mer, tellement peuplé de fous de Bassan à la période de leur reproduction que de loin il semblait couvert de neige (planche 326). Un autre endroit bien caractérisé que l'on découvre dans Birds of America est celui de Perroket Island, proche du petit port de Bradore et de l'extrémité du Saint-Laurent, où Audubon a peint un couple de macareux moines (planche 213). En fait, beaucoup de ces décors paysagés du voyage au Labrador ont peu de valeur comme documentation géographique. On hésite à classer certaines compositions entre le motif végétal dominant des débuts d'Audubon et les quelques paysages caractérisés incontestablement de sa main. Représentant une faible étendue d'espace, elles correspondent plus à la notion de niche écologique qu'à celle de paysage. Il faut remarquer aussi qu'elles sont souvent traitées avec désinvolture, plantes herbacées ou ligneuses restant botaniquement indéfinissables. Souvent aussi, Audubon a représenté des masses rocheuses spectaculaires mais sans localisation particulière, peut-être imaginaires ou ajoutées de mémoire au retour de voyage. Dessiné par lui aux îles de la Madeleine (planche 200), le pluvier siffleur est représenté sur une dalle rocheuse anonyme alors qu'on s'attendrait plutôt à voir les sables d'un cordon littoral. Le paysage caractéristique de ces îles n'est même pas évoqué. Lorsque l'on compare les aquarelles originales provenant du terrain et les gravures exécutées en Grande-Bretagne, il apparaît clairement que le graveur a souvent de lui-même ajouté un décor paysagé ou qu'il a retouché celui fait par Audubon, pour l'embellir. Ainsi, la vue de Baltimore qui apparaît à la planche 301 n'existe pas sur l'aquarelle originale, et on ignore sur quel document le graveur l'a copiée.
Les plus beaux paysages que l'on trouve dans Birds of America ne sont pas de la main d'Audubon. Pour ses voyages en Caroline du Sud et en Floride, il avait engagé un certain George Lehman, excellent dessinateur et aquarelliste. Curieusement, Lehman n'a pas fait par la suite une belle carrière dans le domaine de l'art, et si son nom est bien connu aujourd'hui, c'est grâce à Audubon. Celui-ci a utilisé ses services souvent pour l'aider à peindre certains oiseaux et surtout pour faire des paysages servant de décor. Plusieurs sites ont été magnifiquement représentés par Lehman. Le premier exécuté est celui de la ville de Charleston, il est associé au portrait de deux courlis à long bec (planche 231). Les oiseaux forment un premier plan sombre, avec le sol et une touffe herbacée sur la partie droite du tableau. Vers la gauche se déploient le plan d'eau clair de la baie puis, sur la ligne d'horizon le port et sa forteresse, les bateaux, la ville de Charleston aux nombreux clochers, le tout minutieusement détaillé, et enfin le ciel sous la lumière du soleil couchant. Avec cette composition développée selon la diagonale du tableau, Audubon adoptait le modèle de nombreux paysagistes, alors qu'il était jusqu'alors très habitué aux motifs proches, centrés et presque symétriques des peintres de fleurs et natures mortes. À la planche 269, Lehman a pris pour sujet principal le célèbre Castillo San Marco construit par les Espagnols à l'entrée de la ville de St. Augustine en Floride. Audubon y a ajouté un chevalier aboyeur vu de très près et dont la silhouette verticale traverse toute la composition. Le troisième site peint par Lehman est celui de la planche 281. Audubon y a représenté le grand héron blanc, oiseau massif et de grande taille occupant presque tout l'espace de la gravure. Sur la gauche, au loin, se profile la petite agglomération de Key West, étalée le long d'une terre basse d'origine corallienne ensablée. La peinture de Lehman, réalisée toute en finesse le 26 mai 1832, est intéressante car elle est une des premières représentations de la chaîne des Keys qui à cette époque faisait encore figure de bout du monde. Alors qu'il n'aurait jamais permis que l'on change un détail à ses oiseaux, Audubon a laissé au graveur la liberté de créer un ciel d'orage et une mer agitée. Lehman a donné également, à la planche 207 consacrée au fou brun, une image des Dry Tortugas qui prolongent loin dans l'océan la chaîne des Keys. Une douzaine d'autres planches ont bénéficié d'un décor paysagé de Lehman, souvent magnifique mais qui ne représente pas de localisation précise reconnue, et qui comporte sans doute une part d'imagination ou au moins de reconstruction à partir d'éléments divers.
Beaucoup d'artistes et de scientifiques s'attachent, comme Audubon, à des "objets" concrets, petits, isolables, manipulables, nous l'avons déjà dit, tandis que d'autres voient plus volontiers les choses en grand. Il y a là probablement deux familles de pensée et de sensibilité. Audubon est intéressant parce qu'il appartenait manifestement à la première, et que pour diverses raisons mais avec difficulté et réticence il a élargi son travail dans l'esprit de la seconde. Qu'on me permette d'insister sur la portée de cette distinction de deux familles de pensée. On n'imagine pas que l'artiste peignant un oiseau ou une fleur charge son uvre d'un grand sens sociologique, politique, moral, philosophique (voyez par exemple Pierre Joseph Redouté, le "peintre des fleurs", contemporain d'Audubon). Or, c'est très souvent le cas avec la peinture paysagère. L'Amérique d'Audubon, celle de la première moitié du 19e siècle, a vu naître la première école de peinture authentiquement américaine. On lui a donné le nom de Hudson School of Painting, elle était dédiée au paysage. Thomas Cole (1801-1848) l'a initiée, est devenu son chef de file, informel peut-être mais reconnu par tous. Ses premiers dessins et premiers tableaux étaient strictement consacrés à la nature et au paysage (si l'on fait exception de rares portraits humains réalisés sans doute pour gagner de l'argent ou, plus tard, de portraits de sa femme et d'amis). Très vite, il a chargé ses toiles de significations, d'allégories qui sortaient nettement de la composition géographique. Tout un symbolisme était à sa portée : l'indien sur son rocher était l'homme de la nature, le laboureur à sa charrue l'image de la prospérité, la biche au milieu des bois le bonheur et l'harmonie, le nuage et la pluie l'expression d'une nature puissante et menaçante, l'arbre et le rocher une représentation de la lutte des éléments. Une de ses toiles traduit particulièrement la dualité de conception du paysage de Cole : représentation d'un lieu particulier en même temps que discours plus ou moins philosophique. Je veux parler de View of Mount Holyoke, Massachusetts que l'on appelle aussi plus simplement The Oxbow, datant de 1836 et qui appartient aujourd'hui au Metropolitan Museum de New-York. Le paysage, au sens géographique, est parfait d'exactitude, on voit le Mont Holyoke dans le lointain et plus près la rivière Connecticut décrivant un méandre arrivé à la perfection et proche du recoupement. En même temps, et très artificiellement, Cole a divisé son paysage en deux. D'un côté, la nature est supposée parfaitement sauvage et soumise à la violence des éléments, vent et pluie, de l'autre c'est l'image pastorale, le bonheur bucolique sous un ciel lumineux. Elément supplémentaire de réflexion, l'artiste s'est représenté lui-même installé sur un bout de rocher : comment mieux suggérer la dialectique de l'observé et de l'observant ?
Très vite, Cole s'est lancé dans des paysages imaginaires et chargés de signification. Dans cette voie qui l'écartait du paysage réel de ses débuts, il a réalisé trois grandes séries de tableaux. La première s'appelait The Course of Empire, elle illustrait l'idée que les sociétés, les civilisations humaines suivaient toutes un même cours. Elles naissaient, se développaient, déclinaient et finissaient par disparaître. La deuxième série était centrée sur les âges de la vie humaine, elle s'appelait The Voyage of Life. La dernière série, restée inachevée en raison de la mort prématurée de Cole, avait pour titre The Cross and the World. Elle était empreinte de spiritualité, avec une croix au centre de chaque tableau et, comme les précédentes, montrait des personnages allégoriques, ceux menant une vie chrétienne et ceux s'en écartant. Une vraie leçon de catéchisme ! Alors que le paysage, dans son sens premier, avait lancé la carrière de Cole, celui-ci cherchait à s'en détourner complètement au profit de thèmes philosophiques (s.l.) exprimés à l'aide de paysages et personnages imaginaires. Il s'est plaint d'être parfois obligé de peindre des paysages naturels parce qu'une certaine clientèle en demandait et que lui-même en avait besoin comme gagne-pain. Les très nombreux peintres qui suivirent Cole et constituèrent la Hudson School, sans dériver comme lui jusqu'à une peinture à prétention philosophique, adoptèrent des attitudes intermédiaires. Tous peignirent de vrais paysages mais également voulurent exprimer, au moins sur certaines toiles, des réflexions sur la place de l'homme dans la nature, sur l'évolution de la société américaine, et même (en avance sur l'écologie moderne) sur la destruction des ressources naturelles.
Faut-il s'en étonner ? J'ai développé mon argumentation dans un domaine que je connais bien, celui des artistes de l'Amérique du Nord et de la première moitié du 19e siècle, en me référant plus particulièrement aux deux plus géniaux d'entre eux, Audubon et Cole. Si je me suis peu étendu sur Cole et sur la Hudson School, c'est que je me réserve l'opportunité d'en parler en d'autres textes. Ceci dit, je pense ma thèse confortée par l'histoire de la peinture occidentale. On ne peut oublier que le paysage, entendu comme objet naturel et géographique, n'a que très tardivement défini un genre de peinture autonome et à part entière. Bien avant, le paysage établi comme pure construction de l'esprit est entré en accessoire dans les peintures religieuses, historiques, mythologiques et même dans les portraits. Il était alors porteur de significations diverses, il devait évoquer la Jérusalem céleste ou au contraire un monde démoniaque, il devait montrer les premiers instants de la création du monde et les Vénus sorties de l'onde, il devait illustrer le bonheur ou le malheur humain, la paix ou la guerre. Les éléments majeurs des paysages terrestres avaient tous valeur de symbole et devaient entrer en harmonie avec les sujets traités. Voulait-on représenter des bandits de grand chemin, il leur fallait des rochers et précipices (vertigineux), un ciel d'orage (menaçant). Voulait-on montrer des personnages prospères et heureux, il leur fallait une plaine (fertile), une rivière (paisible) sous les rayons (féconds) du soleil. Le langage littéraire et même le langage courant regorgent d'images associant des éléments du paysage à des états d'âme "Votre âme est un paysage choisi", disait Verlaine qui avouait aussi "Il pleure dans mon cur / comme il pleut sur la ville".
Dans son sens premier, le paysage est un objet naturel et géographique de grande dimension, et comme tel difficile à appréhender : on l'a compris avec Audubon. Il est aussi le lieu imaginaire et malléable où viennent se cristalliser les pensées humaines les plus diverses : Cole nous l'a montré.
Signature :
Yvon Chatelin
Lire plus
Pourtant, à un certain moment, désespérant de se faire reconnaître comme artiste naturaliste, il pensait se consacrer à la peinture de sites réputés et attractifs pour le public. Il n'est pas allé loin dans cette voie, ne réalisant qu'une seule toile à l'huile, Natchez, Mississippi, in 1822 qui se trouve aujourd'hui entre des mains privées mais dont on peut voir une image numérique sur le site Flick.com ou des reproductions sur papier (Mississippi Department of Archives and History). Elle montre de manière très réaliste la ville de Natchez bien connue d'Audubon, vue depuis le plateau où sa partie haute est installée. Le Mississippi n'y est donc pas visible. Au contraire on y distingue des bâtiments précis comme les restes de Fort Rosalie au premier plan, la résidence Clifton dont la propriétaire lui avait commandé le tableau, ou celle du Gouverneur Holmes qui, par la suite, a appartenu à Jefferson Davis, le président de la Confédération à l'époque de la Guerre civile. La peinture est celle d'un bon coloriste auquel le désir de coller à la réalité (grande caractéristique d'Audubon peintre des oiseaux, avec celle du culte de la beauté) a conféré un style assez naïf.
Longtemps, suivant en cela la tradition du dessin ornithologique, Audubon a donné à ses oiseaux un décor végétal et floral qui devait, autant que possible, correspondre à leur habitat et à leurs habitudes alimentaires. Il serait fastidieux d'énumérer tous les types de plantes que l'on trouve dans les gravures de The Birds of America, mais je voudrais tout de même donner une idée de leur diversité. Audubon a représenté quantité d'arbres. Parmi les feuillus, on trouve souvent des chênes (dont les live oaks), mais aussi des érables, noyers (walnut, hickory), magnolias, tulipiers, peupliers, bouleaux, châtaigniers, sassafras, copalmes, houx etc. Les conifères sont nombreux aussi, cèdres, tsugas du Canada, pins divers. Parmi les plantes arbustives, retenons les lauriers, kalmies, rhododendrons, azalées, franklinia, gordonias, cornouillers, hibiscus. Audubon aimait beaucoup les lianes et plantes grimpantes, sumacs, bignones, jasmins, salsepareilles. Enfin, moins spectaculaires, apparaissent aussi quantité de plantes herbacées et annuelles, comme les iris, sarracénies, verveines. Bien entendu, il n'ignorait pas la fameuse mousse espagnole, il l'a représentée à trois reprises. Par facilité souvent, Audubon reproduisait des plantes sans grande signification écologique mais qui permettaient un beau décor. Les bignones aux belles fleurs se prêtaient particulièrement à ces répétitions, car ce sont des lianes qui permettaient d'entourer l'oiseau, sujet principal de la gravure, et que les collaborateurs d'Audubon (comme Maria Martin et le graveur Robert Havell) pouvaient ajouter par eux-mêmes. Au total, si Audubon ne peut pas être pris pour un grand botaniste, il avait cependant de bonnes connaissances en la matière. Qu'il s'agisse d'observer puis de dessiner un oiseau ou d'une plante, ce sont les mêmes aptitudes qui sont nécessaires, le goût du détail et de l'objet que l'on tient dans la main. Allons jusqu'à dire que les mêmes dispositifs techniques servent dans les deux cas, pour Audubon c'était la position board, pour un autre le coin de n'importe quelle table. Et la loupe, pas la longue-vue ! Le décimètre, pas le décamètre ni le théodolite !
Il en va bien autrement à une dimension du milieu naturel plus grande, celle du paysage. Les oiseaux volent, tout le monde le sait, ils planent, plongent, migrent, passent d'un arbre à l'autre, mais les portraits de The Birds of America ne donnent guère d'importance à l'espace et au monde aérien. Les gravures étaient numérotées, jusqu'à 435, et ont été délivrées au cours d'une douzaine d'années par fascicules de cinq. Il faut arriver à la planche 181 pour voir le décor végétal remplacé par un paysage. Le portrait est celui de l'aigle royal, l'aquarelle utilisée pour la gravure a été exécutée à Boston en 1833. L'aquarelle est superbe, l'aigle part d'un vol puissant en portant un lapin dans ses serres, mais le paysage de montagne est totalement imaginaire et fantaisiste, il montre un chasseur (éliminé de la gravure) traversant un précipice sur un tronc d'arbre jeté en travers, l'homme étant vraisemblablement une évocation de l'artiste lui-même. Peu après, la planche 186, celle des tétras cupidon, est la deuxième de l'ouvrage à présenter un paysage. Les prairies et, au lointain, les fortes collines sont probablement une image du Kentucky sans localisation précise. Le premier paysage réel bien identifiable apparaît à la planche 331, celle montrant deux harles bièvres, l'un nageant et l'autre debout au premier plan. Au-delà se déploient les Cohoes Falls, les chutes de la rivière Mohawk dans l'État de New-York, presque aussi impressionnantes et aussi célèbres que celles du Niagara. Toutefois, il n'est pas sûr que le dessin de ces chutes soit de la main d'Audubon car l'aquarelle originale des deux canards ne fait apparaître qu'un plan d'eau à peine esquissé. Il est possible que le graveur ait assemblé une aquarelle et un dessin d'Audubon qui avait visité les chutes lors de son voyage vers les Grands Lacs, ou que le paysage ait été copié sur l'uvre d'un autre artiste.
Au cours de son voyage dans le golfe et sur la rive nord du Saint-Laurent qu'il considérait comme partie du Labrador, en 1833, Audubon a souvent eu recours à des éléments paysagés pour servir de fond à ses portraits d'oiseaux, peut-être simplement parce qu'un décor floral devenait problématique dans des pays froids. Le premier site qu'il a dessiné, au cours de son voyage, est Bird Rock, un modeste îlot rocheux situé en pleine mer, tellement peuplé de fous de Bassan à la période de leur reproduction que de loin il semblait couvert de neige (planche 326). Un autre endroit bien caractérisé que l'on découvre dans Birds of America est celui de Perroket Island, proche du petit port de Bradore et de l'extrémité du Saint-Laurent, où Audubon a peint un couple de macareux moines (planche 213). En fait, beaucoup de ces décors paysagés du voyage au Labrador ont peu de valeur comme documentation géographique. On hésite à classer certaines compositions entre le motif végétal dominant des débuts d'Audubon et les quelques paysages caractérisés incontestablement de sa main. Représentant une faible étendue d'espace, elles correspondent plus à la notion de niche écologique qu'à celle de paysage. Il faut remarquer aussi qu'elles sont souvent traitées avec désinvolture, plantes herbacées ou ligneuses restant botaniquement indéfinissables. Souvent aussi, Audubon a représenté des masses rocheuses spectaculaires mais sans localisation particulière, peut-être imaginaires ou ajoutées de mémoire au retour de voyage. Dessiné par lui aux îles de la Madeleine (planche 200), le pluvier siffleur est représenté sur une dalle rocheuse anonyme alors qu'on s'attendrait plutôt à voir les sables d'un cordon littoral. Le paysage caractéristique de ces îles n'est même pas évoqué. Lorsque l'on compare les aquarelles originales provenant du terrain et les gravures exécutées en Grande-Bretagne, il apparaît clairement que le graveur a souvent de lui-même ajouté un décor paysagé ou qu'il a retouché celui fait par Audubon, pour l'embellir. Ainsi, la vue de Baltimore qui apparaît à la planche 301 n'existe pas sur l'aquarelle originale, et on ignore sur quel document le graveur l'a copiée.
Les plus beaux paysages que l'on trouve dans Birds of America ne sont pas de la main d'Audubon. Pour ses voyages en Caroline du Sud et en Floride, il avait engagé un certain George Lehman, excellent dessinateur et aquarelliste. Curieusement, Lehman n'a pas fait par la suite une belle carrière dans le domaine de l'art, et si son nom est bien connu aujourd'hui, c'est grâce à Audubon. Celui-ci a utilisé ses services souvent pour l'aider à peindre certains oiseaux et surtout pour faire des paysages servant de décor. Plusieurs sites ont été magnifiquement représentés par Lehman. Le premier exécuté est celui de la ville de Charleston, il est associé au portrait de deux courlis à long bec (planche 231). Les oiseaux forment un premier plan sombre, avec le sol et une touffe herbacée sur la partie droite du tableau. Vers la gauche se déploient le plan d'eau clair de la baie puis, sur la ligne d'horizon le port et sa forteresse, les bateaux, la ville de Charleston aux nombreux clochers, le tout minutieusement détaillé, et enfin le ciel sous la lumière du soleil couchant. Avec cette composition développée selon la diagonale du tableau, Audubon adoptait le modèle de nombreux paysagistes, alors qu'il était jusqu'alors très habitué aux motifs proches, centrés et presque symétriques des peintres de fleurs et natures mortes. À la planche 269, Lehman a pris pour sujet principal le célèbre Castillo San Marco construit par les Espagnols à l'entrée de la ville de St. Augustine en Floride. Audubon y a ajouté un chevalier aboyeur vu de très près et dont la silhouette verticale traverse toute la composition. Le troisième site peint par Lehman est celui de la planche 281. Audubon y a représenté le grand héron blanc, oiseau massif et de grande taille occupant presque tout l'espace de la gravure. Sur la gauche, au loin, se profile la petite agglomération de Key West, étalée le long d'une terre basse d'origine corallienne ensablée. La peinture de Lehman, réalisée toute en finesse le 26 mai 1832, est intéressante car elle est une des premières représentations de la chaîne des Keys qui à cette époque faisait encore figure de bout du monde. Alors qu'il n'aurait jamais permis que l'on change un détail à ses oiseaux, Audubon a laissé au graveur la liberté de créer un ciel d'orage et une mer agitée. Lehman a donné également, à la planche 207 consacrée au fou brun, une image des Dry Tortugas qui prolongent loin dans l'océan la chaîne des Keys. Une douzaine d'autres planches ont bénéficié d'un décor paysagé de Lehman, souvent magnifique mais qui ne représente pas de localisation précise reconnue, et qui comporte sans doute une part d'imagination ou au moins de reconstruction à partir d'éléments divers.
Beaucoup d'artistes et de scientifiques s'attachent, comme Audubon, à des "objets" concrets, petits, isolables, manipulables, nous l'avons déjà dit, tandis que d'autres voient plus volontiers les choses en grand. Il y a là probablement deux familles de pensée et de sensibilité. Audubon est intéressant parce qu'il appartenait manifestement à la première, et que pour diverses raisons mais avec difficulté et réticence il a élargi son travail dans l'esprit de la seconde. Qu'on me permette d'insister sur la portée de cette distinction de deux familles de pensée. On n'imagine pas que l'artiste peignant un oiseau ou une fleur charge son uvre d'un grand sens sociologique, politique, moral, philosophique (voyez par exemple Pierre Joseph Redouté, le "peintre des fleurs", contemporain d'Audubon). Or, c'est très souvent le cas avec la peinture paysagère. L'Amérique d'Audubon, celle de la première moitié du 19e siècle, a vu naître la première école de peinture authentiquement américaine. On lui a donné le nom de Hudson School of Painting, elle était dédiée au paysage. Thomas Cole (1801-1848) l'a initiée, est devenu son chef de file, informel peut-être mais reconnu par tous. Ses premiers dessins et premiers tableaux étaient strictement consacrés à la nature et au paysage (si l'on fait exception de rares portraits humains réalisés sans doute pour gagner de l'argent ou, plus tard, de portraits de sa femme et d'amis). Très vite, il a chargé ses toiles de significations, d'allégories qui sortaient nettement de la composition géographique. Tout un symbolisme était à sa portée : l'indien sur son rocher était l'homme de la nature, le laboureur à sa charrue l'image de la prospérité, la biche au milieu des bois le bonheur et l'harmonie, le nuage et la pluie l'expression d'une nature puissante et menaçante, l'arbre et le rocher une représentation de la lutte des éléments. Une de ses toiles traduit particulièrement la dualité de conception du paysage de Cole : représentation d'un lieu particulier en même temps que discours plus ou moins philosophique. Je veux parler de View of Mount Holyoke, Massachusetts que l'on appelle aussi plus simplement The Oxbow, datant de 1836 et qui appartient aujourd'hui au Metropolitan Museum de New-York. Le paysage, au sens géographique, est parfait d'exactitude, on voit le Mont Holyoke dans le lointain et plus près la rivière Connecticut décrivant un méandre arrivé à la perfection et proche du recoupement. En même temps, et très artificiellement, Cole a divisé son paysage en deux. D'un côté, la nature est supposée parfaitement sauvage et soumise à la violence des éléments, vent et pluie, de l'autre c'est l'image pastorale, le bonheur bucolique sous un ciel lumineux. Elément supplémentaire de réflexion, l'artiste s'est représenté lui-même installé sur un bout de rocher : comment mieux suggérer la dialectique de l'observé et de l'observant ?
Très vite, Cole s'est lancé dans des paysages imaginaires et chargés de signification. Dans cette voie qui l'écartait du paysage réel de ses débuts, il a réalisé trois grandes séries de tableaux. La première s'appelait The Course of Empire, elle illustrait l'idée que les sociétés, les civilisations humaines suivaient toutes un même cours. Elles naissaient, se développaient, déclinaient et finissaient par disparaître. La deuxième série était centrée sur les âges de la vie humaine, elle s'appelait The Voyage of Life. La dernière série, restée inachevée en raison de la mort prématurée de Cole, avait pour titre The Cross and the World. Elle était empreinte de spiritualité, avec une croix au centre de chaque tableau et, comme les précédentes, montrait des personnages allégoriques, ceux menant une vie chrétienne et ceux s'en écartant. Une vraie leçon de catéchisme ! Alors que le paysage, dans son sens premier, avait lancé la carrière de Cole, celui-ci cherchait à s'en détourner complètement au profit de thèmes philosophiques (s.l.) exprimés à l'aide de paysages et personnages imaginaires. Il s'est plaint d'être parfois obligé de peindre des paysages naturels parce qu'une certaine clientèle en demandait et que lui-même en avait besoin comme gagne-pain. Les très nombreux peintres qui suivirent Cole et constituèrent la Hudson School, sans dériver comme lui jusqu'à une peinture à prétention philosophique, adoptèrent des attitudes intermédiaires. Tous peignirent de vrais paysages mais également voulurent exprimer, au moins sur certaines toiles, des réflexions sur la place de l'homme dans la nature, sur l'évolution de la société américaine, et même (en avance sur l'écologie moderne) sur la destruction des ressources naturelles.
Faut-il s'en étonner ? J'ai développé mon argumentation dans un domaine que je connais bien, celui des artistes de l'Amérique du Nord et de la première moitié du 19e siècle, en me référant plus particulièrement aux deux plus géniaux d'entre eux, Audubon et Cole. Si je me suis peu étendu sur Cole et sur la Hudson School, c'est que je me réserve l'opportunité d'en parler en d'autres textes. Ceci dit, je pense ma thèse confortée par l'histoire de la peinture occidentale. On ne peut oublier que le paysage, entendu comme objet naturel et géographique, n'a que très tardivement défini un genre de peinture autonome et à part entière. Bien avant, le paysage établi comme pure construction de l'esprit est entré en accessoire dans les peintures religieuses, historiques, mythologiques et même dans les portraits. Il était alors porteur de significations diverses, il devait évoquer la Jérusalem céleste ou au contraire un monde démoniaque, il devait montrer les premiers instants de la création du monde et les Vénus sorties de l'onde, il devait illustrer le bonheur ou le malheur humain, la paix ou la guerre. Les éléments majeurs des paysages terrestres avaient tous valeur de symbole et devaient entrer en harmonie avec les sujets traités. Voulait-on représenter des bandits de grand chemin, il leur fallait des rochers et précipices (vertigineux), un ciel d'orage (menaçant). Voulait-on montrer des personnages prospères et heureux, il leur fallait une plaine (fertile), une rivière (paisible) sous les rayons (féconds) du soleil. Le langage littéraire et même le langage courant regorgent d'images associant des éléments du paysage à des états d'âme "Votre âme est un paysage choisi", disait Verlaine qui avouait aussi "Il pleure dans mon cur / comme il pleut sur la ville".
Dans son sens premier, le paysage est un objet naturel et géographique de grande dimension, et comme tel difficile à appréhender : on l'a compris avec Audubon. Il est aussi le lieu imaginaire et malléable où viennent se cristalliser les pensées humaines les plus diverses : Cole nous l'a montré.
Signature :
Yvon Chatelin
Étude du sol tropical et émergence transdisciplinaire
Une aventure scientifique commencée sur le sol africain à la fin des années 1960. Au départ, étude des sols par une petite équipe de l'ORSTOM. Affranchissement des méthodes descriptives traditionnelles élaborées en milieu tempéré et inadaptées au milieu tropical humide. Élaboration d'un langage typologique respectant un partage sémantique entre observation morphologique de terrain et données de laboratoire. Extension à l'ensemble du milieu naturel, végétation et morphologie du relief. Formation de ‟l'école d'Abidjan." Passage à l'histoire et la sociologie des sciences.
Le sol, peut-on lire dans les documents les plus divers, est la couche superficielle, l'épiderme de l'écorce terrestre, le support de la végétation, des productions agricoles et même, directement ou indirectement, de toute vie terrestre. Beaucoup d'autres expressions de même sens sinon de mêmes mots peuvent être trouvées. Cette banalisation langagière traduit un intérêt pour le sol largement partagé et qui remonte à très loin. Dans la culture occidentale, les premières allusions au sol que l'on ait conservées remontent à la Bible. Par la suite, au cours des temps anciens, sont apparus des auteurs de même préoccupation, toujours plus nombreux et de compétence croissante. Parmi les plus remarquables, retenons Columelle dont tous les latinistes connaissent De re rustica, retenons aussi Olivier de Serres, l'homme de la Renaissance, auteur du Théâtre d'agriculture et mesnage des champs (1600), et enfin Henri-Louis Duhamel du Monceau, le physiocrate du temps des Lumières, qui a produit notamment un Traité de la culture des terres, (1750-1761) (1).
Les devanciers
Le 18e siècle a multiplié les savoirs en tous les domaines. De multiples auteurs et non seulement Duhamel du Monceau ont noté leurs observations des "terres"qui apparaissaient "grasses ou maigres", "fortes ou faibles", "lourdes ou légères", "ductiles", "onctueuses", "franches", "meubles", "alcalines" etc. Notons l'usage très général du mot "terre", ou parfois "terrain", alors que le mot "sol" est alors peu employé dans le sens qui nous occupe. Le Dictionnaire de Trévoux, uvre des Jésuites destinée à un grand public et souvent réédité, utilise cependant ce mot, affirmant que "le sol qui est sec, pierreux ou de roche, est bon pour les vignes ; le sol sablonneux pour les bois ; celui qui est gras et humide, pour le labour et les prés." Avec l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les caractérisations se multiplient et abordent de nouvelles questions qui annoncent la géographie des sols. "Les différentes terres que l'on rencontre sur notre globe varient considérablement pour leurs couleurs, leurs mélanges et leurs propriétés." Croquis à l'appui, l'Encyclopédie précise par quelle technique des observations attentives sont déjà réalisées à cette époque : "Pour connaître la nature intérieure d'un terrain, on se sert de tarières" (2).
Au tournant des 18e et 19e siècles, Alexandre de Humboldt en compagnie de son ami Aimé Bonpland a réalisé lors d'un Voyage aux régions équinoxiales un travail d'observation d'une extraordinaire fécondité. Il lui fallut ensuite plusieurs décennies pour l'exploiter, jusqu'à l'achèvement de son ouvrage Cosmos, essai d'une description physique du monde (1847-1859). Il considérait tous les éléments de ce qu'on dénomme aujourd'hui le "paysage" et le "milieu naturel", montrant leurs liaisons entre eux. Le sol ne pouvait lui échapper. Il remarque, par exemple, qu'il est " excellent sur les rives du Cassiquiare. On y trouve un sable granitique qui est couvert dans les forêts d'épaisses couches d'humus " "Il n'y a pas de végétal," affirmait-il, "dont nous ne puissions indiquer la roche qu'il habite." Il disait aussi que "l'aspect du paysage varie selon la nature du sol et de son enveloppe végétale" et allait jusqu'à affirmer que ses résultats couvraient "à la fois le climat et son influence sur les êtres organisés." Naturaliste dominant du 19e siècle, Charles Darwin ne pouvait manquer d'observer lui aussi certains sols tropicaux lors de son voyage autour du monde de 1831 à 1836. Plus remarquable encore, il a réalisé pendant des années des expériences annonçant la biologie du sol, tardant malheureusement beaucoup pour en publier les résultats, en 1881, dans The formation of vegetable mould through the action of worms (1, 2).
Malgré tous les acquis des Humboldt, Darwin et de bien d'autres que nous ne pouvons rappeler ici, le sol ne bénéficiait pas encore vers la fin du 19e siècle d'un statut bien établi et reconnu. Il ne faisait pas l'objet d'une "science" véritable, avec d'une part un corpus de concepts, de méthodes, de références, et d'autre part avec des praticiens, des institutions, des réseaux. Dans cette situation d'inachèvement et d'attente, le travail d'un certain Vassili V. Dokuchaev (1846-1903) a fait l'effet d'une bombe. Plus savamment dit, il a provoqué une coupure épistémologique (cf Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, P.U.F., 1934 et La formation de l'esprit scientifique, Vrin, 1938, ou généré un paradigme nouveau, (cf Thomas Kuhn, The structure of scientific revolutions, Univ. Chicago Press, 1962). En d'autres termes encore, Dokuchaev a fait naître une discipline, la "science du sol" qui s'est aussi dénommée "pédologie".
Dokuchaev a obtenu ce succès en étudiant le tchernozem, la terre noire à grande fertilité des steppes russes. Son bagage descriptif était simple. Il a reconnu dans le sol trois couches, trois niveaux superposés que les pédologues français appelleront par la suite horizons, et leur a attribué la notation A, B, C. L'important était sa proclamation du sol comme corps naturel ayant son histoire, sa dynamique, sa morphologie et ses constituants originaux. Il ne s'agissait plus dorénavant de n'y voir qu'un mélange de particules minérales relevant de la géologie et de particules organiques sous la dépendance de la botanique et de la biologie. Mieux encore, le climat intervenant dans la formation du sol, il entrevoyait déjà dans sa répartition géographique mondiale une loi générale, dite de zonalité. Dokuchaev a été immédiatement suivi par son jeune compatriote Nikolai Mikhailovich Sibirtzev (1860-1900) puis bientôt par des hommes de science de tous les pays (1, 3).
Naissance d'une science
Aux principes de base posés par Dokuchaev sont venus s'ajouter de nombreuses techniques de laboratoire sans cesse perfectionnées, de diverses origines et acceptées sans contestations, conflits ou dissensions. La valeur d'une caractérisation des argiles par rayons X ou microscope électronique, par exemple, ne peut se contester. Au contraire, entre les communautés scientifiques nationales, des points de scission importants sont apparus. Il s'agissait d'abord de la définition spatiale du sol. Comme le faisait le fondateur de la discipline, le sol est toujours décrit comme la succession verticale de plusieurs couches, ou horizons, constituant le profil pédologique. Mais jusqu'où doit s'étendre ce profil vers la profondeur ? Pour certains, il faut le limiter à une dimension de l'ordre du mètre correspondant au grand développement des systèmes racinaires (au maximum 2 mètres pour la Soil Taxonomy). Pour d'autres, le profil pédologique ne s'arrête qu'à l'apparition de la roche-mère saine. La question est cruciale pour le sol tropical. Si l'on adopte la deuxième définition, historiquement celle des pédologues français, il peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur, en climat très chaud et humide altérant intensivement les roches.
Le deuxième point de désaccord entre communautés nationales s'est situé dans la classification des sols. Celle-ci a longtemps formé le couronnement de l'édifice scientifique, apparaissant comme la représentation finale des sols, servant de moyen de transmission des connaissances (par la cartographie notamment) et de comparaison. Les pédologues russes puis soviétiques ont adopté une classification résolument génétique, fondée sur une philosophie du réalisme (au sens ancien, remontant à la scolastique), ou sur une dialectique hégélienne et marxiste appliquée à la nature. Leurs homologues américains ont prit une position opposée dans leur soil taxonomy, s'inspirant de l'empirisme des philosophes anglo-saxons (Bacon, Locke, Hume). Pour l'école française, Georges Aubert et Philippe Duchaufour ont cherché un système intermédiaire et prétendu établir une classification morpho-génétique (4).
Les spécialistes français du sol tropical ne constituaient donc, sur la scène internationale, qu'une micro-communauté, bien distincte de celles d'Américains, de Soviétiques et même de Belges, Portugais, Britanniques dans leurs possessions coloniales. Un profil de sol profond de la rive nord du fleuve Congo qui était pour des pédologues français ferrallitique, aurait été au sud du même fleuve, et seulement dans sa partie supérieure, un latosol pour des collègues belges influencés par les soil scientists américains, lesquels en auraient peut-être fait un oxisol ou un ultisol. La participation au Congrès international de la science du sol, se tenant ordinairement tous les quatre ans, ou même à des réunions plus régionales comme celles du CROACCUS (Afrique de l'Ouest) et du CRACCUS (Afrique Centrale) ne pouvait faire tomber toutes les barrières entre classifications ni même établir entre elles de strictes correspondances (5). C'est dans ce contexte qu'a commencé le cheminement d'une équipe francophone tropicaliste vers une multidisciplinarité progressivement élargie qui va être décrit dans les pages suivantes.
Difficulté à décrire
En termes spécifiquement pédologiques, ce sont des sols ferrallitiques qui couvrent majoritairement les régions équatoriales et intertropicales les plus chaudes et plus humides. Imaginons un pédologue ayant une large pratique du terrain et se trouvant une fois de plus devant un profil de cette sorte de sol dont il a vu l'équivalent ailleurs, avec de faibles variantes. Ce profil qu'il entend décrire est un corps naturel qui n'est pas constitué d'organes ou de membres clairement distinguables comme chez les êtres vivants (bras, jambes, cerveau branches, troncs, racines ), mais d'organisations moins individualisées qu'il appelle horizons. Dans le cas nous servant d'exemple théorique, ces horizons sont pourtant familiers au pédologue, parce que vus ailleurs dans de mêmes conditions (roche-mère, surface géomorphologique, couvert végétal etc.), et il les reconnait au premier coup d'il. Voyons comment il va les décrire.
Il peut utiliser les Glossaires (6) élaborés par de lointains collèges métropolitains et censés être applicables à tous les sols du globe. Ayant besoin d'une description exhaustive, il va noircir plusieurs pages d'un texte-fleuve dans le style de cet extrait d'un travail, d'ailleurs excellent, sur des sols du Cameroun : " 5YR 4/6 Rouge-jaunâtre. Taches nuances de couleur, 5 YR/4/5, brun-rougeâtre, sur faces des unités structurales Texture argilo-peu sableuse, à sable grossier, quartzeux Agrégats polyédriques très grossiers (5 à 15 cm), à arêtes très anguleuses, à allongement vertical etc." (7).
Notre pédologue peut aussi utiliser la classification des sols. Il fait donc référence à un édifice conceptuel pyramidal complexe, ayant à son sommet des Classes, puis en descendant l'arborescence des Groupes, Familles, Séries de sol. Cette référence a bien entendu sa valeur, mais elle correspond à un diagnostic global sur le profil étudié et ne caractérise pas, un à un, chaque horizon. Elle a aussi l'inconvénient d'être variable dans le temps, d'un auteur à l'autre, d'une révision à la suivante, elle n'est pas toujours et partout admise, elle est parfois aussi fortement contestée.
Dans l'esprit de l'homme de terrain que nous imaginons vont surgir aussi des termes comme cuirasse, latérite, argile tachetée, gley provenant d'un fatras hétérogène de termes vernaculaires ou d'usage familier dont le langage pédologique se sert parfois. On y trouve même une référence au pain d'épices, pour désigner l'altération de roches ultrabasiques. Il apparaîtra immédiatement de certains horizons du profil peuvent être dénommés en puisant dans ce thésaurus, mais pas d'autres horizons.
Le pédologue va alors se servir de la vieille notation A, B, C imaginée autre fois par Dokuchaev, en l'assortissant de différents indices supplémentaires, lettres, chiffres, mots. Certains auteurs sont parvenus ainsi à in système complexe, avec des règles d'écriture pour exprimer apparition, transition, juxtaposition de la suite des horizons et de leurs éléments internes. De multiples indices complètent les notations des horizons majeurs devenus plus nombreux et appelés O, A, E, B, C, R. Les figures ferrugineuses à elles seules vont recevoir les indices cn, (cn), g, fe, fel, ox, K dans l'exemple de l'hypothétique sol que nous envisageons, encore puisé dans le travail de pédologues africanistes de l'Office de la Recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) (8).
Recours à un langage
Cette situation quelque peu incohérente a conduit certains chercheurs de la micro-communauté ORSTOM à proposer un langage typologique (9) formé en partie de néologismes afin d'éviter polysémie et confusions. Imaginons une fois encore le pédologue se trouvant devant un profil, c'est-à-dire une coupe de sol dans une fosse spécialement creusée ou sur un talus d'une autre origine. Il va rapidement tracer sur cette coupe quelques traits horizontaux (plus ou moins réguliers) et va mesurer leur situation en profondeur. Il vient de définir, pour remplacer les notations A, B. C. et leurs variantes, ce que le nouveau langage appelle les horizons majeurs et que l'on pourrait aussi considérer (à l'image des organes et membres d'êtres vivants) comme étant les organisations fondamentales du sol.
Sept horizons majeurs peuvent se rencontrer dans des profils ferrallitiques. Les chercheurs dont nous parlons, en quête d'un renouvellement de langage et de méthode, les ont dénommés appumite, structichron, stérite, gravolite, gravélon, rétichron, altérite. S'agissant de créer un lexique ayant le plus possible d'aptitudes, ils ont retenu des mots se dérivant en adjectifs pour former, par exemple, horizon appumique ou horizon structichrome, et en radicaux comme structi-, gravo-, réti- etc. De multiples combinaisons peuvent être ainsi formées, pour la facilité du langage parlé, écrit, introduit dans les bases de données informatisées, et pour rendre compte des intergrades et des associations fréquentes dans le sol. Il sera alors question de structi-rétichron, de gravo-stérite, ou de structichron à phase rétichrome, etc. Les possibilités lexicales, applicables à ce premier diagnostic en horizons majeurs, sont multiples.
La caractérisation morphologique du profil ne s'arrête évidemment pas là. Le langage typologique admet ensuite une large série de diagnostics complémentaires basés encore sur l'observation visuelle et tactile. Néologismes et mots du langage courant sont acceptés. La couleur est toujours importante, ce peut être le rouge, jaune, brun-rouge etc. De même, les pédologues accordent beaucoup d'attention à la structure des horizons meubles, appumite et structichron. Pour remplacer d'interminables et répétitives descriptions, comme celle donnée par l'utilisation des Glossaires (6) rappelée plus haut, des néologismes applicables à la structure sont ensuite introduits, avec la désinence -clode, grumo-, nuci-, pauci-, angu-, psammoclode, ou la désinence - ode, amér-, aliat-, apalode.
Au total, le langage typologique (9) présenté en 1972 pour les sols ferrallitiques recensait moins d'une centaine de termes, la plupart déjà connus et utilisés, avec une vingtaine de néologismes. À l'époque, c'était bien peu par rapport au vocabulaire entièrement nouveau créé pour la micromorphologie des sols par un spécialiste australien (10) que les spécialistes français acceptaient sans difficulté, et encore moins par rapport au déluge terminologique de la Soil taxonomy américaine (4). Nous verrons plus loin que d'autres pédologues français, plus récemment, ont proposé bien pire.
Le volume pédologique
Notion peu employée malgré son pouvoir évocateur, la pédographie couvre toutes les représentations spatiales du sol, des échelles micro à macro les plus étendues. On conçoit qu'elle ne puisse se faire sans outils particuliers ni règles d'application. La maille élémentaire de ce qui peut être un sol, corps naturel complet, à trois dimensions spatiales, correspond au profil décrit in situ par le pédologue de terrain. On la dénomme pédon (transposition du mot grec πέδον qui a donné "pédologie").Toutefois, cette entité spatiale reste quelque peu théorique et même modulable, puisque la profondeur du sol n'est pas la même pour tous. Des entités spatiales équivalentes ou du même ordre sont appelées parfois individu-sol, polypédon, surface pédologique élémentaire. Les difficultés méthodologiques apparaissent lorsqu'il s'agit de décrire, inventorier, cartographier des sols à de plus grandes dimensions.
Faisant suite à la définition du langage typologique en 1972 et à ses applications pratiques, plusieurs publications de l'année 1977 ont proposé les notions de volume pédologique, de contenu et ont explicité leur emploi. S'il existe de toute évidence des volumes pédologiques de toutes dimensions, certains niveaux volumiques doivent être privilégiés pour des raisons théoriques et pratiques. Le pédon constituant par convention l'ordre de grandeur n, il était proposé de reconnaître vers les plus petites dimensions l'horizon à n-1, la phase typologique à n- 2, l'organisation microscopique à n-3, et vers les plus grandes dimensions le segment fonctionnel à n+1, le paysage pédologique à n+2, la région pédologique à n+ 3 (11).
La méthode traditionnelle consistait à représenter les sols, véhiculer les connaissances, par l'usage du Glossaire et de la classification. Les règles fondamentales de cette méthode étaient bien décrites (pédologie française) (6). Tout en appartenant à une micro-communauté, comme dit plus haut, on ne pouvait se permettre d'ignorer la soil taxonomy américaine (4). Elle voulait apporter une rigueur et une précision jusqu'alors inégalées sinon parfaites. Ainsi, lui fallait-il cinq pages pleines pour définir ce qu'était un argillic horizon. Et s'il s'agissait d'un oxic horizon, on ne devait pas oublier, après lecture et assimilation de trois pleines pages d'instructions, qu'il avait, pour caractéristique : "An apparent CEC of 16 cmol(+) or less per kg clay (by IN NH4 OAc pH 7) and an apparent ECEC of 12 cmol(+) etc." Ceci montre que critères morphologiques de terrain et critères de laboratoire y étaient intimement associés. La taxonomie américaine avait, en plus de la précision, la prétention d'être universelle. Elle se déclare "the result of the collective experience and contributions of thousands of pedologists from around the world. "
Les contraintes et prétentions de la soil taxonomy étaient démesurées et stérilisantes, selon les auteurs de la typologie pédologique. Quelles pouvaient être la véracité et l'utilité de définir un même taxon (du grec τάξις) au Kamchatka et en Patagonie, au Minas Gerais et au Kivu ? Le côté stérilisant du système était d'astreindre les pédologues à un système qu'ils ne maîtrisent pas et de les priver de leurs facultés d'adaptation, d'initiative, d'invention, d'originalité.
Le langage typologique et la pratique pédologique qu'il induisait étaient donc à l'opposé, non spécifiquement de la taxonomie américaine, mais de tout système rigide et normatif. Il était admis que la définition des termes de ce langage était modulable. De plus, la séparation des niveaux de diagnose, c'est-à-dire l'identification des horizons majeurs, puis les diagnostics complémentaires, et enfin les déterminations de laboratoire, facilitait les adaptations à des régions différentes, pour des auteurs variés, selon des buts différents. Quelque pouvait être la réalité représentée, et la finesse voulue de la représentation, le langage offrait une grande souplesse. Il était construit pour fonctionner comme une combinatoire, ses mots se prêtant à toutes les manières d'exprimer les transitions, juxtapositions, mélanges si fréquents dans les sols, entre organisations structichromes, rétichromes, altéritiques par exemple. Il était insisté aussi sur la quantification permise, pour ces mélanges et intergrades, par quelques règles d'emploi des lexèmes, affixes, suffixes, préfixes (12).
Il était clair que le langage typologique ne s'appliquait qu'à la morphologie des sols, lors de l'observation de terrain. Il ne représentait qu'une première étape de la recherche scientifique, laquelle devait se poursuivre dans les laboratoires et sur les bases de données informatisées, mais il était une aide à ces opérations scientifiques ultérieures, par la définition précise des matériaux analysés.
Un cas de contenu-sol à l'échelle n+1 assez simple pouvait s'exprimer, par exemple, par ces quelques mots : "Brachy-apexols sablo-argileux à phase graveleuse et régolique sur gravélon et isaltérite" (11). De telles formules qui condensent beaucoup d'information et ne sont pas nécessairement comprises par tous les lecteurs possibles pouvaient s'accompagner d'autres modes d'information : dessins, schémas, photographies, référence à la classification, aptitude agronomique. Aucun mode de langage et d'expression n'était exclu. Ajoutons enfin que la notice d'une carte pédologique (nombreux travaux 1/200.000 au Congo, Gabon, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Calédonie) comportait un grand nombre de légendes des contenus-sols plus longues et complexes que l'exemple cité précédemment.
Le milieu naturel et son contenu
Depuis bien longtemps, les spécialistes du milieu naturel, dont fait partie le sol, ont eu l'ambition de parvenir à la multidisciplinarité. Réflexions théoriques et déclarations d'intention n'ont pas manqué (13). Plus difficiles, les réalisations pratiques restaient au stade de la multidisciplinarité de juxtaposition qui consistait à faire travailler des spécialistes différents en même temps et sur un même terrain. Cela conduisait, bien entendu, à certains échanges ou partages de connaissances mais, à notre sens, sans véritable intégration. Les exemples n'ont pas manqué dans le domaine intertropical. Ils étaient facilités par le fait que les centres de recherche de l'ORSTOM étaient multidisciplinaires. Les résultats sont apparus souvent décevants, ils étaient aggravés par une inévitable mobilité des chercheurs (congés, maladies, mutations). Un exemple est celui du programme multidisciplinaire conduit en Côte d'Ivoire sur le contact forêt-savane, jugé peu satisfaisant par son principal acteur (14).
Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs présents en Côte d'Ivoire ont voulu édifier pour la totalité du milieu naturel un système complètement nouveau (15), ayant son homogénéité conceptuelle et langagière, sur la base déjà faite et expérimentée pour le sol depuis plusieurs années (9, 11,12). Nous parlons de multidisciplinarité de proximité puisqu'elle réunit des disciplines voisines, historiquement en quête d'union. Les deux principes fondateurs du système, venus de la typologie pédologique décrite plus haut, se situaient dans la notion de perception première (autrement dite, suivant les textes, énonciation directe) et dans le respect du partage sémantique. La perception première désignait l'observation de terrain, purement visuelle et tactile, de la morphologique des corps naturels, des volumes (ou enceintes) qu'ils occupaient. Le partage sémantique voulait qu'elle soit dégagée de tout critère de laboratoire, de tout concept ou interprétation scientifiques étrangers, précédemment acquis, comme des mots vernaculaires, venus de pratiques agricoles, forestières ou autre risquant de causer polysémie, variabilité, confusion.
Cette perception devait donc se traduire par un langage univoque, formés de termes aptes à former une combinatoire exprimant et quantifiant toutes les transitions, les intergrades, les mélanges. Ainsi devait se créer un référentiel commun servant à constituer des corpus de données que les divers spécialistes du milieu naturel (pédologues, botanistes, biologistes, géographes...) devaient comprendre et partager. Pour donner un exemple simplifié, disons qu'un botaniste avait la capacité de reconnaître une terre meuble, minérale, structurée, et un pédologue une couche herbacée. Comme fait pour le sol avec le pédon, il a donc été proposé une sorte de maille élémentaire pour l'ensemble du milieu naturel. Elle s'appellera holoplexion et se décomposera verticalement en une succession d'hoplexols.
Un exemple va montrer comment peut se décrire la partie supérieure de l'holoplexion. Il a été démontré que les arbres, et spécialement ceux des forêts tropicales humides, suivent dans leur développement d'abord un modèle architectural strict par leurs ramification et différenciations morphologiques. Il se produit ensuite, à partir du tronc ou des branches, une réitération de ce modèle, l'arbre apparait alors désordonné, on dit qu'il devient coloniaire, ou qu'il devient à lui seul toute une forêt (16). Les volumes correspondant au premier stade définissent le prophyse, ceux du deuxième stade le paliphyse. Ainsi se constituait une série de diagnostics, d'identification de volumes horizontaux, s'appliquant de la même manière au sol et à ce qu'il supporte. Un vocabulaire intégrant celui déjà fait pour le sol a donc été édifié (le mot hoplexol venant dans ce cas remplacer le mot horizon). Puisque tout repose sur des bases morphologiques et peut être compris des différents spécialistes du milieu naturel, l'holoplexion et ses composantes ( structichron apumite prophyse paliphise ) formaient un schéma intégrateur transdisciplinaire sur lequel se greffaient ultérieurement les caractérisations spécialisées.
Un séminaire, en plusieurs sessions tenues à Abidjan, Paris et Montpellier, a contribué à élaborer cette nouvelle méthodologie et montrer la multiplicité de ses usages. "En premier lieu," y était-il notamment affirmé, "la typologie doit clarifier les problèmes génétiques et en faire apparaître de nouveaux" (17). Quelques années plus tard apparaissait une analyse approfondie de la nouvelle manière d'étudier paysage et milieu naturel (18). La multidisciplinarité établie ainsi est dite de proximité puisqu'elle réunit des disciplines scientifiquement proches (sciences naturelles, géographie physique, géomorphologie) et ayant déjà un certain passé de collaboration (multidisciplinarité de juxtaposition). Elle a été appliquée dans les décades 1970, 1980 et 1990, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne (du Congo au Sénégal), Afrique méditerranéenne (Tunisie), et parfois au-delà (Calédonie, Indonésie). Un répertoire semi-exhaustif de plusieurs centaines de publications ou documents a pu être établi par la suite. Les auteurs étaient des chercheurs ORSTOM ou relevant de différentes institutions africaines.
Bases historiques et épistémologiques
Il serait déraisonnable de vouloir bouleverser un domaine, quel qu'il soit, sans bien connaître ses racines, ses forces et ses faiblesses. Apparue en 1972, la typologie pédologique a été précédée, accompagnée et suivie par des études historiques et épistémologiques.
Un premier texte de réflexion, publiée dès 1967, avait pour but de comprendre comment et pourquoi, dans des contrées voisines d'Afrique tropicale, les pédologues français, belges et portugais de l'époque coloniale ou post-coloniale avaient des conceptions et des modes de classification du sol différents. S'ils accordaient beaucoup d'attention à la paléogéographie, ils étaient enclins à considérer que la couverture d'une très ancienne surface d'érosion ne relevait pas de la pédologie, et ils limitaient le sol à la faible profondeur exploitable par les racines et intéressant l'agronomie. Au contraire, s'ils se trouvaient sous l'influence de géochimistes réputés et/ou de même nationalité, ils privilégiaient les processus d'altération, même à de grandes profondeurs, et ils prenaient le rapport SiO2/Al2O3 comme critère dominant du sol. Cet exemple simplifié montrait le poids de la tradition et de la culture scientifiques (19).
Ce premier travail sur les classifications a été suivi par une étude historique beaucoup plus large, publiée en 1972, en même temps qu'apparaissait la typologie des sols. Pour le présenter aujourd'hui, on pourrait poser la question de savoir s'il y a eu dans l'Histoire un âge d'or de la découverte du monde, de l'aventure scientifique ? En réponse, rappelons qu'en 1827, un Écossais nommé Francis Buchanan relatait, en une dizaine lignes, comment se préparent en Inde des briques de terre crue, par malaxage puis séchage au soleil de matériaux extraits du sol, placés au soleil et pour lesquels il proposait le nom de latérite (du latin lateritis, brique). Cette description et cette appellation nouvelle ont eu un succès extraordinaire et, actuellement encore, le mot latérite est largement utilisé, dans le langage commun et dans les terminologies scientifiques. Il revenait à l'Allemand Max Bauer, à la fin du siècle, de démontrer scientifiquement, par analyse chimique et minéralogique d'échantillons des Seychelles, comment la latérite se forme lors de l'altération des roches, élimination de la silice et accumulation résiduelle de sesquioxides. Bientôt, dans les premières décades du 20e siècle, ce furent l'Anglais J.B. Harrison en Guyane britannique, le Français Alfred Lacroix en Guinée et Madagascar, l'Allemand H. Harrassowitz sur des échantillons variés, qui firent brillamment progresser l'étude de l'altération des roches et de la genèse des argiles dans le domaine intertropical. Un nouveau champ d'investigation scientifique était ainsi ouvert et les contributions se multiplièrent. La géochimie devint une base essentielle de la définition et de la classification française des sols ferrallitiques. Un autre apport important de cette période historique est d'avoir souligné l'importance du facteur topographique. Déjà les premières études réalisées à la suite de Buchanan différenciaient les high-level laterites des low-level laterites. La notion de toposéquence ou catena a ensuite été précisée par le Britannique G. Milne en Afrique de l'Est. Enfin, c'est le Néerlandais E.C.J. qui a bien fait saisir l'âge des sols et des surfaces qu'ils occupent. Ainsi se révèle l'action fondatrice durable des travaux très anciens (20).
Une réflexion épistémologique, de la même année 1972, complétait cette large étude historique que nous venons d'évoquer. Rappelons, extraite de ce texte, une citation d'un grand linguiste à propos de sa propre discipline. "Les questions de typologie ont conservé pendant longtemps un caractère spéculatif et préscientifique. La primauté des problèmes génétiques dans la pensée scientifique au siècle dernier laissa une empreinte particulière sur les esquisses typologiques de cette époque : les types morphologiques furent conçus comme des stades évolutifs." C'était la même situation, mutatis mutandi, que montraient les études historiques et épistémologiques de la pédologie, et c'était cette situation qui avait conduit, par réaction et retour au morphologique et au concret, à la création du langage typologique (21).
Sans doute fallait-il plus d'arguments pour soutenir ce nouveau langage, faire accepter par les pédologues les vocables typologiques. Un travail d'épistémologie plus étendu a suivi le précédent, quelques années plus tard. La méthode, le raisonnement, le langage en constituaient les principaux thèmes. Ainsi voyait-on se dessiner l'image d'une science complexe, parcourue de tendances souvent contradictoires, héritière d'une histoire trop hâtive, aux constructions (comme ses classifications et taxonomies) assez fragiles. Loin d'être une science expérimentale au sens de Claude Bernard, la pédologie utilise beaucoup la méthode comparative, elle construit ses raisonnements avec des faits ou concepts empruntées à d'autres domaines scientifiques, elle se sert d'un langage hétérogène et incomplet (comme dénoncé plus haut). Elle est parfois très interprétative, et parfois très empirique (22).
En dépassement de cette démarche historique et épistémologique, les typologies édifiées pour le sol et le milieu naturel ont été présentées, en 1982, après des années d'utilisation et de réflexion, sous de nouveaux éclairages plus directement liés aux modes de pensée de l'époque. Ces typologies pouvaient se définir comme des modèles verbaux transdisciplinaires. Ainsi pouvait-on soutenir qu'elles se montraient également valables d'un côté pour des analyses de type systémique, factuelles et formelles, et de l'autre pour des démarches interprétatives et théoriques, de type historico- génétique (en proximité du matérialisme dialectique appliqué à la nature) (23).
Vers une transdisciplinarité élargie
Les années pendant lesquelles s'est mise en place cette nouvelle méthodologie ont vu un grand développement de la linguistique et du structuralisme. L'époque a été aussi marquée par l'informatique, l'intelligence artificielle, et l'analyse de système qui en découlait. Il est clair que les auteurs de la typologie pédologique d'abord puis du schéma intégrateur étendu au milieu naturel n'échappaient pas à ces courants généraux de la pensée. Ils s'appuyaient aussi et surtout sur des réflexions appliquées à leurs propres disciplines.
En 1983 Westvien Press (Boulder, Colorado, USA) éditait le travail de Lawrence Busch and William Lacy. Science, Agriculture, and the Politics of Research. En raison de relations personnelles entre L. Busch et Y. Chatelin, ce travail américain a servi de référence et de modèle pour le développement de la démarche jusqu'alors centrée sur l'étude scientifique proprement dite des sols et milieux tropicaux. Les principes de la sociologie des sciences sont venus se greffer sur cette démarche pour donner un jeu de nouvelles publications. Citons Milieux et paysages. Essai sur diverses Modalités de Connaissance en 1986, Sols et agriculture des régions chaudes en 1988, National Scientific Strategies in Tropical Soil Sciences, en 1988 (24).
Enfin, au sein de l'ORSTOM s'est constituée à partir de 1983 une équipe prenant pour intitulée Pratiques et politiques scientifiques. Le travail limité aux sols et milieux naturels s'est trouvé considérablement élargi avec la publication, sous la direction de Roland Waast, des cinq volumes de Les sciences hors d'Occident au XXe siècle, ORSTOM, 1996.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Cinquante ans ont passé depuis que, dans le monde tropical, quelques spécialistes des sols ont commencé à s'interroger sur les fondements de leur démarche scientifique et de leur langage. Au cours du temps, les équipes se sont dissociées et dispersées, certaines carrières personnelles se sont achevées, plusieurs personnalités ont disparu. De leur aventure, il reste quelques doctorats d'État, davantage de doctorats de spécialité ou nouvelle formule, un monceau de textes publiés, ou en littérature grise, ou même passés sur Internet (25).
Présentée ici en achèvement du parcours transdisciplinaire entrepris autrefois à propos du sol tropical, l'analyse sociologique de la science pédologique, de ses institutions, ses équipes, ses publications, se poursuit en France et même dans beaucoup de pays émergents, notamment par la bibliométrie. Le cas du sol tropical, notre point de départ, n'y échappe pas.
Il est plus difficile d'apprécier ce que devient de la science du sol elle-même, dans le microcosme français ou francophone. Des études historiques et épistémologiques comme celles rappelées plus haut seraient sans doute nécessaires. Deux remarques nous semblent cependant possibles.
La première est que l'Association française pour l'étude du sol (Afes) a patronné un référentiel pédologique (26) se réclamant d'une bonne centaine de collaborateurs et reprenant de nombreux d'éléments d'origine internationale (27). Il serait difficile de ne pas noter dans ce corpus le quasi abandon de la classification (ou taxonomie) des sols, l'affichage de la notion et simplement du mot référentiel, la création d'horizons de référence bien proches des horizons majeurs autrefois définis pour les sols ferrallitiques, l'usage fréquent du concept de contenu (qui implique le volume). Au contraire, le partage sémantique à la base de la typologie des sols ferrallitiques (9) n'est pas respecté, beaucoup de définitions de bases amalgament données d'observations visuelles de terrain et critères de laboratoire.
La science du sol se considérait autrefois comme une discipline autonome, bien que pouvant établir des liens multi ou transdisciplinaires. Il en est toujours ainsi, le référentiel de l'Afes le montre, mais en même temps il semble que la pédologie se fonde de plus en plus dans l'écologie, entendue comme métadiscipline. Mais en même temps, à refuser le partage sémantique (entre observation morphologique visuelle et données de laboratoire), la science du sol se prive de l'articulation avec botanique et géographie physique, comme expérimenté par "l'école d'Abidjan.". De plus, la nature étant complexe et variée, il apparaîtra forcément des cas où les critères chiffrés stricts s'appliqueront mal.
Quelle que soit la situation et l'évolution actuelle de la science du sol, il reste intéressant de connaître comment s'est constitué, voici cinquante ans, le changement de paradigme que nous venons de décrire. Ce paradigme n'a que partiellement perduré mais il a laissé des traces, seulement pressenties ici, et qu'une étude plus approfondie que la nôtre mettrait sans doute en lumière
Références
(1) Boulaine, Jean. Histoire des pédologues et de la science des sols. Institut National de la Recherche Agronomique, 1989.
(2) Chatelin, Yvon. Interface histoire : entre 1750 et 1900, la découverte de Milieux Naturels Nouveaux. In Milieux et Paysages, Masson, 1986, pp 71-88.
(3) Aubert, Georges et Jean Boulaine. La Pédologie - Que sais-je ? Presses universitaires de France, 1967, 128 p.
(4) Rozanoff, Boris G. Methodological bases of modern soviet soil science and its future development. Cah. Orstom, sér. Pédologie, vol. XIX, n° 1, 1982. // U.S.D.A., Soil Taxonomy, A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, 2nd ed. 1999. // Aubert, George et Philippe Duchaufour. Projet de classification des sols, C.R. VIe Congr. Intern. Sci. Sol, Paris, 1956. // Aubert, George. Classification des sols, Cah. Orstom, sér. Pédologie, vol. III, n° 3, 1965. [Bien que souvent utilisés l'un pour l'autre, "classification" et "taxonomie" correspondent à deux concepts différents, mais il ne semble pas nécessaire d'approfondir la question ici.]
(5) Pendant la période qui nous occupe, le Congrès international de la science du sol, World Congress of Soil Science, s'est intéressé aux sols tropicaux notamment à Léopoldville en 1954, Madison en 1960, Moscou en 1974, Edmonton en 1978, New Dehli en 1982. // Brugière, Jean-Marie. Premier essai régional de corrélation des classifications pédologiques utilisées en Afrique : résultats du sous-comité du CRACCUS (1958, inédit, fond IRD). [Comité Régional de l'Afrique Centrale pour la Conservation et l'Utilisation des Sols.]
(6) Glossaire de pédologie. Description des horizons en vue du traitement informatique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., 1969. // Maignien, Roger. Manuel de prospection pédologique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn. n° 11, 1969. // Glossaire de pédologie. Description de l'environnement en vue du traitement informatique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., 1971.
(7) Muller, Jean-Pierre et François-Xavier Humbel. Étude d'une séquence de sols ferrallitiques rouges de l'Est du Cameroun. Littérature grise, ONAREST-IFRAM, 1977, 106 p. (cf Base Horizon, IRD)
(8) Muller, Jean-Pierre et Michel Gaveau. Règles de nomenclature des horizons de sols et des traits pédologiques macroscopiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XIV, n° 2, 1976
(9) Chatelin, Yvon et Dominique Martin. Recherche d'une terminologie typologique applicable à l'étude des sols ferrallitiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédologie., vol. X, n° 1, 1972.
(10) Brewer, R0y. Fabric and mineral analysis of soils. J. Wiley and Sons, 1964, 470 p.
(11) Beaudou, Alain G. et Yvon Chatelin. Méthodologie de la représentation des volumes pédologiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XV, n° 1, 1977. // Beaudou, Alain G. et Jean Collinet. La diversité des volumes pédologiques cartographiables dans le domaine ferrallitique africain. Cah. ORSTOM, vol. XV, n° 1, 1977.
(12) Beaudou, Alain G. Note sur la quantification et le langage typologique. Cah. ORSTOM, vol. XV, n° 1, 1977.
(13) Géographie-Pédologie : le concept de sol et la méthodologie de l'étude des sols. Compte-rendu de la journée d'études organisée en mai 1966 à l'E.N.S. de Fontenay-aux-Roses. C.N.R.S., Mémoires et documents, vol. 6, 1967.
(14) Avenard, Jean-Michel. Équipe multidisciplinaire sur le thème contact forêt-savane en Côte d'Ivoire. Mise au point et perspectives. Littérature grise, ORSTOM-Adiopodoumé, 1970.
(15) Richard, Jean-François, Francis Kahn et Yvon Chatelin. Vocabulaire pour l'étude du milieu naturel (tropiques humides). Cah. ORSTOM. Sér. Pédol., vol XV, n° 1, 1977.
(16) Hallé, Francis et Roelof A.A. Oldeman. Essai sur l'architecture de croissance des arbres, Masson, 1970.
(17) Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du milieu naturel (Tropiques humides). ORSTOM, Travaux et Documents, n° 91, 1978. Études et textes de Alain G. Beaudou, Philippe de Blic, Yvon Chatelin, Jean Collinet, Jean-Charles Filleron, Jean-Louis Guillaumet, Francis Kahn, Koli Bi Zueli, Jean-François-Richard. Surnommé "le petit livre vert," le document a longtemps servi de manifeste méthodologique et ses protagonistes ont été désignés comme formant "l'école d'Abidjan" par Gabriel Rougerie, professeur de géographie à la Sorbonne.
(18) Richard, Jean-François Le paysage. Un nouveau langage pour l'étude des sols tropicaux. ORSTOM, Init. Doc. & Techn., n° 72, 1989.
(19) Chatelin, Yvon. Influence des conceptions géomorphologiques et paléoclimatiques sur l'interprétation de la genèse et la classification des sols d'Afrique centrale et australe. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. V, n° 3, 1967.
(20) Chatelin, Yvon. Les sols ferrallitiques. Historique. Développement des connaissances et formation des concepts actuels. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., n°20, 1972. L'index de cet ouvrage recense 237 auteurs cités dans le texte et 307 références bibliographiques.
(21) Chatelin, Yvon. Éléments d'épistémologie pédologique. Application à l'étude des sols ferrallitiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. X, n° 1, 1972.
(22) Chatelin, Yvon. Une épistémologie des sciences du sol. ORSTOM, Mémoires n° 88, 1979.
(23) Chatelin, Yvon, Jean-François Richard et Noël Leneuf. Modèles verbaux et transdisciplinarité dans l'étude des sols et des paysages. 1 - Essai critique en fonction de l'analyse de système. 2 Essai critique pour une approche matérialiste. - Cah. ORSTOM, sér. Pédol. vol. XIX, n° 1, 1982.
(24) Milieux et paysages. Essai sur diverses Modalités de Connaissance. Sous la direction de Yvon Chatelin et Gérard Riou. Masson, 1986. Textes de Chantal Blanc-Pamard, Yves Boulvert, Lawrence Busch, Yvon Chatelin, Francis Hallé, Christian Prioul, Jean-François-Richard, Gérard Riou. Ajoutons deux publications d'Yvon Chatelin et Rigas Arvanitis : Stratégies scientifiques et développement. Sols et agriculture des régions chaudes, ORSTOM coll. Études et thèses, 1988 et National Scientific Strategies in Tropical Soil Sciences, Social Studies of Science, Sage, London, 1988.
(25) En plus des deux doctorats d'État cités plus haut sous leur forme éditée - Chatelin, Yvon (22), Richard, Jean-François (18) - nous devons mentionner ceux de Yves Lucas, Expression cartographique des couvertures pédologiques. Exemples dans le domaine intertropical (1980) //Koli Bi Zueli, Étude d'un milieu de forêt dense. Analyse et cartographie des paysages dans la région de Soubré, Sud-Ouest ivoirien (1981) // J. Tape Bidi, Analyse et cartographie des paysages. Étude d'un milieu de contact forêt-savane, région de Touba, Nord-Ouest ivoirien (1984) // Alain G. Beaudou, Recherche d'un système d'information pour le milieu physique : une méthode de saisie et de traitement des données géo-pédologiques appliquées aux régions tropicales (1988) // Jean-Charles Filleron, Essai de géographie systématique : les paysages du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire (2007). // Sous la forme d'une autobiographie d'un de ses auteurs, l'ensemble de la démarche transdisciplinaire partie de l'étude du sol tropical a été racontée par Chatelin, Yvon. Recherche scientifique en terre africaine. Une vie, une aventure. Éd. De l'Harmattan, Coll. Graveurs de mémoire, 2011. Une large bibliographie y est également donnée.
(26) Baize, Denis et Michel-Claude Girard (coord.), Association française pour l'étude du sol. Référentiel pédologique 2008, Éditions Quae, 2009.
(27) World Reference Base for soil resource. Food and Agriculture Organization for the United Nations, 2006.
Signature :
Yvon Chatelin
Lire plus
Le sol, peut-on lire dans les documents les plus divers, est la couche superficielle, l'épiderme de l'écorce terrestre, le support de la végétation, des productions agricoles et même, directement ou indirectement, de toute vie terrestre. Beaucoup d'autres expressions de même sens sinon de mêmes mots peuvent être trouvées. Cette banalisation langagière traduit un intérêt pour le sol largement partagé et qui remonte à très loin. Dans la culture occidentale, les premières allusions au sol que l'on ait conservées remontent à la Bible. Par la suite, au cours des temps anciens, sont apparus des auteurs de même préoccupation, toujours plus nombreux et de compétence croissante. Parmi les plus remarquables, retenons Columelle dont tous les latinistes connaissent De re rustica, retenons aussi Olivier de Serres, l'homme de la Renaissance, auteur du Théâtre d'agriculture et mesnage des champs (1600), et enfin Henri-Louis Duhamel du Monceau, le physiocrate du temps des Lumières, qui a produit notamment un Traité de la culture des terres, (1750-1761) (1).
Les devanciers
Le 18e siècle a multiplié les savoirs en tous les domaines. De multiples auteurs et non seulement Duhamel du Monceau ont noté leurs observations des "terres"qui apparaissaient "grasses ou maigres", "fortes ou faibles", "lourdes ou légères", "ductiles", "onctueuses", "franches", "meubles", "alcalines" etc. Notons l'usage très général du mot "terre", ou parfois "terrain", alors que le mot "sol" est alors peu employé dans le sens qui nous occupe. Le Dictionnaire de Trévoux, uvre des Jésuites destinée à un grand public et souvent réédité, utilise cependant ce mot, affirmant que "le sol qui est sec, pierreux ou de roche, est bon pour les vignes ; le sol sablonneux pour les bois ; celui qui est gras et humide, pour le labour et les prés." Avec l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les caractérisations se multiplient et abordent de nouvelles questions qui annoncent la géographie des sols. "Les différentes terres que l'on rencontre sur notre globe varient considérablement pour leurs couleurs, leurs mélanges et leurs propriétés." Croquis à l'appui, l'Encyclopédie précise par quelle technique des observations attentives sont déjà réalisées à cette époque : "Pour connaître la nature intérieure d'un terrain, on se sert de tarières" (2).
Au tournant des 18e et 19e siècles, Alexandre de Humboldt en compagnie de son ami Aimé Bonpland a réalisé lors d'un Voyage aux régions équinoxiales un travail d'observation d'une extraordinaire fécondité. Il lui fallut ensuite plusieurs décennies pour l'exploiter, jusqu'à l'achèvement de son ouvrage Cosmos, essai d'une description physique du monde (1847-1859). Il considérait tous les éléments de ce qu'on dénomme aujourd'hui le "paysage" et le "milieu naturel", montrant leurs liaisons entre eux. Le sol ne pouvait lui échapper. Il remarque, par exemple, qu'il est " excellent sur les rives du Cassiquiare. On y trouve un sable granitique qui est couvert dans les forêts d'épaisses couches d'humus " "Il n'y a pas de végétal," affirmait-il, "dont nous ne puissions indiquer la roche qu'il habite." Il disait aussi que "l'aspect du paysage varie selon la nature du sol et de son enveloppe végétale" et allait jusqu'à affirmer que ses résultats couvraient "à la fois le climat et son influence sur les êtres organisés." Naturaliste dominant du 19e siècle, Charles Darwin ne pouvait manquer d'observer lui aussi certains sols tropicaux lors de son voyage autour du monde de 1831 à 1836. Plus remarquable encore, il a réalisé pendant des années des expériences annonçant la biologie du sol, tardant malheureusement beaucoup pour en publier les résultats, en 1881, dans The formation of vegetable mould through the action of worms (1, 2).
Malgré tous les acquis des Humboldt, Darwin et de bien d'autres que nous ne pouvons rappeler ici, le sol ne bénéficiait pas encore vers la fin du 19e siècle d'un statut bien établi et reconnu. Il ne faisait pas l'objet d'une "science" véritable, avec d'une part un corpus de concepts, de méthodes, de références, et d'autre part avec des praticiens, des institutions, des réseaux. Dans cette situation d'inachèvement et d'attente, le travail d'un certain Vassili V. Dokuchaev (1846-1903) a fait l'effet d'une bombe. Plus savamment dit, il a provoqué une coupure épistémologique (cf Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, P.U.F., 1934 et La formation de l'esprit scientifique, Vrin, 1938, ou généré un paradigme nouveau, (cf Thomas Kuhn, The structure of scientific revolutions, Univ. Chicago Press, 1962). En d'autres termes encore, Dokuchaev a fait naître une discipline, la "science du sol" qui s'est aussi dénommée "pédologie".
Dokuchaev a obtenu ce succès en étudiant le tchernozem, la terre noire à grande fertilité des steppes russes. Son bagage descriptif était simple. Il a reconnu dans le sol trois couches, trois niveaux superposés que les pédologues français appelleront par la suite horizons, et leur a attribué la notation A, B, C. L'important était sa proclamation du sol comme corps naturel ayant son histoire, sa dynamique, sa morphologie et ses constituants originaux. Il ne s'agissait plus dorénavant de n'y voir qu'un mélange de particules minérales relevant de la géologie et de particules organiques sous la dépendance de la botanique et de la biologie. Mieux encore, le climat intervenant dans la formation du sol, il entrevoyait déjà dans sa répartition géographique mondiale une loi générale, dite de zonalité. Dokuchaev a été immédiatement suivi par son jeune compatriote Nikolai Mikhailovich Sibirtzev (1860-1900) puis bientôt par des hommes de science de tous les pays (1, 3).
Naissance d'une science
Aux principes de base posés par Dokuchaev sont venus s'ajouter de nombreuses techniques de laboratoire sans cesse perfectionnées, de diverses origines et acceptées sans contestations, conflits ou dissensions. La valeur d'une caractérisation des argiles par rayons X ou microscope électronique, par exemple, ne peut se contester. Au contraire, entre les communautés scientifiques nationales, des points de scission importants sont apparus. Il s'agissait d'abord de la définition spatiale du sol. Comme le faisait le fondateur de la discipline, le sol est toujours décrit comme la succession verticale de plusieurs couches, ou horizons, constituant le profil pédologique. Mais jusqu'où doit s'étendre ce profil vers la profondeur ? Pour certains, il faut le limiter à une dimension de l'ordre du mètre correspondant au grand développement des systèmes racinaires (au maximum 2 mètres pour la Soil Taxonomy). Pour d'autres, le profil pédologique ne s'arrête qu'à l'apparition de la roche-mère saine. La question est cruciale pour le sol tropical. Si l'on adopte la deuxième définition, historiquement celle des pédologues français, il peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur, en climat très chaud et humide altérant intensivement les roches.
Le deuxième point de désaccord entre communautés nationales s'est situé dans la classification des sols. Celle-ci a longtemps formé le couronnement de l'édifice scientifique, apparaissant comme la représentation finale des sols, servant de moyen de transmission des connaissances (par la cartographie notamment) et de comparaison. Les pédologues russes puis soviétiques ont adopté une classification résolument génétique, fondée sur une philosophie du réalisme (au sens ancien, remontant à la scolastique), ou sur une dialectique hégélienne et marxiste appliquée à la nature. Leurs homologues américains ont prit une position opposée dans leur soil taxonomy, s'inspirant de l'empirisme des philosophes anglo-saxons (Bacon, Locke, Hume). Pour l'école française, Georges Aubert et Philippe Duchaufour ont cherché un système intermédiaire et prétendu établir une classification morpho-génétique (4).
Les spécialistes français du sol tropical ne constituaient donc, sur la scène internationale, qu'une micro-communauté, bien distincte de celles d'Américains, de Soviétiques et même de Belges, Portugais, Britanniques dans leurs possessions coloniales. Un profil de sol profond de la rive nord du fleuve Congo qui était pour des pédologues français ferrallitique, aurait été au sud du même fleuve, et seulement dans sa partie supérieure, un latosol pour des collègues belges influencés par les soil scientists américains, lesquels en auraient peut-être fait un oxisol ou un ultisol. La participation au Congrès international de la science du sol, se tenant ordinairement tous les quatre ans, ou même à des réunions plus régionales comme celles du CROACCUS (Afrique de l'Ouest) et du CRACCUS (Afrique Centrale) ne pouvait faire tomber toutes les barrières entre classifications ni même établir entre elles de strictes correspondances (5). C'est dans ce contexte qu'a commencé le cheminement d'une équipe francophone tropicaliste vers une multidisciplinarité progressivement élargie qui va être décrit dans les pages suivantes.
Difficulté à décrire
En termes spécifiquement pédologiques, ce sont des sols ferrallitiques qui couvrent majoritairement les régions équatoriales et intertropicales les plus chaudes et plus humides. Imaginons un pédologue ayant une large pratique du terrain et se trouvant une fois de plus devant un profil de cette sorte de sol dont il a vu l'équivalent ailleurs, avec de faibles variantes. Ce profil qu'il entend décrire est un corps naturel qui n'est pas constitué d'organes ou de membres clairement distinguables comme chez les êtres vivants (bras, jambes, cerveau branches, troncs, racines ), mais d'organisations moins individualisées qu'il appelle horizons. Dans le cas nous servant d'exemple théorique, ces horizons sont pourtant familiers au pédologue, parce que vus ailleurs dans de mêmes conditions (roche-mère, surface géomorphologique, couvert végétal etc.), et il les reconnait au premier coup d'il. Voyons comment il va les décrire.
Il peut utiliser les Glossaires (6) élaborés par de lointains collèges métropolitains et censés être applicables à tous les sols du globe. Ayant besoin d'une description exhaustive, il va noircir plusieurs pages d'un texte-fleuve dans le style de cet extrait d'un travail, d'ailleurs excellent, sur des sols du Cameroun : " 5YR 4/6 Rouge-jaunâtre. Taches nuances de couleur, 5 YR/4/5, brun-rougeâtre, sur faces des unités structurales Texture argilo-peu sableuse, à sable grossier, quartzeux Agrégats polyédriques très grossiers (5 à 15 cm), à arêtes très anguleuses, à allongement vertical etc." (7).
Notre pédologue peut aussi utiliser la classification des sols. Il fait donc référence à un édifice conceptuel pyramidal complexe, ayant à son sommet des Classes, puis en descendant l'arborescence des Groupes, Familles, Séries de sol. Cette référence a bien entendu sa valeur, mais elle correspond à un diagnostic global sur le profil étudié et ne caractérise pas, un à un, chaque horizon. Elle a aussi l'inconvénient d'être variable dans le temps, d'un auteur à l'autre, d'une révision à la suivante, elle n'est pas toujours et partout admise, elle est parfois aussi fortement contestée.
Dans l'esprit de l'homme de terrain que nous imaginons vont surgir aussi des termes comme cuirasse, latérite, argile tachetée, gley provenant d'un fatras hétérogène de termes vernaculaires ou d'usage familier dont le langage pédologique se sert parfois. On y trouve même une référence au pain d'épices, pour désigner l'altération de roches ultrabasiques. Il apparaîtra immédiatement de certains horizons du profil peuvent être dénommés en puisant dans ce thésaurus, mais pas d'autres horizons.
Le pédologue va alors se servir de la vieille notation A, B, C imaginée autre fois par Dokuchaev, en l'assortissant de différents indices supplémentaires, lettres, chiffres, mots. Certains auteurs sont parvenus ainsi à in système complexe, avec des règles d'écriture pour exprimer apparition, transition, juxtaposition de la suite des horizons et de leurs éléments internes. De multiples indices complètent les notations des horizons majeurs devenus plus nombreux et appelés O, A, E, B, C, R. Les figures ferrugineuses à elles seules vont recevoir les indices cn, (cn), g, fe, fel, ox, K dans l'exemple de l'hypothétique sol que nous envisageons, encore puisé dans le travail de pédologues africanistes de l'Office de la Recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) (8).
Recours à un langage
Cette situation quelque peu incohérente a conduit certains chercheurs de la micro-communauté ORSTOM à proposer un langage typologique (9) formé en partie de néologismes afin d'éviter polysémie et confusions. Imaginons une fois encore le pédologue se trouvant devant un profil, c'est-à-dire une coupe de sol dans une fosse spécialement creusée ou sur un talus d'une autre origine. Il va rapidement tracer sur cette coupe quelques traits horizontaux (plus ou moins réguliers) et va mesurer leur situation en profondeur. Il vient de définir, pour remplacer les notations A, B. C. et leurs variantes, ce que le nouveau langage appelle les horizons majeurs et que l'on pourrait aussi considérer (à l'image des organes et membres d'êtres vivants) comme étant les organisations fondamentales du sol.
Sept horizons majeurs peuvent se rencontrer dans des profils ferrallitiques. Les chercheurs dont nous parlons, en quête d'un renouvellement de langage et de méthode, les ont dénommés appumite, structichron, stérite, gravolite, gravélon, rétichron, altérite. S'agissant de créer un lexique ayant le plus possible d'aptitudes, ils ont retenu des mots se dérivant en adjectifs pour former, par exemple, horizon appumique ou horizon structichrome, et en radicaux comme structi-, gravo-, réti- etc. De multiples combinaisons peuvent être ainsi formées, pour la facilité du langage parlé, écrit, introduit dans les bases de données informatisées, et pour rendre compte des intergrades et des associations fréquentes dans le sol. Il sera alors question de structi-rétichron, de gravo-stérite, ou de structichron à phase rétichrome, etc. Les possibilités lexicales, applicables à ce premier diagnostic en horizons majeurs, sont multiples.
La caractérisation morphologique du profil ne s'arrête évidemment pas là. Le langage typologique admet ensuite une large série de diagnostics complémentaires basés encore sur l'observation visuelle et tactile. Néologismes et mots du langage courant sont acceptés. La couleur est toujours importante, ce peut être le rouge, jaune, brun-rouge etc. De même, les pédologues accordent beaucoup d'attention à la structure des horizons meubles, appumite et structichron. Pour remplacer d'interminables et répétitives descriptions, comme celle donnée par l'utilisation des Glossaires (6) rappelée plus haut, des néologismes applicables à la structure sont ensuite introduits, avec la désinence -clode, grumo-, nuci-, pauci-, angu-, psammoclode, ou la désinence - ode, amér-, aliat-, apalode.
Au total, le langage typologique (9) présenté en 1972 pour les sols ferrallitiques recensait moins d'une centaine de termes, la plupart déjà connus et utilisés, avec une vingtaine de néologismes. À l'époque, c'était bien peu par rapport au vocabulaire entièrement nouveau créé pour la micromorphologie des sols par un spécialiste australien (10) que les spécialistes français acceptaient sans difficulté, et encore moins par rapport au déluge terminologique de la Soil taxonomy américaine (4). Nous verrons plus loin que d'autres pédologues français, plus récemment, ont proposé bien pire.
Le volume pédologique
Notion peu employée malgré son pouvoir évocateur, la pédographie couvre toutes les représentations spatiales du sol, des échelles micro à macro les plus étendues. On conçoit qu'elle ne puisse se faire sans outils particuliers ni règles d'application. La maille élémentaire de ce qui peut être un sol, corps naturel complet, à trois dimensions spatiales, correspond au profil décrit in situ par le pédologue de terrain. On la dénomme pédon (transposition du mot grec πέδον qui a donné "pédologie").Toutefois, cette entité spatiale reste quelque peu théorique et même modulable, puisque la profondeur du sol n'est pas la même pour tous. Des entités spatiales équivalentes ou du même ordre sont appelées parfois individu-sol, polypédon, surface pédologique élémentaire. Les difficultés méthodologiques apparaissent lorsqu'il s'agit de décrire, inventorier, cartographier des sols à de plus grandes dimensions.
Faisant suite à la définition du langage typologique en 1972 et à ses applications pratiques, plusieurs publications de l'année 1977 ont proposé les notions de volume pédologique, de contenu et ont explicité leur emploi. S'il existe de toute évidence des volumes pédologiques de toutes dimensions, certains niveaux volumiques doivent être privilégiés pour des raisons théoriques et pratiques. Le pédon constituant par convention l'ordre de grandeur n, il était proposé de reconnaître vers les plus petites dimensions l'horizon à n-1, la phase typologique à n- 2, l'organisation microscopique à n-3, et vers les plus grandes dimensions le segment fonctionnel à n+1, le paysage pédologique à n+2, la région pédologique à n+ 3 (11).
La méthode traditionnelle consistait à représenter les sols, véhiculer les connaissances, par l'usage du Glossaire et de la classification. Les règles fondamentales de cette méthode étaient bien décrites (pédologie française) (6). Tout en appartenant à une micro-communauté, comme dit plus haut, on ne pouvait se permettre d'ignorer la soil taxonomy américaine (4). Elle voulait apporter une rigueur et une précision jusqu'alors inégalées sinon parfaites. Ainsi, lui fallait-il cinq pages pleines pour définir ce qu'était un argillic horizon. Et s'il s'agissait d'un oxic horizon, on ne devait pas oublier, après lecture et assimilation de trois pleines pages d'instructions, qu'il avait, pour caractéristique : "An apparent CEC of 16 cmol(+) or less per kg clay (by IN NH4 OAc pH 7) and an apparent ECEC of 12 cmol(+) etc." Ceci montre que critères morphologiques de terrain et critères de laboratoire y étaient intimement associés. La taxonomie américaine avait, en plus de la précision, la prétention d'être universelle. Elle se déclare "the result of the collective experience and contributions of thousands of pedologists from around the world. "
Les contraintes et prétentions de la soil taxonomy étaient démesurées et stérilisantes, selon les auteurs de la typologie pédologique. Quelles pouvaient être la véracité et l'utilité de définir un même taxon (du grec τάξις) au Kamchatka et en Patagonie, au Minas Gerais et au Kivu ? Le côté stérilisant du système était d'astreindre les pédologues à un système qu'ils ne maîtrisent pas et de les priver de leurs facultés d'adaptation, d'initiative, d'invention, d'originalité.
Le langage typologique et la pratique pédologique qu'il induisait étaient donc à l'opposé, non spécifiquement de la taxonomie américaine, mais de tout système rigide et normatif. Il était admis que la définition des termes de ce langage était modulable. De plus, la séparation des niveaux de diagnose, c'est-à-dire l'identification des horizons majeurs, puis les diagnostics complémentaires, et enfin les déterminations de laboratoire, facilitait les adaptations à des régions différentes, pour des auteurs variés, selon des buts différents. Quelque pouvait être la réalité représentée, et la finesse voulue de la représentation, le langage offrait une grande souplesse. Il était construit pour fonctionner comme une combinatoire, ses mots se prêtant à toutes les manières d'exprimer les transitions, juxtapositions, mélanges si fréquents dans les sols, entre organisations structichromes, rétichromes, altéritiques par exemple. Il était insisté aussi sur la quantification permise, pour ces mélanges et intergrades, par quelques règles d'emploi des lexèmes, affixes, suffixes, préfixes (12).
Il était clair que le langage typologique ne s'appliquait qu'à la morphologie des sols, lors de l'observation de terrain. Il ne représentait qu'une première étape de la recherche scientifique, laquelle devait se poursuivre dans les laboratoires et sur les bases de données informatisées, mais il était une aide à ces opérations scientifiques ultérieures, par la définition précise des matériaux analysés.
Un cas de contenu-sol à l'échelle n+1 assez simple pouvait s'exprimer, par exemple, par ces quelques mots : "Brachy-apexols sablo-argileux à phase graveleuse et régolique sur gravélon et isaltérite" (11). De telles formules qui condensent beaucoup d'information et ne sont pas nécessairement comprises par tous les lecteurs possibles pouvaient s'accompagner d'autres modes d'information : dessins, schémas, photographies, référence à la classification, aptitude agronomique. Aucun mode de langage et d'expression n'était exclu. Ajoutons enfin que la notice d'une carte pédologique (nombreux travaux 1/200.000 au Congo, Gabon, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Calédonie) comportait un grand nombre de légendes des contenus-sols plus longues et complexes que l'exemple cité précédemment.
Le milieu naturel et son contenu
Depuis bien longtemps, les spécialistes du milieu naturel, dont fait partie le sol, ont eu l'ambition de parvenir à la multidisciplinarité. Réflexions théoriques et déclarations d'intention n'ont pas manqué (13). Plus difficiles, les réalisations pratiques restaient au stade de la multidisciplinarité de juxtaposition qui consistait à faire travailler des spécialistes différents en même temps et sur un même terrain. Cela conduisait, bien entendu, à certains échanges ou partages de connaissances mais, à notre sens, sans véritable intégration. Les exemples n'ont pas manqué dans le domaine intertropical. Ils étaient facilités par le fait que les centres de recherche de l'ORSTOM étaient multidisciplinaires. Les résultats sont apparus souvent décevants, ils étaient aggravés par une inévitable mobilité des chercheurs (congés, maladies, mutations). Un exemple est celui du programme multidisciplinaire conduit en Côte d'Ivoire sur le contact forêt-savane, jugé peu satisfaisant par son principal acteur (14).
Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs présents en Côte d'Ivoire ont voulu édifier pour la totalité du milieu naturel un système complètement nouveau (15), ayant son homogénéité conceptuelle et langagière, sur la base déjà faite et expérimentée pour le sol depuis plusieurs années (9, 11,12). Nous parlons de multidisciplinarité de proximité puisqu'elle réunit des disciplines voisines, historiquement en quête d'union. Les deux principes fondateurs du système, venus de la typologie pédologique décrite plus haut, se situaient dans la notion de perception première (autrement dite, suivant les textes, énonciation directe) et dans le respect du partage sémantique. La perception première désignait l'observation de terrain, purement visuelle et tactile, de la morphologique des corps naturels, des volumes (ou enceintes) qu'ils occupaient. Le partage sémantique voulait qu'elle soit dégagée de tout critère de laboratoire, de tout concept ou interprétation scientifiques étrangers, précédemment acquis, comme des mots vernaculaires, venus de pratiques agricoles, forestières ou autre risquant de causer polysémie, variabilité, confusion.
Cette perception devait donc se traduire par un langage univoque, formés de termes aptes à former une combinatoire exprimant et quantifiant toutes les transitions, les intergrades, les mélanges. Ainsi devait se créer un référentiel commun servant à constituer des corpus de données que les divers spécialistes du milieu naturel (pédologues, botanistes, biologistes, géographes...) devaient comprendre et partager. Pour donner un exemple simplifié, disons qu'un botaniste avait la capacité de reconnaître une terre meuble, minérale, structurée, et un pédologue une couche herbacée. Comme fait pour le sol avec le pédon, il a donc été proposé une sorte de maille élémentaire pour l'ensemble du milieu naturel. Elle s'appellera holoplexion et se décomposera verticalement en une succession d'hoplexols.
Un exemple va montrer comment peut se décrire la partie supérieure de l'holoplexion. Il a été démontré que les arbres, et spécialement ceux des forêts tropicales humides, suivent dans leur développement d'abord un modèle architectural strict par leurs ramification et différenciations morphologiques. Il se produit ensuite, à partir du tronc ou des branches, une réitération de ce modèle, l'arbre apparait alors désordonné, on dit qu'il devient coloniaire, ou qu'il devient à lui seul toute une forêt (16). Les volumes correspondant au premier stade définissent le prophyse, ceux du deuxième stade le paliphyse. Ainsi se constituait une série de diagnostics, d'identification de volumes horizontaux, s'appliquant de la même manière au sol et à ce qu'il supporte. Un vocabulaire intégrant celui déjà fait pour le sol a donc été édifié (le mot hoplexol venant dans ce cas remplacer le mot horizon). Puisque tout repose sur des bases morphologiques et peut être compris des différents spécialistes du milieu naturel, l'holoplexion et ses composantes ( structichron apumite prophyse paliphise ) formaient un schéma intégrateur transdisciplinaire sur lequel se greffaient ultérieurement les caractérisations spécialisées.
Un séminaire, en plusieurs sessions tenues à Abidjan, Paris et Montpellier, a contribué à élaborer cette nouvelle méthodologie et montrer la multiplicité de ses usages. "En premier lieu," y était-il notamment affirmé, "la typologie doit clarifier les problèmes génétiques et en faire apparaître de nouveaux" (17). Quelques années plus tard apparaissait une analyse approfondie de la nouvelle manière d'étudier paysage et milieu naturel (18). La multidisciplinarité établie ainsi est dite de proximité puisqu'elle réunit des disciplines scientifiquement proches (sciences naturelles, géographie physique, géomorphologie) et ayant déjà un certain passé de collaboration (multidisciplinarité de juxtaposition). Elle a été appliquée dans les décades 1970, 1980 et 1990, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne (du Congo au Sénégal), Afrique méditerranéenne (Tunisie), et parfois au-delà (Calédonie, Indonésie). Un répertoire semi-exhaustif de plusieurs centaines de publications ou documents a pu être établi par la suite. Les auteurs étaient des chercheurs ORSTOM ou relevant de différentes institutions africaines.
Bases historiques et épistémologiques
Il serait déraisonnable de vouloir bouleverser un domaine, quel qu'il soit, sans bien connaître ses racines, ses forces et ses faiblesses. Apparue en 1972, la typologie pédologique a été précédée, accompagnée et suivie par des études historiques et épistémologiques.
Un premier texte de réflexion, publiée dès 1967, avait pour but de comprendre comment et pourquoi, dans des contrées voisines d'Afrique tropicale, les pédologues français, belges et portugais de l'époque coloniale ou post-coloniale avaient des conceptions et des modes de classification du sol différents. S'ils accordaient beaucoup d'attention à la paléogéographie, ils étaient enclins à considérer que la couverture d'une très ancienne surface d'érosion ne relevait pas de la pédologie, et ils limitaient le sol à la faible profondeur exploitable par les racines et intéressant l'agronomie. Au contraire, s'ils se trouvaient sous l'influence de géochimistes réputés et/ou de même nationalité, ils privilégiaient les processus d'altération, même à de grandes profondeurs, et ils prenaient le rapport SiO2/Al2O3 comme critère dominant du sol. Cet exemple simplifié montrait le poids de la tradition et de la culture scientifiques (19).
Ce premier travail sur les classifications a été suivi par une étude historique beaucoup plus large, publiée en 1972, en même temps qu'apparaissait la typologie des sols. Pour le présenter aujourd'hui, on pourrait poser la question de savoir s'il y a eu dans l'Histoire un âge d'or de la découverte du monde, de l'aventure scientifique ? En réponse, rappelons qu'en 1827, un Écossais nommé Francis Buchanan relatait, en une dizaine lignes, comment se préparent en Inde des briques de terre crue, par malaxage puis séchage au soleil de matériaux extraits du sol, placés au soleil et pour lesquels il proposait le nom de latérite (du latin lateritis, brique). Cette description et cette appellation nouvelle ont eu un succès extraordinaire et, actuellement encore, le mot latérite est largement utilisé, dans le langage commun et dans les terminologies scientifiques. Il revenait à l'Allemand Max Bauer, à la fin du siècle, de démontrer scientifiquement, par analyse chimique et minéralogique d'échantillons des Seychelles, comment la latérite se forme lors de l'altération des roches, élimination de la silice et accumulation résiduelle de sesquioxides. Bientôt, dans les premières décades du 20e siècle, ce furent l'Anglais J.B. Harrison en Guyane britannique, le Français Alfred Lacroix en Guinée et Madagascar, l'Allemand H. Harrassowitz sur des échantillons variés, qui firent brillamment progresser l'étude de l'altération des roches et de la genèse des argiles dans le domaine intertropical. Un nouveau champ d'investigation scientifique était ainsi ouvert et les contributions se multiplièrent. La géochimie devint une base essentielle de la définition et de la classification française des sols ferrallitiques. Un autre apport important de cette période historique est d'avoir souligné l'importance du facteur topographique. Déjà les premières études réalisées à la suite de Buchanan différenciaient les high-level laterites des low-level laterites. La notion de toposéquence ou catena a ensuite été précisée par le Britannique G. Milne en Afrique de l'Est. Enfin, c'est le Néerlandais E.C.J. qui a bien fait saisir l'âge des sols et des surfaces qu'ils occupent. Ainsi se révèle l'action fondatrice durable des travaux très anciens (20).
Une réflexion épistémologique, de la même année 1972, complétait cette large étude historique que nous venons d'évoquer. Rappelons, extraite de ce texte, une citation d'un grand linguiste à propos de sa propre discipline. "Les questions de typologie ont conservé pendant longtemps un caractère spéculatif et préscientifique. La primauté des problèmes génétiques dans la pensée scientifique au siècle dernier laissa une empreinte particulière sur les esquisses typologiques de cette époque : les types morphologiques furent conçus comme des stades évolutifs." C'était la même situation, mutatis mutandi, que montraient les études historiques et épistémologiques de la pédologie, et c'était cette situation qui avait conduit, par réaction et retour au morphologique et au concret, à la création du langage typologique (21).
Sans doute fallait-il plus d'arguments pour soutenir ce nouveau langage, faire accepter par les pédologues les vocables typologiques. Un travail d'épistémologie plus étendu a suivi le précédent, quelques années plus tard. La méthode, le raisonnement, le langage en constituaient les principaux thèmes. Ainsi voyait-on se dessiner l'image d'une science complexe, parcourue de tendances souvent contradictoires, héritière d'une histoire trop hâtive, aux constructions (comme ses classifications et taxonomies) assez fragiles. Loin d'être une science expérimentale au sens de Claude Bernard, la pédologie utilise beaucoup la méthode comparative, elle construit ses raisonnements avec des faits ou concepts empruntées à d'autres domaines scientifiques, elle se sert d'un langage hétérogène et incomplet (comme dénoncé plus haut). Elle est parfois très interprétative, et parfois très empirique (22).
En dépassement de cette démarche historique et épistémologique, les typologies édifiées pour le sol et le milieu naturel ont été présentées, en 1982, après des années d'utilisation et de réflexion, sous de nouveaux éclairages plus directement liés aux modes de pensée de l'époque. Ces typologies pouvaient se définir comme des modèles verbaux transdisciplinaires. Ainsi pouvait-on soutenir qu'elles se montraient également valables d'un côté pour des analyses de type systémique, factuelles et formelles, et de l'autre pour des démarches interprétatives et théoriques, de type historico- génétique (en proximité du matérialisme dialectique appliqué à la nature) (23).
Vers une transdisciplinarité élargie
Les années pendant lesquelles s'est mise en place cette nouvelle méthodologie ont vu un grand développement de la linguistique et du structuralisme. L'époque a été aussi marquée par l'informatique, l'intelligence artificielle, et l'analyse de système qui en découlait. Il est clair que les auteurs de la typologie pédologique d'abord puis du schéma intégrateur étendu au milieu naturel n'échappaient pas à ces courants généraux de la pensée. Ils s'appuyaient aussi et surtout sur des réflexions appliquées à leurs propres disciplines.
En 1983 Westvien Press (Boulder, Colorado, USA) éditait le travail de Lawrence Busch and William Lacy. Science, Agriculture, and the Politics of Research. En raison de relations personnelles entre L. Busch et Y. Chatelin, ce travail américain a servi de référence et de modèle pour le développement de la démarche jusqu'alors centrée sur l'étude scientifique proprement dite des sols et milieux tropicaux. Les principes de la sociologie des sciences sont venus se greffer sur cette démarche pour donner un jeu de nouvelles publications. Citons Milieux et paysages. Essai sur diverses Modalités de Connaissance en 1986, Sols et agriculture des régions chaudes en 1988, National Scientific Strategies in Tropical Soil Sciences, en 1988 (24).
Enfin, au sein de l'ORSTOM s'est constituée à partir de 1983 une équipe prenant pour intitulée Pratiques et politiques scientifiques. Le travail limité aux sols et milieux naturels s'est trouvé considérablement élargi avec la publication, sous la direction de Roland Waast, des cinq volumes de Les sciences hors d'Occident au XXe siècle, ORSTOM, 1996.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Cinquante ans ont passé depuis que, dans le monde tropical, quelques spécialistes des sols ont commencé à s'interroger sur les fondements de leur démarche scientifique et de leur langage. Au cours du temps, les équipes se sont dissociées et dispersées, certaines carrières personnelles se sont achevées, plusieurs personnalités ont disparu. De leur aventure, il reste quelques doctorats d'État, davantage de doctorats de spécialité ou nouvelle formule, un monceau de textes publiés, ou en littérature grise, ou même passés sur Internet (25).
Présentée ici en achèvement du parcours transdisciplinaire entrepris autrefois à propos du sol tropical, l'analyse sociologique de la science pédologique, de ses institutions, ses équipes, ses publications, se poursuit en France et même dans beaucoup de pays émergents, notamment par la bibliométrie. Le cas du sol tropical, notre point de départ, n'y échappe pas.
Il est plus difficile d'apprécier ce que devient de la science du sol elle-même, dans le microcosme français ou francophone. Des études historiques et épistémologiques comme celles rappelées plus haut seraient sans doute nécessaires. Deux remarques nous semblent cependant possibles.
La première est que l'Association française pour l'étude du sol (Afes) a patronné un référentiel pédologique (26) se réclamant d'une bonne centaine de collaborateurs et reprenant de nombreux d'éléments d'origine internationale (27). Il serait difficile de ne pas noter dans ce corpus le quasi abandon de la classification (ou taxonomie) des sols, l'affichage de la notion et simplement du mot référentiel, la création d'horizons de référence bien proches des horizons majeurs autrefois définis pour les sols ferrallitiques, l'usage fréquent du concept de contenu (qui implique le volume). Au contraire, le partage sémantique à la base de la typologie des sols ferrallitiques (9) n'est pas respecté, beaucoup de définitions de bases amalgament données d'observations visuelles de terrain et critères de laboratoire.
La science du sol se considérait autrefois comme une discipline autonome, bien que pouvant établir des liens multi ou transdisciplinaires. Il en est toujours ainsi, le référentiel de l'Afes le montre, mais en même temps il semble que la pédologie se fonde de plus en plus dans l'écologie, entendue comme métadiscipline. Mais en même temps, à refuser le partage sémantique (entre observation morphologique visuelle et données de laboratoire), la science du sol se prive de l'articulation avec botanique et géographie physique, comme expérimenté par "l'école d'Abidjan.". De plus, la nature étant complexe et variée, il apparaîtra forcément des cas où les critères chiffrés stricts s'appliqueront mal.
Quelle que soit la situation et l'évolution actuelle de la science du sol, il reste intéressant de connaître comment s'est constitué, voici cinquante ans, le changement de paradigme que nous venons de décrire. Ce paradigme n'a que partiellement perduré mais il a laissé des traces, seulement pressenties ici, et qu'une étude plus approfondie que la nôtre mettrait sans doute en lumière
Références
(1) Boulaine, Jean. Histoire des pédologues et de la science des sols. Institut National de la Recherche Agronomique, 1989.
(2) Chatelin, Yvon. Interface histoire : entre 1750 et 1900, la découverte de Milieux Naturels Nouveaux. In Milieux et Paysages, Masson, 1986, pp 71-88.
(3) Aubert, Georges et Jean Boulaine. La Pédologie - Que sais-je ? Presses universitaires de France, 1967, 128 p.
(4) Rozanoff, Boris G. Methodological bases of modern soviet soil science and its future development. Cah. Orstom, sér. Pédologie, vol. XIX, n° 1, 1982. // U.S.D.A., Soil Taxonomy, A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, 2nd ed. 1999. // Aubert, George et Philippe Duchaufour. Projet de classification des sols, C.R. VIe Congr. Intern. Sci. Sol, Paris, 1956. // Aubert, George. Classification des sols, Cah. Orstom, sér. Pédologie, vol. III, n° 3, 1965. [Bien que souvent utilisés l'un pour l'autre, "classification" et "taxonomie" correspondent à deux concepts différents, mais il ne semble pas nécessaire d'approfondir la question ici.]
(5) Pendant la période qui nous occupe, le Congrès international de la science du sol, World Congress of Soil Science, s'est intéressé aux sols tropicaux notamment à Léopoldville en 1954, Madison en 1960, Moscou en 1974, Edmonton en 1978, New Dehli en 1982. // Brugière, Jean-Marie. Premier essai régional de corrélation des classifications pédologiques utilisées en Afrique : résultats du sous-comité du CRACCUS (1958, inédit, fond IRD). [Comité Régional de l'Afrique Centrale pour la Conservation et l'Utilisation des Sols.]
(6) Glossaire de pédologie. Description des horizons en vue du traitement informatique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., 1969. // Maignien, Roger. Manuel de prospection pédologique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn. n° 11, 1969. // Glossaire de pédologie. Description de l'environnement en vue du traitement informatique. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., 1971.
(7) Muller, Jean-Pierre et François-Xavier Humbel. Étude d'une séquence de sols ferrallitiques rouges de l'Est du Cameroun. Littérature grise, ONAREST-IFRAM, 1977, 106 p. (cf Base Horizon, IRD)
(8) Muller, Jean-Pierre et Michel Gaveau. Règles de nomenclature des horizons de sols et des traits pédologiques macroscopiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XIV, n° 2, 1976
(9) Chatelin, Yvon et Dominique Martin. Recherche d'une terminologie typologique applicable à l'étude des sols ferrallitiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédologie., vol. X, n° 1, 1972.
(10) Brewer, R0y. Fabric and mineral analysis of soils. J. Wiley and Sons, 1964, 470 p.
(11) Beaudou, Alain G. et Yvon Chatelin. Méthodologie de la représentation des volumes pédologiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XV, n° 1, 1977. // Beaudou, Alain G. et Jean Collinet. La diversité des volumes pédologiques cartographiables dans le domaine ferrallitique africain. Cah. ORSTOM, vol. XV, n° 1, 1977.
(12) Beaudou, Alain G. Note sur la quantification et le langage typologique. Cah. ORSTOM, vol. XV, n° 1, 1977.
(13) Géographie-Pédologie : le concept de sol et la méthodologie de l'étude des sols. Compte-rendu de la journée d'études organisée en mai 1966 à l'E.N.S. de Fontenay-aux-Roses. C.N.R.S., Mémoires et documents, vol. 6, 1967.
(14) Avenard, Jean-Michel. Équipe multidisciplinaire sur le thème contact forêt-savane en Côte d'Ivoire. Mise au point et perspectives. Littérature grise, ORSTOM-Adiopodoumé, 1970.
(15) Richard, Jean-François, Francis Kahn et Yvon Chatelin. Vocabulaire pour l'étude du milieu naturel (tropiques humides). Cah. ORSTOM. Sér. Pédol., vol XV, n° 1, 1977.
(16) Hallé, Francis et Roelof A.A. Oldeman. Essai sur l'architecture de croissance des arbres, Masson, 1970.
(17) Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du milieu naturel (Tropiques humides). ORSTOM, Travaux et Documents, n° 91, 1978. Études et textes de Alain G. Beaudou, Philippe de Blic, Yvon Chatelin, Jean Collinet, Jean-Charles Filleron, Jean-Louis Guillaumet, Francis Kahn, Koli Bi Zueli, Jean-François-Richard. Surnommé "le petit livre vert," le document a longtemps servi de manifeste méthodologique et ses protagonistes ont été désignés comme formant "l'école d'Abidjan" par Gabriel Rougerie, professeur de géographie à la Sorbonne.
(18) Richard, Jean-François Le paysage. Un nouveau langage pour l'étude des sols tropicaux. ORSTOM, Init. Doc. & Techn., n° 72, 1989.
(19) Chatelin, Yvon. Influence des conceptions géomorphologiques et paléoclimatiques sur l'interprétation de la genèse et la classification des sols d'Afrique centrale et australe. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. V, n° 3, 1967.
(20) Chatelin, Yvon. Les sols ferrallitiques. Historique. Développement des connaissances et formation des concepts actuels. ORSTOM, Init. & Doc. Techn., n°20, 1972. L'index de cet ouvrage recense 237 auteurs cités dans le texte et 307 références bibliographiques.
(21) Chatelin, Yvon. Éléments d'épistémologie pédologique. Application à l'étude des sols ferrallitiques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. X, n° 1, 1972.
(22) Chatelin, Yvon. Une épistémologie des sciences du sol. ORSTOM, Mémoires n° 88, 1979.
(23) Chatelin, Yvon, Jean-François Richard et Noël Leneuf. Modèles verbaux et transdisciplinarité dans l'étude des sols et des paysages. 1 - Essai critique en fonction de l'analyse de système. 2 Essai critique pour une approche matérialiste. - Cah. ORSTOM, sér. Pédol. vol. XIX, n° 1, 1982.
(24) Milieux et paysages. Essai sur diverses Modalités de Connaissance. Sous la direction de Yvon Chatelin et Gérard Riou. Masson, 1986. Textes de Chantal Blanc-Pamard, Yves Boulvert, Lawrence Busch, Yvon Chatelin, Francis Hallé, Christian Prioul, Jean-François-Richard, Gérard Riou. Ajoutons deux publications d'Yvon Chatelin et Rigas Arvanitis : Stratégies scientifiques et développement. Sols et agriculture des régions chaudes, ORSTOM coll. Études et thèses, 1988 et National Scientific Strategies in Tropical Soil Sciences, Social Studies of Science, Sage, London, 1988.
(25) En plus des deux doctorats d'État cités plus haut sous leur forme éditée - Chatelin, Yvon (22), Richard, Jean-François (18) - nous devons mentionner ceux de Yves Lucas, Expression cartographique des couvertures pédologiques. Exemples dans le domaine intertropical (1980) //Koli Bi Zueli, Étude d'un milieu de forêt dense. Analyse et cartographie des paysages dans la région de Soubré, Sud-Ouest ivoirien (1981) // J. Tape Bidi, Analyse et cartographie des paysages. Étude d'un milieu de contact forêt-savane, région de Touba, Nord-Ouest ivoirien (1984) // Alain G. Beaudou, Recherche d'un système d'information pour le milieu physique : une méthode de saisie et de traitement des données géo-pédologiques appliquées aux régions tropicales (1988) // Jean-Charles Filleron, Essai de géographie systématique : les paysages du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire (2007). // Sous la forme d'une autobiographie d'un de ses auteurs, l'ensemble de la démarche transdisciplinaire partie de l'étude du sol tropical a été racontée par Chatelin, Yvon. Recherche scientifique en terre africaine. Une vie, une aventure. Éd. De l'Harmattan, Coll. Graveurs de mémoire, 2011. Une large bibliographie y est également donnée.
(26) Baize, Denis et Michel-Claude Girard (coord.), Association française pour l'étude du sol. Référentiel pédologique 2008, Éditions Quae, 2009.
(27) World Reference Base for soil resource. Food and Agriculture Organization for the United Nations, 2006.
Signature :
Yvon Chatelin
Le cheval et la vache
J'étais un jour le passager d'un train roulant à grande vitesse à travers la campagne française. Ne résistant jamais au plaisir de contempler le paysage, je voyais défiler les plaines et collines, les herbages, cultures et vignobles, en période de moisson et bientôt de vendanges. Il y avait peu d'hommes en cette banale campagne de notre époque, ceux dont je pouvais voir ou deviner la présence occupaient le siège d'énormes machines agricoles. Deux ou trois de ces travailleurs agricoles mécanisés pour cent personnes suffisent à nourrir tout le monde, chacun le sait. Soudain, près d'une charrette, je vis un cheval, lui aussi apparemment occupé à travailler la terre ou récolter les cultures. Dans toute la campagne française, s'il n'en restait qu'un, ce devait être celui-là ! L'image m'est restée. Je sais bien que des chevaux, il y en a aujourd'hui ailleurs en France, qui ont eux aussi leurs occupations mais en fait ils ne servent à rien, sinon à exister, conserver leur propre espèce, promener, amuser nos concitoyens. La rareté de la situation, c'était que ce cheval-là était un travailleur agricole. Comme il y en eut tant autrefois !
L'agriculture était déjà partiellement mécanisée, dans ma jeunesse, mais des chevaux, il y en avait partout. Je me souviens de paysans qui en avaient un, pas deux, et aucune machine : un cheval pour labourer et faire tout le reste ! Le Père Pichot, par exemple, quelque part dans le département de la Loire-Inférieure, était de ces paysans pauvres et quelque peu ignorants. Il pratiquait une saignée à son cheval lorsque celui-ci paraissait manquer d'énergie ou pouvait sembler malade ! Je l'ai connu parce que, pour un prix convenu, le Père Pichot louait un sillon, ou deux sillons à ma famille ou à une autre famille de la ville voisine. Aux termes de ce contrat purement verbal, le paysan et son cheval devaient labourer et planter de pommes de terre un ou deux sillons au printemps, dans un champ de petite taille, et à l'automne le contractant n'avait plus qu'à récolter les pommes de terre lui-même, à l'aide d'une houe ou d'un autre instrument manuel, le cheval n'étant plus alors d'aucune aide. Ce petit souvenir me sert d'exemple pour rappeler la place que le cheval, Equus caballus, a eue dans l'histoire de nos campagnes. Il fut un temps où les chevaux étaient presque aussi nombreux que les hommes et il où fallait consacrer à leur alimentation près du tiers des terres arables.
La vie n'a pas fait de moi un paysan, comme mes ancêtres ou comme le Père Pichot, mais un travailleur intellectuel. J'ai pris goût à suivre les spéculations de grands historiens et philosophes qui se sont interrogés sur les raisons ayant fait de notre société ce qu'elle est devenue. Comme eux, je me suis étonné que les civilisations orientales, les premières apparues dans l'histoire, se soient maintenues immuables pendant des siècles, ou aient disparu, alors que la civilisation occidentale, la nôtre, s'est construite dans la continuité d'un changement interne dynamique, surclassant toutes les autres. J'ai essayé de comprendre le miracle grec, le renouveau de l'aristotélicisme dans la philosophie thomiste, j'ai réfléchi à la révolution copernicienne et à la révolution newtonienne, je me suis demandé si l'invention par Robert Boyle de la machine pneumatique et du même coup de la méthode expérimentale n'a pas été le déclic du décollage technologique et du vrai progrès de notre société. J'ai lu Descartes, avec peu d'enthousiasme il est vrai, les encyclopédistes et physiocrates du siècle suivant avec plaisir et sympathie. Avec sa vision un peu mécaniste de l'histoire, Auguste Comte m'a paru moins borné et détestable qu'il n'est de bon ton de le dire. Couronnant cette courte liste, il faut que j'en vienne à Marx. Ah, Karl Marx ! comment l'oublier celui-là ! Personne dans ma génération n'a échappé à son influence, la vulgate marxiste a été dans toutes les têteset nous croyons tous au processus de domination, des femmes par les hommes, des pauvres par les riches, du processus d'exploitation des uns par les autres. Voilà enfin le grand moteur de notre histoire !
L'exploitation des uns par les autres ? Grand Dieu ! N'y aurait-il eu que l'homme et la femme, dans ce beau schéma, à avoir été exploités ? Et le cheval, qui a jamais pensé à parler de lui ? Pourtant, qu'eussent été sans cheval tous les grands personnages de notre histoire, Alexandre le Grand sans Bucéphale ? Imaginerait-on Napoléon conduisant ses guerres éclair sur ses courtes pattes, ou en chaise à porteur peut-être ? Quels personnages seraient devenus un Vercingétorix ou un Roi Soleil se faisant porter à dos d'homme ? Croit-on que les gens de guerre, les marchands, les artistes, les savants, leurs idées, leurs inventions, les nouvelles, les lettres, les objets d'art, les livres eussent circulé dans toute l'Europe comme cela a été le cas sans un messager rapide et puissant ? La réalité est que le cheval a été pendant des siècles le compagnon, le partenaire, la condition sine qua non de toutes nos victoires et de tous nos progrès. Un partenaire d'une complaisance sans faille, intelligent et fort physiquement, capable de s'adapter à la guerre comme à la paix, aux travaux des champs, au moulin, au halage des péniches, des diligences et des chariots, au débardage des grumes. Et même capable de travailler sous terre, dans l'enfer des mines de charbon.
Sait-on, ou veut-on oublier que quatorze chevaux firent la conquête du Mexique au bénéfice des Espagnols ? Huit périrent dans les premières campagnes ou furent laissées aux arrière-gardes. Quand Fernando Cortez revint à la ville à demi lacustre de Tenochtitlan (devenue Mexico), une première fois pacifiquement conquise puis soulevée à cause des exactions de la soldatesque espagnole, il lui restait six chevaux, malheureuses haridelles au trois quarts épuisées, surmenées, mal nourries, mal soignées. Les Espagnols étaient surpassés en nombre par les Aztèques, lesquels savaient se battre. Cortez a raconté la bataille qui dura plusieurs jours. Il plaçait un cheval et son cavalier bien cachés près de chaque point stratégique, notamment près des longues digues traversant le lac Tezcuco et unissant la terre ferme et les trois îles de Tenochtitlan. Lorsque les Aztèques prenaient le dessus en l'un de ces points, la malheureuse haridelle placée en réserve devait charger avec son cavalier protégé d'une lourde de sa cuirasse et armé d'une lance. A chaque fois, le cheval fit la décision, les Aztèques furent vaincus et le Mexique devint espagnol.
N'en déplaise aux philosophes et aux historiens, il en fut ainsi tout au long de notre passé. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin du cheval, on l'a soigneusement fait disparaître de tous les lieux où il s'est illustré, de tous les lieux de la prospérité humaine qui n'eussent pas existé sans lui. L'homme reste le héros de l'Histoire. Aucun monument ne célèbre les équidés victimes de nos guerres mondiales. Le cheval est relégué dans des haras qui nous blanchissent du crime de génocide. On le voit, vivant, sur les champs de course, dans des clubs, sur les prairies des résidences secondaires où il est chargé de couper l'herbe, étant plus décoratif et plus noble que d'autres herbivores. Les économistes se satisfont de nous dire que, dans le secteur des loisirs et des jeux, la "filière cheval" occupe des milliers de personnes en France. Du passé, il nous reste, ici et là, de belles statues. Les visiteurs de Chantilly sourient lorsque, après avoir vu le château et les collections du duc d'Aumale, on leur montre les Grandes Ecuries construites par Louis-Henri de Condé, Prince du sang. Un palais grandiose, superbement décoré, qui coûta une fortune, pour loger des chevaux ! Condé avait peut-être ses bizarreries, mais connaissait vraiment le cheval et avait des motifs de lui rendre hommage.
Si le cheval peut être emblème de vertus masculines, la force, le courage, la vache est facilement créditée de qualités féminines. Elle est douce, pacifiste, maternelle. C'est une extraordinaire nourricière et, par la sélection, l'homme l'a poussée abusivement en cette voie. Les vaches normandes que je vois au Pays d'Auge sont devenues des monstres hypertrophiés, produisant d'incroyables quantités de lait, mais à peine capables de se déplacer, broutant à pas lents, passant des heures immobiles dans la boue plutôt que de chercher un endroit sec. Il faut dire que la vache, Bos taurus, descendante directe de notre auroch des pays aujourd'hui tempérés, est une extraordinaire machine agroalimentaire. Donnez-lui de l'herbe, elle va l'ingérer, la faire passer et repasser dans cet assemblage de la panse, du bonnet, du feuillet et de la caillette qui remplace chez elle l'estomac des autres espèces, et elle va vous restituer des protéines, des lipides, des vitamines. Nos biotechnologies de laboratoire sont loin de réaliser de telles prouesses.
Il y a une bonne vingtaine d'années, dans un cinéma d'Abidjan, j'ai vu "Le Nouveau Monde" (1972), un film magnifique de Jan Troele avec Max von Sydow et Liv Ullman pour acteurs principaux. L'histoire racontée est celle d'une famille d'immigrants scandinaves arrivant Outre-Atlantique, surmontant mille épreuves avant de trouver des terres, s'y implanter et devenir de prospères fermiers américains. Lorsque leur situation commence à s'améliorer, le chef de famille (Max von Sydow) annonce à une épouse (Liv Ullman) aux jupes encombrées d'une abondante progéniture, qu'il va pouvoir se procurer une vache. On voit alors le visage de Liv Ullman s'éclairer d'un merveilleux sourire, tandis qu'elle prononce dans une sorte d'extase ces mots si simples : "Une vache !" L'image est très belle et fait comprendre ce que la vache et son lait apportaient comme confort et sécurité alimentaires à une famille nourrie de haricots et de fèves, aux enfants menacés de malnutrition et de rachitisme. En résumé, une grande partie de l'histoire domestique, familiale et alimentaire de notre société se trouve là.
Les géographes, géologues, botanistes, paléontologues, préhistoriens, archéologues nous ont clairement expliqué que nos paysages européens ont été longtemps couverts de glace, rabotés par des glaciers qui, en disparaissant, nous ont laissé de maigres sols et une pauvre végétation. Les régions tropicales avaient mieux résisté aux glaciations, et ce sont elles qui possédaient la majorité des plantes nourricières, fruits, graines, tubercules. De quoi disposait donc la pauvre Europe, après le néolithique, avant le Columbian exchange qui a commencé (en caravelle) le transfert des plantes d'un continent à l'autre, avant la mondialisation plus complète des espèces et des productions végétales ? De l'herbe ! De l'herbe ! C'est là que la vache est intervenue ! Elle a transformé cette herbe, elle a donné à nos ancêtres, ceux du Moyen-Age, ceux du Grand Siècle, ceux du Siècle des Lumières, les protéines qui ont nourri leur corps, leurs muscles, leurs nerfs, et leurs cerveaux. Pensons aux cerveaux, à ceux des Newton, Lavoisier et autres personnages qui ont fait la science, la technologie, et à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on appelle le progrès.
L'histoire ne se recommence pas, elle ne se soumet pas aux vérifications expérimentales, mais elle se prête aux comparaisons. Cherchez bien. Voyez la civilisation occidentale, voyez les autres civilisations. Examinez les différents continents, les sous-continents, les îles, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Cherchez le cheval, cherchez la vache. Ne les considérez pas comme des "animaux" ou comme des "bêtes" mais tels que des êtres vivants à part entière, ayant un même droit à la vie que d'autres. Voyez en quels endroits et en quels temps, le cheval et la vache ont proliféré et se sont unis pour soutenir les hommes. Ne vous perdez pas dans les détails, particularismes, ou faux-semblants. Ne vous laissez pas impressionner par les thèses évoquées plus haut, celles des philosophes et historiens qui ne connaissent que l'homme. Comparez et concluez par vous-même.
Signature :
Yvon Chatelin
Lire plus
L'agriculture était déjà partiellement mécanisée, dans ma jeunesse, mais des chevaux, il y en avait partout. Je me souviens de paysans qui en avaient un, pas deux, et aucune machine : un cheval pour labourer et faire tout le reste ! Le Père Pichot, par exemple, quelque part dans le département de la Loire-Inférieure, était de ces paysans pauvres et quelque peu ignorants. Il pratiquait une saignée à son cheval lorsque celui-ci paraissait manquer d'énergie ou pouvait sembler malade ! Je l'ai connu parce que, pour un prix convenu, le Père Pichot louait un sillon, ou deux sillons à ma famille ou à une autre famille de la ville voisine. Aux termes de ce contrat purement verbal, le paysan et son cheval devaient labourer et planter de pommes de terre un ou deux sillons au printemps, dans un champ de petite taille, et à l'automne le contractant n'avait plus qu'à récolter les pommes de terre lui-même, à l'aide d'une houe ou d'un autre instrument manuel, le cheval n'étant plus alors d'aucune aide. Ce petit souvenir me sert d'exemple pour rappeler la place que le cheval, Equus caballus, a eue dans l'histoire de nos campagnes. Il fut un temps où les chevaux étaient presque aussi nombreux que les hommes et il où fallait consacrer à leur alimentation près du tiers des terres arables.
La vie n'a pas fait de moi un paysan, comme mes ancêtres ou comme le Père Pichot, mais un travailleur intellectuel. J'ai pris goût à suivre les spéculations de grands historiens et philosophes qui se sont interrogés sur les raisons ayant fait de notre société ce qu'elle est devenue. Comme eux, je me suis étonné que les civilisations orientales, les premières apparues dans l'histoire, se soient maintenues immuables pendant des siècles, ou aient disparu, alors que la civilisation occidentale, la nôtre, s'est construite dans la continuité d'un changement interne dynamique, surclassant toutes les autres. J'ai essayé de comprendre le miracle grec, le renouveau de l'aristotélicisme dans la philosophie thomiste, j'ai réfléchi à la révolution copernicienne et à la révolution newtonienne, je me suis demandé si l'invention par Robert Boyle de la machine pneumatique et du même coup de la méthode expérimentale n'a pas été le déclic du décollage technologique et du vrai progrès de notre société. J'ai lu Descartes, avec peu d'enthousiasme il est vrai, les encyclopédistes et physiocrates du siècle suivant avec plaisir et sympathie. Avec sa vision un peu mécaniste de l'histoire, Auguste Comte m'a paru moins borné et détestable qu'il n'est de bon ton de le dire. Couronnant cette courte liste, il faut que j'en vienne à Marx. Ah, Karl Marx ! comment l'oublier celui-là ! Personne dans ma génération n'a échappé à son influence, la vulgate marxiste a été dans toutes les têteset nous croyons tous au processus de domination, des femmes par les hommes, des pauvres par les riches, du processus d'exploitation des uns par les autres. Voilà enfin le grand moteur de notre histoire !
L'exploitation des uns par les autres ? Grand Dieu ! N'y aurait-il eu que l'homme et la femme, dans ce beau schéma, à avoir été exploités ? Et le cheval, qui a jamais pensé à parler de lui ? Pourtant, qu'eussent été sans cheval tous les grands personnages de notre histoire, Alexandre le Grand sans Bucéphale ? Imaginerait-on Napoléon conduisant ses guerres éclair sur ses courtes pattes, ou en chaise à porteur peut-être ? Quels personnages seraient devenus un Vercingétorix ou un Roi Soleil se faisant porter à dos d'homme ? Croit-on que les gens de guerre, les marchands, les artistes, les savants, leurs idées, leurs inventions, les nouvelles, les lettres, les objets d'art, les livres eussent circulé dans toute l'Europe comme cela a été le cas sans un messager rapide et puissant ? La réalité est que le cheval a été pendant des siècles le compagnon, le partenaire, la condition sine qua non de toutes nos victoires et de tous nos progrès. Un partenaire d'une complaisance sans faille, intelligent et fort physiquement, capable de s'adapter à la guerre comme à la paix, aux travaux des champs, au moulin, au halage des péniches, des diligences et des chariots, au débardage des grumes. Et même capable de travailler sous terre, dans l'enfer des mines de charbon.
Sait-on, ou veut-on oublier que quatorze chevaux firent la conquête du Mexique au bénéfice des Espagnols ? Huit périrent dans les premières campagnes ou furent laissées aux arrière-gardes. Quand Fernando Cortez revint à la ville à demi lacustre de Tenochtitlan (devenue Mexico), une première fois pacifiquement conquise puis soulevée à cause des exactions de la soldatesque espagnole, il lui restait six chevaux, malheureuses haridelles au trois quarts épuisées, surmenées, mal nourries, mal soignées. Les Espagnols étaient surpassés en nombre par les Aztèques, lesquels savaient se battre. Cortez a raconté la bataille qui dura plusieurs jours. Il plaçait un cheval et son cavalier bien cachés près de chaque point stratégique, notamment près des longues digues traversant le lac Tezcuco et unissant la terre ferme et les trois îles de Tenochtitlan. Lorsque les Aztèques prenaient le dessus en l'un de ces points, la malheureuse haridelle placée en réserve devait charger avec son cavalier protégé d'une lourde de sa cuirasse et armé d'une lance. A chaque fois, le cheval fit la décision, les Aztèques furent vaincus et le Mexique devint espagnol.
N'en déplaise aux philosophes et aux historiens, il en fut ainsi tout au long de notre passé. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin du cheval, on l'a soigneusement fait disparaître de tous les lieux où il s'est illustré, de tous les lieux de la prospérité humaine qui n'eussent pas existé sans lui. L'homme reste le héros de l'Histoire. Aucun monument ne célèbre les équidés victimes de nos guerres mondiales. Le cheval est relégué dans des haras qui nous blanchissent du crime de génocide. On le voit, vivant, sur les champs de course, dans des clubs, sur les prairies des résidences secondaires où il est chargé de couper l'herbe, étant plus décoratif et plus noble que d'autres herbivores. Les économistes se satisfont de nous dire que, dans le secteur des loisirs et des jeux, la "filière cheval" occupe des milliers de personnes en France. Du passé, il nous reste, ici et là, de belles statues. Les visiteurs de Chantilly sourient lorsque, après avoir vu le château et les collections du duc d'Aumale, on leur montre les Grandes Ecuries construites par Louis-Henri de Condé, Prince du sang. Un palais grandiose, superbement décoré, qui coûta une fortune, pour loger des chevaux ! Condé avait peut-être ses bizarreries, mais connaissait vraiment le cheval et avait des motifs de lui rendre hommage.
Si le cheval peut être emblème de vertus masculines, la force, le courage, la vache est facilement créditée de qualités féminines. Elle est douce, pacifiste, maternelle. C'est une extraordinaire nourricière et, par la sélection, l'homme l'a poussée abusivement en cette voie. Les vaches normandes que je vois au Pays d'Auge sont devenues des monstres hypertrophiés, produisant d'incroyables quantités de lait, mais à peine capables de se déplacer, broutant à pas lents, passant des heures immobiles dans la boue plutôt que de chercher un endroit sec. Il faut dire que la vache, Bos taurus, descendante directe de notre auroch des pays aujourd'hui tempérés, est une extraordinaire machine agroalimentaire. Donnez-lui de l'herbe, elle va l'ingérer, la faire passer et repasser dans cet assemblage de la panse, du bonnet, du feuillet et de la caillette qui remplace chez elle l'estomac des autres espèces, et elle va vous restituer des protéines, des lipides, des vitamines. Nos biotechnologies de laboratoire sont loin de réaliser de telles prouesses.
Il y a une bonne vingtaine d'années, dans un cinéma d'Abidjan, j'ai vu "Le Nouveau Monde" (1972), un film magnifique de Jan Troele avec Max von Sydow et Liv Ullman pour acteurs principaux. L'histoire racontée est celle d'une famille d'immigrants scandinaves arrivant Outre-Atlantique, surmontant mille épreuves avant de trouver des terres, s'y implanter et devenir de prospères fermiers américains. Lorsque leur situation commence à s'améliorer, le chef de famille (Max von Sydow) annonce à une épouse (Liv Ullman) aux jupes encombrées d'une abondante progéniture, qu'il va pouvoir se procurer une vache. On voit alors le visage de Liv Ullman s'éclairer d'un merveilleux sourire, tandis qu'elle prononce dans une sorte d'extase ces mots si simples : "Une vache !" L'image est très belle et fait comprendre ce que la vache et son lait apportaient comme confort et sécurité alimentaires à une famille nourrie de haricots et de fèves, aux enfants menacés de malnutrition et de rachitisme. En résumé, une grande partie de l'histoire domestique, familiale et alimentaire de notre société se trouve là.
Les géographes, géologues, botanistes, paléontologues, préhistoriens, archéologues nous ont clairement expliqué que nos paysages européens ont été longtemps couverts de glace, rabotés par des glaciers qui, en disparaissant, nous ont laissé de maigres sols et une pauvre végétation. Les régions tropicales avaient mieux résisté aux glaciations, et ce sont elles qui possédaient la majorité des plantes nourricières, fruits, graines, tubercules. De quoi disposait donc la pauvre Europe, après le néolithique, avant le Columbian exchange qui a commencé (en caravelle) le transfert des plantes d'un continent à l'autre, avant la mondialisation plus complète des espèces et des productions végétales ? De l'herbe ! De l'herbe ! C'est là que la vache est intervenue ! Elle a transformé cette herbe, elle a donné à nos ancêtres, ceux du Moyen-Age, ceux du Grand Siècle, ceux du Siècle des Lumières, les protéines qui ont nourri leur corps, leurs muscles, leurs nerfs, et leurs cerveaux. Pensons aux cerveaux, à ceux des Newton, Lavoisier et autres personnages qui ont fait la science, la technologie, et à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on appelle le progrès.
L'histoire ne se recommence pas, elle ne se soumet pas aux vérifications expérimentales, mais elle se prête aux comparaisons. Cherchez bien. Voyez la civilisation occidentale, voyez les autres civilisations. Examinez les différents continents, les sous-continents, les îles, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Cherchez le cheval, cherchez la vache. Ne les considérez pas comme des "animaux" ou comme des "bêtes" mais tels que des êtres vivants à part entière, ayant un même droit à la vie que d'autres. Voyez en quels endroits et en quels temps, le cheval et la vache ont proliféré et se sont unis pour soutenir les hommes. Ne vous perdez pas dans les détails, particularismes, ou faux-semblants. Ne vous laissez pas impressionner par les thèses évoquées plus haut, celles des philosophes et historiens qui ne connaissent que l'homme. Comparez et concluez par vous-même.
Signature :
Yvon Chatelin
Audubon et les vieilles lunes de la psycho-critique
L'Amérique est née puritaine, chacun en convient, mais les mentalités ont évolué depuis John Winthrop, la chasse aux sorcières de Salen, la persécution des premiers Quakers. L'Amérique -entendez les États-Unis - est devenue une grande métropole intellectuelle, et cela ne s'est pas fait sans difficulté, sans conflit, dans le domaine des arts plastiques notamment. Raillés par les Européens qui s'étonnaient avec l'abbé Raynal de ne voir outre-Atlantique aucun savant, écrivain, ou artiste de génie, les Américains ont entrepris de réduire leur handicap dès l'Indépendance acquise. Pour couvrir le domaine des arts plastiques, ils ont fait venir de la vieille Europe statues, tableaux, pièces d'orfèvrerie et d'arts divers, surtout des statues parce qu'ils pouvaient obtenir un moulage quand l'original était hors de portée des acquéreurs.
C'est ainsi que beaucoup d'objets de l'Antiquité grecque et romaine (ou leurs copies) sont arrivées au pays des Puritains. Hélas, la pudeur des Grecs et Romains était limitée, la nudité humaine leur paraissait normale et belle, et la feuille de vigne suffisante pour en masquer (parfois) certains détails. Les Américains ne l'entendaient pas ainsi et beaucoup des premières uvres qu'ils achetèrent ne purent être immédiatement montrées au public. Elles restèrent cachées. Pourtant, il fallait éduquer les citoyens, donner aux artistes débutants des modèles à imiter, il fallait aussi rentabiliser les achats. Il y eut alors, dans les dernières années du dix-huitième siècle et celles qui suivirent, des débats qui sortirent des cercles artistiques et s'exprimèrent jusque dans les journaux. Les uns proposaient d'habiller de voiles les statues litigieuses, les autres de ne les montrer qu'à des personnes à la moralité robuste, ou de faire des expositions séparées pour hommes et femmes ! Arrivé aux États-Unis après l'ultime aventure napoléonienne, Joseph Bonaparte plaçait ses nus et scènes licencieuses sur les murs de sa chambre et suite personnelle, dans sa résidence de Bordentown, et ne les laissait voir qu'à certains amis. Ou amies, car il n'en manquait pas.
Le premier peintre américain qui se permit de représenter sur une toile une femme nue fut John Vanderlyn. Il s'agissait d'un sujet mythologique, Ariane endormie sur l'île de Naxos, qu'il peignit étant alors à Paris, pendant l'Empire. Revenu aux États-Unis, Vanderlyn exposait son tableau dans différentes villes, provoquant quelques réactions dans la société bien pensante, et il se trouvait à la Nouvelle-Orléans en 1821, en même temps qu'Audubon qui devint son ami. Or il se peut que ce soit Audubon, en cette même année 1821, qui produisit le deuxième nu féminin de l'histoire américaine ! En quelques mots, Audubon fut sollicité par une certaine Madame André pour la représenter nue, au pastel. Le portait n'a jamais été rendu public et il a disparu. Qui a pu le voir, on n'en sait rien, mais Audubon a raconté l'histoire dans tous ses détails. Comment il avait été abordé par Madame André, son émotion lorsqu'elle posait dévêtue devant lui, la satisfaction de la jeune femme lorsque le portait fut achevé, le fusil qu'elle lui donna en souvenir. Puis la disparition de la belle mystérieuse qu'Audubon ne revit jamais. Comme l'affaire des nus en général dans la société américaine, mais pour d'autres raisons, celle de Madame André devait provoquer des remous dans le sillage laissé par Audubon lorsqu'il fut disparu.
L'histoire était-elle vraie, ou était-elle fausse ? Ou bien très partiellement vraie ? Audubon n'était-il pas un goujat de mettre l'histoire par écrit et d'envoyer son texte à sa pauvre épouse, à moitié abandonnée par lui ainsi que leurs deux enfants ! N'avait-il pas tout simplement envie d'écrire une fiction ? Alors, pourquoi ne pas le dire ! D'ailleurs, Audubon n'était-il pas un menteur ! Et même un mythomane ! N'a-t-il pas pris plus tard l'habitude d'inventer des histoires, comme celle de sa rencontre avec Daniel Boone, ou comme l'histoire des brigands de la prairie ? D'ailleurs, si certaines choses étaient manifestement fausses dans ses récits, comment croire le reste ! Il disait que son père avait été amiral, quelle blague ! Et sa fameuse et supposée mère espagnole ! Et son lieu de naissance toujours changeant, sa date de naissance qu'il ne connaissait pas !
Devenant le biographe de John James, je suis entré dans une sorte de procès en réhabilitation. Qu'allais-je faire de toutes les accusations, les allégations, les sous-entendus, les remarques ironiques ou amusées se trouvant un peu partout dans la littérature qui le concerne ? J'ai commencé par remarquer que les grands biographes d'Audubon, ceux qui ont donné les faits, étaient les plus indulgents pour lui, les plus compréhensifs. Les vrais accusateurs ont été plutôt des biographes ou des commentateurs de seconde main, ou des écologistes modernes qui détestent Audubon parce qu'il aimait chasser. Il m'est apparu ensuite, en cette affaire de mythomanie supposée, que presque toutes les inexactitudes avancées par Audubon tournaient autour de son origine, de ce que son père avait pu lui en dire, de son enfance et adolescence. Voilà un homme parfait menteur et mythomane quand il s'agit de retracer son identité et qui passe tout le reste de sa vie à travailler, observer, avec la plus grande simplicité de caractère, toujours timide et gêné d'apparaître en société, préférant les bois au grand monde ! Le contraire d'un vrai mythomane, personnage qui aime habituellement s'exhiber. John James était simplement un enfant illégitime et adopté, quelque peu perturbé jusque dans son âge adulte. Pour le reste, on voit bien qu'il a forcé la note dans certaines histoires, qu'il a emprunté quelques anecdotes, mais quel écrivain n'en a jamais fait autant ? Ses amis et ses lecteurs le pressaient de raconter des histoires étonnantes, il est resté dans l'ensemble simple et fiable.
Sans doute connaît-on trop de choses de ce pauvre Audubon. Il a laissé tant de lettres, de journaux (qu'il destinait à sa famille et à son usage personnel, et non à la postérité), de récits plus ou moins largement autobiographiques ! Tous ses mouvements d'humeur nous sont connus. Il avait beaucoup d'amis, et des amis fidèles, mais pour les personnages qu'il n'aimait pas, quelle avalanche de railleries, de mots péjoratifs, de gros mots ! Il critiquait durement ses prédécesseurs, et même de grands auteurs largement connus et célébrés, il dépréciait ceux qu'il prenait comme ses concurrents ou ses homologues, les John Gould, Charles-Lucien Bonaparte, Titian Peale, et même ce George Catlin qui était quand même un plus grand spécialiste et peintre des Indiens que lui ! Etait-il mauvais camarade et collaborateur déshonnête ? Il n'a jamais voulu dire que le jeune Joseph Mason avait dessiné des plantes pour lui, il a fait travailler son fils John Woodhouse, la brave Maria Martin, le grand aquarelliste George Lehman, le naturaliste William MacGillivray sans pleinement reconnaître ses dettes envers eux. Tout était Drawn from Nature by JJ Audubon, même lorsqu'il représentait un oiseau qu'il n'avait vu qu'empaillé et jamais en pleine nature !
Mais, pensai-je devant toutes ces énumérations, n'était-il pas pris comme bien d'autres dans les tensions et les duretés de la vie, dans les luttes normales des cercles d'artistes et d'hommes de science ? Ce n'est pas sans un caractère affirmé, sans volonté ni ambition, que l'on produit une grande uvre. Arrivé là dans mes réflexions, je me souvins de Rousseau et de sa "coterie holbachique", fis le parallèle avec la "coterie Ord-Waterton", la coterie du "Museum Coffee Shop" de la Nouvelle Orléans, et avec tous ceux qui à un moment ou l'autre dénigrèrent Audubon. Dans son Discours sur les Sciences et les Arts, celui de ses textes qui s'applique le mieux à la situation d'Audubon artiste et naturaliste, Rousseau écrivait : "Plus d'amitiés sincères; plus d'estime réelle; plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle..."
Allons, en considérant Audubon lui-même, la peinture est tout de même moins noire ! Il ne s'embarrassait pas toujours d'un voile perfide de politesse ! Il est amusant, d'ailleurs, de remarquer que son épouse, cette brave Lucy dont on a plaint les tribulations et loué la patience, le modèle des vertus conjugales féminines, cette brave Lucy était souvent plus coriace dans ses jugements que son mari. Avec un langage moins vert, heureusement ! Elle ne se privait pas de critiquer l'un, de se méfier de l'autre. Tandis que John James déambulait en Floride, elle vidait sa bile dans ses lettres, lui disant qu'il ne devait pas faire confiance à Richard Harlan, que celui-ci était un incapable, etc. Et pourtant, cet Harlan rendait d'immenses services en gérant, bénévolement et sans y prendre le moindre avantage personnel, les publications d'Audubon. A tel point que John James, excédé, finit par répondre à Lucy, le 29 mars 1832 : "J'ai une bonne opinion du Dr. Harlan, et je continuerai ainsi à moins que je ne trouve que c'est un mauvais homme." A cette même époque, John James confiait la gestion de son argent à son ami et beau-frère Jacques Berthoud. C'était Lucy, et non John James, qui soupçonnait Berthoud de vouloir puiser dans le magot des Audubon, pour se rembourser d'anciennes et très contestables dettes. Audubon avait de la droiture, il savait reconnaître ceux qui en avaient aussi, c'est lui qui avait raison.
J'en vins à penser qu'il fallait sortir des détails et donner de la hauteur à ma défense d'Audubon. La critique est un art qui a eu ses maîtres. Je battis le rappel de mes connaissances. Sainte-Beuve et sa galerie de portraits, dont celui de Chateaubriand et de son cercle littéraire, me revinrent en mémoire. Il m'apparut vite que je n'avais rien à trouver là. Sainte-Beuve était un pisse-froid, une langue de vipère. Tout l'opposé de ce que j'espérais faire. D'ailleurs Proust désapprouvait sa démarche, alors qu'il encensait celle de Ruskin. Je me mis à invoquer John Ruskin, et visitais sa belle maison du Lake District, mais n'en tirais guère plus que de poétiques images. Un des maîtres à penser de ma génération avait été Roland Barthes. Mais son structuralisme était-il transposable, ou n'était-ce rien d'autre qu'un beau mot placé sur une manière très personnelle et très sélective de regarder autour de soi ? Je gardais de l'admiration pour Julia Kristeva et son analyse du langage poétique. Le sens donné par elle à la répétition des "i" et autres sons mouillés et fuyants avait-il de la pertinence pour étudier Audubon ? Certes, celui-ci parlait avec un fort accent français, laissait filer abusivement les "th" et "s" anglais à la manière de nos "z", surtout lorsqu'ils précédaient les "i" et les "e", mais sans rapport avec l'interprétation très, très psychanalytique de Kristeva ! Je n'avais pas oublié non plus Charles Mauron, ayant lu deux fois son travail sur les métaphores obsédantes de Mallarmé. A l'évidence, si l'on pouvait dire qu'Audubon était obsédé par les oiseaux, la ressemblance s'arrêtait là.
Quelques tours et détours supplémentaires, Sartre et son "Flaubert", Raymond Picard et son "Racine", ne m'apportèrent rien. Je décidai de m'en tenir à mon intuition et, dans ma biographie, de repousser toutes les petitesses de la vie, celles d'Audubon comme celle des autres, à une place très limitée. Qu'importe que John James eût la détestable habitude de priser ! Et peut-on lui en vouloir d'avoir bu des grogs, surtout dans les mauvais moments de sa vie, quand il voyait mourir une de ses belles-filles par exemple ? On ne sait pas d'ailleurs exactement ce qu'il appelait grog, c'était un mélange de bourbon et d'eau, mais dans une proportion inconnue Il admirait sa chevelure, qu'il entretenait soigneusement avec de la graisse d'ours. Honnêtement, graisse d'ours en moins, bien d'autres en font autant, soignent leur image, leur habillement, disent des gros mots dans l'intimité, sont parfois de mauvaise humeur, ou d'un optimisme exubérant. D'autres que lui construisent des châteaux en Espagne, sont un peu cyclothymes, naïfs ou même enfantins dans leurs relations conjugales, négligents dans les affaires ordinaires de la vie, portés à célébrer en paroles la beauté féminine, mauvais plaisantins au cours de leur jeunesse, imprécis dans leurs souvenirs, prompts à la riposte lorsqu'on les agresse à coup de gourdin, comme cela arriva un jour à John James.
Au lieu de reprocher à Audubon le papier sur "la belle inconnue", Madame André, j'ai voulu y voir une de ses premières tentatives d'écriture et j'ai considéré qu'il importait peu qu'il ait puisé dans la réalité ou, si cela avait été le cas, dans une demi-fiction. Longtemps après l'achèvement de mon livre, me trouvant à Chicago, j'ai visité le Field Museum. Là, dans la réserve des documents exceptionnels et anciens, j'ai pu voir le Journal 1826 de John James, l'un de ses rares journaux intimes n'ayant pas disparu. C'est un gros volume, qu'il appelait un ledger, entièrement couvert, sans marges, d'une écriture fine, dense et rapide. J'ai pu y lire des textes que je connaissais par leurs rééditions modernes, mais la présence du document original était émouvante pour moi. Surtout, je voyais traduit physiquement, en quelque sorte, ce que j'avais deviné ou pressenti, ce besoin d'écrire d'Audubon, avec tout ce qu'il implique de longs moments de solitude, de retour sur soi-même, de réflexion et de recueillement. J'avais eu raison d'insister sur cette maturation intellectuelle, psychologique, morale conduisant Audubon à écrire, de chercher la source de cette maturation jusque dans l'histoire d'une femme voulant son portrait nue, et de faire bon compte de ce que j'appelle les petitesses de la vie. Chateaubriand disait que, s'il avait eu un talent pour la satire et la caricature, il aurait cherché à l'étouffer. "Tout ce qui fait grimacer la nature de l'homme", ajoutait-il, "me semble peu digne d'estime." (Itinéraires, III e Partie). Ce sentiment est aussi le mien.
Audubon fut un artiste et un naturaliste, beaucoup plus qu'un écrivain. Il avait une philosophie de la vie et fit l'expérience exceptionnelle de passer la plus grande part de son existence à chercher, comprendre, représenter, faire connaître autour de lui ce qu'il appelait les beautés de la Création. Pour cela, il mérite le respect. Les autres personnages aussi doivent être respectés, et quand j'ai eu à parler de George Ord, l'impitoyable adversaire d'Audubon, j'ai préféré chercher les causes de son comportement dans le domaine des raisons scientifiques plutôt que dans les noirceurs d'une âme machiavélique. Quant à l'expérience unique vécue par Audubon, il faut essayer de la revivre. Je lui ai laissé la parole, par des citations, dans toute la mesure compatible avec une biographie. Nous devons faire l'effort de comprendre ce qu'il avait à dire et à montrer, et même l'effort d'aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qui s'exprime difficilement, une sympathie intime, une sorte de symbiose établie entre l'Homme et la Nature, le Cosmos, la Création. Et surtout entre nous et les oiseaux ! Les petitesses de la vie humaine, les névroses, les psychoses, les mauvaises habitudes, les incompréhensions, les réactions déplacées, les complexes sans trop de gravité sont loin de tout cela. Et tant pis pour les vieilles lunes de la psycho-critique !
Lire plus
C'est ainsi que beaucoup d'objets de l'Antiquité grecque et romaine (ou leurs copies) sont arrivées au pays des Puritains. Hélas, la pudeur des Grecs et Romains était limitée, la nudité humaine leur paraissait normale et belle, et la feuille de vigne suffisante pour en masquer (parfois) certains détails. Les Américains ne l'entendaient pas ainsi et beaucoup des premières uvres qu'ils achetèrent ne purent être immédiatement montrées au public. Elles restèrent cachées. Pourtant, il fallait éduquer les citoyens, donner aux artistes débutants des modèles à imiter, il fallait aussi rentabiliser les achats. Il y eut alors, dans les dernières années du dix-huitième siècle et celles qui suivirent, des débats qui sortirent des cercles artistiques et s'exprimèrent jusque dans les journaux. Les uns proposaient d'habiller de voiles les statues litigieuses, les autres de ne les montrer qu'à des personnes à la moralité robuste, ou de faire des expositions séparées pour hommes et femmes ! Arrivé aux États-Unis après l'ultime aventure napoléonienne, Joseph Bonaparte plaçait ses nus et scènes licencieuses sur les murs de sa chambre et suite personnelle, dans sa résidence de Bordentown, et ne les laissait voir qu'à certains amis. Ou amies, car il n'en manquait pas.
Le premier peintre américain qui se permit de représenter sur une toile une femme nue fut John Vanderlyn. Il s'agissait d'un sujet mythologique, Ariane endormie sur l'île de Naxos, qu'il peignit étant alors à Paris, pendant l'Empire. Revenu aux États-Unis, Vanderlyn exposait son tableau dans différentes villes, provoquant quelques réactions dans la société bien pensante, et il se trouvait à la Nouvelle-Orléans en 1821, en même temps qu'Audubon qui devint son ami. Or il se peut que ce soit Audubon, en cette même année 1821, qui produisit le deuxième nu féminin de l'histoire américaine ! En quelques mots, Audubon fut sollicité par une certaine Madame André pour la représenter nue, au pastel. Le portait n'a jamais été rendu public et il a disparu. Qui a pu le voir, on n'en sait rien, mais Audubon a raconté l'histoire dans tous ses détails. Comment il avait été abordé par Madame André, son émotion lorsqu'elle posait dévêtue devant lui, la satisfaction de la jeune femme lorsque le portait fut achevé, le fusil qu'elle lui donna en souvenir. Puis la disparition de la belle mystérieuse qu'Audubon ne revit jamais. Comme l'affaire des nus en général dans la société américaine, mais pour d'autres raisons, celle de Madame André devait provoquer des remous dans le sillage laissé par Audubon lorsqu'il fut disparu.
L'histoire était-elle vraie, ou était-elle fausse ? Ou bien très partiellement vraie ? Audubon n'était-il pas un goujat de mettre l'histoire par écrit et d'envoyer son texte à sa pauvre épouse, à moitié abandonnée par lui ainsi que leurs deux enfants ! N'avait-il pas tout simplement envie d'écrire une fiction ? Alors, pourquoi ne pas le dire ! D'ailleurs, Audubon n'était-il pas un menteur ! Et même un mythomane ! N'a-t-il pas pris plus tard l'habitude d'inventer des histoires, comme celle de sa rencontre avec Daniel Boone, ou comme l'histoire des brigands de la prairie ? D'ailleurs, si certaines choses étaient manifestement fausses dans ses récits, comment croire le reste ! Il disait que son père avait été amiral, quelle blague ! Et sa fameuse et supposée mère espagnole ! Et son lieu de naissance toujours changeant, sa date de naissance qu'il ne connaissait pas !
Devenant le biographe de John James, je suis entré dans une sorte de procès en réhabilitation. Qu'allais-je faire de toutes les accusations, les allégations, les sous-entendus, les remarques ironiques ou amusées se trouvant un peu partout dans la littérature qui le concerne ? J'ai commencé par remarquer que les grands biographes d'Audubon, ceux qui ont donné les faits, étaient les plus indulgents pour lui, les plus compréhensifs. Les vrais accusateurs ont été plutôt des biographes ou des commentateurs de seconde main, ou des écologistes modernes qui détestent Audubon parce qu'il aimait chasser. Il m'est apparu ensuite, en cette affaire de mythomanie supposée, que presque toutes les inexactitudes avancées par Audubon tournaient autour de son origine, de ce que son père avait pu lui en dire, de son enfance et adolescence. Voilà un homme parfait menteur et mythomane quand il s'agit de retracer son identité et qui passe tout le reste de sa vie à travailler, observer, avec la plus grande simplicité de caractère, toujours timide et gêné d'apparaître en société, préférant les bois au grand monde ! Le contraire d'un vrai mythomane, personnage qui aime habituellement s'exhiber. John James était simplement un enfant illégitime et adopté, quelque peu perturbé jusque dans son âge adulte. Pour le reste, on voit bien qu'il a forcé la note dans certaines histoires, qu'il a emprunté quelques anecdotes, mais quel écrivain n'en a jamais fait autant ? Ses amis et ses lecteurs le pressaient de raconter des histoires étonnantes, il est resté dans l'ensemble simple et fiable.
Sans doute connaît-on trop de choses de ce pauvre Audubon. Il a laissé tant de lettres, de journaux (qu'il destinait à sa famille et à son usage personnel, et non à la postérité), de récits plus ou moins largement autobiographiques ! Tous ses mouvements d'humeur nous sont connus. Il avait beaucoup d'amis, et des amis fidèles, mais pour les personnages qu'il n'aimait pas, quelle avalanche de railleries, de mots péjoratifs, de gros mots ! Il critiquait durement ses prédécesseurs, et même de grands auteurs largement connus et célébrés, il dépréciait ceux qu'il prenait comme ses concurrents ou ses homologues, les John Gould, Charles-Lucien Bonaparte, Titian Peale, et même ce George Catlin qui était quand même un plus grand spécialiste et peintre des Indiens que lui ! Etait-il mauvais camarade et collaborateur déshonnête ? Il n'a jamais voulu dire que le jeune Joseph Mason avait dessiné des plantes pour lui, il a fait travailler son fils John Woodhouse, la brave Maria Martin, le grand aquarelliste George Lehman, le naturaliste William MacGillivray sans pleinement reconnaître ses dettes envers eux. Tout était Drawn from Nature by JJ Audubon, même lorsqu'il représentait un oiseau qu'il n'avait vu qu'empaillé et jamais en pleine nature !
Mais, pensai-je devant toutes ces énumérations, n'était-il pas pris comme bien d'autres dans les tensions et les duretés de la vie, dans les luttes normales des cercles d'artistes et d'hommes de science ? Ce n'est pas sans un caractère affirmé, sans volonté ni ambition, que l'on produit une grande uvre. Arrivé là dans mes réflexions, je me souvins de Rousseau et de sa "coterie holbachique", fis le parallèle avec la "coterie Ord-Waterton", la coterie du "Museum Coffee Shop" de la Nouvelle Orléans, et avec tous ceux qui à un moment ou l'autre dénigrèrent Audubon. Dans son Discours sur les Sciences et les Arts, celui de ses textes qui s'applique le mieux à la situation d'Audubon artiste et naturaliste, Rousseau écrivait : "Plus d'amitiés sincères; plus d'estime réelle; plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle..."
Allons, en considérant Audubon lui-même, la peinture est tout de même moins noire ! Il ne s'embarrassait pas toujours d'un voile perfide de politesse ! Il est amusant, d'ailleurs, de remarquer que son épouse, cette brave Lucy dont on a plaint les tribulations et loué la patience, le modèle des vertus conjugales féminines, cette brave Lucy était souvent plus coriace dans ses jugements que son mari. Avec un langage moins vert, heureusement ! Elle ne se privait pas de critiquer l'un, de se méfier de l'autre. Tandis que John James déambulait en Floride, elle vidait sa bile dans ses lettres, lui disant qu'il ne devait pas faire confiance à Richard Harlan, que celui-ci était un incapable, etc. Et pourtant, cet Harlan rendait d'immenses services en gérant, bénévolement et sans y prendre le moindre avantage personnel, les publications d'Audubon. A tel point que John James, excédé, finit par répondre à Lucy, le 29 mars 1832 : "J'ai une bonne opinion du Dr. Harlan, et je continuerai ainsi à moins que je ne trouve que c'est un mauvais homme." A cette même époque, John James confiait la gestion de son argent à son ami et beau-frère Jacques Berthoud. C'était Lucy, et non John James, qui soupçonnait Berthoud de vouloir puiser dans le magot des Audubon, pour se rembourser d'anciennes et très contestables dettes. Audubon avait de la droiture, il savait reconnaître ceux qui en avaient aussi, c'est lui qui avait raison.
J'en vins à penser qu'il fallait sortir des détails et donner de la hauteur à ma défense d'Audubon. La critique est un art qui a eu ses maîtres. Je battis le rappel de mes connaissances. Sainte-Beuve et sa galerie de portraits, dont celui de Chateaubriand et de son cercle littéraire, me revinrent en mémoire. Il m'apparut vite que je n'avais rien à trouver là. Sainte-Beuve était un pisse-froid, une langue de vipère. Tout l'opposé de ce que j'espérais faire. D'ailleurs Proust désapprouvait sa démarche, alors qu'il encensait celle de Ruskin. Je me mis à invoquer John Ruskin, et visitais sa belle maison du Lake District, mais n'en tirais guère plus que de poétiques images. Un des maîtres à penser de ma génération avait été Roland Barthes. Mais son structuralisme était-il transposable, ou n'était-ce rien d'autre qu'un beau mot placé sur une manière très personnelle et très sélective de regarder autour de soi ? Je gardais de l'admiration pour Julia Kristeva et son analyse du langage poétique. Le sens donné par elle à la répétition des "i" et autres sons mouillés et fuyants avait-il de la pertinence pour étudier Audubon ? Certes, celui-ci parlait avec un fort accent français, laissait filer abusivement les "th" et "s" anglais à la manière de nos "z", surtout lorsqu'ils précédaient les "i" et les "e", mais sans rapport avec l'interprétation très, très psychanalytique de Kristeva ! Je n'avais pas oublié non plus Charles Mauron, ayant lu deux fois son travail sur les métaphores obsédantes de Mallarmé. A l'évidence, si l'on pouvait dire qu'Audubon était obsédé par les oiseaux, la ressemblance s'arrêtait là.
Quelques tours et détours supplémentaires, Sartre et son "Flaubert", Raymond Picard et son "Racine", ne m'apportèrent rien. Je décidai de m'en tenir à mon intuition et, dans ma biographie, de repousser toutes les petitesses de la vie, celles d'Audubon comme celle des autres, à une place très limitée. Qu'importe que John James eût la détestable habitude de priser ! Et peut-on lui en vouloir d'avoir bu des grogs, surtout dans les mauvais moments de sa vie, quand il voyait mourir une de ses belles-filles par exemple ? On ne sait pas d'ailleurs exactement ce qu'il appelait grog, c'était un mélange de bourbon et d'eau, mais dans une proportion inconnue Il admirait sa chevelure, qu'il entretenait soigneusement avec de la graisse d'ours. Honnêtement, graisse d'ours en moins, bien d'autres en font autant, soignent leur image, leur habillement, disent des gros mots dans l'intimité, sont parfois de mauvaise humeur, ou d'un optimisme exubérant. D'autres que lui construisent des châteaux en Espagne, sont un peu cyclothymes, naïfs ou même enfantins dans leurs relations conjugales, négligents dans les affaires ordinaires de la vie, portés à célébrer en paroles la beauté féminine, mauvais plaisantins au cours de leur jeunesse, imprécis dans leurs souvenirs, prompts à la riposte lorsqu'on les agresse à coup de gourdin, comme cela arriva un jour à John James.
Au lieu de reprocher à Audubon le papier sur "la belle inconnue", Madame André, j'ai voulu y voir une de ses premières tentatives d'écriture et j'ai considéré qu'il importait peu qu'il ait puisé dans la réalité ou, si cela avait été le cas, dans une demi-fiction. Longtemps après l'achèvement de mon livre, me trouvant à Chicago, j'ai visité le Field Museum. Là, dans la réserve des documents exceptionnels et anciens, j'ai pu voir le Journal 1826 de John James, l'un de ses rares journaux intimes n'ayant pas disparu. C'est un gros volume, qu'il appelait un ledger, entièrement couvert, sans marges, d'une écriture fine, dense et rapide. J'ai pu y lire des textes que je connaissais par leurs rééditions modernes, mais la présence du document original était émouvante pour moi. Surtout, je voyais traduit physiquement, en quelque sorte, ce que j'avais deviné ou pressenti, ce besoin d'écrire d'Audubon, avec tout ce qu'il implique de longs moments de solitude, de retour sur soi-même, de réflexion et de recueillement. J'avais eu raison d'insister sur cette maturation intellectuelle, psychologique, morale conduisant Audubon à écrire, de chercher la source de cette maturation jusque dans l'histoire d'une femme voulant son portrait nue, et de faire bon compte de ce que j'appelle les petitesses de la vie. Chateaubriand disait que, s'il avait eu un talent pour la satire et la caricature, il aurait cherché à l'étouffer. "Tout ce qui fait grimacer la nature de l'homme", ajoutait-il, "me semble peu digne d'estime." (Itinéraires, III e Partie). Ce sentiment est aussi le mien.
Audubon fut un artiste et un naturaliste, beaucoup plus qu'un écrivain. Il avait une philosophie de la vie et fit l'expérience exceptionnelle de passer la plus grande part de son existence à chercher, comprendre, représenter, faire connaître autour de lui ce qu'il appelait les beautés de la Création. Pour cela, il mérite le respect. Les autres personnages aussi doivent être respectés, et quand j'ai eu à parler de George Ord, l'impitoyable adversaire d'Audubon, j'ai préféré chercher les causes de son comportement dans le domaine des raisons scientifiques plutôt que dans les noirceurs d'une âme machiavélique. Quant à l'expérience unique vécue par Audubon, il faut essayer de la revivre. Je lui ai laissé la parole, par des citations, dans toute la mesure compatible avec une biographie. Nous devons faire l'effort de comprendre ce qu'il avait à dire et à montrer, et même l'effort d'aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qui s'exprime difficilement, une sympathie intime, une sorte de symbiose établie entre l'Homme et la Nature, le Cosmos, la Création. Et surtout entre nous et les oiseaux ! Les petitesses de la vie humaine, les névroses, les psychoses, les mauvaises habitudes, les incompréhensions, les réactions déplacées, les complexes sans trop de gravité sont loin de tout cela. Et tant pis pour les vieilles lunes de la psycho-critique !
Qu'est-ce qu'un autodidacte ? Audubon revisité
Remerciements
Le présent document a bénéficié de communications personnelles de Linda Dugan Partridge et de la lecture de son PhD (réf. ci-dessous). Les remarques sur le dessin de l'hirondelle pourprée sont les siennes. C'est avec plaisir que je lui adresse mes vifs remerciements.
Faut-il reprendre une fois de plus l'analyse d'un personnage comme Audubon, alors qu'on pourrait penser tout savoir de cet artiste naturaliste célèbre dont les uvres ont envahi le marché de l'art ? Les gravures originales de The Birds of America (1) se vendent à haut prix dans les galeries spécialisées, ou lors de retentissantes ventes aux enchères dont Christie's s'est fait une spécialité. Quant à leurs reproductions (18), il en existe sur les supports les plus variés et pour tous les prix, en Amérique surtout mais aussi en France : fac-similés de luxe, livres d'images, posters de tous formats, cartes postales, agendas, vignettes. Des timbres postaux reproduisant ses oiseaux ont été émis par une bonne trentaine de pays.
Né à Saint-Domingue en 1785 d'amours illégitimes, mais de pure souche française, élevé dans la région nantaise, le jeune Jean Jacques Audubon a quitté la France pour fuir les guerres napoléoniennes en 1803. Naturalisé américain sous les prénoms de John James, il a passé une grande partie de son âge adulte dans l'obscurité, occupé à une vie d'aventures à la "frontière" des Etats-Unis d'alors. Déprécié dans son pays d'adoption, et ayant largement passé la quarantaine, il partit pour l'Angleterre en 1826 et c'est là qu'il commença à se faire connaître. Deux ans après ce retour dans l'Ancien Monde, il se présentait à Paris avec les premières épreuves de The Birds of America dans son portfolio. Il cherchait à obtenir des souscriptions et s'en alla bientôt, déçu par le peu de succès obtenu, malgré le soutien apporté par deux personnalités influentes, George Cuvier (paléontologue fondateur de l'anatomie comparée) et Pierre-Joseph Redouté (peintre de fleurs). En fait, son "grand uvre" n'en était qu'au début. Cinquante gravures seulement étaient prêtes, aucun texte d'accompagnement n'avait encore été écrit. Une douzaine d'années plus tard, avec les quatre cent trente cinq gravures des Birds of America (1) et quelques mille pages de texte imprimées sous le titre de Ornithological Biography (2), son travail sur les oiseaux était achevé (8, 19).
La célébrité lui était largement acquise en Grande-Bretagne et en Amérique, et bientôt, effaçant l'échec précédent, on allait parler de lui en France aussi. Dans son Cours familier de littérature de 1865, notre grand poète romantique, Alphonse de Lamartine (15), entreprit de chanter très haut ses louanges. "Audubon est le Buffon de l'Amérique," affirmait-il, "mais infiniment plus naïf, plus coloré et plus écrivain que Buffon lui-même." Peu avare de comparaison, Lamartine ne craignit pas d'ajouter : "Quand il quitte l'homme pour décrire et colorier l'oiseau, Audubon surpasse Chateaubriand dans Atala, ce poëte qui ne fut que le précurseur du naturaliste dans les forêts de l'Amérique et qui introduisit cependant une note nouvelle dans la gamme de la poésie en France." Artiste de génie certainement, très grand ornithologue aussi, c'est ce que la postérité retiendra d'Audubon, mais le placer au-dessus de Buffon et de Chateaubriand comme écrivain était sans doute pousser l'éloge un peu loin.
En réalité, Lamartine reprenait en les amplifiant les propos et jugements de son confrère en littérature, Philarète Chasles. Trop oublié de nos jours, Chasles a été un grand chroniqueur de la vie littéraire et artistique du dix-neuvième siècle que l'on peut comparer à Sainte-Beuve, beaucoup plus connu que lui. Mais contrairement à Sainte-Beuve cantonné dans les cénacles parisiens, Philarète était polyglotte, voyageait volontiers, et se fit une spécialité des auteurs allemands, anglais et américains. Il enseigna la littérature comparée au Collège de France et fut un candidat malheureux à l'Académie française. Auteur prolifique et trop pressé, il publia notamment sur les Etats-Unis un livre de notes de voyage médiocre. Plus intéressant pour nous, un séjour en Grande Bretagne lui avait fait découvrir Audubon. Sans doute ne le rencontra-t-il pas personnellement, comme il voulut le laisser croire, mais il entendit parler de lui, et se documenta suffisamment pour présenter ensuite Audubon dans le milieu français.
"Si vous avez visité les salons anglais vers 1832, vous aurez remarqué au milieu de cette foule philosophique un homme bien différent de ceux qui l'environnaient. Le costume européen, mesquin et ridicule, ne pouvait déguiser entièrement cette dignité simple et presque sauvage, dont le génie prend le caractère au sein de la solitude ". Philarète Chasles pratiquait un langage lyrique et ampoulé, mais sa description d'Audubon est bien conforme à ce que nous savons du personnage. "Il a quitté son nom et se nomme lui-même'l'homme des bois d'Amérique' ; c'est le seul titre qui lui convienne", continuait Philarète Chasles. "Ces solitudes ont été son cabinet de travail. Ces grands déserts peuplés d'animaux sauvages, il les a parcourus dans tous les sens. Il y a respiré, avec l'air chargé des émanations de la végétation primitive, ce respect de la dignité, cette conscience de l'énergie humaine qui ne l'ont jamais quitté" (7).
On comprend l'enthousiasme de Philarète Chasles et de Lamartine, dignes héritiers de la pensée rousseauiste, devant ce caractère de "bon sauvage" à la peau blanche. Audubon se présentait et se voyait sincèrement en American Woodsman, il s'habillait volontiers d'une veste en peau de loup et, dit-on, enduisait de graisse d'ours ses cheveux flottant sur les épaules. Etonnante métamorphose, c'est le même Audubon qui faisait étalage des distinctions dont les milieux académiques le couvraient. En première page de son Ornithological Biography (2), il affichait être "Fellow of the Royal Society", consécration majeure de la vie intellectuelle anglaise, ajoutait quelques autres sociétés savantes auxquelles il appartenait également, et terminait par un éloquent "&c., &c., &c., &c., &c." Il est vrai qu'au début des années 1830 la majorité des associations, sociétés, institutions britanniques et américaines ayant un intérêt pour les sciences de la nature ou pour l'art, se faisaient un honneur de l'adopter comme membre. Quand Rousseau lui-même ne voyait son homme de la nature et bon sauvage que comme une abstraction, quelle pouvait être la cohérence de ce nouveau et bien réel Janus, comment concilier chez Audubon deux caractères aussi antinomiques que l'homme des bois et l'homo academicus ?
"Oh Lucy ! Que n'ai-je reçu moi aussi une éducation universitaire !" Ce cri de désarroi était réservé à son épouse, mais nous savons aussi que, dans la réalité de son comportement ordinaire, il avait conscience d'être "un homme qui n'a jamais mis les yeux dans une grammaire qui s'est senti toujours très timide et mal à l'aise en présence d'un étranger." Devait-il lire à un homme de science pourtant son ami une de ses descriptions ornithologiques, le "pauvre Audubon", comme il se désignait lui-même, sentait une "sueur froide" lui couler dans le dos. Mieux valait pour lui, disait-il, traverser sans chemise une nuée de moustiques en Floride que passer une journée à son écritoire. A d'autres moments, ou pour d'autres locuteurs, le Janus-Audubon changeait d'humeur, prenait sa revanche et se lançait dans des rodomontades verbales. "Puisque Napoléon est sorti du rang, pourquoi Audubon ne pourrait-il pas quitter un moment les bois d'Amérique pour publier et vendre un livre ?" La célébrité et les honneurs une fois venus, il avait pris plus d'assurance, tout en répétant que sa véritable place était "dans les bois", où il menaçait sans cesse de retourner lorsque ses affaires allaient mal, par la faute de son graveur, des clients mauvais payeurs, ou des dénigrements que la jalousie de ses rivaux lui valaient (3, 8, 13).
Comment se produisirent les métamorphoses du personnage ? Pour la majorité de ses biographes, l'affaire est vite entendue : Audubon est un personnage admirable mais relativement simple d'"autodidacte", doté au plus d'une petite formation de départ, acquise en France avant son départ pour l'Amérique, c'est-à-dire avant ses dix-huit ans. C'est probablement ainsi qu'il se concevait plus tard, prétendant sortir des bois d'Amérique mais disant avoir étudié "dans sa jeunesse avec de bons maîtres", et ajoutant même, pour se donner des références, que David, le grand Jacques Louis David dont l'atelier était un lieu de formation réputé, "avait guidé sa main".
Cette vision du Janus-Audubon a beaucoup changé depuis quelques années. Le Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle (9) a découvert, entre 2002 et 2003, une collection de dessins qui se révélèrent les plus anciennes de ses uvres de jeunesse connues, datant de la période 1803 à 1806. Dans cette collection ont été trouvés des dessins d'animaux, oiseaux et petits mammifères, représentés morts et suspendus par le bec ou par une patte : ce sont les plus singuliers, les plus inattendus. Dans ses écrits, Audubon indiquait avoir fait ce type de dessin, mais il semblait n'en rien rester. Les recherches se sont trouvées relancées par cette découverte. En France encore, Jean-Yves Noblet (16) a développé l'étude du milieu éduqué ayant environné le jeune Audubon, et surtout la place qu'y prenait un naturaliste, le Docteur Charles-Marie Dessalines d'Orbigny, cet homme "selon mon cur", disait Audubon. Un document d'archive enfin retrouvé a permis à Pierre Watelet (9) d'affirmer qu'Audubon avait été initié à l'ornithologie par François-René Dubuisson, le fondateur du Muséum de Nantes. Enfin, les dessins trouvés à La Rochelle, examinés par Thierry Lefrançois (9), ont clairement montré que le futur Woodsman avait été formé à la technique française du dessin "aux trois crayons" (pierre noire, sanguine, craie blanche), une technique de travail sobre et difficile.
Avant ces découvertes récentes, un travail universitaire américain avait déjà largement entrepris de réviser la vision simpliste de l'autodidacte ayant tout découvert ou inventé par lui-même "dans les bois". Actuellement professeur d'histoire de l'art à la Marywood University, en Pennsylvanie, Linda Dugan Partridge (17) a considéré la période 1805-1826 de la vie américaine d'Audubon. Elle a analysé tous les portraits, visages d'hommes et de femmes, réalisés par lui à titre de gagne-pain dans les moments difficiles et conservés jusqu'à aujourd'hui, et près de deux cents dessins d'oiseaux, uvres précoces et non utilisées pour The Birds of America, se trouvant dans des institutions publiques. Ses investigations se sont étendues aux aspects les plus mineurs des documents considérés, annotations manuscrites, vues de détail de becs et plumes d'oiseaux, esquisses paysagiques et marines servant d'arrière-plan. Dépouillant les textes d'Audubon, ses journaux personnels et ses publications, elle fait apparaître les noms de tous les ouvrages de sciences naturelles qu'il a pu consulter, ceux de Buffon et d'Alexander Wilson (le père de l'ornithologie américaine, 1766-1813) étant les plus importants mais non les seuls. Plus impressionnant encore, apparaît le grand nombre de rencontres personnelles faites par Audubon. Bien que simple amateur à l'époque, il a connu la plupart des hommes de science et artistes vivant alors en Pennsylvanie, au Kentucky, en Louisiane. Il a visité des expositions, des ateliers, il a vu des tableaux et de gravures, il a pu consulter de nombreux livres, et s'inspirer du tout. C'est une longue litanie que constitue la liste des noms de tous les personnages ayant pu ainsi influencer Audubon, avant même qu'il ne vienne en Grande-Bretagne finaliser son travail.
Linda B. Partridge conclut que, loin d'être un épiphénomène surgi de nulle part, "Audubon était entièrement un homme de son temps. Son art assimile la tradition ornithologique, de même que les modes et attitudes de la science et de l'art contemporains." Pour être juste, elle convient que "reconnaître l'importance de ses dettes ne diminue en rien l'importance de son uvre". Néanmoins c'est vers une sérieuse remise en cause du personnage tel qu'il a été compris jusqu'à présent que convergent les études françaises évoquées plus haut et celles de L.B. Partridge.
Qu'en penser, quel recul est-il souhaitable de prendre ? Le problème posé par Audubon dépasse l'anecdote et il serait facile d'en faire une étude de cas relevant de la psycho-sociologie de la connaissance et de la culture. On songe à Pierre Bourdieux (5, 6), à sa notion d'habitus, entendue comme la matrice des perceptions, des jugements et des actions qui est propre à chaque catégorie sociale Sans verser dans la théorie, on conçoit qu'un autodidacte ou un self-made man puisse difficilement sortir de cet habitus qui est un peu une prison, afin de trouve le savoir-faire, la liberté, l'audace nécessaires pour passer dans les hautes sphères de la culture et de l'art, ce que fit pourtant notre American Woodsman. Cette remarque semble triviale. Cependant il serait difficile de bien appréhender l'histoire d'Audubon dans sa singularité comme dans sa portée théorique, si l'on ne prenait pas une juste mesure du jeu complexe de contradictions et de tensions psychologiques et sociales, mais aussi culturelles, d'où il a dû émerger.
Il y eut tout d'abord le problème de sa naissance illégitime, en conflit avec son désir de respectabilité, et qui mit Audubon dans une situation de confusion, d'oublis plus ou moins sincères, de demi-mensonges, comportement dans lequel certains ont vu une tendance à la mythomanie. En effet, il s'attribuait des lieux de naissance variables et finit par se persuader lui-même que sa date de naissance "restait une énigme". Le destin voulut aussi qu'il tombe dans une faillite commerciale jugée déshonorante, bien qu'en partie due à la crise économique de 1819, qu'il perde l'estime de beaucoup de ses proches et, en réaction, s'accroche avec une volonté farouche à une nouvelle réussite, artistique et scientifique sans doute mais aussi monétaire. Pour ce faire, il dut enfin, c'était le plus difficile pour lui et le plus important, s'arracher à son habitus de simple ornithologue, dessinateur amateur et à demi homme des bois, pour combler les insuffisances de sa formation et se faire admettre dans le monde savant. Bâtard ayant à se construire une identité, paria en quête de réussite sociale, ignorant se voulant homo academicus, voilà les trois grandes métamorphoses, les trois ruptures, de sa vie.
Revenons à l'évolution de son art, avec comme exemples des dessins dont on peut trouver des reproductions dans des publications récentes. Les plus anciens que l'on connaisse sont ceux qui correspondent au premier séjour d'Audubon en Pennsylvanie, à Mill Grove, entre 1803 et 1805. A cette époque et en ce lieu, il était entièrement livré à lui-même et il se mit à dessiner avec les "trois crayons", la mine de plomb et le pastel en plus, des oiseaux ou petits mammifères représentés morts, suspendus à un fil ou fixés par une épingle. Ce sont les plus belles réussites de ses années de jeunesse. Il n'avait pas à donner à ses figures les apparences de la vie, il avait la liberté de tourner les animaux dans un sens ou l'autre pour choisir le meilleur aperçu, pour montrer les ailes des oiseaux ouvertes, les pattes déployées, donnant ainsi très naturellement un rythme, une structure originale à sa composition. Ainsi trouve-t-on parmi les dessins de La Rochelle (9) des écureuils et un lapin d'une admirable finesse. Dans leur simplicité, ils atteignent la perfection. Plus nombreux, et bien que certains paraissent plus hâtivement réalisés, les dessins d'oiseaux sont aussi de très belles réussites. Il y a de superbes canards, harles bièvres ou petits garrots qui offrent à l'artiste des volumes et coloris variés, et aussi de beaux geais, coucous, oiseaux moqueurs, pics, etc. Un dessin comme celui représentant une hirondelle pourprée retient l'attention par ce que l'on peut appeler sa modernité. Audubon a fait ressortir le contraste du plumage des ailes, du ventre et du cou tout en travaillant selon une texture fine et dans une gamme chromatique étroite, du gris au brun presque noir. Le plus remarquable est que l'hirondelle définit un espace asymétrique affirmé, la trouée faite entre l'aile déployée et la queue est occupée par une patte dont les fines membrures s'opposent au corps massif, pointes des ailes et bec s'organisent en triangles, les échancrures en forme de V se dupliquent à trois reprises. Cet ensemble géométrique épuré semble exprimer une tendance (certainement involontaire) vers une stylisation abstraite.
L'épisode de Mill Grove prit fin parce qu'Audubon, pour des raisons familiales, revint en France en 1805-1806. Il ne devait jamais reprendre par la suite la technique des oiseaux suspendus. Il est probable que c'est le Docteur d'Orbigny qui lui fit adopter ce que Linda D. Partridge appelle la "tradition ornithologique" : des oiseaux vus debout, de profil, les pattes verticales posées au sol ou accrochées en oblique à un perchoir, les ailes fermées, prétendant aux apparences de la vie mais en réalité, raides, artificiels, et ressemblant à des spécimens empaillés. Les ornithologues examinant de tels dessins devaient y trouver les critères d'identification et de comparaison qui leur étaient nécessaires. Toujours est-il que, pendant cette année passée sous la coupe de son mentor, Audubon réalisa une importante série d'oiseaux de la région nantaise. Contrairement à ceux de Mill Grove, ces dessins sont connus depuis longtemps : il s'en trouve à La Rochelle et à Harvard (Houghton Library). Prisonnier des conventions ornithologiques, Audubon montre dans ces uvres son habileté de dessinateur et de coloriste. Un dessin comme celui de l'avocette a souvent été reproduit (9, 14), car l'oiseau surprend par son bec recourbé, son il vif, son plumage blanc et noir. D'autres, comme celui du gros-bec casse noyaux ou du pic épeiche (9), attirent plutôt par leurs coloris vifs et variés. Néanmoins, ils n'ont pas l'originalité et la saveur de ceux réalisés auparavant, lorsque personne ne guidait le jeune artiste.
Au cours des années qui suivirent, revenu définitivement en Amérique, Audubon poursuivit son travail d'amateur en restant dans la lignée de la "tradition ornithologique". Daté de 1809, son dessin du pigeon migrateur (12) en est un bel exemple. L'ensemble, encore un peu raide, aux contours précis tracés à la mine de plomb et à l'encre, paraît simple et naïf, mais l'oiseau posé sur une branche grossière impose sa présence. Son il attire. Audubon s'est appliqué surtout aux couleurs, utilisant largement le pastel qui permet des tons plus vifs et variés que la sanguine. A d'autres occasions épisodiques, au lieu d'une simple branche servant de perchoir, il s'est lancé dans une composition associant oiseaux et végétaux. C'est le cas pour le superbe portrait du cardinal huppé trouvé à la Rochelle (9). Un autre exemple que nous pouvons donner est celui du carouge à épaulettes (14), qu'il appelle "Le Commandeur" comme le faisait Buffon, et qui est daté de 1810. La composition d'Audubon joue sur l'opposition de l'oiseau, au plumage noir et rouge, et de la plante qu'il a représentée au pastel par des teintes claires et peu intenses. Le sens du mouvement se traduit dans le choix fait par l'artiste d'une inclinaison de la plante, en oblique par rapport à l'oiseau qui semble plonger vers le bas et se trouve montré, pour une fois, de dos.
Dans cette longue période que nous venons de considérer et qui s'étend de 1803 à 1820, les dessins d'Audubon ont suivi une évolution certaine mais lente et irrégulière. Les données collectées et analysées par Linda Partridge (17) montrent chez lui une démarche empirique, presque hésitante. Les changements dans les annotations, les signatures des dessins, les poses données aux oiseaux, les nouveautés comme celles consistant à mettre deux oiseaux sur le même dessin, ou à représenter un oiseau aux ailes déployées, ou un oiseau en vol, l'usage de matériaux nouveaux pour lui comme fusain, pastel, aquarelle, gouache, apparaissent, puis disparaissent, pour n'être repris parfois que longtemps après une première tentative.
La véritable rupture dans le travail d'Audubon se produisit lorsqu'il eut décidé de se consacrer entièrement à son art et qu'il entreprit sa descente fameuse du Mississippi sur un flat boat, passager désargenté aux allures de vagabond, vers la Louisiane et sa nature subtropicale, riche en espèces, à l'automne 1820. Dès ce moment, il devait faire mieux que ses dessins antérieurs, et surtout que ceux de son rival disparu, Alexander Wilson. Il avait progressé auparavant, d'un essai provisoirement oublié à l'autre, mais diversifiant ses compositions, passant de l'usage des "trois crayons" à une "technique mixte" associant le pastel, puis l'aquarelle, la gouache, l'huile et autres matériaux. Il avait atteint une maîtrise qui pouvait pleinement s'exprimer sous de multiples formes, et ceci dès les premières compositions de son séjour louisianais dont beaucoup de planches de The Birds of America sont issues. Il avait désormais le savoir-faire nécessaire, il ne lui restait plus qu'à appliquer ses principes généraux, montrer des oiseaux en taille naturelle, dans des scènes conformes à leur comportement et leur environnement. La période de gestation était finie, et lorsqu'Audubon put s'assurer de la collaboration d'un graveur et du soutien d'une clientèle, le chef-d'uvre (4, 8, 19) allait se développer sans coup férir.
Mais à trop se focaliser sur un unique personnage qui gardera toujours ses non-dits ou ses mystères, on risque de s'égarer, et nous allons reprendre le thème de l'autodidacte en considérant un autre cas. Edward Hicks (1780-1849) est, à peu d'années près, l'exact contemporain d'Audubon (1785-1851). Né en Pennsylvanie, élevé par des Quakers, il n'a probablement mis lui aussi les yeux dans une grammaire que très rarement. Il eut, comme Audubon, une jeunesse insouciante, sinon dissipée, et commença sa carrière d'artiste en peignant des enseignes, des meubles, des manteaux de cheminées, des intérieurs de carrioles ou de diligences. Sa vie d'adulte fut partagée entre la religion, car il devint un prêcheur réputé dans la Society of Friends, et la peinture sur toile. Les sujets de ses tableaux restèrent très limités : on y trouve les inévitables chutes du Niagara, quelques vues rurales, des scènes historiques en petit nombre. Le principal de son uvre est ailleurs. Hicks s'est inlassablement inspiré d'un court passage de la Bible prophétisant le retour de la paix sur terre : "Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble le pays sera rempli de la connaissance de Yavhé." (Isaïe, 42, 11, 6-9, Bible de Jérusalem). Une soixantaine de variantes furent peintes par lui sur ce thème biblique et reçurent toutes le même titre : The Peaceable Kingdom. Il y montre les animaux cessant de s'entredévorer, vivant ensemble et avec de jeunes enfants sans défense, et aussi les hommes réconciliés, ce qu'il aimait illustrer par une évocation du traité de paix historique passés entre William Penn et les Indiens (sur la gauche, sur la toile de la National Gallery of Art, Washington, D.C.). Pour peindre ses personnages, animaux et humains, Hicks s'inspirait d'illustrations trouvées dans des livres, surtout la Bible, et aussi de tableaux et de gravures de grands maîtres, comme Vanderlyn (l'ami d'Audubon) et Benjamin West (l'Américain devenu président de la Royal Academy britannique). Hicks lisait des poèmes, des essais politiques, et n'était donc pas sans une certaine culture acquise à l'âge adulte (11). En tant qu'artiste, pourtant, il n'est pas difficile à classer : c'est un parfait naïf, autant par la technique que par l'inspiration.
"L'autodidacte ne sait rien dont il n'ait eu envie ou besoin", disait Paul Valéry (20). Cette remarque nous réintroduit dans la problématique initiée en référence à Pierre Bourdieu. Dans le cas d'Edward Hicks, nous voyons un autodidacte qui a trouvé une porte d'entrée à la culture et à une certaine notoriété sociale (surtout posthume dans son cas) mais n'est jamais vraiment sorti d'un habitus étroit, ni par l'imagination, ni par la pratique de son art. Il est resté totalement enfermé dans une sorte de méditation mystique sur la promesse d'un nouvel âge d'or et s'est toujours satisfait d'un style naïf, sinon assez enfantin (ce qui n'exclut pas la beauté). Avec Audubon, c'est l'attitude opposée conduite à l'extrême. Il a voulu apprendre, et ne s'en est pas privé, en regardant autour de lui, au hasard de ses rencontres. Pourtant lui aussi reste un autodidacte, en ce sens qu'il n'a jamais fait de long apprentissage, ni dans une institution éducative, ni dans l'atelier d'un quelconque maître de la peinture. Ce n'est que de très loin que sa main fut guidée par David, et passer quelques heures, voir quelques jours dans les ateliers de peintres américains comme John Vanderlyn, John W. Jarvis ou Thomas Sully qui, sauf le premier, étaient exclusivement des portraitistes (10), ne donne pas une véritable formation. Ses acquis se firent au gré d'occasions fugaces et surtout de ses envies ou de ses besoins. Ses "modestes talents" firent le reste.
Qu'est-ce donc qu'un autodidacte ? Entre les extrêmes que sont Hicks et Audubon, il en existe toute une gamme, assurément. Chacun fait son chemin, court ou long, uvrant dans ce que nous appellerons une "stratégie de liberté", c'est-à-dire prenant autour de lui ce qui lui convient, le reste n'ayant pas d'importance ou étant inaccessible, comme l'a si bien dit en quelques mots Paul Valéry. Si ses aptitudes personnelles et son ambition sont grandes, l'autodidacte voudra devenir aussi bon ou meilleur que ceux dont la valeur est reconnue et à qui il veut ressembler. Dans une autre classe sociale et culturelle se trouve l'homo academicus, formé dans une tradition de savoirs ou de goûts établis, confiant en lui-même. Pour montrer son génie et passer à la postérité, il suivra une autre stratégie que celle de l'autodidacte. Il tentera consciemment et volontairement de dépasser radicalement ses acquis, de se démarquer de ses anciens maîtres par la différence, la nouveauté à tout prix, il voudra créer un changement de style, d'école, de paradigme. Nous dirons qu'il se placera dans une "stratégie de rupture". L'histoire des sciences nous a donné mille exemples de sauts épistémologiques, changements de paradigmes ou révolutions scientifiques, selon la terminologie que l'on veut adopter. On en trouve l'équivalent dans l'histoire de l'art.
Lamartine voyait Audubon comme un homme de la Nature. D'autres exégètes l'ont décrit comme un pur autodidacte, ou comme un homme de son époque, ou comme un novateur en rupture avec son temps. Ayant considéré le long cheminement qui fut le sien, il semble que son cas transcende toutes les catégories. Ne serait-ce pas, simplement dit, une marque du génie ?
Bibliographie sélective
(1) Audubon, John James - "The Birds of America", London : Havel edition, 1827-1838.
(2) - "Ornithological Biography, or an Account of the Habits of the Birds ", Edinburgh : Adam Black, 1831-1839.
(3) Audubon, Maria Rebecca - "Audubon and his Journals", New York : Scribner, 1897, reprint New York : Dover, 1986, 2 vol.
(4) Blaugrund, Annette & Theodore E. Stebbins (éd.), "John James Audubon - The Watercolors for The Birds of America", Villard Books, Random House & The New York Historical Society, 1993.
(5) Bourdieu, Pierre - "La Distinction. Critique sociale du jugement", Paris : Ed de Minuit, 1970.
(6) - "Homo Academicus", Paris : Ed. de Minuit, 1984.
(7) Chasles, Philarète - "Etudes sur la littérature et les murs des Anglo-Américains au XIXe siècle", Paris : Amyot, 1851.
(8) Chatelin, Yvon - "Audubon - Peintre, Naturaliste, Aventurier", Paris : Ed. France Empire, 2001.
(9) -, Ben Forkner, Michèle Dunand, Thierry Lefrançois, Pierre Watelet - "Jean Jacques Audubon - Peintre, Naturaliste, Aventurier", Nantes : Revue 303 : Arts, Recherches et Créations, tiré à part du n° 82, 2003.
(10) Dunlap, William - "History of the Rise and Progress of the Arts of Design in the United States", Philadelphia: 1834, reprint New York : Dover, 1969.
(11) Ford, Alice - "Edward Hicks, Painter of the Peaceable Kingdom", University of Pennsylvania Press, 1952.
(12) - "The Bird Biographies of John James Audubon ", New York: The MacMillan Company, 1957.
(13) Forkner, Ben (éd.) - "John James Audubon - Journaux et récits", Nantes : L'Atalante, 1992, 2 vol.
(14) Foshay, Ella M. - "John James Audubon", New York : Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1997.
(15) Lamartine, Alphonse de - "Cours familier de littérature. CXVIIe & CVIIIe entretiens", Paris : Firmin Didot, 1865.
(16) Noblet, Jean-Yves - "Charles-Marie Dessalines d'Orbigny", Bulletin de l'Association Couëron-Audubon-Atlantique, n° 10, 2002.
(17) Partridge, Linda Dugan - "From Nature : John James Audubon's Drawings and Watercolors, 1805-1826", PhD, University of Delaware, 1992.
(18) Peterson, Roger Tory & Virginia Marie Peterson (éd.) - "J. J. Audubon - Le grand livre des oiseaux", éd. française, Paris : Citadelles-Mazenot, 1986.
(19) Rhodes, Richard - "John James Audubon - The Making of an American", New York: Alfred A. Knopf, 2004.
(20) Valéry, Paul - "Cahiers. Tome II", Paris : Bibliothèque de la Pléiade n° 254, Gallimard, 1974.
Lire plus
Le présent document a bénéficié de communications personnelles de Linda Dugan Partridge et de la lecture de son PhD (réf. ci-dessous). Les remarques sur le dessin de l'hirondelle pourprée sont les siennes. C'est avec plaisir que je lui adresse mes vifs remerciements.
Faut-il reprendre une fois de plus l'analyse d'un personnage comme Audubon, alors qu'on pourrait penser tout savoir de cet artiste naturaliste célèbre dont les uvres ont envahi le marché de l'art ? Les gravures originales de The Birds of America (1) se vendent à haut prix dans les galeries spécialisées, ou lors de retentissantes ventes aux enchères dont Christie's s'est fait une spécialité. Quant à leurs reproductions (18), il en existe sur les supports les plus variés et pour tous les prix, en Amérique surtout mais aussi en France : fac-similés de luxe, livres d'images, posters de tous formats, cartes postales, agendas, vignettes. Des timbres postaux reproduisant ses oiseaux ont été émis par une bonne trentaine de pays.
Né à Saint-Domingue en 1785 d'amours illégitimes, mais de pure souche française, élevé dans la région nantaise, le jeune Jean Jacques Audubon a quitté la France pour fuir les guerres napoléoniennes en 1803. Naturalisé américain sous les prénoms de John James, il a passé une grande partie de son âge adulte dans l'obscurité, occupé à une vie d'aventures à la "frontière" des Etats-Unis d'alors. Déprécié dans son pays d'adoption, et ayant largement passé la quarantaine, il partit pour l'Angleterre en 1826 et c'est là qu'il commença à se faire connaître. Deux ans après ce retour dans l'Ancien Monde, il se présentait à Paris avec les premières épreuves de The Birds of America dans son portfolio. Il cherchait à obtenir des souscriptions et s'en alla bientôt, déçu par le peu de succès obtenu, malgré le soutien apporté par deux personnalités influentes, George Cuvier (paléontologue fondateur de l'anatomie comparée) et Pierre-Joseph Redouté (peintre de fleurs). En fait, son "grand uvre" n'en était qu'au début. Cinquante gravures seulement étaient prêtes, aucun texte d'accompagnement n'avait encore été écrit. Une douzaine d'années plus tard, avec les quatre cent trente cinq gravures des Birds of America (1) et quelques mille pages de texte imprimées sous le titre de Ornithological Biography (2), son travail sur les oiseaux était achevé (8, 19).
La célébrité lui était largement acquise en Grande-Bretagne et en Amérique, et bientôt, effaçant l'échec précédent, on allait parler de lui en France aussi. Dans son Cours familier de littérature de 1865, notre grand poète romantique, Alphonse de Lamartine (15), entreprit de chanter très haut ses louanges. "Audubon est le Buffon de l'Amérique," affirmait-il, "mais infiniment plus naïf, plus coloré et plus écrivain que Buffon lui-même." Peu avare de comparaison, Lamartine ne craignit pas d'ajouter : "Quand il quitte l'homme pour décrire et colorier l'oiseau, Audubon surpasse Chateaubriand dans Atala, ce poëte qui ne fut que le précurseur du naturaliste dans les forêts de l'Amérique et qui introduisit cependant une note nouvelle dans la gamme de la poésie en France." Artiste de génie certainement, très grand ornithologue aussi, c'est ce que la postérité retiendra d'Audubon, mais le placer au-dessus de Buffon et de Chateaubriand comme écrivain était sans doute pousser l'éloge un peu loin.
En réalité, Lamartine reprenait en les amplifiant les propos et jugements de son confrère en littérature, Philarète Chasles. Trop oublié de nos jours, Chasles a été un grand chroniqueur de la vie littéraire et artistique du dix-neuvième siècle que l'on peut comparer à Sainte-Beuve, beaucoup plus connu que lui. Mais contrairement à Sainte-Beuve cantonné dans les cénacles parisiens, Philarète était polyglotte, voyageait volontiers, et se fit une spécialité des auteurs allemands, anglais et américains. Il enseigna la littérature comparée au Collège de France et fut un candidat malheureux à l'Académie française. Auteur prolifique et trop pressé, il publia notamment sur les Etats-Unis un livre de notes de voyage médiocre. Plus intéressant pour nous, un séjour en Grande Bretagne lui avait fait découvrir Audubon. Sans doute ne le rencontra-t-il pas personnellement, comme il voulut le laisser croire, mais il entendit parler de lui, et se documenta suffisamment pour présenter ensuite Audubon dans le milieu français.
"Si vous avez visité les salons anglais vers 1832, vous aurez remarqué au milieu de cette foule philosophique un homme bien différent de ceux qui l'environnaient. Le costume européen, mesquin et ridicule, ne pouvait déguiser entièrement cette dignité simple et presque sauvage, dont le génie prend le caractère au sein de la solitude ". Philarète Chasles pratiquait un langage lyrique et ampoulé, mais sa description d'Audubon est bien conforme à ce que nous savons du personnage. "Il a quitté son nom et se nomme lui-même'l'homme des bois d'Amérique' ; c'est le seul titre qui lui convienne", continuait Philarète Chasles. "Ces solitudes ont été son cabinet de travail. Ces grands déserts peuplés d'animaux sauvages, il les a parcourus dans tous les sens. Il y a respiré, avec l'air chargé des émanations de la végétation primitive, ce respect de la dignité, cette conscience de l'énergie humaine qui ne l'ont jamais quitté" (7).
On comprend l'enthousiasme de Philarète Chasles et de Lamartine, dignes héritiers de la pensée rousseauiste, devant ce caractère de "bon sauvage" à la peau blanche. Audubon se présentait et se voyait sincèrement en American Woodsman, il s'habillait volontiers d'une veste en peau de loup et, dit-on, enduisait de graisse d'ours ses cheveux flottant sur les épaules. Etonnante métamorphose, c'est le même Audubon qui faisait étalage des distinctions dont les milieux académiques le couvraient. En première page de son Ornithological Biography (2), il affichait être "Fellow of the Royal Society", consécration majeure de la vie intellectuelle anglaise, ajoutait quelques autres sociétés savantes auxquelles il appartenait également, et terminait par un éloquent "&c., &c., &c., &c., &c." Il est vrai qu'au début des années 1830 la majorité des associations, sociétés, institutions britanniques et américaines ayant un intérêt pour les sciences de la nature ou pour l'art, se faisaient un honneur de l'adopter comme membre. Quand Rousseau lui-même ne voyait son homme de la nature et bon sauvage que comme une abstraction, quelle pouvait être la cohérence de ce nouveau et bien réel Janus, comment concilier chez Audubon deux caractères aussi antinomiques que l'homme des bois et l'homo academicus ?
"Oh Lucy ! Que n'ai-je reçu moi aussi une éducation universitaire !" Ce cri de désarroi était réservé à son épouse, mais nous savons aussi que, dans la réalité de son comportement ordinaire, il avait conscience d'être "un homme qui n'a jamais mis les yeux dans une grammaire qui s'est senti toujours très timide et mal à l'aise en présence d'un étranger." Devait-il lire à un homme de science pourtant son ami une de ses descriptions ornithologiques, le "pauvre Audubon", comme il se désignait lui-même, sentait une "sueur froide" lui couler dans le dos. Mieux valait pour lui, disait-il, traverser sans chemise une nuée de moustiques en Floride que passer une journée à son écritoire. A d'autres moments, ou pour d'autres locuteurs, le Janus-Audubon changeait d'humeur, prenait sa revanche et se lançait dans des rodomontades verbales. "Puisque Napoléon est sorti du rang, pourquoi Audubon ne pourrait-il pas quitter un moment les bois d'Amérique pour publier et vendre un livre ?" La célébrité et les honneurs une fois venus, il avait pris plus d'assurance, tout en répétant que sa véritable place était "dans les bois", où il menaçait sans cesse de retourner lorsque ses affaires allaient mal, par la faute de son graveur, des clients mauvais payeurs, ou des dénigrements que la jalousie de ses rivaux lui valaient (3, 8, 13).
Comment se produisirent les métamorphoses du personnage ? Pour la majorité de ses biographes, l'affaire est vite entendue : Audubon est un personnage admirable mais relativement simple d'"autodidacte", doté au plus d'une petite formation de départ, acquise en France avant son départ pour l'Amérique, c'est-à-dire avant ses dix-huit ans. C'est probablement ainsi qu'il se concevait plus tard, prétendant sortir des bois d'Amérique mais disant avoir étudié "dans sa jeunesse avec de bons maîtres", et ajoutant même, pour se donner des références, que David, le grand Jacques Louis David dont l'atelier était un lieu de formation réputé, "avait guidé sa main".
Cette vision du Janus-Audubon a beaucoup changé depuis quelques années. Le Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle (9) a découvert, entre 2002 et 2003, une collection de dessins qui se révélèrent les plus anciennes de ses uvres de jeunesse connues, datant de la période 1803 à 1806. Dans cette collection ont été trouvés des dessins d'animaux, oiseaux et petits mammifères, représentés morts et suspendus par le bec ou par une patte : ce sont les plus singuliers, les plus inattendus. Dans ses écrits, Audubon indiquait avoir fait ce type de dessin, mais il semblait n'en rien rester. Les recherches se sont trouvées relancées par cette découverte. En France encore, Jean-Yves Noblet (16) a développé l'étude du milieu éduqué ayant environné le jeune Audubon, et surtout la place qu'y prenait un naturaliste, le Docteur Charles-Marie Dessalines d'Orbigny, cet homme "selon mon cur", disait Audubon. Un document d'archive enfin retrouvé a permis à Pierre Watelet (9) d'affirmer qu'Audubon avait été initié à l'ornithologie par François-René Dubuisson, le fondateur du Muséum de Nantes. Enfin, les dessins trouvés à La Rochelle, examinés par Thierry Lefrançois (9), ont clairement montré que le futur Woodsman avait été formé à la technique française du dessin "aux trois crayons" (pierre noire, sanguine, craie blanche), une technique de travail sobre et difficile.
Avant ces découvertes récentes, un travail universitaire américain avait déjà largement entrepris de réviser la vision simpliste de l'autodidacte ayant tout découvert ou inventé par lui-même "dans les bois". Actuellement professeur d'histoire de l'art à la Marywood University, en Pennsylvanie, Linda Dugan Partridge (17) a considéré la période 1805-1826 de la vie américaine d'Audubon. Elle a analysé tous les portraits, visages d'hommes et de femmes, réalisés par lui à titre de gagne-pain dans les moments difficiles et conservés jusqu'à aujourd'hui, et près de deux cents dessins d'oiseaux, uvres précoces et non utilisées pour The Birds of America, se trouvant dans des institutions publiques. Ses investigations se sont étendues aux aspects les plus mineurs des documents considérés, annotations manuscrites, vues de détail de becs et plumes d'oiseaux, esquisses paysagiques et marines servant d'arrière-plan. Dépouillant les textes d'Audubon, ses journaux personnels et ses publications, elle fait apparaître les noms de tous les ouvrages de sciences naturelles qu'il a pu consulter, ceux de Buffon et d'Alexander Wilson (le père de l'ornithologie américaine, 1766-1813) étant les plus importants mais non les seuls. Plus impressionnant encore, apparaît le grand nombre de rencontres personnelles faites par Audubon. Bien que simple amateur à l'époque, il a connu la plupart des hommes de science et artistes vivant alors en Pennsylvanie, au Kentucky, en Louisiane. Il a visité des expositions, des ateliers, il a vu des tableaux et de gravures, il a pu consulter de nombreux livres, et s'inspirer du tout. C'est une longue litanie que constitue la liste des noms de tous les personnages ayant pu ainsi influencer Audubon, avant même qu'il ne vienne en Grande-Bretagne finaliser son travail.
Linda B. Partridge conclut que, loin d'être un épiphénomène surgi de nulle part, "Audubon était entièrement un homme de son temps. Son art assimile la tradition ornithologique, de même que les modes et attitudes de la science et de l'art contemporains." Pour être juste, elle convient que "reconnaître l'importance de ses dettes ne diminue en rien l'importance de son uvre". Néanmoins c'est vers une sérieuse remise en cause du personnage tel qu'il a été compris jusqu'à présent que convergent les études françaises évoquées plus haut et celles de L.B. Partridge.
Qu'en penser, quel recul est-il souhaitable de prendre ? Le problème posé par Audubon dépasse l'anecdote et il serait facile d'en faire une étude de cas relevant de la psycho-sociologie de la connaissance et de la culture. On songe à Pierre Bourdieux (5, 6), à sa notion d'habitus, entendue comme la matrice des perceptions, des jugements et des actions qui est propre à chaque catégorie sociale Sans verser dans la théorie, on conçoit qu'un autodidacte ou un self-made man puisse difficilement sortir de cet habitus qui est un peu une prison, afin de trouve le savoir-faire, la liberté, l'audace nécessaires pour passer dans les hautes sphères de la culture et de l'art, ce que fit pourtant notre American Woodsman. Cette remarque semble triviale. Cependant il serait difficile de bien appréhender l'histoire d'Audubon dans sa singularité comme dans sa portée théorique, si l'on ne prenait pas une juste mesure du jeu complexe de contradictions et de tensions psychologiques et sociales, mais aussi culturelles, d'où il a dû émerger.
Il y eut tout d'abord le problème de sa naissance illégitime, en conflit avec son désir de respectabilité, et qui mit Audubon dans une situation de confusion, d'oublis plus ou moins sincères, de demi-mensonges, comportement dans lequel certains ont vu une tendance à la mythomanie. En effet, il s'attribuait des lieux de naissance variables et finit par se persuader lui-même que sa date de naissance "restait une énigme". Le destin voulut aussi qu'il tombe dans une faillite commerciale jugée déshonorante, bien qu'en partie due à la crise économique de 1819, qu'il perde l'estime de beaucoup de ses proches et, en réaction, s'accroche avec une volonté farouche à une nouvelle réussite, artistique et scientifique sans doute mais aussi monétaire. Pour ce faire, il dut enfin, c'était le plus difficile pour lui et le plus important, s'arracher à son habitus de simple ornithologue, dessinateur amateur et à demi homme des bois, pour combler les insuffisances de sa formation et se faire admettre dans le monde savant. Bâtard ayant à se construire une identité, paria en quête de réussite sociale, ignorant se voulant homo academicus, voilà les trois grandes métamorphoses, les trois ruptures, de sa vie.
Revenons à l'évolution de son art, avec comme exemples des dessins dont on peut trouver des reproductions dans des publications récentes. Les plus anciens que l'on connaisse sont ceux qui correspondent au premier séjour d'Audubon en Pennsylvanie, à Mill Grove, entre 1803 et 1805. A cette époque et en ce lieu, il était entièrement livré à lui-même et il se mit à dessiner avec les "trois crayons", la mine de plomb et le pastel en plus, des oiseaux ou petits mammifères représentés morts, suspendus à un fil ou fixés par une épingle. Ce sont les plus belles réussites de ses années de jeunesse. Il n'avait pas à donner à ses figures les apparences de la vie, il avait la liberté de tourner les animaux dans un sens ou l'autre pour choisir le meilleur aperçu, pour montrer les ailes des oiseaux ouvertes, les pattes déployées, donnant ainsi très naturellement un rythme, une structure originale à sa composition. Ainsi trouve-t-on parmi les dessins de La Rochelle (9) des écureuils et un lapin d'une admirable finesse. Dans leur simplicité, ils atteignent la perfection. Plus nombreux, et bien que certains paraissent plus hâtivement réalisés, les dessins d'oiseaux sont aussi de très belles réussites. Il y a de superbes canards, harles bièvres ou petits garrots qui offrent à l'artiste des volumes et coloris variés, et aussi de beaux geais, coucous, oiseaux moqueurs, pics, etc. Un dessin comme celui représentant une hirondelle pourprée retient l'attention par ce que l'on peut appeler sa modernité. Audubon a fait ressortir le contraste du plumage des ailes, du ventre et du cou tout en travaillant selon une texture fine et dans une gamme chromatique étroite, du gris au brun presque noir. Le plus remarquable est que l'hirondelle définit un espace asymétrique affirmé, la trouée faite entre l'aile déployée et la queue est occupée par une patte dont les fines membrures s'opposent au corps massif, pointes des ailes et bec s'organisent en triangles, les échancrures en forme de V se dupliquent à trois reprises. Cet ensemble géométrique épuré semble exprimer une tendance (certainement involontaire) vers une stylisation abstraite.
L'épisode de Mill Grove prit fin parce qu'Audubon, pour des raisons familiales, revint en France en 1805-1806. Il ne devait jamais reprendre par la suite la technique des oiseaux suspendus. Il est probable que c'est le Docteur d'Orbigny qui lui fit adopter ce que Linda D. Partridge appelle la "tradition ornithologique" : des oiseaux vus debout, de profil, les pattes verticales posées au sol ou accrochées en oblique à un perchoir, les ailes fermées, prétendant aux apparences de la vie mais en réalité, raides, artificiels, et ressemblant à des spécimens empaillés. Les ornithologues examinant de tels dessins devaient y trouver les critères d'identification et de comparaison qui leur étaient nécessaires. Toujours est-il que, pendant cette année passée sous la coupe de son mentor, Audubon réalisa une importante série d'oiseaux de la région nantaise. Contrairement à ceux de Mill Grove, ces dessins sont connus depuis longtemps : il s'en trouve à La Rochelle et à Harvard (Houghton Library). Prisonnier des conventions ornithologiques, Audubon montre dans ces uvres son habileté de dessinateur et de coloriste. Un dessin comme celui de l'avocette a souvent été reproduit (9, 14), car l'oiseau surprend par son bec recourbé, son il vif, son plumage blanc et noir. D'autres, comme celui du gros-bec casse noyaux ou du pic épeiche (9), attirent plutôt par leurs coloris vifs et variés. Néanmoins, ils n'ont pas l'originalité et la saveur de ceux réalisés auparavant, lorsque personne ne guidait le jeune artiste.
Au cours des années qui suivirent, revenu définitivement en Amérique, Audubon poursuivit son travail d'amateur en restant dans la lignée de la "tradition ornithologique". Daté de 1809, son dessin du pigeon migrateur (12) en est un bel exemple. L'ensemble, encore un peu raide, aux contours précis tracés à la mine de plomb et à l'encre, paraît simple et naïf, mais l'oiseau posé sur une branche grossière impose sa présence. Son il attire. Audubon s'est appliqué surtout aux couleurs, utilisant largement le pastel qui permet des tons plus vifs et variés que la sanguine. A d'autres occasions épisodiques, au lieu d'une simple branche servant de perchoir, il s'est lancé dans une composition associant oiseaux et végétaux. C'est le cas pour le superbe portrait du cardinal huppé trouvé à la Rochelle (9). Un autre exemple que nous pouvons donner est celui du carouge à épaulettes (14), qu'il appelle "Le Commandeur" comme le faisait Buffon, et qui est daté de 1810. La composition d'Audubon joue sur l'opposition de l'oiseau, au plumage noir et rouge, et de la plante qu'il a représentée au pastel par des teintes claires et peu intenses. Le sens du mouvement se traduit dans le choix fait par l'artiste d'une inclinaison de la plante, en oblique par rapport à l'oiseau qui semble plonger vers le bas et se trouve montré, pour une fois, de dos.
Dans cette longue période que nous venons de considérer et qui s'étend de 1803 à 1820, les dessins d'Audubon ont suivi une évolution certaine mais lente et irrégulière. Les données collectées et analysées par Linda Partridge (17) montrent chez lui une démarche empirique, presque hésitante. Les changements dans les annotations, les signatures des dessins, les poses données aux oiseaux, les nouveautés comme celles consistant à mettre deux oiseaux sur le même dessin, ou à représenter un oiseau aux ailes déployées, ou un oiseau en vol, l'usage de matériaux nouveaux pour lui comme fusain, pastel, aquarelle, gouache, apparaissent, puis disparaissent, pour n'être repris parfois que longtemps après une première tentative.
La véritable rupture dans le travail d'Audubon se produisit lorsqu'il eut décidé de se consacrer entièrement à son art et qu'il entreprit sa descente fameuse du Mississippi sur un flat boat, passager désargenté aux allures de vagabond, vers la Louisiane et sa nature subtropicale, riche en espèces, à l'automne 1820. Dès ce moment, il devait faire mieux que ses dessins antérieurs, et surtout que ceux de son rival disparu, Alexander Wilson. Il avait progressé auparavant, d'un essai provisoirement oublié à l'autre, mais diversifiant ses compositions, passant de l'usage des "trois crayons" à une "technique mixte" associant le pastel, puis l'aquarelle, la gouache, l'huile et autres matériaux. Il avait atteint une maîtrise qui pouvait pleinement s'exprimer sous de multiples formes, et ceci dès les premières compositions de son séjour louisianais dont beaucoup de planches de The Birds of America sont issues. Il avait désormais le savoir-faire nécessaire, il ne lui restait plus qu'à appliquer ses principes généraux, montrer des oiseaux en taille naturelle, dans des scènes conformes à leur comportement et leur environnement. La période de gestation était finie, et lorsqu'Audubon put s'assurer de la collaboration d'un graveur et du soutien d'une clientèle, le chef-d'uvre (4, 8, 19) allait se développer sans coup férir.
Mais à trop se focaliser sur un unique personnage qui gardera toujours ses non-dits ou ses mystères, on risque de s'égarer, et nous allons reprendre le thème de l'autodidacte en considérant un autre cas. Edward Hicks (1780-1849) est, à peu d'années près, l'exact contemporain d'Audubon (1785-1851). Né en Pennsylvanie, élevé par des Quakers, il n'a probablement mis lui aussi les yeux dans une grammaire que très rarement. Il eut, comme Audubon, une jeunesse insouciante, sinon dissipée, et commença sa carrière d'artiste en peignant des enseignes, des meubles, des manteaux de cheminées, des intérieurs de carrioles ou de diligences. Sa vie d'adulte fut partagée entre la religion, car il devint un prêcheur réputé dans la Society of Friends, et la peinture sur toile. Les sujets de ses tableaux restèrent très limités : on y trouve les inévitables chutes du Niagara, quelques vues rurales, des scènes historiques en petit nombre. Le principal de son uvre est ailleurs. Hicks s'est inlassablement inspiré d'un court passage de la Bible prophétisant le retour de la paix sur terre : "Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble le pays sera rempli de la connaissance de Yavhé." (Isaïe, 42, 11, 6-9, Bible de Jérusalem). Une soixantaine de variantes furent peintes par lui sur ce thème biblique et reçurent toutes le même titre : The Peaceable Kingdom. Il y montre les animaux cessant de s'entredévorer, vivant ensemble et avec de jeunes enfants sans défense, et aussi les hommes réconciliés, ce qu'il aimait illustrer par une évocation du traité de paix historique passés entre William Penn et les Indiens (sur la gauche, sur la toile de la National Gallery of Art, Washington, D.C.). Pour peindre ses personnages, animaux et humains, Hicks s'inspirait d'illustrations trouvées dans des livres, surtout la Bible, et aussi de tableaux et de gravures de grands maîtres, comme Vanderlyn (l'ami d'Audubon) et Benjamin West (l'Américain devenu président de la Royal Academy britannique). Hicks lisait des poèmes, des essais politiques, et n'était donc pas sans une certaine culture acquise à l'âge adulte (11). En tant qu'artiste, pourtant, il n'est pas difficile à classer : c'est un parfait naïf, autant par la technique que par l'inspiration.
"L'autodidacte ne sait rien dont il n'ait eu envie ou besoin", disait Paul Valéry (20). Cette remarque nous réintroduit dans la problématique initiée en référence à Pierre Bourdieu. Dans le cas d'Edward Hicks, nous voyons un autodidacte qui a trouvé une porte d'entrée à la culture et à une certaine notoriété sociale (surtout posthume dans son cas) mais n'est jamais vraiment sorti d'un habitus étroit, ni par l'imagination, ni par la pratique de son art. Il est resté totalement enfermé dans une sorte de méditation mystique sur la promesse d'un nouvel âge d'or et s'est toujours satisfait d'un style naïf, sinon assez enfantin (ce qui n'exclut pas la beauté). Avec Audubon, c'est l'attitude opposée conduite à l'extrême. Il a voulu apprendre, et ne s'en est pas privé, en regardant autour de lui, au hasard de ses rencontres. Pourtant lui aussi reste un autodidacte, en ce sens qu'il n'a jamais fait de long apprentissage, ni dans une institution éducative, ni dans l'atelier d'un quelconque maître de la peinture. Ce n'est que de très loin que sa main fut guidée par David, et passer quelques heures, voir quelques jours dans les ateliers de peintres américains comme John Vanderlyn, John W. Jarvis ou Thomas Sully qui, sauf le premier, étaient exclusivement des portraitistes (10), ne donne pas une véritable formation. Ses acquis se firent au gré d'occasions fugaces et surtout de ses envies ou de ses besoins. Ses "modestes talents" firent le reste.
Qu'est-ce donc qu'un autodidacte ? Entre les extrêmes que sont Hicks et Audubon, il en existe toute une gamme, assurément. Chacun fait son chemin, court ou long, uvrant dans ce que nous appellerons une "stratégie de liberté", c'est-à-dire prenant autour de lui ce qui lui convient, le reste n'ayant pas d'importance ou étant inaccessible, comme l'a si bien dit en quelques mots Paul Valéry. Si ses aptitudes personnelles et son ambition sont grandes, l'autodidacte voudra devenir aussi bon ou meilleur que ceux dont la valeur est reconnue et à qui il veut ressembler. Dans une autre classe sociale et culturelle se trouve l'homo academicus, formé dans une tradition de savoirs ou de goûts établis, confiant en lui-même. Pour montrer son génie et passer à la postérité, il suivra une autre stratégie que celle de l'autodidacte. Il tentera consciemment et volontairement de dépasser radicalement ses acquis, de se démarquer de ses anciens maîtres par la différence, la nouveauté à tout prix, il voudra créer un changement de style, d'école, de paradigme. Nous dirons qu'il se placera dans une "stratégie de rupture". L'histoire des sciences nous a donné mille exemples de sauts épistémologiques, changements de paradigmes ou révolutions scientifiques, selon la terminologie que l'on veut adopter. On en trouve l'équivalent dans l'histoire de l'art.
Lamartine voyait Audubon comme un homme de la Nature. D'autres exégètes l'ont décrit comme un pur autodidacte, ou comme un homme de son époque, ou comme un novateur en rupture avec son temps. Ayant considéré le long cheminement qui fut le sien, il semble que son cas transcende toutes les catégories. Ne serait-ce pas, simplement dit, une marque du génie ?
Bibliographie sélective
(1) Audubon, John James - "The Birds of America", London : Havel edition, 1827-1838.
(2) - "Ornithological Biography, or an Account of the Habits of the Birds ", Edinburgh : Adam Black, 1831-1839.
(3) Audubon, Maria Rebecca - "Audubon and his Journals", New York : Scribner, 1897, reprint New York : Dover, 1986, 2 vol.
(4) Blaugrund, Annette & Theodore E. Stebbins (éd.), "John James Audubon - The Watercolors for The Birds of America", Villard Books, Random House & The New York Historical Society, 1993.
(5) Bourdieu, Pierre - "La Distinction. Critique sociale du jugement", Paris : Ed de Minuit, 1970.
(6) - "Homo Academicus", Paris : Ed. de Minuit, 1984.
(7) Chasles, Philarète - "Etudes sur la littérature et les murs des Anglo-Américains au XIXe siècle", Paris : Amyot, 1851.
(8) Chatelin, Yvon - "Audubon - Peintre, Naturaliste, Aventurier", Paris : Ed. France Empire, 2001.
(9) -, Ben Forkner, Michèle Dunand, Thierry Lefrançois, Pierre Watelet - "Jean Jacques Audubon - Peintre, Naturaliste, Aventurier", Nantes : Revue 303 : Arts, Recherches et Créations, tiré à part du n° 82, 2003.
(10) Dunlap, William - "History of the Rise and Progress of the Arts of Design in the United States", Philadelphia: 1834, reprint New York : Dover, 1969.
(11) Ford, Alice - "Edward Hicks, Painter of the Peaceable Kingdom", University of Pennsylvania Press, 1952.
(12) - "The Bird Biographies of John James Audubon ", New York: The MacMillan Company, 1957.
(13) Forkner, Ben (éd.) - "John James Audubon - Journaux et récits", Nantes : L'Atalante, 1992, 2 vol.
(14) Foshay, Ella M. - "John James Audubon", New York : Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1997.
(15) Lamartine, Alphonse de - "Cours familier de littérature. CXVIIe & CVIIIe entretiens", Paris : Firmin Didot, 1865.
(16) Noblet, Jean-Yves - "Charles-Marie Dessalines d'Orbigny", Bulletin de l'Association Couëron-Audubon-Atlantique, n° 10, 2002.
(17) Partridge, Linda Dugan - "From Nature : John James Audubon's Drawings and Watercolors, 1805-1826", PhD, University of Delaware, 1992.
(18) Peterson, Roger Tory & Virginia Marie Peterson (éd.) - "J. J. Audubon - Le grand livre des oiseaux", éd. française, Paris : Citadelles-Mazenot, 1986.
(19) Rhodes, Richard - "John James Audubon - The Making of an American", New York: Alfred A. Knopf, 2004.
(20) Valéry, Paul - "Cahiers. Tome II", Paris : Bibliothèque de la Pléiade n° 254, Gallimard, 1974.
Accompagner Audubon en Amérique, pourquoi et comment
L'année 1826 a marqué un tournant dans la vie de John James Audubon. Tous ceux intéressés par ce grand artiste-naturaliste le savent pour l'avoir lu ici ou là, parmi les centaines de livres et textes divers qui lui ont été consacrés, dont beaucoup en français. Embarquant sur le navire Delos à la Nouvelle Orléans et à destination de Liverpool en Grande-Bretagne, Audubon l'aventurier, le traîne-misère parfois, l'original ignoré ou méprisé allait se transformer en un Audubon bientôt célèbre, auteur de gravures hors de prix et de livres d'ornithologie, reçu dans tous les cénacles cultivés et savants, chez les aristocrates et les hommes politiques.
À commencer par l'intéressé, personne n'aurait pu garantir l'heureuse issue de ce voyage. En la même année, un autre tournant presqu'aussi discret et au résultat incertain se produisait en France : Marie-Henri Beyle, mieux connu sous le pseudonyme de Stendhal, achevait, pour une troisième édition révisée et enrichie, un livre intitulé Rome, Naples et Florence. On peut se demander quel rapport je trouve entre ces deux événements. Les deux hommes sont étroitement contemporains, puisque nés en 1783 pour Stendhal et 1785 pour Audubon, morts en 1842 pour le premier et 1851 pour le second, mais la coïncidence chronologique est peu signifiante en elle-même, et si j'ouvre le texte qui suit par un rapprochement entre eux, c'est pour une autre raison.
Stendhal faisait en 1826 un premier pas vers un nouveau genre littéraire. Son Rome, Naples et Florence primitif était le récit simple d'un voyage fait quelques années auparavant. Préparant la troisième édition, il lui ajoutait des commentaires, anecdotes, rappels historiques, réflexions sur l'art ne provenant plus directement de ses parcours de voyageur. Quelque temps après, en 1828, il reprenait le procédé en se lançant dans un livre qui cette fois ne reposait pas sur une expérience personnelle du voyage mais sur un travail de documentation et qu'il intitulait Promenades dans Rome. Avec ce deuxième document surtout, la promenade littéraire ébauchée tandis qu'en 1826 Audubon voguait vers la célébrité, venait réellement de naître. Stendhal avait inventé (ou au moins fixé) le procédé et, en tout cas, trouvé le mot (promenade) pour le désigner.
Bien avant Stendhal ou Chateaubriand, le récit de voyage était un genre d'écrit fréquemment pratiqué. Il remonte au moins à Marco Polo de retour de Chine et publiant Le devisement du monde (1298), livre touffu, contenant du réel et un peu d'imaginaire ou de croyances infondées. Les récits de voyage ont pris par la suite une obligation d'authenticité plus grande. J'en ai personnellement beaucoup lus. Le plus ancien et qui m'a vraiment impressionné est la Relation d'un voyage au Levant de Joseph Pitton de Tournefort (1717), le médecin et botaniste qui le premier fit la distinction entre "genre" et "espèce" dans les plantes. Sa façon de présenter son travail, ses découvertes, ses aventures ne manquait pas de saveur. Au moment de ma lecture, alors que j'avais travaillé en chercheur naturaliste des années dans des pays exotiques, Tournefort avait l'image d'un très lointain et admirable devancier.
Bien d'autres récits ont succédé à celui de Tournefort, les 18e et 19e siècles ayant été ceux de l'exploration et de l'inventaire de la planète. Les noms du Père Jean-Baptiste Labat et autres missionnaires, de Jacques Cartier, James Cook, Louis-Antoine de Bougainville, Alexandre de Humboldt, Charles Darwin ou René Caillé sont largement connus. S'il s'agissait de constituer une anthologie, j'y ajouterais celui de William Bartram (voir plus loin) et aussi, autre choix personnel, celui d'Alphonse de Lamartine, auteur d'un Voyage en Orient (1835). Comme beaucoup de ceux l'ayant pratiqué au lycée par obligation, et à tort, je voyais Lamartine, avant de lire ce texte, comme un poète larmoyant et suranné, et son Voyage m'a surpris.
Ce Voyage a été écrit pratiquement sur place et au jour-le-jour, dans un style spontané, fluide, élégant. Lamartine a souvent travaillé de manière hâtive sous la pression de besoins financiers, notamment dans le cas de son Cours familier de littérature dont j'ai lu aussi la plus grande partie. Il en était de même à son retour d'Orient et, preuve qu'il ne s'est pas beaucoup relu et corrigé, Lamartine commence curieusement par dire que son texte ne sera "ni un livre, ni un voyage". De quoi s'agissait-il donc ? Les pages qui s'enchaînent après cette déclaration surprenante montrent qu'il était un grand maître de la langue française et qu'il la pratiquait sans effort, ne passant pas comme Flaubert des journées à peser le poids d'une virgule.
Le plus étonnant pour moi a été de trouver un Lamartine homme de terrain et bon géographe. Beaucoup d'auteurs décrivent des paysages ou des régions sans que l'on comprenne vraiment où ils se trouvent et vers quels lieux les dirigent leurs pas. Le nord et le sud, l'aval et l'amont n'ont pas beaucoup de sens pour eux, arbres et forêts sont des silhouettes poétiques, les eaux libres des miroirs, la terre et les roches un mobilier disposé autour d'eux. Lamartine au Liban fait une démonstration différente. Il est précis, il sait décrire ses parcours, il observe et identifie les reliefs, les cours d'eau, les arbres, les cultures, les oiseaux. On comprend très vite à le lire que, gentilhomme campagnard, bon cavalier, Lamartine avait appris très tôt à pratiquer et connaître la Nature.
Pour donner un titre à ce type de livre, les auteurs ont eu pendant longtemps le choix entre plusieurs mots, les plus fréquents étant Récit¸Relation, Voyage. Un autre terme a été ajouté par Chateaubriand à cette courte liste, celui d'Itinéraire (voir plus loin). Le plus poétique, le plus évocateur dans son imprécision reste, à mon sens, Relation, celui adopté autrefois par Tournefort. Au milieu du 19e siècle, George Sand s'en est encore servi en écrivant sa Relation d'un voyage parmi les sauvages de Paris. Il s'agissait pour elle de raconter un après-midi passé auprès des Amérindiens amenés des Etats-Unis par George Catlin et formant l'illustration vivante d'une exposition appelée Indian Gallery qui allait d'un pays à l'autre. George Sand en profitait pour donner, par comparaison, une image humoristique mais très critique de la société française. Aujourd'hui, le mot a le charme du passé et on imagine mal un auteur écrire une Relation de voyage sans qu'il ne soit accusé de préciosité. Venons-en maintenant à un autre terme, Promenade, qui nous concerne directement ici.
Avec les Promenades dans Rome, ce n'était pas seulement le remplacement d'un mot par un autre. La Promenade selon Stendhal est devenu un genre à part que nous appelons plus volontiers "promenade littéraire". Est-ce à dire que Stendhal a été son seul inventeur, bien sûr que non, il y a des précédents à tout. Chateaubriand, encore lui, était un maître de la question. Son Voyage en Amérique a été publié en 1828 mais il reposait sur les notes d'un voyage de 1791 et sur des textes élaborés, retravaillés, partiellement publiés ensuite pendant des années. Sans en donner toute la mesure, Chateaubriand a convenu que son Voyage incorporait beaucoup d'emprunts à William Bartram et d'autres écrivains encore plus anciens. Avec son Itinéraire de Paris à Jérusalem, la question s'est compliquée. Chateaubriand traitait de nombreux lieux et sites antiques où il n'avait pas mis les pieds, et il ne comprit pas le flot de critiques s'abattant sur lui pour cette raison. Voyager c'était, pour Chateaubriand, non seulement se déplacer physiquement, mais aussi rassembler des souvenirs, s'enrichir de nouvelles recherches et lectures, assimiler le tout. N'oublions pas non plus Xavier de Maistre et son Voyage autour de ma chambre, (1794) qui a bien montré que l'on pouvait voyager (se promener, dirions-nous plutôt) n'importe où et de toutes les manières, jusqu'au virtuel ou l'imaginaire.
La biographie d'un personnage du passé prend par nécessité une certaine allure de promenade littéraire : il faut bien dire où et avec qui il a vécu, quels événements il a connus, quelle culture a pu l'imprégner, mais ce n'est pas le thème dominant. Certains biographes s'y étendent, d'autres moins, et cela en différends styles. Le plus souvent, tout est incorporé dans l'exposé linéaire du livre, ou parfois ventilé en chapitres thématiques. Pour Bartram, voyageur, naturaliste et artiste américain ayant vécu entre 1739 et 1823 j'ai choisi une autre formule. Mon livre Le voyage deWilliam Bartram, sous-titré Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain, est constitué d'une alternance de textes. Les uns sont la traduction d'écrits de Bartram, ils relèvent du genre "récit de voyage". Les autres apportent des données biographiques et psychologiques sur le personnage, historiques et culturelles sur l'époque, ils relèvent du genre "promenade littéraire".
J'ai retrouvé le problème en écrivant Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier, d'autant plus que je ne voulais pas réaliser un travail en recherche d'archives mais faire le portrait d'un homme selon ce qu'il devait à son époque et à la culture française l'ayant façonné dans sa jeunesse : le rousseauisme, le goût du picaresque, le naturalisme à la Buffon. Ma biographie est classique en ce sens qu'elle adopte le premier procédé, celui que j'ai dit linéaire, mais en près de 500 pages elle renferme, sous forme diffuse ou dispersée, beaucoup de ce qui pourrait être de la promenade littéraire. Je n'ai pas épuisé le sujet. Discutant un jour avec un interlocuteur averti, bon connaisseur de l'individu et de son uvre, j'ai avancé qu'Audubon était un personnage suffisamment riche pour que, sans découverte factuelle nouvelle, on puisse cependant écrire encore sur lui pendant longtemps.
Les Editions de l'Harmattan viennent de m'offrir la possibilité de le démontrer, Promenades dans une Amérique naissante, sur les pas d'Audubon le naturaliste (1803-1850) (ISBN 978-2-343-011530) voulant être un cas particulier de ce qu'avaient inventé, plus brillamment, Stendhal et Chateaubriand. Au lieu de focaliser l'attention sur le personnage et sur la chronologie, comme dans sa biographie, j'ai voulu "accompagner Audubon", un peu comme s'il était possible de le suivre en ayant remonté le temps et renoué avec ses parcours nord-américains. La perspective s'est inversée : il ne s'agit plus d'observer Audubon (en biographe), mais au contraire de le laisser regarder autour de lui (en promeneur). Mes treize Promenades sont d'abord des exercices géographiques, toute promenade se faisant dans l'espace, elles ont un support régional et se partagent l'immense domaine parcouru par Audubon, parfois en des séjours prolongés, parfois selon des itinéraires jamais renouvelés. Il y a par exemple une Promenade en Louisiane et une autre au Québec, pour ne mentionner ici que ces parcelles de la francophonie noyées dans un monde anglo-américain.
Accompagnant Audubon, regardant en quelque sorte par ses yeux, on découvre des paysages parfois chauds et luxuriants, parfois froids et désolés, des milieux encore très sauvages ou au contraire urbanisés, des groupes sociaux frustres ou éduqués et raffinés à Philadelphie, New-York et Boston. Certains lieux précis retiennent notre attention. Mill Grove et Oakley, deux maisons autrefois habitées par Audubon, reçoivent chaque année des milliers de visiteurs. Mais combien y a-t-il d'amateurs français du personnage qui connaissent Locust Grove, aux portes de Louisville ? Il s'agit pourtant d'une propriété merveilleusement préservée, toujours aussi belle, où Audubon était souvent reçu sans y séjourner. Mieux que partout ailleurs, on peut à Locust Grove s'imaginer vivre avec lui. Il faut y rêver devant des meubles et instruments de musique de son temps, devant les portraits de personnages qu'il a connus et dont le regard paraît toujours vivant. Ces portraits, Audubon lui-même les a peut-être vus.
En réalité, tout en me référant à Stendhal, j'ai surtout imaginé mes Promenades selon quatre thèmes (je pourrais dire quatre "sous-ensembles") qui s'imbriquent étroitement dans la suite linéaire du texte. Le premier est celui présentant Audubon et son travail, il domine dans la première Promenade parce que celle-ci se déroule sur un territoire limité, à une période pendant laquelle le jeune Audubon ne se déplaçait guère et ignorait presque tout de son environnement social et historique. Il perd ensuite de l'importance, ou en regagne, selon les cas. Le deuxième thème est d'ordre géographique, j'y ai fait allusion plus haut. Il était intéressant de le développer à l'occasion d'un itinéraire comme la descente de l'Ohio ou du Mississippi, lorsque devenait possible la description des accidents naturels, moyens de déplacements, rencontres pittoresques et caractéristiques de l'époque. Le troisième thème est celui de l'histoire, des événements importants, des figures curieuses ou grands personnages rencontrés. Comme les précédents, il est diversement développé dans les différentes Promenades, devenant dominant par exemple à propos du Québec, non seulement pour intéresser un lecteur francophone, mais aussi parce que, si Audubon a voyagé dans ce pays dans un but commercial, il n'y a pas travaillé (le premier thème se réduisant d'autant).
Le quatrième thème est celui l'image, de la représentation visuelle, il est le plus discret dans mon texte. Les dessins, aquarelles, gravures, peintures sur toile, bois et autres supports conservés dans les musées par centaines et même milliers offrent une merveilleuse collection d'images de personnes, lieux, paysages et même événements historiques du passé. Ces images ont été produites par des artistes de toutes sortes, amateurs ou professionnels, hommes ou femmes, travaillant en atelier, sur le vif, en plein air et dans des styles variés. J'ai donc beaucoup étudié les beaux-arts de la période Audubon (et même de la période qui l'a précédée) mais ne pouvant en traiter vraiment dans le présent livre publié par l'Harmattan, je laisse seulement pour le lecteur quelques références, quelques pistes permettant d'entrer dans ce vaste domaine. Ainsi, chacun pourra-t-il accompagner Audubon en passant, à son tour, de l'écrit à la représentation visuelle et entreprendre comme Diderot (Promenade Vernet, 1767) une promenade à travers la nature, l'art et l'imagination.
Lire plus
À commencer par l'intéressé, personne n'aurait pu garantir l'heureuse issue de ce voyage. En la même année, un autre tournant presqu'aussi discret et au résultat incertain se produisait en France : Marie-Henri Beyle, mieux connu sous le pseudonyme de Stendhal, achevait, pour une troisième édition révisée et enrichie, un livre intitulé Rome, Naples et Florence. On peut se demander quel rapport je trouve entre ces deux événements. Les deux hommes sont étroitement contemporains, puisque nés en 1783 pour Stendhal et 1785 pour Audubon, morts en 1842 pour le premier et 1851 pour le second, mais la coïncidence chronologique est peu signifiante en elle-même, et si j'ouvre le texte qui suit par un rapprochement entre eux, c'est pour une autre raison.
Stendhal faisait en 1826 un premier pas vers un nouveau genre littéraire. Son Rome, Naples et Florence primitif était le récit simple d'un voyage fait quelques années auparavant. Préparant la troisième édition, il lui ajoutait des commentaires, anecdotes, rappels historiques, réflexions sur l'art ne provenant plus directement de ses parcours de voyageur. Quelque temps après, en 1828, il reprenait le procédé en se lançant dans un livre qui cette fois ne reposait pas sur une expérience personnelle du voyage mais sur un travail de documentation et qu'il intitulait Promenades dans Rome. Avec ce deuxième document surtout, la promenade littéraire ébauchée tandis qu'en 1826 Audubon voguait vers la célébrité, venait réellement de naître. Stendhal avait inventé (ou au moins fixé) le procédé et, en tout cas, trouvé le mot (promenade) pour le désigner.
Bien avant Stendhal ou Chateaubriand, le récit de voyage était un genre d'écrit fréquemment pratiqué. Il remonte au moins à Marco Polo de retour de Chine et publiant Le devisement du monde (1298), livre touffu, contenant du réel et un peu d'imaginaire ou de croyances infondées. Les récits de voyage ont pris par la suite une obligation d'authenticité plus grande. J'en ai personnellement beaucoup lus. Le plus ancien et qui m'a vraiment impressionné est la Relation d'un voyage au Levant de Joseph Pitton de Tournefort (1717), le médecin et botaniste qui le premier fit la distinction entre "genre" et "espèce" dans les plantes. Sa façon de présenter son travail, ses découvertes, ses aventures ne manquait pas de saveur. Au moment de ma lecture, alors que j'avais travaillé en chercheur naturaliste des années dans des pays exotiques, Tournefort avait l'image d'un très lointain et admirable devancier.
Bien d'autres récits ont succédé à celui de Tournefort, les 18e et 19e siècles ayant été ceux de l'exploration et de l'inventaire de la planète. Les noms du Père Jean-Baptiste Labat et autres missionnaires, de Jacques Cartier, James Cook, Louis-Antoine de Bougainville, Alexandre de Humboldt, Charles Darwin ou René Caillé sont largement connus. S'il s'agissait de constituer une anthologie, j'y ajouterais celui de William Bartram (voir plus loin) et aussi, autre choix personnel, celui d'Alphonse de Lamartine, auteur d'un Voyage en Orient (1835). Comme beaucoup de ceux l'ayant pratiqué au lycée par obligation, et à tort, je voyais Lamartine, avant de lire ce texte, comme un poète larmoyant et suranné, et son Voyage m'a surpris.
Ce Voyage a été écrit pratiquement sur place et au jour-le-jour, dans un style spontané, fluide, élégant. Lamartine a souvent travaillé de manière hâtive sous la pression de besoins financiers, notamment dans le cas de son Cours familier de littérature dont j'ai lu aussi la plus grande partie. Il en était de même à son retour d'Orient et, preuve qu'il ne s'est pas beaucoup relu et corrigé, Lamartine commence curieusement par dire que son texte ne sera "ni un livre, ni un voyage". De quoi s'agissait-il donc ? Les pages qui s'enchaînent après cette déclaration surprenante montrent qu'il était un grand maître de la langue française et qu'il la pratiquait sans effort, ne passant pas comme Flaubert des journées à peser le poids d'une virgule.
Le plus étonnant pour moi a été de trouver un Lamartine homme de terrain et bon géographe. Beaucoup d'auteurs décrivent des paysages ou des régions sans que l'on comprenne vraiment où ils se trouvent et vers quels lieux les dirigent leurs pas. Le nord et le sud, l'aval et l'amont n'ont pas beaucoup de sens pour eux, arbres et forêts sont des silhouettes poétiques, les eaux libres des miroirs, la terre et les roches un mobilier disposé autour d'eux. Lamartine au Liban fait une démonstration différente. Il est précis, il sait décrire ses parcours, il observe et identifie les reliefs, les cours d'eau, les arbres, les cultures, les oiseaux. On comprend très vite à le lire que, gentilhomme campagnard, bon cavalier, Lamartine avait appris très tôt à pratiquer et connaître la Nature.
Pour donner un titre à ce type de livre, les auteurs ont eu pendant longtemps le choix entre plusieurs mots, les plus fréquents étant Récit¸Relation, Voyage. Un autre terme a été ajouté par Chateaubriand à cette courte liste, celui d'Itinéraire (voir plus loin). Le plus poétique, le plus évocateur dans son imprécision reste, à mon sens, Relation, celui adopté autrefois par Tournefort. Au milieu du 19e siècle, George Sand s'en est encore servi en écrivant sa Relation d'un voyage parmi les sauvages de Paris. Il s'agissait pour elle de raconter un après-midi passé auprès des Amérindiens amenés des Etats-Unis par George Catlin et formant l'illustration vivante d'une exposition appelée Indian Gallery qui allait d'un pays à l'autre. George Sand en profitait pour donner, par comparaison, une image humoristique mais très critique de la société française. Aujourd'hui, le mot a le charme du passé et on imagine mal un auteur écrire une Relation de voyage sans qu'il ne soit accusé de préciosité. Venons-en maintenant à un autre terme, Promenade, qui nous concerne directement ici.
Avec les Promenades dans Rome, ce n'était pas seulement le remplacement d'un mot par un autre. La Promenade selon Stendhal est devenu un genre à part que nous appelons plus volontiers "promenade littéraire". Est-ce à dire que Stendhal a été son seul inventeur, bien sûr que non, il y a des précédents à tout. Chateaubriand, encore lui, était un maître de la question. Son Voyage en Amérique a été publié en 1828 mais il reposait sur les notes d'un voyage de 1791 et sur des textes élaborés, retravaillés, partiellement publiés ensuite pendant des années. Sans en donner toute la mesure, Chateaubriand a convenu que son Voyage incorporait beaucoup d'emprunts à William Bartram et d'autres écrivains encore plus anciens. Avec son Itinéraire de Paris à Jérusalem, la question s'est compliquée. Chateaubriand traitait de nombreux lieux et sites antiques où il n'avait pas mis les pieds, et il ne comprit pas le flot de critiques s'abattant sur lui pour cette raison. Voyager c'était, pour Chateaubriand, non seulement se déplacer physiquement, mais aussi rassembler des souvenirs, s'enrichir de nouvelles recherches et lectures, assimiler le tout. N'oublions pas non plus Xavier de Maistre et son Voyage autour de ma chambre, (1794) qui a bien montré que l'on pouvait voyager (se promener, dirions-nous plutôt) n'importe où et de toutes les manières, jusqu'au virtuel ou l'imaginaire.
La biographie d'un personnage du passé prend par nécessité une certaine allure de promenade littéraire : il faut bien dire où et avec qui il a vécu, quels événements il a connus, quelle culture a pu l'imprégner, mais ce n'est pas le thème dominant. Certains biographes s'y étendent, d'autres moins, et cela en différends styles. Le plus souvent, tout est incorporé dans l'exposé linéaire du livre, ou parfois ventilé en chapitres thématiques. Pour Bartram, voyageur, naturaliste et artiste américain ayant vécu entre 1739 et 1823 j'ai choisi une autre formule. Mon livre Le voyage deWilliam Bartram, sous-titré Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain, est constitué d'une alternance de textes. Les uns sont la traduction d'écrits de Bartram, ils relèvent du genre "récit de voyage". Les autres apportent des données biographiques et psychologiques sur le personnage, historiques et culturelles sur l'époque, ils relèvent du genre "promenade littéraire".
J'ai retrouvé le problème en écrivant Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier, d'autant plus que je ne voulais pas réaliser un travail en recherche d'archives mais faire le portrait d'un homme selon ce qu'il devait à son époque et à la culture française l'ayant façonné dans sa jeunesse : le rousseauisme, le goût du picaresque, le naturalisme à la Buffon. Ma biographie est classique en ce sens qu'elle adopte le premier procédé, celui que j'ai dit linéaire, mais en près de 500 pages elle renferme, sous forme diffuse ou dispersée, beaucoup de ce qui pourrait être de la promenade littéraire. Je n'ai pas épuisé le sujet. Discutant un jour avec un interlocuteur averti, bon connaisseur de l'individu et de son uvre, j'ai avancé qu'Audubon était un personnage suffisamment riche pour que, sans découverte factuelle nouvelle, on puisse cependant écrire encore sur lui pendant longtemps.
Les Editions de l'Harmattan viennent de m'offrir la possibilité de le démontrer, Promenades dans une Amérique naissante, sur les pas d'Audubon le naturaliste (1803-1850) (ISBN 978-2-343-011530) voulant être un cas particulier de ce qu'avaient inventé, plus brillamment, Stendhal et Chateaubriand. Au lieu de focaliser l'attention sur le personnage et sur la chronologie, comme dans sa biographie, j'ai voulu "accompagner Audubon", un peu comme s'il était possible de le suivre en ayant remonté le temps et renoué avec ses parcours nord-américains. La perspective s'est inversée : il ne s'agit plus d'observer Audubon (en biographe), mais au contraire de le laisser regarder autour de lui (en promeneur). Mes treize Promenades sont d'abord des exercices géographiques, toute promenade se faisant dans l'espace, elles ont un support régional et se partagent l'immense domaine parcouru par Audubon, parfois en des séjours prolongés, parfois selon des itinéraires jamais renouvelés. Il y a par exemple une Promenade en Louisiane et une autre au Québec, pour ne mentionner ici que ces parcelles de la francophonie noyées dans un monde anglo-américain.
Accompagnant Audubon, regardant en quelque sorte par ses yeux, on découvre des paysages parfois chauds et luxuriants, parfois froids et désolés, des milieux encore très sauvages ou au contraire urbanisés, des groupes sociaux frustres ou éduqués et raffinés à Philadelphie, New-York et Boston. Certains lieux précis retiennent notre attention. Mill Grove et Oakley, deux maisons autrefois habitées par Audubon, reçoivent chaque année des milliers de visiteurs. Mais combien y a-t-il d'amateurs français du personnage qui connaissent Locust Grove, aux portes de Louisville ? Il s'agit pourtant d'une propriété merveilleusement préservée, toujours aussi belle, où Audubon était souvent reçu sans y séjourner. Mieux que partout ailleurs, on peut à Locust Grove s'imaginer vivre avec lui. Il faut y rêver devant des meubles et instruments de musique de son temps, devant les portraits de personnages qu'il a connus et dont le regard paraît toujours vivant. Ces portraits, Audubon lui-même les a peut-être vus.
En réalité, tout en me référant à Stendhal, j'ai surtout imaginé mes Promenades selon quatre thèmes (je pourrais dire quatre "sous-ensembles") qui s'imbriquent étroitement dans la suite linéaire du texte. Le premier est celui présentant Audubon et son travail, il domine dans la première Promenade parce que celle-ci se déroule sur un territoire limité, à une période pendant laquelle le jeune Audubon ne se déplaçait guère et ignorait presque tout de son environnement social et historique. Il perd ensuite de l'importance, ou en regagne, selon les cas. Le deuxième thème est d'ordre géographique, j'y ai fait allusion plus haut. Il était intéressant de le développer à l'occasion d'un itinéraire comme la descente de l'Ohio ou du Mississippi, lorsque devenait possible la description des accidents naturels, moyens de déplacements, rencontres pittoresques et caractéristiques de l'époque. Le troisième thème est celui de l'histoire, des événements importants, des figures curieuses ou grands personnages rencontrés. Comme les précédents, il est diversement développé dans les différentes Promenades, devenant dominant par exemple à propos du Québec, non seulement pour intéresser un lecteur francophone, mais aussi parce que, si Audubon a voyagé dans ce pays dans un but commercial, il n'y a pas travaillé (le premier thème se réduisant d'autant).
Le quatrième thème est celui l'image, de la représentation visuelle, il est le plus discret dans mon texte. Les dessins, aquarelles, gravures, peintures sur toile, bois et autres supports conservés dans les musées par centaines et même milliers offrent une merveilleuse collection d'images de personnes, lieux, paysages et même événements historiques du passé. Ces images ont été produites par des artistes de toutes sortes, amateurs ou professionnels, hommes ou femmes, travaillant en atelier, sur le vif, en plein air et dans des styles variés. J'ai donc beaucoup étudié les beaux-arts de la période Audubon (et même de la période qui l'a précédée) mais ne pouvant en traiter vraiment dans le présent livre publié par l'Harmattan, je laisse seulement pour le lecteur quelques références, quelques pistes permettant d'entrer dans ce vaste domaine. Ainsi, chacun pourra-t-il accompagner Audubon en passant, à son tour, de l'écrit à la représentation visuelle et entreprendre comme Diderot (Promenade Vernet, 1767) une promenade à travers la nature, l'art et l'imagination.
Audubon, ou Les métamorphoses de Jean-Jacques
Il a porté deux noms patronymiques, quatre ou cinq prénoms suivant la manière dont on veut bien les compter, il a eu deux nationalités, des lieux de naissance douteux, une mère biologique oubliée, une autre supposée espagnole, une mère adoptive bien entendu, on l'a cru mort quand il était parfaitement vivant, on a pensé qu'il était de sang royal. Il a été un apprenti-marin, une sorte de jeune dandy en exil, on l'a vu commerçant, manufacturier, il est devenu vagabond, homme des bois, peintre, naturaliste, écrivain, éditeur. Il a été pauvre, il a été riche. On a dit de lui qu'il était un bon à rien, un charlatan, un malhonnête, un mauvais mari, un mythomane, un homme simple et généreux, un génie. Ovide le lui eut accordé, Jean-Jacques avait une merveilleuse aptitude aux métamorphoses !
Cet homme étonnant a eu des biographes remarquables, les Herrick, Alice Ford, Stanley Clisby Arthur, Alexander Adams, parfois de moins bons, ou de médiocres. D'autres auteurs ont été les analystes éclairés de son uvre scientifique et artistique, d'autres encore des vulgarisateurs compétents et honnêtes. Tous ensemble ont porté la masse des documents écrits sur Jean-Jacques à des milliers de pages. J'en ai publié près de cinq cents de plus, parce que je voulais éclairer sa personnalité profonde en la débarrassant des petitesses, des incompréhensions, des méchancetés qui sont venues ternir son image, et en lui donnant des racines culturelles prises aux sources du rousseauisme. Jean-Louis Lavigne, merci à lui, a pu dire : "Yvon Chatelin replace le parcours d'Audubon dans le contexte culturel de l'époque et livre les clefs essentielles de sa personnalité scientifique et artistique, ce qui n'avait jamais été fait" (Ouest-France, 2-3 février 2002). Mais je peux ajouter que, ma dernière page terminée, j'avais le sentiment que mon sujet était loin d'être épuisé.
A défaut d'entreprendre dans la foulée un deuxième ouvrage, j'ai laissé dans mon texte un jalon que je me réservais de retrouver, tel un petit bout de chanvre à peine visible mais sur lequel il suffit de tirer pour découvrir un nouveau fil d'Ariane qui va se dévider. Ce jalon tient en peu de mots, c'est l'expression "le nouvel Audubon" que le lecteur voit apparaître dans le récit de la période où Jean-Jacques est reçu par le Président des Etats-Unis, où il embarque sur des navires de la marine américaine comme le Spark ou sur des garde-côtes comme le Marion mis au service de ses oiseaux, où le Ripley affrété par lui pour aller au Labrador est salué à sa sortie du port par une salve de coups de canon. Quelle métamorphose pour l'ancien vagabond ! Je conviens avoir, dans ma biographie, mis l'accent et le plus grand nombre de pages sur la vie d'Audubon jusqu'au moment où cette grande et très visible métamorphose s'est produite, à partir de l'année 1829. Non que la seconde période de sa vie m'eut parue de moindre intérêt, mais parce que pour la décrire et l'analyser comme la première il eut fallu à nouveau composer tout un paysage social et présenter de nouvelles personnalités et communautés d'hommes de science. En quelques mots, voici une ébauche de ce que j'aurais aimer développer à propos de cette seconde période.
Le "nouvel Audubon" me semble au mieux de son personnage et de son entourage lors du troisième séjour qu'il fit en Grande-Bretagne, entre le 7 mai 1834, date de son arrivée à Liverpool, et son départ pour le voyage au Texas, le 2 août 1836. Le Jean-Jacques du premier séjour anglais qui amusait ses amis Rathbone en poussant des cris d'oiseaux, qui tentait de paraître "well off" (à l'aise financièrement) tout en vivant dans de modestes chambres de location, était bien loin. La "manie ambulante" n'était pas apaisée, et l'on trouve Jean-Jacques, quand il n'était pas en déplacement d'une ville à l'autre, habitant bourgeoisement Edimbourg au 5 India Street, Londres au 5 Lothian Road puis au 4 Wimpole Street. C'est là justement, dans la maison de Wimpole Street, qu'il me semble que la famille Audubon a trouvé son apogée sociale. Car Jean-Jacques n'était plus seul. Il avait fait venir Lucy, autrefois si longtemps livrée à elle-même, ses fils Victor et John rarement vus par lui dans leur adolescence et qui, abandonnant la carrière à laquelle ils se préparaient en Amérique, suivaient la fortune paternelle.
Lucy était destinée à une très longue vie et avait toujours eu une santé de fer, sauf en Angleterre où elle était sans cesse malade. Une mauvaise adaptation au climat, ou peut-être une manière à elle de protester contre une transplantation qu'elle n'avait pas désirée. Les fils, eux, menaient la grande vie. Ils voyageaient. Victor et John sont allés chacun à leur tour en France, Victor et John ont visité le Pays de Galles, Victor et John sont partis ensemble pour Rome. Ils ambitionnaient devenir de grands peintres et protestèrent quand leur père les fit venir d'Edimbourg à Londres sans Joseph B. Kidd qui leur servait en quelque sorte de professeur particulier. La maison de Wimpole Street offrit en compensation à ces deux "lads" du Kentucky l'occasion de se dégrossir au contact de gens raffinés. Jean-Jacques était au mieux avec le Duc du Sussex, avec Lord Stanley, Lord Carnavon, le Comte de Derby, et d'autres aristocrates. Jean-Jacques attirait des intellectuels, hommes de lettres comme Robert Bell, Charles Wentworth Dilke, Henri Chorley, artistes peintres comme John Gould, Edward Lear. Jean-Jacques était lié d'amitié avec la grande famille des Kemble qui étaient tous gens de théâtre et shakespeariens réputés. C'était aussi l'époque où les peintres portraitistes cherchaient à laisser leur signature sous les traits du grand homme. Le portrait fait par Cruikshank était reproduit par en gravures multipliées et diffusées en grand nombre. Toujours à Wimpole Street, quelques années plus tard (1838), Healy entreprenait de représenter un Jean-Jacques dans la maturité, à l'expression douce et nostalgique. Cet intérêt des portraitistes est un bon indicateur de célébrité !
Plus encore que ces cercles mondains et cultivés, le milieu des hommes de science doit être considéré en toile de fond du comportement du "nouvel Audubon", car c'est ce milieu scientifique qui avait le pouvoir de cautionner ou de discréditer "the great work", la grande oeuvre de Jean-Jacques, les Oiseaux d'Amérique. C'était un milieu en pleine mutation, dont les effectifs se multipliaient, qui se cherchait de nouveaux consensus, de nouvelles règles de travail, une nouvelle éthique plus exigeante que celle des décennies passées. Avec pour corrélat un sens plus strict de la propriété intellectuelle, une compétition plus vive, des conflits qui se durcissent. On a tendance, bien sûr, à voir une évolution régulière et normale dans le temps, à dire des choses comparables pour toutes les époques par rapport à leur passé. Cependant, entre la génération qui a vu Jean-Jacques jeune, que j'ai beaucoup décrite, et celle dans laquelle évoluait le "nouvel Audubon" et que j'ai peu abordée dans mon livre, les différences sont frappantes.
Faut-il en proposer une illustration ? La taxonomie botanique de Linné, en plein dix-huitième siècle, a soulevé un enthousiasme extraordinaire mais n'a pourtant pas fait l'unanimité. Buffon, qui avait des lecteurs enthousiastes lui aussi, n'était pas favorable à cette taxonomie basée exclusivement sur les organes floraux. Eh quoi, ronchonnait-il dans son "Histoire Naturelle", les racines, les branches, le tronc des arbres, leur taille, tout cela ne servira à rien ! Les choses n'allaient pas plus loin. Un demi-siècle plus tard, Charles Darwin ruminait dans la solitude de son jardin la théorie de l'évolution des espèces. (Pour la petite histoire, il faut rappeler que Darwin jeune avait assisté à des exposés de Jean-Jacques à Edimbourg, comme l'a retrouvé Jean-Yves Noblet. On peut ajouter aussi que Jean-Jacques connaissait bien John S. Henslow (professeur à Cambridge) qui comptait Darwin parmi ses étudiants.) Cette parenthèse fermée, rappelons qu'il fallut qu'un autre naturaliste, Alfred Wallace, ébauche une théorie évolutionniste semblable à la sienne pour que Darwin, après s'être longtemps abstenu par crainte des critiques et des conflits, se mette à découvert, exigeant d'être reconnu comme le véritable père de la théorie de l'évolution.
On ne peut donner tort à Darwin de s'être méfié quand on connaît la terrible querelle qui a éclaté en 1834, en pleine période du "nouvel Audubon", à la Société géologique de Londres. L'objet de cette querelle : la stratigraphie du dévonien. Elle n'avait aucun enjeu philosophique, mais elle a pourtant secoué toute la communauté des géologues anglais, menacé certains d'eux dans leur emploi, elle s'est étendue en France et même jusqu'en Russie. Aujourd'hui encore il est difficile de dire qui avait tort ou raison, mais ceux qui furent socialement les perdants sont clairement identifiés. L'un d'eux fut Adam Sedgwick, Professeur à Cambridge, que Charles Darwin (encore lui !) avait accompagné un moment sur le terrain, avant de partir sur le Beagle, et que Jean-Jacques connaissait bien, le deuxième et plus grand perdant, Henry T. De la Bèche.
De la Bèche était bon dessinateur et agrémentait ses notes personnelles de caricatures. Sur une d'elles, il se représente, au cours d'une séance de la Geological Society, montrant du doigt son nez en disant : "Mais ceci est mon nez, gentlemen !". Le groupe des géologues incrédules réplique pompeusement : "Mon cher ami ! Ce que vous dîtes de vous-même peut être très bon, mais nous vous avons classé, avant de vous voir, dans le groupe des hommes sans nez, et il n'est pas possible que vous ayez un nez !" De la Bèche intitulait cette scène "Preconceived opinions versus facts". Il croyait les faits scientifiques évidents, faciles à établir, comme Jean-Jacques d'ailleurs qui répétait si souvent : je n'écris que des faits et les Philadelphiens me traitent de menteur ! L'un et l'autre se trompaient en croyant que des idées préconçues ou la mauvaise foi pouvaient seules expliquer un désaccord sur des faits.
Méfiance de Darwin, querelle féroce des géologues, ces anecdotes caractérisent bien la société scientifique dans laquelle évoluait le "nouvel Audubon" et l'opposent nettement à celle qui avait vu les discussions mondaines et distanciées d'un Buffon en désaccord avec Linné sur la taxonomie, ou avec Jefferson sur la taille des animaux du Nouveau Monde. Pour suivre le cheminement de Jean-Jacques entre les écueils et les pièges que lui tendait cette société, il faudrait aussi prendre en compte individuellement les attitudes et enjeux des hommes en relation avec lui. Non seulement les Ord et Waterton, les grands ennemis, boucs émissaires auxquels toute biographie de Jean-Jacques fait inévitablement référence, mais aussi les Jameson, Selby, Jardine, Swainson, Children, Bonaparte, etc. Etaient-ils vraiment tous des amis douteux, prompts aux revirements, sournoisement attachés à leurs petits intérêts personnels, comme le pensait Jean-Jacques sur le coup, ou comme une approche historique trop superficielle aurait tendance à les dépeindre ? Probablement pas.
On a vu Jean-Jacques mettre de la naïveté dans sa conception du "fait scientifique", lui qui collectait les témoignages de gens affirmant avoir "vu" des serpents à sonnettes grimper sur des barrières ou sur des arbres, sans imaginer que ces témoins non spécialistes pussent se tromper... Plus étonnante encore est la désinvolture qu'il affichait envers les règles, de plus en plus contraignantes à cette époque, de la collaboration scientifique et de la propriété intellectuelle. Il a été dit et répété qu'il était loin d'avoir dessiné lui-même la totalité des planches de ses Oiseaux d'Amérique. Les Joseph Mason, George Lehman, Maria Martin, ses fils John Woodhouse et Victor Gifford avaient souvent été chargés des décors, de l'environnement végétal et paysagé. John surtout a beaucoup collaboré avec son père, collectant des informations sur le terrain, dessinant en tout ou partie plusieurs oiseaux. Et pourtant, toutes les gravures portent la seule mention : "Drawn from Nature by J.J. Audubon" et le nom de John apparaît à peine dans les biographies d'oiseau de son père.
Il est facile d'illustrer l'attitude de Jean-Jacques vis-à-vis de ses collaborateurs en feuilletant sa correspondance. Voici, par exemple, ce qu'on trouve en l'espace de quelques lignes dans la lettre écrite pour John Bachman le 10 décembre 1834 : "Edward Harris est un bon ami à moi. Je lui ai écrit pour qu'il me fournisse toutes sortes de peaux... La même chose à Harlan... Si vous le pouvez, procurez-vous les expériences faites sur le vautour par le Docteur Leitner... Où est Benjamin Strobel, peut-il nous aider... Ecrivez au Docteur Gibbes et demandez-lui de nous aider aussi... Essayez d'étudier les murs des alligators..." La mobilisation générale, en quelque sorte ! Quant à lui, Bachman était prié de considérer la situation avec désintéressement : "Maintenant mon cher ami, écrivait Jean Jacques, quelque chose en moi me dit que si j'ai la chance de voir la fin de ma publication actuelle, mon nom passera honorablement à la postérité et la situation de mes fils et de leurs familles sera, de cette manière, bien améliorée. Vous êtes [vous, Bachman] un membre de ma famille..." Beau-père de John Woodhouse et plus tard de Victor, Bachman devait travailler pour les Audubon ! Peut-être a-t-il un peu renâclé quand il a vu la biographie du vautour publiée par Jean-Jacques sous son propre nom évidemment, alors que lui, Bachman, en était dans une large mesure l'auteur ! Bah ! N'était-il pas avant tout pasteur luthérien...
A côté de Bachman qui est un cas spécial et de ceux qui fournissaient des spécimens sans avoir d'ambition scientifique personnelle, William MacGillivray apparaît comme un personnage d'une exceptionnelle complaisance. Payé à la page, comme un "nègre", il a lu, corrigé, complété la totalité de Ornithological Biography, ouvrage dont les premiers volumes sont signés du seul Jean-Jacques et dans lequel son nom à lui n'apparaît que sur la fin. Travailleur acharné, MacGillivray a produit par ailleurs une uvre scientifique abondante et de qualité qui suffisait à établir sa réputation à défaut de le faire vivre confortablement. Mais compte tenu des habitudes des milieux scientifiques, les commentateurs d'Audubon se sont extasiés sur son désintéressement, ils se sont étonnés que, à un moment ou l'autre, MacGillivray ne soit pas revenu sur l'accord passé avec Audubon, et se soit contenté d'être mentionné en fin d'ouvrage. MacGillivray écrivit un jour (7 mars 1833) à Jean-Jacques alors en Amérique, "depuis votre départ, je n'ai pas rencontré un ami tel que vous". Il avait pour lui une estime profonde, et il a traversé l'histoire de Jean-Jacques comme une ombre légère, énigmatique, que l'on connaît peu finalement, parce que les gens complaisants laissent moins de traces que les querelleurs.
Il fut bien le seul ! Tous ceux avec lesquels Jean-Jacques pouvait se trouver en conflit d'intérêt se sont méfiés, protégés, quand ce n'étaient pas eux qui cherchaient à exploiter le "nouvel Audubon", qui voulaient empêcher sa réussite, voire copier son uvre et même en venir au plagiat pur et simple, comme le firent Joseph B. Kidd, Thomas Brown et Thomas D. Lauder dans leur "Miscellany of Natural History". Alors qu'il faudrait écrire un livre pour tout raconter et analyser cas par cas, je me contenterai de quelques mots à propos de William Swainson. Etait-il un ami sincère de Jean-Jacques, ou le détestait-il ? Etait-ce un pisse-vinaigre, un instable qui défendait un jour le "nouvel Audubon" pour le dénigrer le lendemain, un querelleur toujours en bute à ses confrères ? Son besoin d'argent et sa tentative d'en emprunter à Jean-Jacques ont-ils faussé leurs relations ? Peut-être tout à la fois, mais le vrai problème entre eux a été qu'Audubon a voulu lui faire jouer le rôle effacé qu'acceptait le brave MacGillivray. "Devrais-je donner toute l'information scientifique que j'ai travaillé à acquérir pendant vingt ans d'ornithologie, taire mon nom, et transférer ma réputation dans vos écrits, pour votre propre réputation", voilà ce que Swainson gardait en travers de la gorge (lettre à Audubon du 2 octobre 1830). Il partageait pleinement l'éthique des hommes de science de son temps, du nôtre aussi d'ailleurs, et c'est cela qui est significatif et qu'il faut retenir, plus que les petitesses ou les erreurs d'un personnage se débattant dans mille difficultés.
Le British Museum était méfiant vis-à-vis de Jean-Jacques, la Zoological Society était agitée par de violentes divergences d'opinion, ainsi que le dit Alice Ford à qui rien n'échappe. Nous le voyons bien, l'exemple de la Geological Society donné plus haut est loin d'être unique. Les hommes de science ne sont pas gens spécialement querelleurs mais, ayant pour rôle de produire des connaissances, tiennent pour indispensable de contrôler les nouveautés, réfuter les erreurs, parvenir à des consensus. Faire le ménage de la science, si l'on préfère. En dehors de l'affaire des serpents grimpeurs que lui aussi gardait en travers de la gorge, le "nouvel Audubon" avait choisi d'ignorer superbement ces manières de faire. D'autres que lui, son fils Victor Gifford, l'ami Bachman et même le douteux Swainson s'agitaient parfois à le défendre dans les journaux scientifiques. Lui-même n'en avait pas le temps, pas le goût, et n'ayant jamais eu de formation académique, pas toujours les moyens intellectuels. Peu ouvert à une vue critique de la vérité scientifique, peu délicat dans l'utilisation de ses collaborateurs, indifférent à la vie des communautés scientifiques quand cela ne lui était pas indispensable, Jean-Jacques a traversé en porte-à-faux une société dans laquelle il fallait pourtant bien qu'il se fasse une place.
Pauvre Jean-Jacques, que l'anxiété rendait dyspepsique, qui s'épuisait au travail un peu pour sa propre gloire, beaucoup pour le bien matériel de sa famille, plus encore pour ouvrir à tous les beautés de la Nature !
Mais aussi, heureux Jean-Jacques, dans sa nouvelle métamorphose, qui ignorait si allègrement les us et coutumes de la vie scientifique ! Ne se comportait-il pas comme, autrefois, un Comte de Buffon peu embarrassé à exploiter son collaborateur Daubenton ou le plus lointain Réaumur, et peu soucieux de régler ses comptes avec ses détracteurs ? Ou comme le Baron Alexander von Humboldt guère empressé à faire savoir l'aide apportée par Aimé Bonpland dans son voyage aux "régions équinoxiales" ?
Audubon ? Un grand seigneur, à sa manière, que ce "woodsman"...
Signature :
Yvon Chatelin
L'anecdote concernant Henry De la Bèche proviennent du remarquable ouvrage de Martin J.S. Rudwick, The Great Devonian Controversy, The University of Chicago Press, 1985.
Lire plus
Cet homme étonnant a eu des biographes remarquables, les Herrick, Alice Ford, Stanley Clisby Arthur, Alexander Adams, parfois de moins bons, ou de médiocres. D'autres auteurs ont été les analystes éclairés de son uvre scientifique et artistique, d'autres encore des vulgarisateurs compétents et honnêtes. Tous ensemble ont porté la masse des documents écrits sur Jean-Jacques à des milliers de pages. J'en ai publié près de cinq cents de plus, parce que je voulais éclairer sa personnalité profonde en la débarrassant des petitesses, des incompréhensions, des méchancetés qui sont venues ternir son image, et en lui donnant des racines culturelles prises aux sources du rousseauisme. Jean-Louis Lavigne, merci à lui, a pu dire : "Yvon Chatelin replace le parcours d'Audubon dans le contexte culturel de l'époque et livre les clefs essentielles de sa personnalité scientifique et artistique, ce qui n'avait jamais été fait" (Ouest-France, 2-3 février 2002). Mais je peux ajouter que, ma dernière page terminée, j'avais le sentiment que mon sujet était loin d'être épuisé.
A défaut d'entreprendre dans la foulée un deuxième ouvrage, j'ai laissé dans mon texte un jalon que je me réservais de retrouver, tel un petit bout de chanvre à peine visible mais sur lequel il suffit de tirer pour découvrir un nouveau fil d'Ariane qui va se dévider. Ce jalon tient en peu de mots, c'est l'expression "le nouvel Audubon" que le lecteur voit apparaître dans le récit de la période où Jean-Jacques est reçu par le Président des Etats-Unis, où il embarque sur des navires de la marine américaine comme le Spark ou sur des garde-côtes comme le Marion mis au service de ses oiseaux, où le Ripley affrété par lui pour aller au Labrador est salué à sa sortie du port par une salve de coups de canon. Quelle métamorphose pour l'ancien vagabond ! Je conviens avoir, dans ma biographie, mis l'accent et le plus grand nombre de pages sur la vie d'Audubon jusqu'au moment où cette grande et très visible métamorphose s'est produite, à partir de l'année 1829. Non que la seconde période de sa vie m'eut parue de moindre intérêt, mais parce que pour la décrire et l'analyser comme la première il eut fallu à nouveau composer tout un paysage social et présenter de nouvelles personnalités et communautés d'hommes de science. En quelques mots, voici une ébauche de ce que j'aurais aimer développer à propos de cette seconde période.
Le "nouvel Audubon" me semble au mieux de son personnage et de son entourage lors du troisième séjour qu'il fit en Grande-Bretagne, entre le 7 mai 1834, date de son arrivée à Liverpool, et son départ pour le voyage au Texas, le 2 août 1836. Le Jean-Jacques du premier séjour anglais qui amusait ses amis Rathbone en poussant des cris d'oiseaux, qui tentait de paraître "well off" (à l'aise financièrement) tout en vivant dans de modestes chambres de location, était bien loin. La "manie ambulante" n'était pas apaisée, et l'on trouve Jean-Jacques, quand il n'était pas en déplacement d'une ville à l'autre, habitant bourgeoisement Edimbourg au 5 India Street, Londres au 5 Lothian Road puis au 4 Wimpole Street. C'est là justement, dans la maison de Wimpole Street, qu'il me semble que la famille Audubon a trouvé son apogée sociale. Car Jean-Jacques n'était plus seul. Il avait fait venir Lucy, autrefois si longtemps livrée à elle-même, ses fils Victor et John rarement vus par lui dans leur adolescence et qui, abandonnant la carrière à laquelle ils se préparaient en Amérique, suivaient la fortune paternelle.
Lucy était destinée à une très longue vie et avait toujours eu une santé de fer, sauf en Angleterre où elle était sans cesse malade. Une mauvaise adaptation au climat, ou peut-être une manière à elle de protester contre une transplantation qu'elle n'avait pas désirée. Les fils, eux, menaient la grande vie. Ils voyageaient. Victor et John sont allés chacun à leur tour en France, Victor et John ont visité le Pays de Galles, Victor et John sont partis ensemble pour Rome. Ils ambitionnaient devenir de grands peintres et protestèrent quand leur père les fit venir d'Edimbourg à Londres sans Joseph B. Kidd qui leur servait en quelque sorte de professeur particulier. La maison de Wimpole Street offrit en compensation à ces deux "lads" du Kentucky l'occasion de se dégrossir au contact de gens raffinés. Jean-Jacques était au mieux avec le Duc du Sussex, avec Lord Stanley, Lord Carnavon, le Comte de Derby, et d'autres aristocrates. Jean-Jacques attirait des intellectuels, hommes de lettres comme Robert Bell, Charles Wentworth Dilke, Henri Chorley, artistes peintres comme John Gould, Edward Lear. Jean-Jacques était lié d'amitié avec la grande famille des Kemble qui étaient tous gens de théâtre et shakespeariens réputés. C'était aussi l'époque où les peintres portraitistes cherchaient à laisser leur signature sous les traits du grand homme. Le portrait fait par Cruikshank était reproduit par en gravures multipliées et diffusées en grand nombre. Toujours à Wimpole Street, quelques années plus tard (1838), Healy entreprenait de représenter un Jean-Jacques dans la maturité, à l'expression douce et nostalgique. Cet intérêt des portraitistes est un bon indicateur de célébrité !
Plus encore que ces cercles mondains et cultivés, le milieu des hommes de science doit être considéré en toile de fond du comportement du "nouvel Audubon", car c'est ce milieu scientifique qui avait le pouvoir de cautionner ou de discréditer "the great work", la grande oeuvre de Jean-Jacques, les Oiseaux d'Amérique. C'était un milieu en pleine mutation, dont les effectifs se multipliaient, qui se cherchait de nouveaux consensus, de nouvelles règles de travail, une nouvelle éthique plus exigeante que celle des décennies passées. Avec pour corrélat un sens plus strict de la propriété intellectuelle, une compétition plus vive, des conflits qui se durcissent. On a tendance, bien sûr, à voir une évolution régulière et normale dans le temps, à dire des choses comparables pour toutes les époques par rapport à leur passé. Cependant, entre la génération qui a vu Jean-Jacques jeune, que j'ai beaucoup décrite, et celle dans laquelle évoluait le "nouvel Audubon" et que j'ai peu abordée dans mon livre, les différences sont frappantes.
Faut-il en proposer une illustration ? La taxonomie botanique de Linné, en plein dix-huitième siècle, a soulevé un enthousiasme extraordinaire mais n'a pourtant pas fait l'unanimité. Buffon, qui avait des lecteurs enthousiastes lui aussi, n'était pas favorable à cette taxonomie basée exclusivement sur les organes floraux. Eh quoi, ronchonnait-il dans son "Histoire Naturelle", les racines, les branches, le tronc des arbres, leur taille, tout cela ne servira à rien ! Les choses n'allaient pas plus loin. Un demi-siècle plus tard, Charles Darwin ruminait dans la solitude de son jardin la théorie de l'évolution des espèces. (Pour la petite histoire, il faut rappeler que Darwin jeune avait assisté à des exposés de Jean-Jacques à Edimbourg, comme l'a retrouvé Jean-Yves Noblet. On peut ajouter aussi que Jean-Jacques connaissait bien John S. Henslow (professeur à Cambridge) qui comptait Darwin parmi ses étudiants.) Cette parenthèse fermée, rappelons qu'il fallut qu'un autre naturaliste, Alfred Wallace, ébauche une théorie évolutionniste semblable à la sienne pour que Darwin, après s'être longtemps abstenu par crainte des critiques et des conflits, se mette à découvert, exigeant d'être reconnu comme le véritable père de la théorie de l'évolution.
On ne peut donner tort à Darwin de s'être méfié quand on connaît la terrible querelle qui a éclaté en 1834, en pleine période du "nouvel Audubon", à la Société géologique de Londres. L'objet de cette querelle : la stratigraphie du dévonien. Elle n'avait aucun enjeu philosophique, mais elle a pourtant secoué toute la communauté des géologues anglais, menacé certains d'eux dans leur emploi, elle s'est étendue en France et même jusqu'en Russie. Aujourd'hui encore il est difficile de dire qui avait tort ou raison, mais ceux qui furent socialement les perdants sont clairement identifiés. L'un d'eux fut Adam Sedgwick, Professeur à Cambridge, que Charles Darwin (encore lui !) avait accompagné un moment sur le terrain, avant de partir sur le Beagle, et que Jean-Jacques connaissait bien, le deuxième et plus grand perdant, Henry T. De la Bèche.
De la Bèche était bon dessinateur et agrémentait ses notes personnelles de caricatures. Sur une d'elles, il se représente, au cours d'une séance de la Geological Society, montrant du doigt son nez en disant : "Mais ceci est mon nez, gentlemen !". Le groupe des géologues incrédules réplique pompeusement : "Mon cher ami ! Ce que vous dîtes de vous-même peut être très bon, mais nous vous avons classé, avant de vous voir, dans le groupe des hommes sans nez, et il n'est pas possible que vous ayez un nez !" De la Bèche intitulait cette scène "Preconceived opinions versus facts". Il croyait les faits scientifiques évidents, faciles à établir, comme Jean-Jacques d'ailleurs qui répétait si souvent : je n'écris que des faits et les Philadelphiens me traitent de menteur ! L'un et l'autre se trompaient en croyant que des idées préconçues ou la mauvaise foi pouvaient seules expliquer un désaccord sur des faits.
Méfiance de Darwin, querelle féroce des géologues, ces anecdotes caractérisent bien la société scientifique dans laquelle évoluait le "nouvel Audubon" et l'opposent nettement à celle qui avait vu les discussions mondaines et distanciées d'un Buffon en désaccord avec Linné sur la taxonomie, ou avec Jefferson sur la taille des animaux du Nouveau Monde. Pour suivre le cheminement de Jean-Jacques entre les écueils et les pièges que lui tendait cette société, il faudrait aussi prendre en compte individuellement les attitudes et enjeux des hommes en relation avec lui. Non seulement les Ord et Waterton, les grands ennemis, boucs émissaires auxquels toute biographie de Jean-Jacques fait inévitablement référence, mais aussi les Jameson, Selby, Jardine, Swainson, Children, Bonaparte, etc. Etaient-ils vraiment tous des amis douteux, prompts aux revirements, sournoisement attachés à leurs petits intérêts personnels, comme le pensait Jean-Jacques sur le coup, ou comme une approche historique trop superficielle aurait tendance à les dépeindre ? Probablement pas.
On a vu Jean-Jacques mettre de la naïveté dans sa conception du "fait scientifique", lui qui collectait les témoignages de gens affirmant avoir "vu" des serpents à sonnettes grimper sur des barrières ou sur des arbres, sans imaginer que ces témoins non spécialistes pussent se tromper... Plus étonnante encore est la désinvolture qu'il affichait envers les règles, de plus en plus contraignantes à cette époque, de la collaboration scientifique et de la propriété intellectuelle. Il a été dit et répété qu'il était loin d'avoir dessiné lui-même la totalité des planches de ses Oiseaux d'Amérique. Les Joseph Mason, George Lehman, Maria Martin, ses fils John Woodhouse et Victor Gifford avaient souvent été chargés des décors, de l'environnement végétal et paysagé. John surtout a beaucoup collaboré avec son père, collectant des informations sur le terrain, dessinant en tout ou partie plusieurs oiseaux. Et pourtant, toutes les gravures portent la seule mention : "Drawn from Nature by J.J. Audubon" et le nom de John apparaît à peine dans les biographies d'oiseau de son père.
Il est facile d'illustrer l'attitude de Jean-Jacques vis-à-vis de ses collaborateurs en feuilletant sa correspondance. Voici, par exemple, ce qu'on trouve en l'espace de quelques lignes dans la lettre écrite pour John Bachman le 10 décembre 1834 : "Edward Harris est un bon ami à moi. Je lui ai écrit pour qu'il me fournisse toutes sortes de peaux... La même chose à Harlan... Si vous le pouvez, procurez-vous les expériences faites sur le vautour par le Docteur Leitner... Où est Benjamin Strobel, peut-il nous aider... Ecrivez au Docteur Gibbes et demandez-lui de nous aider aussi... Essayez d'étudier les murs des alligators..." La mobilisation générale, en quelque sorte ! Quant à lui, Bachman était prié de considérer la situation avec désintéressement : "Maintenant mon cher ami, écrivait Jean Jacques, quelque chose en moi me dit que si j'ai la chance de voir la fin de ma publication actuelle, mon nom passera honorablement à la postérité et la situation de mes fils et de leurs familles sera, de cette manière, bien améliorée. Vous êtes [vous, Bachman] un membre de ma famille..." Beau-père de John Woodhouse et plus tard de Victor, Bachman devait travailler pour les Audubon ! Peut-être a-t-il un peu renâclé quand il a vu la biographie du vautour publiée par Jean-Jacques sous son propre nom évidemment, alors que lui, Bachman, en était dans une large mesure l'auteur ! Bah ! N'était-il pas avant tout pasteur luthérien...
A côté de Bachman qui est un cas spécial et de ceux qui fournissaient des spécimens sans avoir d'ambition scientifique personnelle, William MacGillivray apparaît comme un personnage d'une exceptionnelle complaisance. Payé à la page, comme un "nègre", il a lu, corrigé, complété la totalité de Ornithological Biography, ouvrage dont les premiers volumes sont signés du seul Jean-Jacques et dans lequel son nom à lui n'apparaît que sur la fin. Travailleur acharné, MacGillivray a produit par ailleurs une uvre scientifique abondante et de qualité qui suffisait à établir sa réputation à défaut de le faire vivre confortablement. Mais compte tenu des habitudes des milieux scientifiques, les commentateurs d'Audubon se sont extasiés sur son désintéressement, ils se sont étonnés que, à un moment ou l'autre, MacGillivray ne soit pas revenu sur l'accord passé avec Audubon, et se soit contenté d'être mentionné en fin d'ouvrage. MacGillivray écrivit un jour (7 mars 1833) à Jean-Jacques alors en Amérique, "depuis votre départ, je n'ai pas rencontré un ami tel que vous". Il avait pour lui une estime profonde, et il a traversé l'histoire de Jean-Jacques comme une ombre légère, énigmatique, que l'on connaît peu finalement, parce que les gens complaisants laissent moins de traces que les querelleurs.
Il fut bien le seul ! Tous ceux avec lesquels Jean-Jacques pouvait se trouver en conflit d'intérêt se sont méfiés, protégés, quand ce n'étaient pas eux qui cherchaient à exploiter le "nouvel Audubon", qui voulaient empêcher sa réussite, voire copier son uvre et même en venir au plagiat pur et simple, comme le firent Joseph B. Kidd, Thomas Brown et Thomas D. Lauder dans leur "Miscellany of Natural History". Alors qu'il faudrait écrire un livre pour tout raconter et analyser cas par cas, je me contenterai de quelques mots à propos de William Swainson. Etait-il un ami sincère de Jean-Jacques, ou le détestait-il ? Etait-ce un pisse-vinaigre, un instable qui défendait un jour le "nouvel Audubon" pour le dénigrer le lendemain, un querelleur toujours en bute à ses confrères ? Son besoin d'argent et sa tentative d'en emprunter à Jean-Jacques ont-ils faussé leurs relations ? Peut-être tout à la fois, mais le vrai problème entre eux a été qu'Audubon a voulu lui faire jouer le rôle effacé qu'acceptait le brave MacGillivray. "Devrais-je donner toute l'information scientifique que j'ai travaillé à acquérir pendant vingt ans d'ornithologie, taire mon nom, et transférer ma réputation dans vos écrits, pour votre propre réputation", voilà ce que Swainson gardait en travers de la gorge (lettre à Audubon du 2 octobre 1830). Il partageait pleinement l'éthique des hommes de science de son temps, du nôtre aussi d'ailleurs, et c'est cela qui est significatif et qu'il faut retenir, plus que les petitesses ou les erreurs d'un personnage se débattant dans mille difficultés.
Le British Museum était méfiant vis-à-vis de Jean-Jacques, la Zoological Society était agitée par de violentes divergences d'opinion, ainsi que le dit Alice Ford à qui rien n'échappe. Nous le voyons bien, l'exemple de la Geological Society donné plus haut est loin d'être unique. Les hommes de science ne sont pas gens spécialement querelleurs mais, ayant pour rôle de produire des connaissances, tiennent pour indispensable de contrôler les nouveautés, réfuter les erreurs, parvenir à des consensus. Faire le ménage de la science, si l'on préfère. En dehors de l'affaire des serpents grimpeurs que lui aussi gardait en travers de la gorge, le "nouvel Audubon" avait choisi d'ignorer superbement ces manières de faire. D'autres que lui, son fils Victor Gifford, l'ami Bachman et même le douteux Swainson s'agitaient parfois à le défendre dans les journaux scientifiques. Lui-même n'en avait pas le temps, pas le goût, et n'ayant jamais eu de formation académique, pas toujours les moyens intellectuels. Peu ouvert à une vue critique de la vérité scientifique, peu délicat dans l'utilisation de ses collaborateurs, indifférent à la vie des communautés scientifiques quand cela ne lui était pas indispensable, Jean-Jacques a traversé en porte-à-faux une société dans laquelle il fallait pourtant bien qu'il se fasse une place.
Pauvre Jean-Jacques, que l'anxiété rendait dyspepsique, qui s'épuisait au travail un peu pour sa propre gloire, beaucoup pour le bien matériel de sa famille, plus encore pour ouvrir à tous les beautés de la Nature !
Mais aussi, heureux Jean-Jacques, dans sa nouvelle métamorphose, qui ignorait si allègrement les us et coutumes de la vie scientifique ! Ne se comportait-il pas comme, autrefois, un Comte de Buffon peu embarrassé à exploiter son collaborateur Daubenton ou le plus lointain Réaumur, et peu soucieux de régler ses comptes avec ses détracteurs ? Ou comme le Baron Alexander von Humboldt guère empressé à faire savoir l'aide apportée par Aimé Bonpland dans son voyage aux "régions équinoxiales" ?
Audubon ? Un grand seigneur, à sa manière, que ce "woodsman"...
Signature :
Yvon Chatelin
L'anecdote concernant Henry De la Bèche proviennent du remarquable ouvrage de Martin J.S. Rudwick, The Great Devonian Controversy, The University of Chicago Press, 1985.
Audubon et la Science : ou Un méconnu à redécouvrir ?
Après avoir publié "Audubon - Peintre, naturaliste, aventurier" aux Editions France Empire en 2001, j'ai été amené à faire sur le personnage et sur son uvre des causeries accompagnées de la projection d'images numériques nombreuses, le tout orienté selon le public attendu. Pour des amateurs de sciences naturelles, je prenais les oiseaux et leurs images comme thème principal, j'insistais sur l'Histoire pour des associations culturelles franco-américaines, je présentais surtout les origines d'Audubon dans la région où il avait vécu sa jeunesse. Pour l'assistance venant un jour de 2004 dans l'amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, il me parut nécessaire de traiter surtout le travail scientifique d'Audubon et les relations personnelles ou sociales entraînées par ce travail. Le texte qui suit n'est pas la transcription des propos tenus dans une causerie qui a consister beaucoup à commenter des images, mais il en reprend l'esprit dans une mise en forme écrite plus classique.
Personnage éminemment complexe, l'homme Audubon (1785-1851), apparaît tout d'abord comme un témoin, un repère facile dont on suit la trace dans les remous de l'Histoire. Créole né sous le nom de Jean Rabin à Saint-Domingue (Haïti), à la veille de la révolution des esclaves, il reçut à Nantes le nom de Jean-Jacques Audubon au plus fort de la Révolution française, et choisit de devenir John James Audubon, citoyen américain, en 1812. Sa vie s'acheva à New York après qu'il eût fréquenté toutes les classes sociales de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ses biographes donnent de lui l'image attachante d'un naturaliste d'autrefois (F. Herrick, Audubon the Naturalist, 1917), d'un homme de passions et d'aventures (A. Ford, J.J. Audubon, 1964), d'un personnage porté par le courant des idées post-rousseauistes (Y. Chatelin, Audubon - Peintre, naturaliste, aventurier, 2001), d'un émigré s'épanouis-sant dans les valeurs de la vie américaine (R. Rhodes, J.J. Audubon - The Making of an American, 2004).
L'écrivain Audubon, ensuite, est salué comme un excellent story teller, conteur d'histoires vécues ou à peine déformées par l'imagination et, peut-être, par une touche de mythomanie. Si un public intéressé par les voyages du passé, les aventures, l'exotisme, le lit aujourd'hui encore, c'est surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'il a retenu l'attention des gens de lettres. Philarète Chasles, Eugène Bazin, Alphonse de Lamartine, et même Jules Michelet se sont penchés sur ses écrits. Lamartine (Cours familier de littérature, 1865), notamment, voyait en lui le premier écrivain émergeant d'une expérience authentiquement américaine (et en cela nécessairement liée à la Nature), ses contemporains ou prédécesseurs américains n'étant, au plus, disait-il, que des imitateurs de Walter Scott et autres romantiques européens.
L'artiste Audubon, enfin, ou plus précisément dit, le peintre naturaliste, n'a pas besoin de longue présentation, car des masses de livres, de reproductions, de posters, de timbres-postes, d'expositions, de multiples galeries d'art, de nombreuses ventes aux enchères attestent de sa célébrité. Ses gravures des oiseaux d'Amérique (The Birds of America) sont un chef-d'uvre incontesté et celles sur les mammifères (Quadrupeds of North America), moins exceptionnelles, suffiraient à une honorable réputation.
Un naturaliste reconnu
mais controversé
Il n'en est plus de même pour l'homme de science Audubon. Avant d'aborder les aspects méconnus de ce personnage, il convient d'établir la part de ce qui est cependant admis largement.
En plusieurs dizaines d'années, Audubon a parcouru les Etats-Unis de son époque, entre rivage de l'Atlantique et Mississippi, poussant quelques expéditions au-delà, jusqu'au Labrador, Texas, haut Missouri. Il y a collecté une masse considérable d'observations, a découvert 23 espèces (ou sous-espèces) d'oiseaux. Souvent il s'agissait d'individus petits et modestes, passés jusqu'alors inaperçus, mais c'était parfois aussi un oiseau exceptionnel, comme le grand héron à phase blanche qui étonne par sa taille, sa beauté, et qui forme, avec celui à phase bleue (connu et décrit longtemps avant Audubon), une seule espèce (Ardea occidentalis). On attribue aussi à Audubon le mérite d'avoir décrit et magnifiquement représenté 5 oiseaux (quatre espèces et une sous-espèce) actuellement totalement éteints, parmi lesquels le pigeon migrateur (Ectopistes migratorius) et la perruche de Caroline (Conuropsis carolinensis), deux oiseaux dont la navrante histoire est connue de tous les amateurs d'ornithologie. Travail d'inventaire et d'indispensable taxonomie : voilà le premier aspect positif et indiscutable de l'uvre scientifique d'Audubon.
Les naturalistes de cabinet et les purs taxonomistes ont été l'objet de fréquentes railleries de sa part. "J'aurais bien moins de plaisir, disait-il, à présenter au monde savant un nouvel oiseau dont j'ignorerais les habitudes, qu'à décrire les particularités et les murs d'un autre déjà depuis longtemps découvert." (O.B.). Plus biologiste que taxonomiste, il est parvenu à édifier de bonnes connaissances de la dynamique des populations. Par exemple, il évaluait la capacité de reproduction du pigeon migrateur et la trouvait supérieure aux déprédations humaines (lors des années 1810, car ces déprédations s'accélérèrent par la suite). Mais, faisant le bilan, il pensait que mise en culture et dégradation des forêts conduisaient au déclin des pigeons. D'autres oiseaux étaient menacés parce que les hommes détruisaient leurs nids et leurs ufs, amenant les femelles à pondre à nouveau, ce qui, selon lui, épuisait leurs forces. L'homme était aux yeux d'Audubon le "tyran de la Création", un "pirate" qui menait une "guerre d'extermination". Une certaine approche de la notion d'écosystème et un sens déjà évolué de la conservation de la Nature ne peuvent lui être déniés.
De son temps, Audubon a été encensé par le public, par une grande majorité de spécialistes et vilipendé par une petite poignée d'irréductibles ennemis. Les erreurs scientifiques qu'il a commises sont presque toutes des fautes dans l'identification des espèces. Le plus grave a été de se tromper sur le serpent à sonnettes (Crotalus horridus) et de croire à des fables racontées à son sujet dans des milieux populaires, ce qui a alimenté les querelles qui lui ont été faites. Peu de chose, à nos yeux d'aujourd'hui.
Un parcours scientifique
soutenu par des rencontres
Fondamentalement, Audubon fut un autodidacte qui regrettait de ne pas avoir reçu d'éducation scientifique formelle, mais qui ne s'est pas fait totalement seul.
Lors de sa jeunesse, il a reçu une certaine initiation, probablement courte, à l'étude des oiseaux par François-René Dubuisson (d. 1836), droguiste, dont le cabinet d'histoire naturelle fut le point de départ du Muséum de Nantes. Il eut aussi et surtout pour ami et mentor le docteur Charles-Marie Dessalines d'Orbigny (1770-1856), père du célèbre Alcide d'Orbigny, et dont les collections sont à l'origine d'un autre Muséum, celui de La Rochelle. Qu'apprit-il de d'Orbigny ? Les indices qui nous restent laissent supposer qu'il travailla avec lui selon les principes de Mathurin Jacques Brisson, ennemi de la taxonomie linnéenne et qui construisit son propre système de classification (Ornithologie, ou 1760). Il est certain d'autre part que le jeune Audubon fut un lecteur assidu de l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon.
Menant ensuite une vie errante en Amérique, Audubon fut longtemps livré à lui-même et mûrit dans un face-à-face solitaire avec un livre de référence, l'American Ornithology de son prédécesseur Alexander Wilson (1766-1813). Les deux hommes se rencontrèrent à deux reprises, en 1810 et 1812, sans parvenir à établir de bonnes relations personnelles. Cependant, autodidacte comme lui, Wilson était un bel exemple à suivre et surpasser, et cet exemple resta présent à l'esprit d'Audubon pendant toutes les années qui suivirent leurs rencontres et qu'il consacra à l'étude des oiseaux. Sur le plan artistique, surpasser Wilson était facile pour lui. Sur le plan scientifique cela signifiait simplement trouver et décrire davantage d'oiseaux, corriger quelques erreurs, sans impliquer de changement de méthodologie. Faire plus, faire mieux suffisaient.
Lorsqu'enfin, en 1824, son portfolio contint suffisamment de portraits d'oiseaux, Audubon se rendit à Philadelphie puis New York. Il avait des dessins de grande valeur artistique à éditer et commercialiser, il voulait en retirer de l'argent, se faire une réputation, mais il n'avait aucune collection ni texte scientifiques à présenter. Néanmoins, c'est aux hommes de science des deux villes qu'il s'adressa immédiatement. Pourquoi ce choix s'imposa-t-il à lui, quand il eût pu faire carrière simplement en artiste ? Question sans réponse peut-être, mais qui montre qu'Audubon suivait le même chemin que Wilson. Il se mettait à la merci des hommes de science, une corporation redoutable, car dotée de capacités de jugement et d'autorité.
Le résultat ne se fit pas attendre. Chef de file des naturalistes l'Academy of Natural Sciences de Philadelphie, George Ord (1781-1866) devint immédiatement l'ennemi acharné d'Audubon et parvint presque à ruiner à jamais son entreprise. On apprend certaines choses dans ces cas-là, et Audubon doit sans doute à Ord la prudence scientifique à laquelle il tenta de s'astreindre par la suite. Un autre personnage important rencontré à Philadelphie était Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857). Audubon allait entretenir longtemps avec lui des relations de fausse amitié et de rivalité cachée. Bonaparte était un taxonomiste, sans pratique de terrain, il aurait aimé prendre Audubon comme dessinateur appointé et dût se contenter de piller certaines de ses connaissances. Leur relation fut cependant positive pour Audubon qui apprit, à son contact, la nécessité de constituer des collections de référence et d'atteindre plus de fiabilité dans le travail de nomenclature et taxonomie.
En cette même année 1824, deux naturalistes de New York, Samuel Latham Mitchill (1764-1831) et James Ellsworth De Kay (1792-1851), eurent une attitude différente de celle de George Ord. Ils se montrèrent bienveillants, permirent une exposition des dessins d'Audubon et lui demandèrent une communication sur les hirondelles (Hirundo fulva) à publier dans les Annales de leur institution, le Lyceum of Natural History. Audubon n'y était pas préparé et n'avait qu'une maîtrise imparfaite de la langue anglaise. Il franchit néanmoins ce premier pas et fit une modeste entrée dans la communauté des hommes de science, avec un texte court, consacré principalement aux migrations des hirondelles.
Le scénario se répéta deux années plus tard, à son arrivée à Edimbourg, avec plus d'ampleur et de succès. Le professeur Robert Jameson (1774-1854) voulut bien aider Audubon, lui permettre d'exposer ses uvres, le soutenir par ses relations, lui ouvrir les collections d'histoire naturelle de la ville, mais, en contrepartie, lui demanda des articles pour la revue qu'il dirigeait, le Edinburgh New Philosophical Journal. Publier constituait une porte d'entrée incontournable : Audubon s'exécuta et se fit connaître par des textes sur les murs de l'alligator, du vautour, du serpent à sonnettes, du pigeon migrateur. Soutenu par les hommes de science, il trouva les graveurs et les clients dont il avait besoin. Il prit soin de mentionner, sur la couverture de ses recueils de gravures, toutes les sociétés savantes qui l'accueillirent (Royal Society, Wernerian Soc., Linnean Soc. & al.).
Quelques années après, l'édition des gravures allait vers son achèvement, leur commercialisation progressait de façon satisfaisante. Mais la clientèle attendait davantage et souhaitait un travail d'ornithologie complet avec, pour commenter chaque gravure, des textes descriptifs et scientifiques. Audubon se mit à son écritoire et produisit les quatre gros volumes de Ornithological Biography (O.B.). Il s'assura l'aide d'un universitaire, MacGillivray (1796-1851), qui lui fut utile sur le plan du langage et apporta aussi un certain contrôle scientifique.
Les principaux tournants de sa carrière se firent dans ces conditions. Audubon rencontra de nombreux autres hommes de science dont on ne peut dire avec précision l'influence qu'ils eurent sur lui : les ornithologues Jardine, Selby, Swainson, le tout jeune Darwin simplement entrevu lors de réunions scientifiques, ou Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, grands maîtres d'une "anatomie comparée" inutile pour lui car elle dépassait ses capacités et ses ambitions. John Bachman, son ami et parent par alliance, est un cas à part. Bachman aida considérablement Audubon, le soutint dans ses querelles, mais probablement sans donner d'infléchissement particulier à ses orientations scientifiques.
Approche expérimentale
et science du comportement
Les aptitudes d'Audubon et sa tournure d'esprit spontanée apparaissent le plus clairement dans ses premières activités. Par la suite, il subit les influences que nous venons de décrire, il fut pris dans l'engrenage des milieux lettrés, artistiques, mondains qu'il eut à fréquenter, il eut à tenir compte des exigences de sa clientèle. S'il parvint à toujours progresser ou garder la même qualité sur le plan artistique, pour le reste, ses capacités d'innovation furent bridées par le manque de temps et une surcharge de travail accablante.
Dès le départ, il fut un homme du pratique et du concret, ayant le goût de manipuler la matière et les objets. Ses portraits d'oiseaux originaux ne furent pas comme on le dit par simplification des "aquarelles", mais le produit d'une "technique mixte" utilisant aussi le pastel, la gouache, l'huile, le vernis ou, plus rares, le blanc d'uf et le bouchon brûlé. Il n'avait pas vingt ans lorsqu'il inventa la "planche de position" sur laquelle il fixait par des aiguilles et fils métalliques les oiseaux morts lui servant de modèles.
Aussi, de l'observation ornithologique pure, est-il passé facilement à l'expérimentation. Peu après son arrivée en Pennsylvanie, il eut l'idée de baguer des moucherolles phébi (Sayornis phoebe) et de contrôler ainsi leur retour, à la migration de printemps, dans le nid de la saison précédente. Bien que l'on puisse trouver dans l'histoire de l'ornithologie d'autres essais de marquage d'oiseaux antérieurs au sien, c'était une grande invention de sa part et, en tout cas, le premier baguage du Nouveau Monde.
Installé plus tard en Louisiane, Audubon se mit à des expériences sérieuses sur les capacités olfactives attribuées traditionnellement aux vautours (Cathartes atratus, Cathartes aura). Les protocoles étaient simples, mais démonstratifs. En des conditions variées, il cachait des charognes et constatait que les vautours ne s'en approchaient pas, ou exposait de fausses carcasses d'animaux vers lesquelles ils se précipitaient. Il mit ainsi un terme à une légende longtemps admise même dans les milieux scientifiques.
Chaque fois qu'il en a trouvé la possibilité, Audubon s'est livré à de petites expérimentations. Par exemple, il obturait artificiellement l'arbre creux fréquenté par des martinets ramoneurs (Chaetura pelagica) pour étudier leurs capacités visuelles et leur comportement dans des situations inattendues. Rompu à toutes les techniques de la chasse, à l'utilisation des leurres, habitué à l'élevage en captivité d'espèces sauvages, il a multiplié les essais, les expériences, comme le font d'ailleurs beaucoup d'hommes ordinaires qui vivent par nécessité auprès des animaux. Son esprit expérimental s'accordait parfaitement à son désir d'étudier les comportements.
En ce dernier domaine, celui des comportements, son acquis est considérable. Audubon s'indignait de l'attribution de stupidité que l'on porte à des oiseaux comme les dindons, ou les oies. Surpris par la pertinence de leurs réactions à des situations difficiles, il s'interrogeait : "Était-ce le résultat de l'instinct, ou de la raison ou l'acte d'un esprit intelligent ?" (O.B.) Il s'attachait en toute occasion à montrer des attitudes ou sentiments comme l'attention, l'affection, l'amour dans le couple et envers les petits, le désarroi devant la destruction d'ufs ou la mort d'oisillons. Attribuer des sentiments à des oiseaux était mal compris à son époque, et on lui a longtemps reproché de faire de l'anthropomorphisme dans sa façon de les comprendre et de les décrire.
Parades de séduction, méthodes de construction des nids, choix de leurs emplacements, ruses des prédateurs pour atteindre leurs proies, ruses de celles-ci pour se défendre, techniques de guet, de fuite ou de diversion, messages d'avertissement du danger, vie sociale avec ses compétitions, ses moments d'isolement et de regroupement (migration, recherche de nourriture, traversée d'un obstacle), adaptation à des conditions nouvelles comme la captivité, les données comportementales remplissent une grande partie des quatre gros volumes de Ornithological Biography. Il n'est guère besoin d'aller loin pour en trouver : la première description donnée dans l'ouvrage, celle du dindon américain (Meleagris gallopavo), en fournit un magnifique exemple.
Une souhaitable
réévaluation
Notre propos a été de montrer que, sortant d'années d'amateurisme passées à l'écart de la société savante, Audubon l'autodidacte avait à son actif une certaine pratique expérimentale et une orientation marquée vers les études comportementales. Ce sont deux originalités relativement méconnues, puisque l'on retient surtout de lui un travail d'inventaire descriptif et la découverte de nouvelles espèces. La méthode expérimentale n'était encore ni courante ni bien développée dans les sciences naturelles du début du 19e siècle. Si Audubon avait pu donner suite à ses premières expériences, de grands progrès auraient été faits. Quant aux sciences du comportement animal, à en croire certains militants de l'éthologie, il semblerait qu'elles soient nées vers le milieu du 20e siècle seulement, avec Konrad Lorenz (1903-1989) et Nikolaas Tinbergen (1907-1988). Cela n'est vrai que si l'on considère ces disciplines dans leur modernité, en négligeant leurs précurseurs. Audubon a été l'un d'eux, un précurseur de première importance et dont le bilan véritable reste encore à reconnaître.
Faut-il y voir un paradoxe, ou au contraire le fait qu'une communauté scientifique bien établie et sûre d'elle-même soit parfois un frein à l'originalité et l'innovation ? Alors que son orientation de départ était différente et à cause des rencontres qu'il a faites, des compétitions et pressions exercées sur lui, Audubon s'est tourné beaucoup plus vers la taxonomie lors de la fin de ses activités. Afin de compléter son inventaire des oiseaux américains, plusieurs dizaines de gravures furent exécutées hâtivement pour représenter des espèces qu'Audubon n'avait pas vues dans la nature lui-même. Il n'était plus question d'expérimenter ni d'analyser les comportements. Son dernier travail a consisté à établir A Synopsis of the birds of North America (1839), une mise en ordre taxonomique rigoureuse qui devait rétablir la priorité et la prééminence de son uvre par rapport à celle de Bonaparte (American Ornithology, or not given by Wilson, 1825).
Autre signe de ce qui était devenu une préoccupation grandissante chez lui à la même époque, Audubon fit exécuter dans une qualité exceptionnellement soignée trois ultimes tirages de ses Birds of America, dont celui qui allait devenir son exemplaire personnel, réarrangés selon "l'ordre taxonomique". Pour lui qui avait écrit peu avant "Je ne vous présenterai pas les objets dont se compose mon livre, dans l'ordre adopté par les auteurs à systèmes" (O.B.), et bien d'autres remarques en ce sens, c'était un revirement notable. Tandis que la biologie darwinienne se préparait à émerger, la "science normale" (Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962), cette science déjà vieillie des naturalistes de cabinet et des taxonomistes purs, prenait le pas sur les orientations qu'Audubon avait prises auparavant.
Dans la soif de connaissances et le génie de ses débuts, Audubon l'amateur, l'autodidacte, avait été très en avance sur son temps.
Signature :
Yvon Chatelin
Lire plus
Personnage éminemment complexe, l'homme Audubon (1785-1851), apparaît tout d'abord comme un témoin, un repère facile dont on suit la trace dans les remous de l'Histoire. Créole né sous le nom de Jean Rabin à Saint-Domingue (Haïti), à la veille de la révolution des esclaves, il reçut à Nantes le nom de Jean-Jacques Audubon au plus fort de la Révolution française, et choisit de devenir John James Audubon, citoyen américain, en 1812. Sa vie s'acheva à New York après qu'il eût fréquenté toutes les classes sociales de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ses biographes donnent de lui l'image attachante d'un naturaliste d'autrefois (F. Herrick, Audubon the Naturalist, 1917), d'un homme de passions et d'aventures (A. Ford, J.J. Audubon, 1964), d'un personnage porté par le courant des idées post-rousseauistes (Y. Chatelin, Audubon - Peintre, naturaliste, aventurier, 2001), d'un émigré s'épanouis-sant dans les valeurs de la vie américaine (R. Rhodes, J.J. Audubon - The Making of an American, 2004).
L'écrivain Audubon, ensuite, est salué comme un excellent story teller, conteur d'histoires vécues ou à peine déformées par l'imagination et, peut-être, par une touche de mythomanie. Si un public intéressé par les voyages du passé, les aventures, l'exotisme, le lit aujourd'hui encore, c'est surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'il a retenu l'attention des gens de lettres. Philarète Chasles, Eugène Bazin, Alphonse de Lamartine, et même Jules Michelet se sont penchés sur ses écrits. Lamartine (Cours familier de littérature, 1865), notamment, voyait en lui le premier écrivain émergeant d'une expérience authentiquement américaine (et en cela nécessairement liée à la Nature), ses contemporains ou prédécesseurs américains n'étant, au plus, disait-il, que des imitateurs de Walter Scott et autres romantiques européens.
L'artiste Audubon, enfin, ou plus précisément dit, le peintre naturaliste, n'a pas besoin de longue présentation, car des masses de livres, de reproductions, de posters, de timbres-postes, d'expositions, de multiples galeries d'art, de nombreuses ventes aux enchères attestent de sa célébrité. Ses gravures des oiseaux d'Amérique (The Birds of America) sont un chef-d'uvre incontesté et celles sur les mammifères (Quadrupeds of North America), moins exceptionnelles, suffiraient à une honorable réputation.
Un naturaliste reconnu
mais controversé
Il n'en est plus de même pour l'homme de science Audubon. Avant d'aborder les aspects méconnus de ce personnage, il convient d'établir la part de ce qui est cependant admis largement.
En plusieurs dizaines d'années, Audubon a parcouru les Etats-Unis de son époque, entre rivage de l'Atlantique et Mississippi, poussant quelques expéditions au-delà, jusqu'au Labrador, Texas, haut Missouri. Il y a collecté une masse considérable d'observations, a découvert 23 espèces (ou sous-espèces) d'oiseaux. Souvent il s'agissait d'individus petits et modestes, passés jusqu'alors inaperçus, mais c'était parfois aussi un oiseau exceptionnel, comme le grand héron à phase blanche qui étonne par sa taille, sa beauté, et qui forme, avec celui à phase bleue (connu et décrit longtemps avant Audubon), une seule espèce (Ardea occidentalis). On attribue aussi à Audubon le mérite d'avoir décrit et magnifiquement représenté 5 oiseaux (quatre espèces et une sous-espèce) actuellement totalement éteints, parmi lesquels le pigeon migrateur (Ectopistes migratorius) et la perruche de Caroline (Conuropsis carolinensis), deux oiseaux dont la navrante histoire est connue de tous les amateurs d'ornithologie. Travail d'inventaire et d'indispensable taxonomie : voilà le premier aspect positif et indiscutable de l'uvre scientifique d'Audubon.
Les naturalistes de cabinet et les purs taxonomistes ont été l'objet de fréquentes railleries de sa part. "J'aurais bien moins de plaisir, disait-il, à présenter au monde savant un nouvel oiseau dont j'ignorerais les habitudes, qu'à décrire les particularités et les murs d'un autre déjà depuis longtemps découvert." (O.B.). Plus biologiste que taxonomiste, il est parvenu à édifier de bonnes connaissances de la dynamique des populations. Par exemple, il évaluait la capacité de reproduction du pigeon migrateur et la trouvait supérieure aux déprédations humaines (lors des années 1810, car ces déprédations s'accélérèrent par la suite). Mais, faisant le bilan, il pensait que mise en culture et dégradation des forêts conduisaient au déclin des pigeons. D'autres oiseaux étaient menacés parce que les hommes détruisaient leurs nids et leurs ufs, amenant les femelles à pondre à nouveau, ce qui, selon lui, épuisait leurs forces. L'homme était aux yeux d'Audubon le "tyran de la Création", un "pirate" qui menait une "guerre d'extermination". Une certaine approche de la notion d'écosystème et un sens déjà évolué de la conservation de la Nature ne peuvent lui être déniés.
De son temps, Audubon a été encensé par le public, par une grande majorité de spécialistes et vilipendé par une petite poignée d'irréductibles ennemis. Les erreurs scientifiques qu'il a commises sont presque toutes des fautes dans l'identification des espèces. Le plus grave a été de se tromper sur le serpent à sonnettes (Crotalus horridus) et de croire à des fables racontées à son sujet dans des milieux populaires, ce qui a alimenté les querelles qui lui ont été faites. Peu de chose, à nos yeux d'aujourd'hui.
Un parcours scientifique
soutenu par des rencontres
Fondamentalement, Audubon fut un autodidacte qui regrettait de ne pas avoir reçu d'éducation scientifique formelle, mais qui ne s'est pas fait totalement seul.
Lors de sa jeunesse, il a reçu une certaine initiation, probablement courte, à l'étude des oiseaux par François-René Dubuisson (d. 1836), droguiste, dont le cabinet d'histoire naturelle fut le point de départ du Muséum de Nantes. Il eut aussi et surtout pour ami et mentor le docteur Charles-Marie Dessalines d'Orbigny (1770-1856), père du célèbre Alcide d'Orbigny, et dont les collections sont à l'origine d'un autre Muséum, celui de La Rochelle. Qu'apprit-il de d'Orbigny ? Les indices qui nous restent laissent supposer qu'il travailla avec lui selon les principes de Mathurin Jacques Brisson, ennemi de la taxonomie linnéenne et qui construisit son propre système de classification (Ornithologie, ou 1760). Il est certain d'autre part que le jeune Audubon fut un lecteur assidu de l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon.
Menant ensuite une vie errante en Amérique, Audubon fut longtemps livré à lui-même et mûrit dans un face-à-face solitaire avec un livre de référence, l'American Ornithology de son prédécesseur Alexander Wilson (1766-1813). Les deux hommes se rencontrèrent à deux reprises, en 1810 et 1812, sans parvenir à établir de bonnes relations personnelles. Cependant, autodidacte comme lui, Wilson était un bel exemple à suivre et surpasser, et cet exemple resta présent à l'esprit d'Audubon pendant toutes les années qui suivirent leurs rencontres et qu'il consacra à l'étude des oiseaux. Sur le plan artistique, surpasser Wilson était facile pour lui. Sur le plan scientifique cela signifiait simplement trouver et décrire davantage d'oiseaux, corriger quelques erreurs, sans impliquer de changement de méthodologie. Faire plus, faire mieux suffisaient.
Lorsqu'enfin, en 1824, son portfolio contint suffisamment de portraits d'oiseaux, Audubon se rendit à Philadelphie puis New York. Il avait des dessins de grande valeur artistique à éditer et commercialiser, il voulait en retirer de l'argent, se faire une réputation, mais il n'avait aucune collection ni texte scientifiques à présenter. Néanmoins, c'est aux hommes de science des deux villes qu'il s'adressa immédiatement. Pourquoi ce choix s'imposa-t-il à lui, quand il eût pu faire carrière simplement en artiste ? Question sans réponse peut-être, mais qui montre qu'Audubon suivait le même chemin que Wilson. Il se mettait à la merci des hommes de science, une corporation redoutable, car dotée de capacités de jugement et d'autorité.
Le résultat ne se fit pas attendre. Chef de file des naturalistes l'Academy of Natural Sciences de Philadelphie, George Ord (1781-1866) devint immédiatement l'ennemi acharné d'Audubon et parvint presque à ruiner à jamais son entreprise. On apprend certaines choses dans ces cas-là, et Audubon doit sans doute à Ord la prudence scientifique à laquelle il tenta de s'astreindre par la suite. Un autre personnage important rencontré à Philadelphie était Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857). Audubon allait entretenir longtemps avec lui des relations de fausse amitié et de rivalité cachée. Bonaparte était un taxonomiste, sans pratique de terrain, il aurait aimé prendre Audubon comme dessinateur appointé et dût se contenter de piller certaines de ses connaissances. Leur relation fut cependant positive pour Audubon qui apprit, à son contact, la nécessité de constituer des collections de référence et d'atteindre plus de fiabilité dans le travail de nomenclature et taxonomie.
En cette même année 1824, deux naturalistes de New York, Samuel Latham Mitchill (1764-1831) et James Ellsworth De Kay (1792-1851), eurent une attitude différente de celle de George Ord. Ils se montrèrent bienveillants, permirent une exposition des dessins d'Audubon et lui demandèrent une communication sur les hirondelles (Hirundo fulva) à publier dans les Annales de leur institution, le Lyceum of Natural History. Audubon n'y était pas préparé et n'avait qu'une maîtrise imparfaite de la langue anglaise. Il franchit néanmoins ce premier pas et fit une modeste entrée dans la communauté des hommes de science, avec un texte court, consacré principalement aux migrations des hirondelles.
Le scénario se répéta deux années plus tard, à son arrivée à Edimbourg, avec plus d'ampleur et de succès. Le professeur Robert Jameson (1774-1854) voulut bien aider Audubon, lui permettre d'exposer ses uvres, le soutenir par ses relations, lui ouvrir les collections d'histoire naturelle de la ville, mais, en contrepartie, lui demanda des articles pour la revue qu'il dirigeait, le Edinburgh New Philosophical Journal. Publier constituait une porte d'entrée incontournable : Audubon s'exécuta et se fit connaître par des textes sur les murs de l'alligator, du vautour, du serpent à sonnettes, du pigeon migrateur. Soutenu par les hommes de science, il trouva les graveurs et les clients dont il avait besoin. Il prit soin de mentionner, sur la couverture de ses recueils de gravures, toutes les sociétés savantes qui l'accueillirent (Royal Society, Wernerian Soc., Linnean Soc. & al.).
Quelques années après, l'édition des gravures allait vers son achèvement, leur commercialisation progressait de façon satisfaisante. Mais la clientèle attendait davantage et souhaitait un travail d'ornithologie complet avec, pour commenter chaque gravure, des textes descriptifs et scientifiques. Audubon se mit à son écritoire et produisit les quatre gros volumes de Ornithological Biography (O.B.). Il s'assura l'aide d'un universitaire, MacGillivray (1796-1851), qui lui fut utile sur le plan du langage et apporta aussi un certain contrôle scientifique.
Les principaux tournants de sa carrière se firent dans ces conditions. Audubon rencontra de nombreux autres hommes de science dont on ne peut dire avec précision l'influence qu'ils eurent sur lui : les ornithologues Jardine, Selby, Swainson, le tout jeune Darwin simplement entrevu lors de réunions scientifiques, ou Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, grands maîtres d'une "anatomie comparée" inutile pour lui car elle dépassait ses capacités et ses ambitions. John Bachman, son ami et parent par alliance, est un cas à part. Bachman aida considérablement Audubon, le soutint dans ses querelles, mais probablement sans donner d'infléchissement particulier à ses orientations scientifiques.
Approche expérimentale
et science du comportement
Les aptitudes d'Audubon et sa tournure d'esprit spontanée apparaissent le plus clairement dans ses premières activités. Par la suite, il subit les influences que nous venons de décrire, il fut pris dans l'engrenage des milieux lettrés, artistiques, mondains qu'il eut à fréquenter, il eut à tenir compte des exigences de sa clientèle. S'il parvint à toujours progresser ou garder la même qualité sur le plan artistique, pour le reste, ses capacités d'innovation furent bridées par le manque de temps et une surcharge de travail accablante.
Dès le départ, il fut un homme du pratique et du concret, ayant le goût de manipuler la matière et les objets. Ses portraits d'oiseaux originaux ne furent pas comme on le dit par simplification des "aquarelles", mais le produit d'une "technique mixte" utilisant aussi le pastel, la gouache, l'huile, le vernis ou, plus rares, le blanc d'uf et le bouchon brûlé. Il n'avait pas vingt ans lorsqu'il inventa la "planche de position" sur laquelle il fixait par des aiguilles et fils métalliques les oiseaux morts lui servant de modèles.
Aussi, de l'observation ornithologique pure, est-il passé facilement à l'expérimentation. Peu après son arrivée en Pennsylvanie, il eut l'idée de baguer des moucherolles phébi (Sayornis phoebe) et de contrôler ainsi leur retour, à la migration de printemps, dans le nid de la saison précédente. Bien que l'on puisse trouver dans l'histoire de l'ornithologie d'autres essais de marquage d'oiseaux antérieurs au sien, c'était une grande invention de sa part et, en tout cas, le premier baguage du Nouveau Monde.
Installé plus tard en Louisiane, Audubon se mit à des expériences sérieuses sur les capacités olfactives attribuées traditionnellement aux vautours (Cathartes atratus, Cathartes aura). Les protocoles étaient simples, mais démonstratifs. En des conditions variées, il cachait des charognes et constatait que les vautours ne s'en approchaient pas, ou exposait de fausses carcasses d'animaux vers lesquelles ils se précipitaient. Il mit ainsi un terme à une légende longtemps admise même dans les milieux scientifiques.
Chaque fois qu'il en a trouvé la possibilité, Audubon s'est livré à de petites expérimentations. Par exemple, il obturait artificiellement l'arbre creux fréquenté par des martinets ramoneurs (Chaetura pelagica) pour étudier leurs capacités visuelles et leur comportement dans des situations inattendues. Rompu à toutes les techniques de la chasse, à l'utilisation des leurres, habitué à l'élevage en captivité d'espèces sauvages, il a multiplié les essais, les expériences, comme le font d'ailleurs beaucoup d'hommes ordinaires qui vivent par nécessité auprès des animaux. Son esprit expérimental s'accordait parfaitement à son désir d'étudier les comportements.
En ce dernier domaine, celui des comportements, son acquis est considérable. Audubon s'indignait de l'attribution de stupidité que l'on porte à des oiseaux comme les dindons, ou les oies. Surpris par la pertinence de leurs réactions à des situations difficiles, il s'interrogeait : "Était-ce le résultat de l'instinct, ou de la raison ou l'acte d'un esprit intelligent ?" (O.B.) Il s'attachait en toute occasion à montrer des attitudes ou sentiments comme l'attention, l'affection, l'amour dans le couple et envers les petits, le désarroi devant la destruction d'ufs ou la mort d'oisillons. Attribuer des sentiments à des oiseaux était mal compris à son époque, et on lui a longtemps reproché de faire de l'anthropomorphisme dans sa façon de les comprendre et de les décrire.
Parades de séduction, méthodes de construction des nids, choix de leurs emplacements, ruses des prédateurs pour atteindre leurs proies, ruses de celles-ci pour se défendre, techniques de guet, de fuite ou de diversion, messages d'avertissement du danger, vie sociale avec ses compétitions, ses moments d'isolement et de regroupement (migration, recherche de nourriture, traversée d'un obstacle), adaptation à des conditions nouvelles comme la captivité, les données comportementales remplissent une grande partie des quatre gros volumes de Ornithological Biography. Il n'est guère besoin d'aller loin pour en trouver : la première description donnée dans l'ouvrage, celle du dindon américain (Meleagris gallopavo), en fournit un magnifique exemple.
Une souhaitable
réévaluation
Notre propos a été de montrer que, sortant d'années d'amateurisme passées à l'écart de la société savante, Audubon l'autodidacte avait à son actif une certaine pratique expérimentale et une orientation marquée vers les études comportementales. Ce sont deux originalités relativement méconnues, puisque l'on retient surtout de lui un travail d'inventaire descriptif et la découverte de nouvelles espèces. La méthode expérimentale n'était encore ni courante ni bien développée dans les sciences naturelles du début du 19e siècle. Si Audubon avait pu donner suite à ses premières expériences, de grands progrès auraient été faits. Quant aux sciences du comportement animal, à en croire certains militants de l'éthologie, il semblerait qu'elles soient nées vers le milieu du 20e siècle seulement, avec Konrad Lorenz (1903-1989) et Nikolaas Tinbergen (1907-1988). Cela n'est vrai que si l'on considère ces disciplines dans leur modernité, en négligeant leurs précurseurs. Audubon a été l'un d'eux, un précurseur de première importance et dont le bilan véritable reste encore à reconnaître.
Faut-il y voir un paradoxe, ou au contraire le fait qu'une communauté scientifique bien établie et sûre d'elle-même soit parfois un frein à l'originalité et l'innovation ? Alors que son orientation de départ était différente et à cause des rencontres qu'il a faites, des compétitions et pressions exercées sur lui, Audubon s'est tourné beaucoup plus vers la taxonomie lors de la fin de ses activités. Afin de compléter son inventaire des oiseaux américains, plusieurs dizaines de gravures furent exécutées hâtivement pour représenter des espèces qu'Audubon n'avait pas vues dans la nature lui-même. Il n'était plus question d'expérimenter ni d'analyser les comportements. Son dernier travail a consisté à établir A Synopsis of the birds of North America (1839), une mise en ordre taxonomique rigoureuse qui devait rétablir la priorité et la prééminence de son uvre par rapport à celle de Bonaparte (American Ornithology, or not given by Wilson, 1825).
Autre signe de ce qui était devenu une préoccupation grandissante chez lui à la même époque, Audubon fit exécuter dans une qualité exceptionnellement soignée trois ultimes tirages de ses Birds of America, dont celui qui allait devenir son exemplaire personnel, réarrangés selon "l'ordre taxonomique". Pour lui qui avait écrit peu avant "Je ne vous présenterai pas les objets dont se compose mon livre, dans l'ordre adopté par les auteurs à systèmes" (O.B.), et bien d'autres remarques en ce sens, c'était un revirement notable. Tandis que la biologie darwinienne se préparait à émerger, la "science normale" (Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962), cette science déjà vieillie des naturalistes de cabinet et des taxonomistes purs, prenait le pas sur les orientations qu'Audubon avait prises auparavant.
Dans la soif de connaissances et le génie de ses débuts, Audubon l'amateur, l'autodidacte, avait été très en avance sur son temps.
Signature :
Yvon Chatelin