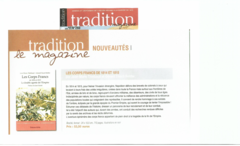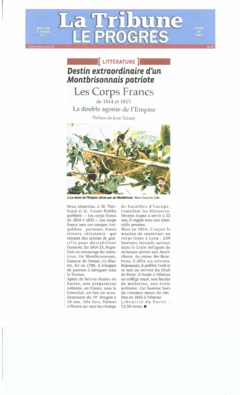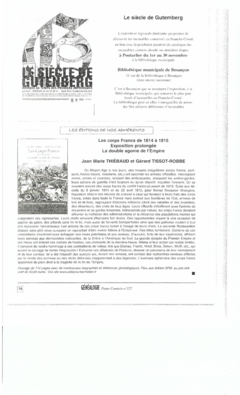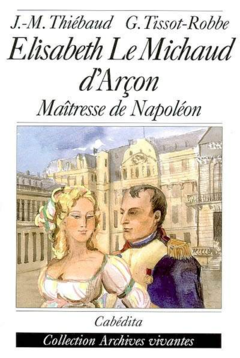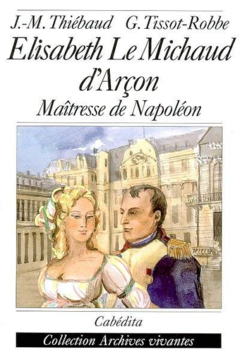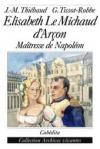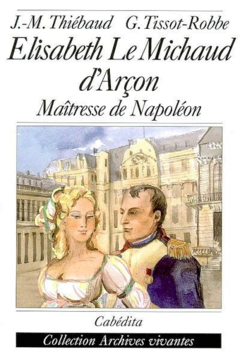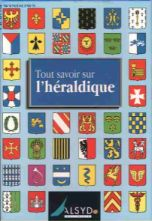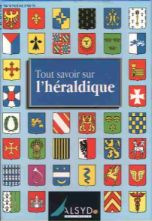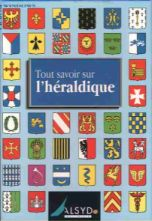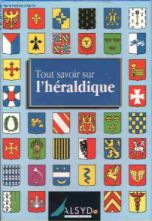Jean-marie Thiebaud
ContacterJean-marie Thiebaud
Descriptif auteur
Docteur en médecine, diplômé de droit et d'informatique, ancien président de la Fédération Française de Généalogie et de la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique, membre de la section des Finances du Conseil Economique et Social (1997-1999), secrétaire général de la Chambre Nationale des Professions Libérales (1988-1998), fondateur de l'Académie Internationale de Généalogie (Turin, Italie, 1998), fondateur du Conseil Français d'Héraldique (et premier président pendant 15 ans, actuellement vice-président, réélu le 4 novembre 2006 et le 10 novembre 2007), ancien membre du Conseil Supérieur des Archives de France, membre d'honneur de la Société d'Histoire et de Généalogie de Moscou (Russie), de l'Institut d'Etudes culturelles d'Argentine et de Karolus, membre (sociétaire) de la SGDL (Société des Gens de Lettres).
Médecin (doctorat en médecine avec la mention très honorable et les félicitations du jury), chargé de cours à la Faculté de Médecine de Besançon et à l'Université Ouverte de Franche-Comté jusqu'en 1998, ancien vice-président du Conseil départemental du Doubs de l'Ordre des Médecins, ancien secrétaire général du Conseil régional de Franche-Comté de l'Ordre des Médecins, maire-adjoint de Pontarlier (Doubs), président du Syndicat intercommunal du château de Joux (1983-1989), breveté parachutiste et tireur d'élite (Russie), aïkidoka, ancien membre de la commission permanente de concertation des professions libérales auprès du Premier Ministre puis du ministre du Commerce, membre de la section des Finances du Conseil Economique et Social (1997-1999), administrateur du Centre Hospitalier Général de Pontarlier de 1977 à 1998, administrateur et vice-président de commission de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en 1997-1998 (nommé par décret), administrateur de l'Union Nationale des Foyers et Services des Jeunes Travailleurs (UFJT) en 1997-1998, grand voyageur (Europe, Amérique, Afrique, Asie). Mission en Ouzbékistan (Tachkent) en 2002-2003. Vit à Séoul (Corée du Sud) de janvier 2004 à décembre 2005. Membre titulaire de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté depuis 1987. membre de la Société d'Emulation du Doubs et de la Société d'Emulation de Montbéliard, vice-président du comité départemental du Doubs de la Fédération Française de Boxe, secrétaire général et médecin du Boxing-Club Pontissalien depuis 1975, administrateur de l'Association des Amis des Archives du Doubs et de Franche-Comté (et ancien vice-président depuis sa fondation), chargé de cours de paléographie, traducteur du site Internet scandinavica.com, Médaille de bronze de la Croix-Rouge Française, médaille de bronze de la Fédération Française de Boxe, médaille de la ville de Besançon, médaille de la Fédération Française de Généalogie (congrès d'Avignon). Marié à Pontarlier le 11.07.1969 avec Geneviève Guilloz, née à Clerval (Doubs) le 6 février 1950, fille du colonel Lucien Guilloz, commandeur de la Legion d'Honneur, et d'Augustine Page, ancienne élève des Maisons d'Education de la Légion d'Honneur, directrice d'école (E.R.). Trois fils : Jean-Noël (11.05.1976), François-Xavier (15.01.1978) et Josserand (21.05.1987).
Titre(s), Diplôme(s) : Docteur en médecine
Fonction(s) actuelle(s) : Conférencier
Vous avez vu 11 livre(s) sur 9
AUTRES PARUTIONS
Vie et oeuvre de Marie Francois Xavier Bichat (1771-1802), Besançon, 1974 (thèse de doctorat)
Histoire de l'église de Chaux-les-Châtillon et de sa paroisse (suivie d'un armorial de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche et du comté de la Roche-Saint-Hippolyte, Dole, Impr. Jurassiennes, 1979
Les Archives de la Grosse Maison de Neuvier (4 vol.), Pontarlier, 1979-1980
Titres de famille et de noblesse des Colin de Valoreille, Pontarlier, 1982
Généalogie de la famille Boucard, Landry et Landry-Boucard, Pontarlier, 1982 (en collaboration avec Annie et Jean-Claude Boucard)
Généalogie de la famille Guilloz suivie de notices généalogiques sur les familles Page et Bretillot, Impr. Jacques et Demontrond, Roche-les-Beaupré (Doubs), 1983
Petit Dictionnaire des termes du blason, Lons-le-Saunier, Marque-Maillard, 1984
Le Château de Joux, Pontarlier, éd. Pourchet (en collaboration avec Michel Malfroy, Roland Lambalot et Joël Guiraud), 1987
Répertoire héraldique de Franche-Comté, Le Havre, 1987 (en collaboration avec Jean-Jacques Lartigue)
Dictionnaire des noms de famille de Franche-Comté (2 vol.). Tome 1er, les noms d'origine géographique, 1988 - tome II, Les noms de métiers, les sobriquets, 1998
Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté, Lons-le-Saunier, Marque-Maillard (2 vol.), 1981-1983
De sable et d'or (recueil de 67 articles d'héraldique)
Le Symbolisme des animaux et des couleurs (recueil d'articles parus dans Généalogie-Magazine)
Les échevins de Belvoir, Pontarlier, 1985
Les Députés des Villes et Villages de Franche-Comté aux Assemblées du Tiers État en 1789, Besançon, CEGFC, 1989
Médecins et Chirurgiens de Franche-Comté, Lyon, éd. de la Tour Gile, 1992
L'Hôpital militaire de Baume-les-Dames, Pontarlier, 1992
Histoire et généalogie de la famille Frère de Villefrancon, XVIe-XIXe siècles, Pontarlier, Besançon, Dole et Villefrancon, 1992
Notaires et tabellions de Franche-Comté et du comté de Montbéliard (5 vol.), 1994
Inventaire détaillé des arrêts du Parlement de Dole (1506-1531), Pontarlier, 1994
Dictionnaire des termes du blason, Besançon, éd. Cêtre, 1994
Pratique de la Généalogie - Guide universel de recherche, Besançon, éd. Cêtre, 1995
Les Cogouverneurs de la cité impériale de Besançon. Dictionnaire historique, biographique et généalogique. Le livre d'or des anciennes familles bisontines, Besançon, préface de Robert Schwindt, sénateur-maire de Besançon, CEGFC, 1996
Les Archives de la Bastille à la Bibliothèque Nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, Paris, 1997
Une grande famille princière de Russie, les Princes Galitzine, Généalogie et notes historiques, Paris, 1997
Tout savoir sur l'héraldique, CD-Rom, Alsyd Multimedia, Meylan (Isère), 1997
Les Romanov, Paris, éd. Christian, 1998
Généalogies de familles de la région de Saint-Hippolyte (Doubs), XVe-XXe siècles, Pontarlier, 2000
Les Princes Demidov de Russie. Notes généalogiques et historiques, Besançon, 2000
Notes généalogiques et historiques sur la famille des docteurs Botkine, médecins privés des tsars Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II, Paris, 2000
Inventaire nominatif des sépultures russes du cimetière de Prague, Paris, 2001
Les Français et les Suisses francophones en Russie et en URSS, éd. Geneaguide.com, 2002
Bibliographie héraldique française, Armoriaux, répertoires héraldiques et dictionnaires de devises, Paris, 2002
Dictionnaire Encyclopédique Toponymique de Franche-Comté - Les lieux et les hommes des origines à nos jours, 2 vol. grand format, 1529 p., Pontarlier, 2003
Les Ambassadeurs et les Représentants de la France en Russie et en URSS, Paris, 2003
Dictionnaire encyclopédique toponymique de Franche-Comté, 2 vol., 1515 p., Pontarlier, 2003
Les Francs-Comtois de l'Empire (en collaboration avec Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe), avant-propos du Prince Napoléon, préface du comte Morand, Paris, Icc. 2004
La Russie, l'URSS, la Biélorrussie, les Pays baltes, l'Ouzbékistan, l'Arménie, la Géorgie et l'Ukraine, dictionnaire bibliographique, biographique, généalogique, héraldique et historique du Moyen Âge au XXIe siècle, (4 forts vol.), Paris, 2004 (5e vol. en cours d'édition)
Le Stress, Paris, 2004 (et ebook, 2010)
Moulins et meuniers de Franche-Comté, 2005
Les stress des Coréens sous le regard d'un Occidental, Séoul, 2004
Élisabeth Le Michaud d'Arçon, maîtresse de Napoléon, préface de Bernard Quintin, éd. Cabédita, Yens (Suisse), 2006 (en collaboration avec Gérard Tissot-Robbe)
Les Francs-Comtois de la Révolution, 2 vol. grand format, 1414 p., Pontarlier, l'auteur, 2006
Les Comtois de Napoléon - Cent destins au service de l'Empire (en collaboration avec Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe), préface de S.A.R. le prince Joachim Murat, éd. Cabédita (Yens, Suisse), 2006
Les Marquis en Franche-Comté, Pontarlier, 330 p., 2006
Issue de la Vouivre et loin des Vipères, Pontarlier, 2008 (en collaboration avec Geneviève Thiébaud)
Dictionnaire de l'Ancien Régime dans le Royaume de France - Institutions, moeurs, termes juridiques et religieux, vieux français, noblesse, féodalité, mainmorte, art de la guerre, armes et armures, duel, vêtements, mesures, métiers, bourreaux et tortures, sages-femmes et accouchements, superstitions, maladies, monnaies, provincialismes, généalogie, us et coutumes, Besançon, Cêtre, 2009.
Les comtes, vicomtes, barons et chevaliers en Franche-Comté, Pontarlier, l'auteur, 2009
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
CONSULS et VICE-CONSULS DE FRANCE à MOGADOR (MAROC)
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
N.B. : La ville de Mogador (nom donné par les Portugais et redonné par les Français en 1912), appelée aussi Mogdoura, Amegdoul ("La bien gardée") en berbère), au bord de l'Atlantique, à 176 km à l'ouest de Marrakech, a été rebaptisée Essaouira ("La bien dessinée"), son ancien nom depuis le XVIIIe siècle.
1858-1861 : Henri GUYS (Pierre François Marie Henry dit Henri Guys, né à Marseille (13) le 12.10.1787, décédé en 1868, consul à Alep de 1838 à 1847, officier de la Légion d'Honneur, fils cadet de Pierre Alphonse Guys (1755-1812) et d'Elisabeth Marguerite alias Marguerite Elisabeth de Rémusat, née le 03.11.1749, décédée en avril 1829, fille de Hyacinthe de Rémusat et de Suzanne Goy)
1862 : Comte de ROSCOAT [Amédée Henri ROLLAND du ROSCOÄT, né à Vitry-aux-Loges (45) le 10.06.1828, décédé à Pléhédel (22) le 30.05.1879, fils d'Amédée Rolland du Roscoät (1791-1851), chef de bataillon, et d'Elisabeth Colas des Francs (1806-1883). Il épousa à Paris, en 1866, Berthe Clémentine Marie Ghislaine Descantons de Montblanc (1840-1897), née à Ingelmunster (Belgique), fille de Charles, comte Descantons de Montblanc, baron d'Ingelmunuster (1785-1861), et de Virginie Rocques de Montgaillard (1812-1889)]
1863-1864 : Georges HUET (Georges Henri Huet, né à Paris le 26.04.1830, décédé le 18.01.1900, chevalier (10.08.1867), officier de la Légion d'Honneur le 12.05.1881)
1865-1876 : BEAUMIER
1877 : CARRA de VAUX (Marie-Camille-Georges CARRA de VAUX, né à Chartres (Eure et Loir) le 30.12.1840, décédé à Toulon (83) le 26.01.1915, chevalier de la Légion d'Honneur (25.01.1885), fils d'Alexandre-François-Louis Carra de Vaux et de Marie-Madeleine-Nathalie Marchand), élève-consul puis LE RÉE, consul
1879 : CARRA de VAUX, consul
1880 : MAHON
1883 : Alphonse BERTRAND
1885 : LACOSTE
1892 : Léon-Vincent-Auguste HUGONNET, consul (né à Dole (39) le 17.05.1842,
chevalier de la Légion d'Honneur)
Joseph-Paul NAGGIAR, drogman-chancelier (né au Caire (Égypte) le 17.10.1854, chevalier de la Légion d'Honneur)
1893-1896 : Jean-Antoine-Louis PELLEGRINI, consul
1893 : Paul-Antoine-Joseph OTTAVI, drogman-chancelier (né à Balogna (Corse-du-
Sud) le 18.10.1861, chevalier de la Légion d'Honneur)
Louis-Edouard-Victor-Joseph LERICHE, drogman-chancelier
1897-1898 : Félix BERTRAND
1897 : Louis-Edouard-Victor-Joseph LERICHE, drogman-chancelier
1903-1906 : Charles-Céleste-Albert JEANNIER, vice-consul (né à Ornans (25) le 25.11.1862, élève de l'Ecole des Hautes Etudes, chevalier de la Légion d'Honneur).
1907-1910 : Nooman KOURI, consul (né à Becassinne (Syrie) le 14.08.1856, chevalier de la Légion d'Honneur)
1907-1908 : Henri-Eugène LOURGEOU, interprète-chancelier
1911 : Edmond-Raoul-Marie MARC, consul (né à Salonique (Turquie) le 14.10.1872,
chevalier de la Légion d'Honneur
Jean-Victor MONGE, interprète-chancelier (né au Caire (Égypte) le
10.06.1882, chevalier de la Légion d'Honneur)
[ Listing des Ouvrages | Retour | Listing des Personnages ]
LES INSCRIPTIONS DU CIMETIÈRE DE MOGADOR (ESSAOUIRA, MAROC) étude épigraphique et généalogique
étude épigraphique et généalogique
par Jean-Marie Thiébaud
Le cimetière chrétien de la "Cité des Alizés" abrite les tombes de familles françaises, italiennes, grecques, anglaises, allemandes, espagnoles, danoises, etc.
ADRAGNA Livia, née MAZZELLA, 13.11.1927, âgée de 64 ans
AGOSTINI : v. BARTOLI
ARAGONES Teodoro (27.08.1886-08.09.1896)
BANO François, 04.08.1949 à l'âge de 65 ans
AUBERTIN Alexia Elisabeth (30.07.1876-06.10.1876)
BARTHES Paul Jules (01.06.1898-21.12.1948)
BARTOLI Madame, née AGOSTINI, 19.06.1925 dans sa 27e année
BARTOLI Madame, née FURRIOLI, 07.11.1927 dans sa 24e année
BATAILLE Charles Henri, né à Narbonne (Aude) le 25.06.1861, 18.10.1926.
BAUDIN : v. SANDILLON
BEAUNE Bernard (1944-2005)
BEAUNE Marie Françoise, née CROCCI-TORTI (1920-1948)
BERTRAND Renaud (simple plaque en fer blanc)
BORDENAVE Vincent (1891-1940)
BOUBENNEC Jean-Baptiste, 1er maître de la Marine, contrôleur d'acconage (13.06.1870-04.11.1918)
BOUBENNEC Lucien François Ferdinand (30.11.1918-19.01.1919)
BOUCHENY Léontine
BRASSEUR : v. MERGAULT
BRAUER Theodor-Ferdinand, né à Leipzig le 01.06.1840, Mogador le 25.12.1884, vice-consul d'Allemagne à Mogador. Charles et William BRAUER, ses fils jumeaux décédés le 24.09.1884, âgés de quelques jours. N.B. : Une famille Brauer est connue à Leipzig depuis les 15e-16e siècles.
BRECQUECHAIS Richard dit "RIRI d'ARABIE" -inscription manuscrite sur un panneau en bois)
BROOME Cecil G., 27.08.1957
BROOME Emily Caroline (19.01.1880-20.01.1969)
BROOME Myra E., 12.09.1950
CAMPOS Antonio Ruiz, né à Vigo (Espagne), 16.09.1945
CANTIN : v. aussi MEUBET
CANTIN Marie Ange, née à Lamballe le 22.08.1858, Mazagan (actuellement El-Jadida) le 10.09.1937
CANTIN Raymond (1891-1975)
CAREL : v. aussi MERGAULT
CAREL F.
CAREL Marie Thérèse (1877-1943)
COLEMAN Arthur, né vers 1820, 12.03.1880
CORTEGGIANI Marie Françoise, née MARTINI, née à
Corte le 22.08.1857, Mogador le 01.02.1921
COURAPIED Thérèse (1931-2006)
CRESPO José A., 07.04.1878
CROCCI-TORTI : v. BEAUNE
DAHAN : A l'entrée de l'allée où sont inhumés les membres de la famille Dahan (à droite de l'entrée du cimetière), se trouve la tombe de Job dit Jean Dahan. Celui-ci était originaire du Liban, descendant d'une longue lignée chrétienne, maronite, puis anglicane de nationalité française par son père, depuis 1815. Arrivé à Mogador en 1864, il y est décédé en 1917. Il est enterré aux côtés de son épouse Grace Rahana Nahem, juive convertie au christianisme, et de leurs fils, dont Léon Dahan, né à Mogador en 1872, décédé en 1934, marié à Blanche Giles, anglaise de confession anglicane; leur nombreuse descendance,
protestante et catholique, a quitté le Maroc pour la France, à
partir de 1958 (renseignements communiqués avec M. Richard Dahan).
DAHAN Grace, 10.07.1914
DAHAN J., 17.08.1917
DAHAN J. B., né à Mogador en 1867, 1900
DAHAN Léon, né le 09.11.1872, 18.09.1934 - Que mon âme ô divin roi t'adore et te glorifie car, en mourant avec toi, elle a retrouvé la vie.
DAHAN Théophile, né le 03.03.1879, 30.11.1903 - La couronne de justice m'est réservée.
DEBOST Jean-Marie (1896-1966)
DECKER Heinrich, né à Arösund (Danemark) le 28.06.1878, Mogador le 10.03.1896
DEDIEU Marie (1882-1965)
DEMONTE Louisa Maud (23.07.1871-24.06.1930)
DEPENVEILLER Bernard
DEVITA : v. aussi VITA (de)
DEVITA Béatrice (01.08-1955-10.12.1955)
DUPUY Henri (1904-1991)
FURRIOLI : v. AGOSTINI
GARDELLEC Jean, 15.03.1949
GASC Nicole (28.03.1954-30.08.1956)
GAUTRON Marie, née GUERIN (1889-1984)
GEBAUER Sylvia Charlotte (15.03.1915-24.11....)
GIANFRANCHI Giovanni, né à Castelnuovo di Macra le 05.12.1832, 11.11.1916
GIANGIACOMI Ruggero (1930-2006), artiste (Ruggero Giangiacomi, né à Ancône (Italie), Essaouira (Maroc) en avril 2006, plasticien et peintre italien, directeur artistique d'une manufacture de céramiques à Milan (Italie) en 1980, qui s'était installé à Rabat dans les années 1980, pour y travailler à l'Institut Culturel Italien, avant de découvrir Essaouira en 1990 et d'y fonder une galerie d'art, "Marea Arte" qui abrite plusieurs collections d'artistes italiens, français et marocains. Il a offert dix de ses oeuvres au musée Sidi Mohammed ben Abdellah de la ville d'Essaouira. Il a été inhumé dans le cimetière de cette ville en présence d'une pléiade de personnalités artistiques et intellectuelles. Un hommage posthume lui a été rendu à Essaouira en juin 2006, en présence d'André Azoulay, président-fondateur de l'association Essaouira-Mogador et conseiller de S.M. le roi du Maroc).
GRACE Harriet John, 04.11.1887
GRACE William, 03.09.1874
GRIESSER Michael (08.08.1964-13.07.1997)
GROGNOT Valentin (16.02.1867-11.02.1942)
GUERIN : v. GAUTRON
GUILLAUMET Gaby (08.10.1932-07.07.1933)
GUYONNET Charles (1862-1918)
HILLAIRET Louis
HOFFMANN Conrad, né à Feucht (Allemagne) le 21.10.1873, Mogador le 06.04.1829
HOISNARD Joseph (29.01.1910-14.07.1963)
HUCKWELL Ernest A. (v. 1874-29.01.1913)
JOHNSTON Marjorie Beatrice, 24.06.1893, âgée de 8 mois, et son frère, 12.06.1888, âgé de quelques heures
KERSAUDY Marcel (1904-1974)
LACOSTE Lucienne, 05.08.1988
LEARMOND Johan W., 23.12.1910
LEROUX Andrée (25.02.1919-24.06.1936)
LORIGNON Christianne, 01.11.1943
MAGLIOLO Carmen, 05.07.1934 à l'âge de 18 mois
MAGLIOLO Concheta née NANNINI (08.12.1904-04.12.1960)
MAGLIOLO Giacomino (05.03.1900-29.06.1977)
MAGLIOLO Giuseppe et Prospero, frères
MANOURY Madame Veuve, née Esther OUEVAL, 16.07.1924 dans sa 60e année
MARTEL Catherine Paulette, née à Paris le 19.11.1950, Essaouira Mogador le 08.01.2007
MARTIN Conception, 02.04.1931
MARTIN J., 03.08.1916
MARTRES Jean-Jacques (20.07.1945-20.01.2007)
MAURIES/LEFEVRE Famille
MAYOR Encarnacion Castillo, né à Granada (Espagne) le 29.01.1891, Mogador le 21.08.1939
MAZZELLA : v. ADRAGNA
MENDIERRY Gaetan (1888-1952)
MERGAULT Emilie, née BRASSEUR (1892-1983)
MERGAULT Jean (1894-1962)
MERGAULT Jeannine, épouse CAREL (1926-2002)
MEUBET Emilienne Jolie, épouse CANTIN, née à Nogent L'Artaud (Aisne) le 06.06.1865, Mogador le 20.12.1934
MITCHELL John Craig, 02.01.1865 dans sa 23e année
MONTERO Joseph, 18.01.1931, âgée de 62 ans
MONTERO Madame Veuve Antonia (02.08.1886-12.05.1953)
MONTERO (de) Maria Serra, 10.11.1917, âgée de 43 ans
MORENAS Ernest (1879-1944)
MULLER Eugène (1895-1957)
NANINI épouse PLAZA Giovanna (05.08.1917-06.04.1998)
NANINI : v. aussi NANNINI
NANINI Famille
NANINI François, 1952
NANINI Giuseppe, 1918
NANINI Giovana, épouse PLAZA (05.08.1917-06.04.1998)
NANINNI : v. NANINI, MAGLIOLO
NANINNI Petro, 18.05.1914
NEROUTSOS Geo. (George) D., né à Athènes (Grèce), résidant en Grande-Bretagne à Bowden (Cheshire), 13.10.1876, âgé de 58 ans
NEROUTSOS Marie, 01.05.1878, âgée de 41 ans, femme du précédent
NÜSCKE (MÜSCKE ?) P. H. Behrend (29.11.1856-02.04.1892, vice-consul allemand
OLIVIER Jean-François, 28.04.2010
OUEVAL : v. MANOURY
PABST Antoine (1881-1947)
PABST Marcel (1899-1949)
PAHAUT Jean (12.03.1894-19.12.1953)
PAYTON Beatrice Vera, 19.07.1887, fille d'Alfred Payton, consul britannique à Mogador [Charles Alfred Payton, né le 12.11.1843, 11.03.1926, diplômé du Dover College, consul britannique à Mogador du 16.03.1880 à 1893 puis consul à Gênes (Italie) de 1893 à 1896)
PILLOT Claude (1868-1953)
PLAZA : v. aussi NANINI
PLAZA Ricardo (24.11.1905-27.02.1971)
PROVASOLI Berthe (1929-1949)
RICHARD Christian (21.10.1940-&2.01.2001), peintre traducteur
ROVILLAIN Dominique (12.09.1955-06.12.195.)
SANDILLON François, 23.10.1912 à l'âge de 77 ans
SANDILLON Odette, née BAUDIN, 09.12.1929 à l'âge de 29 ans
SCHMITZ René, 16.10.1927 à l'âge de 47 ans
STARCK René (1937-2006)
TALBOTH Mary Ann, femme de Llak BENCASS (BENCASSI ?), 13.02.1895, âgée de 85 ans
THOMSON Henry Albert Richardson, (Mogador) le 23.07.1879, âgé de 35 ans (Henry Albert Richarson Thomson, né en 1843 dans le district de Thanet (Kent, Grande-Bretagne, fils de John Buck Thomson, né à St. Mary's, Newmarket (Suffolk, G.-B.) le 19.10.1810 (fils d'Henry Thomson et de Mary Ann Pittock), et d'Elizabeth (Payton) Thomson, sa première femme, décédée en 1850, qu'il avait épousée le 12.11.1833. Il épousa Clara Roberts)
THOMSON Richard Edward Charles (1877-13.10.1878), âgé de 11 mois, fils d'Henry Albert Richardson cité ci-dessus et de Clara (Roberts).
TORNEZY Antoine Adolphe, à Mogador le 10.08.1926 à l'âge de 41 ans (Jules Antoine Adolphe dit Adolphe Tornezy, né à Marseille (13) le 10.06.1887, inspecteur d'agriculture à Marrakech, fils de Gaspar Antoine Alphonse dit Alphonse Tornezy, né à Marseille le 09.03.1838, ibid. le 29.08.1926, propriétaire, et de Marie Thèrèse Philomène dite Thérèse Gilles, née à Marseille le 22.02.1855, Aix-en-Provence (13) le 01.07.1939, fille de Joseph françois Isidore Gilles (1808-1900) et d'Elisabeth Esther Consolat (1828-1880). Il épousa à Marrakech, le 04.11.1921, Marthe Yvonne Lejeune, née à Souk-el-Arba (Tunisie) le 25.05.1893, Marrakech le 30.09.1946).
VALETTE Jean-Pierre, né le 26.03.1878, 09.08.1912, chirurgien à Marrakech
VAN LAARHOVEN, né à Tilburg le 30.06.1941, Essaouira le 23.05.2009
VITA (de) : v. aussi DEVITA
VITA (de) Jeanne Huguette, 14.02... (plaque fracturée)
WALKER Augusta Sophie Elizabeth Martha (01.09.1829-24.11.1879)
WALKER Lara Angelina (née v. 1839, 20.11.1925)
ZERBIB M.E., née à Phalsbourg (Moselle), Mogador le 25.07.1881. Issue d'une famille juive mais inhumée dans le cimetière chrétien.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les comtes, vicomtes, barons et chevaliers en Franche-Comté Index des noms de personnes
Jean-Marie Thiébaud
La doctoresse Françoise Légey, toubiba en Algérie puis à Marrakech
La doctoresse Françoise Légey, toubiba en Algérie puis à Marrakech
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Le docteur Françoise Légey, dans son infirmerie à Alger, organisa 20000 consultations dans la première décennie du 20e siècle. En 1909, elle effectua un voyage à Marrakech (Maroc) et en rapporta "Notes de Route. Voyage à Marrakech" paru à Alger sous la forme d'un livret de 20 pages réalisé en janvier 1920 par l'Imprimerie P. Crescenzo, Voûtes Bastion Nord.
Lorsqu'elle arriva à Marrakech, le docteur Émile Mauchamp, auteur d'un ouvrage sur la sorcellerie au Maroc, venait d'y être assassiné. Cette circonstance fut certainement à l'origine de la décision du docteur Françoise Légey de prendre le relais dans cette cité prestigieuse du Sud marocain, au rythme de 60000 consultations annuelles pour femmes et enfants.
Elle s'impliqua très vite dans la lutte pour la dignité de la femme arabe et considéra qu'une des toutes premières tâches du protectorat français était de parvenir à abolir l'esclavage et à réformer le système du harem. Ses propos ont été relayés aux États-Unis dans le "New York Times" du 5 janvier 1913 sous le titre : "Pleads for Release of Moroccan Women ; French Woman tells of Cruelties and Oppressions Due to Slavery and the Harem system".
Médecin parfaitement arabophone, Françoise Légey livra aussi sa connaissance du Maroc dans deux ouvrages parus en 1926 : un "Essai de Folklore marocain" avec une préface-lettre du maréchal Lyautey (Paris, Paul Geuthner, Impr. alençonnaises, Alençon, Orne, 235 p.), et "Contes et légendes du Maroc : recueillis à Marrakech par la doctoresse Légey", publié par l'Institut des Hautes études marocaines", tome XVI, Paris, Ernest Leroux, in-8°, 321 p. Ce dernier ouvrage a été réédité en 2000. Il a aussi été traduit en anglais par Miss Lucy Holtz (London, G. Allen et Unwin, 1935, in-16, 277 p., ill., et en espagnol Cuentos y Leyendas populares de Marruecos, recopilados en Marrakech por la doctora Légey (Madrid, Siruela, 2009.
La mémoire de la doctoresse Françoise Légey (Doctoresse Légey étant le nom qu'elle a fait figurer sur la couverture de ces ouvrages) a été rappelé dans l'ouvrage de Robert Aldrich, "Greater France :A History of French Overseas Expansion (European Studies)" (Palgrave Macmillan, 1996, 385 p., en anglais), page 156.
Marrakech a possédé une rue de la Doctoresse Légey, rebaptisée rue de Tétouan depuis l'indépendance du pays en 1956.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le cimetière chrétien de Marrakech (Maroc)
On y a également transféré les corps inhumés des anciens cimetières de l'Aguedal et de la ville d'Ouarzazate.
LE CIMETIÈRE CHRÉTIEN DE MARRAKECH (MAROC)
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Le cimetière chrétien de Marrakech est situé dans le quartier de Gueliz.
Le centre du cimetière, à l'intersection des deux allées principales, est occupé par un grand monument blanc portant l'inscription
AUX COMBATTANTS
FRANÇAIS ET MAROCAINS
QUI ONT DONNE LEUR VIE POUR LA LIBERTE
Plusieurs pierres tombales portent les inscriptions P.P.E. (Priez pour elle), P.P.L. (Priez pour lui), P.P.E. (Priez pour eux). Presque toutes les tombes d'enfants sont signalées par la mention "UN ANGE AU CIEL".
Le cimetière chrétien d'Ouarzazate a été fermé en novembre 1985 et les sépultures ont été transférées au cimetière de Marrakech sous une pierres tombale sur laquelle on peut lire :
ICI
REPOSENT
LES CORPS DU
CIMETIERE
CIVIL FRANÇAIS
DE LA VILLE DE
OUARZAZATE
Novembre 1985
Sous cette inscription, on trouve le nom d'Yvonne Pataut (citée plus loin).
Une autre pierre horizontale, de grande taille, recouvre les restes d'un autre cimetière :
ICI REPOSENT
LES CORPS DES CIVILS DE
L'ANCIEN CIMETIERE DE L'AGUEDAL
N. B. : Le relevé ci-dessous des inscriptions du cimetière chrétien de Marrakech, bien que fort détaillé, est encore très incomplet.
ABOURISK Famille
AFFRE Valentine, épouse CHALUMEAU, o 22.05.1904, 06.01.1955
ALBERNY Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO
ALBI Famille (regroupée avec la famille BITARD)
ALFANO Baldazoro (?), 30.07.1947
ALFANO Marie, née FARINA, 04.10.1940
ANDRIEUX Robert Alexandre (1901-1988)
ANNA (d') Famille
ARBACETTE Famille
ARNAUD Baptistine, née BERNARD, o 1916, 03.05.2002
ARNAUD Florent, 10.01.1944
AUDIBERT Gaston, famille
BARRA Mélanie, o 17.07.1886, 06.02.193.
BAUDRON Gabrielle, 27.03.1931
BEDOYA Joseph, o 22.02.1905, 16.12.1994
BELLIER née ORSONI Marie Annonciade, o 15.11.1897, 13.12.1983
BERENDY Hélène (1908-1988)
BERENGER : voir DAURE
BERGER Anne-Eugénie, o 25.09.1865, 13.10.1954
BERGER Henri, 2002
BERNARD Émile, o 02.03.1891, 30.03.1953
BERNARD : voir ARNAUD
BLACHÈRE : voir GAUTIER
BLION Léon, 28.07.1933 à l'âge de 58 ans
BOCABEILLE Émile, 04.01.1932 à l'âge de 42 ans
BOCK (de) Mariette, épouse Abdelkader KABBAJ, 14.06.2000
BONNET Anaïs Antoinette, o Marseille (Bouches du Rhône) le 13.06.1891, Marrakech le13.11.19..
BOTARD Famille (regroupée avec la famille ALBI)
BOURLAUX née CHARON Elise Solange, o 08.07.1896, 17.09.1946
BRIDA Famille
BRUMMER C. C., o 02.02.1900, 05.05.1988
BRUNEAU Virginie, o 1890, 10.10.1924
CALAUDI Pierre, 21.01.1949 à l'âge de 44 ans
CANCEL née ETIENNE Marcelle (1899-1980)
CARAPEZZA Famille
CARNUCCINI Famille
CARRASCO Famille
CARTIER Charles
CASTAÑEDA Antoine, o 28.04.1901, 17.01.1946
CATHARINAZ : voir DIBON
CAUMER Roger, 10.10.1909 à l'âge de 47 ans
CHALUMEAU José, 19.11.19.. à l'âge de 2 ans
CHALUMEAU : voir AFFRE
CHARBONNIER Louise, o 21.03.1879, 07.09.1931
CHARON : voir BOURLAUX
CHASSAGNE Catherine, veuve COUBIER (ou GOUBIER), 02.08.1944 dans sa 84e année
CHATELET Famille
CHAUSSEDENT Yvette, o 22.06.1928, 31.08.1928
CHAVE Augustin Denis (1864-1935)
COLOMINA Antoine (1883-1943)
CONSTANTIN Jean-Marie (1939-2002)
CONTESTIN Marguerite, o 27.08.1868, 23.05.1955
CONTESTIN Vincent, o 22.11.1863, 28.04.1939
CONTRÉRAS Famille
CONTRÉRAS Maria, o 14.01.1872, 26.08.1946
CONTRÉRAS : voir MORENO
COPPER-ROYER Marie-Antoinette, o 28.12.1904, 06.11.1988
COSSET Joëlle, o 30.10.1941, 25.01.1942
COUBIER : voir CHASSAGNE
COUSINERY Famille
COUTOLLE Albert (1872-1943)
COUTOLLE Henriette (1867-1948)
CREPIN, colonel (1883-1945), commandant de l'infanterie de la 1re division marocaine, commandeur de la Légion d'Honneur
CROCHET Solange Denise, o 29.05.1922, 22.09.1937
CRUCHET Solange, o 15.06.1910, 03.10.2000
CUVIER Adrienne, 02.12.1950 à l'âge de 71 ans (épouse de Gustave Renneteau)
DANTARD Victor, o 11.10.1887, 06.03.1928
DAURE Marie-Antoinette, née BERENGER ; o 26.11.1905, 10.12.1949
DELAMARRE Charles
DELAMARRE Marcelle
DEREIMS Félix (1882-1942)
DEVAUX Marie, épouse DEVAUX, âgée de 85 ans
DIBON Marie, femme de Maurice CATHARINAZ, décédée accidentellement le 14.02.1929
DONNADIEU Arthur, o 16.03.1896, 11.08.1946
DORÉE Marius (1875-1943), officier de la Légion d'Honneur, mérite militaire
DRUET Raoul, o 11.06.1900, 21.11.1954
DUCROS Aimé, o 21.07.1882, 24.12.1967
DUPAS Alexandre, colonel (1868-1838), Cdt (commandant) le 2ème R.T.M. (Régiment de Tirailleurs Marocains) depuis 1904, commandeur de la Légion d'Honneur [Alexandre.Louis Joseph Dupas, o Auberchicourt (Nord) le 21.10.1868, Meknès (Maroc) le 13.04.1938, fils d'Édouard Dupas et d'Henriette Catherine Claire Tribout. Il a reçu la cravate de commandeur de la Légion d'Honneur le 02.08.1920]
EGUIZABAL : voir FERNANDEZ
EMMERY Marcelle (1904-1943)
ERNE Max F. (Dr) de Crosaz, "né le 26 mars 1924 à Bâle Suisse comme citoyen du monde en passage et mort le 26 novembre 2001 selon son destin ; enterré selon son vux (sic) le 1er desembre (sic) 2001) Marrakech. Dieu bénise (sic) son âme".
ESCOUROU Alphonse, 27.09.1930 à l'âge de 55 ans
ESCOUT Louis, 04.07.1958 à l'âge de 56 ans
ESTEVAN Famille
ETIENNE Berthe (Madame), Marrakech le 18.08.1932 à l'âge de 57 ans
ETIENNE : voir CANCEL
FABBY Jenny Gisèle, née GARROUTY (1918-1944)
FANTUN Pablo, Marrakech le 13.01.1937 à l'âge de 68 ans
FAREY Raoul, 06.01.1954 à l'âge de 56 ans
FARINA : voir ALFANO, REINA
FAUDRAY Jacqueline, o 03.06.1937, 17.10.1937
FAURE Famille
FERNANDEZ Aranza Eguizabal, o 23.12.1960, 02.01.1981
FERRE Joachim, o 22.04.1904, 17.04.1929
FINES Paul Frédéric (1867-1944)
FRAYSSINET Daniel, o 29.08.1912, 30.06.1939
GANGAROSSA Famille
GARCIA J., famille
GARROUTY Marcelle, née GORCE (1896-1944)
GARROUTY : voir aussi FABBY
GARROUTY-FABBY Familles
GAUTIER née BLACHÈRE Marie Jeanne, o Avignon, 17.12.1929 dans sa 64e année
GILLES Albert ; o 24.08.1875, 11.09.1947
GILLES Marthe, o 08.07.1886, 20.11.1945
GORCE : voir GARROUTY
GOUBIER : voir CHASSAGNE
GRAMMATICO Paul, o 14.05.1877, 22.01.1931
GREENBURG Berthe, née LITVACK
GUADRADOY TORREGROSA Tomas, o 17.09.1905, 28.08.1981
GUERON Paulette, o 03.06.1947, 04.01.2001
GUI Charles (Maître), o 04.03.1897, 23.01.1977, médaille militaire, croix de guerre, chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur du Ouissam Alaouite
GUILABERT Albert, 28.06.1943, à l'âge de 46 ans
GUIRAUD Famille
HENNION Émile, 1940 à l'âge de 37 ans, aviateur
HERTZ-OBERLÉ Alain, o 31.07.1943, 03.10.1943
HERTZ-OBERLÉ-BOSSERELLE Famille
HURTADO Antoine, 02.04.1939 à l'âge de 53 ans
HURTADO Julia, 03.11.1951 à l'âge de 67 ans
INGLOTT née JOANNIDIS Olga Edmée, o 13.06.1903, 17.05.1987
ISABELLITA MARTIN GARCIA, o 06.09.1924, 02.05.1930
JARRY Marc-Michel (1916-2003)
JEANNEAU Marcel Henri, o 13.12.1892, 24.12.1981
JOANNIDIS : voir INGLOTT
KABBAJ : voir BOCK (de)
KEIFLIN Fernand Joseph Emile, o Bartenheim (Haut-Rhin) le 29.08.1925, Marrakech le 03.02.2002 (N.B. : Son nom est également écrit en arabe).
KLAIBER Alwin, o 27.06.1902, 02.09.1983
KOSIY Paulette Lucienne, née ROSTAING, 28.01.1932 dans sa 20e année
L'HERBETTE Paul, 16 mai-16 novembre 1930
LA SALLE (de) Ernest, Marrakech le 03.03.1944
LAMBERT Léontine (1891-1977)
LAMBERT Roger (1889-1968)
LANASCOL (de) Georges (1882-1928)
LAUGA Charles, o 22.01.1873, 05.12.1932
LAUGA Jeanne, o 10.01.1873, 15.01.1937
LAZZARO L., famille
LE CALVÉ Joachim, o 12.09.1887, 11.01.1930
LE RAOUX Famille
LEJEUNE Marguerite Yvonne, o 13.10.1919, 07.12.1928
LELACHE Famille
LIMOUSE Famille
LINARES Famille
LIOCATTO Angelo
LITVACK : voir GREENBURG
LORENZO Jean, 16.01.1933 à l'âge de 50 ans
LORES A., o 18.05.1901, 22.08.1938
LOUIS Étienne, o 21.05.1875, 09.05.1958
LOVAT Louis Marc, o Moirans (Isère) le 03.05.1884, Marrakech le 16.03.1927
LUSSON Famille
MAKTIS G., Famille
MANGUIN Odette, o Lyon (Rhône) le 16.02.1919, Marrakech le 08.01.1982
MARTIN Flores, o 29.02.1923 (date théoriquement impossible, 1923 n'étant pas une année bissextile), 08.10.1940
MARTINEZ Agustina Lorente, 27.12.1929 à l'âge de 42 ans
MARTINEZ ESPINOSA Marcelino, o 09.11.1887, 06.01.19..
MARTINEZ Famille
MARTINEZ Marie Rose, o 20.12.1944, 15.04.1945
MARTINEZ Mario, o 05.1917, 13.11.2001
MARTINEZ SERUVE Dominica, o 08.02.1887, 17.09.1961
MARTINEZ Thomas, o 29.11.1920, 24.09.1950
MASSON Denise (1901-1994)
MATHIEU Famille
MELIS Vamille
MELOU-LOGATTO Famille
MIGOT René, sous-brigadier de police, tué en service commandé le 15.08.1953 à l'âge de 30 ans
MIRA François, o 06.06.1888, 21.06.1929
MIRGON Famille
MOKHEFI Christian (février-juin 1956), "Un ange au ciel"
MOKHEFI Juliette (1925-1940)
MOKHEFI Robert, 08.03.1947, "Un ange au ciel"
MOLINA : voir RODRIGUEZ
MONCANY Berthe Madeleine, o 12.09.1898, 21.12.1986
MONNEY Louise Marie, o 12.08.1888, 22.01.1976
MONNEY Marius, o 13.04.1886, 18.08.1943
MONTINI Famille
MOREL Charles, o 17.02.1902, 07.08.1977
MORELLI Jean Antoine, o Vero (Corse) le 11.09.1874, Marrakech le 10.11.1928
MORENO Famille
MORENO Francisco, o 09.06.1901, 09.11.1928
MORENO Madame, née CONTRÉRAS, o 05.07.1896, 15.07.1948
MORENO Marcel, 28.01.1933, à l'âge de 6 mois
MORENO, veuve, née CONTRÉRAS, 19.02.1945 à l'âge de 79 ans
MORERE Paul (1874-1932)
MOUDOUX Colette, o 21.03.1935, 13.07.1938
MULLER Joseph, 01.09.1938
MUSA Famille
NICOLAS Fernand, o 20.07.1920, 09.08.1928
NICOLAS François, o 15.04.1878, 25.07.1930
NICOLAS N.
ORSONI : voir BELLIER
ORTENA Adolfo, 22.12.1959 à l'âge de 47 ans
OUSTRY Famille
PANAYOTIS Theodorellis, o 19.04.1909, 25.02.1965
PARADIS Famille
PARRA Liliane, o 06.04.1923, 21.12.1931
PATAUT Yvonne, 09.01.1960
PECORILLA Famille
PIERRE Émile (1887-1951)
POMMIER Suzanne (1911-2002) (Sa tombe est ornée d'un violon sculpté dans la pierre. Suzanne Pommier, violoniste, était professeur de musique au lycée Descartes de Rabat.Farid Bensaïd fut l'un de ses élèves).
PORTE Francisque, o 25.01.1932 à l'âge de 50 ans
POUILLAUDE Edmée (Madame) (1897-1989)
PRAT Marie Antoinette, o 07.02.1867, 07.02.1945
PRESTET-JOFF André, o 17.08.1882, 12.07.1943
PROD'HOMME Lucien (1917-1927)
QUILÈS Isidore, le 02.06.1929 à l'âge de 51 ans
RABASA Marcel, 03.01.1928 à l'âge de 7 ans. "Regrets éternels".Con Pté (Concession à perpétuité) n° 48
REINA Vincente, née FARINA, 24.05.1942
REISSIS Famille (famille grecque)
RENNETEAU Gustave, 28.09.1945, à l'âge de 58 ans
RODRIGUEZ née MOLINA Joséphine, 12.02.1946 à l'âge de 59 ans
ROLLAND Raymonde, 01.07.1938 à l'âge de 10 mois
RONGIERAS Gaston, accidentellement le 18.01.1928 dans sa 39e année
ROSSENBECK Frédéric, o 26.01.1882, 05.11.1938
ROSSIGNOT Marie-Louise, o 03.05.1897, 27.03.1931
ROSTAING : v. KOSIY
ROUDY René, 17.04.1951 à l'âge de 30 ans
RUCH Robert, 30.06.1982
SABY Famille
SAKELLARIS Konstantin, o 27.10.1885, 25.02.1928
SALA Marie, 03.02.1932 à l'âge de 64 ans
SALOMON Jules, o Paris le 16.03.1871, Marrakech le 26.12.1930
SALORD François, o 08.01.1889, 2.10.1941
SALORD Joseph, o 28.05.1892, 14.02.1950
SALVA Famille
SANTOUL Rodolphe, 02.09.1934, à l'âge de 9 mois.
SARRAGOSSA José, o 14.10.1886, 30.01.1945, à l'âge de 59 ans
SARRAT Famille
SARRAT Marcel, o 12.07.1883, 29.04.1944
SARRAT Rosa, o 15.02.1893, 22.11.1938
SCHREIBER Adolf, 20.02.1977, médaille militaire, croix de guerre, croix du combattant, chevalier du Ouissam Alaouite, commandeur du Mérite volontaire
SCHREIBER Paula, 15.03.1976
SIMON Georgette, o 20.10.1887, 01.10.1941
SOTO (de) Jean, 24.02.1928 à l'âge de 35 ans
SURLEAU Famille
TESSARO Albert, o 27.06.1912, 27.10.2000 (N.B. : un portrait du défunt surmonte l'inscription)
THIEMANN Hans Karl Ludwig, o Bremen (Brême, Allemagne) le 19.04.1924, Marrakech le 28.10.2001 (à la suite des inscriptions en français et en allemand) [Vivant dans les environs de Marrakech (au km 10 sur la route de Casablanca), ce collectionneur allemand de cactus qui a fondé une immense plantation au Maroc en 1963 (avec quelque 150 variétés provenant essentiellement d'Amérique latine) a vendu des plants à Pierre Bergé pour la restauration du Jardin Majorelle. Hans Thiemann, ingénieur horticole a d'ailleurs donné son nom à un cactus].
TONGLET GANDIBLEUX Renée dite "Mamie", "partie au ciel à 90 ans" ; o 18.06.1912, 29.11.2002. "Tous tes enfants t'aiment".
TORREGROSA : voir GUADRADOY TORREGROSA
TORRENT Jean, 06.07.1923 dans sa 63e année
TREBOZ Eugène Emmanuel Alexis, o 10.12.1919, 20.04.1925
TRINTIGNAN Augustin, o 25.08.1859, 19.12.1917
TRINTIGNAN Lucie, o 15.02.1876, 10.01.1955
TRINTIGNAN Marie-Antoinette, o 28.11.1859, 31.05.1932
TRUFFOT Armandine, 22.01.1940 à l'âge de 74 ans
URSO Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO
VALLIER Alexandrine, o 25.07.1896, 12.02.1947
VALLIER Colette, o 15.11.1928, 16.11.1936
VASARI Leda, o 15.04.1899, 15.11.1991
VIETTI Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO
VIETTI-ALBERNY-URSO Famille
WALDEN Paul, o 12.07.1916, 03.03.1995
YAGUES Joséphine, 15.05.1945 à l'âge de 39 ans
ZECHETTI Famille
ZVIKEVITCH Eugène, o 10.08.1906, 13.05.1994
© Jean-Marie Thiébaud, 30 novembre 2009
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le catholicisme au Maroc et l'église de la paroisse des Saints Martyrs de Marrakech
Le catholicisme au Maroc et l'église de la paroisse des Saints Martyrs de Marrakech
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Baignée de lumière et ornée de coloris clairs en harmonie avec ceux du Maroc, l'église des Saints Martyrs de Marrakech est située dans le quartier de Guéliz (quartier construit sous Lyautey par l'architecte urbaniste français Henri Prost), rue El Imam Ali Guéliz, à proximité du musée Dar et Pacha et à 50 mètres à peine de l'avenue Mohammed V.
Elle nous ouvre sa porte latérale après un passage obligé au presbytère. De loin, nous avions reconnu le clocher surmonté d'une croix, moins élevé certes que le minaret d'une mosquée voisine, église et mosquée pouvant toutefois coexister en paix dans un pays essentiellement musulman sunnite1 mais de rite malékite2, la branche la plus tolérante des quatre madhhab (écoles de droit) de l'Islam.
Au fond de l'édifice construit vers 1928, au-dessus du porche d'entrée, trônent d'importantes orgues de fabrication européenne récente.
Jusqu'en 1968 au moins, le fond du chur était orné d'une immense fresque représentant le christ pantocrator (Christ en gloire, assis sur un trône après sa résurrection, tenant une Bible de la main gauche et bénissant de la main droite). Cette fresque, qui avait été réalisée par Frère Jacques et Frère André Boutin, bénédictin, a disparu et a été remplacée par un grand Christ franciscain polychrome, proche de celui qu'on peut voir dans les chapelles des couvents de Sainte Claire, avec le bras supérieur de la croix en forme de tau.
Sur les piliers du chur ont été apposées deux plaques rectangulaires en marbre. Celle de gauche porte l'inscription : "L'Église de Maroc, Fille de l'Église romaine, Innocent IV, 31 octobre 1246", et celle de droite : "Nous avons élevé l'évêque de Maroc à la charge de légat pour l'Afrique, Alexandre IV, 18 mars 1255". Ces deux évènements fondateurs sont postérieurs au massacre de cinq jeunes franciscains (16 janvier 1220)3, à l'origine du nom de cette paroisse, et au placement du siège de la Nouvelle Église d'Afrique à Marrakech par le pape Grégoire IX le 9 juin 1237.
Le lundi 4 août 1578, les Portugais furent battus à la bataille dans la bataille des Trois Rois dans l'Oued Makhazen à Ksar El-Kébir au Nord du Maroc. Le sultan Moulay Abu Marwan Abd-al-Malik (sur le trône depuis 1576 grâce à l'appui des Turcs qui l'avaient aidé à chasser le sultan Moulay Mohammed) fit de nombreux captifs chrétiens et les rendit contre de fortes rançons ou les vendit comme esclaves aux princes Saadiens. Une kasbah marocaine porte encore le nom de ce sultan. L'esclavage sera aboli au 18e siècle
Le sultan saadien Mohammed esh Sheik es Seghir (v. 1636-1655) confia officiellement l'église de Marrakech à l'Ordre des franciscains.
Le culte de la Vierge fut vivant jusqu'en 1672 dans la médina de Marrakech où une petite chapelle lui était dédiée.
Ce n'est qu'en 1923 que Pie XI créa deux vicariats apostoliques au Maroc un à Rabat, pour la zone du protectorat français et un autre à Tanger pour la zone du protectorat espagnol et la zone internationale de Tanger.
Victor Colombanus Dreyer, né à Rosheim (67) le 15.02.1866, 07.05.1944, eut en charge le vicariat apostolique de Rabat jusqu'à son départ du Maroc le 11.03.1927, tandis que le vicariat de Tanger était confié à Mgr Francisco Maria Cervera y Cervera, O.F.M., né à Valence (Espagne) le 13.03.1858, 25.03.1926, sa succession étant assurée par Mgr José María Betanzos y Hormaechevarría, O.F.M., né à Guernica y Luno (Espagne) le 07.09.1863, qui demeura à Tanger jusqu'à sa mort le 26.12. 1948.
En 1947, Mgr Louis Amédée (Louis François Bienaimé Amédée) Lefevre, 15.01.1968, était vicaire apostolique à Rabat, succédant à Mgr Henri Vielle4 (né le 15.061867, 07.05.1946, l'intérim étant alors assuré par Mgr Ludovic Peurois qui avait été jusqu'alors coadjuteur de l'évêque défunt), successeur lui-même du Père Lucien Dané, O.F.M., le premier vicaire apostolique de Rabat. Suite à l'indépendance du pays, la population chrétienne a diminué suite au départ progressif de la population européenne. Par les décrets des 14 septembre 1955 et 14 novembre 1956, Pie XII éleva les deux vicariats apostoliques au rang d'archidiocèses dépendant tous deux du Saint-Siège. En 1967, Mgr Marcel (en religion Jean) Chabbert (né à Castres (81) le 31.12.1920 et évêque de Perpignan depuis 1982) succéda à Mgr Lefebvre à Rabat et, à Tanger, Mgr Francisco Aldegunde Dorrego, O.F.M., né à Chamoso le 12.03.1896, 16.10.1983, évêque coadjuteur, succéda à Mgr Betanzos à la mort de ce dernier en 1948.
En 1983, deux nouveaux archevêques furent consacrés : Mgr Hubert (Hubert Louis Marie Félix) Michon, né à Paris 7e le 2 juin 1927, dans une clinique de Parly II le 20.05.2004, pour Rabat et Mgr Antonio Peteiro Freire, O.F.M., né à Vilasantar (Espagne) le 20.07.1936, pour Tanger (successeur de Mgr Ramon Lourido). Le 5 mai 2001, Mgr Vincent Landel, né le 25.08.1941, ordonné prêtre le 29.06.1969 dans la congrégation des Prêtres du Sacré-Cur de Jésus (SCJ) de Bétharram, devient le nouvel archevêque titulaire de Rabat et siège à la cathédrale Saint-Pierre de cette ville. Mgr Antonio Peteiro Freire démissionna pour raison de santé le 24 mars 2005 et le Père José Seijas Torres a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Tanger. Depuis le 17.06.2007, le nouvel archevêque de Tanger est Mgr Santiago Agrelo Martínez, O.F.M., né à Asados, Rianjo, La Coruña (Espagne) le 20.06.1942.
Alors qu'il était de 350 à 400 000 à l'époque du protectorat français, le nombre actuel des catholiques au Maroc est d'environ 22000 (répartis dans les 57 paroisses de l'archidiocèse de Rabat) auxquels il convient d'ajouter les 2500 catholiques de Tanger.
© Jean-Marie Thiébaud, 2 décembre 2009
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
1 Le sunnisme, largement majoritaire, représente 85 à 90 % des pratiquants de l'Islam.
2 Ce rite doit son nom à l'imam Mâlik ibn Anas (son nom complet étant Abou Abdallah Mâlik ibn Anas ibn Mâlik ibn'Amr ibn Harith), né en 93 de l'Hégire, imam de Médine, arrière-petit-fils d'un compagnon du Prophète. Il rassemble environ un quart des musulmans (N.B. : Il existe un lycée Imam Mâlik à Casablanca). Les trois autres rites sont le chafiisme (pratiqué en Turquie, en Indonésie, en Inde, aux Philippines, en Malaisie aux Comores, etc.), le hanafisme (en Turquie, au Pakistan, en Afghanistan, en Chine, en Inde, au Bengale, au Bengladesh, en Jordanie, en Égypte et en Syrie, plus modestement en Algérie, en Tunisie, etc.) et le hanbalisme, socle du fondamentalisme, ce dernier ayant généré le salafisme ((en arabe : السلفية as-salafiyyah) du mot arabe "salaf", ancêtre, prédécesseur, terme utilisé pour désigner les compagnons du prophète Mohamed et les deux générations qui leur succédèrent et le wahhabisme (en Arabie Saoudite), fondé vers 1745 par Mohammed ibn Abd el-Wahhâb (1703-1792). Ce courant est désireux comme le salafisme (rite ancien mais revivifié au 14e siècle par Ibn Taymiyya), mais de façon encore plus radicale et fondamentaliste, de rendre à l'Islam sa pureté originelle.
3 Après avoir été fouettés, ils furent exécutés par le roi en personne qui leur fendit la tête avec son cimeterre. Le prince de Portugal récupéra leurs dépouilles et les déposa dans l'abbaye de Coimbra. On prêta à celles-ci de nombreux miracles dont la conversion de Fernando de Bulhões, né à Lisbonne et connu plus tard, après son entrée dans les ordres chez les Frères mineurs, sous le nom d'Antoine de Padoue (1195-1231), docteur de l'Église (titre confirmé officiellement par Pie XII le 16 janvier 1946). Ces religieux (Bérard de Carbio, chef de la mission, Orhon, prêtre, Pierre de Saint-Gélinien, diacre, Adjute et Accurce, frères lais) ont été canonisés par le pape Sixte VI le 17 août 1421. Une partie des reliques de ces martyrs est retournée au Maroc en 1957.
4 On doit à Mgr Henri Vielle l'église de Mogador (Essaouira), consacrée en 1936 et toujours en activité. Notons que le nord de la ville actuelle possède deux anciens cimetières, l'un chrétien et l'autre juif. Une des portes du cimetière chrétien est ornée d'une grande croix latine sommant l'inscription PAX, tandis que le cimetière juif est divisé en carrés, chacun d'eux abritant des sépultures des diverses origines de cette communauté autrefois importante numériquement : c'est ainsi qu'il existe un quartier français, un quartier allemand, etc.
Les sous-préfets de Saint-Hippolyte (Doubs) de 1800 à 1816
Créé le 17 février 1800, l'arrondissement de Saint-Hippolyte comprenait les cantons de Blamont, Maîche, Pont-de-Roide, Le Russey et Saint-Hippolyte. La loi n° 342 du 9 janvier 1816 remplaça cette sous-préfecture par celle de Montbéliard.
Cinq sous-préfets se succédèrent à Saint-Hippolyte de 1800 à 1816
1. - Jean Agathe MICAUD, de 1800 au 27.10.1802. Il devint ensuite sous-préfet de Pontarlier jusqu'en 1815, adjoint puis maire de Besançon
2. - Alexandre François de BRUNETEAU de SAINTE-SUZANNE (1769-1853) du 27.10.1802 au 25.01.1805.
3. - Jean Félix Athanase RAVIER (1765-1850), ancien curé constitutionnel de Morteau (25), frère de Jean Baptiste Ambroise Ravier, général et baron de l'Empire, sous-préfet de 1806 à 1811.
4. - Armand de BRANGES de BOURCIA (1781-1857), sous-préfet de Saint-Hippolyte du 14.01.1811 à 1814.
5. - HUOT de NEUVIER, sous-préfet de 1814 à janvier 1816.
Jean-Marie Thiébaud, 27 juillet 2009.
Notes généalogiques et biographiques sur la famille Marlet, d'Ornans (Doubs) Une famille de bourgeois engagés dans la Révolution
Notes généalogiques et biographiques sur la famille Marlet, d'Ornans (Doubs)
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
I. Pierre MARLET, né à Ornans (25), cloutier, épousa Magdelaine NARGAUD qui lui donna dix enfants dont :
II. Le Sieur Jean Baptiste MARLET, né à Ornans (25) le 25.08.1681, vigneron, bourgeois d'Ornans (25), épousa demoiselle Jeanne SIMON (alias SYMON) qui lui donna huit enfants dont :
III. Le Sieur Jacques François (dit parfois Jacques) MARLET, à Ornans (25) le 25.03.1788, notaire royal, procureur postulant au bailliage d'Ornans. Par contrat passé devant le notaire Pierre Alexis Billerey, le 10.06.1756, il épousa demoiselle Jeanne Marguerite (dite parfois Marguerite) PERROT (alias PERROD), 1802/, fille du sieur Jean Claude PERROT (alias PERROD), marchand, et de demoiselle Jeanne MUSELIER, qui lui donna au moins six enfants :
IV A. Jeanne Françoise MARLET, née à Ornans le 19.03.1757 (parrain : Jean Baptiste Marlet, son aïeul paternel ; marraine : Jeanne Muselier, femme de Jean Claude Perrot, son aïeule maternelle).
IV B. Claude Étienne MARLET, né à Ornans le 21.11.1758, à Ornans (25) le 07.01.1802 (marraine : Étiennette Perrot, sa tante maternelle), prêtre, vicaire à Faverney (70), nommé directeur de la confrérie de la sainte hostie miraculeuse de Faverney le 25.09.1791, élu curé de Vuillafans (25), vicaire épiscopal de la Haute-Saône, retiré dans sa famille en 1800.
IV C. Jean Ambroise Bruno (dit parfois Jean Ambroise) MARLET, né à Ornans le 20.06.1761 (parrain : Claude Ambroise Bruno Cardey (1), prêtre familier, cousin paternel ; marraine : Jeanne Baptiste Perrot, sa tante maternelle), prêtre, professeur du collège de Dole (39), assermenté, élu curé de La Grand'Combe (25), vicaire épiscopal du Jura.
IV D. François Philibert (dit aussi Philibert) MARLET, né à Ornans le 11.09.1763 (parrain : Jean François Muselier, vicaire de Chassagne ; marraine : Philiberte Muselier), notaire royal puis notaire public, juge (tribunal civil) en l'an V.
IV E. Jean Claude MARLET, né à Ornans le 17.10.1765 (parrain : Claude Étienne Marlet ; marraine : Jeanne Françoise Marlet).
IV F. Jean François MARLET, né à Ornans le 15.03.1769, à Ornans le 29.12.1800 (parrain : Jean Claude Perrot, son aïeul maternel), notaire public. Il épousa à Ornans, le 06.06.1796, Jeanne Marie Élisabeth Josèphe GRANDJACQUET, mineure autorisée, fille de Jean François Grandjacquet, ancien régisseur de la baronnie de Belvoir (25) ; négociant et avoué à Ornans, vice-président du directoire du district d'Ornans, président du club révoltionnaire des Frères et Amis de Belvoir en mai 1793, nommé membre du conseil général du département du Doubs le 08.10.1793, incarcéré en 1795, membre de l'administration d'Ornans en 1796, nommé administrateur du département du Doubs par arrêté du Directoire le 22.12.1799, juge de paix du canton d'Ornans depuis le 23.12.1799 ; et de Jeanne Marie Tissandier (2). Parmi les témoins de ce mariage, citons son frère, François Philibert Marlet, notaire public à Ornans.
Armoiries de la famille Marlet, d'Ornans : d'azur à trois merles d'argent (sceau du notaire Philibert Marlet, 1790).
(1) Claude Ambroise Bruno Cardey, né à Ornans (Doubs) le 25.09.1729, fils de Nicolas Cardey et de Marguerite Symon (alias Simon).
(2) Jean François Grandjacquet, fils du sieur Joseph Grandjacquet, négociant, et de demoiselle Claude Pierrette Besson, épousa par contrat passé à Ornans devant le notaire Bonnefoy, le 30.01.1775, demoiselle Jeanne Marie Tissandier, née à Ornans en 1750, fille du sieur Pierre Étienne Tissandier, ancien conseiller au magistrat, et de demoiselle Élisabeth Rigolier (mariés à Ornans en 1734).
Sources et bibliographie :
R.P. et E.C. d'Ornans
Archives diocésaines de Besançon
Minutes notariales de M° Pierre Alexis Billerey
Jules et Léon Gauthier, Armorial de Franche-Comté.
Jean-Marie Thiébaud, Les Francs-Comtois de la Révolution, tome I, p. 626 ; tome II, p. 868-869.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Médecins et chirurgiens, barons de l'Empire (1808-1813)
Certains médecins et chirurgiens reçurent de Napoléon &er des titres de comte, dee baron ou de chevalier de l'Empire. Voici une première liste recensant ceux qui furent créés barons.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS, barons de l'Empire (1808-1813)
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
· BOYER Alexis, né à Uzerche (19) le 27.03.1760, à Paris le 25.11.1833, fils de Jean Boyer, tailleur, et de Thérèse Goudrias. Anatomiste et chirurgien, premier chirurgien de Napoléon 1er en 1805 (sur présentation de Jean Nicolas Corvisart). Il a été créé baron de l'Empire le 31.01.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'azur à la main appaumée d'or ; au 2, des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 3, de gueules à la verge en pal d'or, tortillée d'un serpent d'argent ; au 4, d'azur au coq hardi d'or, crêté et barbé de gueules.
· CORVISART Jean Nicolas, né à Dricourt (08) le 15.02.1755, à Athis (78) à Paris le 18.09.1821, fils de Pierre Corvisart (1724-1808), avocat, et de Madeleine Louise Scriblot. Professeur à l'École de Médecine, premier médecin de l'Empereur. Officier de la Légion d'Honneur. Il a donné son nom à une rue parisienne et à une station de métro. Il a été créé baron de l'Empire le 12.12.1808. Arm. : Écartelé : au 1, d'or au cur de gueules ; au 2, des barons tirés des corps savants ; au 3 ; de gueules au lion d'argent ; au 4, d'or à la verge de sable tortillée d'un serpent de sinople.
· DESGENETTES : voir DUFRICHE-DESGENETTES.
· DUBOIS Antoine, né à Gramat (Lot) le 19.06.1756, à Paris le 30.03.1756, fils de Marc Antoine Dubois (1721-1771), receveur des domaines, et de Marguerite Baffos. Professeur à la faculté de médecine, chirurgien des armées de Napoléon, accoucheur de l'Impératrice Marie-Louise. Il a été créé baron de l'Empire le 23.04.1812. Arm. : Coupé : au 1, de sinople à la fleur de lotus d'argent, au franc-quartier des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 2, d'or à la louve au naturel, la tête en rencontre, allaitant un enfant de carnation, le tout posé sur une terrasse alaisée de sinople. N.B. : la présence de cet enfant sur les armoiries de Dubois rappelle qu'il fut le premier accoucheur de l'Impératrice qui mit au monde le roi de Rome.
· DUFRICHE-DESGENETTES Nicolas René, né à Alençon (61) le 23 mai 1762, à Paris le 03.02.1837, fils de Nicolas Desfriches des Genettes et de Françoise Duval-Bichon. Inspecteur général du service de santé, médecin en chef du Val-de-Grâce, de la Garde impériale puis des Invalides, maire du Xe arrondissement de Paris. Commandeur de la Légion d'Honneur. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il a été créé baron de l'Empire le 31.05.1810. Arm. : D'azur à la massue en pal d'or accolée d'un serpent d'argent, à la fasce d'or chargée de trois étoiles d'argent brochant sur le tout. Franc-quartier de baron officier de santé.
· HEURTELOUP Guillaume, né à Tours (37) le 26.10.1750, le 27.03.1812. Chirurgien en chef de la Grande Armée. Officier de la Légion d'Honneur. Il a été créé baron de l'Empire le 16.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, de sinople au dextrochère ganté d'argent, mouvant du canton dextre du chef, heurtant un loup ravissant, le corps contourné d'or, endenté d'argent ; au 2, de sable à trois massues d'or posées en fasce l'une sur l'autre, celle du milieu contournée ; au 3, de gueules à la tour crénelée d'argent de quatre pièces ; au 4, d'or à la tête de Maure de sable, tortillée, accolée et allumée d'argent, avec boucles d'oreille du même. Franc-quartier des barons officiers de santé, brochant sur le tout.
· LALLEMAND François Antoine. Médecin, maire de la ville de Nancy (54) du 03.10.1795 au 14.11.1795, du 15.01.1798 au 10.02.1814 et d'avril au 26.06.1815. Il a été créé baron de l'Empire le 19.06.1813. Arm. : De gueules au serpent vivré en pal d'argent, surmonté de deux étoiles d'or. Franc-quartier des barons maires, à la filière d'argent, brochant sur le tout.
· LARREY Dominique Jean, né à Beaudéan (65) le 07.07.1766, à Lyon (69) le 25.07.1842, fils de Jean Larrey et de Philippe Perès. Chirurgien en chef de l'hôpital de la Garde impériale, inspecteur général du service de santé. Il a été créé baron de l'Empire le 31.01.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'or au dromadaire contourné d'azur, adextré d'un palmier de sinople, le tout posé sur une terrasse de même ; des barons officiers de santé attachés aux armées ; au 3,d'azur à trois chevrons d'or ; au 4, coupé : au 1, d'argent à la barre dentelée de gueules chargée d'une raie (poisson) d'argent ; au 2, d'or à la pyramide alésée de sable.
· MARCHANT Nicolas Damase, né à Pierrepont (57) le 11.12.1767, à Metz (57) le 01.07.1833, fils de Hubert Marchant et de Marguerite Arnould. Médecin, maire de la ville de Metz (57). Il a été créé baron de l'Empire le 11.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, parti d'argent et de sable (armes de la ville de Metz) ; au 2, des barons maires ; au 3, de gueules au lion d'or armé d'une épée d'argent, montée d'or ; au 4, d'argent à la massue de sinople, accolée d'un serpent d'argent et surmontée d'une étoile du même.
· PERCY Pierre François, né à Montagney-lès-Pesmes (70) le 28.10.1754, à Paris le 10.02.1825, fils de Claude Percy, chirurgien-major de l'Ancien Régime, et d'Anne Guillemin. Chirurgien militaire, inspecteur général du service de santé. Il a été créé baron de l'Empire le 14.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'or à la lampe de sable éclairée de gueules ; au 2, des barons officiers de santé attachés aux armées ; au 3, d'azur au miroir d'argent mis en pal, accolé d'un serpent tortillant d'or ; au 4, d'or à la main ailée de carnation tenant un scalpel et entourée d'une couronne de chêne de sinople.
· YVAN Alexandre (Alexandre Urbain), né à Toulon (83) le 28.04.1765, à Paris 1er le 01.12.1839, fils de Louis Yvan, maître maçon, et de Marie Collomb. Chirurgien ordinaire de l'Empereur (1805), chirurgien-major des grenadiers de la Garde impériale, chirurgien en chef de l'hôtel impérial des Invalides. Il a été créé baron de l'Empire le 31.07.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'argent à la tête de Minerve de profil de sable ; au 2, des barons officiers attachés à la maison de l'Empereur ; au 3, de gueules au coq d'argent adextré en chef d'une étoile d'or ; au 4, d'argent au pélican avec sa piété d'azur.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les intendants de Franche-Comté de 1674 à la Révolution
par le Dr Jean-Marie Thiébaud
1674-1684 : Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoy et de Chandeuil, né le 29.08.1642, le 30.07.1719, inhumé dans l'église des Carmes de la place Maubert à Paris ; fils de Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoy et de Chandeuil, le 08.11.1645,, et de Claudine Bonneau, le 20.08.1684. Après avoir servi à Besançon, il devint intendant de Normandie. Le 11.06.1682, il épousa Marguerite Billard qui lui donna au moins six enfants : deux fils, Louis et Germain Louis, et quatre filles dont Angélique Henriette Thérièse qui épousa, le 1er mai 1712, Anne Claude de Thiard, marquis de Bissy (neveu de Henry Pons de Thiard de Bissy dit le cardinal de Bissy, né à Besançon le 25.05.1657, à Saint-Germain-des-Prés le 26.07.1737), et deux religieuses de la Visitation à Paris (Michel Popoff, "Prosopographie, héraldique et généalogie des gens du Parlement de Paris, 1268-1753", Paris, Le Léopard d'Or, 2003 ; Jougla de Morenas, "Armorial général" ; A. de Maurepas et A. Boulant, "Les Ministres du siècle des Lumières").
1685-1688 : Arnaud de Labriffe, né en 1649, dans son château de Ferrières-en-Brie le 24.09.1700, fils de Jean de Labriffe, seigneur de Roquefort, trésorier de France au bureau de Montpellier, et d'Anne de Masparault. Conseiller au Parlement de Paris (20.04.1674), intendant de Franche-Comté, procureur général au Parlement de Paris (septembre 1689), il sera créé marquis de Ferrières-en-Brie en 1692. Il épousa 1) le 29.04.1675, Marie Agnès Pothier, fille de Nicolas Pothier, seigneur de Novion (1618-1693), greffier de l'Ordre du Saint-Esprit, membre de l'Académie française, et de Catherine Gaillard, qui lui donna trois enfants (Pierre Arnaud (1678-1740), conseiller au Parlement de Paris, Anne Catherine (1678-1701) et Marguerite, femme de Louis Bossuet, neveu de l'Aigle de Meaux), 2) le 28.02.1691, Bonne de Barillon d'Amoncourt (1667-1733), fille de Paul de Barillon d'Amoncourt, marquis de Branges, et de Marie Madeleine Mangot qui lui donna au moins quatre autres enfants (Aynette, Marguerite Henriette (1695-1724), Anne Madeleine, religieuse visitandine à Saint-Denis, et Antoine Arnauld, né le 04.01.1699, conseiller au Parlement de Paris (16.12.1718), 1er président du Parlement de Bretagne (18.08.1734).
1688-1698 : Claude de La Fond, seigneur de La Beuvrière, Saint-Georges, Lezernay, Diou, Paudy, La Ferté-La-Fond et autres terres en Berry, Limesy, Brunville en Normandie, et des Laisses près de La Rochelle, le 23.04.1719 et inhumé à Saint-Louis en l'île, fils de Jacques de La Fond, seigneur de La Beuvrière, et de Marguerite Bannelierr. Secrétaire du Roi et garde des Rôles sur la résignation de son père (29.04.1671), membre du Grand Conseil (25.01.1673), maître des Requêtes (16.03.1676). Plus tard, il fut intendant en Roussillon et en Alsace en 1698. Le 28.06.1677, il avait épousé Jeanne Philippe Bence, baronne d'Oulmes en Poitou, dame de Criqueville-en-Auge et du Breuil-en-Auge (1654-1734), fille d'Adrien Bence, seigneur de Criqueville-en-Auge, secrétaire du Roi, et de Jeanne de Chastillon, qui lui donna au moins cinq enfants dont Claude Adrien (1679-1726). Armoiries : d'or au chevron de sable accompagné en pointe d'un arbre de sinople, issant de la pointe de l'écu.
1698-1700 : Jean Baptiste Desmarets de Vaubourg, chevalier, seigneur de Cramaille et de Saponay, fils de Jean Baptiste Desmarets, marquis de Maillebois (1608-1682), intendant de justice en la généralité de Soissons, ministre d'État, et de Marie Colbert (1626-1703), sur du grand Colbert. Il fut successivement nommé intendant en Navarre et Béarn (1685-1687), en Auvergne (1687-1691), en Lorraine et Barrois (1691-1697), en Franche-Comté (1698-1700) puis à Rouen (1700-1701). Un record de durée puisqu'en seize ans de service, il prendra en charge cinq intendances successives avec "grande réputation" selon le marquis de Dangeau. Il quitta la Normandie, en 1701, appelé à de plus hautes destinées, assumant désormais des responsabilités au sommet de l'État : la direction des affaires commerciales au Contrôle général en 1701, le Conseil d'État en 1709 et le Conseil de commerce en 1715. Il épousa Marie Madeleine Voysin. Il mourut à son domicile parisien, rue Saint-Paul.
1700-1703 : André d'Harrouys de La Seilleraye, né le 18.09.1661, 1731, fils de Guillaume d'Harouys, chevalier, seigneur de La Rivière et de La Seilleraye, conseiller du Roi en son Conseil d'État et en son Parlement de Rouen, trésorier général de Bretagne, mort à la Bastille, et de Marie Madeleine de Coulanges. En avril 1687, il épousa Marie Anne Quentin de Richebourg, fille de Jean Quentin de Richebourg (1623-1705) et d'Anne Marguerite Balthazar (ca 1637-1703) qui ne lui donna pas d'enfants. Nommé intendant de Franche-Comté le 11.08.1700, il passa à l'intendance de Champagne le 20.11.1702 et y demeura jusqu'en 1711, se retirant alors pour raison de santé (Charles Frostin, "Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d'influence sous l'Ancien Régime", Presses Universitaires de Rennes, Rennes, collection Histoire, 2006).
1703-1708 : Louis de Bernage, seigneur de Saint-Maurice et de Vaux, né le 03.03.1663, à Paris le 25.11.1737, fils de Jean de Bernage, sieur d'Avrigny, de L'Hermitage, de Saint-Maurice-Thizoualle, de Saint-Maurice-le-Vieil, de Vaux-la-Vallée et de Chaumont, 1689, conseiller au Grand-Conseil, et de Madeleine de Voyer d'Argenson. Il fut conseiller au Grand-Conseil, grand rapporteur et correcteur des lettres en la chancellerie de France en 1687, maître des requêtes en 1689, intendant à Limoges en 1694. Il poursuivra sa carrière. Il épousa Anne Marie Rouillé (1662-1754) (Michel Popoff, "Prosopographie, héraldique et généalogie des gens du Parlement de Paris, 1268-1753", Paris, Le Léopard d'Or, 2003).
1708-1717 : Pierre Hector Le Guerchois, seigneur de Sainte-Colombe, le 27.03.1740, nommé conseiller d'État en 1717.
1717-1734 : Charles Deschiens de La Neuville
1734-1743 : Barthélémy de Vanolles, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires en son hôtel, conseiller honoraire au Grand Conseil. Il descendait de la famille Van Holt, originaire de la Gueldre et dont la généalogie est suivie depuis Jean Van Holt, maître d'hôtel du duc de Gueldre en 1448. La famille obtint la francisation de son nom sous Louis XIV. Une rue de Pontarlier (25) porte le nom de l'intendant Barthélémy de Vanolles. Armoiries : d'argent à sept annelets de sable.
1744-1750 : Jean Nicolas Mégret de Sérilly, né en 1702, le 15.10.1752, fils de François Nicolas Mégret, seigneur de Passy (1673-1734), et de Marguerite de Beaucousin. Il fut maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi, conseiller d'honneur à la Cour des Aides de Paris. Il a fait publier à Besançon une "Ordonnance concernant les salpêtriers".
1750-1754 : Jean louis Moreau de Nassigny, chevalier, seigneur de Beaumont, né à Paris le 28.10.1715, à Fontenay-Saint-Père (78) 1785, fils de Pierre Jacques Moreau, seigneur de Nassigny (1689-1768) et de Claude Françoise Antoinette d'Amoressan de Pressigny. Il fut successivement conseiller au Parlement, maître des Requêtes (1740), président du grand Conseil (17546), intendant du Poitou (1747), de Franche-Comté (1750) puis de Flandre (1754). En mai 1743, il épousa Marie Françoise Grimod de La Reynière, née à Lyon (69) en 1725, fille de Jean Antoine Grimod, seigneur de La Reynière, et de Marie Jeanne Labbé, dont il n'eut pas de postérité.
1754- 1761 : Pierre Étienne Bourgeois de Boynes, marquis de Boynes, comte de Gueudreville, marquis de Sains, baron de Laas, né à Paris le 29.11.1718, en son château de Boynes le 19.09.1783, fils d' Étienne Bourgeois de Boynes (anobli par une charge de secrétaire du Roi), trésorier général de la Banque royale, et de sa première épouse, Hélène de Francini (1692-1722). Il épousa 1) Marie Marguerite Catherine Parat de Montbgeron (1737-1753), morte en couches, mère de Marguerite Bourgeois de Boynes (1753-1762) ; 2) Charlotte Louise Desgots (1740-1804) qui lui donna sept enfants. Il fut nommé simultanément intendant de Franche-Comté et premier président du Parlement de Besançon. Il sera secrétaire d'État à la Marine du 17.04 au 23.07.1774.
1761-1784 : Charles André de Lacoré, né à Paris le 24.08.1720, 1784, conseiller au Parlement de France en 1741, maître des requêtes au Conseil d'État en 1749, président du grand Conseil en 1756, intendant de Franche-Comté où il arriva le 05.10.1761. Grand maître et protecteur perpétuel de la loge maçonnique La Sincérité.
1784-1790 : Marc Antoine Le Fèvre de Caumartin de Saint-Ange, né à Paris le 04.03.1751, à Londres le 31.08.1803, fils d'Antoine Louis François Le Fèvre de Caumartin (1725-1803), prévôt des marchands de Paris (fils d'Antoine Louis françois Le Fèvre de Caumartin, né en 1696, conseiller au Parlement de Paris en 1719, maître des requêtes en 1721), et de Geneviève Anne Marie Moufle (1733-1763), fille de Jean Simon Moufle (1685-1753), secrétaire du Roi, receveur général d'Amiens, et d'Anne Geneviève Marie Brochet de Pontcharault (1709-1733) (Luc Boisnard, "Les Phélypeaux", 1986). Cet intendant prit la fuite pendant la Révolution.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Patronymes russes dérivés de noms de métiers
par Jean-Marie Thiébaud
· БОЧАР (tonnelier) : БОЧАРEВ [Botcharev] ; БОЧАРОВ [Botcharov]
· ШЛЯПНИК (chapelier) : ШЛЯПНИКОВ [Chliapnikov]
· ГРАНИЛЩИК (tailleur de pierre) : ГРАНИЛЩИКОВ [Granilchtchivov et Granilshchikov en translittération anglaise]
· ГРЕБЕЦ (rameur) : ГРЕБЕЦOB [Grebetsov]
· КАМЕНШИК (maçon) : КАМЕНШИКОВ [Kamenchtchikov]
· КОЖЕВНИК (tanneur) : КОЖЕВНИКОВ [Kojevnikov]
· КОЛБАСНИК (charcutier) : КОЛБАСНИКОВ [Kolbasnikov, Kalbasniskov]
· КУЗНЕЦ (forgeron) : КУЗНЕЦОВ [Kouznetsov]
· ЛОДОЧНИК (batelier) : ЛОДОЧНИКОВ [Lodotchnikov, Lodotchnikoff]
· МЕЛНИК (meunier) : МЕЛНИК [Melnik], МЕЛНИКОВ [Melnikov]
· МЯСНИК (boucher) : МЯСНИКОВ [Miasnikov]
· МУЗЫКАНТ (musicien) : МУЗЫКАНТОВ [Mouzykantov]
· ПАХАРЬ (laboureur) : ПАХАРEВ [Pakharev] ; ПАХАРОВ [Pakharov]
· ПАЛАЧ (bourreau) : ПАЛАЧЕВ [Palatchev]
· ПЕКАРЬ (boulanger, fournier) : ПЕКАРEВ [Pekarev] ; ПЕКАРОВ [Pekarov]
· ПЕBЕЦ (chanteur) : ПЕBЕЦOB [Pevetsov]
· ПИЛЬЩИК (scieur) : ПИЛЬЩИК [Pilchtchik]
· ПОП (pope) : ПОПОВ [Popov]
· РЫБАК (pêcheur) : РЫБАКОВ [Rybakov]
· САПОЖНИК (cordonnier) : САПОЖНИКОВ [Sapojnikov]
· СКОРНЯК (fourreur) : СКОРНЯКОВ [Skorniakov]
· СЫРОВАР (fromager) : СЫРОВАРОВ [Syrovarov]
· СОЛДАТ (soldat) : СОЛДАТОВ [Soldatov, Soldatoff]
· ТАНЦОР (danseur) : ТАНЦОРEВ [Tantsorev] ; ТАНЦОРОВ [Tantsorov]
· ТКАЧ (tisserand) : ТКАЧEB [Tkatchev] ; ТКАЧОВ [Tkatchov]
· ВИНОГРАДАР (vigneron) : ВИНОГРАДOB [Vinogradov]
Généalogie de la famille JOBIN, de Damprichard, Santoche et Clerval (Doubs) XVIIe-XIXe siècles
Les Jobin arrivèrent du Noirmont (Jura, Suisse) en Franche-Comté au 17e siècle, après la guerre de Dix Ans.Pierre François Jobin, de Damprichard (Doubs), demeurant à Montby (Doubs) puis à Santoche (Doubs), né vers 1690, décédé à Pompierre-sur-le-Doubs (Doubs) le 15 septembre 1775, fils de Jean Baptiste Jobin et de Blaise Péquignot, épousa, par contrat passé devant le notaire Blondeau à Clerval (Doubs), le 31 décembre 1721, Jeanne Servoise (dite Servoise) Bonfils (fille de Benoît Bonfils et de Marguerite Moine) qui lui donna cinq enfants (Joseph, Roch, Jean François, Alexis et Catherine). L'aîné, Joseph Jobin, né vers 1725, épousa à Clerval, le 20 mai 1758, Anne Françoise Billoutet, fille de Joseph Billoutet, de Clerval, et de Claude Françoise (dite Claude) Briot, fille de Marc Briot et de Claude Françoise Mouchet (N.B. : ce couple eut aussi un fils, Nicolas Briot, notaire royal, qui épousa à Clerval, le 3 juin 1722, Anne Françoise Poirel, fille de François Poirel et de Claudine Petitot, qui lui donna un fils, François-Michel Briot, également notaire royal, procureur fiscal de la seigneurie de Clerval jusqu'en 1789). De cette union est issu : Joseph (II) Jobin, vigneron puis tailleur de pierre, né à Clerval le 28 février 1760, décédé audit lieu le 24 juillet 1813, épousa à Clerval, le 18 février 1783, Françoise Michotey, née à Chazot (Doubs) qui lui donna au moins sept fils :- Joseph Isidore Jobin, né à Clerval le 6 janvier 1784, décédé audit lieu le 9 mai 1784.- Jean François Jobin, né à Clerval le 7 juin 1787, décédé audit lieu le 22 mars 1791 (parrain : Jean Claude Guilloz)- Louis Gabriel Jobin, né à Clerval le 21 mars 1789- Pierre François Jobin, vigneron puis journalier, né à Clerval le 20 janvier 1791, décédé audit lieu le 8 avril 1859. Il épousa à Clerval, le 12 juin 1824, Barbe Xavière Peron (alias Perron), née à Clerval le 7 août 1797, décédée audit lieu le 20 novembre 1854, fille d'Antoine Peron et de Jeanne Doutey. De cette union sont issus quatre enfants : 1) Louise Jobin, née à Clerval le 24 août 1824 ; 2) Claude François Jobin, journalier puis marinier, né à Clerval le 29 juillet 1825, qui épousa a) à Clerval le 20 novembre 1850, Marie Généreuse Arvier, née à Clerval le 5 mars 1827, fille de François Adrien Arvier, journalier, né à Clerval le 4 février 1798 (fils de Claude Arvier et de Claude Françoise Martelot), et de Marguerite Boiteux, née à Villars-sous-Écot (Doubs) le 20 mars 1790, décédée à Clerval le 4 juillet 1843 (fille de Jean Claude Boiteux, cultivateur à Blussans (Doubs), mariés à Clerval le 29 septembre 1825 ; b) à Clerval le 5 novembre 1873, Françoise Gabrielle Mange, né à Anteuil (Doubs) le 9 mai 1831 (veuve de Georges Caillier), fille de François Mange et de Jeanne Antoine Colin ; 3) André Jobin, né à Clerval le 6 novembre 1827 ; 4) Pierre Louis Jobin, né à Clerval le 4 août 1830.- Claude Jobin, né à Clerval le 27 février 1795.- Jean Claude Jobin, né à Clerval le 23 septembre 1797, décédé de fièvre à l'hôpital à Paris le 12 juillet 1829 (après être entré à l'hôpital le 6 avril 1829), ancien vigneron à Clerval, fusilier au 5e régiment d'infanterie de ligne, 4e compagnie du 22e bataillon. Il épousa à Clerval, le 30 mars 1825, Adèle-Benoîte Guilloz, née le 9 fructidor an 12, fille de Claude Antoine (dit Antoine) Guilloz (1768-1825) et de Benoîte Jeannot. De cette union naquirent des jumeaux : Jeanne et Jean Claude Jobin, nés le 12 juillet 1827. Veuve, Adèle-Benoîte Guilloz épousera en secondes noces, à Clerval le 28 avril 1831, Jean Claude Auguste Besson, fils de Jean Alexandre Besson et d'Anne Tirole N.B. : Auguste Guilloz fut témoin des deux mariages d'Adèle-Benoîte Guilloz.- Claude Baptiste Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 13 mars 1804, décédé audit lieu le 18 octobre 1854. Il épousa Jeanne Françoise Billon, née à Clerval le 3 octobre 1810, fille de Pierre Billon, pêcheur, né vers 1768, décédé à Clerval le 26 mai 1814, et de Marie Boyer (?). De cette union naissent trois fils :- Pierre Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 26 janvier 1831. Il épouse à Clerval, le 17 décembre 1863, Charlotte Judith Barret, née à Clerval le 25 février 1835, fille de Claude Etienne Barret, décédé à Pont-de-Roide (Doubs) le 20 décembre 1853, et de Françoise Alexandrine Picard, décédée à Clerval le 22 novembre 1863.- Antoine Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 29 mai 1835. Il épouse à Clerval, le 23 mai 1872, Adèle Coindet, née à Clerval le 15 janvier 1851, fille de Joseph Coindet, décédé à Clerval le 18 mars 1860, et de Josèphe Isabey. Le père reconnut alors sa fille Jeanne Augusta Jobin, née à Clerval le 16 février 1872.- Auguste Joseph Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 6 janvier 1843, décédé audit lieu le 22 janvier 1903. Le 1er février 1865, il épousa à Clerval Françoise Isabey, née à Chaux-les-Clerval le 5 juin 1845, fille de Joséphine Isabey, revendeuse à Clerval (et mariée ensuite avec Joseph Coindet). Le couple eut deux fils : 1) Antoine Emile Jobin, né à Clerval le 15 juillet 1865, qui épousa à Clerval, le 27 décembre 1890, Augustine Anastasie Paillot, née à Soye (Doubs) le 6 avril 1871, fille de Blaise Paillot, décédé à Clerval le 23 septembre 1887, et de Jeanne Justine Pittey ; 2) Jules François Jobin, tailleur de pierre, né vers 1875, qui épousa Lucine Vieille (1883-1969), "la mère Jobin", sage-femme). De ce couple naquit Louise Jobin (1903-novembre 1990), sage-femme, épouse de Maurice Curty.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Monseigneur Laurent-Casimir BOURQUARD, prélat de Sa Sainteté (1820-1900) Membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Besançon
Issu de la famille Bourquard, de Seleute (hameau de Delle, Jura, Suisse), Laurent-Casimir), né à Delle le 1er janvier 1820. Après de brillantes études, il fut ordonné prêtre à Strasbourg le 19 juin 1843. D'abord professeur au petit séminaire de Strasbourg pendant trois ans puis directeur du collège de Ruffach pendant cinq ans, il devint professeur de philosophie au collège de Vaugirard en 1852 puis au lycée de Besançon pendant neuf ans. Premier aumônier du collège Rollin à Paris, il sera nommé professeur titulaire de la chaire de philosophie dès l'ouverture de l'Université catholique d'Angers. Mgr Charles-Émile Freppel, évêque de ce diocèse, le nomma chanoine tandis que Léon XIII élevait ce docteur en théologie et ès-lettres (diplômé à l'Académie romaine de Saint-Thomas d'Aquin) à la dignité de camérier du pape. Laurent-Casimir Bourquard sera plus tard directeur du collége des R.P. Bénédictins de Mariastein, réfugiés à Delle, ville suisse où il mourra en 1900. Laurent-Casimir Bourquard avait été reçu membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Besançon en 1881. On lui doit plusieurs ouvrages dont une Méthode dans les Sciences théologiques (Paris, Lecoffre, 1860).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Descendance d'honorable Etienne Fallot, de Fleurey (Doubs) et d'Isabelle d'Auxiron, de Valoreille (Doubs) 17e-19e siècles
Marié le 27 mai 1608 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Isabelle d'Auxiron, née le 24 novembre 1588 à Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), fille de Jacques d'Auxiron, juge-châtelain de la principauté de Mandeure (25), greffier et tabellion général de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (25), et de Pierrette de la Verne (fille de Nicolas de la Verne, écuyer, seigneur de Mandeure, Courcelles-les-Mandeure, de Cheveney, de Blamont et de Vellechevreux, et de Françoise de Blicterswick), dont
· Jean Fallot, né le 22 mai 1611 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié le 30 octobre 1638 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Foy Burthelier (alias Bretelier), dont
o Jean Fallot, né le 13 décembre 1639 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié le 9 décembre 1661 dans la chapelle de Fleurey (25), avec Marguerite Rondot, de Trévillers (25).
o Marguerite Fallot, née le 9 novembre 1641 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Nicolas Fallot, né le 30 septembre 1645 à Fleurey (25), baptisé à Saint-Hippolyte (25).
Marié le 23 janvier 1667 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Claude Jeambrun, de Ferrières-le-Lac (25), dont
§ Charles François Fallot, né le 21 octobre 1667 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 1er janvier 1749 à La Sincelle, Fleurey (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), échevin de Fleurey.
Marié le 2 mai 1694, Chaux-les-Châtillon (25), avec honnête Marie Antoine Colard, née le 19 mars 1662 à Neuvier (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 3 juin 1751 à La Sincelle, Valoreille (25), inhumée le 4 juin 1751 à Chaux-les-Châtillon (25), fille d'honorable Claude Colard et de Claudine Vuillier, dont
§ Jeanne Baptiste Fallot, née le 7 mai 1695 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jeanne Antoine Fallot, née le 9 juin 1697 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Anne Claude Fallot, née le 10 décembre 1698 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 16 septembre 1779 à Valoreille (25).
Mariée le 27 septembre 1719 avec Pierre Joseph Monnier, né le 19 mars 1693 à Les Reuchaules, Valoreille (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 27 décembre 1767 à Valoreille (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), fils d'Antoine Joseph Monnier et de Catherine Joly, dont
§ Claude Françoise Monnier, née le 22 février 1730 à Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 23 décembre 1818 à Peseux (25).
Mariée le 1er février 1752 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Henry Vadam, né le 28 janvier 1725 à Peseux (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 23 février 1802 à Peseux (25), laboureur, échevin de Peseux, fils de Claude Denis Vadam et de Jacqueline Carnet, dont
§ Jean Jacques Frédéric Vadam, né le 3 avril 1753 à Peseux (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 11 novembre 1831 à Peseux (25).
Marié en 1784 avec Gertrude Gabrielle Pégeot, née en 1752 à Valonne (25), dont
§ Marie Charlotte Vadam
Mariée le 21 novembre 1831 à Peseux (25), avec Joseph Ligier Thiébaud.
§ Marie Théophile Vadam, née le 12 octobre 1785 à Peseux (25).
§ Marie Thérèse Vadam, née le 17 juillet 1755 à Peseux (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
Mariée le 9 février 1779 à Cour Saint Maurice (25), avec Joseph Receveur, fils de Claude François Receveur et d'Anne Marie Lajeanne, dont
§ Jeanne Marie Josèphe Receveur.
§ Jean-Baptiste Modeste Vadam, né le 28 janvier 1758 à Peseux (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 8 novembre 1839 à Peseux (25), laboureur, capitaine de la garde nationale de Peseux (25), maire de Peseux de 1808 à 1812.
Marié le 8 messidor an V (26 juin 1797) à Peseux (25), avec Marie Joseph Ponceot, née le 2 mars 1766 à Peseux (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 26 janvier 1853 à Peseux (25), inhumée audit lieu, fille de Jacques Ligier Ponceot, recteur d'école, maire de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche et de la baronnie de Belvoir, et de Jeanne Clothilde Boiteux, dont
§ Henri Joseph Vadam, né le 15 avril 1799 à Peseux (25).
§ Marie Elisabeth Vadam, née le 29 décembre 1799 à Peseux (25), en 1824.
§ Marie Virginie Vadam, née le 29 novembre 1804, Peseux (25), le 10 février 1896 à Peseux (25).
§ Joseph Léonard Vadam, né le 25 mai 1807, Peseux (25), ibidem le 28 décembre 1840.
§ Hermanfroid Benjamin Vadam, né le 25 mai 1807 à Peseux (25).
§ Jean Joseph Célestin Vadam, né le 17 janvier 1810 à Peseux (25), le 22 juillet 1887 à Peseux (25).
Marié le 27 juin 1859, Fessevillers (25), avec Adèle Lumina Boiteux, née le 31 janvier 1837 à Fessevillers (25), le 21 juin 1897 à Peseux (25), fille de Claude Antoine Boiteux et de Marie Dubail.
§ Marie Françoise Angélique Vadam, née le 7 octobre 1763 à Peseux (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 16 mars 1843 à Neuvier (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
Mariée le 30 janvier 1787, église de Chaux-les-Châtillon (25), avec François-Xavier Thiébaud, né le 10 mars 1768 à Peseux (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 19 janvier 1849 à Neuvier (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), cultivateur et propriétaire, maire de Neuvier, fils de Jean Joseph Ligier Thiébaud, entrepreneur des bois pour la Marine du Roi, et de Marguerite Ursule Socié, dont
§ François Généreux Thiébaud, né le 1er février 1793 à Peseux (25), le 26 août 1856 à Neuvier (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), propriétaire et cultivateur, maire de Neuvier, Les Terres-de-Chaux (25).
Marié le 31 décembre 1813 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Jeanne Véronique Garessus, née le 19 août 1784 à Courcelles-lès-Châtillon (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 28 octobre 1849 à Neuvier (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25), fille de François Xavier Garessus (1750-1833), châtelain de Courcelles-les-Châtillon, et de Jeanne Claude Chognard (1757-1827).
§ Claude Hermanfroid Thiébaud, né le 15 germinal an III (4 avril 1795), Neuvier (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), décédé le 16 septembre 1855 à Neuvier (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), cultivateur.
Marié le 28 mai 1816, Neuvier Les Terres-de-Chaux (25), avec Geneviève Laville.
§ Célestine Victoire Thiébaud, née le 24 floréal an V (13 mai 1797) à Neuvier (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Marie Rose Thiébaud, née le 16 prairial an VIII (15 juin 1800) à Neuvier (25).
§ Joseph Benjamin Thiébaud, né le 30 prairial an XI (19 juin 1803) à Neuvier (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), cultivateur.
Marié le 8 août 1824 à Neuvier (25), avec Marie Césarée Étienne, née en 1806, en 1830.
Marié le 19 janvier 1835 à Liebvillers (25), avec Marie-Anne Laville, née le 16 décembre 1807 à Liebvillers (25), le 14 septembre 1884 à Neuvier (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Marie Bernardine Thiébaud,
Mariée avec Jean François Xavier Grillot, de Vauclusotte (Doubs).
§ Claude Joseph Vadam, né le 8 janvier 1767 à Peseux (25).
§ Pierre François Monnier
§ Jacques Joseph Monnier
§ Jean Claude Alexandre Monnier, né vers 1735, le 7 août 1790 à Valoreille (25).
§ Claude Ignace Monnier.
Marié le 6 janvier 1752 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Jeanne Ursule Jeannin, dont
§ Marie Gabriel Monnier, née le 18 février 1754 à Les Reuchaules, Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Antoine Joseph Monnier, né le 27 mai 1755 à Les Reuchaules, Valoreille (25).
§ François Louis Monnier, né le 8 mai 1757 à Les Reuchaules, Valoreille (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 7 novembre 1758 à Les Reuchaules, Valoreille (25), inhumé le 8 novembre 1758 à Chaux-les-Châtillon (25).
§ François Joseph Monnier, né le 3 aoput 1758 à Les Reuchaules, Valoreille (25), le 25 octobre 1758 à Les Reuchaules, Valoreille (25).
§ François Joseph Monnier, né le 3 janvier 1760 à Les Reuchaules, Valoreille (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jean Nicolas Monnier, né vers 1761.
Marié avec Marie Scholastique Régnier, née en 1768 à Thiébouhans (25).
§ Jean Baptiste Monnier, né le 7 mars 1761 à Les Reuchaules, Valoreille (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Nicolas Fallot.
§ Anne Ève Fallot, née le 15 avril 1669 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
Mariée avec Jacques Antoine Regnaud, dont
§ Ligière Regnaud, née le 11 septembre 1689 à Fleurey, baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Charles François Regnaud, né le 28 mars 1691 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jean François Regnaud, né le 10 mars 1694 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 26 novembre 1759 à Fleurey (25), inhumé le 27 novembre 1759 à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jean Baptiste Regnaud, né le 11 août 1695 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jean François (II) Regnaud, né le 15 août 1698 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jeanne Ursule Regnaud, née en décembre 1701, le 10 mars 1703 à Fleurey (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Claude Antoine Fallot, né le 26 octobre 1647 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié le 5 octobre 1677 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Pierrette Mesloye, née le 27 février 1656 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), fille de Jean Baptiste Mesloye et de Claude de Vaux (alias Devaux) dont
§ Marie Antoinette Fallot, née le 18 avril 1678 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
Mariée le 10 novembre 1700 à Fleurey, paroisse de Chaux-les-Châtillon (25), avec Jean-Pierre Maillard, dont
§ Jacquotte Maillard
Mariée avec Jean Claude Cagnon, né le 20 juillet 1696 à Valoreille (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), laboureur, fils de Jean Cagnon et de Blaise Burthelier, dont
§ Jeanne Françoise Cagnon, née le 26 mai 1746 à Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Claude Françoise Cagnon, née le 24 novembre 1748 à Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 26 septembre 1759 à Valoreille (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Marie Joseph Cagnon, née le 18 septembre 1752, Valoreille (25), baptisée, Chaux-les-Châtillon (25), décédée le 16 janvier 1818, Valoreille (25).
Mariée le 6 janvier 1787, Chaux-les-Châtillon (25), avec François Joseph Péquignot, né le 4 mai 1751 à Cour-Saint-Maurice (25), le 16 mai 1829 à Valoreille (25), inhumé à Valoreille (25), domestique de Claude Joseph Marcel Pourcelot (1759-1829), avocat en Parlement, demeurant à Vauclusotte (25), fils de Jacques Péquignot (1714-1786) et de Marie-Thérèse Richard (1725-1783), dont
§ Henry Péquignot, né en 1788, le 4 décembre 1847 à Valoreille (25), cultivateur.
Marié le 30 octobre 1814 à Valoreille (25), avec Marie Joseph Mougey, née le 25 mars 1788 à Valoreille (25), le 5 mars 1870 à Valoreille (25), dont
§ Marie Virginie Péquignot, née le 5 août 1815 à Valoreille (25).
§ Célestin Joseph Péquignot, né le 4 juillet 1818 à Valoreille (25), le 3 février 1871 à Bief (25).
Marié le 6 février 1850 avec Marie Barbe Zoé Renaud, née le 2 octobre 1826 à Saint-Hippolyte (25).
§ Marie Victoire Péquignot, née le 18 mars 1821 à Valoreille (25), audit lieu le 20 janvier 1871.
§ Euphrasie Péquignot, née le 9 novembre 1823 à Valoreille (25), le 31 mars 1890.
§ Joséphine Péquignot, née le 28 novembre 1826 à Valoreille (25).
§ Octavie Péquignot, née le 29 novembre 1830 à Valoreille (25).
§ Joseph Benjamin Péquignot, né le 20 mars 1833 à Valoreille (25).
§ Louis Joseph Péquignot, né en 1789, le 19 mai 1816 à Valoreille (25).
§ Marie Généreuse Péquignot, née le 24 juin 1792 à Valoreille (25).
§ André Cagnon, né le 20 août 1754 à Valoreille (25).
§ Pierre Antoine Maillard, né à Valoreille (25) le 24 avril 1704, en 1767.
Marié le 31 juillet 1759 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Marie Anne Vadam, née à Peseux (Doubs) le 25 mai 1718, ibid. le 01.12.1778, fille de Claude Denis Vadam (1682-1752) et de Jacqueline Carnet (1686-1759), dont
§ Pierre Joseph Maillard, né le 21 décembre 1760 à Peseux (25), baptisé en décembre 1760 à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Blaise Fallot, né le 2 septembre 1681 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), décédé le 2 janvier 1763 à Fleurey (25), inhumé le 3 janvier 1763 à Chaux-les-Châtillon (25), laboureur.
§ Pierre François Fallot, né le 10 juin 1686 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jacquotte Fallot, née le 2 avril 1690 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Claude Fallot, née le 16 novembre 1693 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Jeanne Ursule Fallot, née le 8 juillet 1651 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), décédée à Fleurey (25) le 22 août 1825, inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
Mariée le 31 janvier 1673 à Chaux-les-Châtillon (25), avec honorable Pierre Antoine Farey, né le 12 décembre 1635 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 20 janvier 1697 à Fleurey (25), inhumé au cimetière de Chaux-les-Châtillon (25), fils de François Farey et de Jeanne Tisserand, dont
§ Jean Claude Farey, né le 10 février 1675 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié le 28 février 1696, Chaux-les-Châtillon (25), avec Marguerite Françoise Romain, née vers 1673, Les Plains, paroisse de Courtefontaine (25), décédée le 28 décembre 1743 à Fleurey (25), inhumée le 29 décembre 1743 à Chaux-les-Châtillon (25), dont
§ Pierre Louis Farey, né le 18 février 1697 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 18 janvier 1767 à Saint-Hippolyte (25), inhumé dans la collégiale de Saint-Hippolyte, notaire royal dès 1721, juge-châtelain du comté de La Roche-Saint-Hippolyte (25) de 1734 à 1767 et de la seigneurie de Feule (25) de 1741 à 1762, cofermier de la principauté de Mandeure (25).
Marié avec Claude Françoise Vourron, née à Mandeure (25), dont
§ Marie Thérèse Farey, née en 1734, le 25 novembre 1739 à Saint-Hippolyte (25), inhumée dans la collégiale de Saint-Hippolyte.
§ Anne Claude Farey, née le 27 juillet 1737 à Saint-Hippolyte (25).
§ Catherine Dorothée Farey, née le 2 février 1740 à Saint-Hippolyte (25), le 14 mars 1740, Saint-Hippolyte (25), inhumée dans la collégiale de Saint-Hippolyte.
§ Jeanne Marie Farey, née en décembre 1701, le 30 mai 1702, Fleurey (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Claude François Fallot, né le 7 février 1654 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Marguerite Fallot, née le 25 août 1656 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
· Foy Fallot, née le 14 septembre 1613 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
· Isabelle Fallot, née le 19 mars 1618 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
· Denise Fallot, née le 19 février 1620 à Fleurey (25), baptisée à Saint-Hippolyte (Doubs), le 19 août 1620 à Fleurey (25), inhumée à Chaux-les-Châtillon (25).
· François Fallot, né le 2 avril 1621 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié avec Charlotte Debois, fille de Jacques Debois (ou des Bois) et de Jeanne Maillot, dont
o Jeanne Françoise Fallot, née le 31 août 1644 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), à Arbois (39) le 17.09.1690.
Mariée le 26 septembre 1661 avec Etienne Baptiste Petitjean, en 1675 à Les Planches près Arbois (39), dont
§ Jean Claude Petitjean, né le 31 mai 1674 à Arbois (39), le 11 octobre 1754 à Arbois (39), receveur des impôts royaux.
Marié le 28 août 1692 à Arbois (39), avec Guyette Laurenceot, née le 14 mai 1661 à Arbois (39), le 3 mars 1746, dont
§ Claude Adrienne Petitjean, née le 13 juillet 1693, le 12 juin 1764.
Mariée en 1725 avec Pierre Gros, dont
§ Jeanne Marguerite Petitjean.
§ Jean Etienne Petitjean, né le 16 décembre 1696 à Arbois (39), décédé le 26 août 1782 à Arbois (39), notaire royal.
Marié le 11 octobre 1729, Arbois (39), avec Anne Françoise Boudrand, née le 20 août 1698 à Arbois (39), le 17 juin 1772 à Arbois (39), dont
§ Claude Etienne Petitjean, né le 11 juillet 1730 à Arbois (39), ibid. le 28 octobre 1803, avocat en parlement.
Marié le 12 juillet 1763 à Arbois (39), avec Thérèse Marguerite Jarre, née le 28 octobre 1729 à Arbois (39), ibid. le 13 février 1783, dont
§ Jeanne Thérèse Petitjean.
§ Jean Baptiste Petitjean, né le 3 mai 1764 à Arbois (39), le 13 août 1844, prêtre.
§ Charles François Aimé Petitjean, né à Arbois (39) le 9 février 1766, ibid. le 14.04.1748, avocat en parlement, juge de paix d'Arbois.
Marié le 6 mai 1788, Arbois (39), avec Jeanne Antoinette Ursule Brahier, née le 9 mars 1752 à Arbois (39), le 21 octobre 1796, fille d'Adrien Brahier et de Jeanne Baptiste Gabrielle Laurenceot.
Marié le 18 novembre 1798 à Ornans (25) avec Marie Françoise Rose Lucie Gaudion, née le 29 mars 1776 à Ornans (25), le 10 mai 1855 à Arbois (39), fille d'Étienne Joseph Gaudion, né le 14 octobre 1739 à Vercel (25), le 14 juillet 1797 à Ornans (25), avocat en Parlement, président du district d'Ornans en 1790 (fils de Jean Baptiste Xavier Gaudion et de Rose Agnès Pergaud, et de Jeanne Claude Josèphe Gonzel (fille d'Adrien Gonzel et de Jeanne Françoise Simard), dont
§ Etienne Coralie Petitjean, née le 1er novembre 1799, le 29 juillet 1801.
§ Etienne Florent Marcel Petitjean, né le 21 août 1802, le 1er décembre 1843.
§ Charles Etienne Adolphe Petitjean, né le 10 mars 1804, décédé le 10 mars 1885.
Marié avec Nicole Antoinette Eugénie Jarre, née le 12 août 1823 à Besançon (25), le 24 novembre 1889.
§ Charles Petitjean, né le 10 avril 1808, le 9 mars 1812.
§ Hélène Françoise Elisabeth Petitjean, née le 19 novembre 1768 à Arbois (39), ibid. le 9 avril 1800.
Mariée le 3 janvier 1797, Arbois (39), avec Thérèse Ferdinand Coulon, né le 13 novembre 1766 à Arbois (39), ibid. le 26 août 1845, contrôleur des contributions directes, fils de Pierre Coulon et de Marie Ursule Emmanuelle Jonas, dont
§ Jules Pierre Etienne Petitjean, né le 27 septembre 1799 à Arbois (39), ibid. le 15 février 1857..
Marié le 16 octobre 1823 à Arbois (39), avec Delphine Jeanne Caroline Regnault d'Epercy, née le 27 juillet 1800 à Arbois (39), ibid. le 27 mars 1857, fille de Louis Marie Regnault d'Epercy (fils de Charles Antoine Regnault d'Epercy, avocat en Parlement, dernier lieutenant mayeur d'Arbois (39), seigneur engagiste des Planches (39), député du Jura à l'Assemblée Législative, et de Thérèse Justine de Perrey) et de Jeanne Bonaventure Françoise Bouvenot.
§ Jeanne Charlotte Jacques Petitjean, née le 23 juin 1699, le 2 octobre 1761.
Mariée en 1736 avec Jean Baptiste Dugoy, né en 1712, dont
§ Jean François Dugoy.
Marié avec Anne Louise Thérèse Lefèvre, dont
§ Jeanne Baptiste Thérèse Ursule Dugoy, née le 24 mars 1791 à Arbois (39), ibid. le 14 juin 1865.
Mariée le 24 octobre 1810 à Arbois (39), avec François Joseph Hippolyte Huguenin Dugoy, né le 19 janvier 1786, Arbois (39), ibid. le 18 janvier 1861, avocat, greffier au tribunal d'Arbois, adjoint au maire d'Arbois.
§ Jeanne Etiennette Gabrielle Dugoy.
Mariée avec Claude Bathilde Bonaventure Caffod de La Ferrière, écuyer, capitaine au régiment de Normandie, dont
§ Jean Joseph Maurice Caffod de La Ferrière, capitaine d'artillerie.
Marié avec Alexandrine Teste, fille de Jean Clément Teste, lieutenant criminel au bailliage d'Ornans, juge du tribunal du district, maire, et de Thérèse Constance Joseph Bidault, dont
§ Augustine Hélène Hermance Caffod de la Ferrière, née en 1803 à Arbois (39), avant 1859.
Mariée le 12 avril 1826 à Arbois (39), avec Claude Étienne Désiré Laurenceot, né le 3 août 1786 à Arbois (39), le 30 septembre 1859 à Port-Lesney (39), fils de Jacques Henri Laurenceot (1763-1833), avocat, commandant du 12e bataillon du Jura en 1792, député à la Convention puis au Conseil des Cinq Cents, inspecteur des eaux et forêts, député du Jura, et de Françoise Ursule Mayre (fille de Claude Dominique Mayre, écuyer).
§ Jean François Petitjean, né le 5 avril 1702, le 24 mai 1765, religieux.
Marié avec Jacquette Mathatoz, dont
o Hugues Fallot, né le 25 juin 1651 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Gabriel Fallot, né le 17 mai 1653 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié le 2 juillet 1690 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Germaine Cupillard, née le 25 avril 1659 à Courcelles-les-Châtillon (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 27 juin 1734, fille d'Étienne Cupillard et de Jeanne Bernard, dont
§ Pierrette Fallot, née le 13 août 1695 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
§ Jean Antoine Fallot, né le 2 juin 1698 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Pierre Antoine Fallot, né le 5 février 1655 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Servois Fallot, né le 14 avril 1657 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
Marié avec Pierrette Gaillot, dont
o Anne Marie Fallot, née le 8 décembre 1664 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Nicolas Fallot, né le 3 juin 1666 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Jeanne Ignace Fallot, née le 30 avril 1670 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Pierre François Fallot, né le 8 août 1673 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).
o Claude Françoise Fallot, née le 4 octobre 1675 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
o Pierre Ignace Fallot, né le 11 mars 1677 à Fleurey (25), ibid. le 20 novembre 1745.
Marié avec Pierrette Cagnon, née vers 1682, décédée le 5 janvier 1754 à Valoreille (25), inhumée le lendemain à Chaux-les-Châtillon (25).
· Agathe Fallot, née le 17 mai 1623 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).
· Anne Ursule Fallot, née le 22 février 1625 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25). Son baptême est également enregistré dans les R.P. de Saint-Hippolyte (25).
· Jeanne Baptiste Fallot, née le 30 août 1628 à Fleurey (25). Son baptême est également enregistré dans les R.P. de Saint-Hippolyte (25).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Familles Robardey de Feule, de Moustier de Marvelise, de Crosey de Rans, de Roll et Bassand Notules généalogiques
Notules généalogiques
Mariage à Crosey-le-Grand (Doubs), le 7 février 1780, entre Claude Charles Félix de Moustier de Marvelise, né le 27 janvier 1755, fils de Georges de Moustier de Marvelise, né à Dambelin (Doubs) le 2 janvier 1721 (fils de Jacques Bernard de Moustier (1693-1775) et de Jeanne Françoise Richard) et de Jeanne Françoise Bassand (dite aussi Bassand d'Anteuil (mariés à Grammont (Haute-Saône) le 4 janvier 1746), et Marie Françoise de Crosey de Rans, née à Petit Crosey le 10 août 1751, fille de Pierre Alexis de Crosey de Rans et de Camille Agathe de Roll.
N.B. : Claude Charles Félix de Moustier de Marvelise était le frère de François de Moustier de Bermont, né à Grammont (Haute-Saône) le 11 mars 1749, décédé à Paris le 17 février 1828 (qui épousa à Berne (Suisse), le 26 avril 1794, Marie Anne de Wyttenbach), un des trois gardes du corps qui accompagnèrent Louis XVI lors de la fuite de la famille royale à Varennes. Ces trois gardes du corps portaient la livrée des Conti ce qui n'était assurément pas le meilleur moyen de passer inaperçus.
Décès à Clerval (Doubs), le 26 décembre 1849, d'Alexis Robardey, officier retraité, âgé de 73 ans, fils de Nicolas Robardey et d'Elisabeth Belain. Son épouse, Françoise Scolastique de Crosey, née vers 1784, décédée à Clerval le 27 mai 1859, était fille de Félicie Dorothée de Crosey, demoiselle de Saint-Cyr, décédée à Clerval, âgée de 96 ans, le 11 février 1853.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les trois premiers recteurs de l'Université de Besançon Du Premier Empire à la Monarchie de Juillet
LES FRÈRES ORDINAIREPierre François ORDINAIRE dit l'aîné, né à Salins (Jura) le 20 mars 1773, décédé à Chaux-sur-Champigny (Jura) le 28 février 1804, était fils de Jacques ORDINAIRE, avocat en Parlement.Pierre François ORDINAIRE, avocat en Parlement comme son père, fut reçu citoyen de Besançon le 7 décembre 1789. Il avait été un des huit députés de la ville aux États provinciaux de Franche-Comté en 1788 puis représentant des avocats à l'assemblée générale de la ville de Besançon, député de la ville à l'assemblée préliminaire et délégué du tiers état à l'assemblée générale du bailliage de Besançon en 1789. Il fut aussi un des quatorze commissaires chargés de rédiger le cahier de doléances de ce bailliage. Élu maire de Besançon le 26 janvier 1790 (par 765 voix sur 959 électeurs), il devint commissaire du Roi près le tribunal du district de Besançon le 27 octobre 1790. Inscrit sur la liste des suspects, il fut incarcéré en avril 1793 et libéré le 12 juin suivant.Nommé conseiller général du canton de Salins en 1800, Pierre François ORDINAIRE fut le premier président du Conseil général du Jura de 1800 à 1803.Il épousa Jeanne Antoine Salomon qui lui donna plusieurs enfants dont deux fils recteurs de l'Académie de Besançon :1. - Jean-Jacques ORDINAIRE, né à Besançon (Doubs) le 27 décembre 1770, mort audit lieu le 31 janvier 1843 (son éloge funèbre étant prononcé par le recteur Carbon et Charles Weiss, président annuel de l'Académie). Camarade de classe des frères Couchery, des généraux Pajol et Griois, de Fourier, etc. Reçu avocat en Parlement en 1790 (comme son père et son grand-père), joueur amateur de guitare (accompagnant parfois son compatriote Fourier lorsque celui-ci chantait), il fut nommé professeur de grammaire générale à l'École centrale du Doubs en mai 1797, professeur au Lycée de Besançon sous le Premier Empire (dès le 2 juin 1809), maître maçon de la loge de Besançon, Sincérité et Parfaite Union (1809), doyen de la Faculté des Lettres (où il était titulaire de la chaire de philosophie) de 1809 à 1823 et choisi, en août 1809, comme premier recteur de l'Académie de Besançon (conservant de poste jusqu'en avril 1821, date à laquelle il l'abandonna au profit de son frère Désiré qui l'assistait déjà depuis quelques années). Membre titulaire de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon dès la reconstitution de cette compagnie par Napoléon 1er en 1806, il fut élu président de cette Académie en 1830 après avoir été conseiller général du département du Doubs. Il fut à nouveau recteur de l'Académie de Besançon de 1834 à sa retraite, devenant alors recteur honoraire à compter du 14 septembre 1839. Il fut reçu membre correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques, section de morale (place n° 2) le 25 janvier 1834 (prédécesseur de l'avocat André Guerry (1802-1866), élu le 10 février 1844). Adepte des idées de Pestalozzi, Jean-Jacques Ordinaire fut l'un des précurseurs de la pédagogie moderne. Il proposa notamment une méthode d'apprentissage mutuel de la langue latine dans un Livret de désinences, édité à Paris (Colas, 1823, in-12). Officier de la Légion d'honneur (mars 1839). Il demeurait rue Saint-Vincent (actuelle rue Mégevand). Il épousa à Besançon Jeanne Hélène Beaudot, fille de Pierre Alexis Beaudot et de Jeanne Baptiste Boyer.Son portrait par Antoine Charles Thérèse dit Melchior Borel (1777-1838) est conservé au musée de Besançon.2. - Jean Gabriel Désiré ORDINAIRE, né à Besançon (Doubs) le 26 avril 1773, mort à Maisières (Doubs) le 7 avril 1847, docteur en médecine, professeur d'histoire naturelle, doyen de la Faculté des Sciences de Besançon (dont il devint doyen en octobre 1810), inspecteur d'Académie à Besançon (juin 1819), recteur des Académies de Besançon de 1821 à 1824 puis de Strasbourg (30 septembre 1824-21 mars 1831), directeur de l'Institut royal des sourds et muets de Paris (1831-1838), contraint à démissionner pour avoir tenté d'y imposer des cours de parole pure. Il a été reçu membre titulaire de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon le 6 février 1811 et membre de la Société d'agriculture du Doubs. Il résida 5, rue Neuve (actuelle rue Charles Nodier). Il a laissé un Essai sur l'éducation et spécialement sur celle du sourd-muet (Paris, Hachette, 1836). Chevalier de la Légion d'honneur. Son fils, Hubert Joseph Édouard, né à Besançon le 27 mars 1812, mort à Maisières (Doubs) le 12 mars 1887, fut reçu docteur en médecine comme son père mais préféra une carrière de journaliste. Il créa, en mars 1848, le journal Républicain de Franche-Comté. Il sera élu député du Doubs en mai 1869 battant de peu (avec 50,5% des voix) Claude Adrien Gustave, marquis de Conégliano (1825-1901), chambellan de l'Empereur. Lors de la proclamation de la République en 1870, il fut nommé préfet du Doubs (8 septembre 1870). On lui doit notamment un opuscule de 16 pages intitulé Considérations générales sur l'état de l'agriculture en France (Broch, in-8 ; chez Dess, libraire à Besançon, et Bruno Labe, 33, quai des Augustins à Paris). Hubert Joseph Édouard Ordinaire épousa Zoé Corne qui lui donna deux fils : Olivier, né à Besançon le 28 mars 1845, mort à Maisières le 7 février 1914, diplomate, auteur de récits consacrés à ses voyages et Marcel, né à Maisières le 17 juin 1848, mort audit lieu le 5 juillet 1896, peintre (élève de Courbet).Claude Éloi (dit Éloi) BERTAUTNé à Vesoul (Haute-Saône) le 13 juillet 1782, décédé à Besançon (Doubs) le 25 juillet 1834, Claude Éloi (dit Éloi) Bertaut, était fils d'André Bertaut, avocat en Parlement, et de Jeanne Françoise Natier.Élève fort brillant, il fut nommé professeur de mathématiques au lycée de Besançon à l'âge de 18 ans.Son intérêt pour la philosophie et l'économie politique firent de lui un correspondant régulier de d'Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836), comte de Tracy, comte de l'Empire, député aux États Généraux de 1789 et philosophe ; Marie-Joseph de Gérando (1772-1842), anthropologue, linguiste, pédagogue, membre de l'Institut, lauréat de l'Académie royale de Stockholm avec un sujet portant sur "Les deux méthodes d'enseignement" ; Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), homme politique libéral et philosophe, membre du Conseil des Cinq-Cents, et Jean-Baptiste Say (1767-1832), le principal économiste classique français, un des maîtres de la doctrine libre-échangiste.Il publia en 1806, à l'âge de 24 ans, un ouvrage Sur le vrai, considéré comme source du bien.Nommé peu après inspecteur d'académie à Besançon, il fut élu président de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Besançon en 1808.Il deviendra recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en 1819 et il y prononça en 1820, pour une distribution des prix, un discours si éblouissant et tellement hors des sentiers battus que ce texte eut l'honneur d'être imprimé dans le journal Les Débats.Ayant refusé sa mutation à Cahors, il demeura sans emploi de 1823 à 1830, date où il fut nommé recteur de l'académie de Besançon.On lui doit aussi un Traité sur les lois en général dont un long fragment a été publié dans les Procès-Verbaux et Mémoires de l'Académie de Besançon en 1833 et dans la Revue provinciale. Sa mort prématurée l'a empêché d'achever cet ouvrage. Il a laissé de nombreux manuscrits dont on trouve la trace dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, rédigé par Ulysse Robert, sous les numéro 1330 (Notes et opuscules divers, politiques et économiques), 1331 (fragment d'une comédie dont seul le premier acte est achevé), 1332-1333 (Tablettes).Claude Éloi (dit Éloi) Bertaut était chevalier de la Légion d'honneur.Son portrait par Antoine Charles Thérèse dit Melchior Borel (1777-1838) est conservé au musée de Vesoul.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les léopards anglo-normands en héraldique
Dans l'univers des armoiries, ce ne sont pas les léopards normands qui sont allés en Angleterre mais les léopards anglais qui sont venus en Normandie et ces mêmes léopards ne sont jamais passés de deux à trois mais, au contraire, de trois à deux.
Lors de la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume de Normandie, celui-ci ne possédait pas d'armoiries et pour cause : l'héraldique n'avait pas encore fait son apparition.
Richard, Cur de Lion, portait "de gueules à deux lions rampants affrontés d'or". À son retour de captivité en 1195, il transforma ces deux lions rampants en trois léopards passants, l'un sur l'autre, que conservèrent ses successeurs, de son frère Jean sans Terre à Édouard III, de 1198 à 1340.
La Normandie fut un duché indépendant du royaume de France de 911 à 1204. Lorsque Philippe Auguste confisqua les biens de Jean sans Terre en vertu du droit de retrait féodal en 1204, les Anglais conservèrent les îles anglo-normandes et, en 1279, Édouard 1er accorda au bailliage de ces îles un sceau avec les trois léopards qu'on retrouve encore de nos jours sur le drapeau de l'île de Jersey.
La Normandie continentale a donc été annexée au royaume de France. En septembre 1465, Louis XI nomma son frère Charles duc de Normandie et celui-ci, au lieu d'ajouter une brisure aux armes de France (les fleurs de lis), préféra reprendre les léopards des Plantagenets mais en réduisant leur nombre de trois à deux.
Précisons enfin que le terme "léopard" n'existe pas dans l'héraldique anglaise. Les animaux que les Français qualifient de léopards en héraldique sont dits "lions passants gardants (regardants)" dans le vocabulaire anglais du blason ce qui est plus logique puisque les léopards ne sont pas ceux de la faune mais des lions dont la tête n'est plus vue de profil, mais de face, les yeux de l'animal regardant le lecteur de l'écu.
Docteur Jean-Marie Thiébaud
Fondateur du Conseil Français d'Héraldique
25 mars 2008
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Membres de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons de Franche-Comté à Rome (17e-18e siècles)
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Le 19 août 1650, trois Francs-Comtois (Jean Bonnot, prêtre de Salins (Jura), Hippolyte Collot alias Coillot, de Poligny (Jura), docteur ès droits et attaché à la Cour de Rome, et Jean Menacard, chanoine de Saint-Maurice de Salins) présentèrent, au nom de leurs compatriotes installés à Rome, au vice-gérant du cardinal-vicaire de Sa Sainteté l'autorisation de se réunir en assemblée et c'est ainsi que, dix jours plus tard, "quarante-neuf nationaux de la Franche-Comté de Bourgogne se réunissaient, en vertu d'une autorisation temporaire, dans la chapelle de la Purification des Transalpins. Ils y déclaraient vouloir créer à Rome une confrérie nationale sous l'invocation de saint André et de saint Claude, patrons et protecteurs de la Franche-Comté ; ils ajoutaient que cette confrérie, à la fois pieuse et charitable, s'efforceraient de trouver des ressources pour ouvrir une église et ensuite pour fonder un hôpital à l'usage exclusif des indigents de la Franche-Comté qui se trouveraient à Rome Dans une seconde assemblée, tenue à Saint-Yves des Bretons le 4 novembre 1650, les nationaux de la Franche-Comté, au nombre de 156, constituèrent des procureurs pour l'acquisition, aux frais de leur groupe national, d'un oratoire destiné aux exercices de la confrérie qu'ils projetaient d'établir. Ces mandataires firent choix d'une petite église que les Bernardins réformés de la province de Piémont possédaient sur la vieille place de Saint-Silvestre et que ces religieux consentaient à aliéner. Cet oratoire fut d'abord amodié, et le groupe national s'y réunit pour recevoir notification d'un acte du 7 mai 1652 qui donnait l'institution canonique à la confrérie de Saint-Claude. Séance tenante, il fut procédé à une première élection des officiers annuels de la confrérie, c'est-à-dire de deux recteurs, d'un secrétaire, de six conseillers ou assistants, de deux syndics, de deux visiteurs des pauvres et de deux sacristains, toutes ces fonctions étant bénévoles. Il fut arrêté ensuite que la confrérie se recruterait uniquement parmi les nationaux de la Franche-Comté et les citoyens de Besançon, ainsi que parmi les enfants mâles desdits nationaux ou citoyens résidant à Rome. On ne tarda pas cependant à faire appel en faveur de l'uvre aux Comtois qui habitaient Naples, et l'un deux, Claude François de Lallemand, baron de Lavigney, fut accrédité pour recevoir les offrandes destinées à la confrérie . L'oratoire de la vieille place de Saint-Silvestre fut acquis le 3 avril 1656, moyennant la somme de onze cents écus. L'autorisation d'y recevoir des sépultures fut obtenue le 28 juin 1659. Dans le même temps, la confrérie acheta trois maisons contiguës à son église et entreprit la réédification de l'une d'elles " (Castan, op. cit., p. 185-188). Ces maisons permettront la construction d'un hôpital. Plus tard, la confrérie devait s'adjoindre les services d'un agent comptable (essatore) et celui d'un fabricien (fabbriciere).
L'église des Francs-Comtois à Rome, placée sous le double patronage de saint André et de saint Claude. Située Via del Pozzetto (160, Piazza San Silvestro), est plus connue sous le simple nom de Saint-Claude des Bourguignons. Sur sa frise, on peut lire l'inscription suivante : COMITATUS BURGUND. SS. ANDREÆ AP. ET CLAUDIO EP. NATIO DIC. (Le Peuple du Comté de Bourgogne a dédié cette église à saint André, apôtre, et à saint Claude, évêque).
Tous les Francs-Comtois arrivant à Rome avaient le droit d'être reçus gratuitement dans l'hospice fondé à leur intention. Au-dessus de la petite porte constellée de clous de cet établissement cédé à l'administration de l'hôpital, Via del Mortaro, on pouvait encore lire, à la fin du 19e siècle, l'inscription HOSPITIO PER. LI. POVERI PELLEGRINI BORGOGNONI CONTE (Hospice pour les pauvres pèlerins du comté de Bourgogne).
La construction d'un hôpital, annexé à l'oratoire Saint-Claude, avait été autorisée le 08.10.1663 par un rescrit de l'archevêque de Patras, vice-gérant de Rome. La dotation de l'asile avait été assurée par François Henry (surnommé Francesco Arrigo et Francesco de Borgogna par les Italiens), originaire de Montarlot-les-Champlitte (Haute-Saône) et installé depuis plusieurs années à Rome, grâce à un important legs contenu dans le testament rédigé par ce bienfaiteur le 26.01.1654.
Après la conquête de la Franche-Comté par les troupes de Louis XIV, l'église était administrée par le curé de Saint-Louis des Français et on y avait apposée l'inscription QUICUMQUE ORAVERIT PRO REGE FRANCIÆ HABET DECEM DIES DE INDULGENTIA, A PAPA INNOCENT. IV (Quiconque prie pour le roi de France a dix jours d'indulgence accordés par le pape Innocent IV).
Les Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette (fondation française installée en Italie) sont propriétaires de cinq églises dans la capitale italienne : Saint-Louis des Français, La Trinité des Monts, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons et Saint-Claude des Bourguignons. Ces églises sont placées, par le biais de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. L'affectation de certains des biens des Pieux établissements de la France à Rome, comme l'ensemble conventuel de la Trinité des Monts et l'église de Saint Claude des Francs-Comtois de Bourgogne, fait l'objet d'accords internationaux bilatéraux entre la France et le Saint Siège. En outre, le dernier règlement de cette fondation, du 25 août 1956, a été approuvé par bref du Pape Pie XII, en date du 8 septembre 1956.
Leur administrateur actuel est le Père Bernard Ardura.
· ALVISET Pierre (fils d'un notaire de Besançon), 1660-1675
· AYMONIN Joseph, prêtre du diocèse de Besançon (Doubs), membre de la confrérie de Saint-Claude dès 1761, recteur de celle-ci en 1767, curé de Saint-Louis des Français à Rome en 1774. C'est lui qui rédigea, le 28.11.1774, l'acte de décès du sculpteur Pierre de l'Estache, auteur, selon Castan et Muntz, des quatre figures d'évangélistes qui décorent les pendentifs de la coupole de Saint-Claude des Bourguignons (Eugène Muntz, "Artistes employés à Saint-Louis des Français", in Nouvelles Archives de l'Art français, 1876, p. 380). En réalité, on doit ces pendentifs à Giuseppe Rusconi (1687-1758). On doit par contre à Pierre de l'Estache (v. 1688-1774) la réalisation de statues en stuc représentant quatre vertus.
· BALLET Philippe, membre fondateur de la confrérie en 1650
· BARBAUD Jean, recteur de la confrérie en 1786
· BARBERET Albert, membre fondateur de la confrérie en 1650
· BARBEROT Claude (fils de Jean Barberot), de Chargey-les-Port (Haute-Saône), membre de la confrérie depuis 1672. Il testa le 11 août 1672 devant le notaire Belletti (qui le nomme "Barbaro" dans ce document), fondant deux dots pour des jeunes filles pauvres d'origine franc-comtoise. Cette libéralité ne devint effective qu'au décès de Jeanne Jacquet ("Giovanna Giacchi"), veuve du testameur. Ce testament est conservé aux Archives d'État (Archivio di Stato).
· BARTHELET François, recteur de la confrérie en 1742-1743, 1749-1760
· BAUDOT Jean, recteur de la confrérie en 1725-1727, trésorier en 1728-1732
· BAUDOT Joseph, membre de la confrérie dès 1670.
· BEJAMAIN (BENJAMIN) François Humbert, membre fondateur de la confrérie en 1650, sacristain en 1652
· BESANÇON Jean Antoine, recteur de la confrérie en 1784
· BÉSARD Jean, membre de la confrérie depuis 1650.
· BEUQUE Claude (Claude Jean Baptiste), originaire de Dole (Jura), à Rome en avril 1717, docteur en théologie, prieur, membre de la confrérie dès 1694, recteur en 1694-1696, trésorier en 1698, prieur en 1716-1717. Il fit un legs au profit de l'église Saint-Claude. Son frère, Denis Beuque, protonotaire apostolique, fut recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Besançon (Doubs).
· BIDO (alias BIDAU) Jean-Louis, membre fondateur de la confrérie en 1650, assistant en 1652, trésorier en 1653, prieur de la confrérie en 1655-1658
· BOISOT Jean-Baptiste, né en juillet 1638, abbé de Saint-Vincent de Besançon, membre de la confrérie dès 1663. Il constitua une importante bibliothèque qu'il légua à sa ville natale afin qu'elle devînt un dépôt public (le premier de France) (H. Tivier, "L'abbé Boisot", Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs, 4e série, t. IX, 1875).
· BOLE Jean, prêtre, recteur de la confrérie en 1675-1676, 1684-1685
· BONDONA Abraham, écrivain apostolique,1650, recteur de la confrérie en 1654 et en 1659
· BONNET Jean, de Salins (Jura), prêtre, membre fondateur de la confrérie en 1650, trésorier en 1662, secrétaire de la confrérie en 1668
· BORDEAU Claude, recteur de la confrérie en 1768
· BOUCHET Jean, recteur de la confrérie en 1662
· BOURGONGNE (de) François, membre fondateur de la confrérie en 1650
· BOUVOT Claude Étienne, recteur de la confrérie en 1746-1747, 1753-1754
· BRESSAN Simon, prêtre, membre fondateur de la confrérie en 1650
· BRETON Luc François, né à Besançon (Doubs) le 06.10.1731, ibidem le 4 ventôse an VIII (23.02.1800), fils de François Breton, procureur au bailliage de Besançon, et de demoiselle Catherine Obingen. Menuisier puis sculpteur, il se rendit à Rome, tailla ensuite le marbre et réalisa la Mort du général Wolf et un saint André colossal qui fut placé devant l'église de Saint-Claude des Bourguignons. De retour à Besançon, il réalisa deux Anges adorateurs en marbre blanc (1765) qui ornent l'autel de la cathédrale Saint-Jean (et seront copiés dans de nombreuses églises de Franche-Comté), une Piéta en pierre de Tonnerre, placée dans l'église Saint-Pierre en 1787, un buste de Cicéron et une statue de saint Jérôme. On lui doit aussi un magnifique tombeau exécuté dans l'église de Pesmes (Haute-Saône) pour Ferdinand de la Baume mais malheureusement détruit à la Révolution. Il adhéra à la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons lors de son séjour à Rome à l'Académie de France en 1766. Il était membre associé de l'Institut. On a donné son nom à une rue de Besançon, reliant la grande-rue et la rue des Granges.
· BRIOT Jean Baptiste, recteur de la confrérie en 1703-1704, 1709-1710, trésorier en 1716, 1724
· BRIOT Jean Pierre, recteur de la confrérie en 1761-1764, trésorier en 1764. Il fonda une messe dans l'église Saint-Claude
· BRIOT Joseph, né à Belleherbe (Doubs) vers 1689, à Rome le 04.07.1781, inhumé dans l'église Saint-Claude des Bourguignons, fils de Jean-François Briot, greffier de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche, et d'Anne-Marie Genevois. Prêtre, secrétaire de la confrérie en 1718, recteur en 1728-1730, 1736, trésorier en 1742, prieur commendataire de Romainmôtier (1739), futur préfet de la Daterie apostolique à Rome. Par décret du 31 mars 1764, l'archevêque de Besançon autorisa la construction d'une église succursale à Belleherbe, édifiée aux frais de Joseph Briot, préfet de la Daterie à Rome, et de Sébastien Briot, vicaire de Verrière. Joseph Briot envoya de Rome trois tableaux pour l'ornementation de cet édifice. Son portrait était conservé à la cure de Belleherbe. Voir du même auteur, "Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté", t. II, p. 201-205.
· BROUILLARD Antoine, assistant de la confrérie en 1652
· CHAPUISET Claude, recteur de la confrérie en 1669, trésorier en 1672, recteur en 1673-1674, trésorier en 1676, recteur en 1678, 1680-1681, 1686-1687
· CHASSIGNET Jean, le 17.06.1680, membre de la confrérie depuis 1655, chanoine de l'église métropolitaine de Besançon (Doubs) depuis 1667
· CLAUDET Jean-Baptiste, prêtre, recteur de la confrérie en 1732-1733, 1750-1752, 1756-1760
· CLERC Nicolas, trésorier de la confrérie en 1679, recteur en 1683-1684, 1687-1695, 1699-1700, 1702-1703, 1708-1709, 1717-1718
· COILLOT Claude François, de Poligny (Jura), reçu docteur en droit à Rome, 1661. Avec son frère Jean-Charles Coillot, alphère, il défendra la ville de Besançon (Doubs) en 1674. Tous deux seront ensuite reçus gratuitement citoyens de Besançon. Claude François Coillot sera maire de Poligny en 1684 (Chevalier, Histoire de Poligny, t. II, p. 335).
· COILLOT Hippolyte, de Poligny (Jura), docteur en droit, attaché à la cour de Rome, membre fondateur de la confrérie en 1650, secrétaire de la confrérie en 1653-1662, recteur en 1663
· COLETTE Claude Antoine (alias COLLETTE Claude), membre fondateur de la confrérie en 1650, assistant en 1652
· COLIN de CHAFFOIS Philippe, écuyer, membre de la confrérie en 1685, maire de Pontarlier (Doubs) en 1695
· COLOMBOT Étienne, secrétaire de la confrérie en 1685
· COSTE Nicolas, membre fondateur de la confrérie en 1650, greffier en 1660-1661, recteur de la confrérie en 1670
· CUINET Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650, syndic en 1652
· DAILLO Jean Charles, membre fondateur de la confrérie en 1650
· DEGOUX : voir GOUX (de)
· DESCHARD Jacques, trésorier de la confrérie en 1720, recteur en 1727-1728
· DESCHARD Jean Baptiste, recteur de la confrérie en 1701-1702, 1720-1721
· DESCHARD Pierre, recteur de la confrérie en 1738-1741, 1747-1748, 1761-1762, trésorier en 1762
· DUBOIS (alias DU BOIS) Alexandre, recteur de la confrérie en 1655-1558
· DUMONT (alias DU MONT) Philibert, membre fondateur de la confrérie en 1650
· DURAND François, recteur de la confrérie en 1729-1730
· FATELAY Claude, originaire de Chapelle d'Huin (Doubs), prêtre, membre fondateur de la confrérie en 1650, trésorier de la confrérie en 1655-1659, recteur de la confrérie en 1664-1665, 1668, 1671
· FATELAY Ignace, recteur de la confrérie en 1692-1695, 1718-1719
· FROISSARD de BROISSIA Jean, membre fondateur de la confrérie en 1650
· FROISSARD de BROISSIA Jean Claude Joseph, seigneur de Montagna, recteur de la confrérie en 1677
· FROISSARD de BROISSIA Jean Ignace, prieur de Vaux-sur-Poligny (Jura), chanoine du chapitre métropolitain de Besançon (Doubs), membre fondateur de la confrérie en 1650, prieur de la confrérie en 1663
· FROISSARD de BROISSIA Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650
· GALOIS Étienne François, de Poligny (Jura), en 1774, curé de Saint-Louis des Français à Rome (1733) (Eugène Muntz, "Artistes employés à Saint-Louis des Français", in Nouvelles Archives de l'Art français, 1876, p. 379), membre de la confrérie en 1731, chanoine de l'église métropolitaine de Besançon en 1734, vicaire général de l'archevêque de 1746 à 1772, vice-chancelier de l'université de Franche-Comté dès 1748 (Almanachs de Besançon et de Franche-Comté).
· GARNIER Hugues, membre fondateur de la confrérie en 1650
· GELIOT Frédéric, membre fondateur de la confrérie en 1650
· GENERO Claude, membre fondateur de la confrérie en 1650
· GIROD Claude, de Nozeroy (Jura), docteur en droit, 1661. Il sera reçu gratuitement citoyen de Besançon le 13.11.1669.
· GOUX (de) Claude René, membre fondateur de la confrérie en 1650
· GRANDJACQUET Guillaume Antoine (dit Antoine), né à Reugney (Doubs) le 17.06.1731, à Rome, dans la paroisse de San Lorenzo in Lucina, le 22 février 1804, fils de Claude Étienne Grandjacquet et de Jeanne Françoise Troutet (parrain : Guillaume Vallet ; marraine : Marie Antoine Grandjacquet, tous deux de Reugney. Sculpteur, il réalisa en 1771 une statue colossale de saint Claude, placée à côté de celle de saint André, uvre de son compatriote Luc Breton. Devenu membre de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons en 1766, il en fut secrétaire en 1769 et recteur (député) en 1793. Il épousa Girolama Girod, d'origine comtoise.
· GRIFFON Quentin, membre fondateur de la confrérie en 1650, recteur de la confrérie en 1652-1653 et en 1660-1661, secrétaire en 1663-1667, recteur en 1668-1669, 1671-1672, trésorier en 1673, recteur en 1674-1675, 1679
· GRISET François, membre fondateur de la confrérie en 1650
· HENRY François, assistant de la confrérie en 1652, recteur en 1654
· ISABEY, membre fondateur de la confrérie en 1650, visiteur des pauvres en 1652
· JEANNIN Philippe, recteur de la confrérie en 1730-1731, 1736-1737, trésorier en 1738, recteur en 1745-1746
· JODIMET (JODIMEY, GOUDIMEL) Nicolas, de Besançon (Doubs), membre fondateur de la confrérie en 1650
· JOLIOT Frédéric, membre fondateur de la confrérie en 1650
· JOUSSERANDOT Marc, recteur de la confrérie en 1719, 1725-1726, 1731-1732, trésorier en 1733, recteur en 1737, trésorier en 1739-1741, recteur en 1742
· LAMBERT Henri, prêtre, recteur de la confrérie en 1676
· LANCHY Jacques, recteur de la confrérie en 1755
· LANCHY Jean, recteur de la confrérie en 1784-1785
· LANCRENON Claude Simon, de Lods (Doubs), en 1756, secrétaire de la confrérie en 1724, 1727, 1731, 1734, 1737-1741, recteur en 1744-1745, 1755-1756
· LANGROGNET Antoine Nicolas (dit Nicolas), né à Vesoul (Haute-Saône) le 08.01.1651, ibidem le 07.05.1727 (fils de François Langrognet et de Marguerite Othenin), membre de la confrérie depuis 1671, maire de Vesoul en 1683, 1692 et 1699 (Suchaux, Galerie nobiliaire, tome I, p. 324), lieutenant général de police (lettres patentes du 20.06.1700). Devenu conseiller au Parlement de Franche-Comté (03.01.1712) et seigneur de Chargey-les-Port (Haute-Saône), il a été reçu citoyen de Besançon (Doubs) le 05.03.1712. Il épousa à Vesoul, le 20.04.1676, Anne Madeleine Miredondel, fille de Jean Miredondel, procureur au bailliage, et de Claudine Buretel, qui lui donna seize enfants.
· LASSAU (de) Hyacinthe, originaire de "Molard" (Molay), membre de la confrérie depuis 1662. Il a fondé une messe dans l'église Saint-Claude.
· LINGLOIS Jean-Baptiste, membre fondateur de la confrérie en 1650, docteur en droit, avocat à Besançon (Doubs) dès le 12.02.1657
· LOGRE François, membre fondateur de la confrérie en 1650
· LOISY (de) Charles Jean Baptiste, né à Besançon (Doubs) le 25.06.1655, le 14.05.1705 (fils de Pierre de Loisy (1619- v. 1670), orfèvre et graveur, et d'Anne Gaudot, membre de la confrérie en 1678, reçu maître orfèvre à Besançon le 24.04.1680
· LOMBARD Charles, recteur de la confrérie en 1785-1786
· LOMBARD Jean Claude, secrétaire de la confrérie en 1723, 1725-1726
· LOMBARD Jean-François, recteur de la confrérie en 1711-1715, trésorier en 1717, recteur en 1721-1722
· LOMBARD Jean Ignace, de Bouverans (Doubs), recteur de la confrérie en 1769, trésorier en 1771
· LOUVET Claude François, recteur de la confrérie en 1672-1673
· LOUVET Jean Claude, d'Arbois (Jura), docteur ès droits et écrivain apostolique, recteur de la confrérie en 1670, 1672
· LUC Nicolas, de Poligny (Jura) (?), vers 1710, trésorier de la confrérie en 1670. Il fonda deux chapellenies dans l'église de Saint-Claude en 1710.
· MAGNIN Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650
· MAILLET Nicolas, doyen, membre fondateur de la confrérie en 1650
· MAIROT Jacques Louis, de Baume-les-Messieurs (Jura), prieur des Bouchoux depuis 1638, membre fondateur de la confrérie en 1650
· MARCHAND de LA CHÂTELAINE Claude Pierre, membre de la confrérie en 1685.
· MARCHANDET Étienne, recteur de la confrérie en 1677
· MARGUET Jacques, assistant de la confrérie en 1652, trésorier de 1663 à 1669, 1671-1672, 1674, 1678
· MARMIER Georges, vers 1707, recteur de la confrérie en 1688-1689, 1691-1693, trésorier en 1696. En 1707, il fit un legs au profit de l'église Saint-Claude à charge de deux messes par mois.
· MASSON Claude, membre fondateur de la confrérie en 1650, syndic en 1652
· MAUGAIN Pierre, trésorier de la confrérie en 1723, 1734-1737
· MAUPRÉ Vincent, recteur de la confrérie en 1681-1682, trésorier en 1683-1686
· MELIN Antoine, prêtre, secrétaire de la confrérie en 1749
· MENECARD Jean, vers 1660, chanoine de Saint-Maurice de Salins (Jura), membre fondateur de la confrérie en 1650, chanoine de l'église métropolitaine de Besançon (Doubs) lors de son décès
· MICAUD Guillaume, secrétaire de la confrérie en 1681, recteur en 1685-1686
· MIGET Jean, de Pontarlier (Doubs), vers 1663, docteurs ès droits, chanoine de Saint-Jean de Besançon, prieur de Jussey et de La Loye, membre de la confrérie en 1650 à Rome où il devint chanoine de Sainte-Marie-Majeure et avocat consistorial à la cour de Rome. En 1652, il était assistant de la confrérie. Il travailla à la canonisation de saint François de Sales. Il fit un legs d'actions de sociétés immobilières au profit de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons, à charge d'une messe hebdomadaire.
· MILLET Noël, recteur de la confrérie en 1708
· MONNOT Pierre Étienne, né à Orchamps-Vennes (Doubs) le 11.08.1658, à Rome le 24.08.1733, inhumé dans le chur de l'église Saint-Claude (fils d'Étienne Monnot, de Noël-Cerneux (Doubs), sculpteur, reçu citoyen de Besançon (Doubs) le 07.09.1676, et d'Élisabeth Fleguerin, Bohémienne), sculpteur, recteur de la confrérie des Bourguignons de Franche-Comté à Rome en 1698-1699, 1704-1706, 1710-1711. Influencé par Domenico Guidi, il réalisa le tombeau du pape Innocent XI de 1697 à 1704, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, en s'inspirant de celui qu'Algardi avait sculpté pour le compte de Léon XI. Son oeuvre, qui s'épanouit d'Allemagne (Le Bain de Marbre à Cassel) et d'Angleterre (où il travailla pour le comte d'Exeter) à Rome, constitue un parfait exemple du baroque flamboyant. Monnot sculpta de nombreuses statues ayant la mythologie pour thème. Il n'hésita pas à reprendre certains personnages déjà traités par Pierre Puget et Le Bernin, notamment Apollon et Daphné, Persée. Son ensemble Andromède et le monstre marin (1700-1704) est conservé à New York au Metropolitan Museum of Art. On peut voir aussi à Saint-Jean de Latran ses Saint Paul et Saint Pierre, deux statues colossales, en marbre blanc, hautes de 4,25 m. et, à Poligny (Jura), cinq bas-reliefs. Le Louvre, les musées de Besançon et de Nancy conservent aussi des uvres de cet artiste. Pierre Étienne Monnot aurait été anobli par le pape Innocent XIII et portait des armoiries parlantes : une fasce accompagnée de deux étoiles en chef et d'un moineau en pointe. Voir Christiane Dotal, Pierre-Etienne Monnot (1657-1733) : l'itinéraire d'un sculpteur franc-comtois de Rome à Cassel, au XVIIIe siècle, catalogue d'exposition, musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier (juin-sept. 2001), juin 2001.
· MOREL François, recteur (député) de la confrérie en 1793
· OSANNE Claude, membre fondateur de la confrérie en 1650
· OTHENIN Henri, de Vesoul (Haute-Saône), chanoine du chapitre métropolitain de Besançon (Doubs), présent à Rome depuis 1639, membre fondateur de la confrérie en 1650, recteur de la confrérie en 1652
· PANIER Anatoile, secrétaire de la confrérie en 1672, recteur en 1677-1678
· PAQUET Jacques, trésorier de la confrérie en 1725-1726
· PERRIN Jean Baptiste, prêtre, recteur de la confrérie en 1749
· PERRON Anatoile, membre fondateur de la confrérie en 1650, sacristain en 1652
· PERROUX Claude Étienne, secrétaire de la confrérie en 1680
· POULANCHET Antoine, membre fondateur de la confrérie en 1650
· QUETOD Didier, argentier, membre fondateur de la confrérie en 1650, recteur de la confrérie en 1679-1680. Avec son épouse Antoinette Cornier, il offrit un calice et sa patène à l'église Saint-Claude en 1678.
· REDOUTEY Jacques Antoine, citoyen de Besançon, notaire apostolique, secrétaire de la confrérie en 1674
· RENAUD Hilaire, secrétaire de la confrérie en 1730, recteur en 1733-1734, secrétaire en 1735, recteur en 1739-1741, secrétaire en 1742, recteur en 1750-1753, 1763-1764, secrétaire en 1771
· REUD Claude Antoine, le 08.11.1683, originaire de Besançon (Doubs), membre fondateur de la confrérie en 1650, chanoine du chapitre métropolitain de Besançon depuis 1667
· RICHARD Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650, secrétaire de la confrérie en 1652
· ROLLET Philippe, recteur de la confrérie en 1717
· ROUGET Christophe, membre fondateur de la confrérie en 1650
· ROY Noël, recteur de la confrérie en 1734, 1743-1744
· SAILLARD Étienne, secrétaire de la confrérie en 1670-1671
· SALINS (de) Jean Baptiste, membre fondateur de la confrérie en 1650
· SCEY (SCEY-MONTBÉLIARD) (de) Antoine Sébastien, membre de la confrérie depuis 1678
· SILVAN François, de Dole (Jura), trésorier de la confrérie en 1765-1766, recteur en 1768
· SIMONNOT Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650
· SIRE Étienne (Il signore Stefano Siliri della Borgogna della Contea), né dans la région de Gray (Haute-Saône) vers 1693, le 28.03.1663 (fils de Jean Sire), membre fondateur de la confrérie en 1650. Il en fut trésorier en 1652, et recteur en 1653, 1660-1661. Par son testament, reçu par le notaire Abenantes, le 14.01.1663 (conservé à la fin du 19e siècle dans les minutes du notaire Pomponi), il demanda à être inhumé dans l'église San Lorenzo in Lucina (ce qui fut fait) et légua à Saint-Claude des Bourguignons 6000 écus (l'écu romain valant 5 francs 37 centimes), dont 1000 pour achever le maître-autel de l'église et 500 pour acheter six chandeliers et une croix à placer sur ledit autel. Il offrit aussi quatre dots de vingt écus chacune, plus cinq écus pour le trousseau, à des jeunes filles pauvres, nées en Franche-Comté ou issues de parents appartenant à cette province. Il épousa Maddalena Tavanetti (probablement Madeleine Thevenet, née à Rome d'un père originaire de Franche-Comté), le 21.03.1688.
· SIRGUEY Jean Baptiste, recteur de la confrérie en 1682-1683
· THIÉBAUD Claude, recteur de la confrérie en 1709
· TISSERAND Claude, membre fondateur de la confrérie en 1650
· TISSERAND Simon, membre fondateur de la confrérie en 1650
· VARÉCHON François, recteur de la confrérie en 1696-1697, secrétaire en 1705-1706, 1712-1716
· VARÉCHON Jean-Baptiste, secrétaire de la confrérie en 1733
· VERMOT Poncet, recteur de la confrérie en 1687-1688, 1697-1698, 1700-1701, 1705-1707
· VILLAIN Claude, membre fondateur de la confrérie en 1650
· VILLAIN Pierre, membre fondateur de la confrérie en 1650, visiteur des pauvres en 1652
· VOISSART Thiébaud, vers 1672, docteur ès droits, attaché à la cour de Rome, recteur de la confrérie en 1659 et 1662, 1664. Il fit un legs au profit de celle-ci en 1672.
· VUILLIN Pierre François, de Baume-les-Dames (Doubs), second chapelain et confesseur de la confrérie dès 1678. Son salaire fut fixé à trois écus de monnaie romaine par mois. Il bénéficiait aussi d'un logement de deux chambres situées au-dessus de l'église.
· VUITENEY Jean-Ange, trésorier de la confrérie en 1719, prieur en 1723-1724
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Archives du ministère des Affaires étrangères, Mémoires et Documents, Rome (111 et 113).
Jean Gaume, Les trois Rome. Journal d'un voyage en Italie , Rome, 1856, p. 256.
Eugène Muntz, "Artistes employés à Saint-Louis des Français", in Nouvelles Archives de l'Art français, 1876, p. 380.
Louis Suchaux, Galerie héraldo-nobiliaire de la Franche-Comté, Paris, Honoré Champion, 1878, 372 et 400 p.
Auguste Castan, "La confrérie, l'église et l'hôpital de Saint-Claude des Bourguignons de la Franche-Comté à Rome - Notice historique suivie de documents", Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs, 1880, Besançon, 1881, p. 175-266.
Chanoine René Flusin, "Un sculpteur franc-comtois à Rome : Pierre-Étienne Monnot (1656-1733)", P.V. et Mémoires de l'Académie de Besançon, 1956, p. 331-343.
Jean-Marie Thiébaud, Les Cogouverneurs de la Cité impériale de Besançon.
Pierre R. Sonnet (sous la direction de), Dictionnaire biographique de la Haute-Saône, SALSA, 2005, 2 vol., 863 p.
Jean Ignace Froissard de Broissia (1627-1694) Membre fondateur et recteur de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons à Rome
Membre fondateur et recteur de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons à Rome
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Né à Dole (Jura) le 15.05.1627, à Besançon (Doubs) le 19.05.1694, Jean Ignace Froissard de Broissia, était fils de Jean Simon Froissard, né à Saint-Oyand (Saint-Claude) (Jura) le 15.05.1586, à Dole (Jura) le 31.12.1670, créé chevalier par Philippe, roi d'Espagne, en vertu de lettres patentes datées de Madrid (24.03.1629), seigneur de Broissia, Montagna, Molamboz, Châtenois et autres lieux, maître des requêtes au Parlement de Dole, et de Bonaventure du Moulin ( en 1646), mariés le 24 juin 1614. Son frère, Jean Froissard de Broissia, conseiller maître des requêtes au Parlement de Dole, obtint l'érection en marquisat de ses terres de Châtenois (Jura), Bellecin (commune actuelle du Bourget, Jura), Fontenelle (commune actuelle de Fontenelle-Montby, Doubs), Molamboz (Jura), Maisod (Jura), Rantechaux (Doubs) et dépendances, par lettres patentes de 1697 (Bibliothèque municipale de Besançon, collection Boisot, ms 1203 ; Archives départementales du Doubs, n° B - Chambre des Comptes - 651, fol. 119, 120 v° et suivantes : dénombrement de ce marquisat).
Prieur de Vaux-sur-Poligny (Jura) dès 1650, Jean Ignace Froissard de Broissia se rendit à Rome la même année pour étudier chez les jésuites et devint aussitôt membre fondateur de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons de Franche-Comté (fondée dans la Ville éternelle le 29 août 1650). Reçu docteur en théologie, il revint à plusieurs reprises en Franche-Comté et cumula les prébendes ecclésiastiques devenant aussi prieur de Fay (Fay-en-Montagne, Jura) et Laval (Doubs)1 et chanoine de l'église métropolitaine de Besançon. En 1660, il soutint avec succès une thèse de doctorat en droit. Trois ans plus tard, il était recteur de la confrérie de Saint-Claude des Bourguignons à Rome.
En 1666, il fut nommé abbé commendataire de l'abbaye cistercienne de Cherlieu (Montigny-les-Cherlieu, Haute-Saône) et le demeurera jusqu'à sa mort. Au retour d'un de ses nombreux voyages à Rome, il reçut la charge de grand chantre de la cathédrale de Besançon. C'est en qualité d'abbé commendataire de Cherlieu qu'il se rendit en 1680 auprès du pape Innocent XI, pour défendre quelques intérêts de cet établissement. Ayant pleinement réussi sa mission, le Souverain Pontife le mit au nombre de ses camériers.
À la date du mardi 6 novembre 1674, après la seconde conquête de la Franche-Comté par les troupes de Louis XIV, on peut lire dans les registres des délibérations municipales de Besançon : "M. de Broissia, abbé de Cherlieu et grand-chantre de l'insigne chapitre [métropolitain de Besançon], ayant visité M. le Président pour faire compliment à Messieurs et à leur faire sçavoir qu'il s'en va à Rome où il leur a offert ses services, Messieurs ont commis le sieur avocat fiscal pour l'en aller remercier et luy souhaitter bon voyage."
Par son testament du 10.03.1689, l'abbé Jean Ignace Froissard de Broissia "donna une partie de ses biens pour servir à la fondation, dans la ville de Dole [dans son hôtel de la rue des Chevannes], d'un séminaire ou collège semblable au collège Salviati, à Rome, dans lequel seraient élevés dix-huit jeunes petits garçons orphelins de père et de mère, nés en légitime mariage et baptisés au comté de Bourgogne". Plus tard, un de ses parents enrichit la fondation de sept bourses supplémentaires.
Son portrait, dans un cadre ovale est conservé au château de Bersaillin (Jura) et a été inscrit monument historique en 1981.
Charles Froissard de Broissia, neveu de Jean Ignace Froissard de Broissia, sera jésuite missionnaire en Chine. Il mourra près de Pékin le 18.10.1704 après avoir fondé six nouveaux postes catholiques.
Armoiries : d'azur au cerf passant d'or.
1 Il succédait à son oncle, Claude François Froissard, conseiller au Parlement de Dole, chanoine de l'église métropolitaine de Besançon, prieur de Laval depuis 1602.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La Présence française au Japon Index des noms de lieux japonais
Quelques mots japonais peuvent aider à comprendre l'étymologie des toponymes : gawa (rivière), hama (plage), hashi (pont), higashi (est), iwa (rocher), jima, shima (île), juku (étape), kawa (rivière), kami (dieu, grand esprit), kita (nord), matsu (bois de pin), mizu (eau), moto (proche), mura (village), naka (centre, milieu), nishi (ouest), oka (colline), saki (cap, promontoire), shi (ville), shu (territoire), tô (capitale, qu'on retrouve dans Kyotô et Tôkyô), tsu (port), ue (dessus, haut), yama (montagne), yashi (forêt), etc.
Le Japon comprend 47 préfectures. Les préfectures (-ken) sont divisées en arrondissements (-ku), villes (-shi) et districts (-gun).
Les dates données ne correspondent pas à la fondation mais au jour où une localité a acquis le statut de ville.
Abazu (quartier de Tôkyô) 401
Abeno (cimetière chrétien d'Ôsaka) 271, 369, 391, 407
Ajawi-Kôbe (île) : v. Sumoto
Ajimu (couvent de cisterciennes à Ôita-ken, préfecture d'Onsen, île de Kyûshû) 143
Akaogi (île d'Amami-Oshima, préfecture de Kagoshima) 204, 282
Akitsu (paroisse de Tôkyô) 193, 296, 334
Amagasaki (faubourg d'Ôsaka) 186, 242, 343, 345
Amakusa (île de la côte ouest de Kyûshû) 182, 252, 260, 424
Amakusa Akitsu 205
Amami-Ôshima (une des îles Ryûkyû, d'une superficie de 715 km² dans la préfecture de Kagoshima, à environ 300 km au nord d'Okinawa) 200, 260, 282
Aoyama (cimetière pour étrangers et quartier de Tôkyô) 40, 156, 174, 186, 196, 249, 353, 275, 393, 401, 405, 419
Aoyama Gakuin (Université fondée à Tôkyô en 1949) 355
Arai-machi (département de Shizuoka) 40
Arakami 286
Arima 128, 131
Asago (district de la préfecture de Hyôgo, ce district ayant disparu lors de la création de la nouvelle ville d'Asago le 1er avril 2005) 33
Asago (ville qui a fusionné avec Ikuno, Santo et Wadayama, le 1er avril 2005, pour former la nouvelle ville d'Asago) 33
Asahikawa (ville de l'île Hokkaïdo) 366, 389
Atami (district de Shizuoka) 394
Awaji 401
Awaji-Kôbe 276
Awaji-Uchi-Machi (paroisse du centre d'Ôsaka) 402
Azabu (paroisse de Tôkyô) 236
Beppu (baie de l'île Kyûshû) 142
Biwa (lac), Biwako (le plus grand lac d'eau douce du Japon, au centre de la préfecture de Shiga) 113
Biwasaki (léproserie) 195, 228, 229, 355
Bungo (ancienne province à l'est de Kyûshû et actuellement dans la préfecture d'Ôyta) 128, 131
Bunkyo-ku (quartier de Tôkyô) 221, 256, 364
Chichabu 228
Chikugo (ancienne province de l'île de Kyûshû, au sud de l'actuelle préfecture de Fukuoka) 26
Chinase (île Amami-Oshima, préfecture de Kagoshima) 229
Chiyoda (un des 23 arrondissements du centre de Tôkyô) 88, 122, 179, 337, 373, 412
Dejima (île artificielle dans la baie de Nagasaki) 147
Edo (ou Yedo, ancien nom de Tôkyô) 18, 27, 49, 130, 132, 249, 268, 274, 278, 308, 454
Fuchu (région de Tama, près de Tôkyô) 192, 211, 216
Fujieda (ville fondée le 31 mars 1954 dans la préfecture de Shizuoka) 171, 174, 243, 291, 304, 305
Fujimi-cho alias Fujimicho (colline de Tôkyô) 49, 183
Fujisan : v. Fuji Yama
Fuji Yama (Fujisan pour les Japonais) (stratovolcan, point culminant du Japon à 3776 m dans l'île de Honshû) 86, 288
Fukuoka (chef-lieu de préfecture à la pointe nord de l'île de Kyûshû) 26, 96, 97, 113, 140, 153, 170, 173, 181, 183, 189, 190, 194, 196, 197, 200, 205, 221, 225, 229, 236, 237, 244, 248, 251, 267, 271, 278, 287, 292, 295, 301, 314, 315, 331, 333, 346, 356, 368, 370, 380, 382, 385, 394, 397, 399, 401, 446
Ginza (quartier construit en 1612 sur une ancienne zone marécageuse, aujourd'hui zone commerçante de luxe à Tôkyô) 31, 86, 88, 101, 102, 191, 197, 350, 357
Gotô (îles), archipel de 140 îles (dont cinq principales) dans la préfecture de Nagasaki 200, 252, 265, 286, 300, 314, 330
Guma 145
Hachinohe (ville du sud-est de la préfecture d'Aomori) 190
Hachiôji (ville à 40 km à l'ouest de Tôkyô) 248
Hadogaya 288
Hakodate (seconde ville de l'île de Hokkaidô, derrière Sapporo) 25, 26, 27, 36, 38, 50, 141, 142, 143, 165, 166, 169, 171, 174, 183, 186, 190, 191, 192, 205, 216, 217, 218, 219, 229, 225, 227, 228, 231, 233, 236, 237, 246, 253, 261, 268, 276, 286, 290, 292, 294, 312, 315, 320, 329, 333, 336, 340, 341, 349, 360, 361, 367, 371, 376, 377, 379, 382, 400, 404, 410
Hakosaki (ville de la préfecture de Fukuoka dans l'île de Kyûshû) 286
Hamamatsu (ville à l'ouest de la préfecture de Fukuoka dans l'île de Kyûshû) 143, 164, 171, 174, 176, 179, 187, 234, 235, 258, 277, 283, 304, 371, 373
Hanamatsu 333
Haomori (montagnes) 142
Hayami-gun alias Hayamigun (ville de la préfecture d'Oita dans l'île de Kyûshû) 142
Heiankyo (ancien nom de la ville de Kyôto) 149
Higashi-Matsuyama (ville de la préfecture de Saitama dans l'île de Honshû) 193, 301
Higashiyamate (quartier de Nagasaki) 50
Hiiji (Hayami-gun, préfecture d'Oita dans l'île de Kyûshû) 142
Himeji (préfecture de Hyôgo) 220, 224, 297
Hirado (ville de la préfecture de Nagasaki, sur une île reliée à Kyûshû par un pont) 17, 195, 333
Hiroshima (chef-lieu de préfecture dans l'île de Honshû) 47, 140, 160, 214, 229, 357, 391
Hitoyoshi (ville fondée le 11 février 1942 dans la préfecture de Kumamoto) 197, 204
Hôki (ancienne province, préfecture actuelle de Tottori) 333
Hokkaidô (île du Nord) 27, 36, 38, 86, 141, 156, 160, 165, 186, 197, 207, 220, 238, 273, 284, 296, 299, 310, 312, 313, 331, 344, 361, 392, 406
Hokuni (village, préfecture de Kumamoto) 123
Hongo (paroisse de Tôkyô) 288
Honjo (Honju) 167, 174
Honshû (anciennement Hondo) (île la plus importante de l'archipel, 230 800 km². Elle abrite les villes de Tôkyô, Kyôto, Ôsaka) 26, 160
Ibaraki (chef-lieu de préfecture) 145
Iidamachi (quartier de Tôkyô) 49
Ikitsuki (île de la côte ouest de Kyûshû) 195, 333
Ikuno (ville du district d'Asago, dans la préfecture de Hyôgo. Elle a fusionné avec la ville d'Asago) 29, 33, 54, 165, 199, 224, 272, 285, 315, 330, 344, 355, 362, 366, 382, 390, 391, 397
Imajuku (préfecture de Fukuoka) 399
Imamura (paroisse du diocèse de Fukuoka) 197, 387
Ise (ville au sud-est de la préfecture de Mie) 84, 379
Isogo (paroisse de Yokohama) 196, 234
Ito (paroisse de la presqu'île d'Izu) 277, 393, 394
Iwata (paroisse) 176, 179
Izu (péninsule au sud-ouest de Tôkyô, sur l'océan Pacifique, dans le parc de Fuji-Hakone-Izu) 27, 277
Jonai 373
Jootsi-Sima alias Jootsissima (île) 19, 20
Kagamigahara (ville de la préfecture de Gifu ken, dans l'île de Honshû) 40
Kagoshima (chef-lieu de préfecture au sud-ouest de l'île de Kyûshû) 9, 13, 17, 42, 127, 140, 204, 214, 234, 268, 308, 354, 383
Kakegawa (ville de la préfecture de Shizuoka) 305, 387
Kamaishi (ville de la préfecture de Yamaguchi dans l'île de Honshû) 377
Kamakura (ville sur le Pacifique dans la préfecture de Kanagawa, à 50 km au sud-ouest de Tôkyô) 116, 205, 229, 233, 263, 274, 288, 315, 321
Kambara (village sur le flanc nord du volcan actif de l'Asama) 179
Kamikosaki (village de la préfecture de Nagasaki, près de Hirado) 333
Kanazawa (chef-lieu de la préfecture d'Ishikawa) 213, 216, 283
Kanda (quartier de Tôkyô) 111, 221, 274, 290, 361
Karuizawa (préfecture de Nagano) 95, 291, 337
Katase (localité près de Kamakura) 306, 321
Kawago (alias Kawagoe) 187, 301
Kawaguchi (ville fondée le 1er avril 1933 à Saitama) 187, 242, 370
Kawasaki (ville fondée le 1er juillet 1924 dans la préfecture de Kanagawa) 258
Kesenmura 216
Kikuna (Yokohama) 270
Kishiwada (ville de la banlieue d'Ôsaka) 216
Kitakyûshû ("Nord Kyûshû", seconde ville de l'île de Kyûshû après Fukuoka) 165, 167, 182, 183, 189, 190, 247, 248, 292, 338, 343, 370
Kitano 271
Kiyose (ville fondée le 1er octobre 1970 dans la préfecture de Tôkyô) 192, 261
Kôbe (ville au centre de l'île de Honshû) 35, 41, 42, 45, 70, 83, 84, 99, 101, 108, 109, 167, 172, 180, 187, 191, 192, 214, 216, 217, 228, 232, 236, 242, 249, 256, 276, 277, 284, 297, 298, 303, 322, 329, 336, 344, 345, 346, 349, 354, 358, 360, 375, 380, 385, 389, 391, 393, 395, 401, 403
Kochi (chef-lieu de préfecture, au sud de l'île de Shikoku) 400
Koenji (localité à l'ouest de Nakano) 334
Kôfu (ville principale de la préfecture de Yamanashi dans l'île de Honshû) 190, 210, 238
Kojimachi (quartier de Tôkyô) 350
Kokura (ville de l'île de Kyûshû) 173, 178, 183, 189, 236, 286
Kôri (ville de la préfecture d'Okayama) 180
Kosai (ville de la préfecture de Shizuoka dans l'île de Honshû) 48
Kotakyûshû (ville de l'île de Kyûshû) 333
Kôyama Gotemba (ville de la préfecture de Shizuoka, sur le versant sud-est du mont Fuji) 166, 189, 190, 234, 296, 368, 396, 412
Kukora 346
Kumamoto (préfecture, île Kyûshû) 123, 189, 204, 228, 259, 355
Kumano (sanctuaire shintô dans la préfecture de Yamagata) 84, 89
Kuroaki (île Amami-Oshima, préfecture de Kagoshima)
Kurosaki 173, 183, 189, 195, 206, 236, 237, 370, 382
Kuroshima (île de la préfecture de Nagasaki) 205, 229, 330
Kurume (cimetière chrétien de Sago) 97, 204, 267, 315, 346, 371, 387, 394, 397
Kusanagi 196, 283, 304
Kyôto (chef-lieu de préfecture, ancienne capitale du Japon de 794 à 1603) 30, 47, 50, 65, 72, 84, 87, 88, 91, 95, 101, 103, 105, 109, 115, 119, 120, 140, 149, 150, 152, 153, 156, 164, 165, 166, 171, 172, 180, 182, 187, 191, 194, 196, 201, 211, 214, 222, 234, 236, 252, 253, 260, 269, 278, 279, 286, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 302, 318, 319, 322, 328, 335, 336, 346, 348, 351, 356, 365, 366, 372, 376, 378, 382, 384, 388, 411
Madarajima (ville de la préfecture de Saga, au nord-ouest de Kyûshû) 205
Maizuru (port de Kyôto) 214, 249, 330, 373
Makomanai : v. Mokomanai
Maria (hôpital) à Himeji 297
Matsue (ville à château de la préfecture de Shimane, sur la côte ouest de l'île de Honshu) 303, 402, 421
Matsushima (groupe d'îles de la préfecture de Miyagi) 189
Matsumoto (petite ville à château de la préfecture de Nagano) 174, 216, 223, 238, 274, 290, 380
Meguro-ku (quartier de Tôkyô) 296, 335, 404
Mikasa (ville de l'île de Hokkaidô) 270
Mikkabi (ville du district d'Inasa, préfecture de Shizuoka) 143
Mikatagahara (école militaire, localité fameuse à cause de la bataille du 6 janvier 1573 dans l'ancienne province de Totomi, aujourd'hui dans la préfecture de Shizuoka) 40
Mimasaka (ancienne province du Japon, dans le nord-est de l'actuelle préfecture d'Okayama) 27
Minato 57
Minato-ku (quartier de Tôkyô) 65, 172, 363, 377, 385
Minoo (près d'Ôsaka) 156
Mishima (ville fondée le 29 avril 1941 dans la préfecture de Shizuoka) 187, 337
Miyagi (chef-lieu de préfecture, au nord-ouest de l'île de Honshû) 36
Miyako ("ville de l'océan", sur la côte orientale de la principale île du Japon) 38, 143
Miyakonoko (village de la préfecture de Miyazaki) 43
Miyamae 410
Miyamaechô (ville de la préfecture de Hyôgo) 371
Miyazaki (chef-lieu de préfecture dans l'île de Kyûshû) 43, 140
Miyazu (ville de la préfecture de Kyôto, sur la mer du Japon) 373
Mizumaki (alias Mizuma-ki) 183, 189, 271, 301
Moji (port), appelé aussi Mojikô (dans le nord de Kyûshû) 138, 183, 190, 271, 301, 399
Mojikô : v. Moji
Mokomanai alias Makomanai (Sapporo, île de Hokkaidô) 343
Montana 210
Morioka (ville de la préfecture d'Iwate) 199, 228, 404
Motomachi (paroisse de Hakodate) 261, 276, 320, 410
Nabo (cap) 20
Nachi (sanctuaire dans la péninsule de Kii) 84
Nada (Kôbe) 180, 336
Nagano (chef-lieu de préfecture, dans l'île de Honshu) 160, 161, 163, 165, 166, 167, 173, 175, 179, 187, 193, 196, 200, 204, 205, 208, 211, 214, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 232, 234, 241, 243, 253, 254, 265, 280, 281, 282, 285, 287, 288, 289, 291, 308, 310, 312, 322, 325, 329, 332, 339, 341, 342, 349, 353, 357, 359, 362, 363, 365, 373, 378, 383, 384, 385, 386, 389, 391, 394, 403, 407, 408
Nagano-ken 144
Nagasaki (chef-lieu de préfecture dans l'île de Kyûshû) 16, 17, 25, 26, 29, 30, 50, 53, 61, 128, 130, 132, 133, 134, 140, 147, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 214, 215, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 239, 247, 252, 253, 256, 259, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 283, 286, 289, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 319, 321, 322, 325, 326, 329, 330, 331, 335, 337, 338, 339, 341, 351, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371, 372, 376, 381, 382, 383, 386, 387, 391, 393, 395, 397, 398, 402, 406, 412
Naha (port, principale ville de la préfecture d'Okinawa) 22, 23, 25, 132, 140, 164, 264, 268, 269, 279, 297
Nakahara (paroisse de Kawasaki) 258
Nakatsu (ville au nord de la préfecture d'Ôita) 204, 219
Nakayamate alias Nakaya-Mate (Kôbe) 252, 256, 276, 345, 380, 388
Nara (anciennement Heijo, première capitale du Japon dès 710) 83
Nariki 164
Nasu (ville de la préfecture de Tochigi dans l'île de Honshû) 87, 143, 261, 385
Naze (localité de l'île d'Okinawa) 383
Nemuro (détroit) 156, 222
Nihonbashi (quartier de Tôkyô) 31, 357
Ni-i-Gata alias Niigata (chef-lieu de préfecture, la plus grande ville de la côte de la mer du Japon) 31, 357
Niphon (île) 18, 20
Nishinomiya (ville de la préfecture de Hyôgo, dans la région du Kansai) 143, 202, 216
Noto (cap dans la préfecture d'Ishikawa) 19, 20
Numazu (ville à l'est de la préfecture de Shizuoka, à l'extrémité de la péninsule d'Izu) 164, 196, 393, 394
Oe (localité de l'île d'Amakusa) 31, 182
Ogawamachi Kanda (Tôkyô) 174
Oita (port, chef-lieu de préfecture dans l'île de Kyûshû) 140, 142, 204
Okinawa (archipel des îles Ryûkyû, principale base américaine de la zone Asie-Pacifique) 17, 18, 21, 22, 23, 95, 159, 180, 215, 264, 269, 297
Ôse (village) 11
Ôtsu (chef-lieu de la préfecture de Shiga, dans l'île de Honshû) 338
Oura (quartier de Nagasaki) 50, 53, 140, 175, 225, 230, 290, 386, 402
Oye (localité de l'île d'Amakusa, à confondre avec Oe, citée plus haut ?) 260, 270
Ramashima 284
Ryûkyû alias Ryû-Kyû (archipel d'une soixantaine d'îles, entre Kyûshû et Taiwan) 18, 21, 22, 23, 25, 58, 159, 164, 180, 215, 263, 268, 274, 279, 281, 297, 318, 336, 386
Sado (île de la mer du Japon dans la préfecture de Niigata) 174, 265, 349
Saga (chef-lieu de préfecture au nord-ouest de l'île de Kyûshû) 204
Sage-ken 143
Saginomiya (paroisse de Hamamatsu) 258, 304
Saitama (chef-lieu de préfecture au centre du Kantô) 140, 141, 322
Saitano 370
Sakai (port de la préfecture d'Ôsaka) 35, 42, 184, 193, 216, 322, 369, 383, 403
Sakamoto (cimetière des étrangers à Nagasaki) 173, 175, 176, 193, 196, 201, 206, 208, 220, 230, 289, 363, 386, 402
Sakitsu (localité de l'île d'Amakusa) 182, 282
Sakosi 260
Saltama 145
Sambogi 190
Samenura (baie dans la préfecture de Miyagi) 36
Sanda (préfecture de Hyôgo) 232, 297, 345
Sapporo (capitale régionale de l'île de Hokkaidô) 101, 113, 141, 153, 154, 160, 161, 192, 235, 276, 302, 302, 315, 320, 359, 360, 369, 371, 393, 478
Sedome 204
Sekigahara (site d'une célèbre bataille qui s'est déroulée les 20 et 21 octobre 1600, actuellement ville de la préfecture de Gifu) 128
Sekiguchi (paroisse de Tôkyô) 166, 190, 240, 334, 358
Sekirube (localité de l'île d'Oshima) 199
Sendai (chef-lieu de la préfecture de Miyagi) 14, 16, 22, 141, 153, 154, 204, 214, 217, 235, 249, 254, 314, 341, 401
Shibuya-ku (quartier de Tôkyô) 88, 156, 202, 392
Shichirigahama (ville de la préfecture de Kanagawa, dans l'île de Honshû) 210, 233, 236, 277, 315
Shikoku (la plus petite des quatre principales îles de l'archipel japonais, au sud de Honshû et à l'est de Kyûshû) 57, 400
Shimada (ville de la préfecture de Shizuoka) 187, 258, 316
Shimizu (ville du district de Suntô, préfecture de Shizuoka) 114, 196, 258, 291, 304, 305, 373
Shimoda (ville et port à l'extrémité sud de la péninsule d'Izu dans la préfecture de Shizuoka) 25, 26, 27, 28
Shimonoseki (ville de la préfecture de Yamagushi à la pointe sud de l'île de Honshû) 26, 27, 72, 74, 133, 249, 284, 293
Shimoyamate 186, 249, 276, 336, 395, 398, 401
Shinagawa-ku (quartier de Tôkyô) 196, 354
Shindenbaru (localité de la préfecture de Fukuoka) 178, 189, 194, 303
Shinkoyasu (localité de la préfecture de Kanagawa) 228
Shigonawa-ku (quartier de Tôkyô) 335
Shitsu (village jumelé avec Sotome, district de Nishisonogi, préfecture de Nagasaki) 205, 382
Shizuoka (chef-lieu de préfecture dans la région de Shubû, île de Honshû)
Shizuoka (Otemachi) 27, 48, 164, 174, 176, 179, 192, 223, 237, 238, 259, 270, 283, 288, 296, 314, 337, 347, 350, 393, 394
Shukugawa (cimetière de Nishinomiya) 180, 202, 220, 277, 388
Shuri (ancienne capitale de l'île d'Okinawa) 23
Sizuroka (Yawata) 371
Sotome (village jumelé avec Shitsu, district de Nishisonogi, préfecture de Nagasaki) 382
Sumida, rivière de Tôkyô 210, 362
Sumiyoshi (quartier d'Ôsaka et temple shintô) 186, 192
Sumoto (localité de l'île d'Ajawi-Kôbe) 276
Surugadaira (localité de la préfecture de Shizuoka) 86, 208
Susono (ville de la préfecture de Shizuoka) 179
Suzurandai (paroisse catholique de Kôbe) 186
Tabata 382
Tabira (localité de l'île d'Oku) 333
Tagawa (ville fondée le 3 novembre 1943 dans la préfecture de Fukuoka) 301
Takatori (ville de la province de Nara, région du Kansai) 366
Takatsuki (ville de la préfecture d'Ôsaka) 91
Tamatsukuri (ville du district de Namegata, préfecture d'Ibaraki) 330, 345, 400, 401
Tanabe (banlieue d'Ôsaka) 180
Tarumi (quartier de Kôbe) 187, 232, 276, 380, 395
Tenjin (quartier de Fukuoka) 370
Tenjinmachi (Yahata) 173, 301
Tobata (quartier et paroisse de Kitakyûshû) 178, 181, 183, 189, 247, 292
Tobetsu (ville de l'île de Hokkaidô) 141, 142, 167, 190, 197, 207, 220, 228, 238, 273, 284, 299, 310, 312, 313, 331, 344, 361, 392, 406
Tochigi (chef-lieu de préfecture du Kantô, dans l'île de Honshû) 26, 143, 145, 262
Tokorozawa (ville de la préfecture de Saitama) 40, 43, 296
Tokuden (paroisse) 296, 324
Tokunoshima (île du sud-ouest du pays) 200
Tôkyô (Edo, capitale du Japon sous le nom de Tôkyô depuis 1868) 25, 27, 29, 32, 33, 38, 40-43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 65, 67, 76-78, 81-85, 88, 89, 91, 92, 95-97, 99-105, 109-111, 113, 114, 116, 117, 119, 121-123, 125, 126, 135, 136, 140, 145, 147, 148, 150, 151-153, 155, 156, 158, 160, 161-194, 196-218, 220-251, 253-415, 417-420
Toma-Koumaï (île) 236
Tomari (Pot-Tsoung en chinois, village près de Naha) 22, 269
Tomioka (célèbre filature, ville depuis le 1er avril 1888 dans la préfecture de Gunma) 30, 178, 182, 201, 207, 217, 219-221, 317, 326, 341, 368, 403, 406
Tosa (ville de la province du même nom, connue actuellement sous le nom de préfecture de Kôchi) 35, 57
Toshima (une des 23 municipalités de Tôkyô) 234, 328, 408
Totsuka (quartier de Yokohama) 218
Tottori (ville depuis le 1er octobre 1889, chef-lieu de préfecture dans la région du Chûgoku) 234, 400
Toyoma (partie de la ville de Tome, dans la préfecture de Miyagi, au nord-ouest de l'île de Honshû) 39, 201
Tsu (ville anciennement fortifiée sur la baie d'Ise, chef-lieu de la préfecture de Mie) 164, 242
Tsugaru (ville fondée le 11 février 2005 par la fusion de la ville de Kizukuri et des villages d'Inagaki, Kashiwa, Morita et Shariki, dans la préfecture d'Aomori) 36
Tsukiji (paroisse de Tôkyô) 234, 328, 408
Tsukisamu (quartier de Sapporo) 371
Tsukuba (ville de la préfecture d'Ibaraki dans le Kantô) 267, 355, 407
Tsukyo 190
Tsurugaya (localité du Sendai) 217
Tsushima (île située aux abords du détroit du même nom, dans la préfecture de Nagasaki dont elle est la plus grande île) 27
Tsuwano (ville du district de Kanoashi, préfecture de Shimane) 35
Tusu (province d'Ise) 379
Ueda (ville de la préfecture de Nagano) 243, 368, 375, 393
Urakami (banlieue de Nagasaki) 133, 134, 140, 225, 231, 237, 265, 358, 365, 386, 397, 398
Urawa (ville au nord-ouest de Tôkyô) 141, 145, 186, 197, 200, 228, 296, 301, 376, 409
Usuki (ville de la préfecture d'Ôita) 219
Utsunomiya (ville fondée le 1er avril 1896, chef-lieu de la préfecture de Tochigi) 325
Uwajima (ville de la préfecture d'Ehime) 192
Wakabacho (paroisse de Yokohama) 174, 216, 256, 333
Wakamatsu (une des cinq villes réunies en 1963 pour former la conurbation de Kitakyûshû) 190, 236, 298
Wakayama (préfecture située dans la péninsule de Kii, région de Kinki, île de Honshû) 182, 188, 267, 271
Waseda (Université de Tôkyô) 214n 350, 408
Yahata (une des cinq villes réunies en 1963 pour former la conurbation de Kitakyûshû) 181, 196, 205, 248, 271, 301
Yahata-tenijin-machi 194
Yaizu (ville fondée le 1er mars 1951 dans la préfecture de Shizuoka) 164, 258, 394
Yakumo (Hokkaidô) 261, 276, 296, 372
Yasuoka (village du canton de Shimoina, île de Honshu) 144
Yatsu (ville de la préfecture de Shizuoka) 237, 387
Yawata (ville de la préfecture de Kyôto) 167, 197, 219, 371, 382
Yedo : v. Edo
Yeso (île rebaptisée Hokkaidô après la guerre de Boshin) 28
Yokohama (ville portuaire, 2e ville du Japon, chef-lieu de la préfecture de Kanagawa) 26, 29-31, 36, 41, 47, 49, 50, 64, 69, 74, 76, 77, 85, 88, 91, 102, 108, 116, 118, 132-135, 141, 143-145, 147, 151-153, 156, 166, 169, 171, 174, 176-179, 181, 186, 187, 189, 191, 195-197, 199, 202, 207, 210, 214, 216, 218, 219, 221, 225, 227, 228, 231, 234-236, 239, 241, 243, 244, 251, 253, 255, 256, 258, 262, 268, 270-272, 274-276, 279, 281, 285, 291, 299-301, 303, 305, 306-309, 312-314, 316, 317, 319, 322, 326, 328, 333, 336, 337, 339, 349, 353, 357, 359, 360, 361, 365, 367, 368, 370-373, 375-377, 379, 382, 384, 386, 387, 389, 393, 407, 411, 312, 416
Yokosuka (ville située dans la péninsule de Miurua, préfecture de Kanagawa) 29, 30, 33, 42, 168, 178, 188, 211, 227, 241, 248, 251, 255, 258, 262, 266, 270, 272, 273, 277, 280, 283, 291, 294, 299, 309, 312, 315, 320, 327, 329, 331, 334, 336, 338, 342, 364, 368, 369, 376, 387, 397, 399, 401, 405, 412
Yoshida 179, 187
Yoshiwara (quartier commerçant de Tôkyô, ancien quartier chaud d'Edo) 196, 387
Yufu (mont) 142
Yunokawa (paroisse de Hakodate) 286, 315, 360, 371
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La Présence française au Japon Errata et compléments
p. 118 : le directeur actuel de la Maison de la Culture du Japon à Paris est Masateru Nakagawa. Il a succédé à Isômura Hisanori en 2005.
p. 128 : lire Toyotomi Hideyoshi au lieu de Toyomoti Hideyoshi
p. 239 : lire Bin Kimura au lieu de Bin Kimuta
p. 244 : lire Yosano Akiko au lieu de Yosano Akido
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La Présence française au Japon Index des patronymes japonais
Patronymes japonais - Index
Abe H., major, pilote 47
Akihito, né en 1933, empereur du Japon depuis 1989 160
Akiko Yosano (1878-1942), poète 244
Amakusa Shiro, ronin (17e siècle) 131
Anesaki Masaharu (1873-1949), professeur de l'Université impériale de Tôkyô 319
Asahara Shoko, né en 1955, gourou de la secte "Arche la Vérité" 299
Asahi Yoshihide, prêtre en chef du sanctuaire Kumano Nachi 84
Asai, médecin de la cour impériale en 1926 117
Chivija Michel 128
Date Masamune (1567-1636), daimyô du Sendai 14
Fukuda Hachinosuke (1797-1879) 157, 162
Hachisuka Mochiaki (1846-1918), marquis 188
Hachisuka Narihiro, marquis 188
Hara Martin 128
Hasegawa Kiyoshi, peintre 64, 244
Hasekura Rokuemon Tsunenaga (1571-1622) 14, 16, 23
Hasekura Tsunenari, samouraï 13
Hata, docteur en médecine, membre de l'Académie impériale en 1926 117
Hata, jardinier 58
Hayashi, professeur de médecine en 1926 117
Hidenobu Takahide (1929-2002), maire de Yokohama 152, 156
Hidetoshi Murakami (1811-1890), médecin, auteur du premier dictionnaire français-japonais 147
Hinata Yasushi 42
Hiraiwa Gaishi (1915-2007), président de Tokyo Electric Power Company 117
Hirose Saihei (1823-1914), directeur de la mine de cuivre de Besshi 306
Hiroshi Nakada, né en 1965 156
Hitachi, frère cadet de l'empereur 87
Hokusai Katsushika (1760-18.04.1849), peintre 63, 65, 67
Hoeumi Yatsuka, professeur de droit 32
Hanako, modèle de Rodin 65
Hasegawa Saeko, professeur au conservatoire et chef de chur 167
Ikunobe Yamane 64
Inabata Katsutaro (1862-1937), industriel, sénateur 45, 149
Inada, professeur de médecine en 1926 117, 123
Inajiro Taneka Tajiri (1850-1923), vicomte, maire de Tôkyô 43
Inoue Ihee 30
Inoue Tetsujira, professeur à l'Université impériale du Japon (fin 19e siècle) 136
Inouye Masashige 132
Inouye Tetsujiro 319
Isômura Hisanori, directeur de la Maison de la Culture du Japon à Paris jusqu'en 2005 (N.B. : son successeur est Masateru Nakagawa) 118
Itakura, docteur en médecine en 1926 117
Itô Mancia 128
Iwao Ôyama (1842-1916), général, ministre de l'Armée de terre 39, 42
Jun Aoki, né en 1956, architecte 102
Junii Hachisuka, ministre plénipotentiaire 39
Junzo Sakakura (1901-1969), architecte 150, 156
Kano Jigoro (1860-1935), créateur du judo 157
Kano Jirosaku Mareshiba, intendant naval du shogun Tokugawa 157
Kano Risei, président de la Fédération internationale de judo 157
Kashiwagi Takao, né en 1946, professeur d'université 82
Kawachi K., pilote 47
Keisai Eisen (1790-1848), peintre 63
Kimura Bin 239
Kitagawa Ichitaro : voir Utamaro
Kitasato Shibasaburo (1853-1931), professeur de médecine 116, 123
Kiyotake Shigeno, né en 1882, baron, officier d'aviation 47
Koboyashi K., scientifique 114
Koizumi Junichiro, né en 1942, Premier Ministre 335
Kojima Masajito, écrivain 152
Kondo Koichiro (1884-1962) 83
Koseki Kayoko, pianiste 239
Kotyo Baba, traducteur 82
Kuninomiya Asahiko, prince 150
Kuninomiya Igashi (S.A.I.), né en 1887 150
Kurosaki, senseï 160
Kurosawa Akira (1910-1998), réalisateur, producteur et scénariste de cinéma 209
Kuwabaara Takeo, employé à l'ambassade de France en 1938, traducteur 82
Maekawa Kunio (1905-1986), architecte 311
Masamitsu Ochiai 104
Masayoshi Ushibuko, président de Sanden Corporation Japan 107
Masuda Yoko, directrice du musée Niki à Nasu 87, 385
Matsudaira Hirodata (1526-1549), daimyô de Mikawa 22
Matsukata Kojiro (1865-1950), baron, banquier et industriel de Tôkyô 85
Matsukata Masayoshi (1835-1924), comte, Premier Ministre 85
Matsukura Shigeharu, 1638, daimyo 131
Matsumoto Akira, né en 1938, auteur de mangas 96, 97
Matsuoka, chef de demi-brigade pendant la guerre du Boshin 199
Meiji : voir Mutsuhito
Miki, chef de demi-brigade pendant la guerre du Boshin 199
Miki Fukusuke 45
Mikinosuke Kawaishi (1899-1969), professeur de judo 157
Misuzu Shobô 152
Miura, professeur de médecine 117
Miyamoto Masakiyo 152
Mizuno Tadamasa (1493-1543), samouraï 22
Mori Ôgai (1862-1922), médecin 35
Morikami Toyomatsu 201
Murata Yoshihiro 88
Muri Yoko, violoniste, fondatrice et directrice de l'Académie de musique française de Kyôto 87
Murota Jubi, traducteur 82
Mushanokôji Saneatsu (1885-1976), nouvelliste et dramaturge 152, 156
Mushanokôji Sanezane, 1887, vicomte 156
Mutsuhito, empereur (Meiji) (1852-1912) 31, 135, 150
Nagamine Hideki, traducteur 82
Nagayo, doyen de la faculté de médecine de Tôkyô en 1926 117
Nakae Chômin (de son vrai nom Nakae Tokusuke) (1847-1901), écrivain et penseur 82
Nakagawa Hisayasu, directeur général du Musée national de Kyôto 296
Nakura Julien 128
Nambu Yoshinao, né en 1943, créateur du karaté sankukai 160, 206
Naotake Sato (1882-1971), ambassadeur du Japon en France 117
Narinobu Kano (17e siècle), artiste 57
Nawa, colonel, médecin militaire en 1926 117
Nobusuke Kishi (01.11.1896-07.08.1987), Premier Ministre 83, 89
O Dai-no-kata 22
Okano Kiichiro, banquier 86, 208
Okawa, demi-chef de brigade pendant la guerre du Boshin 314
Okayama Hachiroji (1802-1862) 162
Okuda Benjiro 45
Ômura Sumitada (Don Bartolomeo après son baptême par les jésuites) (1533-1587), daimyo 128
Osaragi Jiro (1897-1973) 152
Oshima Tesui, supérieur du temple de Zozoji en 1935 319
Ounda, demi-chef de brigade pendant la guerre du Boshin 314
Ozaki Kihachi (1892-1974), écrivain 152
Sakakura Junzo (1901-1969), architecte 311
Sakura Tsuneshichi 30
Sakurai, ingénieur (fin 19e siècle) 188
Sasakawa Ryôichi (1899-1995) 155, 156
Sato, professeur de médecine 117
Satoru Ito, président de Renesas Technology Corp. 107
Sayako, princesse 118
Schiota, professeur de médecine 117
Seiichiro Yasui (1891-1962), gouverneur de la préfecture de Tôkyô 150
Shibusawa Eiichi (1840-1931), banquier et mécène 148
Shiga Nagoya 152
Shigehiko Hasumi 48
Shimazu Nariakira (1809-1858) 25, 27
Shimazu Narioki 27
Shimazu Takahisa (1514-1571), daimyo de Kagoshima 127
Shinogushi Ideki, cuisinier 89
Shintaro Tsihara, né en 1932, maire de Tôkyô 155, 156, 186
Shinzo Abe, Premier Ministre 53
Shiro Aihara, capitaine de vaisseau 40
Shûishi Katô, écrivain et critique 275
Sujiyama Naojiro (1873-1949), professeur de l'Université impériale de Tôkyô 319
Suzuki Kareishi, traducteur 82
Suzuki Junji 58, 65, 67
Suzuki Ryoji, architecte 49
Suzuki Tadeishi, traducteur 82
Suzuji Zenko (1911-2004), Premier Ministre 117
Taguchi Paul Yoshigoro, 1978, cardinal 214, 413
Tajima Toshikazu, président de Dior Couture au Japon 102
Takagi, pâtissier 108
Takahashi Takuji, cuisinier 89
Takakusu Junjirô (1866-1945), professeur à l'Université de Tôkyô 240, 319
Takamatsu (1905-1987), prince 150, 156
Takamura Kotaro (1883-1956), écrivain 152
Takanobu Fujiwara (1142-1205) 84
Takasugi, amiral en 1926 117
Takayama Toshihiko 152
Takemoto Tadao 89
Takôyama, maire de Kyôto 318
Taro Watanabe, président de Yoku Moku 107
Tasuku Tsukada, maire de Nagano 160
Tatsuhiko Shibusawa (de son vrai nom Tatsuo) (1928-1987), traducteur 82
Tatsumi Hajime, ingénieur de 1re classe (fin 19e siècle) 188
Tokato, industriel 108
Tokugawa 131, 132
Tokugawa Hidetada, shogun 22
Tokugawa Iemoshi (1846-1866) 28
Tokugawa Iemitsu (1604-1651) 130
Tokugawa Ieyasu (Matsudaira Tekechiyo) (1543-1616) 22, 128
Toyoda Eji 48
Toyoda Kiichiro (1894-1952), fondateur de la Toyota Motor Corporation 46, 48
Toyoda Sakichi (1867-1930) 48
Toyoda Yoshitoshi, président honoraire de Toyota Automatic Loom Works 154
Toyomi Hideyoshi 14
Toyotomi Hideyoshi 128
Tsuneji Uchida, président de Canin Inc. 107
Tsurumi Mitsuzo, professeur de médecine dans les années 1920 117, 123
Tyutaro Hashimoto 53
Uehara, général, chef d'état-major 41
Uehara Usaku (1856-1923), baron, premier maréchal de l'armée impériale japonaise 43
Uemura Shu 101
Utagawa Hiroshige (de son vrai nom Ando Tokutaro ou Ando Tokugero) (1797-1858), peintre 63, 65
Utamaro Kitagawa (1754-1806), peintre 63
Wakayama, ingénieur (fin 19e siècle) 188
Yamamoto Hatsujiro, homme d'affaires et collectionneur d'uvres d'art 85
Yamamoto Hôsui (1850-1906), illustrateur 59
Yamanuchi Toyoshige 35
Yasuhiro Nakasone, né en 1918, Premier Ministre 53
Yatabe Atsuhiko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en France 177
Yoshida Chushichi 30
Yoshihito (Taisho Tenno), empereur 41, 43
Yoshitoshi Tokugawa (1883-1963), capitaine 40
Yukawa Hideshi (1901-1987), auteur d'ouvrages scientifiques, prix Nobel de physique 149, 156
Zenji Ono 152
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La Présence française au Japon Table des patronymes français et francophones
Table des patronymes français et francophones
A
ABECASSIS, ABELES, ABITBOL, ACERBIS, ACHARD, ADAM (4), ADLER, ADNET, AGATA (d'), AGNES B, AICARDI, AINCIART, AKRICH, ALAIN, ALARD, ALAUZET, ALBEROLA, ALBERY, ALBUGUES, ALERTE, ALEXANDER, ALFERI, ALLARD, ALLEGRET, ALLENDER, ALLETON, ALMURO, ALSOT, AMADE, AMERIS, AMIEZ, AMZELEK, ANACHARSIS, ANCHEN, ANDRE (2), ANDREA, ANDREU, ANDRIEU, ANGELIS (de), ANGLADE, ANGLES (2), ANGOT, ANGUIS, ANISSINA, ANOGE, ANOUILH, ANQUETIL, ANQUEZ, ANTOINE, APERGHIS, APPATHURAI, APPERRY, APPERT, ARCIER, ARDENNE, ARDOUIN, ARMAND, ARMBRUSTER, ARNOUL, ARNOULD, ARRIVET, ARRON, ARSENE-HENRY, ARSON de SAINT-JOSEPH, ARTHUR H, ARTUS, ARVIN-BEROD, ASSAYAS, ASSERAY, ATLAN, AUBERT, AUBOUIN, AUBRON, AUBRUN, AUDAN (2), AUDIFFRET (d'), AUDREN, AUGER (2), AUGMARD, AURIENTIS, AUSTIN, AUSTRY, AUTRAND, AUVRAY, AVELINE, AVERDOINCT, AYMARD (2), AYROLLES, AZNAVOUR, AZOULAY (3)
B
BAALA, BABICZ, BADINTER, BAHEZRE de LANLAY, BAILLOT, BAILLOT de GUERVILLE, BAILLY-SALINS, BAJON, BAL, BALANCHE, BALARD, BALDAUFF, BALET (2), BALETTE, BALIBAR (2), BALLAND, BALMES (6), BALTHUS, BAPST, BAQUIE, BARBE (2), BARBER, BARBEROT, BARBIER, BARDOL, BARIOZ, BARMONT, BARON, BAROUH, BARRAL (2), BARRAS, BARRAULT, BARRE, BARRET-DUCROCQ, BARTABAS, BARTH, BARTELEMY, BARTHELET, BARTHES, BARRUCA, BASSET, BASSINO, BASSOT, BASTID, BASTIDE, BASTIEN (2), BATAILLE (2), BATTAGLIA, BATTEKE, BATTON, BAUBEROT, BAUDELOT, BAUDOT, BAUDRILLARD, BAUDRY, BAUDU, BAUMARD, BAUMGARTNER, BAVEREL-ROBERT, BAVET, BAYE, BAYEN, BAYZELON, BAZANTAY, BAZI
BEAL, BEAU, BEAUCE (de), BEAUCHESNE, BEAUGRAND (2), BEAUJOUR, BEAUREPAIRE, BEAUVOIR (de), BEAUVOIS, BEB DEUM, BEC, BEFFA, BEGUEUX, BEIGNET, BEILLEVAIRE, BEINEIX, BEJART, BELIARD (2), BELLABOUS, BELLANDO, BELLEN, BELLESSORT, BELLIARD (3), BELLION, BELMONT, BENBOUDAOUD, BENHAMOU, BENJAMIN, BENOÎT (3), BENSAÏD, BENYOWSKI, BERARD, BERCE, BERESTYCKI, BERET-MARTINEL, BERGASSE du PETIT-THOUARS, BERGER (2), BERGERET, BERGERON, BERGER-VACHON, BERGES, BERGIER, BERHAULT, BERKANE, BERLIOZ (2), BERMON, BERNADIS, BERNARD (4), BERNARDOT, BERNIER, BERNOLD, BERQUE, BERTHAUT, BERTHELOT, BERTHET (2), BERTHET-BONDET, BERTHON, BERTIN (3), BERTRAND (6), BERTRAND-PRADVIEL, BESIAT, BESIN, BEUVE, BEYSSADE, BEZIAUD
BIANCO, BIANNIC, BIARD, BIEUX, BIGINI, BIGOT (4), BILAL, BILJENGA, BILLAUT, BILLET (2), BILLIET, BILLING, BILLY (de), BIRKIN, BIRRAUX, BIZE, BIZEL
BLANC (2), BLANCHARD, BLANCHET, BLANCHOD, BLANLIL, BLANQUART, BLIN-AYSUSAWA, BLOC, BLOT, BLUM, BLUSSON
BOCKEL, BODIN, BODY, BOEHRER, BOELLE, BOHER, BOIDIN (2), BOILET, BOIS (2), BOISSONNADE de FONTARABIE, BOLATTRE, BOLI, BOMBLED, BON (2), BONALY, BONAUD, BONDY (de), BONHAMEAUX, BONICELLI, BONNAUD, BONNE, BONNEAU (2), BONNECAZE, BONNET (3), BONNETAIN, BONNEVILLE, BONNIN, BONPAIN, BONTEMPS, BORCHARD, BOREL, BORIE, BORRELLY, BOSLAK, BOSSI, BOST, BOUBAT, BOUCHITEY, BOUCHOT, BOUCHY, BOUCLY, BOUDERLIQUE, BOUDOU, BOUDRIAU, BOUFFIER (2), BOUGAREL, BOUGNOUX, BOUGON, BOUGOÜIN, BOUIGE, BOUILLEUX, BOUILLY-LEBEC, BOUISSOU, BOULANGER (2), BOULEZ, BOULIER, BOULOM, BOUQUET, BOUQUILLON, BOURELLE, BOURGAULT, BOURGEAT, BOURGEOIS (2), BOURGON, BOURGUE (2), BOURGUEDIEU, BOURGUIGNON, BOURHIS, BOURIAU, BOURNAZEL, BOURREAU, BOURRET, BOUSQUET (2), BOUSSEMART, BOUTHIER, BOUTOILLE, BOUVIER (2), BOVE, BOYER (2), BOYSSON (de), BOZO, BOZZETTO
BRABANT, BRANCOURT, BRASSELET, BRAUMAN, BRENAC, BRENGUIER, BRET, BRETON (2), BREUILLARD, BREY, BRIALY, BRIAN, BRIAND, BRIEUX, BRILLAT, BRIN, BRINDEJONC de TREGLODE, BRIZON, BROCK-PEVERELLY, BROGLIE (de), BROSSEAU, BROTELANDE, BROUSTEL, BRUANT, BRUEFEL, BRUHL, BRULEY des VARANNES, BRUN (3), BRUNACHE, BRUNAT, BRUNET (3), BRYLINSKI
BUCAILLE, BUCI-GLUCKDMANN, BUFFET, BUIRGE, BULAND, BUREN, BURGER, BURTIN (2), BUSSERRAU, BUTEL, BUTOR, BUYS
BYRAM
C
CADET, CADILHAC,,CADIOT, CADOU, CADY-ROUSTAND de NAVACELLE de COUBERTIN, CAHUZAC, CAILLERIE, CAILLOIS, CAILLOU, CALLENS, CALOIN, CALVET, CAMPLAN, CAMUS, CANAL, CANDAU (2), CANDELORO, CANIVET, CANNEVA, CAPDEVIELLE, CAPELLE, CAPEZALLI, CAPITAINE, CAPITANT (2), CARA, CARDIN, CARISTAN, CARLIER, CARMONA, CARNE, CARO, CAROL (2), CARON (2), CARRE, CARRERE d'ENCAUSSE, CARRIERE, CARTIER (2), CARTON, CASAVIN, CASPARD, CASSAGNAU, CASSEN, CASTANIER, CATERS (de), CAUDRELIER, CAUSSE, CAVAGLION, CAVAGNOUD, CAVAIGNAC, CAVALLO, CAVARROT, CAVASIN, CAVRO, CAYLUS, CAZENAVE, CAZENEUVE, CAZIERCECCALDI, CECCATY (de), CECILLE, CELLIER, CERNUSCHI, CESAR, CESSELIN (2), CETTOURCHABAGNO, CHABAUTY, CHABERISNER, CHABERT, CHABROL, CHADOURNE, CHAGNON, CHAILLOU, CHAKER, CHALLAYE, CHALUS, CHALVET, CHALVIN, CHAMAISON, CHAMBON, CHAMPAGNE, CHAMPEAUX (de), CHAMPMORIN, CHANGEUX, CHANOINE, CHAPDELAINE, CHAPELAIN, CHARAY, CHARBONNEL, CHARLET, CHARLEVOIX (de), CHARNAUX, CHARPENTIER (2), CHARRON, CHARTIER, CHASSIRON (de), CHASTAGNOL, CHATIGNOUX, CHATRON (2), CHAUTARD, CHAUVEL, CHAZAL, CHEDRI, CHEGARAY, CHENAL, CHERAMI, CHEREAU, CHEREL, CHERON (2), CHEVALIER (4), CHEVALIER-LAVAURE (2), CHEVALLIER, CHIRAC, CHOMETTE, CHOPINOT, CHOPPIN, CHRISTEN, CHRISTIE, CHRISTIN (2), CHRISTMANN, CHRISTOPHE, CHUQUETCIXOUSCLAPAREDE (de), CLARET, CLATEAU, CLAUDEL, CLAUSSE, CLAVERY, CLAVET, CLAVIER, CLAYDERMAN, CLEMENT (2), CLERGET, CLIMONET, CLUNYCOBEE, COCHERIE, COCKEDEY, COHEN-TANGUI, COICAUD, COIGNET, COINTAT, COLARDELLE, COLAS, COLIN-ASANO, COLLACHE, COLLASSE, COLLET, COLLIN, COLLOMB-PATTON, COLLONVILLE, COLOMBIN, COMBAZ, COMBES, COMBET, COMELADE, COMPAGNON (2), CONDAMINAS, CONDE, CONDEVAUX, CONIL, CONNAN, CONORT (2), CONSIGNY, CONSTANSOUX, CONSTANT (2), CONSTANTIN, CONTADES (de), CONTE, CONTENSON (de), CONTES (de), COQUEMPOT, CORCUFF, CORDEMER, CORDIER, CORGIER, CORLAY, CORMIER, CORNET, CORNIC, CORNIER, CORNOLIER, CORNU, CORPET, CORRE, CORSINI, CORVAISIER, CORVISART, COSSARD, COSTA, COSTES, COTE (2), COTIN, COTREL, COTTE (2), COTTEAU, COTTEREAU, COTTIAS, COUCHAUD, COUCHOT (2), COUDER, COUGNARD, COULAUD, COUPRIE, COURANT, COURAY, COURBOT, COURRIER, COURRON, COURTET, COURTINE, COUSIN (3), COUSYN, COUTARD, COUTURIERCRANCON, CRASSET, CREIGNOU, CREPIEUX, CREPON, CRESEVEUR, CRETIER, CRIMPET, CROISSET (de), CROSCUCHEROUSSET, CUECO, CUISSET, CUNIN, CUNY, CUSONNEAU
D
DACHY, DAENINCKX, DAGON, DAGRON, DAÏKELER, DALIBERT, DALISSIER, DALLOZ, DALMAS (de), DALPAYRAT, DANIEL, DANION, DANSEREAU, DARBIER, DARIDON, DARTIGE du FOURNET, DAUCA, DAUMAN, MAUMER, DAVY, DAYANDEBERNARD, DEBOISSY, DEBRAY, DEBRE, DEBROUX, DECHAMBOUX, DECHAUX, DECKERT, DE FAYSSE, DEFFRENNES, DEFOSSE, DEGIOANNI, DEGRON, DEGUEST, DEGUY, DEJARDIN, DEJEAN (2), DELABY, DELACAMPAGNE, DELACROIX, DELAHAYE, DELAISTIER, DELALEX, DELANNOY, DELAPIERRE, DELARGE, DELAUNAY, DELAUZE, DELAY, DELBOS, DELECOUR, DELEDALLE, DELEVAY, DELIE, DELILLE, DELMAIRE, DELMAS (2), DELMAS-MARTY, DELMONT-OSAKA, DELOUIS, DELPIERRE, DELRIEU, DELSARTE, DEMANGELLE, DEMEY, DEMIEVILLE, DEMONTFAUCON, DEMOULE, DENEUVE, DENEYER, DENEZ, DENIAUD, DENIEL, DENNERY, DENTICE, DENTICI, DEPARDIEU, DEPARDON, DEPELLEY, DEPESTRE, DEQUINCEY, DERCOURT, DEROO, DERRIDA, DERUY, DESCANTONS de MONTBLANC, DESCHAMPS, DESCHARMES, DESERT, DESFORGES, DESHOUILLERS, DESOYE, DESPLECHIN, DESTRIBAT, DETEY, DETRIE, DEUFF (2), DEUVE, DEVELLE, DEVIN, DEVISSE, DEYRAT, DEZOUCHESDHASPDIABAT, DIETLIN, DINIZ, DIRRINGER, DISSONDJJONE, DJIANDODANE, DODEMAN, DOILLON, DOLEAC-STADLER, DOLEANS, DOLLER, DOMAIN, DOMENACH (2), DONADELLO-SZAPARY, DONGUY, DONNET (2), DONZELLI, DOR, DORIN, DORION, DORIZON, DORMOIS, DORT, DORTIER, DOSSE, DOSSEVI, DOSSIER, DOUCOURE, DOUILLET (2), DOUMENGEDREGE, DREUX, DREVET (2), DROIT, DROUART de LEZEY, DROUET, DROUILLARDDUARTE, DUBARD, DU BESSEY de CONTENSON, DUBET, DUBOIS (4), DUBOIS de JANCIGNY, DUBOSCQ, DUBOURDIEU, DU BOURG de BOZAS, DU BOUSQUET, DU CHENE, DUCHER, DUCHESNE, DUCHESNE de BELLECOUR, DUCORNEZ, DUCROS, DUDEBOUT, DUFOUR, DUFOURMONT, DUFOURNEL, DUFROS, DUHAMEL, DUJARRIC, DUMAS, DUMERC, DUMERGUE, DUMOLARD (2), DUMON, DUMONT, DUMOUSSEAU, DUNOYER, DU PETIT-THOUARS, DUPEYRON, DUPOND, DUPONT (2), DUPUREUR, DUPUY, DUQUESNOY, DURAND (3), DURAND-FARDEL, DURAND-PRINBORGNE, DURANTEAU, DURECU, DURIS, DURIX (2), DUROCHER, DURT, DURY, DUSAPIN, DUSSERRE, DUSSUD, DUTEIL, DUTEIL-OGATA, DUTILLEUX, DUVAL (2), DUVILLARD
E
ECHANOVE, ECHEMANN, ECHENOZ, EECHOUTTE, EGROS (2), EHRHARD, ELMALEH, EMBERG, ENAUDEAU, ENJALBAL, ENNADRE, ENZO ENZO, ERNAULT, ERNAUX, EROUART, ESCOUDE, ESMEIN, ESTEBAN, ESTEBE, ESTIENNE, EURANIE, EVIN, EVRARD, EVREUX, EYMARD, EYSSERIC
F
FABRE (2), FAGE, FAGGIANELLI (2), FAIVRE, FALZON, FANO, FARRERE, FATOUMI, FAUBOURNET de MONTFERRAND, FAUCHIER (2), FAUCONNET, FAUGERAT, FAUQUET, FAURE (4), FAURIE, FAUTRAT, FAUVE-CHAMOUX, FAUVARQUE, FAVEYRAL, FAVIER, FAY, FAYEFEDELI, FELIX, FEQUANT, FERLAMPIN-ACHER, FERNAGU, FERNANDES, FERON, FERRAND (2), FERRET, FERRIE, FERRIER, FERRO, FERT, FEVRIERFIESCHI, FIEVE, FILIPPI (2), FILLIEULE, FILLON, FILLOUX, FINASFLAMAND, FLAMBARD-HERICHER, FLAUJAC, FLAVIGNY (de), FLEURY-VILLATTE, FLEXNER, FLORENT (2), FLOUZAT, FLURY, FLÛRY-HERARDFOFANA, FOISSY, FOMBERTAUX, FONTAINE (4), FONTENEAU, FORCADE, FOREST, FORNIER-DUPLAN, FORTANT, FORTE, FOUASSA, FOUCART, FOUCAUD, FOUCAULT, FOUCHER, FOUCRAS, FOUGERAY, FOUQUE, FOUQUEAU, FOURIER, FOURIER d'HINCOURT, FOURNIER (2)FRADET, FRAINEAU, FRAISSE (2), FRANCE, FRANÇOIS (4), FRANÇOIS-XAVIER (saint), FRANDON, FRANK (2), FREDERIC, FREDON, FREMY, FRESSENON, FREY, FREYMUTH, FRIDENSON, FRIEDT, FRIQUEFUCHS (2), FUMAROLI, FURET, FURTH, FURTH (de), FUSERO
G
GABORIAUD, GABRIAC (de), GAC, GACHET, GAGNON, GAILLARD, GAILLARD-JEUNE, GAINSBOURG (2), GALAND, GALAS, GALEREAU, GALL, GALLAND, GALLECIER (2), GALLOIS, GALLOT, GALOPIN, GAMBAULT, GARDON, GARNAULT, GARNIER (4), GARRABE, GARRAUD, GARREL, GARRIGUE-TESTARD, GATTY, GAUDERAU, GAULTIER, GAURY, GAUSSEN, GAUSSIN, GAUTSCH, GAY, GAYARD, GAYMAN, GAZEAUGELEY, GENEVAY, GENNES (de) (3), GENTELLE, GENTIL (2), GEOFFROIS, GEOFFROY (de), GERARD (6), GERBIER, GEREAU, GERMAIN, GERMAN, GESBERTGHIONGIANNOLI, GIBELIN, GILLAIN, GILLET (2), GIL-MARCHEX, GILOTEAUX, GINER, GIOVANNONI, "GIPSY KING", GIRARD (4), GIRARDIER, GIRAUD, GIRAUDIAS, GIRAUDOU, GIRAULT, GIROIT, GIUSTOGLISSANTGOARIN, GOGER, GOMEZ, GONDRY, GONNORD, GONZARES-FOERESTER, GORDES (2), GOSSE, GOSOT, GOTMAN, GOTTLIEB, GOUDAREAU, GOUEFFON, GOUËLOU, GOUGES, GOUILLAUD, GOUINEAU, GOUPILLE, GOURDAULT-MONTAGNE, GOURNEY, GOURRAUD, GOURVENEC, GOURY, GOUZERTGRACY, GRAFF, GRANGE, GRAVELEAU, GRAVO, GRECO, GREEN, GREGOIRE, GRENIER, GRIGNON, GRINAND, GRIOLET, GRIPEAU, GROC, GROMBEL, GROMOV, GROSJEAN, GROSSAIN, GROSSER, GROUTGUEGAN, GUELTON, GUELLE, GUENA, GUENIN, GUERIN (3), GUERINEAU, GUERNIOU, GUERRIN, GUETTA, GUFFROY, GUIBIER, GUICHARD, GUIDONI, GUIGNOLET, GUIHARD, GUILAINE, GUILLAIN, GUILLAUME (3), GUILLAUMIN, GUILLEMARD, GUILLERM, GUILLERY, GUILLOU, GUILLOUET, GUIMET, GUINCHARD, GUISTIANO, GUITARD (2), GUSMEROLI, GUTKNECHT, GUTTHIG, GUY, GUYARD, GUYON (2), GUYONNET, GUYOT, GUYOTAT
H
HABIG, HAHNE, HALBOUT, HALIMI, HALLE, HALLER, HAMON, HANS, HAOUR (2), HAREL, HARGUINDEGUY, HARLE, HARMAND (2), HARNOIS, HARTOG, HARVEY, HASCHER, HATTU, HAUCHECORNE (2), HAURE, HAURIE, HAVERBEQUE, HAYEK, HAZARDHEBERT (2), HEBERT de BEAUVOIR, HECK, HEIDSIECK, HEINICH, HEINTZ, HELARY, HEMERY, HENON, HENRIOT, HENRY (3), HERAIL, HERARD, HERVE (2), HERVIEU, HERZOG (2), HEUZET, HEYBERGER, HEYMANNHILSZ, HIRSCHHOCHMANN, HOFFMANN, HOLEC, HOLTZER, HONORE, HORIE, HORIO, HOSTACHE, HOUARD, HOUDART, HOUETTE, HOUMMADY, HOUNGUES, HOUTINHUBERT (3), HUBY, HUCHET, HUEREN, HUET, HULLIN-MATSUDA, HULOT d'OSERY, HUMANN, HUMBERT-DROZ, HUON, HUON de PENANSTER, HUOT, HUPPERT, HURIET, HURTIS-HOUAIRI, HUSS, HUTT, HUYGHE, HYVER
I
IKÊME, IRRMANN, ISRAËL (2), ISSARD, ITO, IVALDI, IZARD
J
JACCARD, JACHET, JACOB, JACOPIN (2), JACOULET (2), JACQ (2), JACQUEL, JACQUET, JAFFREDO, JALABERT, JAMAULT, JAMET, JAMI, JANKOVIC, JANSSEN, JAPY, JARRE, JARROT, JARRY (2), JAUNEAUD, JAURES, JAUSSAUDJEAN, JEANNETEAU, JEUNETJOANAN, JOBIN, JOFFRE, JOFFROY, JOHAN, JOISTEN, JOLAS, JOLIVET, JOLY (3), JONQUET, JOQUEL, JORGE, JORLAND, JOSSET, JOSSINET, JOSSON, JOSTE, JOTTRAND, JOUBERT, JOUBIN, JOUFFROY, JOUMARD, JOÜON des LONGRAIS, JOURDAIN, JOURDAN, JOXEJUGON, JUGUET, JUHEL, JUIGNER, JULIEN, JULLIARD, JULLIEN (2), JULLIOT de LA MORANDIERE (2), JUPILLAT, JURIEN de LA GRAVIERE, JUSTER, JUTTETKKAH (2),
K
KAHN (2), KAISER, KANDEL, KAPEK, KAPFER, KARINA, KARONIS, KASSILE, KAUFMANN, KAUSS, KAWAI-CHARNAYKEATING, KEDADOUCHE, KEITA, KERGOAT, KERGOLAY (de); KERJEGU (MONJARET de), KERMALEC, KERMAREC, KERSALE, KERVEN, KERVINGANT, KESSEDJIAN, KESSLERKIEHL, KIENER, KINEIDER, KINTZEL (2), KIRMANKLAUS, KLEIN (2), KLEINPETER, KLIFAKNEIBKOEST, KOMSTA, KONDRACKI, KOUAMEKRAFFT (2), KRANTZ, KREITMANN, KRESLING, KRISTEVA, KRONLUNDKÜNKEL, KUNTZELLLABARTA,
L
LABARTHE, LABASTIE, LABIT, LABRUSSE-RIOU, LACEY, LACHAUD, LACHAUSSEE, LACORDELLE, LACOSTE, LACROIX, LAFON, LAFONT, LAGARDE, LAGERFELD, LAGREVE, LAHAYE, LAIDEBEUR, LAÏDI, LAISNE, LALEU, LALLEMENT, LALOUETTE, LAMALLE, LAMANT, LA MAZELIERE, LAMBOURS, LAME, LAMOUREUX, LANCELOT, LANCRY, LANDRU, LANE, LANG (2), LANGLAIS, LANHER, LANNELONGUE, LANNES, LANZMANN, LA PEROUSE (GALAUP, comte de), LAPEYRERE (de), LAPLANTE, LA POMAREDE (de), LAPOUGE, LARI, LARCHER, LAROSIERE de CHAMPFEU (de), LARRIEU, LARROQUE, LASSERRE, LASZLO, LA TAILLE-TRETINVILLE (de), LATOUR, LA TOUR DU PIN, LATOUR-MAUBOURG (de), LATTANZIO, LATTUADA, LAUCAIGNE, LAUFFENBURGER, LAUNAY, LAURENDEAU, LAURO, LAUT, LAUVERGEON, LAVALLEE, LAVANCHY, LAVERGNE, LAYRLELEANDRE, LE BAIL (2), LEBARBEY, LEBDIRI, LE BEC, LEBEL, LEBENSZTEJN, LE BERRE, LE BESCO, LEBLANC, LEBON, LEBOST, LE BOUCHER, LE BRAS, LEBRIX, LE BRUN, LEBRUN, LE CALVE, LE CARRE, LECCIA, LECERF, LE CHANONY, LECHAT, LECHEVALIER, LECLERC, LECLERCQ, LE COADIC, LECOMTE (4), LECOMTE DU NOU, LECONTE (2), LE CORBUSIER, LE DORZE, LE DRIAN, LEENAERS, LEFEBVRE (2), LEFEVRE (2), LE FORESTIER, LEFRANC, LEFRANC-DUVILLARD, LE GALL, LEGARDEUR, LEGENDRE, LEGRAND (2), LEGROS, LEGROUX, LEGUIL-BAYARD, LEGUILLIER, LEHODEY, LEJEUNE, LE LIDEC, LEMAGNY, LEMAIRE (2), LEMAÎTRE, LEMARECHAL, LEMARIE, LE MARLIN, LEMERCIER, LEMIEUX (2), LEMOINE, LENFANT, LENIAUD, LENNE, LENTZ, LEONSTIC, LEOUTRE, LEPAUL, LE PECHOUX, LE PICHON, LEPINE (de), LEPIQUET-LAMI, LE PODER, LE PORS, LE PRIEUR, LEQUES, LEQUEUX, LEQUILLER (2), LE QUINTREC, LERME, LEROI-GOURHAN, LEROUX (3), LEROUX-SHIMADA, LEROY (2), LEROY-BEAULIEU, LE ROY-LIBERGE, LESAFFRE (2), LESCASSE, LESCOT, LESIGNE, LESTURGEON, L'ETANG, LETELLIER, LETOURNEL, LETT, LE TURDU, LETZELTER, LEUCHTENBERG-BEAUMARCHAIS (de), LEURET, LEURS, LEVAL, LEVÊQUE (2), LEVI, LEVICQ, LEVI-STRAUSS, LEVY (5)LHEUREUXLICCIONI, LICHTNER, LIENHARD, LIENHART, LIFAR, LIGNEUL, LIGRON, LIMAIRAC (de), LIMBOUR, LIMOUZIN, LINDAU, LIONS, LIORET, LIPSCHUTZ, LIPSKY, LISNER, LISSARAGUE, LIZONLOCATELLI, LOISEL, LOMPRE, LONGUEVRE, LOONEN, LOOS, LOPEZ, LORCY, LORIOD, LORMIER, LOSCOS, LOTI, LOUAMI, LOUARN, LOUIS (2), LOUSTAU, LOZERANDLUCA-BERNIER (de), LUCAS (2), LUCKEN, LUCOT, LUNEAU, LUSSY (de), LISTENBERGERLYAUTEY
M
MABESOONE, MACE, MAEKAWA, MAFFESOLI, MAGIMEL, MAGNARD, MAGNE (2), MAHE, MAÏDER, MAILLARD, MAILHET (ou MAILHER), MAILHOT, MAILLET (2), MAIRE, MAIZIERES, MAJET, MAKEIEFF, MALABOU, MALAMOUD, MALEVAL, MALIK, MALIN, MALINAS, MALET, MALPHETTES, MALRAUX, MANGE, MANGEL, MANZELLE, MARANDON, MARBOT, MARCEAU, MARCEL, MARCHAND, MARCHANT, MARCUS, MARE, MARECHAL (3), MARGAIRAZ, MARGEREL, MARGERIN, MARIANI, MARICOU, MARIE (2), MARIN, MARIN-CUDRAZ, MARION, MARIX, MARKS, MARLAND, MARLOT, MARMONIER, MARNAS, MAROGER, MARQUERIE, MARQUET (2), MARQUIS (2), MARSEILLE, MARTEL, MARTIN (10), MARTIN de CHASSIRON, MARTINIE, MARTINS-VALERA, MARTRE, MARTY, MARVIER, MARY, MASNADA, MASSE, MASSERON, MASTALSKI, MATAS, MATHIEU, MATHIEU-RIDEL, MATHILDE, MATHON, MATIGNON, MATRAT, MAUGENDRE, MAUGET, MAUGRAS, MAULPOIX, MAURICE (2), MAURY, MAY, MAYET, MAYRAND, MAZEAUD (2), MAZEAUD-LEVENEUR,MBANDJOCK, M'BARKEMEGRE, MEHEUT, MEKHISI, MELLON, MELOT, MELQUIOT, MENARD (3), MENEGOZ, MENIERE, MENNESSON, MERCIER (2), MERIGOT, MERMET, MERMET-CACHON (MERMET de CACHON), MESCHONNIC, MESNIL, MESSELOT, MESSIAEN, MESTIER DU BOURG (de), MESTRALLET, METAIS, MEUNIER, MEUNIER-CARRIDI, MEYER, MEYNARD, MEZILMICHANOL, MICHAUD (2), MICHAUX, MICHEL (5), MICHELIN, MICHON, MIDAN, MIDON, MIGEON, MIGNEAULT, MILCENT, MILLER, MILLET (2), MINI, MIOLLIS, MIOTTE, MISSOFFE, MITTERRAND, MIZUBAYASHIMNOUCHKINEMNCH, MOGES (de), MOLLIER, MOLMONT, MONGE, MONJOUR (de), MONIER, MONIOTTE, MONJARET de KERJEGU, MONNIER (2), MONNIN, MONPERT, MONSET, MONTAGNIER, MONTAGU, MONTQGUE, MONTAND, MONTBLANC (DESCANTONS de), MONTEBRUN, MONTFERRAND (de), MONTFORT (2), MONTGOLFIER (de), MONTHEROT (de), MONTILLET, MONTROGNON de SALVERT (de), MOORS, MORA, MORE, MOREAU, MORECHAND-NAGATAKI, MOREL, MORGES, MORIN (2), MORLAT, MORMANNE, MORNAND, MORNAT, MORON, MORTIER de TREVISE, MORVAN, MOSSE, MOSSUZ-LAVAU, MOTAIS, MOTTE, MOUCHET, MOUCLIER, MOULIN (3), MOUNICOU, MOURIER, MOUSTAKI, MOUTOUTMUCHIELLI, MUGABURE-SAUBARER, MUKAI, MULLER (2), MUNIER, MUNOZ, MURGUE, MUTZ, MUXEL
N
NADEAU, NAHOUM, NAITO, NANA-DJIMOU IDA, NANCY, NANTA, NANTET, NAPOLEON, NAPPI-CHOULET, NARDIN, NASIO, NASTI, NATHAN, NAUDEAU, NAVACELLE (de), NAYRALNEDJAR, NESPOULOS, NETTANCOURT-VAUBECOURT (de), NEUNGUYENNIARE, NICOLAS (2), NICOLLE alias NICOL (de), NICOLLIER, NIEL, NIOGRETNOAILLES (de), NOGACKI, NOGUEZ, NORA, NORDMAN, NORMAND, NORO, NOTHOMB, NOUDELMANN, NOUËT, NOUVEL, NOUVELLET, NOUVIONNUEL, NUGIER, NUSSAUMNYSNZOLA MESO BA
O
OCHEM, ODAJIMA, ODIN, OGIER, OHL (2), OLDENDORF, OLIER, OLIVARES, OLIVEIRA (de), OLIVIER, OLIVIER-UTARD, OLRY de LABRY, ONETO, ONFRAY, ORCEL, ORIGAS, ORLEANS (d'), duc de PENTHIEVRE, ORMESSON (LEFEVRE d'), ORSENNA, ORSINI, ORY, OSERY (HULOT d'), OSOUF, OUDART, OGIER, OUI, OURISSON, OURY, OUTREY, OUVRIEU, OZIERPPACHON,
P
PACQUEMENT, PADOUX, PADOVANI, PAGEOT, PAGNIE, PAILHAS, PALIER, PALLARD, PALMA, PALME, PANEL, PAPIN, PAPINOT, PARADIS, PARENT, PARIENTE, PARILLAUD, PÂRIS (3), PARISET, PASCAL, PASCALINI, PASCAREL ? PASQUIER (2), PASTOR, PATIN, PATROUILLOT, PATS, PATTE, PAUCOD, PAVILLONPEAN, PECH, PECHKOV (alias PESCHKOFF ou PETCHKOFF), PECKER, PEIZERAT, PELEGRIN (2), PELISSERO, PELLETIER, PELLETIER-DOISY, PELT, PELU, PENANSTER (HUON de), PENCHREC'H, PENNAC, PENOT, PEPIN (2), PEQUEGNOT, PERA, PERARD, PERCAL, PERCHERON, PERCIN, PEREL, PEREZ (3), PERI, PERICAT, PERIGNY (SIMON de), PERIGOT, PEROL, PERRARD, PERRAUDIN, PERREGAUX, PERRIN (5), PERRINEAU, PERROT (2), PERROUIN, PETIT, PETITJEAN (2), PETITMENGIN, PETRAU-LARTIGUES de MEMBIEL, PETTIER, PETTIT, PEUILLER, PEYRON, PEYRUSSEL (2), PEZEU-MASSABUAUPHILIBERT, PHILIPPOTPICAUT, PICCARD, PICOULY, PICQUET, PICQUIER, PIERRE, PIERRE-KAHN, PIERRE LA POLICE, PIERRE-LOUIS, PIERREL-VAXELAIRE, PIERSON, PIGEOT, PIGNATEL (3), PIJAUDIER-CABOT, PILA, PILLIE, PIMODAN (de), PINAUD, PINCHEMEL, PINÇON, PINÇON-CHARLOT, PINGUET, PINON-KAWATAKE, PIQUEMAL, PIRARD, PIRIOU, PITAULT, PITTEPLACE (de), PLANES, PLANQUETTE, PLANTU (PLANTUREUX), PLATTARD, PLESSIS (2), PLEVER, PLOCK, PLUDERMACHERPOIDATZ, POIREE, POIRIER, POISSON, POITEVIN, POLAK, POLLET, POLLY, POLY, POMAGALSKI, PONS (2), PONTIER, PORLIER, PORTAL, PORTICHE, PORTUGAL, POSTEL-VINAY, POTOSKI, POUCHELLE, POUGET, POULET, POULIGNY, POUPI, POUSSET, POUZETPRADIER, PRADVIEL, PRANCHERE, PRAT (2), PRATMARTY, PRAUDEL, PRESSE, PRIGENT, PRIOU, PROCHASSON, PROUCELLE, PROUTEAU, PROUVEE, PROVOST, PRUCNAL, PRUNIER (2), PRUSNOL de ROSNYPUISEUX, PUISSANT, PUNGIER, PUTHODQQUELLIER,
Q
QUENOUELLE, QUENTIN, QUIGNARD, QUILLERE, QUINIOU, QUINQUET de MONJOURRRABIER, RACINE, RAGON, RAGOT, RAHM, RAMANANTSOA, RAMBACH, RAMBERT, RAMETTE, RAMONET, RAMPAL, RANCIERE, RAOULT, RARECOURT de LA VALLEE de PIMODAN, RAUD, RAULT, RAVASSARD, RAVEL-CHAPUIS,
R
RAY, RAYMOND, RAYNALREAL des PERRIERES, REVEUH, REBOLLAR, REGAFFRE, REGAMEY, REGNAULT (2), REGNIER-LAFFORGUE, RELAVE, REMUSAT (de), REMY (3), RENARD, RENARD-CHAPIRO, RENAUD, RENAUT, RENEAU, RENO, RENOM de LA BAUME, RENOMA, RENONCIAT, RENOU (2), RENOUX, REQUILLART, RESSLER, RETZ, REVEL, REVILLIOD, REVOL, REVON, REY (2), REYNAERT, REYNARD, REYNAUD (2), REYNAUD de LIGUESRIBAUD, RIBAULT, RIBES, RICCI (de), RICHARD (3), RICHARDSON, RICUR, RICO, RICO-YOKOHAMA, RIEGERT, RIEU, RIEUNIER, RIGAUDIS, RIGOUT, RINER, RIO, RISPAL, RIVA, RIVEAU, RIVIERE (2)ROBBE-GRILLET, ROBEIN-SATO, ROBERGE, ROBERT (6), ROBERT-MICHON, ROBIN, ROBINSON-VALERY, ROCHANT, ROCHARD, ROCHE, ROCHES, ROGER, ROLAND (2), ROLIN, ROMIER, RONCIN, RONEL, ROSANVALLON, ROSENBERG, ROSENTAL, ROSIER, ROSNY (PRUNOL de), ROSS, ROSSELLET, ROSSI, ROSSILE, ROSSO, ROTHEY, ROTZ de LA MADELEINE (de), ROUBAUD, ROUBE-JANSKY, ROUCHIER, ROUE, ROULLIER, ROUPIE, ROUQUET, ROUSSE (3), ROUSSEAU (3), ROUSSEL (3), ROUSSET, ROUSSIN, ROUX, ROVER, ROY (3), ROZERUAIS, RUBY, RUELLAN, RUET, RUIZSSABBAN,
S
SABOURET (2), SADIN, SAGAZ, SAGLIO, SANIER, SAILLARD, SAINT-AULAIRE (de), SAINT-ETIENNE (de) (2), SAINT-LOUP, SAINT-MARTIN, SAINT-PHALLE (de), SAIONI, SALAVIN, SALIGNON, SALLUS, SALMON, SALVADOR, SALVERT (de), SALVERY (3), SALZGEBER, SAMIE, SANCHEZ, SARAGUETTA, SARDA, SARKISSIAN, SAROCCHI, SARRAZIN, SARTRE, SATO, SAUBIAC, SAURET, SAUTET, SAUTTER, SAUVION, SAUZEDDE, SAVATIER, SAYSCHAEFFER, SCHERPEREEL, SCHILLES, SCHMEER, SCHMITT, SCHOENDOERFFER, SCHOTT, SCHREIBER, SCOB, SCHWARTZSECHER, SEGUELA (2), SEGUIN, SEGURA, SEITZ, SEIZELET, SEKINE, SEMPER, SEMPERE, SEMPRUN, SENECAT, SENTOUT, SENUT, SERAIN (2), SEROT, SERVE, SESTER, SEVAISTRE, SEVOZSHAHROKH NADERISIARY, SICHEL, SICURO, SIEBES, SIEFFERT, SIENKIEWICZ, SIGANOS, SIGERE, SIGNOLES, SILHOL, SIMON (3), SIMON de PERIGNY, SIMOND, SIPIERE, SIROT (2), SISLEYSKOTNIKSONNET, SORIANO, SORTAIS, SOUBITEZ, SOULA, SOULAGES, SOULAS (2), SOULILLOU, SOUM, SOUMARE, SOUROQUE, SOUYRISPARFEL, SPORTESSTAEBLER, STEENACKERS, STEGA, STEICHEN, STEINMETZ, STEPHAN, STEPHANT, STEPHENSON, STERN, STEURER, STRASKIEWICZ, STRASNOY, STROBEL, STRUDELSUBRAHMANYAM, SUCHET, SUET, SUEUR, SULIAC, SUTTERSWERTSSYLVAIN (2), SYLVESTRESZYMUSIAK, SZYSTERTTAHRI,
T
TALPIED, TAKINO, TANET, TAUTOU, TAVERNIER (2)TEISSIER, TEMMAN, TENEZE, TERNAUX, TERRANOVA, TERTRAIS, TESSIER, TESSON, TESTARD, TESTART, TESTEVUIDE, TÊTUTHIEBAULT, THELLIER, THELOT, THENOT, THEOVAL, THEREAUX, THERON, THERY, THEVENARD, THEVENET, THEVENIN, THIBAUDIER, THIBAULT, THIEBAULT, THIRY, THIS, THOMANN, THOMAS (3), THOMASSET, THOMPSON, THORAVAL, THOUNYTIJOU, TILOT, TINSEAU (de), TIRARD, TISSIER, TISSOT, TIXIER (2), TIXIER-MITATODA, TODD, TODESCHINI, TOEPLITZ, TOQUEBUF, TORDJMAN, TORRES, TORSIACHI, TOUCHET (de), TOULOUSE, TOUSSAINTTRAHAN, TRAORE, TREGLODE (BRINDEJONC de), TRELU, TRENET, TREVISE (de), TRIBOUILLARD, TRIEGER, TRINQUIER, TRINTIGNAC, TRINTIGNANT, TRIOZZI, TROCK, TROTTER, TROUSSIER, TRUBERTTULPIN, TURENNE (d'AYNAC) (de), TUROT, TUVACHEUUNTERWALD
V
VACCARI (2), VACHIER, VAGNER, VALAND, VALAT (3), VALENCE (de), VALENTIN, VALERY, VALET, VALETTE (2), VALLAT, VALLE, VALLENT, VALOT, VANDERMEERSCH, VANDERVOO, VAN GESSEL-YODA, VANHERZEEKE, VANNEY, VANNIEUWENHUYSE, VANUCCI-ROOS, VAQUEZ, VARDA, VARTAN (VARTANIAN), VASSEUR, VASSITCHVEILHAN, VELGE, VENCIENNE, VENDREDI-AUZANNEAU, VENDROUX, VENEL, VENTURE, VERCHERY, VERDIER (2), VERDOLLIN, VERDON, VERGNEAU, VERGON, VERISSEL, VERNES, VERNEY, VERNISSE, VERNY, VEYCHARD, VEYSIEREVIDAL, VIDAL-NAQUET, VIDON, VIEILLARD, VIELFAURE, VIERA, VIEST, VIGNERON, VILLAIN, VILLARET (de), VILLENEUVE, VILLION, VILMOUTH, VIOLLIS, VION, VITTOZVLAEMINCKVOCANCE, VODENITCHAROV, VOLCKMAN, VORPSI, VOS (de)VRIGNAUDVUARIN
W
WACZIARG, WAHNICH, WALRAVENS, WALTER (2), WARET, WARNIER, WASSEREAU, WANATABEWEIL (2), WEISBECKER, WENGER, WEULERSSEWIAZEMSKY, WEIL, WIENER, WIEVORKA, WILL, WILSON, WINDAL, WINDISCH, WISMAN, WITZWOLINSKY, WOLTONXXANAKIS
Y
YEMMOUNI, YGREC, YOKOHAMA, YOURCENAR, YUNGZZAO-WOU-KI,
Z
ZELWER, ZINK, ZOUAOUI-DANDRIEUX
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le comte Terauchi Masatake (1852-1919) Le premier gouverneur japonais de la Corée de 1910 à 1916
Le comte japonais TERAUCHI MASATAKE (1852-1919)
Fils d'un samouraï du clan Hagi, à Chôshû (actuelle préfecture de Yamaguchi, Japon) le 5 février 1852, à Oiso le 3 novembre 1919, il s'appela d'abord Tada Jusabaro avant d'être adopté par la famille Terauchi. Entré dans l'armée à l'âge de 12 ans, il combattit le shogounat dans les rangs de l'armée impériale lors de la guerre de Boshin (1868-1869). Puis il sera gravement blessé pendant la rébellion de Satsuma (1877) mais ses blessures n'empêchèrent pas la poursuite de sa carrière militaire et politique. Attaché militaire en France vers 1880, ministre de la Guerre de 1901 à 1905 (dans le cabinet Katsura Taro), le général fut créé baron en 1905 puis comte en 1911. Terauchi Maasatake était devenu résident général du Japon en Corée en mai 1910. C'est lui qui avait été chargé d'opérer l'annexion pure et simple de ce pays. Il rédigea les termes du traité avec Yi Wan-yong, le Premier Ministre du dernier gouvernement Yi, qui y apposa sa signature le 22 août 1910 ce qui lui valut une réputation de traître à sa patrie. Sur ce document, Terauchi Masatake porte le titre de vicomte. Sept jours plus tard, le roi Sunjong (25 mars 1874-24 avril 1926), dernier empereur de la dynastie Joseon de 1907 à 1910 (4e fils de l'empereur Gwangmu), dut tout à la fois abandonner son trône et son palais. On le confina dans le palais de Changdeokgung où il finira sa vie. La capitale Séoul devint Kyongsong (Keijô en japonais).
Terauchi Masatake changea son titre de résident général contre celui de gouverneur général et il quadrilla aussitôt le pays avec d'importantes forces de police ordinaire, de police militaire et de gendarmerie (en tout, plus de 14 000 hommes).
Les Coréens eurent à souffrir de l'occupation musclée de ces troupes qui perdurera après lui jusqu'en 1945 mais le but premier de Terauchi Matasake était de faire des Coréens de parfaits sujets, loyaux et soumis, de l'empereur du Japon. Ce général était persuadé que le Japon et la Corée avaient de forts liens historiques et donc un destin tout tracé pour fusionner. Il faut mettre à son crédit la modernisation du pays et la création de centaines d'écoles dans le pays, destinées, il est vrai, à répandre l'apprentissage du japonais (devenu discipline obligatoire) mais qui contribuèrent à l'élévation générale du niveau de l'éducation. Ces points positifs ne sauraient en aucune façon effacer le terrible souvenir des exécutions (dont celle de Yu Gwan-sun, héroïne indépendantiste, coupée en trois au sabre), des très nombreux emprisonnements, des femmes devenues esclaves sexuelles et des tortures exercées sur les Coréens s'opposant à l'annexion de leur pays.
Nommé maréchal en 1916, Terauchi Masatake deviendra Premier Ministre du Japon du 9 octobre 1916 au 29 septembre 1918.
Son fils, Terauchi Hisaichi, commandant d'un groupe expéditionnaire de l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale, deviendra lui aussi maréchal.
Parmi les neuf successeurs de Terauchi Masatake au poste de gouverneur japonais de la Corée occupée, citons les deux premiers : le comte Hasegawa Yoshimishi, d'octobre 1916 à août 1919, et Saito Makoto, né à Misuzawa le 27 octobre 1858, à Tôkyô le 26 février 1936, baron le 21 septembre 1907, amiral le 16 octobre 1912, vicomte le 29 avril 1925, gouverneur général de la Corée à deux reprises : d'août 1919 à 1927 et de 1929 à 1931.
Le troisième gouverneur général fit construire la "Maison bleue" (uvre de George De Lande, architecte prussien), devenue le palais présidentiel actuel.
Bibliographie sommaire
Craig, Albert M., Chōshū in the Meiji Restoration, Cambridge, Harvard University Press, 1961.
Dupuy, Trevor N., The Harper Encyclopedia of Military Biography, New York, Harper Collins Publishers Inc., 1992.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le couvent et le séminaire de Consolation (Doubs) Histoire du Moyen Âge à nos jours Liste des dix premiers supérieurs du séminaire (1833-1906)
Le cirque naturel de Consolation1 culmine à 870 mètres d'altitude au sud du territoire communal. Dans un double hémicycle grandiose où prennent naissance la rivière du Dessoubre et ses affluents, le Lançot, le Tabourot et la Source Noire, plusieurs grottes sont creusées sur les flancs de la roche. Sur le rebord de la falaise, le belvédère de la Roche du Prêtre offre une vue impressionnante sur la vallée du Dessoubre et le parc de l'ancien monastère qu'il surplombe de plus de 350 mètres.
Véritable décor semblant sorti tout droit d'un roman d'heroic fantasy, Consolation, terre de légendes, se prête avec un rare bonheur à des promenades romantiques et sportives pour amateurs de grottes et de cascades à découvrir dans un abondant fouillis de verdure qu'on sait habité par les hommes depuis l'âge du bronze et à l'âge du fer I et II. Pour tous les nostalgiques de la collection "Signe de Piste", Consolation permet de se réinventer une âme adolescente de boy-scout en quête d'aventures. Le cadre constitue également un lieu rêvé pour ceux qui veulent se plonger, hors du temps, dans les forces primitives de la nature ou pour d'autres en recherche du spirituel, loin du vacarme du monde dit civilisé. Il ne faut donc pas s'étonner que, depuis le Moyen Âge, un site aussi exceptionnel ait attiré ceux qui désiraient prier.
Succédant à un oratoire construit en 1432-1433 (reconstruit au 16e siècle), le monastère des minimes de Consolation a été construit en 1670, avec les pierres de l'ancien château de Châtelneuf-en-Vennes, par Marie Henriette de Cusance et de Vergy, veuve de Ferdinand François Just (dit François) de Rye, marquis de Varambon, décédé à Besançon (Doubs) le 5 août 1657, fils de Christophe de Rye, marquis de Varambon, et de sa seconde épouse, Christine Claire d'Haraucourt. L'église néo-romane du couvent abrite toujours le tombeau monumental de ce personnage. Il est composé d'un socle de marbre noir sur lequel quatre lionceaux de marbre blanc soutiennent une table de marbre rouge : celle-ci supporte un socle de marbre noir à doucine très prononcé, sous un retable accosté de gaines de marbre blanc surmontées de têtes de femmes sculptées. Au sommet du monument, un génie à demi-nu porte un cartouche aux armes des Rye : une aigle éployée (d'azur à l'aigle d'or) tandis qu'on peut lire cette inscription : "Apprends, Bourgogne, combien de héros tu as perdus en un seul, combien de flambeaux tu as vus s'éteindre qui brillaient pour toi - Apprends, voyageur, à quoi tiennent les plus magnifiques choses qui disparaissent à jamais en un moment". Ce mausolée, restauré par les soins de l'abbé Deluvre, supérieur du séminaire, a été classé monument historique le 29 janvier 1910. Il a été exécuté en 1670 à la demande de Marie-Henriette de Cusance et de Vergy2, veuve du marquis et sur de la célèbre Béatrix de Cusance, dame de Belvoir. Un des anges en marbre de ce tombeau monumental a été volé en 2001.
Le couvent des minimes, qui ne comptait plus que quatre religieux, a été vendu comme bien national pendant la Révolution et l'église désaffectée devint un magasin à fourrage après qu'on eût violé la tombe du marquis de Varambon et martelé des armoiries de son monument funéraire.
Lorsque Louis François Auguste de Rohan-Chabot (né à Paris le 29.02.1788, à Besançon le 08.02.1833), prince de Léon, archevêque de Besançon, obtint son chapeau de cardinal (grâce à une demande adressée au pape par Charles X), Consolation avait déjà été acheté par l'archevêché mais c'est son successeur, quelques mois plus tard, qui le transforma en séminaire.
Le séminaire de Consolation (appelé familièrement "Conso" surtout par les anciens élèves) ouvrit ses portes en 1833. Mgr Louis-Guillaume-Valentin Dubourg (né à Cap-Français (Saint-Domingue) le 10.01.1766, à Besançon le 12.12.1833), archevêque de Besançon, avait simultanément supprimé les écoles ecclésiastiques d'Ornans et de Belvoir (cette dernière ayant jusqu'alors fonctionné dans l'enceinte du château et accueilli, parmi ses élèves, le futur académicien Xavier Marmier). Ces deux écoles avaient été transférées et réunies pour former le petit séminaire de Consolation.
Fermé en 1906 après une diminution du nombre d'élèves, dont tous ne se destinaient pas à la prêtrise (80 pensionnaires contre 150 dans les années 1860-1880) et transféré à Ornans, sous la direction de l'abbé Bobinet, puis à Maîche en 1910 (les locaux d'Ornans ayant été confisqués par la République pour être donnés à l'école Perrenot de Granvelle), le séminaire de Consolation fut à nouveau en activité dès 1920 pour 168 séminaristes sous la direction du chanoine Paul Rognon. Il ferma définitivement en 1978 après avoir commencé à former plus de 600 prêtres de 1833 à 1906 et environ 300 prêtres et missionnaires de 1920 à 1978.
Ses murs permirent d'installation d'hôpitaux provisoires de campagne en septembre-octobre 1944.
De nos jours, les bâtiments du séminaire de Consolation abritent une importante collection d'oiseaux naturalisés.
La Fondation du Val de Consolation, organisatrice de réunions religieuses et de manifestations culturelles, a pris le relais du séminaire. Cette fondation a été reconnue d'utilité publique par décret ministériel du 2 mai 1978.
Liste des directeurs
1833-1835 : Chanoine François Girardot
1835-1837 : Abbé Alexandre Liquet
1837-1841 : Abbé Antoine Boisson
1841-1848 : Abbé Amédée Bontront
1848-1854 : Abbé Henry de Vaulchier du Deschaux3
1854-1857 : Abbé Jean-Baptiste Bourgoin, ancien professeur à la maîtrise de la cathédrale de Besançon
1857-1887 : Chanoine Joseph Deluvre, restaurateur du mausolée de Ferdinand François Just de Rye, marquis de Varambon
1887-1901 : Abbé Ernest Monnier
1901-1903 : Abbé Charles Huot-Marchand
1903-1906 : Abbé Joseph Vitte
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
1 Commune de Consolation-Maisonnettes (Doubs) depuis le 17 mars 1910.
2 Après une année de veuvage, Marie-Henriette de Cusance et de Vergy épousa, en secondes noces, le prince Charles Eugène d'Aremberg, gouverneur de Franche-Comté.
3 Henri de Vaulchier du Deschaux (en religion Dom Louis Joseph), né à Damerey (Saône-et-Loire) le 23 mars 1819 (fils de Louis René Simon, 3e marquis de Vaulchier du Deschaux, et de Céleste Guilhelmine Gasparine Millot de Montjustin, ordonné prêtre en 1842, vicaire pendant une courte période à la cathédrale de Besançon (25) puis à Arbois (39) avant d'être nommé directeur du petit séminaire de Consolation (2). Après un voyage en Terre Sainte (1855-1856) et un autre en Italie, il devint curé de Dole (39) en 1857 puis prieur de la chartreuse de Valbonne après avoir reçu successivement les titre de chanoine honoraire et de vicaire général honoraire. Procureur général de son ordre, il refusa l'évêché de Grenoble (38). Il mourut dans le canton de Fribourg (Suisse) au monastère de la Valsainte le 24.03.1911 dans sa 93e année. On lui doit une "Histoire de France jusqu'au XVIe siècle", malheureusement restée à l'état de manuscrit (Jean-Marie Thiébaud, Les Marquis en Franche-Comté, p. 181).
Les ambassadeurs de la Confédération helvétique en République populaire de Chine, République populaire démocratique de Corée du Nord et Mongolie Liste de 1950 à 2008
1950-1954 : Clemente Rezzonico (1897-1976), ministre plénipotentiaire, entré en fonction le 28.11.1950, accrédité à Pyongyang le 28.11.1950. Ses successeurs seront tous ambassadeurs.
1954-1958 : Fernand Bernouilli, né en 1905, futur ambassadeur à Addis-Abeba de 1967 à 1972.
1959-1962 : René Naville, né en 1905, à Estoril le 12.02.1978 (fils de Paul Naville et de Marguerite Soret). Le 24.07.1934 à Corsier (Suisse), il épousa Éliane de Diesbach de Belleroche (1902-1969), fille de Roger de Diesbach de Belleroche (1876-1938) et d'Édith de Boccard (1876-1967).
1962-1966 : Hans Kaspar Keller (1908-1999)
1966-1972 : Oscar Rossetti (1912-1996), ancien consul général à Washington de 1959 à 1963.
1972-1975 : Albert-Louis Natural (1918-2002).
1975-1977 : Heinz Langenbacher (Dr), né en 1919, docteur en droit, ancien ambassadeur à Addis Abeba de 1970 à 1975, futur ambassadeur à Tunis de 1977 à 1984, demeurant à Ferenberg (canton de Berne).
1977-1982 : Werner Sigg (1917-1989).
1982-1986 : Hans Müller, né en 1921.
1986-1988 : Fritz Bohnert (1928-1988), ancien ambassadeur à Addis-Abeba de 1977 à 1981.
1988-1995 : Erwin Schurtenberger (Dr), né en 1940, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, demeurant ensuite à Minusio.
1995-1998 : Uli Sigg (Dr), né à Lucerne le 29.04.1946, docteur en droit à l'Université de Zurich, journaliste pour l'entreprise Ringuer puis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il possède la plus grande collection au monde d'objets d'art chinois. Il est membre du comité consultatif international de la Tate Gallery de Londres et du Museum of Modern Art de New York. En 1979, il avait lancé le premier joint-venture entre la Chine et un pays d'Occident.
1999-2003 : Dominique Dreyer, né à Trub (canton de Berne) en 1945, étudiant à Fribourg et à Cambridge, docteur en droit, secrétaire d'ambassade à Beijing de 1974 à 1979, conseiller d'ambassade dès 1994, ministre et premier collaborateur du chef de mission en 1995 puis chargé d'affaires par intérim avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 1999.
2004-2008 : Dante Martinelli, né à Faido (canton du Tessin) le 05.10.1947, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Chine le 26.07.2004. Depuis septembre 2008, il est ambassadeur auprès de l'Office des Nations unies et des autres organismes internationaux à Genève.
2008- : Blaise Godet, né à Neuchâtel (canton de Neuchâtel) en 1947, licencié en droit de l'université de Neuchâtel, avocat, conseiller d'ambassade en 1983, ambassadeur en Thaïlande, au Laos, au Myanmar et au cambodge en 1993, en Egypte et au Soudan en 1997, auprès de l'Office des Nations unies et des autres organismes internationaux à Genève, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Chine depuis le 10 septembre 2008.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les ambassadeurs de la République française en République populaire de Chine Liste de 1964 à 2008
1964-1969 : Lucien Paye (1907-1972), premier ambassadeur depuis la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine.
1969-1975 : Étienne Manac'h (né en 1910), un ancien de la France Libre, élevé à la dignité d'ambassadeur de France en 1974, auteur de Mémoires d'Extrême Asie. La Face cachée du Monde.
1975-1979 : Claude Arnaud (né en 1919)
1979-1982 : Claude Chayet qui connaissait déjà le pays pour été chargé d'affaires dès le 22 février 1964 afin de préparer l'arrivée du premier ambassadeur.
1982-1986 : Charles Malo
1986-1989 : Michel Combal
1989-1990 : Charles Malo
1990-1993 : Claude Martin
1993-1997 : François Plaisant
1997-2002 : Pierre Morel
2002-2004 : Jean-Pierre Lafon
2004-2006 : Philippe Guelly
2006- : Hervé Ladsous
Le gel des rapports avec la Chine (1989)
Le 6 juin 1989, deux jours après le massacre de la place Tiananmen à Pékin, Michel Rocard, Premier Ministre annonça à l'Assemblée nationale le gel de tous les rapports avec la République populaire de Chine.
Les ventes d'armes françaises à Taïwan
À la fin des années 1980, Thomson CSF signa avec Taipei un contrat de vente d'un montant initial de 15 à 16 milliards de francs, pour six frégates de type Lafayette d'une longueur de 125 mètres pour un déplacement de 3500 tonnes à pleine charge (pour) mais le gouvernement français, soucieux de garder de bonnes relations avec Pékin, s'opposa à cette vente. En effet, le 2 janvier 1990, Zhu Jue, ambassadeur de Chine à Paris, avait demandé à être reçu en urgence pour signifier le désaccord de la Chine sur la vente de ces unités à Taïwan. En juillet 1990, Thomson signa un contrat de lobbying avec la société de droit suisse Frontier AG Bern (représentant ELF). Finalement, les réticences du gouvernement français furent dissipées et Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, autorisa la vente des frégates mais à la condition qu'elles seraient désarmées. Le contrat définitif put donc être signé en août 1991. Dossier Bravo puis Tango-Bravo devinrent le nom de code de ce programme et cette affaire.
En octobre 1992, Dassault Aviation vendit à Taïwan 60 Mirages 2000-52 par le biais du CIEEMG et 1000 missiles MICA de chez Matra. Dans le sillage de cette transaction, Thomson fournit alors l'armement pour équiper les frégates.
Construites à Lorient par DCN, les frégates ont été livrées ont été livrées en juin 1996 (Kang Ding), septembre 1996 (Si Ning), août 1997 (Di Hua), décembre 1997 (Wu Chang), janvier 1998 (Chang te) et août 1998 (Kun Ming).
L'armement de ces unités navales comporte 8 missiles antinavires Hsiung Feng II (engin guidé pouvant atteindre une portée de 130 km), un système surface/air Sea Chaparral (portée de 9 km), un canon de 76 mm (cadence : 85 coups / minute), deux canons Bofors de 40 mm, un système multitubes Phallanx (3000 coups par minute), deux plateformes triples pour tubes lance torpilles et enfin, un hélicoptère.
La marine taïwanaise a porté de 599 millions à 1,2 milliard de dollars sa demande de dommages et intérêts à propos du contrat de vente de six frégates, signé en 91 avec Paris. C'est ce qu'a annoncé le groupe français Thales dans un communiqué. Cette réclamation fait suite à la procédure d'arbitrage introduite en août 2001.
La poursuite de relations harmonieuses entre la France et la République populaire de Chine passe bien évidemment par l'arrêt de vente de matériel militaire à Taïwan. En novembre 2007, lors de son entretien avec le président chinois Hu Jintao, Nicolas Sarkozy, Président de la République française, a souligné que la France adhérait à l'idée d'une Chine unique et s'opposait à l'indépendance de Taïwan et à son projet de référendum pour tenter d'entrer à l'ONU.
L'ambassade actuelle
L'ambassade de France actuelle est située à Beijing, Chaoyang District San Li Tun Dong San Jie 3 Hao. Alain Sarfati est l'architecte de la future ambassade.
NOTES DU CHAPITRE
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les ambassadeurs du royaume de Belgique en République populaire de Chine Liste de 1972 à 2008
Liste des ambassadeurs belges en Chine depuis 1972 :
1972-1976 : Baron Jacques GROOTHAERT
1976-1977 : J. A. Raoul SCHOUMAKER
1977-1979 : Raoul DOOREMAN
1979-1984 : Roger DENORME
1984-1987 : Jan HOLLANTS VAN LOCKE, auteur de l'ouvrage De la Colonie à la Diplomatie, préface de Xavier Mabille, Paris, éd. de L'Harmattan, 1999, 304 p.
1987-1990 : Frans BAEKELANDT
1990-1993 : Baron Willy J. B. de VALCK
1993-1997 : Madame Claire KIRSCHEN, présidente de l'Institut belge des Hautes études chinoises, représentante spéciale de la Belgique à la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. Grand-croix de l'Ordre de la Couronne (arrêté royal du 12.07.2006).
1997-2002 : Johan MARICOU, né à Ypres en août 1949, licencié en sciences diplomatiques, ambassadeur en Algérie de septembre 1995 à 1997. Depuis 2006, il est ambassadeur de Belgique à Tôkyô.
2002-2005 : Gaston VAN DUYSE-ADAM
2005- : Bernard PIERRE, né en 1950, licencié en droit
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
L'Ordre du Soleil levant (Japon) Titulaires français et étrangers
Kojiro Akagi, né à Okayama-shi en 1934, arrivé en France en 1963, artiste peintre, décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or avec rosette.
Georges Appert (1850-1934), diplômé de la faculté de droit de Paris, professeur pendant dix années (1880-1889) à l'École de droit fondée au Japon par Georges Bousquet pour le ministère de la Justice (Shihôshô-hôgakkô). Il a été décoré du petit cordon de la 4e classe dans l'Ordre du Soleil levant. Sa statue est conservée au ministère de la Justice à Tôkyô. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Jean-Louis Barrault, né au Vésinet (Yvelines) le 08.09.1910, à Paris le 22.01.1994, acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. Organisateur en 1977 d'une tournée de représentations de la compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault dans tout l'archipel, il a été reçu à l'Institut franco-japonais de Tôkyô. S. E. Atsuhiko Yatabe, ambassadeur du Japon en France, lui a remis le 14.06.1993 l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or en sautoir. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Nicolas Bataille, Français qui s'efforce de faire connaître la culture japonaise. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant.
Maurice Béjart (de son vrai nom Maurice-Jean Berger), né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 01.01.1927, à l'hôpital universitaire de Lausanne (Suisse) le 22.11.2007, fils du philosophe Gaston Berger. Ce chorégraphe de renommée internationale a effectué une tournée au Japon (avec le danseur étoile Patrick Dupond) et s'est vu décerné le Praemium Imperiale, grand prix artistique du Japon, en 1993, et le prix de Kyôto en 1999. L'empereur Hirohito l'avait déjà décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1986. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Normand Bernier, premier délégué du Québec à Tôkyô de septembre 1973 à août 1979, décoré de l'Ordre du Soleil levant.
Gustave Boissonade de Fontarabie, né à Vincennes (Val-de-Marne) le 07.06.1825, à Antibes (Alpes-Maritimes) le 27.06.1910, chargé en 1873 par le recteur de l'Académie de Paris d'enseigner le droit constitutionnel et criminel à des résidents japonais à Paris, embarqué pour le Japon en novembre de la même année, ministre du Japon en France de 1873 à 1895, engagé par contrat signé à Paris en juin 1873 pour "aider à la confection des lois et autres travaux réglementaires et consultatifs, comme légiste au service du gouvernement japonais", rédacteur du Code pénal et du Code de procédure criminelle du Japon de 1875 à 1880 puis, de 1881 à 1888, du premier Code civil japonais conçu en respectant la consigne de l'empereur ("Wakon Yôsai", "esprit du Japon, technique de l'Occident"), président honoraire de la société franco-japonaise fondée à Paris le 16 septembre 1900. Il a été décoré de Ordre du Soleil levant de 2e classe en 1876 puis de 1re classe avant son départ du Japon (premier étranger à recevoir cette éminente distinction). Pour une notice biographie plus détaillée, voir du même auteur "La Présence française au Japon".
Pierre Bourque, maire de Montréal (Canada), signataire d'un accord de jumelage entre Montréal et Hiroshima, directeur de 1980 à 1994 du jardin botanique où il fit créer un jardin et un pavillon japonais. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant le 19 novembre 2007.
Dominique Bussereau, né à Tours (Indre-et-Loire) le 13.07.1952, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales de juin 2005 à mai 2007, secrétaire d'État chargé des Transports. Il reçut de l'empereur Akihito dans son palais de Tôkyô, le 06.01.2007, le grand cordon de l'Ordre du Soleil levant pour avoir, dans les négociations de l'OMC relatives à l'agriculture, fait cause commune avec son homologue japonais. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Alan Farnsworth Campsay, Canadien, décoré de l'Ordre du Soleil levant, rayons d'or avec rosette en 1997.
Michel Carpentier, né le 23.10.1930, diplômé de H.E.C. et de l'É des études politiques de Paris, membre du Comité économique et social de 1995 à 1997, membre du conseil d'administration de l'IDATE (Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe), décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or en Sautoir.
Charles Chanoine, né à Dijon (Côte d'Or) le 18.12.1835, à Baudement (Marne) le 09.01.1915, commandant de la mission militaire française arrivée à Yokohama le 13 janvier 1867. Troisième classe de l'Ordre du Soleil levant (1878). Il sera ministre de la Guerre en 1898. Pour une notice biographie plus détaillée, voir du même auteur "La Présence française au Japon".
H. Chevalier, ingénieur civil, décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1889.
Léon Delacroix, né à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 27.12.1867, à Baden-Baden (Allemagne) le 15.10.1929, avocat à la Cour de Cassation en 1909, premier Premier ministre de Belgique, grand cordon de l'Ordre du Soleil levant.
Lamine Diack, footballeur sénégalais, président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (Aifa) depuis 1999 (réélu à Ôsaka le 18 décembre 2007), grand cordon de l'Ordre du Soleil levant le 5 novembre 2007.
Mahdi Elmandjra, né à Rabat (Maroc) en 1933, universitaire qui a occupé de hautes responsabilités au sein des Nations Unies. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1986.
Félix Évrard, né à La Maxe (Moselle) le 25.02.1844, le 05.04.1919 après une chute de rickshaw, missionnaire. Le ministre de la République française lui demanda de servir de secrétaire et d'interprète à la légation ce qui lui valut d'être décoré en 1882 de l'Ordre du Soleil levant. Pour une notice biographie plus détaillée, voir du même auteur "La Présence française au Japon".
Joseph Flaujac, né à Rodez (Aveyron) le 31.03.1886, au Japon le 12.12.1959, missionnaire, fondateur des établissements de l'uvre de Béthanie, en japonais "Jiseikai", répartis en quatre centres. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant. Pour une notice biographie plus détaillée, voir du même auteur "La Présence française au Japon".
Docteur Roderick D. Fraser, Canadien, décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or (avec ruban sautoir) en 2006.
François Gros, né le 24.04.1925, membre de l'Académie des Technologies, commandeur de l'Ordre du Soleil levant.
Robert Guillain, né le 04.09.1908, en 1998, journaliste, entré à l'agence Havas en 1934, envoyé en Chine en 1937 pour couvrir la guerre sino-japonaise, correspondant du journal "Le Monde" à Tôkyô avant-guerre, auteur de "Aventure Japon et de Geishas ou le monde des fleurs et des saules" (1997), président d'honneur et fondateur de l'Association de presse France-Japon. Il a été reçu à l'Institut franco-japonais de Tôkyô. Robert Guillain a été décoré en 1994, de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or en sautoir. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Ángel Gurría, né à Tampico (Mexique) le 08.05.1950, ministre des Finances et du Budget de janvier 1998 à décembre 2000, décoré de l'Ordre du Soleil levant.
Kintaro Hayakawa : v. Hayakawa Sessue.
John F. Howes, Canadien de Vancouver, auteur de la biographie de langue anglaise Japan's modern prophet: Uchimura Kanzô, 1861-1930, décoré de l'Ordre du Soleil levant en 2003.
Sid Kiyoshi Ikeda, Canadien d'origine japonaise, décoré de l'Ordre du Soleil levant en 2007.
Daniel Janssen, baron belge, né le 15.04.1936, ingénieur et scientifique. Il vint pour la première fois au Japon lors de l'exposition universelle d'Ôsaka et y donna une conférence sur "L'innovation technologique en Belgique et en Europe". Depuis cette époque, il multiplia les voyages dans ce pays et reçut, le 20.06.2006, des mains de l'ambassadeur du japon à Bruxelles, le grand cordon de l'Ordre du Soleil levant. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Jean-François Jarrige, membre de l'Académie et directeur du musée Guimet. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or en sautoir le 17.05.2006.
M° Donald J. Johnston, juriste canadien, président du Parti libéral du Canada, élu en 1994 secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, grand cordon de l'Ordre du Soleil levant en 2006.
Paul Gilbert Jean Ghislain Lacombe, né à Lille (Nord) le 09.07.1911, le 18.12.1997, ingénieur et chercheur, professeur de métallurgie à l'École des Mines, commandeur de l'Ordre du Soleil levant.
Gilbert Lancry, docteur en médecine, président de l'AMEXHA (Association des médecins en exercice à l'Hôpital américain). Il a effectué une quinzaine de séjours au Japon et lorsque des membres de la famille impériale japonaise ou de hautes personnalités du gouvernement séjournent en France, c'est à lui qu'on demande d'assumer la responsabilité de la permanence médicale. S. E. Atsuhiko Yatabe, ambassadeur du Japon en France, l'a décoré le 10.06.1993 de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or avec rosette. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Charles William Legendre, né à Oullins (Rhône) le 26.08.1830, à Séoul (Corée) le 01.09.1899, brigadier general de l'US Army, décoré de l'Ordre du Soleil levant de 2e classe en juillet 1874. V. du même auteur "La Présence française en Corée", p. 199).
Claude Lévi-Strauss, né à Bruxelles (Belgique) le 28.11.1908 de parents français, agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur au Collège de France, ethnologue auteur de "Tristes Tropiques" (1955), élu membre de l'Académie française le 24.05.1973, grand-croix de la Légion d'Honneur, reçu à l'Institut franco-japonais de Tôkyô. La plupart des ses uvres ont été traduites en japonais. Lors d'une conférence donnée à Tôkyô en 1986, il a affirmé que la plus haute ambition de l'anthropologie est d'inspirer aux individus et aux gouvernants une certaine sagesse. Le 26.05.1993, S. E. Atsuhiko Yatabe, ambassadeur du Japon en France, l'a décoré de l'Ordre du Soleil levant, étoile d'or et d'argent. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Jacques-Louis Lions (1928-2001), titulaire de la chaire d'analyse mathématique des systèmes et de leur contrôle au Collège de France, professeur à l'École Polytechnique, président de l'Académie des Sciences de 1996 à 1998, membre du Forum de dialogue franco-japonais en 1996, décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or et d'argent.
Dr Henry A. McKinnell, Canadien, grand cordon de l'Ordre du Soleil levant en 2007.
Raymond Moriyama, né à Vancouver (Canada), architecte établi à Toronto, élu président de la Brock University en 2001, décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or avec rosette en 2004.
Dr Ed. S. Morse (1838-1935), grand voyageur, professeur de zoologie à l'Université impériale de Tôkyô, premier Américain décoré de l'Ordre du Soleil levant.
Gustave Moynier, né à Genève (Suisse) le 21.09.1826, dans sa villa de Sécheron le 21.08.1910, président du Comité international de la Croix-Rouge en 1863, l'un des initiateurs de la Convention de Genève, grand officier de l'Ordre du Soleil levant le 01.04.1887.
Shun-ichiro Okano, né à Tôkyô le 28.08.1931, médaille de bronze de football aux J.P. de 1968, membre du Comité International Olympique depuis 1998, décoré de l'Ordre du Soleil levant (ruban avec raies d'or).
Hironori Otsuka, né le 01.06.1892, le 29.01.1982, professeur de karaté-do, décoré de l'Ordre du Soleil levant.
Philippe Pinchemel, né le 10.06.1923, géographe, président de la Société franco-japonaise de géographie, professeur émérite de l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'or en sautoir en 1994. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Antonin Raymond (1890-1976), architecte américain d'origine tchèque, ancien étudiant à l'École polytechnique de Prague. Après avoir participé avec Frank Llyod Wright en 1919 au projet du nouvel Hotel Imperial de Tôkyô, il reconstruisit l'ambassade de France après le tremblement de terre du Kantô qui ravagea Tôkyô et Yokohama en 1923. En 1926,
Antonin Raymond fut nommé consul honoraire de la République tchécoslovaque à Tôkyô. Cet architecte devint ami de Paul Claudel298. Le 21.04.1964, Antonin Raymond a reçu l'Ordre du Soleil levant des mains du vice-ministre des Affaires étrangères du Japon. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Marie Joseph Guy Henri de Riquet, prince de Chimay, prince de Caraman, ministre des Affaires étrangères de Belgique, grand cordon de l'Ordre du Soleil levant.
Hayakawa Sessue (de son vrai nom Kintaro Hayakawa), né à Nanaura (Japon) le 10.06.1889, à Tôkyô le 23.11.1973, acteur de cinéma et de théâtre, producteur, décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1966.
Isaac Stern, né à Kremenets, région de Ternopil (Ukraine) en 1920, à New York en 2001, violoniste américain, décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1997.
Docteur Hideo Tanaka, expert en matière d'élevage intensif de puces, directeur de la faculté de médecine d'Osaka. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil Levant en mars 1979.
Ernest Vieillard, né à Paris le 27.12.1844, le 08.12.1915, diplômé de l'École polytechnique en 1864 puis de l'école de l'application d'artillerie et du génie en 1866, capitaine d'artillerie. Il rejoignit en juin 1873 la seconde mission militaire française envoyée au Japon. Il y demeura jusqu'en 1876 et y dirigea l'instruction du corps du génie et l'école régimentaire. Officier de l'Ordre du Soleil levant. Il finira sa carrière militaire comme général de division, membre du comité consultatif d'état-major de février 1908 à décembre 1909. V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Étienne de Villaret, né au château de Floyras à Saint-Laurent Lolmie (Lot) le 17.02.1854, à Angers (Maine-et-Loire) le 18.01.1931, embarqué à San Francisco pour Yokohama en 1884. Arrivé au Japon en octobre 1884, il y demeura jusqu'en 1887 en qualité d'enseignant à l'Académie militaire (dès septembre 1885). À son retour en France, il publia Dai Nippon (Le Japon), étude historique et politique sur le Japon des origines à l'ère Meiji (avec la géographie et l'histoire du pays, l'écriture, les règles japonaises de conjugaison, les monnaies, la météorologie, la liste des mikados et des shoguns depuis 660 avant J.-C., les noms des gouverneurs par canton, l'armée, les garnisons, le nombre d'étrangers par nationalité et par sexe, les castes, l'évolution des mariages et des divorces, la pyramide des âges, les salaires, les productions, les temples et les prêtres). En 1892, il fit aussi paraître deux autres ouvrages, sur La Numismatique japonaise et, plus tard, sur les Sabres japonais, décrivant sa propre collection. Son Dictionnaire japonais-français des mots composés, en deux volumes, achevé en 1920, est resté à l'état de manuscrit. Poursuivant sa carrière militaire, il deviendra général de division et sera élevé à la dignité de grand-officier de la Légion d'Honneur. Il reçut aussi l'Ordre du Soleil levant (28.12.1886). V. du même auteur "La Présence française au Japon".
Andrzej Wajda, né à Suwalki (Pologne) le 06.03.1926, un des plus fameux metteurs en scène de cinéma. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil levant en 1995.
Hisato Yoshimura, président de la faculté de médecine de Kyotô, conseiller de l'expédition antarctique Japonaise, et président de la Société météorologique, décoré de l'Ordre du Soleil levant de 3e classe. Puis il sera président de l'université féminine de Kôbe.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
L'Ordre du Trésor sacré (Japon) 88 autres titulaires
En complément du précédent article sur des Français décorés de l'Ordre impérial japonais du Trésor sacré, voici 88 autres récipiendaires (de toutes nationalités) de cette haute distinction japonaise.Otto Abetz, né à Schwetzingen (Allemagne) le 26 mai 1903, d'un accident de voiture à Langenfeld près de Dortmund (Allemagne) le 5 mai 1958, ambassadeur d'Allemagne auprès du gouvernement de Vichy, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Kiheiji Amamiya, président de la société Atago, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or et d'argent en avril 1984.Charles Appolinaire Baltet, né à Troyes (Aube) le 14 janvier 1830, en 1908, fameux horticulteur. En 1876-1877, il accueillit en stage deux Japonais envoyés par le ministère nippon de l'Agriculture pour apprendre la culture et la taille de la vigne. Ils repartirent avec des plants à partir desquels ils développèrent à Katsumuma le "crû de Troyes". Balter a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Herbert W. Armstrong, né à Des Moines (Iowa, U.S.A.) le 31 juillet 1892, à Pasadena (Californie, U.S.A.) le 16 janvier 1986, fondateur d'une église évangélique et, plus tard, de l'Ambassador College, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (2e classe).Jackson H. Bailey, né à Portland (Maine, U.S.A.) en 1925, le 2 août 1996, diplômé de l'Université de Harvard, universitaire spécialiste de l'histoire du Japon, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Tristan E. Beplat, banquier qui aida financièrement le Japon après la seconde Guerre mondiale. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Guido Biscaretti, comte de Ruffia, né le 28 octobre 1867, le 21 octobre 1946, amiral d'escadre italien, commandeur de l'Ordre du Trésor sacré.Alice Bolduc, Canadienne, décorée de l'Ordre du Trésor sacré en 1999.Daniel J. Boorstin, né à Atlanta le 1er octobre 1914, à Washington le 28 février 2004, historien, bibliothécaire du Congrès américain de 1975 à 1987, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Faubion Bowers, né à Miami (Floride, U.S.A.) le 29 janvier 1917, à New York City le 17 novembre 1999, diplômé de l'Université de Columbia, aide de camp et traducteur officiel de japonais pour le général Mac Arthur pendant l'occupation américaine du Japon. Défenseur du kabuki dans le Japon occupé, il fut décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Klaus Bungert, Oberbürgermeister de Dusseldorf (Allemagne), décoré de l'Ordre du Trésor sacré le 17 juin 1994.Jules Chanoine, né à Dijon (Côte d'Or) en 1935, à Baudement (Marne) en 1915, général, décoré de l'Ordre du Trésor sacré de 1re classe. V. du même auteur "La Présence française au Japon".Hilda Chen Apuy, née à Puntareras (Costa-Rica) le 23 janvier 1923, fille d'un père chinois et d'une mère costaricienne. Universitaire spécialiste de l'Asie, décorée de l'Ordre du Trésor sacré (première Latino-Américaine décorée par le gouvernement japonais).Ramsay Cook, né en Saskatchewan, titulaire d'un doctorat de l'Université de Toronto (1960), directeur général du Dictionnaire biographique du Canada (DBC), professeur auxiliaire d'histoire à l'Université de Toronto et professeur émérite d'histoire à l'Université d'York, à Toronto, membre de la Société royale du Canada. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1994.David Culver, né à Winnipeg (Canada) le 5 décembre 1924, bachelier en sciences de l'Université McGill, MBA de l'Université d'Harvard, titulaire d'un certificat du Centre d'études industrielles de Genève (Suisse), successivement président du Conseil canadien des chefs d'entreprises, président et chef de la direction d'Alcan Aluminium Itée, membre du Conseil consultatif de l'INM (Institut et hôpital neurologiques de Montréal, Université McGill). Grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré.Eliezer Baptista Da Silva, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Dorothy DeLay, née à Medecine Lodge (Kansas, U.S.A.) le 31 mars 1917, le 24 mars 2002, professeur de violon, décorée de l'Ordre du Trésor sacré.W. Edwards Deming, né à Sioux City (Iowa, U.S.A.) le 14 octobre 1900, à Washington D.C. le 20 octobre 1993, statisticien, universitaire, auteur. Il participa au recensement des habitants du Japon en 1951. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (2e classe) en 1960.Mamadou Diarra, né à Thiès (Sénégal) le 5 juin 1948, conseiller économique et financier à l'ambassade du Sénégal à Tôkyô de 1987 à 1991, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons de soleil, en 1988.Milton Friedman, né à Brooklyn (U.S.A.) le 31 juillet 1912, d'une crise cardiaque à San Francisco le 16.11.2006, économiste. Grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré.Anton Geesink, né à Utrecht (Pays-Bas) le 6 avril 1934, instructeur à l'Académie royale militaire de Breda, professeur et entraîneur national et international de judo, médaille d'or aux J.O. de Tôkyô (1964), champion du monde de judo (1961, 1964, 1965). Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré avec rais d'or.Samuel A. Goldlith, né à Lawrence (Massachusetts, U.S.A.) le 5 mai 1919, à Peabody (Massachusetts, U.S.A.) le 28 décembre 2001 (fils d'un émigré russe), spécialiste de la nutrition, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (2e classe).Douglas Greenwald, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Willem Grootaers. Ayant dû fuir en 1948 la Chine où il résidait depuis 1939, il continua à travailler comme linguiste en Extrême-Orient. Commandeur de l'Ordre du Trésor Sacré. Tadashige Habe (1917-2002), président de la Japanese Malacological Society Society de 1979 à 1995, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1986.John Whitney Hall, né le 13 septembre 1916, le 21 octobre 1997 (fils de missionnaires américains), historien spécialiste du Japon, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Daniel Hays, né à Calgary (Alberta, Canada) le 24 avril 1939, nommé sénateur le 29 juin 1984. Il s'était rendu pour la première fois au Japon en 1970 pour promouvoir l'exportation des moutons de race au Canada. Séduit par l'empire du Soleil levant, il devint président du groupe interparlementaire Canada-Japon. L'empereur du Japon lui a remis le grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré le 29 avril 2000.Georg Heer, né à Striegau le 13 novembre 1849, à Wilna le 26 octobre 1924, lieutenant-général, instructeur d'artillerie de Jüterborg où il a formé de nombreux jeunes officiers japonais venus se former dans l'armée prussienne. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (4e classe).Heinrich Hertz, né à Hambourg (Allemagne) le 22 février 1857, le 1er janvier 1894 (fils de Gustav Ferdinand Hertz, avocat, et d'Anna Elisabeth Pfefferkorn), professeur de physique, inventeur d'un oscillateur produisant des ondes électromagnétiques et du télégraphe sans fil, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Fumiko Higashiyama, née à Hiroshima en 1910, présidente de la firme de cosmétiques médicaux Sansho Co Ltd. (qu'elle a voulu créer pour soigner les séquelles cutanées de la bombe d'Hiroshima dont elle eut elle-même à souffrir), décorée de l'Ordre du Trésor sacré en 1984.Friedrich Hirzebruch, né à Hamm (Westphalie, Allemagne) le 17 octobre 1927, mathématicien, professeur assistant à l'Université de Princeton (U.S.A.), décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or et d'argent, en 1996.Masura Ibuka, né à Nikkô (Japon) le 11 avril 1908, à Tôkyô le 19.12.1997, industriel de l'électronique, inventeur, cofondateur de Sony Corporation, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Akira Ifukube, né à Kushiro (Hokkaïdô) le 31 mai 1914, à Tôkyô le 8 février 2006, compositeur de musique classique et de musique de films (série des Godzilla, etc.), décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Roy Hisashi Inouye, Canadien, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or avec rosette en 2002.Marcel Junod (Dr), né à Neuchâtel (Suisse) le 14 mai 1904, décédé d'une crise cardiaque le 16 juin 1961, fils de Richard Samuel Junod (1868-1919), pasteur, et de Jeanne Marguerite Bonnet (1866-1952), médecin anesthésiste, arrivé au Japon le 9 septembre 1945 en qualité de chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Il se rendit à Hiroshima pour voir les effets de la bombe atomique, soigna des blessés et, pendant cinq jours, distribua quinze tonnes de matériel obtenu de l'état-major allié. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré à titre posthume en 1961. Le journaliste Y. Ohsako a publié sa biographie sous le titre Valiant without arms; the Life and Personality of Dr. Marcel Junod, Tokyo 1979, 209 p.Fukoyoshi Kanai, décoré de l'Ordre du trésor sacré (6e classe).Otsuma Kotaka, né à Kawashiri (préfecture de Hiroshima) le 21 juin 1884, le 3 janvier 1970, un des pionniers de l'éducation des femmes au Japon en leur ouvrant largement les universités, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Fujitaro Kubota, originaire de la préfecture de Koshi (Shikoku), émigré à San Francisco (U.S.A.), créateur d'un parc public, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (5e classe).Kume Kunikate, né le 19 août 1839, le 29 février 1931, historien, professeur à l'Université impériale de Tôkyô, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1889.Tokubei Kuroda, né à Fukurea (Awaji-shima, Japon) en 1886, le 15.05.1987, malacologue éminent, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1939.Tetsuko Kuroyanagi, née à Tôkyô, actrice de télévision très populaire, conseillère auprès du World Wild Fund for Nature au Japon, ambassadrice itinérante de l'UNICEF pour l'Asie depuis 1984. Elle a été décorée de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or avec sautoir, le 12 mai 2003.Philippe Marie Joseph François Alain, comte de Lannoy et du Saint-Empire romain, né à Bruxelles le 23 avril 1866, décédé à Anwaing (Belgique) le 9 mars 1937, grand maréchal honoraire de la Cour du roi Albert 1er de 1929 à 1934, grand-croix de l'Ordre du Trésor sacré.Gerhard Lüke, né à Hildesheim (Basse-Saxe, Allemagne) le 21 février 1927, universitaire, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or, en 1991.Maruyama Masao, né à Ôsaka le 22 mars 1914, à Tôkyô le 15 août 1996, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe) en 1976.James McNaughton Hester, né à Chester (Pennsylvanie, U.S.A.) le 19 avril 1924, officier traducteur de japonais, premier recteur de l'Université des Nations Unies en 1974, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Kokichi Mikimoto, né à Toba (préfecture actuelle de Mie) le 10 mars 1858, le 21 septembre 1954, inventeur de la production commerciale de perles de culture, grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré.Akio Morita, né à Tokoname le 26 janvier 1921, à Tôkyô le 3 octobre 1999, cofondateur de Sony Corporation, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (1re classe).Genzô Murakami, né en Corée (alors occupée par le Japon) le 14 mars 1910, à Tôkyô le 3 avril 2006, fameux nouvelliste, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe) en 1981.Masahiko Nakano, membre de la Présidence de l'IRU et président de la Japan Trucking Association (JTA) - décoré de l'Ordre du Trésor sacré avec ruban à rayures d'or, par sa Majesté, l'empereur Akihito en personne (11 novembre 2002).Isamu Nogushi, né à Los Angeles (Californie, U.S.A.) le 17 novembre 1904, à New York le 30.12.1988, sculpteur et architecte paysagiste, décoré du 3e Ordre du Trésor sacré en 1988.Thomas Nogushi, né au Japon le 4 janvier 1927, médecin légiste et procureur du comté de Los Angeles (U.S.A.) de 1967 à 1982. Il se rendit célèbre en pratiquant les autopsies de Marylin Monroe et de Robert F. Kennedy. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe) en 1999.Junnosuke Ofusa, journaliste, directeur de Times à Tôkyô, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (4e classe).Frank Okamura, spécialiste des bonsais, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.J. Olivier, directeur technique des Laboratoires Pierre Fabre, décoré de l'Ordre du Trésor sacré avec rayons d'or en sautoir.Lawrence Olson, né le 7 mai 1918, à Washington le 17 mars 1992, historien spécialiste de l'histoire du Japon, professeur d'histoire à l'Université Wesleyan, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Jean-Jacques Origas, le 26 janvier 2003, maître de conférences à l'Institut des langues et civilisations orientales, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1998. V. du même auteur "La Présence française au Japon".Masunori Ôseki, né le 28 janvier 1849, le 9 août 1905, samouraï, créé vicomte, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Comte Maurice de Patoul, né à Mons (Belgique) le 3 novembre 1875, à Bruxelles le 20 octobre 1965, maréchal honoraire de la Cour du roi Albert 1er de 1909 à 1934, grand officier de l'Ordre du Trésor sacré.Hugh Patrick, professeur de commerce international, spécialiste de l'économie japonaise et des échanges américano-japonais, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (2e classe).Richard W. Pound, Canadien décoré de l'Ordre du Trésor sacré, étoile d'or et d'argent, en 1998.Leonard Pronko, professeur de théâtre, le premier non-Japonais qui étudia le kabuki. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Jean-Claude Redonnet, agrégé des universités, docteur de IIIe cycle, Conseiller culturel et scientifique, Ambassade de France en Australie, Conseiller culturel, Ambassade de France au Canada, Ambassade de France au Japon, Recteur de l'Université Senghor (Développement africain) Alexandrie, Egypte. Directeur de l'Ecole française, Middlebury College, EU., commandeur de l'Ordre du Trésor sacré.Eric Gascoigne Robinson, né à Greenwich (Grande-Bretagne) le 16 mai 1882, à Gosport (Grande-Bretagne) le 20 août 1965, commandant adjoint lors de la campagne de Gallipoli pendant la première Guerre mondiale. Il finit sa carrière avec le grade d'amiral. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Renato Ruggiero, né à Naples (Italie) le 9 avril 1930, directeur général de l'O.M.C. de 1995 à 1999, grand-croix de l'Ordre du Trésor sacré.Tadahiro Sakimoto, né à Hyôgo le 14 novembre 1926, le 11 novembre 2007, ingénieur en électronique, président de la NEC Corporation, grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré.Sakip Sananci, né à Kayseri dans le village d'Akçakaya (Turquie) en 1933, le 10.04.2004, un des plus grands hommes d'affaires de la Turquie. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (étoile d'or et d'argent) en 1992.Franz Seitelberger, né à Vienne (Autriche) le 4 décembre 1916, le 5 novembre 2007, professeur de neurologie et de psychiatrie, recteur de l'Université de Vienne de 1975 à 1977, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or et d'argent, en 1989.Henry Shibata, professeur de chirurgie et d'oncologie, durecteur du service d'oncologie de l'Hôpital Royal Victoria (HRV) au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré avec rais d'or et rosette en 2007.Carl S. Shoup (1902-2000), professeur d'économie à l'Université Columbia, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Thomas K. Shoyama, né à Kamloops (Colombie britannique, Canada) en 1916, en décembre 2006, sous-ministre des Finances du Canada de 1975 à 1979. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1992 pour sa contribution à la communauté nippo-canadienne.René Sieffert, fondateur et directeur des Presses orientalistes de France, président de la Société franco-japonaise de 1981 à 1990, décoré du 3e degré de l'Ordre du Trésor sacré. V. du même auteur "La Présence française au Japon".Sergio Silva do Amaral, né à São Paulo (Brésil) le 1er juin 1944, professeur assistant au département des Sciences politiques et des Relations internationales de l'Université de Brasilia (Brésil) de 1981 à 1999, ambassadeur du Brésil à Londres en 1999-2000, ministre d'État du Développement de l'Industrie et du Commerce extérieur en 2001-2002, ambassadeur du Brésil et représentant du Brésil auprès de l'OCDE en 2003-2005, grand-croix de l'Ordre du Trésor sacré en 1996. Gunther Sohl, industriel allemand, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1998.Elisabeth Süpke, née en Allemagne en 1916, le 8 février 1998, président de la Société germano-japonaise à Lünebourg depuis 1971, décorée de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or, le 29 avril 1997.Kenjiro Takayanagi, né le 20 janvier 1899, le 23 juillet 1990, un des pionniers de la télévision, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Herbert Cyril Thacker, né à Poona (Inde) en 1870, à Victoria (Colombie britannique, Canada) en 1953, chef de l'état-major du Canada de 1927 à 1929, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Masaho Takahashi, Canadien, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or avec rosette en 2002.Samba Tall, membre du service culturel de l'ambassade du Japon au Sénégal (assistant de madame Mika Hira) depuis 1971, décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 2005.Mifune Toshiro, né le 1er avril 1920, le 24 décembre 1997, acteur de cinéma, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (ruban d'or) en 1993.Charles Egbert Tuttle, né le 5 avril 1915, le 9 juin 1993, éditeur implanté aux U.S.A. et au Japon. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré en 1983.Morihei Ueshiba, né à Tanabe (préfecture de Wakayama, Japon) le 14 décembre 1883, le 26 avril 1969, fondateur de l'aïkido. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré à titre posthume pour avoir répandu l'aïkido dans le monde.Carl Hermann Ule, né à Stettin le 26 février 1907, le 16 mai 1999, professeur de droit, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or et d'argent, en 1988.Yosh Ushida, né en 1920, homme d'affaires américain, décoré de l'Ordre du Trésor sacré avec rayons d'or en 1986.Dayasiri Warnakulasooriya, président de l'association de l'enseignement du japonais au Sri Lanka et directeur du groupe de compagnies Midaya dans son pays, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or avec rosette, le 8 juillet 1996.Eugene P. "Dennis" Wilkinson, né à Long Beach (Californie, U.S.A.) en 1918, premier commandant de l'USS Nautilus, le premier sous-marin nucléaire. Il prit sa retraite avec le grade de vice-amiral. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré (2e classe).Eiji Yoshikawa, né le 11 août 1892, le 7 septembre 1962, nouvelliste, décoré de l'Ordre du Trésor sacré.Kenchichi Yoshizawa, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Chine en 1925, membre de la première classe de l'Ordre impérial du Trésor sacré.Arthur Young (sir), né à Eastleigh (Grande-Bretagne) le 15 février 1907, colonel, commissaire principal de la ville de Londres de 1950 à 1971, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe).Herbert Zachert, né à Berlin (Allemagne) le 28 avril 1908, le 11 novembre 1979, professeur de japonologie, décoré de l'Ordre du Trésor sacré (3e classe) en 1976.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Médecins français collectionneurs à l'époque du japonisme
Ces noms dont tirés des catalogues de vente de l'hôtel Drouot à Paris vers 1910-1930
Docteur ANCELET
Docteur Jean-Marc ANDRÉ
Docteur Edmond FOURNIER
Docteur Louis FRICOTELLE
Docteur Émile JAVAL (1839-1907), ingénieur des mines et ophtalmologiste, père de l'orthoptique, député de l'Yonne
Docteur Édouard MENE, collectionneur d'armes
Docteur Jacques MILLOT
Docteur P. J. MOURIER qui résida au Japon dès 1864. Il réunit une bibliothèque éclectique.
Docteur Francis PONCETTON (1877-1950), collectionneur de tsuba (gardes de sabres)
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Henri Bouchot (1849-1906), sa famille et son uvre
En 1941, comme presque toutes les statues de bronze de Besançon, le buste de Bouchot a été fondu par les Allemands à des fins militaires. Le moulage, réalisé par la municipalité, permit au sculpteur Saupique, gendre de Bouchot, d'en réaliser une copie en pierre inaugurée après-guerre, le 26 mai 1946. C'est elle qu'on peut voir actuellement au square Bouchot. Sur le piédestal subsistent les points d'attache de la palme arrachée par des inconnus.
Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), 5e fils du roi Louis-Philippe, grand amateur d'art, avait réuni une impressionnante collection de dessins dont les portraits de Madame de Duras, de Charles de Lorraine, d'Élisabeth d'Espagne (fille de Henri II), de François d'Alençon, du cardinal Philibert de la Bourdaisière, etc. En 1876, il acheta la collection du duc de Sutherland, comprenant 148 dessins. Puis il apprit que George James Howard, 9e comte de Carlisle, était prêt à vendre la collection des comtes Carlisle, conservée au Howard Castle. Pour préparer cette acquisition, le duc d'Aumale vint à plusieurs reprises à la Bibliothèque Nationale en septembre et octobre 1889 afin de consulter Georges Duplessis, conservateur du Cabinet des estampes, et Henri Bouchot, auteur du catalogue de la collection de crayons du Cabinet.
C'est Bouchot qui fut chargé des négociations ; il partit pour l'Angleterre, et fut aussitôt conquis par la beauté des dessins. Son enthousiasme décida le duc d'Aumale à en faire l'acquisition, malgré le prix de 190 000 francs, jugé prohibitif pour l'époque. Finalement, l'acquisition fut effectuée dans la première quinzaine de décembre et Bouchot fut chargé de ramener les dessins de Londres. Le 27 décembre, le duc d'Aumale reçut à Chantilly Léon Bonnat, Henri Bouchot et plusieurs amateurs d'art ; l'enthousiasme était général, et le duc ne cacha pas sa très vive satisfaction.
C'est suite à cette importante acquisition que le musée Condé de Châtillon possède de nos jours la plus importante collection de portraits au crayon du 16e siècle au monde : 366 dessins attribués pour la plupart à Jean Clouet (v. 1485-Paris 1540/1541) et à François Clouet (v. 1510/1515-Paris 1572), son fils. Le duc d'Aumale avait en effet légué sa collection de dessins et toutes ses autres collections à l'Institut de France.
uvres de Henri Bouchot :
AArmorial général de France - Généralité de Bourgogne, Dijon, Imprimerie Darantière, 1875-1876, 2 vol., in-8, VIII-322 p. et VIII-289 p. (publication de l'Armorial général de Charles d'Hozier). Armorial général de France - Franche-Comté, Dijon, Imprimerie Darantière, 1875, in-8, VIII-267 p. (publication de l'Armorial général de Charles d'Hozier). Le Luxe français - L'Empire. Illustration documentaire d'après les originaux de l'époque, Paris, La Librairie illustrée, 1880, grand in-8, III-214 p., 93 gravures in et h.-t.Les sept discours touchant les dames galantes du sieur de Brantôme publiés sur les manuscrits de la bibliothèque nationale par Henri Bouchot, Paris, éd. Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 1882, 3 vol. in-12, XII + 248 p., 263 p., 314 p., réédité Paris, E. Flammarion s.d., (v. 1925), XVI + 408 p + 416 p, avec eaux-fortes (10 dessins d'Ed. de Beaumont gravés par Boilvin et un portrait de Brantôme en frontispice).Portraits au crayon des 16e et 17e siècles conservés à la Bibliothèque nationale (1525-1646), Paris, 1884.Le livre, l'illustration, la reliure, étude historique sommaire, Paris, éd. Quantin, collection "Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts", 1886, in-8, 320 p., illustr., traduit en anglais sous le titre The book : its printers, illustrators and binders, from Gutenberg to the present time, London, H. Grevel and Co., 1890; réédition Detroit (U.S.A.), Gale Research Company, 1971, XVI-384 p.Dictionnaire des Marques et Monogrammes des graveurs (écrit avec Georges Duplessis), Paris, 1886-1887, in-12, 3 vol., nombreuses figures.Murs et coutumes de la France, 1887.Contes franc-comtois, 1887, 378 p., rééd. Lons-le-Saunier, Impr. J. Mayet & Cie, Édition du comité Bouchot, 1907, in-12, illustrations de Coindre, Edelfeldt, Enders, Friant, Mathey-Doret [Ouvrage couronné par l'Académie française]. Réédition aux éditions du Bastion en 2000.L'uvre de Gutenberg, Paris, éd. H. Lecene et H. Oudin, 1889, 240 p., nombreuses illustrations.Les reliures d'art à la Bibliothèque nationale, Paris, éd. Édouard Rouveyre, 1888 [ouvrage dédié à Duplessis, directeur de Henri Bouchot à la B. N.].La Franche-Comté, Paris, éd. Plon, 1890 (illustrée par Eugène Sadoux). Réédition en 1995 par La Tour Gile.Inventaire des dessins exécutés par Roger de Gaignières et conservés aux départements des estampes et des manuscrits [de la Bibliothèque Nationale], Paris, 1891 [François-Roger de Gaignières, né à Entrain-sur-Nohain en (Nièvre) le 30 décembre 1642, à Paris le 27 mars 1715, écuyer du duc de Guise en 1671, gouverneur des château, ville et principauté de Joinville, fils de Aimé de Gaignières, secrétaire puis intendant du duc d'Harcourt, et de Jacqueline de Blanchefort mariés en 1642. Il a amassé une importante collection : des centaines de manuscrits, des milliers d'estampes et de dessins, des tableaux, 3000 livres, des médailles, des jetons, deux globes de Coronelli et des porcelaines. François-Roger de Gaignières donna l'intégralité de sa collection à Louis XIV le 19 février 1711. Le titre choisi par Bouchot pour cet Inventaire semble donc mal choisi : il ne s'agit pas des dessins exécutés par Roger de Gaignières mais des dessins qu'il a collectionnés puis offert à la couronne].Les Livres à vignettes XVe au XIXe siècle. T. I - Du XVe au XVIIIe siècle ; T. II - Du classique et du romantique, le livre à vignettes sous Louis-Philippe, sous le Second Empire et de 1870 à 1880, Paris, éd. Édouard Rouveyre, 1891, 2 vol., 94 et 102 p.Des livres modernes qu'il convient d'acquérir - L'art et l'engouement - La bibliophilie contemporaine - Les procédés de décoration, Paris, Paris, éd. Édouard Rouveyre, "Bibliothèque des Connaissances Utiles aux Amis des Livres", 1891.Les Ex-libris et les Marques de possession du livre, Paris, "Bibliothèque des Connaissances Utiles aux Amis des Livres", 1891.Histoire anecdotique des métiers avant 1789, Paris-Poitiers, 1892, 192 p., 27 gravures [Métiers de luxe (libraires, ménestrels, orfèvres...) - Métiers de relations (médecins, dentistes, domestiques ) - Métiers d'alimentation (boulangers, poissonniers, fruitiers, cuisiniers...) - Métiers du vêtement (tisserands, cordonniers, gantiers, dentelliers ) - Métiers du fer (armuriers, horlogers, forgerons...) - Métiers du bâtiment ou du meuble (architectes, charpentiers, menuisiers )]. L'ouvrage a été réédité récemment en 1991 (224 p.) dans la collection "La France pittoresque").Les élégances du Second Empire, Paris, La Librairie Illustrée, s.d., in-12, XVII-253 pp., 48 photo. h.-t.La Lithographie, Paris, éd. Alcide Picard et Kaan, 1895, 296 p.La Toilette à la cour de Napoléon : chiffons et politique de grandes dames, 1810-1815, Paris, Librairie illustrée, in-8, XII-267 p.Le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Guide du lecteur et du visiteur, catalogue général et raisonné des collections qui y sont conservées, Paris, éd. Dentu, 1896, in-12, XXIV-392 p. [détail des corps de métiers "dont on a pu retrouver des représentations depuis le XIIème jusqu'au XIXème" dans l'Encyclopédie méthodique. Dans cet ouvrage, Henri Bouchot décrivit ce qu'est l'enfer de la Bibliothèque nationale : le nom d'Enfer, employé ordinairement, sert en réalité à couvrir une marchandise peu curieuse en soi, le plus souvent idiotement obscène].M. Georges Duplessis 1834-1899, s.l.n.d. (vers 1899), portrait gravé de Duplessis par Jean Gruyer en regard de la première page. Souvenirs sur Duplessis par son adjoint au Cabinet des Estampes.Exposition des Primitifs français au Palais du Louvre (Pavillon de Marsan) et à la Bibliothèque nationale - Catalogue [Henri Bouchot avait été le commissaire de l'exposition des Primitifs français qui se tint au musée du Louvre du 27 février au 17 mai 1904. Cette exposition allait du portrait de Jean le Bon (conservé aujourd'hui au musée du Louvre) à un tableau daté de 1604, donc débordant nettement la période qui englobe traditionnellement les primitifs, c'est-à-dire les 14e et 15e siècles].La Convention, Paris, Société française d'éditions d'art, s. d. (début 20e siècle) [Dans cet ouvrage d'Alexandre Bérard (1859-1923), magistrat et historien, député radical, Henri Bouchot a écrit un chapitre sur la société parisienne et la mode].La Miniature française de 1750 à 1825, Paris, éd. Goupil, 1907.Il préfaça aussi La Crèche drame populaire en patois de Besançon tel qu'il fut joué en 1873... de Louis Androt [Lons-le-Saunier, J. Mayet], 1889, 70 feuillets imprimés recto
Henri Bouchot fut en outre directeur de la Revue franc-comtoise.
Il épousa Joséphine Chevalier (domiciliée à Paris, 3, rue d'Alençon, en 1932) qui lui donna :- Jean Henri Joseph Marie Bouchot, né à Paris 6e le 29 juin 1886, à Besançon (Doubs) 23, avenue de Fontaine-Argent, le 6 mai 1932, ancien élève de l'École nationale des Chartes, conservateur des musées et notamment de celui de Besançon en 1931-1932, élu membre de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon en 1930 (son discours de réception porta sur "Henri Mouhot et la découverte d'Angkor", vol. 159 (1931), p. 173-198). Son décès a été déclaré par Paul Grosrichard, pharmacien, chevalier de la Légion d'Honneur, domicilié à Besançon, 12, place de la Révolution. Son éloge funèbre a été rédigé par Eugène Ledoux (Procès-verbaux et Mémoires de l'Académie, vol. 160 (1932), p. 136-140). Coauteur avec Henri Cucherousset de Notes japonaises : le pays des frais épis de la luxuriante plaine des roseaux, Hanoi, éd. de l'Éveil Économique de l'Indochine, 1925, in-4, 90 p. Il épousa Germaine Léontine Gervais demeurant à Besançon 7, rue du Docteur Hyenne, lors du décès de son mari.- Jacqueline Marie Louise Joséphine Bouchot, née à Paris 6e le 20 juin 1893, à Saint-Ylie (Dole, Jura) le 3 février 1975, domiciliée à Paris 105, rue Notre-Dame des Champs, épouse du sculpteur Georges Laurent Saupique (1889-1961). Elle fut professeure à l'École du Louvre, conservatrice en chef au cabinet des dessins du Louvre, membre associée correspondante de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon depuis 1925. On lui doit notamment Les Dessins de Watteau, collection "Bibliothèque Aldine des Arts", F. Hazan, 1953 (plaquette petit in-12).
Dr Jean-Marie Thiébaud Copyright 2007
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Église de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) Terrier et rentier de la chapelle de la Vraie Croix (1498-1563)
Parmi les nombreuses chapelles de cette ancienne église, une était placée sous le vocable de la Vraie Croix. Fondée à la fin du 15e siècle par Guillaume de Coeuve, issue d'une famille noble originaire de la principauté de Bâle, elle a donné naissance à une confrérie qui a subsisté pendant plusieurs siècles. Le terrier et rentier de cette chapelle appartient aux archives de l'auteur qui en doute ci-dessous la transcription in extenso.
Église de Chaux-les-Châtillon, chapelle de la Vraie Croix (1498-1563)
Les censes et rentes provenant de la chappelle Fondée en l'église Monsr Sainct Ligier de Chaulxsoubz maiches1 en l'honneur de la vraye croixappartenant à messire Guillame de Queuve2, religieux del'église et monastère Sainct Pierre de Luxeu3Description des terres et rentesacquises par feu messire JehanDagney en la seignorie de Chastillon4pour la fondation de la chappellepar luy fondée en l'église MonsrSainct Ligier de Chaulx soubs maicheen l'honneur de la vraye croix.Et premièrementLes meix chesaulx cloz vergiers curtilz chenevièresterre arrible et aultres choses acquises de PetitJehan Drapelotz, Girard et Vuillemin Drappelotz sesenffants d'Orve les Belvoir5 pour le prix et somme de quattre vingt libvres est(evenantes) commeappert par les lectres d'acquisitions faicteset passées en date du dix neufvième jour de janvierde l'an mil cinq cens et deux reçues par J.Folpoy commenceant Nous Petit Jehan Drappelots,d'Orve, Girard et Vuillemin, fils dudit Petit Jehan,finissant Huguenin Choignard le Jeune de Corcelles6et Vuillemin Bailletz, de Neufvye7 tesmoings adce appeléset especialement requis.Item les terres de Jehan Falotz le Vieulxde Fleurey8, et Jehan Fallotz le Jeune, frères,séans au territoire dud. Lieu et seignorie deChastillon pour le prix et somme de quarantehuict francs et demi comme appert par les lettresd'achat commenceans par Jehan Falots le Viez de Fleurey et Jehan Falotz le Jeunefrères, et finissant par Jehan Gaulthier de la VilleSoubz le Mont9 et Huguenin Doby, de Corcelles, tesmoingsadce appelés et requis en date du XXVe en febvrierl'an mil cinq cens et deux signé de C. Folpoy10.Item quarante cinq solz esteven(ants) de cense que luydoibvent chacun an Huguenin Nivel et Jehan Nivelson filz le jour d'une chacune feste SainctMartin d'iver comme appert par les lettresd'acquisitions surce faictes et reçues par J.Dauxiron11.Item le chesaul prelz cloz curtilz chenevièreset aultres héritaiges acquis de Girard etPierre dict Villeret de Vauclusatte12 pour leprix et somme de quarante cinq francscomme appert par les lettres d'achat datéesdu tiers jour du mois d'aoust mil quattre censnonante et neufz commenceans Nous Girardet Pierre dict Vuillerey et finissant HugueninEschappe de Sainct Ypolite et Huguenin Darsotde Montando(n)13 et du Recepveur de Bel lieu14,tesmoings et signés. C. Folpoy.Item les terres prelz cloz oiches curtilzchenevières que aultres héritaiges acquis deJehan Peletier, de Vauclusatte15, et PierreChevoillet, son gendre, pour la somme de vingtet ung francs et demy comme appert par leslettres dud. achat en datte du quatrième jourdu mois de may l'an mil cinq cens et ungcommenceant Nous Jehan Peletier, deVauclusatte, et Pierre Chevoillet et finissantGirard Sorcier dudit lieu et Nicolas Bourquenotz,de Fleurey, tesmoings adce appelés.Signé C. Folpoy.Item deux pièces de terre acquisesdudit Jehan Peletier pour le prix etsomme de cinq francs quattre groz cinqengroingnes16 monnaie, comme appert par les lectresdud. achapt en datte du VIIe de may l'an milcinq cens et douze commenceans Je JehanPeletier, de Vauclusotte et finissant messireHugues Doyen, pbre (prêtre), Pierre Lambert etHuguenin Vuilley, tesmoings adce appelés etSigné J. Dauxiron.Item les terres, cloux (clos), maisons, prelz, jardins et aultreshéritaiges acquis de Guillame et Jehan Boichot,de Vauclusatte, frères, pour la somme de vingtfrancs comme appert par les lectres desd.acquisitions surce faictes en datte du XVIeen febvrier mil cinq cens et deux commenceantNous Guillame et Jehan Boichot, et finissant Girard Virot et Didier Boiteuxde Valeroilles17, tesmoings adce appelés etsignées de C. Folpoy.Item les terres prelz cloux curtilzchenevières et aultres héritaiges acquisde Estienne et Jehan Peletier, de Vauclusatte,frères, pour la somme de douze libvres est(evenantes) commeappert par les lectres d'achat surce faictesen datte du premier jour de juing mil cinqcens et unze commenceant Nous Estienneet Jehan Peletier, de Vauclusotte, frères, etfinissant Richard Grozgirard, de Charmoille18,et Jehan, son filz, tesmoings adce appelez. Signéespar C. Folpoy.Item encore aultres terres acquises duditEstienne Peletier manans de laseignorie de Chastillon pour la sommede sept francs deulx groz comme appert parles lectres d'achat surce faictes endatte du VIIe en may l'an mil cinq censet douze commenceant Je Estienne Peletieret finissant messire Hugues Doyen, pbre (prêtre),Pierre Lambert et Huguenin Vielley, tesmoingsadce appelez, signé J. Dauxiron.Item deux pièces de terre acquises de Nicole,vefve (veuve) de feu Petit Jehan Colard, de Court19, etThiébauld Colard, filz de lad. Nicole pour lasomme de seize frans comme appert par leslectres surce faictes en date du VIIe en apvrill'an mil cinq cens et treize commenceant Nous Nicole, vefve de feu Petit Jehan Colard, jadisde Court, et Thiébauld Colard, etc., et finissant HugueninVielley et Jehan Moingey, tesmoings adce appelez.Signé de J. Dauxiron.Item neuf faulx de prelz acquises de HenryConvert, de Provenchieres20, et Bietrix, sa femme,assis au territoire dud. lieu pour le prixet somme de XVI frans III groz demy comme appertpar les lectres surce faictes en datte du tier jourde febvrier mil cinq cens et deux, commenceant NousHenry Convert, de Provenchieres, et Bietrix, sa femme, etc., et finissant Jehan Boiteux, de Varoilles21,et Didier, son filz, tesmoings adce appelez.Signé de C. Folpoy.Item ung prel contenant environ une faul tant prelque cloux sis au finaige dud. Varoilles22au lieu dit Dessoubz la fontainne Lambertacquis de Nicolas Boiteux dud. lieu pour septfrans neufz groz comme appert par les lectresd'acquisition surce faictes en date du dix septièmejour en febvrier mil cinq cens et deux, commenceant Je Nicolas Boiteux deVareroilles23, etc., et finissant Jaques de (blanc) [Sagey ?]escuyer demeurant aud. Chastillon tesmoingsadce appelés, signé de C. Folpoy.Item une aultre pièce de terre contenant deuxjournaulx au territoire de Varereilles24 au lieudit En Fresnoy, acquise dud. Nicolas Boiteuxpour le prix et somme de quattre frans commeappert par les lectres d'achat en date du XXVIIeen mars l'an mil cinq cens et trois. Reçu et signé deC. Folpoy.Item trois pièces de terre tant prel queterres aribles acquises de Jehan Boichot leJeune alias dit Neuschot, de Vauclusatte25, pourle prix et somme de douze frans commeappert par lectre surce faicte en datte duXIIe en mars mil cinq cens et trois, signé C. Folpoy.Item les terres acquises de Besançon Faivre, deFleurey, estans au territoire dud. lieu pourle prix et somme de neufz frans commeappert par les lectres d'achat surce faictes endatte du XIIe en (papier déchiré) l'an mil cinq cens et troislaquelle terre led. Besançon a réacheté etrendu l'argent en vertu du réachat de lesreufz frans (papier déchiré) à Jehan Purnelle, deVarroille26, comme les debvoit assigner.Item une pièce de terre arrible contenant environung journault et demy séant au territoire deValeroille27 au lieu dit Au Boille, acquise deEstevenin Boiteux, dud. lieu, pour la sommede sept francs et neufz groz comme appert parles lectres surce faictes en datte du IIIe enfebvrier mil cinq cens et trois. Signé par F.Ramey.Item deux pièces de terre tant prelsque terres aribles acquis de Jehan Jeannot, deVauclusatte28, pour le prix et somme de six franstrois groz huict engroingnes29, comme appert parlectres en datte IIe en febvrier l'an milcinq cens et trois. Signé F. Ramel.Item une pièce de cloz size en la villedud. Vauclusatte, touchant et estant appendueau chaseaul feu Jehan Grolloy, contenant environ lequart d'une faulx de prel, pour le prix dequatorze frans acquis de Jehan Gainnet, de Fleurey,et Girarde, sa femme, comme appert par lectresen date du XVIIe en mars mil cinq cens etquattre, commenceans Nous Jehan Gainnet, etc.,et finissant Nicolas Chauvelier. Signé de J. Dauxiron.Item plusieurs pièces de terres acquisesde feu Jehan Moingey, de La Ville soubz Le mont30, pour le prix de vingt neufzfrans trois g(ros) comme appert par lectresd'achat surce faicte.Item la terre acquise de Pierre Lambert,de Vauclusatte31, pour la somme detrente frans comme appert par leslectres receues et signées de J. Dauxiron.Item quarante cinq sols est(evenants) dehu ung chacunan perpétuellement par Vuillemin et JaquesColard, de Neufvye32, frères, et chascun deulxde cense payable au jour de feste Conception Nre (Notre)dame pour le prix et somme de quarante cinqlibvres est(evenantes) assignées sur tous leurs prelzséans et gisans au finaige dud. Neufvie aulieu dit Au Vaulx de Purgey, au lieudit unprel de Rausse et générallement surtous leurs biens comme appert par les lectresde la constitution d'icelle cense reçue soubzle scel de Besançon par Claude Folpoy endatte du XIIe de febvrier l'an mil cinq censquattre vingt XVIII (erreur : 1498) commençant Nous Officialde la Cour de Besançon etc. et finissant Jehande Manget, de (papier détruit) tesmoings adce appelés.Item trente sols est(evenants) de cense chacun anPar Jeune Jehan (papier détruit) de Varereille au jour deFeste Sainct Mar(tin d')hyvers et perpétuellementPour le prix et somme de trente libvresAssignées sur deux pièces de prel contenantEnviron sept faulx l(es d)eux, l'une assise esMechelle et l'aultre En Montancy et Générallement sur tous leurs biens commeAppert par les lectres reçues par J. DauxironEn datte du pénultième jour du mois deJanvier l'an mil cinq cens et quatorzeCommenceant Nous Official de laCourt de Besançon et finissant Jehan filzRichard Odrion [Oudrion], dud. Varereille, tesmoingsAdcd appellés.Item cinq sols tournois de cense dehue parEstienne Girardey, de La Ville soubzle mont33, perpétuellement chacun an le jourde feste Sainct Martin d'hyvers pour leprix et somme de cinq francs comme appertpar les lectres de constitution de cense reçuesde J. Dauxiron.Item Pierre Petit, de Froidevaulx34, doibt cinqsolz tournois de cense chacun an au jourde feste Sainct Martin d'hyver pour cinqfrancs qui do(papier détruit) assigné.S(ens)uyvent les censes dehues chacunan (à M)essire Guillaume de Queuve35ch(apel)ain de la chapelle de lavray croix fondée en l'église de Chaulx lesChastillon36.PremièrementJehan Crelerot, de Solemon37, me doibt chacun an à chacunjour de feste Sainct Martin d'hyver ung escus d'or au soleil pource.(paragraphe rayé avec, en marge, la mention : radiationpour ce que les Briot ont l'amodiation).Les Convert, de Provenchieres38, doibvent chacunan aud. jour dix groz forte monnaie pource.Guillaume du Cloz, de Neufvye39, doibt chacun anaud. jour trente groz monnaie forte pource.Dans la marge : Solvit pour 1562, 1563.Les hoirs Didier et Jehan Vallot, deCourcelles40, doibvent chacun an aud. jour sixsols est(evenants) pource.Dans la marge : Radiation pour ce que m'a cédé lapièce pour quatre francs que luy doit délivrerThomas Michoutey41.Estevenin Maig(nin), de Froideval42, doibt chacunan aud. jour neuf (so)ls esteven(ants) pource.Dans la marge : Solvit Marie femme Maignin, Girard et ClaudotMaigninJehannette femme Claudot Maignin, fils dudit Estevenin.Solvit Girard Maignin et Claude Magnyen en l'an mil 1562, en présance de Tho(mas M)ichoutey et Ligier Petit.Solvit la veuve de feu Claudot Magnyen le Vielx.Solviy en l'an 1562, 1563.Estienne et Jacquot Burthelier, de Varoilles43,doibvent chacun an aud. jour vingt groz fort demonnaie pource.En marge : Solvit en l'an 1562.Jehan Peletier dict Estallon, de Vauclusotte,doibt chacun an audit jour quatorze gros fortemonnaie pour ce.En marge : Solvit 1562.Jehan Pelletier dict Faillon, dud. Vauclusotte,doibt chacun an audit jour XXIII sold este(venants)pource.En marge : Solvit 1562.Solvit 1563.Pierrot Lambert, dud. lieu, doibt chacun an vingtsept solz demy pource.En marge : Solvit 10 gros Jehan Boichot 1562.Guiod Lambert doit le reste.Solvit 1562.Jehan Billerey dict de Mortaut doibt chacun an aud.jour vingt sept sols esteven(ants) pource.En marge : Solvit par François Chevalier, gendre dudit Billerey.Jehan Caviron (?) doibt chacun an aud. jour troissols et demy pource.En marge : Solvit 1562, 1563.Huguenin Gaillet et les hoirs feus Nicolas et Girard Gaillet chacun an aud. jourhuict sols pource.En marge : Solvit Jehan Gaillet dict Grillon la moitié de la cense 1562. Solvit 1562.Pierre Gaillet dict Grillon doit IIII sols. Solvit ( ) 1562).(Aul)res censes dehues chacun an( ) jour de feste Sainct GeorgeJehan Boucon le Vieux et Jehan Boucon leJeune doibvent chacun an aud. jour quaranteCinq solz pource..Au terme Sainct MartinLes Briot, de Soulemont44, doivent chascung an III escus demy et douze libvres de fromage comme appert paradmodiation pource.En marge : Solvit 1562.Des Bollay, de Soulemont, que doivent chascung an unequarte froment comme appert par admodiation pource.En marge : Solvit 1562, 1563.Du maire de Vauclusotte et le San que doivent audictterme VI groz comme appert par admodiation pource.En marge : Solvit Claudot Loreilleuz trois gros pour le prédessus le moulin 1562. Solvit en l'an 1562.Solvit ledit Loreilleuz III gros l'an 1563.Terme Sainct GeorgeDe Pierre Froidevaulx, de Chaul45, que doit à feste Sainct Georgeprochaine la somme de XVIII groz pour l'amodiation de lamaison de Chaul.En marge : Solvit en l'an 1562.De Jehan Peletier dit Estal(on) qui doit III groz pour l'amodiation desprez appelés les mourayes dict Sus les Charbonières entreJehan Boichoit [Boichot] d'une part et Jehan Pelletier dict Estallon d'aultre partcontenant à une faulx, au terme de Sainct Martin.En marge : Solvit.
Notes :
1 Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs). L'église est placée sous le vocable de saint Ligier (Léger).
2 Guillaume de Coeuve, fils de Guillaume de Coeuve et de sa première épouse, Barbe de la Palud, fille de Claude de la Palud. Guillaume de Coeuve fut chapelain de la chapelle de la Vraie Croix en l'église de Chaux-les-Châtillon de 1540 à 1577 (Jean-Marie Thiébaud, "Les familles de Coeuve (XIIe-XVIe siècle) : essai généalogique", Société jurassienne d'émulation, Porrentruy, Suisse).
3 Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône).
4 Châtillon-sous-Maîche, Les Terres de Chaux (Doubs).
5 Orve (Doubs).
6 Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
7 Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs).
8 Fleurey (Doubs).
9 Solemont (Doubs).
10 Folpoy, notaire de Saint-Hippolyte (Doubs).
11 Jean Dauxiron alias d'Auxiron, notaire de Valoreille (Doubs).
12 Vauclusotte (Doubs).
13 Montandon (Doubs).
14 Le Bélieu (Doubs).
15 Cf. supra n° 12.
16 Engrognes.
17 Valoreille (Doubs).
18 Charmoille (Doubs).
19 Cour-Saint-Maurice (Doubs).
20 Provenchère (Doubs).
21 Cf. supra n° 17.
22 Idem.
23 Idem.
24 Idem.
25 Vauclusotte (Doubs).
26 Valoreille (Doubs).
27 Idem.
28 Vauclusotte (Doubs).
29 cf. supra n° 16.
30 Solemont (Doubs).
31 Vauclusotte (Doubs).
32 Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs).
33 Solemont (Doubs).
34 Froidevaux (Doubs).
35 Guillaume de Coeuve.
36 Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
37 Solemont (Doubs).
38 Provenchère (Doubs).
39 Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs).
40 Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
41 Thomas Michotey, de Belvoir (Doubs), écuyer, juge-châtelain de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche de 1541 à 1576 (Jean-Marie Thiébaud, Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté, tome I, p. 130).
42 Froidevaux (Doubs).
43 Valoreille (Doubs).
44 Solemont (Doubs).
45 Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
Les armoiries de la Laponie
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Roche-lès-Clerval (Doubs)
Eugène (Eugène Marius) POUX, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 26.12.1886, tué en 1914, caporal.
Armand (Armand Raoul) LOMONT, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 27.03.1893, mort de blessures de guerre à Somme Suippe (Marne) le 28.09.1915, 2e classe au 11e régiment de dragons.
Aimé (Albert Aimé) VERDY, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 25.04.1889, tué en 1916, 2e classe.
Francis (Marie Augustin Francis) LOMONT, né à Roches-lès-Clerval (Doubs) le 13.05.1895, mort pour la France à Brauenkopf (Alsace) le 07.06.1916, 2e classe au 5e bataillon de chasseurs à pied.
Albin (François Albin) TOURNIER, né à Fontaine-lès-Clerval (Doubs) le 28.03.1880, tué à l'ennemi à Pisoderi (Grèce) le 22.09.1916, 2e classe au 235e régiment d'infanterie.
Charles (Charles Victor) FAURE, né à Roche-ls-Clerval (Doubs) le 15.03.1889, tué à l'ennemi sur la position devant Cléry (Somme) le 10.09.1916, canonnier au 57e fégiment d'artillerie, venu de la 107e division lourde blindée, 29e bataillon.
Flavien (Flavien Marcellin) MOUREY, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 05.12.1880, tué à l'ennemi sur les crêtes nord de Monastir (Serbie) le 19.03.1917, caporal au 242e régiment d'infanterie.
Félicien (Louis Félicien) COUR, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 27.11.1889, tué à l'ennemi à Saregovo ou Saiegovo (?) (Serbie) le 29.03.1917, 2e classe au 242e régiment d'infanterie.
Joseph (Pierre Joseph) LOMONT, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 14.09.1893, tué à l'ennemi à Berméricourt (Marne) le 16 avril 1917, sergent au 42e régiment d'infanterie.
Émile (Auguste Émile) LENOIR, né à Roche-lès-Clerval (Doubs) le 18.02.1886, disparu au combat à Cuffies (Aisne) le 13.01.1915, 2e classe au 60e régiment d'infanterie (déclaré mort pour la France par jugement rendu par le tribunal de Besançon (Doubs) le 02.10.1920).
Émile LOMONT, caporal, tué en 1918 (N.B. : son nom n'a pas été retrouvé aux Archives de Vincennes).
On peut voir les portraits photographiques d'Armand et de Joseph LOMONT sur deux plaques émaillées apposées en bas et à droite du monument aux morts..
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Historique des relations diplomatiques entre la France et la Mongolie (1965-2007)
Liste des ambassadeurs de France en Mongolie de 1966 à nos jours
Mai 1966 - 1974 : Georges PERRUCHE
Décembre 1974 - 1978 : Georges de BOUTEILLER
Janvier 1978 - 1982 : Jacques FESQUET
Mai 1982 - 1984 : LEGRAIN
Septembre 1984 - 1985 : Claude ARNAUD, né à Voiteur (Jura) le 09.11.1919, le 01.05.1999, ancien ministre conseiller auprès de l'ambassade de France en Chine de 1975 à 1979, ambassadeur de France en U.R.S.S. du 29.12.1981 à 1985. Il épousa Christine Guida. Il prit sa retraite près de Voiteur.
Janvier 1985 - 1986 : Jean-Bernard RAIMOND, né à Paris 12e le 06.02.1926, fils de Henri Raimond, ingénieur, et d'Alice Auberty, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres, élève de l'ENA de 1954 à 1956, ambassadeur en U.R.S.S. et en Mongolie du 08.01.1985 à 1986, ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1988, élevé à la dignité d'ambassadeur de France en 1991. Officier de la Légion d'Honneur, commandeur de l'Ordre national du Mérite. Il a épousé Monique Chabanel.
Septembre 1986 - juin 1991 : Yves PAGNIEZ, né en 1924, licencié ès lettres, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA, ancien ambassadeur au grand-duché du Luxembourg en 1982.
Juin 1991 - octobre 1992 : Bertrand DUFOURCQ, né à Paris le 05.07.1933, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA (1961), ambassadeur de France dans la Fédération de Russie depuis le 04.02.1991, futur secrétaire général du Quai d'Orsay à compter du 29.09.1993, inspecteur général des Affaires sociales. Il épousa Élisabeth Lefort des Ylouses.
Octobre 1992 - octobre 1996 : Pierre Jean Louis Achille MOREL, né à Romans (Drôme) le 27.06.1944, fils d'André Louis Morel, chirurgien, et de Janine Vallernaud, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans la Fédération de Russie (du 11.06. 1992 à septembre 1996) et en Mongolie (J.O. du 07.10.1992). Il résidait à Moscou. Puis, en 2000-2001, il est ambassadeur en Chine et, jusqu'en 2005, il sera ambassadeur auprès du Saint-Siège. Il épousa Olga Bazanoff.
Octobre 1996 - juin 2003 : Jacques-Olivier MANENT, chevalier de la Légion d'Honneur (décret du 12.05.1999).
17 juin 2003 - 16 juillet 2005 : Nicolas CHAPUIS, conseiller des affaires étrangères (Orient) hors classe, premier conseiller d'ambassade à Londres, nommé le 17.06.2003, parti d'Oulan Bator le 16.07.2005.
Septembre 2005 - : Patrick CHRISMANT, né le 12.04.1947, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques et de l'École nationale des langues orientales, ambassadeur à Malte en 2003. Chevalier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Adresse de l'Ambassade de France : 3, avenue de la Paix, Quartier n° 1, District de Chingeltai, OULAN-BATOR Boite postale 687 MONGOLIE.
L'Ordre du Trésor sacré du Japon Français titulaires de cette décoration
Il comprend cinq classes. Parmi les Français titulaires de cette décoration, citons :
ANOGE Antoine, né à Lyon (Rhône) le 26.07.1900, à Montbeton (Tarn-et-Garonne) le 07.07.1991, inhumé dans le tombeau familial à Chauffailles (Saône-et-Loire), docteur en philosophie en 1922, envoyé à Rome pour y obtenir son doctorat en théologie, parti le 20.09.1926 pour le diocèse d'Osaka au Japon, rappelé en France en 1934 pour enseigner, au séminaire de Bièvres, la théologie, la philosophie et l'histoire de l'église. Il devint conseiller de l'ambassadeur du Japon à Rome de 1952 à 1981. Le pape Paul VI le nomma prélat d'honneur de Sa Sainteté en juillet 1960. Chevalier de la Légion d'Honneur (1963), officier de l'Ordre National du Mérite (1978), officier de l'Ordre du Trésor sacré.
ARCOUËT Henri-Nicolas (1896-1969), membre de la mission militaire française d'aéronautique française (1919-1920) (renseignement communiqué par Patrick Arcouët, son petit-fils).
AUGARDE Jacques, né à Agen (Lot-et-Garonne) le 13.04.1908, le 19.07.2006, inhumé au cimetière municipal d'Agen, journaliste, député MRP de Constantine, sous-secrétaire d'État aux Affaires musulmanes en 1947-1948, sénateur de 1951 à 1959, maire de Bougie (Algérie) de 1947 à 1962, fondateur et président du comité de liaison des associations nationales de rapatriés, commandeur de la Légion d'Honneur, de l'Ordre national du Mérite et de l'Ordre du Trésor sacré.
BARRAULT Jean-Louis, né au Vésinet (Yvelines) le 08.09.1910, à Paris le 22.01.1994, acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. Organisateur en 1977 d'une tournée de représentations de la compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault dans tout l'archipel du Japon, décoré en 1969 de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or en sautoir.
BOISSONNADE de FONTARABIE Gustave Émile, né à Vincennes (Val-de-Marne) le 07.06.1825, à Antibes (Alpes-Maritimes) le 27.06.1910, inhumé au cimetière de Ribiac, agrégé de droit en 1853, chargé de cours à la faculté de droit de l'université de Paris jusqu'en 1864 puis professeur adjoint à la faculté de droit de l'université de Grenoble (Isère) jusqu'en 1867, chargé en 1873 par le recteur de l'Académie de Paris d'enseigner le droit constitutionnel et criminel à des résidents japonais à Paris, embarqué pour le Japon en novembre de la même année, ministre du Japon en France de 1873 à 1895, engagé par contrat signé à Paris en juin 1873 pour "aider à la confection des lois et autres travaux réglementaires et consultatifs, comme légiste au service du gouvernement japonais", rédacteur du Code pénal et du Code de procédure criminelle du Japon de 1875 à 1880 puis, de 1881 à 1888, du premier Code civil japonais conçu en respectant la consigne de l'empereur ("Wakon Yôsai", "esprit du Japon, technique de l'Occident"), président honoraire de la société franco-japonaise fondée à Paris le 16 septembre 1900. Officier de la Légion d'Honneur, Ordre du Soleil levant (Japon) de 2e classe en 1876 puis de 1re classe avant son départ du Japon (premier étranger à recevoir cette éminente distinction), Ordre du Trésor sacré (1887).
BRYLINSKI Roger Auguste, né à La Bresse (Vosges) le 17.01.1873, capitaine de frégate, attaché naval près l'ambassade de France au Japon en 1919, chevalier de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre du Dragon vert d'Annam, officier de l'Ordre du Trésor sacré.
CARDIN Pierre, né à Venise (Italie) le 07.07.1922, grand couturier et mécène français, commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite, chevalier des Arts et Lettres, décoré de l'Ordre du Trésor sacré, étoile d'or et d'argent en 1991.
ÉVRARD Félix, né à La Maxe (Moselle) le 25.02.1844, le 05.04.1919, inhumé à Yokohama dans le cimetière des étrangers, ordonné prêtre aux Missions étrangères de Paris le 15.06.1867, parti pour le Japon le 16.08.1867, envoyé dans le Nord du pays à Niigata où il demeura une douzaine d'années. En 1880, il fut muté à Yokohama où il se rendit déguisé en samouraï. Le ministre de la République française lui demanda de servir de secrétaire et d'interprète à la légation ce qui lui valut d'être décoré, en 1882, de l'Ordre du Soleil Levant et, en 1903, lors d'un congé en France, de la croix de chevalier de la Légion d'Honneur. En 1906, il fut nommé procureur et vicaire général de l'archidiocèse de Tôkyô et, en 1915, curé de la paroisse de Wakabacho (Yokohama). En 1917, l'empereur du Japon lui remit la décoration de l'Ordre du Trésor sacré.
FARRÈRE Claude (de son vrai nom Frédéric-Charles BARGONE), né à Lyon (Rhône) le 27.04.1876, à Paris le 21.06.1957, capitaine de corvette en 1918. Il démissionna de l'armée en 1919 pour se consacrer à l'écriture et obtint le prix Goncourt en 1905 avec Les Civilisés. Le 6 mai 1932, il fut blessé de deux balles en s'interposant entre le président Doumer et son assassin Paul Gorgulov. Membre de l'Académie française depuis le 28 mars 1935, Farrère fut invité en 1938 par le gouvernement japonais en tant qu'écrivain "indépendant" et, pendant son séjour, reçut l'insigne de deuxième classe de l'Ordre du Trésor sacré.
FAURE Jacques-Paul, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 14.11.1869, à Paris à l'hôpital du Val de Grâce le 24.08.1924, inhumé au cimetière de Clermont-Ferrand, admis à l'École Polytechnique le 21.10.1889, lieutenant-colonel d'artillerie, chef de la mission militaire française d'aéronautique au Japon en 1918-1920, au cours de laquelle il fut promu colonel en 1919. En 1923, il finira sa carrière comme général commandant la 11e brigade de bombardement de Metz (Moselle). Commandeur de la Légion d'Honneur (1924), croix de guerre 1914-1918, commandeur des ordres du Trésor sacré et du Soleil levant.
FLOUZAT Denise, née à Paris en 1928, docteure ès sciences économiques et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, professeure de sciences économiques et de gestion à l'université Paris I- Panthéon-Sorbonne, ancien membre du conseil général de la Banque de France. Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite, officier des Palmes académiques, cordon de l'Ordre du Trésor sacré.
FRANK Bernard, né à Paris le 28.02.1927, le 15.10.1996, diplômé de japonais en 1948, pensionnaire de la Maison franco-japonaise de Tôkyô de 1954 à 1957, diplômé de l'École pratique des hautes études, chargé de cours à la Sorbonne de 1967 à 1970, directeur d'études (histoire et philologie japonaises) à l'École pratique des hautes études de 1965 à 1981, directeur français de la Maison franco-japonaise de 1972 à 1974, directeur de l'équipe de recherche associée au C.N.R.S., "études japonaises", de 1976 à 1991, professeur titulaire de la chaire de civilisation japonaise au Collège de France de 1979 à 1996, membre associé de l'Académie du Japon. Il avait découvert le Japon à travers l'uvre de Lafcadio Hearn, un écrivain irlandais qui s'était fixé dans ce pays à la fin du 19e siècle. Lors de son premier séjour au Japon, il a épousé Tsuchihachi Junko, issue d'une vieille famille de notables de la préfecture de Wakayama, étudiant la peinture occidentale à l'université des Arts de Tôkyô. Officier de la Légion d'Honneur, de l'Ordre national du Mérite, des Palmes académiques, chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres, grand officier de l'Ordre du Trésor sacré.
GUILLAIN Robert, né le 04.09.1908, en 1998, journaliste, entré à l'agence Havas en 1934, envoyé en Chine en 1937 pour couvrir la guerre sino-japonaise, correspondant du journal Le Monde à Tôkyô avant-guerre, auteur de Aventure Japon et de Geishas ou le monde des fleurs et des saules (1997), président d'honneur et fondateur de l'Association de presse France-Japon. Il a été reçu à l'Institut franco-japonais de Tôkyô. Robert Guillain a été décoré en 1969 de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or en sautoir.
GUIMET Émile, né à Lyon (Rhône) le 2.06.1836, à Fleurieu-sur-Saône (Rhône) le 12.06.1918, richissime industriel, président de Péchiney. Il s'embarqua pour Yokohama et séjourna au Japon avec un ordre de mission de Jules Ferry, ministre français de l'Instruction publique, du 10 avril 1876, lui demandant de mener une enquête sur les religions de la Chine, des Indes et du Japon. De retour en France, il collabora activement à l'organisation d'un musée Guimet qui ouvrit ses portes à Lyon en 1879. Il jugea opportun de le transférer trois ans plus tard à Paris. L'actuel Musée national des Arts asiatiques - Guimet, inauguré par Sadi-Carnot le 20.11.1889, rattaché à la direction des musées de France en 1927, rassemble la plus grande collection mondiale d'uvres d'art en provenance de l'Asie. Émile Guimet a été nommé commandeur de l'Ordre du Trésor sacré en 1899.
LAROSIÈRE de CHAMPFEU (de) Jacques, né à Paris 7e le 12.11.1929, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, élève de l'ENA de 1954 à 1958, licencié ès lettres et en droit, inspecteur général des finances, directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances (de janvier à mai 1974), directeur du Trésor de 1974 à 1978, directeur général du F.M.I. (Fonds monétaire international) de 1978 à 1986, directeur de la Banque de France de 1987 à 1993, élu le 03.05.1993 à l'Académie des Sciences morales et politiques. Il s'est rendu plusieurs fois au Japon depuis mai 1973 et s'est lié d'amitié avec de nombreuses personnalités japonaises de premier plan. S. E. Atsuhiko Yatabe, ambassadeur du Japon en France, lui a remis, le 26.07.1993, le grand cordon de l'Ordre du Trésor sacré.
MOUCLIER Jacques, né le 02.12.1924, président de la Fédération française de la Couture, du Prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode, président de la Chambre syndicale de la Couture parisienne, auteur de l'ouvrage Haute Couture, publié en 2004. En 1994, il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or en sautoir, pour avoir favorisé le développement de l'industrie de la mode au Japon.
MUSELIER Émile, né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 17.04.1882, à l'hôpital maritime de Toulon (Var) le 02.11.1965, inhumé au cimetière Saint-Pierre de Marseille, amiral, grand officier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre du Trésor sacré.
OURISSON Guy, né à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 26.03.1926, à Strasbourg (Bas-Rhin) le 03.11.2006, professeur de chimie organique. Dès son arrivée à l'université Louis Pasteur (dont il fut le premier président), il forma de jeunes chercheurs japonais et a initié des échanges pluridisciplinaires entre chercheurs strasbourgeois et japonais. En mai 1985, il a créé l'association Amitié Strasbourg-Japon. Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite, il a été décoré en 1993 de l'Ordre du Trésor sacré.
PINTE Étienne, né à Ixelles (Belgique) le 19.03.1939, maire de Versailles, député UMP de la 1re circonscription des Yvelines, grand officier de l'Ordre du Trésor sacré.
PLATTARD Serge, docteur en physique nucléaire de l'université d'Orsay, conseiller scientifique à Tôkyô de 1990 à 1994, directeur des relations internationales du Centre National d'Études Spatiales (C.N.E.S.), premier secrétaire général de l'European Space Policy Institute (ESPI), chevalier de la Légion d'Honneur et décoré de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or. En janvier 2003, dans le cadre de l'association Synergies France-Japon, il a donné une conférence sur "Les relations franco-japonaises dans le domaine spatial".
PLIQUE Joseph Anatole, né à Montreuil-sur-Thomance (Haute-Marne) le 01.12.1866, à Gudmont (Haute-Marne) le 17.07.1949, colonel, premier directeur de la direction de la gendarmerie nouvellement créée en 1920, général de brigade le 24.06.1923, officier de la Légion d'Honneur (1921), commandeur de l'Ordre du Dragon de l'Annam (1921), 3e classe dans l'Ordre du Trésor sacré.
RAMPAL Jean-Pierre, né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 07.01.1922, à Paris le 20.05.2000, professeur de flûte au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il a été décoré de l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'or en sautoir, en 1994 pour avoir enseigné la flûte à des étudiants japonais et avoir contribué à une meilleure connaissance de la flûte au Japon.
VANDERMEERSCH Léon, né à Wervicq-Sud en 1928, sinologue, professeur émérite à l'École pratique des hautes études, directeur de la Maison franco-japonaise de Tôkyô de 1981 à 1984, directeur de l'EFEO (École française d'Extrême-Orient de 1989 à 1989, membre correspondant de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres). Il a participé à de nombreux congrès et colloques au Japon. Chevalier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre des Palmes académiques, il a aussi été décoré de l'Ordre du Trésor sacré, étoile d'or et d'argent.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le cimetière de la mission d'Urakami à Nagasaki (Japon)
- Jean-Claude COMBAZ, né à Saint-Beron (Savoie) le 08.12.1856, à Oura (quartier de Nagasaki) le 18.08.1926.
- Jules Alphonse COUSIN, né à Chambretaud (Vendée) le 21.04.1842, à Nagasaki le 18.09.1911.
- Jean-Marie DELALEX, né à Marin (Haute-Savoie) le 11.05.1873, à Nagasaki le 08.02.1901.
- Pierre Théodore FRAINEAU, né à Jonzac (Charente Maritime) le 10.10.1847, à Urakami (quartier de Nagasaki) le 24.01.1911.
- Albert Charles Arsène PÉLU, né à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe) le 30.03.1848, à Nagasaki (Japon) le 03.03.1918.
- Amédée Marie SALMON, né à Buzançais (Indre) le 11.11.1845, à Oura (quartier de Nagasaki) le 04.01.1919.
- Fernand Jean Joseph THIRY, né à Anor (Nord) le 28.09.1884, à Kurume (Japon) le 05.10.1930.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Généalogie descendante des samouraïs Matsudaira (15e-16e siècles)
On a la filiation depuis :
1- Matsudaira Nagachika, né vers 1450-1460, père de
2- Matsudaira Nobutada (1489-1531), père de :
3a- Matsudaira Nobutaka, en 1548, père de plusieurs enfants dont l'aîné, Matsudaira Kiyoyasu, vécut de 1511 à 1536.
3b- Matsudaira Kiyoyasu, père de :
4- Matsudaira Hirodata (1526-1549) qui épousa :
1) Dai no Kata (dite aussi Hirotada), fille du samouraï Mizuno Tadama. Elle épousa Matsudaira Hirodata, né le 9 juin 1526, le 3 avril 1549, daimyo de Mikawa (fils de Matsudaira Kiyoyata). De cette union est issu Tokugawa Ieyasu, né le 31 janvier 1543, le 1er juin 1616, le premier shogun de la dynastie des Tokugawa.
2) (Après avoir divorcé de Dai No Kata en 1544), N., fille de Toda Yasumitsu, qui lui donna un fils, Matsudaira Nobutaka, en 1548.
Signature :
par Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Bibliographie :
THIÉBAUD Jean-Marie, "Les grandes familles japonaises - Généalogie des shoguns Tokugawa (16e - 19e siècles)", document électronique.
TURNBULL Stephen, The Samurai Sourcebook, London, Cassell & Co, 1998.
Les grandes familles japonaises Généalogie de la lignée des shoguns Tokugawa (16e-19e siècles)
2- Tokugawa Hidetada (dit aussi Benitora, "tigre rouge"), né le 2 mai 1579, le 14 mars 1632, 3e fils du précédent et d'une de ses concubines. Shogun de 1605 à 1623, il passa le pouvoir à son second fils, Tokugawa Iemitsu, mais conserva jusqu'à sa mort le titre d'ôgosho. Il épousa Oeyo Oda, du clan Taira, qui lui donna deux fils : 1) Takagawa Iemitsu ; 2) Takagawa Tadanaga.
3- Tokugawa Iemitsu, né le 2 août 1604, le 8 juin 1651, fils aîné du précédent. Troisième shogun de la dynastie de 1632 à 1651. De ses concubines, il eut plusieurs enfants dont 1) Tokugawa Ietsuna auquel il transmit le shogunat ; 2) Tokugawa Tsunashige, père de Tokugawa Ienobu, cité plus loin ; 3) N. ; 4) Tokugawa Tsunayoshi qui succédera à son frère aîné. Tokugawa Iemitsu fut le premier des shoguns à ne pas se rendre à Kyôto pour y recevoir le mandat impérial. Désormais, ce sera un émissaire du souverain qui portera celui-ci à Edo, la capitale shogunale. C'est sous le gouvernement de Iemitsu que la cour du shogun s'organisa avec, notamment, un haut conseil composé de daimyo.
4- Tokugawa Ietsuna, né le 7 septembre 1641, le 4 juin 1680, fils aîné du précédent et d'une de ses concubines. Shogun de 1650 à 1680, il a laissé l'image d'un homme faible. Il transmit le shogunat à son frère cadet, Tokugawa Tsunayoshi.
5- Tokugawa Tsunayoshi, né à Edo le 23 février 1646, le 19 février 1709, frère cadet du précédent et 4e fils de Tokugawa Iemitsu. Daimyo de Tatebayashi jusqu'en 1681 puis shogun de 1681 à 1709.
6- Tokugawa Ienobu (connu aussi sous le nom de Tsunatoyo), né le 11 juin 1662, le 12 novembre 1712, neveu du précédent et fils aîné de Tokugawa Tsunashige (un des fils de Tokugawa Iemitsu, cité plus haut, et d'une concubine). Shogun de 1709 à 1712. Il eut plusieurs fils dont : 1) Tokugawa Ietsugu qui lui succéda ; 2) N. qui épousa une des filles cadettes de l'empereur Nakamikado.
7. - Tokugawa Ietsugu, né à Edo le 8 août 1709, le 19 juin 1716, fils du précédent et d'une concubine. Il détint le shogunat de 1713 à 1716. Décédé à l'âge de 7 ans sans descendance, le pouvoir passa à un de ses cousins.
8. - Tokugawa Yoshimine (Tokugawa Genroku dans son enfance puis Shinnosuke en 1697 après avoir subi des rites d'initiation, et enfin Tokugawa dès 1705 à la mort de son père et de ses deux frères aînés qui lui laissaient le titre de daimyo de Kii), né le 27 novembre 1684, le 12 juillet 1751, fils du daimyo Tokugawa Mitsusada, né le 28 janvier 1627, le 25 septembre 1705), petit-fils du daimyo Tokugawa Yorinobu (né le 28 avril 1602, le 19 février 1671) et arrière-petit-fils de Tokugawa Ieyasu, le premier shogun. Les historiens le considèrent comme le meilleur des shoguns. Shogun de 1716 à 1745, conservant alors le titre d'ôgosho. Il épousa 1) Nami-no-miya, fille du prince Fushimi-no-miya ; 2) la fille d'Okubo Tadanao, un courtisan, qui lui donna plusieurs enfants dont l'aîné, Ieshige, devint le 9e shogun.
9. - Tokugawa Ieshige, né le 28 janvier 1712, le 13 juillet 1761, inhumé dans le mausolée des Tokugawa à Zôjô-ji (Shiba, Edo), fils du précédent. Shogun de 1745 à 1760. En 1760, il abandonna le pouvoir et le transmit à son fils aîné, Takagawa Ieharu.
10. - Tokugawa Ieharu, né le 20 juin 1736, le 17 septembre 1786, inhumé à Edo, fils aîné du précédent. Shogun de 1760 à 1786.
11. - Takugawa Ienari, né le 18 novembre 1773, le 22 mars 1841. Les historiens l'ont considéré comme un dégénéré à cause de son harem de 900 femmes et de ses 55 enfants dont beaucoup, adoptés par des familles de daimyo, jouèrent un rôle pendant le Bakumatsu (fin du shogunat) et la guerre de Boshin. Shogun de 1786 à 1837. Son second fils, Tokugawa Ieyoshi, lui succéda.
12. - Tokugawa Ieyoshi, né le 22 juin 1793, le 27 juillet 1853, second fils du précédent. Shogun de 1837 à 1853. Shogun de 1837 à 1853. Il se maria et eut une descendance.
13. - Tokugawa Iesada, né le 6 mai 1824, le 14 août 1858. Il aurait été mentalement incapable d'assumer les responsabilités du pouvoir. Il régna de 1853 à 1858 et c'est lui qui signa avec le commodore Perry et les Occidentaux les traités de commerce et d'amitié qui mettaient fin à la politique isolationniste du Japon. Il mourut sans héritier et laissa le pouvoir à son cousin et fils adoptif, Tokugawa Iemochi.
14. - Tokugawa Iemochi, né à Edo le 17 juillet 1846, le 20 juillet 1866, fils aîné de Tokugawa Nariyuki et fils adoptif de Tokugawa Iesada, cité ci-dessus. Shogun de 1856 à 1866. Son pouvoir, comme celui de son père adoptif à la fin de sa vie, s'appuya sur le shinsen gumi, force spéciale composé de guerriers soumis à un code de l'honneur et à une discipline de fer. Cette unité, surnommée les Loups de Mibu, comprenait dix groupes (bantaïs) avec un capitaine à la tête de chacun d'eux. Ils étaient vêtus d'un kimono bleu marqué du caractère makoto (fidélité, sincérité). Le shinsen gumi fut démantelé à la fin du shogunat.
15. - Tokugawa Yoshinobu dit aussi Keiki (né Tokugawa Shichiroma), né à Mito (Hiraki) le 28 octobre 1837, le 21 novembre 1913, septième fils de Tokugawa Nariaki, daimyo de Mito, issu de la troisième et ultime lignée descendant du 1er shogun, Takugawa Ieyasu. Son père le fit adopter par le clan des Hitotsubashi afin qu'il puisse avoir plus de chances d'accéder au shogunat. C'est pendant qu'il était au pouvoir que se déroula la guerre du Boshin (1867-1869) entre ses partisans et ceux de l'empereur. Vaincu, il fut le dernier des shoguns.
Signature :
par Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Sources et bibliographie :
BODART-BAILEY Beatrice, Kaempfer's Japan : Tokugawa Japan Observed. Honolulu, University of Hawai Press, 1999.
RIN-SIYO Siyun-sai, GAHÔ Hayashi, Nipon odaï itsi ran (Annales des empereurs du Japon), 1652, rééd. à Paris par Isaac Titsing en 1834.
SCREECH Timon, Shogun's Painted Culture : Fear and Creativity in the Japanese States, 1760-182, London, Reaktion Books, 2000.
SCREECH Timon, Secret Memoirs of the Shoguns : Isaac Titsingh and Japan, 1779-1822. London, 2006.
SHIBA Ryôtarô. The Last Shogun: The Life of Tokugawa Yoshinobu, traduit par Juliet Winters Carpenter, New York, Kodansha International, 1998.
TITSING Isaac, Illustrations of Japan, London, Ackerman, 1822.
TOKUGAWA Munefusan, Tokugawa Yonbyaku-nen no naisho-banashi, Tokyo, Bungei-shunju, 2004.
TOKUGAWA Yoshitomo, Tokugawa Yoshinobu-ke ni Youkoso : Waga ie ni tsutawaru aisubeki "Saigo no Shogun" no Yokogao, Tokyo, Bungei-shunju, 2003.
TOTMAN Conrad, Politics in the Tokugawa bakufu, 1600-1843. Cambridge, Harvard University Press, 1967.
TURNBULL Stephen, The Samurai Sourcebook, London, Cassell & Co, 1998.
Le gaijin bochi (cimetière pour étrangers) d'Aoyama à Tôkyô
- TÔKYÔ - le cimetière d'Aoyama (Reien) (Aoyama signifiant littéralement "montagne bleue" en japonais), ouvert en 1872, regroupe actuellement quelque 100 000 tombes familiales sur une superficie de 26 000 m², au milieu de 200 cerisiers et de nombreux autres arbres. L'adresse de ce cimetière est Minami-Aoyama-2-Chome (station Gaeienmae, sortie 1). À mi-chemin de l'entrée nord et de l'entrée centrale, on trouve une section de 2000 m² qui est réservée aux étrangers. Un panneau avec 68 notices rédigées en katakana et en anglais indique l'emplacement des principales tombes.
Dans cette partie du cimetière, on trouve une douzaine de Français :
- des missionnaires des Missions étrangères de Paris : Honest BALANCHE (1853-1882), Justin BALETTE (1852-1918), Jean-Baptiste BERGER (1864-1891), Mgr Pierre-Marie OSOUF (1829-1906), premier archevêque de Tôkyô, Mgr Jean-Pierre REY (1858-1930), archevêque de Tôkyô, Augustin TULPIN (1858-1933),
- Albert du BOUSQUET (1837-1882), lieutenant d'infanterie et interprète de la légation de France, et son épouse, Maria du BOUSQUET (1850-1930).
- Pierre N. OSUT (?) (1829-1906).
- J. F. SARAZIN (1838-1906), consul de France honoraire.
- Michael STEICHEN (1857-1929)
- Jean-Baptiste VERDOLLIN, né vers 1848, décédé à Tôkyô le 07.01.1891.
Des Britanniques :
- William Douglas COX (1844-1905).
- Margaret DENBIGH, née vers 1841, décédée au Japon le 16 mars 1906, sur de G. D. Denbigh, marchand.
- Victoria DENING, décédée en 1889, épouse du Reverend Walter Dening, pasteur de l'église épiscopale. Ce dernier, correspondant de Lafcadio Hearn, est l'auteur de The Life of Toyotomi Hideyoshi (1536-98), édité à Kôbe en 1930 et réédité dans les années 1950.
- Hugh FRASER, né le 22 février 1837, décédé en poste à Tôkyô le 4 juin 1894, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne au Japon. Une incription indique : Here rests Hugh Fraser of the House of Balmain in Scotland. British Minister in Japan Son of Sir John Fraser, KCMG [knight commander of St Michael and St George] and of Selima his wife. Born at Slede Hill, Kent Feb 22 1837, Entered Queen's Service Jan 15 1855 Fell asleep in Christ Jun 4 1894 Erected by his wife and family and by the members of Her Majesty's diplomatic and consular services in Japan.
- Mary A. GUNDRY (1836-1905).
- Frederick Wiliam HAMMOND, né le 25 septembre 1841, décédé au Japon le 20 août 19°7.
- Mary J. HOLBROOK CHAPPELL (1852-1912), missionnaire méthodiste, épouse du Canadien Benjamin CHAPPELL, cité plus loin.
- Gervas K. HOLMES, décédé mystérieusement au Japon le 10 juin 1906.
- Arthur LLOYD (Reverend), né le 10 avril 1852, décédé le 27 octobre 1911, missionnaire, professeur, traducteur en anglais de la nouvelle "Démon d'Or" de Konjiki Yasha (histoire d'un jeune étudiant nommé Kanichi, amoureux depuis son enfance d'Omiya qui épousa le riche Tomiyama. Mais Kanichi ignorait que la jeune femme avait été contrainte à ce mariage par ses parents. Désormais de glace, Kanichi ne s'intéressa plus qu'à l'or et, pour s'en procurer, devint usurier, semant le malheur auteur de lui. Cette histoire a été portée à l'écran par Koji Shima en 1953).
- Alexander MACMILLAN, né vers 1851, décédé à Tôkyô le 2 novembre 1899.
- le major général Henry Spencer PALMER, né à Bangalore (Inde) le 30 avril 1838, décédé le 10 février 1893, ingénieur militaire qui travailla à la construction du port de Yokohama.
- Albert Robert PATTISON (1865-1907).
- Thomas RYDING GREEN, né à Liverpool vers 1835, décédé à Yokohama le 6 janvier 1898.
- Frederick William STRANGE, né vers 1854, arrivé à Yokohama en 1873, professeur d'anglais à son arrivée puis homme d'affaires, décédé d'une maladie cardiaque le 5 juillet 1889. C'est lui qui introduisit les courses d'aviron au Japon.
- Dorothy TENNANT, décédée en 1890
- Paul TENNANT
- Elizabeth THORNTON (1852-1904).
- John Caroll WRIGHT, né le 21 avril 1891, décédé le 13 juillet 1891.
Deux Irlandais :
- Captain Francis (alias Franck) BRINKLEY, né à Leinster (Irlande) en 1841, le 12 octobre 1912. Il arriva au Japon en 1867 en qualité d'officier d'artillerie attaché à la légation britannique avant de devenir, en 1871, conseiller étranger du gouvernement Meiji. Il fonda et dirigea le journal Japan Mail de 1881 à sa mort. Il épousa Tanaka Yasuko, fille d'un samouraï.- Charles DICKINSON WEST, né à Dublin (Irlande) en 1847, décédé en 1908, technicien, arrivé au Japon en 1882 en qualité de oyatoi gaikokujin, professeur d'architecture navale et de génie mécanique à Kobu Daigakko, la division charpente-menuiserie de l'université de Tôkyô et on peut encore voir sa statue dans le campus.Trois Canadiens :- Alice E. BELTON, née à Clayton (Ontario, Canada) en 1867, décédée au Japon en 1904, missionnaire méthodiste, enseignante dans diverses écoles et travaillant à Kanazawa. Elle vint une première fois au Japon de 1894 à 1899, rentra au Canada pour raison de santé et revint de 1902 à sa mort (Anamizu Tsueneo, "Deux missionnaires méthodistes canadiennes et Tokuyo Nikaido - Nikaido à Kanazawa", Nihon Joshi Daigaku Kiyo, 1999, vol. 29, p. 61-72 (en japonais)).- Benjamin CHAPPELL, né à Charlottetown (Prince Edward Island, Canada) le 3 avril 1852, décédé à Hagi (Japon) le 3 mai1925, pasteur méthodiste, fils de Benjamin Chappell, né à Charlottetown le 25 octobre 1812, décédé audit lieu le 24 février 1858, et de Mary Barber, née à Charlottetown avant 1815, décédée à Hillsborough Park (Prince Edward Island, Canada) le 17 janvier 1874, fille de Jabez Bernard. Il épousa l'Anglaise Mary J. HOLBROOK CHAPPELL (1852-1912), citée plus loin, qui lui donna trois enfants : Constance, Mary et Jean.- Mary VANCE, née à Burlington (Ontario, Canada) le 8 février 1858, décédée à Tôkyô le 27 septembre 1892.Huit Allemands :- Karl Anton BRÜCK (1839-1880)- Udo EGGERT (Dr), né le 19 juin1848, décédé le 1er mars1893, juriste, professeur de sciences politiques. Sa pierre tombale porte l'inscription allemande : Hier ruet in Gott Dr. UDO EGGERT Proffessor de Staatswissenschaften geb.D. 19 Juni 1848 gest.d. 1 Maerz 1893.- Paul EHMANN, né à Bielsko (Silésie, Prusse, actuellement en Pologne) le 28 juillet 1858, décédé à Tôkyô le 16 mars 1901 (inscription en allemand sur la pierre tombale).- Karl FLAIG, né à Waldsee (Souabe, Allemagne) le 7 mai 1865, décédé à Tôkyô le 28 août 1907. Sa tombe porte l'inscription : Hier Ruht Karl Flaig geboren 7 Mai 1865 in Waldsee gestorben 28 August 1907 in Tokyo Gewidmet Von den Imperial Hotels Ltd und von seinen Freunden (Ici repose Karl Flaig, né à Waldsee le 7 mai 1865, décédé à Tôkyô le 28 août 1907. Offert par Imperial Hotel Ltd et ses amis).- Caesar JUNGHERR, né à Hanau (Hesse, Allemagne) le 1er février 1854, décédé à Tôkyô le 18 mai 1904 (inscription en allemand sur la pierre tombale).- Lucius C. M. LANGGUTH, né à Heusden le 10 mars 1854, décédé à Tôkyô le 24 avril 1906 (inscription en allemand sur la pierre tombale). - Adolf LUBOWSKI, né à Islezen, Buckelberg, Katscher, Silésie (Prusse) le 13 septembre 1833, décédé au Japon le 22 septembre 1897.- Julius Karl SCRIBA, né à Darmstadt le 5 juin 1848, décédé à Kamakura (préfecture de Kanagawa) le 3 janvier 1905, éminent chirurgien, exerçant d'abord à Fribourg en Brisgau puis conseiller étranger appelé par le gouvernement de l'ère Meiji. Arrivé en 1881, il donna des cours de dermatologie et de chirurgie pendant 25 ans à l'université de Tôkyô, formant toute une génération de jeunes chirurgiens japonais, pratiquant même en 1892 la première trépanation effectuée dans ce pays. Son assistant japonais, le docteur Miyake Hayari (1867-1945) devint le premier neurochirurgien de son pays. Le buste de Scriba orne l'université de Tôkyô (Yoshio Mishima ; "The Dawn of Surgery in Japan", Surgery Today 2006, vol 36, n° 5, p. 395-402).Des Américains :- Flora BEST : v. Flora B. HARRIS.- Alice BISHOP, femme de William J. BISHOP, née vers 1873, décédée le 9 mars 1900. Sa tombe porte l'indication : Christian Literature Society Japan.- Un enfant (prénom non cité), né et mort en 1902, fils de William J. BISHOP et de sa (seconde) femme Clara May BISHOP. N.B. : Des lettres de William J. Bishop et de Clara May Bishop (1903-1916) sont conservées à l'Abilene Christian University (ACU) ainsi que Plain Statement of Work in Japan, écrit par William J. Bishop en juin 1910.- Gilbert BOWLES, né le 26 novembre 1869, décédé le 31 janvier 1960, quaker, fondateur avec les diplomates japonais Nitobe Inazo et Sawada Setzuko la Peace Society, tentant en vain d'arrêter la militarisation du Japon dans les années 1930. Le monument funéraire du cimetière d'Aoyama n'est peut-être que commémoratif car la sépulture de ce personnage se trouve au Ivy Cemetery Prescott, Walla County (Washington, U.S.A.).- Charlotte P. BROWN : v. Gideon Draper Jr.- CHAPPELL : v. HOLBROOK CHAPPELL.- Lucretia H. CLEMENT, née à Lowell (Massachusetts, USA) le 12 février 1831, décédée à Tôkyô le 26 juillet 1908.- Gideon DRAPER Jr, né à Clifton Springs, Ontario County (New York) le 22 juin 1828, décédé à Yokohama le 8 décembre 1889, et son épouse, Charlotte Prickney Brown (Prickney Brown-Draper), née à Clifton, Ontario County (New York) le 13 septembre 1832, décédée à Hakodate le 7 avril 1899.- Gideon Clarence DRAPER, né le 8 septembre 1886, décédé au Japon, fils des précédents.- Edwin DUN, né dans un ranch près de Springfield (Ohio) en 1848, décédé au Japon en 1931, propriétaire de ranch, arrivé au Japon en 1873 à bord du steamer Great Republic et vécut d'abord à Sapporo de 1875 à 1883. Il supervisa l'élimination des loups et des chiens sauvages (au sud-est de l'île d'Hokkaido) et apporta au Japon de Meiji l'élevage bovin (dans l'île d'Hokkaido) et les techniques agricoles les plus modernes de son temps. Il sera secrétaire de la légation américaine au Japon en 1893.- William Clark EASTLAKE (1834-1887), dentiste, introducteur de l'art dentaire au Japon.- Frank W. (William) EASTLAKE (1858-1905), fils du précédent.- Pascal L. EASTLAKE (1888-1954), fils du précédent.- Charles E. GARST, né à Dayton (Ohio) le 21 août 1853, décédé à Tôkyô le 8 décembre 1888. Après avoir été cadet de 1872 à 1876, il servit comme second lieutenant au 15th US Infantry puis il s'engagea comme missionnaire à la Foreign Missionnary Society (FCMS) of the Disciples of Christ (créée en 1877) et arriva à Yokohama le 18 octobre 1883.- Flora B. (BEST) HARRIS (1850-1909) qui a épousé le suivant le 23 octobre 1873 et lui donna deux filles, Florence et Elizabeth.- Merriman Colbert HARRIS, né à Beallville (Ohio) le 9 juillet 1846, fils de Colbert et Catherine Harris, missionnaire envoyé servir dans la zone Pacifique-îles Hawaï, vice-consul américain à Hokkaido du 6 novembre 1875 au 6 octobre 1876, superintendant des missions japonaises à San Francisco en 1886, évêque méthodiste en charge du Japon et de la Corée dès 1904. Dans sa jeunesse, il avait servi comme caporal au 12th Ohio Volunteer Cavalry pendant la guerre civile américaine de 1863 à 1865. Il a été décoré à deux reprises de l'Ordre du Trésor sacré et décéda à Aoyama le 8 mai 1921.- Henry HARTSHORNE, né le 16 mars 1823, décédé à Tôkyô le 10 février 1897, docteur en médecine, professeur d'anatomie, de physiologie, d'hygiène et de sciences naturelles, élu membre du Collège des médecins de Philadelphie en 1851, un des fondateurs de l'American Public Health Association en 1872. Il vint au Japon pour aider la communauté quaker, une première fois en 1893 et à nouveau de 1895 à sa mort. Il épousa, le 8 janvier 1849, Mary E. Brown, décédée en 1886.- Enfant HOSKING (sans précision du prénom), fils de Richard et Sarah Hosking, cités ci-dessous.- Ralph Burgess HOSKING, né le 7 août 1881, décédé le 16 décembre 1887, fils de Richard et Sarah Hosking, cités ci-dessous.- Richard HOSKING, né en 1855, décédé le 30 janvier 1898.- Sarah Anne HOSKING, épouse de Richard HOSKING cité ci-dessus.- John Ashbourne Gordon ROBINSON (1889-1889), fils de Cooper et Bessie Robinson.- Martha SHELBOURNE ROBINSON (1884-1885), fille de Cooper Shelbourne et Bessie Robinson.- Duane B. SIMMONS (1837-1897), médecin éminent qui s'installa à Yokohama, y répandit avec James Curtis Hepburn (1815-1911) l'usage de la vaccination antivariolique, des mesures de prévention contre le choléra, le traitement des maladies infectieuses et vénériennes. Il épousa à New York City, le 5 mai 1869, Maria Antoinette Simmons dont il divorça en 1880. Sa pierre tombale indique : In memory of Duane B Simmons M D of New York For many years a resident and friend of Japan who died Feb 19, 1889 at Tokyo. This stone is erected by his Japanese friends (À la mémoire de Duane B. Simmons, docteur en médecine, de New York, résident et ami du Japon pendant de nombreuses années, qui décéda le 19 février 1889 à Tôkyô. Cette pierre a été élevée par ses amis japonais).- Connell SMITH- Percy A. SMITH (Reverend) (1876-1845), missionnaire.- Uriel SMITH, né le 16 juillet 1889, décédé le 13 avril 1891.- Maria T. TRUE (1841-1896), épouse du Reverend Albert TRUE.- Olive WHITING BISHOP, née à Jasper (New York, U.S.A.) en 1847, décédée en 1914, épouse du Révérend Charles BISHOP, pasteur méthodiste, auquel elle donna un fils, Carl WHITING BISHOP, né à Tôkyô le 12 juin 1881, lieutenant de la marine américaine.- Anna WHITNEY (1834-1883), fondatrice du Akasaka Hospital qui fonctionne encore de nos jours.- Edmund Radcliffe WOODMAN (Révérend) (1851-1909), missionnaire au Japon pendant 29 ans.- Maurice E. WOODMAN (1897-1899), fils du Révérend Edmund Radcliffe WOODMAN, cité ci-dessus.- May Lassell WOODMAN (1856-1921), épouse du Révérend Edmund Radcliffe WOODMAN, cité ci-dessus.Trois Italiens : - Edoardo CHIOSSONE, né à Arenzano près de Gênes en 1809, décédé d'une crise cardiaque le 11 avril 1898, arrivé au Japon le 12 janvier 1875, peintre (portraits de l'empereur du Japon en uniforme militaire (1893) et de plusieurs membres de la famille impériale) et fin graveur auquel on doit sans doute la technique de fabrication des timbres-poste et des billets de banque dont celui encore en cours de 10 000 yens orné du portrait de Fukuzawa Yukichi.- Isidoro Francisco LOUVERIO- Silvia Maria PATERNOSTROUn Hollandais - Guido H. F. VERBECK (alias VERBEEK), né à Zeist (Pays-Bas) le 28 janvier 1830, décédé d'une crise cardiaque à Tôkyô le 10 mai 1893, missionnaire et un des principaux conseillers politiques du gouvernement Meiji.Un Coréen- C. KIM (1894).Deux Russes - Samuel CHTCHERESCHEVSKY- Susan CHTCHERESCHEVSKYOn trouve aussi dans le quartier des étrangers du cimetière d'Aoyama des tombes d'enfants comme celle d'Allen DO BONCHI (sans date), de Vera ECKERT (1909-1909), de Joseph HEGO, décédé le 12 juin 1897 à l'âge de 6 ans, d'Anna Grace NEWTON, décédée le 10 septembre 1889, âgée de 1 an 9 jours, fille de Reverend J. C. C. Newton et de Mrs L. E. Newton, de Warren Reynolds SCHWARTZ, né le 26 septembre 1888, décédé en mars 1892, second fils de Herbert Warren et de Lola SCHWARTZ, des enfants de Cooper et Bessie ROBINSON.Il n'a pas été possible de découvrir avec certitude la nationalité de :- Vittorio AYMONIN (1823-1888)- Charles Cory BRADBURY- Raymond Theodore BRADBURY- Perine DITTRICH (1860-1891)- Marie FRAZIER, épouse de John SCHWARTZ- Henry A. HOWE (1844-1899)- E. L. JAMES- Erwin KAUFFMANN, décédé le 11 février 1889- Ine KESSLER- Harry P. KNOTT- Frederick William KRECKER- Alan Ryder HALL- William Silver HALL- Benjamin Vernor HEROD, né le 5 novembre 1896, décédé en avril 1987- E. L. JAMES- John SCHWARTZ, mari de Marie FRAZIER- Merry B. TAFT- Harold VELKMAN- Emmanuel WUTZEn 2005, plusieurs de ces tombes non entretenues étaient menacées de reprise et donc de disparition pour faire place à un parc mais une association s'est aussitôt constituée pour sauver ces vestiges, témoins d'une partie de l'histoire du Japon. À l'entrée de la section "étrangers" du cimetière, Shintaro Ishihara, gouverneur de Tôkyô, a fait poser une pierre circulaire indiquant en anglais que ladite section regroupe les tombes d'hommes et de femmes venus au Japon aux 19e et 20e siècles et ayant grandement contribué à la modernisation du pays : Laid to rest here in the "Foreign Section" of the Aoyama Cemetery are men and women who came to Japan in the 19th and early 20th centuries. Many of them played leading roles and contributed greatly to the modernization of Japan. We have erected this monument to commemorate their achievements and ensure their memory is passed on to posterity. March, 2007. Toute la section, désormais sauvegardée, fait encore actuellement l'objet de restaurations et, auprès des principales tombes, des panneaux donnent des renseignements biographiques bilingues (japonais et anglais) sur les personnes inhumées.
Signature :
par Jean-Marie Thiébaud
Biographie et généalogie de la famille de Gabriel Louis Sabas Faivre de Courcelles dit Febure (1726-1793), général de la Révolution
Jean Jacques Frédéric Faivre de Courcelles, né et baptisé à Vaucluse (Doubs) le 22.04.1673, dans son château de Courcelles-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 19.04.1747 et inhumé deux jours plus tard dans le chur de l'église de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux (Doubs), conseiller à la Chambre des Comptes de Dole, fils d'honorable Jean Ferdinand Faivre (1), de Courcelles-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs), notaire, juge-châtelain de la seigneurie de Vaucluse (Doubs) de 1654 à 1684, procureur de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche, Les Terres de Chaux (Doubs) de 1653 à 1685, et de Marie Antoine Magnin (2), demeurant à Fleurey (Doubs), avocat en Parlement, épousa, le 08.11.1718, Marie Philiberte de Sagey, née et baptisée à Ornans (Doubs) le 13.12.1683, fille de Jean François (alias Jean Claude) de Sagey, seigneur de Pierrefontaine (Pierrefontaine-les-Varans, Doubs), né vers 1653, à Ornans (Doubs) le 13.01.1724, et de Claude Louise Froissard. Ils eurent six enfants dont :
- Jean Joseph Théodore Faivre de Courcelles, l'aîné
- Gabriel Louis Sabas Faivre de Courcelles, né au château de Courcelles-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) (3) le 05.02.1726, lieutenant au bataillon de milice de Salins en 1744, enseigne en 1746 puis lieutenant au régiment de Beauce. Pendant la guerre de 1744 à 1748, il fit campagne en Flandre, en Allemagne et en Piémont. Promu capitaine le 08.12.1746 puis capitaine-commandant en 1753. Il servit au siège de Mahon en 1756, fit les campagnes de la guerre de Sept ans en Allemagne et fut blessé à Minden en 1759. Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, il reçut aussi la croix de chevalier de Saint-Louis en 1763 avant de servir en Corse en 1768. Chef de bataillon en 1774, il ne put obtenir le grade de lieutenant-colonel en dépit de ses notes de service fort élogieuses. On l'y décrivait comme "un très bon officier de race militaire, ayant toutes les qualités requises pour remplir une place qui lui était promise depuis longtemps. La Révolution lui donna l'occasion de réparer cette injustice. En effet, il fut élu, par les volontaires du Doubs, lieutenant-colonel du 1er bataillon du département mais, devenu colonel, il sera mortellement blessé devant Lauterbourg (Bas-Rhin), sur la frontière d'Alsace, le 18.09.1793. Ce ne fut que quelques jours après sa mort qu'arriva sa nomination comme général de brigade sous le nom de "Febure". Jean-Antoine Thiébaud, de Jallerange (Doubs), lieutenant au premier bataillon de volontaires du Doubs, lui avait prêté 1000 livres comme en témoignent deux billets signés les 13 juillet 1792 et 23 avril 1793 aux camps d'Haeslingen et de Wissembourg (Bas-Rhin). Cette somme n'ayant pu être remboursée, une saisie arrêt fut ordonnée sur les biens de Jean Josepf Théodore Faivre de Courcelles, le frère aîné du général, le 17 brumaire 1794.
Armoiries : Avant la Révolution, la famille Faivre de Courcelles portait : fascé de gueules et d'argent de quatre pièces, la première chargée de trois étoiles d'argent (alias : de gueules à deux bandes d'or, le chef chargé de trois étoiles d'argent).
(1) Né à Courcelles-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 02.05.1622, ibidem le 29.06.1684, inhumé dans l'église de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux (Doubs), fils de Jean Faivre le Jeune, notaire (fils de Ligier Faivre et de Jeannette Fallot, fille de Huguenin Fallot), et de Claudine de La Grange. Son parrain fut noble Jean Ferdinand Magnin, capitaine-châtelain de Châtillon-sous-Maîche, sa marraine Claudine Perrot. Ligier Faivre, père de Jean Faivre le Jeune était le fils de Jean Faivre, /1577, et de Vuillemette Vurpillot.
(2) Née au château de Châtillon-sous-Maîche (Les Terres de Chaux, Doubs) le 13.04.1636, baptisée audit lieu (l'église de Chaux-les-Châtillon ayant été saccagée et souillée par les Croates au début de la guerre de Dix Ans), au château de Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), le 17.06.1692, fille de Philibert Louis Magnin, de Fleurey (Doubs), chevalier, lieutenant du château de Châtillon-sous-Maîche, et de demoiselle Othilie Hendel, de Porrentruy (Suisse). Voir la généalogie des Magnin sur le site Internet http://www.jeanmariethiebaud.com
(3) Le château de Courcelles-les-Châtillon, alors propriété d'Auguste Garessus, a entièrement brûlé le 5 décembre 1907. Il avait été racheté comme bien national pendant la Révolution par les frères Claude-François et François-Xavier Garessus, ce dernier étant un ancêtre direct de l'auteur de cet article. Seule la chapelle castrale, sous le vocable du Seigneur Jésus et de la Vierge, reine de la Paix, fondée en 1671, par Jean Ferdinand Faivre et Marie Antoine Magnin, a échappé aux flammes. Elle subsiste et porte l'inscription : DEO FILIO VIRGINIQUE MATRI PACIS VOTA.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Sources et bibliographie : R.P. de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux (Doubs), d'Ornans et de Vaucluse ; Archives de l'Armée de Terre, château de Vincennes (dossier individuel de Gabriel Louis Sabas Febure) ; Jules et Léon Gauthier, "Armorial de Franche-Comté", n° 1759 ; "Dictionnaire de biographie française", publié sous la direction de Roman d'Amat, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1975, tome XIII, p. 494 (notice rédigée par E. Franceschini) ; Jean-Marie Thiébaud, "Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté", tome 1er, p. 300-301 ; "Le Petit Comtois", décembre 1907 (récit de l'incendie du château de Courcelles-les-Châtillon) ; Roger de Lurion, "Nobiliaire de Franche-Comté", p. 303-304 ; Jean Girardot, "Le département de la Haute-Saône pendant la Révolution", tome O, p. 211 ; Jean-Marie Thiébaud, "Histoire de l'église de Chaux-les-Châtillon et de sa paroisse" ; "Les Francs-Comtois de la Révolution", t. I, p. 524-525 ; "Dictionnaire des communes du Doubs" (sous la direction de Jean Courtieu), tome II, p. 986 (notice rédigée par Jean-Marie Thiébaud).
Les échevins de Sancey-le-Long (Doubs) 236 échevins de 1507 à 1790
1508 : Etienne MAIROT, Pierre PESEUX et Jean MALDINEY le Vieil
1521 : Pierre MAIROT et Estevenin PIGNET
1542 : Pierre MAIROT, Nicolas LIGIER, Guillaume MALDINEY
1544 : Jehan PESEUX, Pierre LIGIER, Richard PINET (PIGNET)
1545 : Jehan SERDET le Vieux, Nicolas LIGIER, Etienne MALDINEY, Jean PIGNET
1547 : Jean SERDET le Vieux, Pierre MAIROT et Jehan RESET (?)
1548 : Pierre BIGUENET, Jehan PESEUX le Jeune
1552 : Jehan PIGNET le Vieux, Pierre MALDINEY dit BIGUENET, Jehan ROBE (ROBBE)
1560 : Jehan SERDET
1561 : Estevenin BIGUENET, Jehan PESEUX le Vieux, Huguenin MALDINEY
1581 : Claude PESEUX, Antoine LIGIER
1583 : Jehan PESEUX
1587 : Claude, fils de feu Pierre BIGUENET, Pierre PESEUX (parfois remplacé par Claude PESEUX)
1588 : Jehan PESEUX, Pierre MORENARD (MORNARD)
1590 : Honorable Jehan BASSAND
1591 : François PARROT
1595 : François PARROT, Adrien LIGIER, Pierre PESEUX
1596 : Jehan SERDET le Jeune, Pierre MAIROT, Estienne V
1598 : Estienne PIGNET (ou PIGUET)
1601 : François PARROLZ (PARROT), Claude MALDINEY
1606 : Pierre PARROLZ (PARROT), Estienne MASSON le Jeune
1607 : Estienne GALZOT (GALLEZOT), Jehan LIGIER
1608 : André LIGIER, Jean LIGIER
1609 : Adrien LIGIER, Jehan RUSSELOT (ROUSSELOT), Jean TUZILLET (TUSILLET), Claude MALDINEY
1610 : Jehan LIGIER
1612 : Jean LIGIER, notaire, Adrien DIEULEFILS
1628 : Jean, fils de feu Claude LIGIER, Claude MALDINEY, maire de la seigneurie
1637 : Claude MONOT (MONNOT), Claude DELEFIT (DIEULEFIT)
1644 : Claude LIGIER
1647 : Jacques, fils de Guillaume LIGIER
1648 : Jean LIGIER
1649 : Pierre CUCHOT le Vieux, Pierre CUCHOT le Jeune
1656 : Jean BULLIARD
1657 : Claude BIGUENET, Pierre BIGUENET
1661 : Nicolas DESLEFIT (DIEULEFIT), Etienne LIGIER
1666 : Jean Baptiste LIGIER
1667 : Claude GERARD (ou GIRARD), Sébastien CRESTIN (CRETIN)
1668 : Jacques BIGUENET, Nicolas RICHARD
1669 : Claude LIGIER
1670 : Laurent BIGUENET, Estienne GALAIZOT (GALLEZOT)
1671 : Honorable Pierre BOUDARD, honorable Antoine SERDET
1672 : Honorable Jean CUENOT, maître Jacques SERDET
1673 : Honorable Jean LIGIER, Pierre COURTOT
1674 : Honorable Jacques COURTOT, Henri MASSON
1675 : Sébastien LIGIER, Marin BOURGOIN
1676 : Jean MALDINEY, Charles PEPIOT
1677 : Sébastien CRETIN, Jacques LIGIER
1678 : Louis CATEL, Jacques CUENOT
1679 : Claude MALDINEY, Sébastien LIGIER, Sébastien CRESTIN (CRETIN)
1680 : Honorable Simon PIGNET, honorable Pierre BOUDARD
1681 : Claude LIGIER le Vieil, maître Pierre CONSTET (CONTET)
1682 : Honorable Jacques COURTOT, Jean CUENOT
1683 : Maître Jean LIGIER, Claude MALDINEY
1684 : Sieur Sébastien LIGIER, maître Claude BULIARD
1685 : Jacques-François COURTOT, Pierre MAÇON (MASSON)
1686 : Pierre DELEFIT (DIEULEFIT) et Estienne GALEZOT (GALLEZOT)
1687 : Maître Etienne GALEZOT (GALLEZOT), Pierre DELEFIT (DIEULEFIT)
1688 : Simon CUENOT, Jacques François COURTOT
1689 : Jean MALDINEY, Louis CATEL
1690 : Sieur Jean-Baptiste COURTOT, honorable Jean MALDINEY
1691 : Sébastien CRESTIN (CRETIN)
1692 : Simon LIGIER, Simon PIGNET
1693 : Jean LIGIER, Claude MALDINEY
1694 : Honorable Jacques GIRARD, Jean Claude FAIVRE
1695 : Claude BULLIARD
1696 : Jacques-François COURTOT, Pierre BIGUENET
1697 : Jean Claude LIGIER
1698 : Sieur Jacques BOUDARD, Jean SERDET
1699 : Etienne GALLEZOT, Claude MASSON
1700 : Simon CUENOT, Etienne GALEZOT (GALLEZOT)
1701 : Simon PIGNET, Simon CUENOT
1702 : Sébastien CHRESTIN (CRETIN), Jacques GIRARD
1703 : Sébastien LIGIER, Pierre CUENOT le Vieim
1704 : Sébastien LIGIER, Pierre CUENOT
1705 : Pierre François BOURGOIN, Jacques BIGUENET, Didier BÉCOULET
1706 : Jean Claude MALDINEY, Jean Claude LIGIER
1707 : Etienne BIGUENET, Henry CUENOT
1708 : Jacques-François COURTOT, Claude BULIARD, Claude BÉCOULET
1709 : Nicolas, fils de feu Claude BIGUENET
1710 : Etienne GALEZOT (GALLEZOT), Jacques GIRARD le Jeune
1711 : Jean SORDET (SERDET), Louis NOIROT
1712 : Claudy BOITEUX, Guillaume GIRARD
1713 : Simon PIGNET (PIGUET)
1714 : Jean BIGUENET, Didier BÉCOULET ; Jean Baptiste COURTOT, maître chirurgien royal
1715 : Claude AZIER (alias ASIER)
1716 : Claude BULLIARD
1717 : Jean CRETIN, Claude AZIER (alias ASIER)
1718 : Ligier VANNOT (VANNOD)
1719 : Ligier HUGUENOT, Jean Baptiste CRUET (GRUET ?)
1720 : Honorable Guillaume COURTOT, Pierre MALDINEY
1721 : Jean Claude PESEUX, recteur d'école et maire de seigneurie
1722 : Honorable Claude MALDINEY, Jean BIGUENET, Jean Claude MONNOT
1723 : Claude AZIER (alias ASIER), Guillaume PIGUET (ou PIGNET), Didier BÉCOULET
1724 : Claude CAILLE, Jean BIGUENET le Vieux
1725 : Guillaume GIRARD
1726 : Claude DELEFILS (DIEULEFIT), Claude François SIROUTOT
1729 : Ligier VANNOT (VANNOD), Jacques COURTOT
1731 : Jean Claude MALDINEY, Jean SERDET
1732 : Pierre COURTOT, Jean Claude CUENOT, Pierre GIRARDET
1733 : Jacques GIRARDET, Jean BIGUENET, Pierre BIGUENET
1734 : Jean BIGUENET, Guillaume COURTOT
1735 : Jean Claude BIGUENET, Jacques BIGUENET, Didier BÉCOULET, honorable Jean Claude LIGIER
1736 : Jean Claude TRIPONNEY1738 : Didier BÉCOULET, Claude François CARTIER
1739 : Claude BIGUENET
1740 : Jean Claude PESEUX, recteur d'école et maire de seigneurie, Pierre CUENOT
1742 : Claude François BIGUENET, Claude DELEFILS (DIEULEFIT)
1743 : Pierre BIGUENET
1744 : Claude François PAHIN, Jean MALDINEY
1748 : Jean Baptiste CUENOT
1749 : Claude CAILLE
1750 : Jacques François MALDINEY
1752 : C. GIRARDET
1753 : Jacque AZIER (alias ASIER), Claude THOURET
1759 : Joseph BIGUENET
1760 : Claude BIGUENET
1761 : Claude François RABY
1769 : Sébastien VADAM, Jean Claude BÉCOULET
1771 : Joseph Hyacinthe Armogaste BIGUENET
1777 : Jean Claude BÉCOULET
1779 : Claude Louis PESEUX, Jean François THOURET
1780 : Jacques Antoine LIGIER
1781 : Jacques François MALDINEY
1799 : Jean François THOURET le Vieux (parfois remplacé par Jean Etienne THOURET le Vieux), Etienne BATAILLARD
1790 : Claude BIGUENET
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Source : Jean-Marie Thiébaud, Les échevins du bailliage de Baume-les-Dames (manuscrit).
Le ministre Jules François Stanislas Viette (1843-1894) et sa famille
Jules François Stanislas Viette eut une sur, Marie Françoise Joséphine Euphrasie Viette, née le 9 novembre 1833, décédée en 1925, épouse de Jules Huguet, procureur impérial à Pontarlier (Doubs), et deux frères morts en bas âge : Pierre Louis François Huguet, né le 8 août 1835, décédé le 26 septembre 1837, et Pierre Louis François Mathias Viette, né le 26 juillet, décédé le 14 septembre 1839.
Jules François Stanislas Viette, homme politique et journaliste (à La Démocratie franc-comtoise et à La République de l'Est), prit la tête d'une compagnie de corps francs en 1870-1871. Républicain radical, il a été élu député de l'arrondissement de Montbéliard (Doubs) et sans cesse réélu. Il devint ministre de l'Agriculture en 1887-1888 et des Travaux publics en 1892-1893. Il mourut à Paris en 1894.
Sources et bibliographie : Etat civil de Blamont ; Dictionnaire des communes du Doubs, tome I, p. 396.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
L'aristocratie japonaise
En 1884, en l'année 17 de l'ère Meiji, le gouvernement japonais établit une hiérarchie nobiliaire, parfaitement calquée sur les titres de la noblesse anglaise. L'ancien shogun, Tokugawa Yoshinobu avait déjà été élevé au rang de prince. Ce titre de prince (ko) fut également attribué aux héritiers des cinq familles de régents (go-seike) : les Konoe, les Takatsukasa, les Kujo, les Ichijo et les Nijo. Les Shô, descendants des rois des îles Ryükyü, durent se contenter du titre de marquis. L'ancienne maison royale de Corée, après l'annexion de ce pays par le Japon, reçut le titre d'ozoku (de lignage royal), d'un niveau certes inférieur à l'empereur mais supérieur à l'ensemble de la noblesse japonaise. Le titre de taikoxacu (grand-prince) est limité depuis 1963 aux descendants mâles du grand roi coréen Kojon.
Le 31 mars 1908, on dénombrait au Japon 15 ko (ou koshaku) (ducs), 36 ko (ou koshaku) (marquis), 100 haku (ou hakushaku) (comtes), 375 shi (ou shishaku) (vicomtes) et 376 dan (ou danshaku) (barons), le tout représentant 902 familles, comprenant en tout quelque 4600 membres.
De nos jours, on recense 25 princes, 50 ducs et marquis, 137 comtes, 429 vicomtes et 873 barons, soit 1514 personnes. Une loi adoptée en 1959 limite le nombre des princes, des ducs et des marquis et on ne peut en créer de nouveaux que si des lignées portant un de ces titres se sont éteintes.
Les titres se transmettent par ordre de primogéniture.
Le dévouement d'un noble japonais va jusqu'au sacrifice de sa vie. Le rituel du seppuku (suicide ritualisé) est le symbole de la valeur centrale de l'éthique de la noblesse japonaise. On retrouvera cetta attitude dans le dévouement sans limite des soldats japonais pendant la seconde guerre mondiale.
Mon, monsho, mondokoro et kamon désignent les symboles héraldiques familiaux. Le terme mon s'applique à n'importe quel symbole tandis que kamon et mondokoro s'appliquent uniquement aux symboles familiaux.
Signature :
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Bibliographie : Takie Suguyama Lebra, Above the Clouds. Status Culture of the Modern Japanese Nobility, Berkeley, University of California,1993.
Encyclopædia Britannica.
Richard J. Miller, Ancient Japanese Nobility : The Kabane Ranking System, University of California Publications : Occasionnal Papers, n° 7.
Toyohara Chikanohu, A Mirror of Japanese Nobility, 1887.
Dictionnaire biographique des Pays baltes Le personnel politique, diplomatique et militaire de 1918 à 2007 Table des noms cités
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
Paul Marie Joseph CLERC, lieutenant au 229e régiment d'infanterie, né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 18.01.1891, de ses blessures de guerre dans un hôpital de campagne à Bouleuse (Marne) le 13.04.1917.
Lucien Edmond Pélagie (Félagie sur le monument aux morts) COUSIN, sous-lieutenant
Ferdinand LASSAGNE, sous-lieutenant
Cyrille Adolphe Lucien LORIN, sergent au 8e régiment de marche, né à Remoray (Doubs) (Romoray aux Archives de Vincennes) le 11.07.1890, tué à l'ennemi le 05.11.1914
Rémi CHARMOILLAUX, sergent au 170e régiment d'infanterie, né à Frambouhans (Doubs) le 12.09.1893, porté disparu le 06.10.1915 (tué à l'ennemi, par jugement rendu le 21.08.1919 par le Tribunal de Pontarlier, transmis à Labergement-Sainte-Marie le 30.09.1919)
Maxime FRACHEBOIS, sergent (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Roger Lucien Arsène GUINCHARD, sergent fourrier au 45e bataillon de chasseurs à pied, né à Villers-sous-Chalamont (Doubs) le 29.05.1893, mort à l'ennemi à Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) le 29.08.1914
Marc Constant Amédée ROYET, maréchal-des-logis au 47e régiment d'artillerie, né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 07.07.1891, mort des suites de blessures de guerre à l'ambulance 3/7 à Cuperly (Marne) le 06.10.1915.
Jules Aimé Désiré AUTHIER, caporal au 132e régiment d'infanterie, né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 07.07.1880, tué aux Éparges (Meuse) le 05.04.1915.
André COMTE, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Auguste (Augustin Xavier Ferréol) CÔTE, 2e classe skieur du 60e R.O. en subsistance au 213e R.I., né à Rochejean (Doubs) le 26.10.1894, tué à l'ennemi à Nardenhutt (Haute-Alsace) (indét.) le 10.02.1915.
Charles CÖTE (Charles Félix Adolphe CÔTE-COLISSON), 2e classe au 171e régiment d'infanterie, né aux Granges-Sainte-Marie (Doubs) le 16.05.1878, tué à l'ennemi à la ferme de Navarin le 27.07.1915.
Arthur Joseph Alphonse CREVOISIER, 2e classe au 42e régiment d'infanterie, né aux Combes (Doubs) le 15.06.1895, tué à l'ennemi à Bouchavesnes (Somme) le 15.09.1916.
Théodule Ferjeux Arthur DUMONT, soldat au 7e R.I., né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 13.03.1889, tué à l'ennemi à Tigny (Aisne) le 31.05.1918.
Victorin Émile Alfred GUY, caporal au 97e régiment d'infanterie, né à Villedieu (Doubs) le 27.11.1897, tué à l'ennemi à Hooylede Thielt (Belgique) le 16.10.1918.
Fernand LESTRAT, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Louis Marius Jules LORIN, soldat au 149e régiment d'infanterie, né à Bonnevaux (Doubs) le 03.05.1893, mort des suites de ses blessures de guerre à l'hôpital de Besançon (Doubs) le 19.12.1914.
Paul Arsène MESNY, soldat de 1re classe au 149e régiment d'infanterie, né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 22.10.1893, tué d'un coup de feu au combat à Aix Noulette (Pas-de-Calais) le 09.05.1915.
Adrien PEYRONNET, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Francis ROBBE, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Raymond ROBBE, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Louis ROBBE, soldat (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Simon Joseph Émile ROUGET, soldat, né le 11.05.1894
Joseph François Fidèle ROUSSELET, soldat au 69e régiment d'infanterie, né à Labergement-Sainte-Marie (Doubs) le 03.12.1894, tué à l'ennemi à Beauséjour (Marne) le 10.10.1915.
Albert SAUVONNET, soldat au 128e régiment d'infanterie, né à Chaux-Neuve (Doubs) le 17.08.1882, mort de blessures de guerre à l'hôpital complémentaire n° 20 de Melun (Seine-et-Marne) le 05.08.1918.
Guerre 1939-1945
Roger PÂRIS, adjudant
Michel GARNACHE, sergent
Jean-Baptiste BOURGEOIS, soldat
Pierre DEFRASNE, soldat
Indochine
Baptiste LOCATELLI, sergent (non retrouvé aux Archives de Vincennes)
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les mots russes dans la langue française
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Anthroponymie : le forgeron
En France, les patronymes issus de cette profession sont légion et varient selon les régions : Fèvre, Lefèvre, Lefebvre, Lefebure, Faivre, Le Faivre, Favre, Fabre et la variante graphique Fabbre), Fabresse (matronyme), Faur, Faure, Fauré, Febry, Fabri, Fabbri, Fabry, Faury (ces cinq derniers patronymes étant des formes latinisées), Feubre (Poitou), etc. sans oublier Le Feuve et Le Feuvre (rencontrés en Bretagne) ni les diminutifs et hypocoristiques Faivret, Fauret, Favrel (forme archaïque), Favret, Favrey (Est de la France), Faveret, Faverot, Favrot, Favreau, Favereau, Febvret, Fevrat, Fevret, Faurel, Fauret, Faurial, Fauriat, Fauriel, Faurisson, Faurissou, Fauron, Faurot, Faurou, Faurou, Fauroux, Favrin, Favron, etc.
En Espagne et dans les pays d'Amérique latine, Herrero, Herrera
En Catalogne, Ferré, Farré, Farrer, Ferrer
Au Portugal et au Brésil, Ferreiro, Ferreira
En Italie, Fabri, Fabbri, Ferrari
En Allemagne et dans les pays de langue germanique, Schmid, Schmidt, Schmied, Schmit, Schmitt, Schmitz (forme génitive traduisant la notion "fils de") et les diminutifs Schmidlin, Schmitlein, Schmittlein, Schmitlin
En Arménie, Demirdjian
En Grande-Bretagne et dans les pays anglophones, Smith et quantité de dérivés, Smyth, Smither, sans oublier Smithson et Smythson ("fils" de Smith)
En Russie, Kouznetsov (de kouznets, le forgeron) et les dérivés Kuznits, Kuznitz, Kuznitski, Kuznicki qu'on retrouve aussi surtout en Pologne.
Aux Pays-Bas et en Belgique, Smid, De Smidt, De Smit, De Smet, De Smedt, etc., "De" étant l'équivalent de l'article français "le").
En Pologne, Kowal, Kovalski, Kowalski, Kovalevski, Kowalevski et autres variantes graphiques.
En Hongrie, Kovach, Kovacs, Kovats
En Slovaquie et en République tchèque, Kovac, Kovaci, Koval, Kovar. On retrouve Kovac, Kovic, Kovacevic en serbo-croate.
En Lituanie, Kalvaitis
En Ukraine, Kovalenko, Kovaltchouk (tirés du mot koval')
En Finlande, Seppänen
En Roumanie, Fieraru
En Turquie, Demirci
En Bretagne, Le Gof, Le Goff, Le Goffic (et Le Goïc, considéré comme un diminutif)
En Gascogne, Haure (et le diminutif Hauret), Hargou, Hargous, Laforge, Laforgue, Lahargou, Lahargue, Lahorgue, mais aussi Izarn (du gaulois izarnos, le fer).
En arabe, Addah qui a donné un patronyme porté par des familles juives
Chez les Gitans, Tcheraru, Tcherari, ce nom étant d'ailleurs porté par le baron des tziganes de Moldavie.
En Afrique, forgeron se dit teugg en ouolof, baïlo en peulh, Noumou en bambara (et en mandingue), ogoun, etc. Ces mots ne semblent pas avoir donné de patronymes mais on les retrouve assez fréquemment dans des prénoms. Ogun, par exemple, apparaît comme suffixe dans le prénom Olegosun du président Obasanjo du Nigéria. Baïlo Diallo est le ministre de la Défense de Guinée en 2007. Noumou est utilisé comme prénom au Libéria, etc.
Au Sénégal, Thiam (nom de famille très répandu).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, 3 juin 2007
Les gouverneurs d'Estonie (Empire de Russie) de 1710 à 1917
1711-29.05.1719 : Friedrich von Lieven
29.05.1719-19.11.1728 : Fedor Matveevitch Apraxine (27.11.1661-19.11.1728), amiral général de Russie, sénateur et conseiller privé
1730-21.10.1735 : Friedrich von Lieven
21.10.1735-26.07.1736 : Platon Ivanovitch Moussine-Pouchkine
1736-1738 : Sebastian Ernst von Manstein
1738-03.03.1740 : Otton Gustav von Douglas
03.03.1740-1743 : Valdemar (Vladimir) von Levendahl
13.10.1743-29.03.1753 : Petr August Friedrich von Holstein-Beck (1697-1775)
29.03.1753-30.03.1758 : prince Vladimir Petrovitch Dolgoroukov (1696-1761), fils du prince Petr Mikhaïlovitch Dolgoroukov ( 1708)
03.07.1783-23.10.1786 : Georg Friedrich von Grotenhelm
23.10.1786-28.11.1796 : Henrikh Ivanovitch von Wrangel
12.12.1796-25.01.1797 : Ivan Andreevitch von Wrangel
26.01.1797-14.06.1808 : Andreï Andreevitch von Langel
27.06.1808-03.08.1818 : Boris Vassilievitch von Uexküll
23.12.1818-27.07.1832 : Bogdan Vassilievitch (Gottard Wilhelm) Budberg (1766-29.07.1833)
20.09.1832-27.10.1833 : Otto Vassilievitch von Essen
27.10.1833-02.12.1841 : Pavel Ermolaevitch (Paul Friedrich) von Benckendorff
02.01.1842-21.12.1858 : Ivan Egorovitch (Johan Christoph) von Grünwald (Grünenwald)
23.06.1859-10.10.1868 : Vassilii Kornilovitch (Wilhelm Otto Kornelius Aleksandr) von Ulrich
11.10.1868-25.09.1870 : Mikhaïl Nikolaevitch Galkine-Vraskoï (1834-08.04.1916)
26.09.1870-11.03.1875 : prince Mikhaïl Valentinovitch Chakhovskoï-Glebov-Strechnev (1836-1892), général-leutenant, fils du prince Valentin Mikhaïlovitch Chakhovskoï (1801-1850). Il portait le nom Chakhovskoï-Glebov-Strechnev depuis le 12.10.1864 car il avait épousé, en 1862, Evguenia Fedororovna Breven, fille de Fedor Loguinovitch Breven, général-major, et de Natalia Petrovna Glebova-Strechneva, fille de Petr Fedorovitch Glebov et d'Elisaveta Petrovna Strechneva ( 1793).
14.03.1875-04.04.1885 : Viktor Petrovitch Polivanov ( 1889)
04.04.1885-12.10.1894 : prince Sergueï Vladimirovitch Chakhovskoï (1852-1894), fils du prince Vladimir Lvovitch Chakhovskoï (1813-1881)
25.10.1894-20.06.1902 : Evstafii Nikolaevitch Scalon
03.07.1902-04.03.1905 : Alekseï Valerianovitch Bellegarde (1861-1949)
04.03.1905-novembre 1905 : Alekseï Aleksandrovitch Lopoukhine (1864-01.03.1928)
novembre 1905-21.01.1906 : Nikolaï Gueorguievitch von Bünting (1861-1917)
21.01.1906-juillet 1907 : Piotr Petrovitch Bachilov
11.07.1907-1915 : Ismaïl Vladimirovitch Korostovets
1915-08.06.1917 : Petr Vladimirovitch Veriovkine
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les cimetières de Iaşi (Moldavie, Roumanie)
La population de Iasi était juive à 50% (1) ce qui explique l'importance du premier de ces cimetières. La plupart des noms sont d'origine germanique et les inscriptions gravées dans le marbre sont en allemand sur le recto de la pierre tombale (ex : "geliebt und unvergessen", "aimé et jamais oublié") et en hébreu au verso.
Le cimetière Eternitatea abrite un imposant monument dédié "Aux Français morts en Roumanie 1916-1918". En cours de restauration en mai 2007, il est formé d'un obélisque de couleur blanche, orné d'une croix de guerre. Une crypte fermée par une énorme chaîne cadenassée ne renferme plus que quelques plaques encastrées dans les murs latéraux. Sur 39 morts inhumés dans le caveau, ces plaques ne portent plus que les noms suivants, inhumés au cimetière Eternitatea de Iaşi le 22.01.1921 :
- Général LAFONT [conseiller du général Henri Mathias Berhelot (1861-1931), commandant de la mission militaire française à Iaşi], 29.11.1918
- Dr J. CLUNET, médecin-major du 2e C.T., 03.04.1917
- Eugène Joseph DUFRECHE, médecin aide-major de la 1re compagnie, hôpital n° 277, né le 18.03.1871, Botasani le 26.04.1917
- Marie PICARD, infirmière, 20.10.1917
- Omer ARCENS, capitaine, 15.04.1917
- Charles CAUBET, lieutenant, 16.04.1917
- Émile LOISEAU, adjudant, aviateur, 31.08.1917
- Mahomet BEN AM, caporal, 10.04.1918
- Léopold DELAFOY, caporal, 23.06.1917
- Célestin LECRET, soldat, 04.04.1917
N.B. : 677 Français sont tombés en Roumanie pendant la première guerre mondiale.
Un carré, à droite de l'allée principale et à une centaine de mètres de l'entrée du cimetière, regroupe des aviateurs militaires (avec les portraits de la plupart d'entre eux) :
- Petru BRUMA, lieutenant-major (14.06.1928-21.06.1954)
- C. CIOBANU, sergent (20.04.1927-29.07.1951).
- Elisei CONSTANTIN, adjudant aviateur, 20.04.1942.
- Trifan CONSTANTIN, major (21.04.1923-07.05.1964).
- Vasile CONSTANTIN, pilote (1919-1974).
- Alexandru COTET, lieutenant d'aviation (02.10.1927-04.08.1999).
- C. Ilie DINCA (20.07.1919-04.06.1944), adjudant aviateur.
- Petru DRAGAN, capitaine d'aviation (1911-1944).
- Dumitru GOLESCU, aviateur, lieutenant-major (10.06.1929-12.09.1954)
- Dumitru GRASNADU, commandant d'aviation (1886-1970)
- Vasile GRECU, instructeur de navigation (27.11.1931-01.04.1977).
- Vasile IRINESCU, adjudant, 19.05.1942, âgé de 22 ans.
- Teodor MELNIC, pilote (10.03.1910-08.06.1974).
- Dionisie NICHIFOR, capitaine, 24.07.1935.
- Gh. PARASGHIV, capitaine d'aviation (16.02.1902-25.02.1942).
- Ion PERIAL (29.10.1934-1986)
- Vasile PETREANU, pilote (21.08.1909-16.02.1991).
- Gheorghe POPA, pilote (02.08.1914-18.01.1967à.
- Vasile PROTOPOPESCU, capitaine d'aviation (1899-1923)
- Eugen RUS, officier aviateur (19.12.1919-14.10.1944)
- Vasile SPATARU, 11.10.1937, âgé de 37 ans.
- Gheorghie STEFANESCU, colonel (09.12.1918-04.11.1991)
- Dumitru TITIUNUC, adjudant aviateur (25.10.1901-03.10.1938). La pierre tombale porte en bas-relief une tête sculptée avec casque et lunettes de pilote.
- TOTORCEA (1902-11.09.1940), adjudant.
- Gheorge TROFIN, général-lieutenant
- Constantin UNGUREANU, lieutenant, 11.10.1937, âgé de 23 ans.
- Valentin VELEV, lieutenant, 06.08.1930, âgé de 25 ans.
- Trifan ZINOVA, instructeur parachutiste et pilote de planeur (15.02.1935-06.02.1968).
Parmi les autres tombes roumaines, on relève celles des familles Alexandrescu, Alexandroae, Alexandru, Ananiescu, Anderco (lieutenant-colonel Ioan Anderco, né le 15.11.1922, 02.07.1969), Andriescu (lieutenant-colonel Mihail C. Andriescu, commandant du bataillon des grenadiers de la Garde, né en 1894, 1938, inhumé aux côtés de ses parents, Const. Andriescu (1865-1943) et Elena Andriescu (1868-1948)), Anghelescu, Apostolide, Avram, Balaur, Bayer, Berinoe, Birleanu, Boboc, Boisteanu, Bratuleanu, Budescu, Budura, Bumbacescu, Busuioc, Butnaru, Cali (Maria Cali, née le 19.10.1874, 04.04.1878), Cascaval, Cernatescu, Cernescu, Chicos, Chiodariu, Chiriac (Andreican C. Chiriac, avec une chapelle), Chiruta, Ciornea, Ciuca, Climescu (Constantin Climescu, recteur de l'Université d'Iaşi, né le 30.11.1844, 06.08.1926), Cojacaru, Conta, Constantinescu, Cosmovici, Costrus, Cremenciuc, Cretu, Criste (famille du colonel Al. Christe), Culianu, Damaskin-Bojinca (Aga Damaskin-Bojinca, jurisconsulte, ministre de Moldavie, né en 1802, 17.08.1869), Daniil, Dascalescu, Densusianu, Dumitrascu, Doina (professeur Giurgea Doina, né le 05.10.1940, 15.11.2001), Dragomira (Louise Béatrice, née le 21.09.1921, 22.09.1942), Eftene, Enasescu, Enache (N. Constantin Enache, né le 30.01.1902, 19.12.1994 ; Agripina Enache, née le 07.04.1902, 25.06.1976 ; Aurica Enache, née le 25.12.1916 ; Neculai Enache, né le 15.02.1908, 16.07.1983; Ghe. Enache, né le 02.09.1918, 23.04.1985; Maria Enache, née le 23.08.1923, 06.05.1996), Gheorghiu, Ginju, Gligor, Grigore, Grigorescu, Gugeanu, Gutu, Hartinguer, Hauta (Lioara Minodora Hauta, née en 1975), Hodorogea, Holban, Hotnoc, Ibanescu, Ionescu, Iordachi, Jorgu, Juncu, Kernbach, Lates, Lazar, Leica, Lesnea, Lozinschi, Luca, Lupu, Macri, Manolescu, Marzescu, Melnic, Mihailov, Minea (Ilie Minea, professeur d'Université, hé le 15.07.1881, 20.02.1943), Mocanu, Morosanu, Moruzi (chapelle ornée d'armoiries sur le fronton : parti : au 1, de à l'aigle éployée de enserrant une épée posée en barre, la pointe en bas, et accompagnée en chef d'une étoile à six rais de ; au 2, de à un rencontre de taureau surmonté d'une étoile à six branches de ; au chef de à trois étoiles à six branches de , rangées en fasce. L'écu est surmonté d'une couronne fermée), Motas, Muscalu, Musicescu, Neagu, Neamtu, Nechita (lieutenant-colonel Toader Nechita, né en 1926), Neculai, Neculau, Nemteanu, Nepoceantkovski, Netedu, Nistor, Nour (Dr Virgil Nour, 1922-2006), Olcescu, Ostapovici, Pamfil, Pascariu, Paun, Penescu, Petru, Petruc, Pistol, Plesca, Podoleanu, Popa, Popovici (professeur Grigori Popovici, 1933-2002), Psait, Puiu (Dr Liliana Puiu, née en 1968), Raigu, Rauss, Ravarut (Mihai Ravarut, professeur émérite d'Université, 1907-1981), Rivalet, Rosu, Rotschung, Sandu-Ville (Constantin Sandu-Ville, docteur, professeur, né en 1897, 13.10.1969), Savini (Emil Savini, professeur de la Faculté de Médecine, 1880-1929), Simonescu, Sirotta, Slavic, Solomon, Sordhan, Stancaciu, Stanescu (lieutenant-colonel Mihai Valentin Stanescu, né en 1967), Staniceanu, Stanicel, Strachinaru, Taraboiu, Teodorescu, Teodoriu, Teodorovici, Tepordei, Tilea, Toma (capitaine Augustin Toma, né en 1968, 09.01.2006), Tomm, Trifan, Trus, Tudose (lieutenant-colonel Valeriu Tudose, né le 13.12.1915, 11.03.1991), Turta (Rodica Turta, professeur de français, née le 23.09.1946, 25.07.2003), Ungarasu, Usurelu, Vasiliu, Vataman, Vieru, Zacordonet (Alexandru Zacordonet, docteur, professeur d'Université, 1912-1977), Zavalide, Zota, etc.
Quelques civils russes : famille Cheptine (Vladimir Cheptine, né le 12.12.1914, et Olga Cheptine, née le 16.12.1918), etc.
Quelques civils français : famille Petit (F. Jean E. Petit, né le 15.09.1915, 19.01.1971 ; Anne Petit, née le 31.12.1916, 28.01.2002), famille Place (Victor Place (1818-1875), consul de France à Iaşi de 1855 à 1863 ; Henri Philippe Ernest Place, né à Paris le 01.12.1854, en Roumanie le 01.06.1947 ; Thomas Victor Place), Victor Castan (qui a "roumanisé" son patronyme en Castano), professeur de français, auteur d'un dictionnaire franco-roumain (avec un buste sculpté par I. C. Dumitru-Bïrlad), familles Launay, Patrognet, Rivalet, Sibi, etc. (dans la parcelle catholique).
Un Coréen : Son Ben dun (1922-décembre 1960), étudiant.
Au centre du cimetière s'élève l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, inaugurée le 01.09.1876.
Le cimetière Eternitatea abrite aussi des cimetières militaires : un roumain et un soviétique. Ce dernier regroupe, sur quatre rangées parallèles, des soldats morts pendant la seconde guerre mondiale. Dans ce cimetière soviétique, un des monuments, celui du major Mikhaïl Ivanovitch Lopatine, est surmonté d'une croix orthodoxe. Cet ajout semble assez récent. L'ensemble des tombes est regroupé autour d'un monument central commémoratif de la première guerre mondiale, portant cette inscription en français et en russe : "Aux vaillants héros de la Grande Russie tombés pour le bonheur des peuples en 1916-1918 sur le front allié russo-roumain". Dans cette partie du cimetière, la plupart des tombes sont anonymes et portent uniquement la mention "héros soviétique" en roumain ("Eroi Sovietici") avec une étoile rouge. Quelques pierres tombales portent toutefois les inscriptions suivantes :
- V. I. ALEKSEEV, soldat- Mikhaïl Iakovlevitch BALINE, soldat- I.M. BONDARENKO, 1898-1945- Dmitrii Mikhaïlovitch BOZANOV, 1897-1944- Petr Pavlovitch CHTCHERBAR, sergent, 1916-1944- David Alekseevitch DAVIDENKO, 1905-1945- Boris Mikhaïlovitch DMITRIEV, premier lieutenant, 1911-1944- A. S. EFIMOV, soldat, 1911-1944- P. V. ELISEEV, soldat, né en 1925- Dmitrii Efimovitch ELKIARENKO, 1944- Ivan Grigorovitch EREMENKO, sergent, 1915-1945- Aleksandr Fedorovitch GOLOVOKOV, sergent, 1914-1945- Konstantin Stepanovitch GRATCHEV, 1924-1945- Iakov IARMOURAKA, 1921-1944- A. E. IASSOVINE, lieutenant, né en 1916- Iliia Anfumovitch JOUKOV, 1905-1945- Anatoli Nikolaevitch KAZATCHENKO, 1924-1945- Anna Grigorievna KAZDEM, 1921-1945- B. A. KISSELEV, sergent, né en 1894- Ivan Gavrilovitch KOPYLOV, soldat, 1911-1944- Mikhaïl Stepanovitch KOROL, 1944- Viktor Vladimirovitch LITVINENKO- Mikhaïl Ivanovitch LOPATINE, major- Nikolaï Vassilievitch MALIKOV, sergent, 1915-1945- Pavel Ivanovitch MATENTSOV, 1921-1944- Iliia NAZAROV, sergent major- OUDODINE, sergent, né en 1923- Pavel Klimentievitch OUVOROV, sergent, 1914-1945- Dmitrii Iakovlevitch PERVOUCHINE, capitaine, 1905-1945- N. S. PONOMARENKO, soldat, 1944- P. A. POSMARKINE- A. P. POTNEVSKII, soldat, né en 1921- Aleksandr Nikolaevitch PRISTAV, 1915-1945- V. Efimovitch PRONSKII, 1911-1944- Savva Vassilievitch RIJKOVOÏ, soldat, 1911-1944- Iakov Ivanovitch SAMARA, 1927-1944- V. S. SEPEAKOV, sergent, 1918-1945- N. T. SOKOURENKO, soldat, né en 1907- Sergueï STEFANOV, lieutenant major- Ivan STEPANOV, 1926-1945- P. M. TCHERNYNE, 1919-1944- M. Ivanovitch TODOSENKO, 1907-1944- Ivan Filimonovitch TOUGOV, 1909-1945- Viktor Andreevitch TOUNAR, soldat- Venedikt VASSILIEV, 1921-1945- A. S. VNOUKOVOÏ, 1922-1945- Iakov Antonovitch VOINIKOV, sergent, 1923-1944*****
Au monastère Frumoasa, sur les hauteurs de Iaşi, se trouve un monument où sont inhumés les membres de la famille de Mihail STURDZA, né en 1758, 13 mars 1833, grand logothète, chevalier de Sainte-Anne. Derrière l'église, quelques tombes de prêtres :- Ioan BUZILA (1), 1905-1950- Mihail GROSU, 1904-1956- Nicodim X. PETRANICI, 31.10.1881-10.05.1958
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) La première synagogue a été construite en 1796 sur intervention du gouvernement autrichien.
(2) Buzila, en roumain, signifie "lippu", celui qui a de grosses lèvres.
Ascendants de Jean Jacques Girard, de Sancey (Doubs) Meunier, XVIe-XVIIe siècles
Génération 1
1 Jean Jacques Girard, né le 22 novembre 1710, Sancey (Doubs), baptisé audit lieu, décédé en 1793, Goux-les-Vercel (Doubs), meunier, échevin de Rosières-sur-Barbèche (Doubs) en 1777. Marié en 1734 avec Anne Marie Petitcuenot.
Génération 2
2 Claude François Girard, né le 31 décembre 1670, Sancey (Doubs), baptisé, Sancey (Doubs), meunier et échevin de Rosières-sur-Barbèche (Doubs).
3 Anne Françoise Vyatte, née en 1670, décédée le 2 juin 1762, La Barbèche, paroisse de Dampjoux (Doubs).
1. Jean Claude Girard, né le 6 juin 1699, Sancey (Doubs). Marié en 1723 avec Claude Françoise Thiébaud, fille d'Etienne Thiébaud et d'Anne Marie Racine.
2. Claudine Gitard, née vers 1700, décédée le 1er mars 1768, Dampjoux (Doubs). Mariée avec François Bonvalot, né le 7 avril 1689, Feule (Doubs), baptisé à Dampjoux (Doubs), décédé le 23 janvier 1747 à Feule (Doubs), inhumé à Dampjoux (Doubs), meunier au moulin neuf de la Barbèche à Feule (Doubs) et laboureur, fils de Pierre Antoine Bonvalot et Marguerite Bonnot.
3. Claude Françoise Girard, née vers 1701, Rosières-sur-Barbèche (Doubs), décédée le 15 septembre 1788 à Peseux (Doubs), inhumée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs). Mariée le 30 novembre 1723 à Chaux-lès-Châtillon Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Jean-Noël Thiébaud, né le 20 juillet 1687, Peseux (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon Les Terres-de-Chaux (Doubs), décédé le 31 juillet 1764 à Peseux (Doubs), inhumé audit Chaux-les-Châtillon, laboureur puis entrepreneur des bois pour la marine du Roi., fils de Jean Thiébaud 1644-1724 et Anne Ponceot 1654-1724.
4. Jean Jacques Girard, né le 22 novembre 1710 à Sancey (Doubs), baptisé audit lieu, décédé en 1793 à Goux-les-Vercel (Doubs). V. 1.
Génération 3
4 Pierre Girard, né le 25 septembre 1644 à Sancey-le-Long (Doubs), baptisé à Sancey l'Eglise (Doubs), meunier.
5 Françoise Pahin, née le 26 novembre 1644 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisée audit lieu.
dont:
1. Claude François Girard né le 31 décembre 1670 à Sancey (Doubs), baptisé audit lieu.
2. Jeanne Claude Girard, née le 29 novembre 1672 à Sancey (Doubs), baptisée audit lieu.
3. Catherine Girard, née le 25 novembre 1674 à Sancey (Doubs), baptisée audit lieu.
4. Jean Charles Girard, né le 21 juin 1677 à Sancey (Doubs), baptisé audit lieu.
5. Jacque Girard, née le 29 avril 1680 à Sancey (Doubs), baptisée audit lieu, décédée le 7 octobre 1770 audit Sancey. Mariée avec Jean-Claude Peseux, recteur d'école, maire de la baronnie de Belvoir (Doubs).
6. Pierre Girard, né le 14 mars 1686 à Sancey (Doubs), baptisé audit lieu.
6 Nicolas Vyatte
7 Anne Boillot
dont:
1. Anne Françoise Vyatte, née en 1670, décédée le 2 juin 1762 à La Barbèche, paroisse de Dampjoux (Doubs). V. 3.
Génération 4
8 Claude Girard
9 Denise Thouret, née le 14 février 1602 à Orve (Doubs), baptisée à Sancey, décédée à Sancey-l'Eglise (Doubs)
dont:
1. Anne Girard, née le 2 novembre 1639 à Sancey-le-Long (Doubs),
2. Catherine Girard, née le 25 décembre 1641 à Sancey-le-Long (Doubs),
3. Pierre Girard, né le 25 septembre 1644 à Sancey-le-Long (Doubs), baptisé, Sancey l'Eglise (Doubs),
4. Eve Girard, née le 9 mai 1647 à Sancey-le-Long (Doubs), décédée. Mariée avec Pierre Bassand.
10 Claude Pahin, né le 6 juin 1617 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu.
11 Barbe Truchot
dont:
1. Françoise Pahin, née le 26 novembre 1644 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisée audit lieu. V. 5.
Génération 5
18 Pierre Thouret
19 Claude Bécoulet
dont:
1. Denise Thouret, née le 14 février 1602 à Orve (Doubs), baptisée à Sancey, décédée le 5 février 1677 à Sancey-l'Eglise (Doubs). V. 9.
20 Jacques Pahin, né le 20 mars 1593 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu.
21 Thienette N
dont:
1. Claude Pahin, né le 6 juin 1617 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu. V. 10.
Génération 6
40 Jean Pahin, né le 25 mars 1565 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu.
41 Vuillemette N
dont:dont: 1. Jacques Pahin, né le 20 mars 1593 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu.
2. Etienne Pahin, né le 6 janvier 1596 à Sancey (Doubs)
3. Jeanne Pahin, née le 23 août 1597 à Sancey (Doubs)
4. Jean Pahin, né le 13 janvier 1601 à Sancey (Doubs),. Marié avec Marguerite de Villers.
5. Claudine Pahin, née le 16 mars 1603 à Sancey (Doubs)
6. Jean Pahin, né le 26 janvier 1606 à Sancey (Doubs)
7. Claude Pahin, né le 26 janvier 1609 à Sancey (Doubs), décédé. Marié avec Jeanne de Villers née à Laviron (Doubs).
8. Guillemette Pahin, née le 28 avril 1614 à Sancey (Doubs).Génération 780 Guillaume Pahin, né vers 1530
81 Françoise N
dont:
1. Jean Pahin, né le 25 mars 1565 à Sancey-l'Eglise (Doubs), baptisé audit lieu.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les ambassadeurs U.S. dans les pays baltes en 2005-2007
TODD BAILEY Catherine, née dans l'Indiana, nommée ambassadrice en Lettonie par le président George W. Bush le 08.09.2004. Membre active des campagnes électorales du Parti Républicain. Elle a présenté ses lettres de créance à la présidente Vaira Vike-Freiberga le 04.02.2005. Mariée, quatre enfants.
WOS Aldona Zofia (Mme), o Varsovie (Pologne), élevée à Long Island, New York (U.S.A.), fille de Paul Zenon Wos, survivant du camp de concentration de Flossenbürg (Allemagne), récipiendaire du titre de "Juste parmi les nations". Elle fut diplômée de l'Académie de Médecine de Varsovie, ayant ensuite prolongé sa formation en médecine et en pneumologie à New York. Membre active du Parti Républicain. Le président George Bush l'a nommée membre du Conseil du Mémorial américain de l'holocauste suite à l'action qu'elle a menée pour rappeler la situation des juifs polonais pendant la seconde guerre mondiale. Elle devint la 5e ambassadrice d'Est. aux U.S.A. à compter du 13.08.2004. Elle a épousé Louis DeJoy et le couple a des jumeaux, nés en 1996.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, le 15 avril 2007
Commandants du 1er R.E.P. (Régiment Etranger Parachutiste) de 1956 à 1961
(Régiment Etranger Parachutiste)
06.02.1956 : Le 1er R.E.P. reçoit comme chef de corps, le lieutenant-colonel Albert
BROTHIER qui est à la tête du 1er R.E.P. pendant l'opération du canal
de Suez.
Le relais est pris par le lieutenant-colonel Maurice (Pierre, Paul) JEANPIERRE, né à Belfort (Territoire-de-Belfort) le 14.03.1912, tué
à Guelma (Algérie) le 28.05.1958.
17.06.1958 : Colonel Albert BROTHIER, renommé commandant du régiment. Il
reçut le drapeau du régiment des mains du général Massu.
01.05.1959 : Colonel Henri DUFOUR (qui avait choisi la Légion à sa sortie de Saint-
Cyr en 1934)
07.12.1960 : Lieutenant-colonel Maurice, Victor GUIRAUD, né à Mazamet (Tarn) le
08.06.1915, fils d'Emile Louis Etienne Guiraud et de Thérèse Louet.
18.04.1961 : Lieutenant-colonel Hélie DENOIX de SAINT-MARC, né à Bordeaux
(Gironde) le 11.02.1922, fils de Joseph Denoix de Saint-Marc et de
Madeleine Buhan. Commandant en second, assurant l'intérim pendant
une permission du lieutenant-colonel Guiraud.
30.04.1961 : Dissolution du 1er REP à Zéralda après la participation de ce régiment
au putsch.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France d'Ouvans (Doubs)
- Aimable Just Félicien (dit Félicien) ALIX, né à Ouvans (Doubs) le 26 février 1882, 2e classe au 146e régiment d'infanterie, mort en captivité au lazaret de Lansdorf (Allemagne) le 12 octobre 1918.
- Marie Joseph Benoît (dit Benoît) BERCOT, né à Ouvans (Doubs) le 13 septembre 1898, 2E classe au 35e régiment d'infanterie, décédé à l'hôpital militaire de Belfort (Haut-Rhin) le 3 février 1919 des suites d'une maladie contractée en service.
- Léon Jules Constant (dit Léon) BERNARDOT, né à Laviron (Doubs) le 6 décembre 1894, 2e classe au 25e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi dans la forêt d'Apremont le 23 avril 1915.
- Henri Joseph (dit Henri) BOLARD, né à Longechaux (Doubs) le 12 septembre 1890, 2e classe au 172e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à la butte de Souain (?) (Marne) le 28 septembre 1915.
- Marie Émile Henry (dit Henri sur le monument aux morts) CREUILLOT, né à Ouvans (Doubs) le 21 février 1886, 1re classe au 169e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi dans le secteur de Prosnes (Marne) le 21 avril 1917.
- Georges JACQUOT
- Jean Just Joseph (dit Just) VERNIER, né à Ouvans (Doubs) le 21 septembre 1895, soldat au 132e régiment d'infanterie, disparu au combat à Trélon (Nord) le 15 octobre 1918.
- Gaston VUILLEMIN
- Marie Stéphane (dit Stéphane) VUILLEMIN, né à Ouvans (Doubs) le 3 septembre 1883, soldat au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, tué à l'ennemi au fort de Vaux (Meuse) le 14 juin 1916.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France d'Aïssey (Doubs)
- Joseph Félicien (dit Joseph) BOUCARD, né à Aïssey (Doubs) le 2 mars 1885, 1re classe au 11e régiment de chasseurs, tué à l'ennemi à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) le 25 septembre 1915.
- Charles COLIN. Parmi tous les Charles Colin tombés pendant la guerre, un seul était quadragénaire : Charles Louis Colin, né à Saint-Juan (Doubs) le 3 août 1875, mort à l'hôpital compl émentaire de Charmes (Vosges) le 13 août 1917 des suites de blessures de guerre.
- Georges DESCHAMPS (non retrouvé dans les archives du S.H.A.T.)
- Louis Irénée (dit Louis) ESTAVOYER, né à Aïssey (Doubs) le 27 février 1881, 2e classe au 132e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi aux bois des Éparges (Meuse) le 9 avril 1915.
- Henri FITSCH, né à Orsans (Doubs) le 9 juillet 1894, soldat au 171e régiment d'infanterie, mort à l'hôpital de Rethenans Belfort (Haut-Rhin) le 23 septembre 1914 d'une maladie contractée en service
- Louis NACHIN (non retrouvé dans les archives du S.H.A.T.)
- Claude Louis Paul (dit Paul) RICHARD, né à Aïssey (Doubs) le 11 juin 1894, 2e classe au 7e régiment d'infanterie, tué au bois Contant près de Verdun (Meuse) le 5 août 1916.
Guerre 1939-1945
- Camille COLIN
- Léonie ESTAVOYER née TISSERAND
- Suzanne ESTAVOYER
- Roger LECLERC
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France d'Adam-lès-Vercel (Doubs)
- Auguste Éloi Joseph (dit Auguste) AMIOT, né à Adam-lès-Vercel (Doubs) le 17 février 1883, 2nd canonnier au 101e régiment d'artillerie lourde, tué à l'ennemi à Verdun (Meuse) le 13 septembre 1917.
- Clément Germain Maximin (dit Clément) DÉTOUILLON, né à Adam-lès-Vercel (Doubs) le 8 mars 1896, tué à l'ennemi au combat de Barenton Cel (Aisne) le 19 octobre 1918.
- Charles Jules Auguste (dit Jules) DÉTOUILLON, né à Adam-lès-Vercel (Doubs) le 26 avril 1887, mort de blessures de guerre à Guildviller (Alsace) le 25 septembre 1914.
Nourriture, santé, longévité Conférence donnée à Besançon le 3 mars 2007 à la SNAAG Société Nationale des Anciens et des Amis de la Gendarmerie
Le lien entre alimentation et santé est une évidence.
Nous sommes, depuis notre naissance et même depuis les premiers jours de notre vie embryonnaire constitués d'atomes et de molécules que nous avons bus et mangés, mais aussi fumés car notre organisme possède plusieurs portes d'entrée : le tube digestif certes, mais aussi les poumons et on comprend mieux la campagne intensive anti-tabac qui a commencé aux USA et s'étend actuellement aux pays de la communauté européenne. On pourra aussi, si vous le souhaitez, en dire quelques mots dans les questions diverses.
Dans les pays industrialisés, les deux grandes causes de mortalité sont, c'est bien connu, les CANCERS et les maladies CARDIO-VASCULAIRES (les accidents cardiaques, circulatoires et cérébraux) qui fauchent à elles deux 80 à 90% des Européens et des Américains à des âges de plus en plus avancés mais parfois, hélas, à la fleur de l'âge, alors que bon nombre de ces décès prématurés auraient pu être empêchés.
D'où une première série de questions, liste à laquelle vous serez invités à ajouter les vôtres pour toutes sortes d'interrogations qui pourraient rester en suspens.
1. - Les cancers ont-ils un lien avec l'alimentation ?
2. - Les maladies cardio-vasculaires sont-elles la conséquence des aliments que nous consommons ?
La réponse à la seconde question est facile, vous la connaissez tous. La sagesse populaire n'affirme-t-elle pas, avec raison, que nous avons tous l'âge de nos artères ? Et comment les artères se détériorent-elles ? Elles vieillissent certes et à des vitesses différentes selon notre hérédité, c.a.d. notre patrimoine génétique, tout comme certains ont de l'arthrose dès l'âge de 40 ans alors que d'autres en sont presque totalement préservés à 80, tout comme certains voient leur capital intellectuel et leur mémoire s'altérer dès la quarantaine alors que Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), écrivain français, neveu de Corneille, jonglait allègrement avec ses neurones aux alentours de 100 ans. Son capital intellectuel, on le préserve en faisant faire de la gymnastique à son cerveau mais aussi en prenant soin, grand soin de son alimentation. Car le cerveau utilise deux types essentiels de carburants : l'oxygène et le glucose. Sans oxygène, les cellules nerveuses souffrent puis meurent en quelques minutes. Sans glucose, les cellules nerveuses souffrent et si le taux sanguin de sucre s'abaisse trop, c'est la possible syncope (le fameux coup de barre de 11 h du matin, lié au fait que les Français ne savent pas petit déjeuner) puis si la chute du sucre se poursuit le coma (qu'on voit, par exemple, chez des diabétiques qui ont fait leur injection d'insuline sans manger) et, terme ultime du coma : la mort. Pour l'oxygène, c'est simple : il suffit de ne pas fumer, mais surtout de respirer (ce que nous faisons sans y réfléchir depuis notre arrivée sur cette planète), de marcher (ce que beaucoup hélas commencent à ne plus savoir faire) et de faire un peu d'exercice, ne serait-ce qu'abandonner les ascenseurs lorsqu'il n'y a qu'un ou deux étages à monter. Le glucose, lui, est apporté par l'alimentation (et par nos graisses de réserve si nous sommes en période de famine ou de régime alimentaire). Oui, mais, le glucose, C6H1206 pour les passionnés de chimie qui veulent savoir ce qu'ils mangent, le glucose, c'est le sucre et ne dit-on pas beaucoup de mal du sucre partout : à la télévision, sur les emballages de nos aliments et de nos boissons, etc. ? Partout, une seule consigne : sucre : 0. Tout est sans sucre, tout se doit d'être light, ultra-light (y compris le déodorant et là, on ne comprend plus très bien, mais arrêtons cette digression). Oui, mais, notre cerveau, notre ordinateur central, nos muscles ont besoin de sucre, un besoin vital. Alors, cette chasse au sucre, vérité ? mensonge ? Vrai pour certaines personnes ? Faux pour d'autres ? Ce serait oublier qu'il y a sucre et sucre : il y a le sucre tout blanc, celui qu'on trouve en morceaux et en poudre (et, dans la même famille, les friandises, les sodas et l'alcool) et il y a les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les fruits. Donc, pour se résumer, les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres dits rapides qui envoient en quelques minutes une giclée de glucose dans le sang, un coup de fouet pouvant être des plus utile lors d'un accès de fatigue à l'effort (ex : une tranche de pain d'épices ou une barre de chocolat en pleine escalade de la face Nord du Mont-Blanc) mais dont l'effet s'estompe vite. Et les sucres dits lents car ils distillent du sucre dans l'organisme pendant des heures et des heures, raison pour laquelle, il sera par exemple opportun de manger ½ kg de pâtes la veille au soir avant de prendre le départ du marathon de New York. Et le moment est peut-être venu de parler du grignotage, véritable maladie de civilisation pour certains et d'abord pourquoi le grignotage est-il source d'obésité ? Imaginons que, subitement, nous ayons une "petite faim" vers 9 h 30 du matin et cela, bien sûr, parce que notre petit déjeuner était plus qu'insuffisant (se réduisant même pour bon nombre de Français à une simple tasse de café et, dans ce domaine au moins, les Britanniques font preuve de plus d'intelligence que nos compatriotes en absorbant dès l'aube des ufs, du bacon, des beans, des céréales, des toasts, des jus de fruits et que sais-je encore ). Imaginons donc que nous ayons cette petite faim de 9 h 30, nous la calmons en mangeant, par exemple un fruit bien en évidence dans une corbeille trônant sur un meuble de la cuisine. Une pomme n'a jamais fait grossir, n'est-ce-pas ? Mensonge, bien sûr : une pomme, comme tous les fruits, ce n'est que du sucre et de l'eau. Et le sucre, ça fait grossir, c'est bien connu. Donc nous mangeons une pomme qui, ô miracle, calme notre faim en 2 ou 3 minutes. La faim était due à une baisse du taux de sucre dans le sang (habituellement et normalement : 1 g environ/litre), chiffre qui avait pu descendre à 0,70, 0,60 g ou même plus bas. Le sucre de la pomme, déjà passé en partie dans le sang au niveau de la bouche, fait joyeusement remonter le taux de ce sucre défaillant. Non seulement le sucre remonte à 1 g /litre de sang mais grimpe joyeusement jusqu'à 1,40, 1,50 g. Si ce taux continuait à monter (ce qui se passe chez les diabétiques), nous serions en danger. Heureusement, notre pancréas analyse minute après minute notre taux sanguin et dès que le taux du sucre atteint un certain seuil, se met à secréter de l'insuline. Cette giclée salutaire d'insuline fait descendre le taux : de 1,50, il redescend à 1,30, 1, 10, 1 g (le bon taux), ouf ! Mais non, une heure plus tard, la descente continue encore : 0,80, 0,70, etc. Et la faim réapparaît. Tiens, si je mangeais un petit morceau de chocolat ou un yaourt, nature bien sûr, à 0% de matières grasses, bien sûr, bio bien sûr. Et les yaourts maigres, c'est bien connu, ça ne fait pas grossir Mensonge, un yaourt, c'est du sucre et l'insuline recommence son petit balai. Et, des mois, des années plus tard, c'est 5, 10, 20, 30 ou 50 kg de plus sur la balance car le corps ne sait quoi faire de ces apports de sucre à répétition et quand il ne sait pas quoi en faire, il stocke ces sucres sous forme de graisse (et qui dit graisse dit cholestérol, triglycérides et athérosclérose, c.a.d., dépôt qui s'accumule sur la paroi de nos artères, les durcit et finit même par les boucher. Or, on croit toujours que les graisses du sang viennent des graisses que nous mangeons, elles viennent aussi en grande partie des sucres. La graisse d'ours ne vient-elle pas du miel dont ces plantigrades adorent se gaver ? Mais, pour un ours, se gaver de sucre, c'est parfaitement justifié : il va hiberner et il lui faut des stocks pour survivre au cours des longs mois de son hibernation. Or, à ma connaissance, les adultes et les enfants, Américains et maintenant Européens, hibernent peu. Quoi que nous eut dit un humoriste fameux, hélas disparu. Et néanmoins, ces adultes et ces enfants des temps nouveaux, ils grigotent devant la télévision force entremets, gâteaux plus ou moins chocolatés, chips, pop corn, cacahuètes, pistaches, tout en buvant force sodas ou cannettes de bière (la bière accompagnant systématiquement le formidable effort physique des amateurs de football enfoncés dans leurs fauteuils, croyant peut-être faire ainsi du sport alors qu'ils se contentent de regarder sur le petit écran ceux qui en font vraiment en suant sang et eau sur le gazon.Tout cela peut-il changer ? Les pouvoirs publics et, récemment, les grands industriels de l'alimentation (Coca-cola, Mac Do et consorts) viennent de signer une charte les obligeant, sans sanction, à signaler désormais systématiquement : "Une alimentation trop riche en sucres, trop riche en sel, trop riche en graisses est dangereuse pour la santé". Je ne suis pas sûr que nos chères têtes blondes sachent toutes lire dès l'âge de 4-5 ans, âge où l'obésité a souvent déjà commencé, et pas sûr que les plus âgés tiennent compte de ces sages conseils qui à force d'être désormais balancés urbi et orbi auront tôt fait de perdre leur pouvoir de convaincre. Ce n'est pas, hélas, la mention "danger cancer" sur les paquets de cigarettes qui a freiné le tabagisme. Néanmoins tout espoir n'est pas perdu : Coca-cola, par exemple, a pris deux mesures drastiques : on va revenir à des conditionnements plus raisonnables : 20 à 25 cl au lieu des 50 cl qu'on voit se multiplier chez nous alors qu'aux USA, on vous sert 50 cl uniquement si vous avez expressément précisé "small", "medium" et "maxi" s'appliquant à des quantités d'un litre et de deux. Ces récipients en carton capables de contenir 2 litres du précieux breuvage avaient posé un problème pour ceux qui allaient les consommer dans des "drive-in" : vous savez ces fast-foods où des serveurs et serveuses avec képi en carton sur la tête vous servent sur des plateaux accrochés à la vitre de votre voiture pour que vous n'ayez aucun effort surhumain à fournir pour vous extraire de votre véhicule. Les plateaux pouvaient supporter des piles de hamburgers, de big mac, de super big mac, de pizzas, de frites (french fries, please), de desserts glacés, de sundaes, ces délicieux mélanges de sucres et de graisse qui feront que, plus tard, vous devrez payer deux places d'avion plutôt qu'une en raison de vos dimensions nouvelles , mais que faire de ces récipients de 2 litres de liquide additionnés de glace pilée et tenant difficilement en équilibre. C'était sans compter avec l'ingéniosité des équipementiers de voitures américaines qui ont prévu, tout près du cendrier du tableau de bord un dispositif rabattable juste à la dimension de votre gobelet. Oui mais voilà, dans la décennie passée, ce petit dispositif n'était prévu que pour des gobelets d'un litre au maximum. Qu'à cela ne tienne, on a changé les voitures : désormais, on peut aussi y planter des récipients deux fois plus grands. On n'arrête ni le progrès ni la bêtise.Mais, me direz-vous, nous ne fréquentons pas ce genre d'établissements et je vous crois bien volontiers. Mais nos enfants et surtout nos petits-enfants, oui. Parce qu'on les y gave, tels des oies, à des prix défiant toute concurrence, parce que les produits vendus sont ceux qui flattent le plus le palais (mélanges de graisses et de sucres), parce que ces lieux ont un look, un design résolument "jeunes", lumineux, clinquants, parce qu'ils y retrouvent des camarades de leur génération, des étudiants venus de toute la planète mais eux aussi déjà acclimatés, j'allais dire assujettis à cette grande bouffe universelle et parfaitement uniformisée. On peut tester des Mac Do de Clermont-Ferrand à San Francisco, de Londres à Pékin, de Dakar à Tokyo ou à Moscou (où l'on croise tous les nouveaux Russes, parvenus au pinacle de la réussite sociale, tandis que leurs chauffeurs attendent au garde-à-vous devant de puissantes limousines noires, longues comme des jours sans pain) et on ne devrait pas tarder à en ouvrir en Mongolie extérieure et au Tibet ce que je ne devrais pas tarder à aller vérifier.Le sucre était encore un luxe aux 18e et 19e siècles. Il est devenu un produit de consommation courante et il flatte tellement le palais que les enfants qui y ont goûté en réclament à cors et à cris, rejetant choux-fleurs, épinards et autres courgettes que vous aimeriez les voir manger. Au diable les yaourts natures, ils les veulent sucrés, parfumés, fruités ou les remplacent encore plus volontiers par des entremets industriels qu'ils appellent d'ailleurs yaourts, on ne sait trop pourquoi puisque ce n'en sont plus. La première mesure consiste assurément à ne surtout pas sucrer le biberon des bébés et à ne pas leur donner de biberons d'eau sucrée pour calmer leur prétendue faim au milieu de la nuit. Aucune espèce animale ne commet pareille bévue. J'imagine trop une lionne sucrant son lait ou préparant des biberons d'eau sucrée pour ses lionceaux à 3 heures du matin. Le lait en lui-même contient du lactose, donc une variété de sucre, et n'a besoin d'aucun complément pour être un parfait aliment de croissance.Le grignotage, comme nous l'avons vu, vient de l'absorption de sucres rapides qui eux-mêmes sont source de grignotage. Mais, la seconde explication majeure est l'ennui. Seuls à la maison devant un écran de télévision, les enfants mangent. En l'absence de leurs parents aux heures des repas, les enfants vont piocher dans le réfrigérateur à toute heure du jour, voire de la nuit. En se remplissant à tort et à travers avec n'importe quoi, sans le moindre souci d'équilibre alimentaire, les enfants tentent maladroitement de remplir un vide. Et même lorsque certains parents sont là, on peut voir des enfants de 3-4 ans assis par terre devant la sacro-sainte télé, un paquet de chips entre les jambes, gavant tout à la fois des aliments peu diététiques et des émissions du même tonneau. Mais, pendant de précieuses minutes, voire hélas des heures, des parents obtiennent à ce prix ce qu'ils cherchent par ce biais : la paix. La paix, oui, mais à quel prix
Attention : la grande maladie du 21e siècle est et sera chaque jour davantage : le DIABÈTE et notamment le diabète qui apparaît vers 40-50 ans. Si, très souvent, des facteurs génétiques sont en cause dans ce type de diabète, nos habitudes alimentaires contribuent à n'en pas douter à son apparition et à son développement. Une alimentation équilibrée ne peut que retarder l'apparition de cette maladie sévère, voire en empêcher l'apparition ou, si elle apparaît, se manifester sous une forme moins grave et/ou plus aisément contrôlable.
NOURRITURE ET CANCER
Il est à présent avéré qu'il existe un lien étroit entre le type de nourriture et l'apparition d'un cancer. Les experts sont simplement encore divisés sur une question de prévalence. Certains affirment que 30% des cancers sont dus à l'alimentation alors que pour d'autres ce chiffre atteindrait 60%. La vérité se situe sans doute quelque part entre ces deux chiffres et l'on peut dire sans crainte de se tromper que près de la moitié des cancers viennent de notre alimentation. J'ai pu le constater de visu, par exemple, au cours de deux années passées en Corée. La plupart des missionnaires français travaillant depuis plusieurs années dans ce pays y meurent de cancers digestifs causés par une nourriture assurément trop épicée. Quant aux Japonais, ils semblent plutôt bien protégés contre ce fléau et on a pu penser qu'il s'agissait tout simplement d'une prédisposition génétique favorable. Oui, mais voilà, le taux des cancers des Japonais transplantés aux USA ne tarde pas à rejoindre en quelques années celui des Américains. Il fallait donc rejeter cette prétendue différence génétique. La différence vient tout simplement du mode d'alimentation : les Japonais du Japon mangent beaucoup de poisson et la graisse des poissons protège contre les cancers ; les Japonais transplantés aux USA mangent comme les Américains, donc beaucoup de viande dont le rôle cancérigène est bien connu, générant notamment beaucoup de cancers de l'intestin. Et je ne parle pas des barbecues dont on pourra dire un mot tout à l'heure.Pour les Africains, la situation est différente : ne mangeant pas assez de viande pour des raisons de pauvreté, ils développent des cancers de l'estomac. Or les cancers de l'estomac tuent beaucoup plus quer les cancers de l'intestin. La différence de régime alimentaire ne penche pas en leur faveur.Quelles premières conclusions tirer de tous cela ? Assurément que nous, Européens, mangeons trop de viande. Ne pas en manger du tout dans le cadre d'un régime végétalien sans ufs, ni lait, ni beurre, ni fromages ni rien d'origine animale, est une hérésie alimentaire conduisant à des anémies sévères, un déficit en fer, une plus grande vulnérabilité aux infections, etc. Mais manger trop de viande est tout aussi nuisible à la santé. Une fois de plus : IN MEDIO VERITAS. Seconde conclusion : nous ne mangeons pas assez de poisson (et notamment de poisson de mer pêché dans les eaux froides). L'idéal pourrait être : VIANDE : 3 jours par semaine ; POISSON : 3 jours par semaine et NI VIANDE, NI POISSON : 1 jour par semaine, pour laisser à l'organisme le temps de se détoxiquer car les protéines animales produisent des déchets évacués en particulier par les reins.Autre constatation majeure : les femmes qui ont une nourriture trop grasse sont beaucoup plus nombreuses à développer un cancer du sein ; les hommes qui ont une nourriture trop grasse sont beaucoup plus nombreux à développer un cancer de la prostate. Et, dans ces deux catégories de cancers, les différences sont indiscutables. Alors, constatons que notre nourriture contient en moyenne 40% de graisses et il nous faut des graisses mais l'idéal serait qu'elles ne dépassent point 30 à 35% de nos apports quotidiens. Pour cela, pour réduire ce petit écart qui fait hélas tout le danger, quatre conseils simples : 1) ne jamais additionner deux graisses (ex : sandwichs jambon-beurre ou saucisson-beurre ou foir gras avec du beurre ou chocolat au lait ou à je ne sais quel produit crêmeux bien gras), 2) retirer la graisse visible de la viande, du jambon, etc., lorsqu'on mange ; 3) ne jamais se servir 2 fois en fromage ; 4) ne jamais manger la sauce qui reste dans son assiette en l'épongeant soigneusement avec des morceaux de pain plantés sur sa fourchette, même si cette sauce est vraiment trop tentante.Soigner à temps les cancers du sein (le premier des cancers féminins) et de la prostate (2e cause de décès par cancer chez l'homme) est possible grâce à un dépistage précoce : les mammographies chez les femmes, le dosage dans le sang des PSA chez les hommes.Avant de poursuivre et d'en finir avec ce survol des grandes causes de cancer (auxquels il faudrait ajouter le tabac et le surensoleillement, ce qui prouve que nous devrions être capables d'éviter les ¾ des cancers sans grande difficulté), une ultime consigne d'ordre général : manger moins de protéines animales et surtout davantage de FRUITS et de LÉGUMES dont l'effet bénéfique n'est plus à démontrer.
LE VIEILLISSEMENT
Est dû essentiellement à la présence de radicaux libres dans notre organisme.En prenant de l'âge, nos molécules s'oxydent (comme le fer rouille au contact de l'air) : l'oxygène, source de vie, est donc aussi notre ennemi. S'il y avait eu plus d'oxygène sur la terre, la vie n'aurait pas pu y apparaître. De même que s'il y en avait eu nettement moins. Merveilleux équilibre de notre planète où la vie a pu éclore grâce à un ratio oxygène/azote optimum.
Sous l'action de l'oxygène, nos molécules peuvent perdre un électron et sont donc très réactives pour tenter de recapter un autre électron n'importe où dans leur environnement. D'où un effet boule de neige. Ces radicaux libres peuvent attaquer les membranes cellulaires, pénétrer dans nos cellules et attaquer les noyaux avec leur patrimoine génétique. Vous imaginez les conséquences
L'idéal serait d'organiser la lutte contre ces radicaux libres. C'est possible avec trois enzymes (super oxyde dismutase, catalase, glutathion-peroxydase). Mais aussi et surtout par notre alimentation, notamment les vitamines C et E, la provitamine A, les polyphénols et les oligo-éléments (sélénium, manganèse, zinc, cuivre).
Supprimer les radicaux libres, c'est bien, les empêcher d'apparaître, c'est encore infiniment mieux.Les radicaux libres se multiplient :
- en cas de tabagisme actif ou passif
- en respirant de l'oxyde de carbone
- avec la pollution en général
- avec les radiations
- avec le stress. Le stress fait vieillir (se souvenir de Marie-Antoinette qui eut la désagréable surprise de constater au retour de Varennes que tous ses cheveux avaient brutalement blanchi alors qu'elle n'avait alors que 37 ans, ou ce parachutiste tombé de son avion sans parachute et qu'on retrouva certes mort à l'aterrissage mais avec lui aussi une chevelure devenue, en quelques minutes d'un stress maximal, totalement blanche).
- et même avec des efforts physiques trop intenses. Inutile de se mettre à courir des marathons à plus de 60 ans Pour apporter la vitamine C (fruits (agrumes, mangues), crudités, le persil, les choux qui apportent le stock nécessaire de cette vitamine dans les pays où les fruits sont rares) et E (poissons gras, margarine, germe de blé, légumes verts, huiles de pépins de raisins, de colza, de tournesol), c'est facile.
Rappelons au passage les marins qui, lors des grandes traversées de la Renaissance mouraient d'un mal sur bien étrange sur les bateaux alors qu'ils mangeaient à leur faim : leurs dents se déchaussaient, leurs gencives saignaient et leur santé allait se dégradant jusqu'à la mort. C'était le scorbut qu'on a pu ensuite prévenir, lorsqu'on comprit l'origine du mal, en apportant à bord des citrons et surtout de grands barils de choux. Pareil malheur frappa aussi les trappeurs et les explorateurs du Nord de l'Amérique. En débarquant au Canada, les premiers colons avaient été tout heureux d'y trouver du poisson et du gibier en abondance et notamment des lapins qu'ils firent cuire à la broche et dont ils se régalèrent en pensant qu'ils ne manqueraient ainsi jamais de nourriture. Ce qui fut vrai. De nourriture, ils ne manquèrent jamais mais ils moururent les uns après les autres sans comprendre que leur salut était à portée de main. Il eût fallu pour éviter le terrible scorbut se contenter d'agrémenter leurs capucins et autres rongeurs-sauteurs à longues oreilles (car il est des animaux dont on ne peut décemment pas prononcer le nom sur un bateau) qu'ils se contentassent d'agrémenter leur menu de quelques pommes sauvages. Du lapin aux pommes, voilà qui n'est certes pas une recette à écarter sans réfléchir. Mais on ne connaissait pas encore la vitamine C, le sacro-saint acide ascorbique.
Pour la provitamine A, c'est tout aussi facile (en dehors du beurre peu recommandé en grande quantité à cause du cholestérol et de l'huile de foie de morue qui a fait les délices de notre enfance) : carottes, poivrons, abricots, les citrouilles, les mangues, les melons (en gros et pour faire simple, tout ce qui a une couleur orange, coloration due au carotène)
Pour les polyphénols, plusieurs catégories
1. - les flavonoïdes (pigments qui protègent les plantes des effets nocifs du rayonnement solaire) : oignons, ail, citron, pommes et les agrumes en général.
2. - les tanins : le thé (noir, vert ou rouge), le vin, les raisins.
3. - les anthocyanes (i.e. les colorants bleurs, rouges, violets des fruits) : baies, framboises, cassis, et à nouveau le vin et les raisins).
4. - les acides phénoliques qu'on trouve dans les pommes, les abricots, les tomates, les agrumes, les kiwis et les céréales.
A tout cela et pour accroître l'espérance de vie, il convient d'augmenter le taux de mélatonine (qui possède un très fort pouvoir anti-oxydatif) : puisque la mélatonine n'a pas reçu le feu vert pour être commercialisée en France, on peut en avoir notre ration quotidienne en recevant un maximum de lumière pendant la journée et en mangeant beaucoup de fruits (et notamment des bananes dans lesquelles les singes puisent peut-être leur longévité).On peut recourir aussi au gingko, qui non seulement est anti-oxydant mais favorise le développement de la micro-circulation bien utile en particulier pour le cerveau dont nous savons tous qu'il commence à vieillir dès l'âge de 18-20 ans, voire dès la naissance, les pertes de neurones étant heureusement compensées par l'expérience et l'acquisition quotidienne de nouvelles connaissances.
Et le chocolat, qu'en est-il du chocolat ?
Très énergétique par les glucides et les lipides qu'il contient, le chocolat fournit 500 kcal pour 100 g et même 550 kcal pour le chocolat au lait. Cela veut dire que 100 grammes de chocolat fournissent 25% des besoins quotidiens d'une femme qui sont d'environ 2000 kcal/jour.Le chocolat ne contient pas moins d'une centaine de corps chimiques antioxydants (flavonoïdes, tanins et polyphénols). Difficile de faire mieux pour ralentir les processus du vieillissement. Oui, mais les chocolats contiennent des graisses. Quasiment plus dans le chocolat noir à 70% de cacao qu'on peut vraiment considérer comme un aliment de régime.Le chocolat renferme aussi :
- de la théobromine (40 à 500 mg/100 g), un psychostimulant, un véritable dynamisateur mais qu'il ne faut pas donner à votre chien car son tube digestif ne peut le digérer et un chien qui absorberait une grande quantité de chocolat pourrait en mourir. Vous l'auriez tué en voulant lui faire plaisir
- de la caféine (70 mg/100 g), elle aussi dynamisante
- de la phényléhylamine (PEA) (0,4 à 0,6 microgramme/gramme) et cette molécule a pour rôle de stimuler la production de dopamine dans le cerveau ce qui en fait un authentique aphrodisiaque, light soit, mais aphrodisiaque tout de même.
- De l'anandamide dont les effets sont voisins du cannabis et vous comprendrez vite pourquoi on se sent bien quand on mange du chocolat.
- De la vitamine E et des flavonoïdes qui, comme nous le savons maintenant luttent contre le vieillissement puisque ce sont des antioxydants neutralisateurs de ces fameux radicaux libres, sources de tous nos maux
- On pourrait ajouter que le chocolat est un décontractant musculaire grâce à son magnésium, un antianémique grâce à son fer, un anti-crampes grâce à son potassium. Il contient aussi du phosphore et mille autres substances tout aussi bénéfiques pour l'organisme.Oui, mais, a-t-il un effet sur notre taux de cholestérol ? Longtemps décrié, le chocolat n'a d'effet ni positif ni négatif sur le mauvais cholestérol. En effet, le beurre de cacao est constitué pour moitié d'acides gras saturés qui induisent la formation de "mauvais" cholestérol et, pour l'autre moitié, d'acides gras insaturés qui, eux, favorisent le "bon" cholestérol. Or vous savez que ce qui est important c'est le rapport entre ce bon et ce mauvais cholestérol. Avec le chocolat, ce pourcentage ne varie pas ni en bien ni en mal. Sauf si vous aviez l'idée saugrenue de manger du chocolat au lait, à la crème, etc., etc., voire du "chocolat blanc" qui n'est en aucun cas du chocolat mais un concentré bien gras de beurre de cacao.Et le vin, qu'en est-il du vin ?L'agence Reuters vient de nous informer depuis Washington que boire régulièrement un peu de vin semble allonger de quelques années l'espérance de vie chez les hommes, selon des chercheurs néerlandais qui ont publié ce mercredi les résultats de leurs travaux. Pour évaluer l'impact sur la santé et l'espérance de vie de la consommation d'alcool, ils ont suivi 1 373 hommes nés entre 1900 et 1920 à Zutphen, une cité industrielle des Pays-Bas. Les chercheurs ont étudié leur consommation d'alcool dans le cadre de sept enquêtes menées sur 40 ans, à partir de 1960. Ils ont suivi certains des sujets jusqu'à leur mort et les autres jusqu'en 2000, en les interrogeant sur ce qu'ils boivent, mangent et fument, et en suivant leur poids et la prévalence chez eux des attaques cardiaques, du diabète et du cancer.Boire un peu d'alcool, à savoir moins d'un verre par jour, semble être associé à un taux moindre de décès dû à des problèmes cardiovasculaires, selon l'étude. La consommation de vin semble plus bénéfique que celle d'alcools forts ou de la bière. Les chercheurs ajoutent que la consommation d'un-demi verre de vin par jour en moyenne semble associée à des moindres niveaux de mortalité.Contrairement à d'autres études menées sur les effets sur la santé de la consommation d'alcool, celle-ci s'est efforcée d'identifier son impact sur l'espérance de vie, soulignent les chercheurs. Ils ont trouvé que les hommes buvant du vin avaient une espérance de vie supérieure de 3,8 années à celle d'hommes n'en buvant pas.Ces buveurs de vin ont en outre une espérance de vie supérieure de deux ans à celle de personnes buvant d'autres boissons alcoolisées, selon l'étude, qui ne portait pas sur les risques pour la santé d'une consommation excessive d'alcool."Le principal message est que si vous consommez des boissons alcooliques, faites-le avec modération - un à deux verres par jour au maximum", a expliqué Martinette Streppel, qui a dirigé l'étude, dans un entretien téléphonique."Et si vous devez choisir une boisson, prenez le vin, car il a un effet bénéfique qui dépasse celui du seul alcool", a-t-elle ajouté.Le vin de Bordeaux serait le plus bénéfique (contenant un maximum de tanins) mais ceci n'est pas encore scientifiquement prouvé.Streppel travaille à l'Institut national de la santé publique et de l'environnement de l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas.Cette étude confirme ce qu'on savait déjà empiriquement et explique le fameux paradoxe français : les Français mangent beaucoup, mangent de la charcuterie, du beurre, du fromage en quantité (assurément en trop grande quantité) et autres matières grasses et jouissent pourtant d'une belle longévité que nombre de pays peuvent lui envier. Et personne dans le monde scientifique ne comprenait ce phénomène propre à la France. Il était dû simplement à la consommation régulière de vin (rouge) qui possède au moins trois vertus : la première qui résulte d'un théorème scientifique : les graisses brûlent au contact des hydrates de carbone. En clair et à titre d'exemple, ce n'est pas un hasard si la gastronomie a toujours associé le fromage et le vin : les graisses du fromage sont détruites et mieux éliminées si on y ajoute du vin. La seconde, c'est la présence de tanin dont on a dit tout à l'heure tout le bien qu'il faut en penser. La troisième, c'est que le vin possède, comme l'aspirine à très faible dose, des propriétés anticoagulantes en empêchant les plaquettes de s'agglutiner entre elles, ce qui réduit d'autant les accidents cardiaques (infarctus) et les thromboses cérébrales. En un mot, le vin rouge fluidifie le sang et ce serait le bordeaux qui serait le plus efficace mais ceci reste à démontrer En conclusion, que dire ?Bonne alimentationHygiène de vieExercice modéré mais régulierDes fruits et des légumes, des fruits et des légumes, un peu de thé, un peu de vin, du chocolat noir.Chasser les stress (les mauvais stress, les stress répétitifs, ceux qui usent et non les stress stimulants, dynamisants (voir mon ouvrage consacré au STRESS).Boire suffisamment d'eau (appelons-nous la triste aventure de la canicule : 15000 morts dans notre seul pays, 6 fois plus que les tours du World Trade Center, mais une catastrophe assurément moins télévisuelle au point que ces 15000 morts (sans doute environ 100 000 pour l'ensemble de l'Europe) n'ont pas dû occuper une seule minute des petits écrans d'Outre-Atlantique ni trois lignes dans la presse étatsunienne. Se rappeler impérativement que plus on avance en âge, moins la soif se fait sentir et lorsqu'on se met à avoir soif, c'est déjà tard, souvent trop tard : des dégats irréparables ont déjà pu se produire). Il serait intelligent, été comme hiver (car, en hiver, il y a le chauffrage central pas toujours accompagné de saturateurs et d'humidificateurs) de boire ½ verre d'eau toutes les heures (en plus du thé, du café, des potages et autres aliments plus ou moins liquides).De la lumièreDe la bonne humeur et de la convivialité qu'il est bon d'évoquer avant de partager ensemble un délicieux repas. Car la joie, le rire, le plaisir d'être ensemble participent, c'est prouvé, à la bonne assimilation des aliments dans l'attente de travaux scientifiques qui prouveront assurément un jour prochain que cette bonne humeur contribue elle aussi à maintenir ce qui nous est le plus cher : notre capital santé.
Signature :
par Jean-Marie Thiébaud
Noms actuels de villes de l'ex-URSS
Noms actuels Noms anciens
ACHGABAT (Turkménistan) ACHKHABAD
ALMATY (Kazakhstan) ALMA-ATA
AKTAOU (Kazakhstan) CHEVTCHENKO
BICHKEK (Kirghizistan) FROUNZE
TURKMENABAD(Turkménistan)CADZOU
IEKATERINBOURG (Russie) SVERDLOVSK
NIJNI-NOVGOROD (Russie) GORKI
NOVOMOSKOVSK (Russie) STALINOGORSK
PERM (Russie) MOLOTOV
SAINT-PETERSBOURG (Russie) LENINGRAD
SAMARA (Russie) KOUÏBYCHEV
SIMBIRSK (Russie) OULIANOVSK
TOGLIATTI alias TOLIATI (Russie) STAVROPOL
TURKMENABAT (Turkménistan)TCHARDJOOU
TURKMENBASHI (Turkménistan) KRASNOVODSK
VIATKA (Russie) KIROV
VLADIKAVKAZ (Russie) ORDJONOKIDZE
VOLGOGRAD (Russie) STALINGRAD
Noms anciens et actuels de villes et villages d'Algérie Origine de ces noms de localités
Les noms de nombreux lieux commencent par AÏN qui, en arabe, signifie "source". C'est dire l'importance de l'eau en Algérie.
D'autres noms commencent par SIDI, désignant, en arabe, un garçon aïné de la famille et, par extension, tout homme auquel on veut témoigner du respect. Le Cid (El Campeador) tire son nom du SIDI arabe.
BIR signifie "puits", OUED, la "rivière" (Bab-el-Oued = Porte de la Rivière), OULED, les "enfants" ou "les frères", BORDJ, la "tour" ou la "fortification", KSAR, le "village" (fortifié), "ksar" étant aussi l'adjectif arabe pour "fort".
Tout naturellement, l'Algérie nouvelle a baptisé plusieurs de ses localités de héros de l'indépendance.
Noms anciens et actuels des villes et villages d'Algérie
Origine des noms de ces localités
Après la proclamation de l'indépendance de leur pays en 1962, les autorités algériennes ont rebaptisé les localités d'Algérie.
Les noms de nombreux lieux commencent par AÏN qui, en arabe, signifie "source". C'est dire l'importance de l'eau en Algérie.
D'autres noms commencent par SIDI, désignant, en arabe, un garçon aïné de la famille et, par extension, tout homme auquel on veut témoigner du respect. Le Cid (El Campeador) tire son nom du SIDI arabe.
BIR signifie "puits", OUED, la "rivière" (Bab-el-Oued = Porte de la Rivière), OULED, les "enfants" ou "les frères", BORDJ, la "tour" ou la "fortification", KSAR, le "village" (fortifié), "ksar" étant aussi l'adjectif arabe pour "fort".
Tout naturellement, l'Algérie nouvelle a baptisé plusieurs de ses localités de héros de l'indépendance.
Anciens noms NOUVEAUX NOMS
Abbo SIDI-DAOUD
Abdellys (Les) SIDI ABDELLI
Aboukir MESRA
Aboukir rappelait le nom d'une victoire de Bonaparte en Egypte le 25 juillet 1799
Aboutville AÏN-EL-HADJAR
Affreville (colonia Augusta à l'époque romaine) KHÉMIS MELIANA
Aïn-Mokra BERR AHA
Alma (L') BOUDOUAOU
Alger DJEZAÏR (El-)
Ampère AÏN AZEL
Arcole BIR-EL-DJIR
Arcole rappelait une victoire de Bonaparte (17 novembre 1796)
Arthur TLELAT ED DOUAIR
Auguste-Comte : BAGHAÏ
Aumale : SOUR-EL-GHOZLANE
Henri Eugène Philippe Louis d'Orlaans, duc d'Aumale (1822-1897), 4e fils de Louis-Philippe et de la reine Amélie, s'est illustré en Algérie, notamment avec la prise de la smala d'Abd-el-Kader en mai 1843, ce qui valut le grade de lieutenant général. IL fut élu à l'Académie française en 1871.
Auribeau : AÏN CHERCHAR
Aïn-Sultan : AÏN-SOLTANE
Baraque(la) : HACHIMIA (El-)
Barbinais(la) : BIR-AISSA
Baudens BELARBI
Lucien Jean Baptiste Baudens (1804-1857), chirurgien d'une grande habilté, professeur à Alger, servit en Algérie au début de la conquête. On lui doit un "Traité des plaies par armes à feu".
Bedeau RAS-EL-MA
Marie Alphonse Bedeau (1804-1863) fit toute sa carrière en Algérie à partir de 1834 et fut gouverneur général de l'Algérie.
Belle Fontaine TIDJELABINE
Belle-Côte AÏN BOUDINAR
Bellevue SOUR
Beni-Mansour BOUDJELLIL (Kabylie)
Bérard AÏN TAGOURAIT
Bernelle OULED-El-MA
Berteaux OULED HAMLA
Maurice Berteaux fut ministre de la guerre dès 1904. Il mourut dans un accident d'aéroplane en 1911.
Berthelot YOUB
Bizot DIDOUCHE MOURAD
Mourad Didouche, né à El Mouradia, Alger, le 13 juillet 1927, tué au combat lors de la bataille du douar Souadek le 18 janvier 1955, était le chef de la Wilaya II. Il fut l'un des rédacteurs de la Déclaration du 1er novembre 1954. Son adjoint Youcef Zighout a lui aussi donné son nom à une localité de l'Algérie indépendante.
Blandan BOUTELDJA
Boghari KSAR-EL-BOUKHARI
Bône ANNÂBA
Borély-la-Sapie OUAMRIA
Bosquet HADJADJ
Bossuet DHAYA
Bougainville SENDJAS
Bougie BEJAÏA
Bourbaki KHEMISTI
Brazza ZOUBIRIA
Bréa (hamau de Tlemcen) ABOU-TACHFINE
Bugeaud SERALDI
Thomas Robert Bugeaud de La Piconnerie (1784-1849), maréchal de France, duc d'Isly, consolida la conquête de l'Algérie où il avait été envoyé dès 1836.
Burdeau MEHDIA
Auguste Burdeau (1851-1894), ministre des finances en 1893-1894, termina sa carrière comme président de la Chambre des Députés en 1894.
Cacherou SIDI KADA
Calle (La) KALA (El-)
Camp-du-Maréchal TADNAÏT
Canrobert OUM-El-BOUAGHI
Certain Canrobert (1809-1895), maréchal de France, fut aide-de-camp du prince Louis-Napoléon.
Carnot ABADIA (El-)
Cassaigne SIDI ALI
Castiglione BOU-ISMAÏL
Castiglione rappelait une victoire de Bonaparte (5 août 1796)
Cavaignac BORDJ ABOUL El HASSEN
Louis Eugène Cavaignac (1802-1857), général, prit part à la conquête de l'Algérie, reçut le commandement de la subdivision de Tlemcen puis, en 1847, succéda à Lamoricière comme gouverneur de la province d'Oran. Enfin, en 1848, il fut nommé général de division et gouverneur général de l'Algérie.
Cavallo AOUNA (El-)
Champlain OMARIA (El-)
Changarnier OUED-ZEBBOUDJ
Nicolas Anne Théodule Changarnier (1793-1877) fut nommé gouverneur de l'Algérie en 1848
Chanzy SIDI ALI BEN YOUB
Antoine Eugène Alfred Chanzy (1823-1883), chef du bureau arabe de Tlemcen, général, devint gouverneur de l'Algérie en 1873.
Charon BOU KADIR
Viala Charon (1794-1880) fut gouverneur général de l'Algérie jusqu'en 1849
Charrier MEFTAH SIDI BOUBEKER
Chasseloup-Laubat GUIDJEL
Justin de Chasseloup-Laubat (1805-1873) fut ministre de la Marine sous Napoléon III puis président du Conseil d'Etat en 1869.
Chassériau BOUZGAHAÏA
Théodore Chassériau a peint un portrait équestre d'Ali-ben-Ahmet, calife de Constantine (1847), "Le Sabbat dans le quartier juif de Constantine" (1848), des "Femmes mauresques jouant avec une gazelle" (1850), etc.
Châteaudun-du-Rhumel CHELGOUN-El-AÏD
Chevreul ARBAOUN
Chiffalo KHEMISTI-PORT
Clairefontaine AOUINET (El-)
Clinchant MATMAR (El-)
Charles Clinchant (1820-1881) fut général puis gouverneur de Paris
Col-des-Oliviers AÏN BOUZAINE
Coligny BOUÏRA
Colomb-Béchar BECHAR
Condé-Smendou ZIGHOUT YOUCEF
Youcef Zighout a été l'initiateur du soulèvement dans le Constantinois.
Constantine QACENTINA
Corneille MEROUANA
Dalmatie OULED-YAICH
Damiette AÏN-DHAB
Damiette fut une victoire des Français en 1798 et Kléber y battit les Turcs le 1er novembre 1798
Davoust KHELIL
De Malherbe AGHLAL
Desaix NADOR
Détrie SIDI-LAHSSEN
Djidjelli JIJEL
Dolfusville OUED CHORFA
Dombasle HACHEM (El-)
Dominique-Luciani TAKHEMARET
Dublineau HACINE
Duperré AÏN ED DEFLA
Victor-Guy, baron Duperré (1775-1856), amiral et pair de France, commanda la flotte française devant Alger en 1830.
Dupleix DAMOUS
Duquesne KAOUS
Duvivier BOUCHEGOUL
Franciade-Fleurus Duvivier (1794-1848), général, était présent à la prise d'Alger en 1830 et fit presque toute sa carrière en Algérie
Duzerville HADJAR (El-)
El-Arrouch HARROUCH (El-)
Edgar-Quinet KAÏS
Edgar Quinet (1803-1875), professeur au Collège de France, maître à penser de la république laïque. IL fut suspendu pour son anticléricalismr en 1846.
El-Goléa MENIA (El-)
El-Rahel HASSI-El-GHELLA
Eugène-Étienne HENNAYA
Félix-Faure SIDI-MUSTAPHA
Ferry OUED-El-DJEMAA
Fleurus HASSIANE ETTOUAL
Fleurus est une victoire française (1794)
Fondouk KHEMIS-El-KECHNA
Fort-de-l'Eau BORDJ-El-KIFAN
Fort-National LARBAA NATH IRATHEN
Franchetti SI-AMAR
Francis-Garnier BENI-HAROUA
Marie Joseph François dit Francis Garnier (1839-1872), marin et explorateur, mourut en combattant les pirates chinois
Froha KHARA
Fromentin TADJENA
Eugène Fromentin (1820-1876), peintre et écrivain, fut l'auteur de "Un été dans le Sahara" (1857), "Une année dans le Sahel" (1858). on lui doit aussi plusieurs tableaux sur l'Algérie dont "Chasse au faucon en Algérie" (1863), "Campement arabe", "Halte de cavaliers arabes" (1870), "Chasse à la gazelle", "Les gorges de la Chiffa", "La place de la Brèche à Constantine", etc. La plupart de ces toiles sont conservées au Louvre.
Gallieni BOUATI MAHMOUD
Gambetta TAOURA
Léon Gambetta (1838-1882), président du Conseil, préconisa une politique d'expansion coloniale
Gastonville OUED BERKECHE
Gastu ZIT EMBA
Georges-Clemenceau STIDIA
Geryville BAYAH (El-)
Gounod ABDI
Guiard AÏN TOLBA
Guillaumet AÏN-EL-HAMMAN
Guyotville AÏN BÉNIAN
Hamma-Plaisance HAMMA-BOUZIANE
Hanoteau ZEBOUDJA
Louis Joseph Adolphe Charles Constance Hanoteau (1814-1897), général, fit presque toute sa carrière en Algérie. On lui doit un "Essai de grammaire kabyle", "La Kabylie et les coutumes kabyles" (1873), etc.
Haussonvillers NACIRIA
Henri-Duc OUED-ES-SALAM
Hoche KHABBOUZIA
Inkermann OUED RHIOU
Jemmapes AZZABA
Rappelait la victoire remportée par Dumouriez le 5 novembre 1792
Kellermann FEDJOUDJ (El-)
François Christophe Kemmermann, duc de Valmy (1735-1820), maréchal de France, remporta la première victoire de la République
Kléber SIDI BEN YABKA
Jean-Baptiste Kléber (1753-1800), général, remporta la victoire de Mont-Thabor et écrasa les Turcs à Héliopolis
Lacroix AL AÏOUM
Lacs (Les) OULED ZOUAI
Lafayette BOUGAA
Laferrière CHAABAT-EL-LERAM
Julien Lafferrière (1841-1901), jurisconsulte et administrateur, fut gouverneur général de l'Algérie en 1898
Lamartine KARIMIA (El-)
Lambèse TAZOULE
Lamoricière OUED MIMOUN
Jean Christophe Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865), général, prit une part importante dans la conquête de l'Algérie, notamment lors de la bataille d'Isly (1844). C'est lui qui reçut la soumission d'Abd-el-Kader en 1847.
Lamy BOU-HADJAR
François Joseph Amédée Lamy (1858-1900), officier et explorateur, commanda l'escorte militaire de la mission Foureau, de la Méditerranée au lac Tchad
Lapaine KHEZACAS
Lappasset SIDI LAKHDAR
Lavarande SIDI LAKHDAR
Lavayssière AÏN YOUSSEF
Lavigerie DJENDEL
Charles Lavigerie, né à Bayonne (Pyrénées Atlantiques) (1) en 1825, mort à Alger en 1892, fut archevêque d'Alger dès 1867, cardinal en 1882. Il fonda les Missionnaires d'Afrique connus sous le nom de "Pères blancs". Il fut l'instrument de la réconciliation des catholiques français avec la République. (1) On peut voir une statue monumentale de ce prélat à Bayonne, près du pont Saint-Esprit.
Lecourbe HAMMAOUADIA (El-)
Lecourbe, général
Letourneux DERRAG
Levasseur BIR CHOUADA
Liebert OULED BESSEM
Lodi DRAA-ESMAR
Lodi rappelait une victoire de Bonaparte (9 mai 1796)
Lourmel AMRIA (El-)
Frédéric Henri Lenormand de Lourmel (1811-1854), aide-de-camp de Louis-Napoléon, promu général, fut tué en Crimée
Loverdo OUZERA
Magenta HACAIBA (El-)
Magenta rappelait une victoire de Napoléon III sur les Autrichiens (4 juin 1859)
Maginot CHELLALAT EL ADHAOUARA
André Maginot fut ministre des colonies en 1917
Maillot M'CHEDILLAH
François-Clément Maillot (1804-1894), médecin militaire, répandit l'usage du sulfate de quinine pour soigner les soldats de l'armée d'Afrique touchés par le paludisme. On a donné son nom à la commune de Béni-Mansour en Algérie
Maison-Blanche DAR-EL-BEÏDA
Maison-Carrée HARRACH (El-)
Mangin BRAYA (El-)
Charles Mangin (1866-1925), général, fut inspecteur général des troupes coloniales. Un paquebot de la compagnie Paquet, reliant Bordeaux à Dakar, portait encore son nom dans les années 1960
Marbot TARIK IBN ZIAD
Jean-Baptiste-Antoine-Marcelin, baron de Marbot (1782-1854), maréchal de camp, suivit le duc d'Orléans en Algérie
Marceau MENACEUR
Maréchal-Foch AFBATACHE
Marengo HADJOUT
Marengo rappelait une victoire de Bonaparte sur les Autrichiens (14 juin 1800)
Marguerite AÏN-TORKI
Marnia MAGHNIA
Martimprey AÏN EL HADID
Edouard Charles, comte de Martimprey (1808-1883), général, fut sous-gouverneur puis gouverneur de l'Algérie en 1864. Il finit sa carrière comme gouverneur des Invalides.
Masqueray NACEREDDINE
Emile Masqueray (1843-1894) fut professeur à Alger de 1871 à 1880. On lui doit de nombreux ouvrages dont "L'Aurès pendant la période byzantine" (1882).
Masséna OULED BEN ABDELKADER
Ménerville THENIA
Mercier-Lacombe SFIZEL
Michelet AÏN-EL-HAMMAM
Mirabeau DRÂA BEN KHEDDA
Ben Youcef Ben Khedda, né à Berrouaghia le 23 février 1920, pharmacien, fut le second président du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA). L'Université d'Alger porte aussi son nom.
Molière BORDJ BOUNAAMA
Mondovi DREAN
Mondovi rappelait une victoire de Bonaparte sur les Piémontais (22 avril 1796)
Montagnac REMCHI
Montcalm TAMLOUKA
Montebello SIDI-RACHED
Montebello rappelait une victoire de Bonaparte sur les Autrichiens (12 juin 1800)
Montenotte SIDI AKACHA
Montenotte rappelait une victoire de Bonaparte sur les Autrichiens (14 avril 1796)
Montesquieu M'DAOUROUCH
Montgolfier EAHOULA
Montpensier BEN BOULAÏD
Mostefa Ben Boulaïd, né à Arris le 5 février 1917, tué le 22 mars 1956, fut l'un des chefs historiques de la guerre d'Algérie.
Morris BEN MEHIDI
Larbi Ben Mehidi, né à Douar el Kouahi en 1923, mort prisonnier en mars 1957 après avoir dirigé la bataille d'Alger, avait été le premier chef de la Wilaya V (Oran). C'est à lui qu'on doit l'apostrophe fameuse : "Jetez la révolution dans la rue et elle sera prise en charge par le peuple".
Mouzaïa-les-Mines TAMESGUIDA
Mouzaïaville MOUZAÏA
Munier AÏN-KERMA
Navarin BIR-EL-ARCHE
Nazereg REBAHIA
Nelsonbourg SIDI-MAHDJOUB
Noisy-les-Bains AÏN-NOUISSY
Nouvion GHOMRI (El-)
Oran WHARAN
Orléansville CHLEF
Oued-Imbert AÏN-EL-BERD
Ouillis ABDELMALEK RAMDAN
Abdelmalek Ramdane, héros de l'indépendance algérienne, a aussi donné son nom à une place d'Oran.
Palat MELLAKOU
Palestro LAKHADARIA
Palikao RIGHENIF
Palissy SIDI KHALED
Parmentier SIDI ALI BOUSSIDI
Paul-Doumer SIDI-EMBAREK
Paul-Robert TAOUGRITE
Paul Robert, né à Orléansville (aujourd'hui Chlef) en Algérie en 1910, mort à Mougins en 1980, lexicographe et éditeur, a dirigé la rédaction du "Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française "(1954-1963). On lui doit aussi le "Petit Robert" (1967).
Penthièvre AÏN BERNA
Perigotville AÏN-EL-KEBIRA
Pérregaux MOHAMMADIA
Petit BOUMAHRA AHMED
Philippeville SKIKDA
Picard KHADRA
Pirette AÏN-ZAOUIRA
Pointe-Rouge SOUK-ELBAKAR
Pont-de-l'Isser BENSEKRANE
Pont-du-Cheliff SIDI-BEN-ATAR
Port-aux-Poules MERS-EL-HADJAD
Port-Gueydon AZEFFOUN
Prévost-Paradol MECHERAA ASFA
Prudhon SIDI-BRAHIM
Rabelais AÏN-MERANE
Randon BESBES
Rebeval BAGHLIA
Renault SIDI M'HAMED BENALI
Réunion (La) OUED GHIR
Richelieu AHMED RACHIDI
Rio-Salado MALAH (El-)
Rivet MEFTAH
Rivoli JEZ-ED-CHICH (El-)
Robertsau (La) ES SEBT
Rochambeau MEZAOUROU
Rouffach EBB ZIAD
Rouget-de-Lisle SOUK-NZAMANR
Rovigo BOUGARA
Saint-Aimé JDOUIA
Saint-Antoine HEDIAEK (El-)
Saint-Arnaud EULMA
Saint-Charles RAMDANE DJAMAL (alias RAMDANE DJAMEL)
Saint-Cloud GOYEL
Saint-Denis-du-Sig SIG
Saint-Donat TADJENANET
Sainte-Barbe-du-Tlélat OUED TLELAT
Saint-Eugène BOLOGHINE-IBNOU-ZIRI
Saint-Ferdinand SOUIDANIA
Saint-Joseph BOUKAMOURA
Saint-Leu BETHIOUA
Sainte-Amélie RAHMANIA
Sainte-Léonie MAGHOUN (El-)
Saint-Lucien ZAHANA
Saint-Maur TAMZOURA
Saint-Pierre-Saint-Paul OULED MOUSSA
Sidi-Ferruch SIDI-FERDJ
N.B. : c'est sur les plages de cette localité, à l'ouest d'Alger, que le corps expéditionnaire français a débarqué le 14 juin 1830.
Stéphane-Gsel HAKIMIA
Strasbourg EMIR ABDELKADER
Taine LAAVOUNE
Tassin HASSI ZENANA
Téfeschoun KHEMISTI
Thiers KADIRIA
Thiersville GHRISS
Tirman TEGHALIMET
Tocqueville RAS-EL-OUED
Tounin KHEIR DINE
Trembles (Les) SIDI HAMADOUCHE
Trezel SOUGUEUR
Trois-Marabouts SIDI BEN ADDA
Trolard-Taza BORDJ-EL-EMIR-ABDELKADER
Trumelet DANMOUNI
Turgot TERCA
Uzés-le-Duc OUED-EL-ABTAL
Valée HAMOUDI HAMROUCHE
Valmy KERMA (El-)
Vialar TISSEMSILT
Victor-Duruy CHAABAAT OULED CHELITH
Victor Duruy (1811-1894), historien, ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869, est le créateur de l'École Pratique des Hautes Études (1868)
Victor-Hugo HAMADIA
Voltaire AÏN LECHNIAK
Waldeck-Rousseau SIDI-HOSNI
Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904), ministre de l'Intérieur, fit voter la loi créant les syndicats (1884) et, en qualité de président du Conseil, gracier Dreyfus. On lui doit aussi la loi sur les associations (1901).
Warnier LARBAAT OULED FARES
Youks-les-Bains HAMMAMET
N.B. : Hammamet signifie "Les Bains" en arabe.
Yusuf AÏN-EL-ASSEL
Zégla MERINE
Zurich SIDI-AMAR
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les habitants de Moissey (Jura) en 1770
La dame Rabuet abandonnait aux habitants de Moissey une partie de son jardin, un terrain d'environ 60 pieds sur lequel les habitants entendaient construire "le meix de la maison commune", au lieu-dit "La Planchotte" ou "Rue Haute". En contrepartie, les habitants cèdaient à dame Rabuet un autre terrain sis rue de Pesmes et rue Haute. L'acte notarié de cet échange fut passé en présence de Jean-Jacques Genriet, curé de Moissey, et Claude Joseph Guillaume, contrôleur des actes dudit lieu.
Liste des habitants de Moissey (Jura) cités dans la délibération du 4 novembre 1770
Echevins : Joseph FICHET et Claude BAILLY
Habitants de la communauté : Claude GAILLARD, Claudet DUROT, Sébastien GENELET, Toussaint PRODHON, Joseph BELIN, le sieur Jean-Baptiste CUGNET, Jean-Baptiste DERRIEZ, le sieur Pierre Joseph GUILLAUME, Denis ODILLE, François VIENNOT, Claude GELIN, Claude JOUBERT, George MIROUDOT, François DERRIEZ, Jean-Baptiste PITOTBELIN, Jean-Baptiste GAILLARD, Jean-Claude SANTONAN, Claude BON, Jean JANNOT, Claude THIEBAULT, Claude BRENET, Gabriel JOANNET, Joseph SOUBRANS, Jean-Baptiste FATET le Jeune, Claude GUILLAUME, Jacque GUILLAUME, Jean-Baptiste GAUDILLOT, Claude GRANDPERRIN, Claude GAILLARD le Jeune, Jean-Claude MAIRE, Marc DERRIEZ, Jean-Baptiste CHAPPUIS, Jean-François PETITLAURENT, le sieur Claude-Joseph BOLU, Claude FOURNIER, Jean-Baptiste STECHIN, Pierre GUILLAUME le Viel, Pierre CAVAROZ, Claude-Joseph BOLU le Jeune, Pierre REY, Pierre FRERE, Joseph TOURNU, Claude GUILLAUME le Jeune, Sébastien FRERE, Claude-Joseph DERRIEZ le Viel, Claude-François GUILLAUME, Simon PITOTBELIN, Jean-Claude BULOT, Pierre DUROT, Pierre-Laurent PITOTBELIN, Pierre GILLES, Claude MARTIN, Claude François PITOTBELIN, Sébastien PITOTBELIN, Claude PORTIER, Jean JAUBERT, François FRERE et Joseph GAILLARD.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, 7 février 2007
Archives de l'auteur.
Les souverains de la Franche-Comté de la fin du 13e siècle à l'annexion définitive par le royaume de France en 1678
- OTHON IV, comte palatin de BOURGOGNE (fils de Hugues de Chalon et d'Alix de Méranie), vendit le comté de Bourgogne en 1295 au roi de France, PHILIPPE IV LE BEL. À la mort de celui-ci (1314), le comté fut administré par
- JEANNE DE BOURGOGNE (qui avait épousé le dauphin, le futur Philippe V, roi de France) jusqu'à la mort de celle-ci en 1330. Le comté passa alors à sa fille
- JEANNE de FRANCE qui avait épousé, en 1318, EUDES IV, duc de BOURGOGNE. Duché et comté de Bourgogne étaient désormais unis pour près de deux siècles. Eudes IV mourut en 1349. Son fils, Philippe de Bourgogne, qui avait épousé Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, était mort avant son père en 1346. Duché et comté de Bourgogne passèrent donc au petit-fils d'Eudes IV :
- PHILIPPE de ROUVRES, sa mère Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, exerçant la régence. Philippe de Rouvres mourut prématurément en 1361 sans descendance. Le duché de Bourgogne échut au roi de France, Jean le Bon, et le comté de Bourgogne à
- MARGUERITE de FRANCE, fille cadette de Philippe V et de Jeanne de Bourgogne.
- MARGUERITE de FLANDRES, veuve de Philippe de Rouvres, qui épousa en 1362 :
- PHILIPPE II le HARDI, 1er duc-comte de BOURGOGNE (4e fils du roi Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, et frère du roi CHARLES V), mort en 1404. Lui succéda son fils :
- JEAN SANS PEUR, 2e duc-comte de BOURGOGNE depuis 1404, assassiné par Tanneguy Duchâtel en 1419. Lui succéda son fils :
- PHILIPPE III LE BON, 3e duc-comte de BOURGOGNE depuis 1419 jusqu'en 1467. Lui succéda son fils :
- CHARLES LE TÉMÉRAIRE, 4e et dernier duc-comte de BOURGOGNE, de 1467 à sa mort en 1477. Louis XI hérita du duché de Bourgogne alors que le comté de Bourgogne revint à la fille de Charles le Téméraire :
- MARIE de BOURGOGNE qui épousa, le 19 août 1477, MAXIMILIEN d'AUTRICHE, futur empereur germanique. Marie de Bourgogne meurt prématurément en 1482 (dans un accident de chasse) et laisse son héritage à sa fille :
- MARGUERITE d'Autriche, comtesse de Bourgogne jusqu'à sa mort le 1er décembre 1530, régente des Pays-Bas pour son neveu CHARLES. Maximilien d'Autriche avait toutefois laissé la succession à son fils, Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, mari de Jeanne la Folle, reine d'Aragon et de Castille, mais Philippe le Beau étant mort presque aussitôt, c'est ainsi que le pouvoir était revenu au dernier enfant de Maximilien : Marguerite d'Autriche. En 1530, le comté de Bourgogne échoit à
- L'empereur CHARLES QUINT, fils de Philippe le Beau, et de Jeanne La Folle. Il abdiqua en 1556 et mourut deux ans plus tard, laissant la Franche-Comté à son fils :
- PHILIPPE II, roi d'ESPAGNE de 1556 à 1598. Puis la province aurait dû passer à son fils, PHILIPPE III, roi d'ESPAGNE de 1598 à 1621, mais il préféra la léguer avec les Pays-Bas à sa fille ISABELLE qui épousa son cousin ALBERT, archiduc d'AUTRICHE.
- ALBERT et ISABELLE, archiducs d'AUTRICHE, gouverneurs des Pays-Bas et de la Franche-Comté de 1598 à 1621. Lorsque Albert mourut en 1621, ces provinces retournèrent à la couronne d'Espagne, c'est-à-dire au fils de Philippe III :
- PHILIPPE IV, roi d'ESPAGNE de 1621 à 1665, père de
- CHARLES II, roi d'ESPAGNE de 1665 à 1700, souverain de la Franche-Comté de 1665 (il avait alors 4 ans) jusqu'en 1678 (17 ans).
- LOUIS XIV, roi de FRANCE, souverain de la Franche-Comté depuis 1678.
Les unités de la Légion étrangère Bref historique et devises
Unités de la Légion
1er R.E. (Régiment étranger), créé en 1831, implanté à Sidi-bel-Abbès (Algérie), rapatrié en 1962 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), quartier Viénot. En qualité de doyen de tous les régiments de la Légion, c'est lui qui est dépositaire des traditions et a la charge de conserver les reliques. Il est composé de quatre compagnies. Devise : HONNEUR et FIDÉLITÉ.
1er R.E.C. (Régiment étranger de cavalerie), créé à Saïda (Algérie) en 1921 puis installé à Sousse (Tunisie) puis à Mers El-Kébir (Algérie) et enfin à Orange (Vaucluse), quartier Labouche, depuis 1967. C'est le seul régiment de la Légion spécialisé dans les combats de blindés en étant un des deux régiments de cavalerie de la 6e B.L.B. (Brigade Légère Blindée). Devise : NEC PLURIBUS IMPAR (À NUL AUTRE PAREIL). Cette devise était celle que portait Louis XIV.1er R.E.G. (Régiment étranger du génie), surnommé le "Régiment du Levant", créé le 1er octobre 1999 par simple changement d'appellation de l'ancien 6e R.E.G. (créé le 1er juillet 1984). Composé de sept escadrons, il est implanté à Laudun L'Ardoise (Gard), quartier Général Rolet. C'est le régiment de génie de combat de la 6e B.L.B. (Brigade Légère Blindée). Devise : AD UNUM (JUSQU'AU DERNIER).1er R.E.P. (Régiment étranger parachutiste), créé à Khamisi sous le nom de 1er B.E.P. (Bataillon étranger parachutiste), devenu 1er R.E.P. en 1955 et s'implantant alors à Zéraldal (Algérie), dissous à Thiersville (village d'Algérie ainsi nommé en l'honneur d'Adolphe Thiers, président de la République) le 30 avril 1961 après sa participation au putsch.2e R.E.C. (Régiment étranger de cavalerie), créé le 1er juillet 1939 avec les 3e, 4e et 5e escadrons du 1er R.E.C.. Cette unité, implantée à Oujda (Algérie) a été dissoute le 31 juillet 1962 et son étendard a été confié au D.L.E.M. cité plus loin.2e R.E.G. (Régiment étranger du génie), régiment de génie d'assaut et de montagne de la 27e brigade d'infanterie de montagne, créé le 1er juillet 1999, implanté à Saint-Christol (Vaucluse), caserne Maréchal Koenig, dans le Lubéron, dans l'ancienne base des missiles nucléaires stratégiques. C'est le benjamin des régiments de la Légion. Ses hommes effectuent leurs stages à l'E.M.H.M. (École Militaire de Haute Montagne) à Chamonix. Tous possèdent leurs brevets d'alpinistes et de skieurs militaires. Devise : RIEN N'EMPËCHE.2e R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie), créé en 1841, dissous en 1968, recréé à Corte (Corse) en 1972, installé à Nîmes (Gard), caserne Colonel de Chabrières, depuis 1983. Avec plus de neuf compagnies, c'est le plus important régiment de l'Armée française. Devise : ÊTRE PRÊT.2e R.E.P. (Régiment étranger parachutiste), ancien 2e B.E.P. (Bataillon étranger parachutiste), créé le 9 octobre 1948, devenu 2e R.E.P. le 1er décembre 1955 et installé à Philippeville (Algérie) puis à Bou-Sfer (Algérie). Actuellement, il est installé à Calvi (Corse) au camp Raffali (N.B. : le commandant Raffali a été tué au combat le 10 septembre 1952) depuis 1967. Ce régiment fait partie des quatre régiments d'infanterie de la 11e brigade parachutiste (anciennement 11e D.P., division parachutiste). Il possède aussi le chalet Vergio pour les entraînements en montagne, un village de combat dans le sud de la Corse et un centre nautique. Devise : MORE MAJORUM (POUR SUIVRE L'EXEMPLE DES AÎNÉS alias POUR SUIVRE L'EXEMPLE DES ANCIENS). Depuis la dissolution des 1er et 3e R.E.P., le 2e R.E.P. est le seul régiment de parachutistes de la Légion étrangère. Formée de 9 compagnies regroupant environ 1200 hommes, cette unité, qui s'est notamment illustrée à Kolwezi, a acquis une renommée internationale.3e R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie), créé le 11 novembre 1920 (ancien RMLE, Régiment de marche de la Légion étrangère, formé en 1915) et installé à Fez (Maroc). Il a quitté Madagascar en septembre 1973 et, depuis cette date, a en charge la protection du C.S.G. (centre spatial guyanais) de Kourou et garantit la souveraineté du territoire. Devise : LEGIO PATRIA NOSTRA.3e R.E.P. (Régiment étranger parachutiste), créé à Mascara (Algérie) en avril 1949 sous le nom de 3e B.E.P. (Bataillon étranger parachutiste), devenu 3e R.E.P. le 1er septembre 1955 et basé alors à Flatma. Ce régiment a été dissous le 1er décembre 1955.4e R.E. (Régiment étranger), créé à Marrakech (Maroc) le 15 novembre 1920, devenu le R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie) en 1922, dissous en 1940, recréé en 1941 sous le nom de 4e D.B.L.E. (Demi-brigade de la Légion étrangère), reprenant son nom d'origine, 4e R.E., en 1948, dissous le 25 avril 1964 après la fermeture du centre d'essais nucléaires français à Reggane (Sahara), recréé le 1er juin 1980, implanté en Corse puis transféré à Castelnaudary (Aude), d'abord au quartier Lapasset puis au quartier Capitaine Danjou (quartier baptisé en l'honneur du capitaine qui s'illustra à Camerone), route de Pexora. Ce régiment porte la devise HONNEUR et FIDÉLITÉ sur son drapeau.4e R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie), créé à Meknès (Maroc) avant de s'installer à Marrakech (Maroc). C'est le nom que prit le 4e R.E. en 1922.6e R.E.G. : voir 1er R.E.G. La nouvelle dénomination du 6e R.E.G. était devenue nécessaire après la création du 2e R.E.G.11e R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie), créé à Sidi-bel-Abbès (Algérie) en août 1939, transféré au camp de La Valbonne le 1er novembre 1939. Il a été dissous à l'Armistice.12e R.E.I. (Régiment étranger d'infanterie), créé au camp de La Valbonne le 25 février 1940.13e D.B.L.E. (Demi-brigade de la Légion étrangère), créée le 20 février 1940 à Sidi-bel-Abbès (Algérie). Elle est installée actuellement au quartier Général Monclar à Djiboutide (République de Djibouti, indépendante depuis 1977). Devise : MORE MAJORUM (POUR SUIVRE L'EXEMPLE DES AÎNÉS alias POUR SUIVRE L'EXEMPLE DES ANCIENS).D.L.E.M. (Détachement de la Légion étrangère à Mayotte), créé à partir de la 2e compagnie du 3e R.E.I., installé à Dzaoudzi. Créé en 1973 pour l'ensemble des îles Comores, il s'est replié sur Mayotte en 1976. Devise : PERICULA LUDUS (DANS LE DANGER MON PLAISIR).R.M.L.E. (Régiment de Marche de la Légion Étrangère) : voir 3e R.E.I.Jean-Marie Thiébaud, 2007.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, 2007
L'origine des noms des cinq commandos marine (Hubert, Jaubert, de Montfort, de Penfentenyo et Trepel)
- Commando Jaubert (assaut), basé à Lorient : capitaine de frégate François Jaubert, tué en Indochine le 29 janvier 1946.
- Commando de Montfort (appui et destruction à distance), basé à Lorient : enseigne de vaisseau Louis de Montfort, tué en Indochine le 27 novembre 1946.
- Commando de Penfentenyo (reconnaissance), basé à Lorient : enseigne de vaisseau Alain de Penfentenyo de Kervereguin, tué en Indochine le 12 février 1946.
- Commando Trepel (assaut), basé à Lorient : capitaine Charles Trepel, disparu lors d'un raid en Hollande en février 1944.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, 2007
Les Garessus tués pendant la guerre 1914-1918
- Charles Garessus, né à Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), dont le nom n'a pas été retrouvé dans les fiches du S.H.A.T.
- Émile Prosper Hippolyte Garessus, né à Ferrières-le-Lac (Doubs) le 3 novembre 1884, 2e classe au 171e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi au combat de la forêt d'Apremont dans la Meuse le 27 novembre 1914.
- Henri Albert Léon Garessus, né à Indevillers (Doubs) le 15 octobre 1894, tué à l'ennemi au fort de Vaux (Meuse) le 3 juin 1916.
- Jules Auguste Gaston Garessus, né à Noël-Cerneux (Doubs) le 23 juin 1887, sergent au 171e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Marbotte au bois d'Ailly (Meuse) le 29 septembre 1914.
- Léon Xavier Auguste Garessus, né au Barboux (Doubs) le 4 septembre 1886, 2e classe au 203e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Esnes (Meuse) le 18 septembre 1916.
- Louis Garessus, né à Ferrières-le-Lac (Doubs) le 26 mai 1894, 2e classe au 29e régiment d'infanterie, mort de blessures de guerre dans l'ambulance 5/53 à Dagny (Meuse) le 18 juillet 1916.
- Marie Justin Arthur Armand Garessus, né au Friolais (Doubs) le 3 janvier 1893, 2e classe au 173e régiment d'infanterie, décédée de maladie contracté au service, à l'hôpital d'Épinal (Vosges) le 14 décembre 1914.
Source : S.H.A.T. (Service Historique de l'Armée de Terre), château de Vincennes.
Les devises des R.C.P. (Régiments de Chasseurs Parachutistes)
2e R.C.P. : QUI OSE GAGNE (traduction de la devise anglaise des SAS, « WHO DARES WINS »). Unité dissoute.
3e R.C.P., unité basée à Pau : WHO DARES WINS (devise des SAS).
9e R.C.P., unité créée en 1956 et dissoute en 1999 : NORMANDIE EN AVANT.
18e R.C.P., unité dissoute en 1961 après les évènements d'Algérie : BRAVE 18e, DEVANT TOI L'ENNEMI NE TIENT PAS.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les devises des régiments parachutistes français
- 1er R.H.P. (Régiment de Hussards Parachutistes) - Tarbes (Hautes-Pyrénées), quartier Larrey : SI TOUT EST PERDU, SOUVIENS-TOI QU'IL RESTE L'HONNEUR À SAUVER.
- 1er R.T.P. (Régiment du Train Parachutiste) - Toulouse (Haute-Garonne), quartier Colonel Edmé : PAR LE CIEL, PARTOUT, POUR TOUS.
- 2e R.E.P. (Régiment Étranger Parachutiste) - Calvi (Corse), camp Raffali : MORE MAJOREM (À L'EXEMPLE DE NOS ANCIENS) sans oublier la devise générale de la Légion : LEGIO PATRIA NOSTRA.
- 13e R.D.P. (Régiment de Dragons Parachutistes - Dieuze (Moselle), quartier Maréchal-Lyautey : AU-DELÀ DU POSSIBLE et NUNC LEO, NUNC AQUILA(TANTÔT LION, TANTÔT AIGLE).
- 17e R.G.P. (Régiment de Génie Parachutiste) - Montauban (Tarn-et-Garonne), Quartier Doumerc : SAPEUR SUIS, PARA DEMEURE.
- 35e R.A.P. (Régiment d'Artillerie Parachutiste) - Tarbes (Hautes-Pyrénées), quartier Soult : DROIT DEVANT.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le docteur Frank Schofield (1889-1970) Missionnaire canadien anglophone presbytérien en Corée
Ses études de l'effet du dicoumarol sur le bétail permirent de développement les traitements anticoagulants chez l'homme.
Il mourut en Corée le 12.04.1970 et fut le premier et seul Occidental à être inhumé à Séoul dans la section des patriotes du Cimetière National de Corée, en présence du Premier Ministre.
Le docteur Frank Schofield, membre de l'American College of Pathologists, docteur honoris causa de médecine vétérinaire de l'Université Maximilian de Munich (Allemagne), docteur honoris causa en droit des Universités de Toronto (Canada) et de Corée, avait été décoré en 1968 de l'Ordre du Mérite, la plus haute distinction honorifique de la Corée du Sud.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les devises des R.P.I.M.A. (Régiments Parachutistes d'Infanterie de Marine)
Devise : QUI OSE GAGNE (traduction de la devise anglaise des S.A.S. : WHO DARES WINS)
2e R.P.I.M.A. (créé en 1947, dissous en métropole en 1962, recréé à Madagascar en 1965 par changement d'appellation du 5e Bataillon parachutiste d'infanterie de marine).
Actuellement : Pierrefonds - Saint-Pierre de la Réunion.
Devise : NE PAS SUBIR
3e R.P.I.M.A. (professionnel depuis 1976) - Carcassonne, caserne Laperrine
Devise : ÊTRE ET DURER (donnée par Bigeard)
6e R.P.I.M.A. (a pris cette appellation le 1er décembre 1958). Stationné en Algérie, rapatrié à Verdun puis installé, depuis 1963, à Mont-de-Marsan, caserne Bosquet, et à Biscarosse, camp de Naouas. Ce régiment a été dissous en 1998.
Devise : CROIRE ET OSER
7e R.P.I.M.A. : unité dissoute à Dakar (Sénégal) le 1er mai 1965.
Devise : AU PAQUET
8e R.P.I.M.A. (créé en 1958, stationné à Castres, quartier Fayolle, avenue Desplats, depuis 1963).
Devise : VOLONTAIRE
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Devise du 1er R.C.P. Premier Régiment de Chasseurs Parachutistes
Première compagnie de combat (les verts) : DU CIEL AU COMBAT
Deuxième compagnie de combat (les rouges) : PAS MOYEN QUAND MËME
Troisième compagnie de combat (les noirs) : JE VEUX, JE PEUX
Quatrième compagnie de combat (les gris) : IN CAUDA VENENUM (cette compagnie, qui arborait un scorpion comme insigne pendant la guerre d'Algérie, porte actuellement un marsupilami, animal imaginaire à longue queue interminable, jaune, tachetée de noir, dessinée par Franquin)
Cinquième compagnie (réserve) (les jaunes et bleus, aux couleurs du régiment) : ENSE ET ARATO (Par le glaive et la charrue)
CEA (Compagnie d'éclairage et d'appui) (les bleus) : NE PAS SUBIR
12e compagnie (compagnie de soutien) (les carmine) : FORMARE ET SUSTENTARE PUGNAM (organiser et soutenir au combat)
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les marquis en Franche-Comté Index des noms de lieux Classés par pays et, pour la France métropolitaine, par départements
Algérie 29
- Alger 94, 142
-
Allemagne 104, 137, 142, 160. V. aussi Bade, Bavière, Prusse, Saxe, Souabe, Trêves, Würtemberg.
- Aix-la-Chapelle (Aachen, Rhénanie du Nord-Westphalie) 30
- Alt-Bitingen (Bavière) 93
- Anspach (Franconie, Bavière) 113
- Augsbourg (Augsburg, Bavière) 103, 104
- Berlin (Land de Berlin) 23, 139, 140
- Braunschweig (Brunswick) 139
- Bremen-Farge, kommando de Neuengamme (Hambourg) 140, 142
- Coblence (Koblenz, Rhénanie-Palatinat) 137
- Dachau (Bavière) 82
- Dülmen (Westphalie) 83
- Frankfurt-am-Main (Hesse) 66
- Hambourg (Land d'Hambourg) 27, 140
- Heidelberg (Bade-Würtemberg) 139
- Höchstädt (Bavière) 104
- Kaiserslautern (Rhénanie-Palatinat) 102
- Karlsruhe (Bade-Würtemberg) 83, 113
- Leipzig (Saxe) 64
- Mannheim (Bade-Würtemberg) 54, 121
- Minden (Rhénanie du Nord-Westphalie) 142
- Münich (Bavière) 68, 89, 179
- Neuengamme (Hambourg), camp de concentration 140, 142
- Nuremberg (Bavière) 114, 180
- Rotenburg an der Fulda 183
- Siegen (Rhénanie du Nord-Westphalie) 183
- Trêves (Trier, Rhénanie-Palatinat) 162
- Wesel (Rhénanie du Nord-Westphalie) 30
- Wittemberg (Saxe) 105
Amérique 58, 112, 163
Angleterre 22, 104, 113, 137, 140, 141, 184. V. aussi Grande-Bretagne.
Aragon 9
Argentine
- Buenos Aires 141
Autriche 19, 139
- Vienne 32, 37, 38, 55, 72, 147, 176
Bade (grand-duché) 121
Bavière 63, 82, 121
Belgique 19
- Amblise (province du Hainaut) 140
- Andennes (province de Namur) 142
- Anhée (province de Namur) 66
- Anvers (province d'Anvers) 105
- Barbançon (province du Hainaut) 159
- Belil (province du Hainaut) 140
- Bruges (province de Flandre occidentale) 14
- Bruxelles (région de Bruxelles-Capitale) 66, 76, 81, 119, 133, 134, 158
- Chiny (province du Luxembourg) 184
- Conroy (province du Brabant) 142
- Denée (province de Namur) 66
- Épinay (province du Hainaut) 140
- Everbergh (province du Brabant) 139
- Fleurus (province du Hainaut) 103
- Freyr 132
- Gilly (province du Hainaut) 88
- Ham-sur-Heure (province du Hainaut) 183
- Hornu (province du Hainaut) 143
- Liège (province de Liège) 88, 130
- Limbourg (province) 81
- Louvain (Leuven, province du Brabant flamand) 58, 158
- Malines (province d'Anvers) 105
- Mons (province du Hainaut) 94, 139, 158, 183, 184
- Namur (province de Namur) 157
- Neerwinden (province du Brabant) 102
- Nieuport (Nieuwport, province de Flandre occidentale) 81
- Ostende (province de Flandre occidentale) 47
- Philippeville (province de Namur) 78
- Rixensart (province du Brabant wallon) 66
- Roeulx (Le) (province du Hainaut) 83
- Staden (province de Flandre occidentale) 111
- Tournai (province du Hainaut) 135
- Turnhout (province d'Anvers) 157
- Waulsort (province de Namur) 133
- Ypres (province de Flandre occidentale) 111
- Yvoir (province de Namur) 93
Brésil 165
- Rio de Janeiro 94, 165
Canada
- Québec (province du Québec) 44
Castille et Castilles (Deux-) 9, 86, 117
Chypre 31
Confédération Helvétique : v. Suisse
Crimée (Empire de Russie) 29, 98
Danemark
- Copenhague
Deux-Castilles : v. Castille
Deux-Siciles (royaume des) 58
Égypte 173
- Le Caire 44
Espagne 19, 45, 102, 138. V. aussi Aragon, Castille.
- Barcelone (Catalogne) 59, 104
- Cadix (Andalousie) 45
- Madrid 81, 105, 138, 158
- Saint-Ildefonse (San Ildefonso, Castille-León) 38
- Tarragone (Tarragona, Catalogne) 59
- Vitoria (Pays basque) 91
Estrémadure 117
États-Unis 139
- Alexandrie (Virginie) 112
- Chesapeake (baie sur l'océan Atlantique, Maryland et Virginie) 112
- New York 21, 138
- Ohio, fleuve 112
- Pennsylvanie (état) 140
- Portsmouth (New Hampshire) 112
- Potomac, fleuve 112
- San Francisco (Californie) 94
- Sciotto, rivière, affluent de l'Ohio 112
Éthiopie 164
- Addis-Abeba 164
Europe 164
France 165
Ain (01)
- Bourg-en-Bresse 81, 105, 146
- Chalamont 81
- Châtillon-les-Dombes 100
- Gex 99
- Marboz 102
- Meximieux 33, 35
- Montmerle 81
- Neuville en Bresse : v. Neuville-les-Dames
- Neuville-les-Dames 89
- Pont-de-Vaux 37, 38, 81
- Saint-Sorlin (commune actuelle de Saint-Sorlin en Bugey) 37
- Saugey 175
- Sermoyer 81
- Seyssel 37
- Trévoux 102
- Varambon 158
Aisne (02)
- Branges 92
- Passy-en-Valois 135
- Saint-Quentin 33
- Vailly-sur-Aisne 166
Allier (03) 87
- Moulins 137, 165
- Paray le Frésil 87
- Vichy 130, 142
Alpes (Hautes-) (05)
- Briançon 30
Alpes Maritimes (06)
- Cannes 91, 179
- Châteauneuf Grasse 92, 93
- Grasse 62, 92, 134
- Nice 73, 90, 92, 165, 172
- Valbonne 47
- Vence 92
Ardèche (07)
- Annonay 166
- Grospierres 95
- Lanas 47
- Plantier (Le) 166
- Vans (Les) 94
Ardennes (08)
- Ambly 27
- Blaise 27
- Ferté-sur-Chiers (La) 152
- Parfondru 79
Ariège (09)
- Pamiers 176
Aube (10) 87
- Dienville 29
- Épagne 156
- Saint-Phal 156
- Troyes 156
- Vaubercey 156
Aude (11)
- Couffoulens 47
- Pennautier 118
- Ribaute 47
Basses-Pyrénées : v. Pyérénées Atlantiques
Bouches-du-Rhône (13) 87
- Aix-en-Provence 95
- Arles 43
- If (château), Marseille 91, 164
- Marseille 78, 130, 160, 164
- Tarascon 57
Calvados (14)
- Barneville 137
- Caen 176
- Coulibuf : v. Morteaux-Coulibuf
- Fontaine Henry 51
- Morteaux-Coulibuf 51, 52
- Saint-Germain Langot 51
- Troarn 43
Cantal (15)
- Allanche 89
Charente (16) 180
- Angoulême 151
- Vasselay La Brosse 99
Charente Maritime (17)
- Brouage 53
- Rochelle (La) 155
- Saintes 59
- Saint-Simon 58
- Taillebourg 102
- Tesson 58
Cher (18)
- Bourges 150, 151
- Saint-Martin d'Auxigny 150
- Thaumiers 79
Corrèze (19) 180
- Tulle 166
Côte d'Or (21) 88, 90, 92
- Agey 89
- Antigny (commune actuelle d'Antigny La Ville) 102
- Arceau 118
- Auvillars-sur-Saône 147
- Auxonne 123
- Beaune 95, 97, 100, 102, 121, 122
- Charmes 37
- Charrey 91
- Châtillon-sur-Seine 79
- Concur 100
- Dampierre 178
- Diancey 89
- Dijon 24, 30, 41, 49, 50, 55, 59, 65, 71, 72, 77, 78, 88, 89, 92, 96, 101, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 165, 158, 170, 174, 182
- Époisses 119
- Flammerans 131
- Fraignot et Vesvrotte 126
- Genlis 95
- Glanon 146
- Grosbois 11, 144
- Grosbois-les-Tichey 77, 89
- Longecourt 88
- Lusigny-sur-Ouche 95
- Mandelot : v. Mavilly-Mandelot
- Mauvilly 40
- Mavilly : v. Mavilly-Mandelot
- Mavilly-Mandelot 178
- Mirebeau-sur-Bèze 37, 38
- Montmain 37, 166
- Motte-les-Argilly (La) 123
- Roche-en-Brenil (La) 66
- Rochefort 79
- Rouvres-en-Plaine 118
- Ruffey-les-Échirey 34, 125
- Saint-Aubin 178
- Saint-Jean-de-Losne 21
- Savigny 139
- Semur-en-Auxois 29, 61, 62
- Sombernon 33, 35
- Tanay 122
- Thenissey 151
- Trouhans 125
- Vellemont 144
- Villecomte 86
- Villers la Faye 37
- Vouges 144
Creuse (23)
- Noth : v. Serrier (Le)
- Royère de Vassivière 58
- Serrier (Le), commune de Noth 58
Doubs (25) 98, 132, 138, 141, 142, 148, 154, 165, 167, 174, 177, 179
- Abbans-Dessous 66, 69, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 136
- Abbans-Dessus 97, 99
- Abbenans 70
- Aigremont (commune de Roulans) 108
- Amagney 100
- Ambre (commune de Bouclans) 108
- Amondans 122
- Antorpe (ancienne commune du Jura, rattachée à Saint-Vit) 177
- Arguel 63
- Auxon 31
- Auxon-Dessous 46, 47
- Avanne (commune actuelle d'Avanne-Aveney) 146
- Baume-les-Dames 40, 73, 90, 97, 135, 141, 143
- Beline (La), banlieue de Besançon 110
- Belvoir 158
- Besançon 13, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 139, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184
- Bouclans 107, 108
- Boulot (Geneuille) 166
- Bournel (château de) : v. Cubry
- Bournois 70, 149
- Boussières 25
- Brémondans 70, 149
- Bréseux (Les) 85
- Burgille 180
- Busy 62, 63, 64, 123
- Byans 81, 95
- Cendrey 66
- Cernay 85
- Chalezeule 95, 183
- Châtelneuf-en-Vennes (commune actuelle de Consolation-Maisonnettes) 103, 159
- Châtillon-Guyotte 62
- Chaucenne (25) 28, 59
- Chevigney-lès-Vercel 25
- Cléron 131, 167
- Cluse-et-Mijoux (La) 30, 32, 152
- Consolation (commune actuelle de Consolation-Maisonnettes) 158, 181
- Corcondray 37
- Cordiron (commune fusionnée avec celle de Burgille) 37
- Courcelle (indét.) 124
- Courchapon 32
- Cour-Saint-Maurice 163
- Courvières 109, 124
- Crouzet-Migette 56, 57, 67, 68, 90, 91, 131, 132, 163
- Cubry (et château de Bournel) 121, 137, 139, 141, 142, 143, 144
- Déservillers 27
- Durnes 33, 35, 37
- Écorces (Les) 85
- Étrabonne 32
- Fertans 131
- Flagey-Rigney 37
- Fleurey 163
- Fontain 31, 47, 67
- Fontenelle-Montby 63, 76
- Fourg 81
- Geneuille 166
- Gennes 122
- Glamondans 108
- Joux (château) : v. Cluse-et-Mijoux (La)
- Labergement-Sainte-Marie 42
- Larnod 63, 64
- Lavernay 37
- Leugney 70, 149
- Liesle 69, 81
- Loray (25) 167, 168, 174
- Maîche 65
- Maisières (commune actuelle de Maisières-Notre-Dame) 100, 106
- Malans 99
- Mamirolle 109, 124
- Mancenans 85
- Métabief 46, 166
- Migette : v. Crouzet-Migette
- Miserey-Salines 46, 47
- Moncey 62
- Moncley 95, 167, 168, 169, 170, 172, 174
- Montbéliard 145
- Montbenoît 84, 185
- Montferrand-le-Château 37
- Montmartin 100, 101, 102
- Mont-Sainte-Marie (abbaye), commune de Labergement-Sainte-Marie 42
- Morre 122
- Morteau 69, 94
- Myon 56
- Naisey (commune actuelle de Naisey-les-Granges) 90
- Nans 137, 142
- Noironte 124
- Novillars 90, 100
- Ollans 39, 40, 77
- Orgeans (commune actuelle d'Orgeans-Blanchefontaine) 85
- Ornans 35, 62, 105, 106
- Orsans 70, 149
- Osse 108
- Palantine 95
- Pontarlier 49, 105, 109, 124, 125, 126, 173, 183
- Provenchère 156
- Pugey 108
- Quingey 95
- Rantechaux 76
- Recologne 48, 49, 101
- Refranche 17
- Rennes-sur-Loue 11, 44, 56, 99, 100
- Rougemont 147, 156, 157
- Roulans 108
- Ruffey-le-Château 37
- Saint-Hippolyte 157
- Saint-Julien 158
- Saint-Juan 125
- Saint-Vit 177
- Sancey 58, 158
- Saône 153
- Scey-en-Varais 106
- Sochaux 97
- Soye 101
- Thoraise 185
- Torpes 60
- Trepot 62
- Uzelle 101
- Vaire 32
- Vaire-le-Grand 32
- Valdahon (Le) 125
- Vercel 70, 73
- Villars-Saint-Georges 95
- Vuillafans 37, 157, 159
- Vuillafans-le-Vieux (seigneurie) 157
Drôme (26)
- Loriol 47
Eure (27)
- Bec Hellouin (Le) 94
- Chaise-Dieu du Theil
- Conde-sur-Iton 115
- Écos 87
- Évreux 115
- Glisolles 139
- Montreuil l'Argille 177
- Verneuil-sur-Avre 138
Finistère (29)
- Brest 22, 95, 114, 146
- Concarneau 145
- Fouesnant 145
- Lesnévar 145
- Saint-Paul-de-Léon 130
Gard (30)
- Aigues-Mortes 47
- Boucoiran 47
- Branoux-les-Taillades 175
- Quincandon, commune d'Aigues-Mortes 47
- Saint-Paulet-de-Caisson (chartreuse de Valbonne) 181
- Valbonne (chartreuse) : v. Saint-Paulet-de-Caisson
- Vezenobres 47
- Vigan (Le) 47
- Villevieille 58
Garonne (Haute-) (31)
- Lezac 96
- Rieux 96
Gers (32)
- Condom 136, 137
Gironde (33) 87
- Blaignac 133
- Bordeaux 131
- Château Léoville, commune de Saint-Julien 148
- Civrac 88
- Garve d'Ambarès (La) 42
- Saint-Julien 148
Hérault (34)
- Béziers 96
- Lunel 47
- Montpellier 34
- Villemagne (commune actuelle de Villemagne L'Argentière) 96
Ille-et-Vilaine (35)
- Gouillon 47
- Miniac Morvan 132, 133, 137
Indre (36)
- Neuvy-Pailloux 136
Indre-et-Loire (37)
- Amboise 139, 149
- Château-la-Vallière 114, 117
- Loches 52, 182
- Saint-Ouen-les-Vignes 149
- Tours 91, 116
Isère (38)
- Grenoble 29, 47, 53, 172, 181
- Tencin 154
Jura (39) 170, 176, 179, 180
- Abergement (L') 11, 54, 57, 78
- Abergement-les-Thésy 117
- Acey (abbaye) : v. Vitreux
- Aizans 74
- Amange 46
- Andelot-lès-Saint-Amour : v. Andelot-Morval
- Andelot-Morval 85
- Annoire 76, 77
- Arbois 17, 54, 56, 78, 127, 170, 181
- Aresches 11, 56, 57, 117
- Arinthod 126, 132, 133, 135, 136
- Arlay 179, 181
- Augéa 181
- Augerans 57
- Aumont 36
- Authume 66, 71, 121, 122, 123
- Auxange 31
- Azans 108
- Balme (La) 135
- Baume-les-Messieurs 17, 57, 81, 123, 130, 131, 185
- Beauchemin (commune rattachée à celle de Chemin) 77, 155
- Beffia 114
- Bellecin (commune rattachée au Bourget) 76
- Belmont 81
- Belmont (château), commune de Saint-Lothain 110
- Bersaillin 75
- Binans (commune rattachée à Publy) 53, 54
- Blandans (commune rattachée à Domblans) 130, 135
- Bletterans 183
- Boissière (La) 32
- Bornay 50
- Bouchot (Le) 75
- Bourget (Le) 76
- Boutavant (commune rattachée à celle de Vescles) 105, 126
- Brainans 66
- Bretenière (La) 76
- Bretenières 77
- Broissia 76
- Censeau 109
- Chambéria 33
- Chamblay 164
- Champagney 78
- Champagnolot 54
- Champdivers 31, 46
- Champvans 67, 155
- Chapelle-sur-Furieuse (La) 56
- Charézier 81
- Château-Chalon 38, 40, 77, 183
- Châtel-de-Joux 37
- Châtelet (Le) 114
- Chatenois 76, 77
- Chaumergy 155
- Chaussin 78, 110
- Chaux-des-Crotenay (La) 45
- Chemin 176
- Chilley 11, 56, 57
- Chilly (commune actuelle de Chilly-le-Vignoble) 50, 136
- Chissey 81
- Choisey 111, 155
- Clairvaux-les-Lacs 35, 37, 38
- Combe (La), lieu-dit 32
- Condes 81
- Conliège 53
- Corcondray 81
- Cornod 126
- Costarel 126
- Courlaoux 102, 103, 114, 115
- Cousance 32
- Cressia 36
- Crissey 46
- Curny, village disparu près de Montagna-le-Reconduit 135
- Dammartin (commune actuelle de Dammartin Marpain) 78
- Dampierre 64, 146
- Deschaux (Le) 150, 178, 179
- Dole 10, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 32, 38, 46, 53, 55, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 93, 94, 96, 99, 100, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 146, 147, 151, 153, 154, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 178, 180, 181
- Domblans 94, 130, 135
- Dramelay 135, 136
- Éclans (commune actuelle d'Éclans Nenon) 66, 176
- Esclans : v. Éclans
- Étival 33, 34
- Étoile (L') 41
- Évans 96, 181
- Falletans 63, 64
- Ferté (La) 54
- Fétigny 106, 126
- Fort-du-Plasne 114
- Fraisans 12, 146, 147
- Frontenay 127, 128, 129
- Gatey 154
- Gendrey 106
- Germigney 11, 56, 57
- Gigny 96
- Goailles, hameau de Salins 134
- Grandvaux : v. Saint-Laurent-en-Grandvaux
- Grange de Vaivre 56
- Grozon 185
- Grusse 178
- Holiferne : v. Oliferne
- Larnaud 64
- Lavans-les-Dole : v. Lavans-les-Orchamps
- Lavans-les-Orchamps (commune actuelle de Lavans-les-Dole) 109
- Lavigny 178
- Longwy (commune actuelle de Longwy-sur-le-Doubs) 67, 69
- Lons-le-Saunier 22, 32, 40, 50, 51, 56, 57, 72, 73, 74, 77, 78, 106, 112, 114, 115, 116, 127, 131, 135, 136, 145, 152, 173, 179, 181
- Louverot (Le) 72
- Loye (La) 151
- Maisod 76, 152
- Mantry 181
- Marigna (commune actuelle de Marigna-sur-Valouse) 32, 33
- Marigny 33, 37, 38, 39
- Marnézia 114
- Marnoz 150
- Marpain (commune actuelle de Dammartin Marpain) 54, 55, 131
- Marterey 45
- Marzenay (commune réunie à celle de Chambéria) 32
- Maynal 33
- Miéry 129, 167
- Mignovillard 90
- Mirebel 106
- Moissey 52
- Molamboz 64, 76
- Molay 125
- Monnetay
- Montagna (commune actuelle de Montagna-le-Reconduit) 76
- Montcroissant (commune actuelle de Chisséria) 135
- Monteplain : v. Plaine (La)
- Montigny (commune actuelle de Montigny-lès-Arsures) 50, 98, 151, 155, 156
- Montmirey-la-Ville 79
- Montrambert (commune réunie à celle de Marpain) 54, 55
- Mont-Saint-Sorlin, hameau de la commune de Charézier 81
- Moutonne 112, 113, 114
- Mutigney 54, 78
- Nance 114, 178
- Nancuise 32
- Neublans (commune actuelle de Neublans Abergement) 75, 76, 77, 78, 79
- Nevy-sur-Seille 110
- Nozeroy 33, 67, 109, 129, 183
- Oizans 74
- Oliferne (commune actuelle de Vescles) 135
- Orchamps 71
- Orgelet 113, 114
- Ougney 54, 105
- Ounans 164
- Pagney 54
- Pagnoz 56
- Parcey 171
- Parthey (château) : v. Choisey
- Perret (Le) 11, 56, 57
- Perrigny 131
- Petit-Noir (Le) 76, 77
- Plaine (La), hameau de Monteplain 10
- Pleure 31, 65, 146
- Plumont 32
- Poligny 18, 45, 55, 78, 110, 128
- Présilly 114
- Publy 53, 54
- Pupillin 75
- Quintigny 64, 75, 117
- Rahon 125, 126
- Ranchot 10, 66, 69
- Rans 10, 45, 66, 68, 69, 70
- Revigny 62
- Rochefort 121
- Rochette (La), grange 146
- Romange 179
- Rosières (abbaye) 170
- Rothonay 114
- Rye 53
- Saint-Amour 45, 54, 114
- Saint-Claude 51, 72, 96, 112, 160
- Saint-Julien 81, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 116
- Saint-Laurent-en-Grandvaux 112, 114
- Saint-Lothain 108, 110
- Saint-Loup 104
- Saint-Martin 129, 131
- Saint-Maur 50
- Saint-Thiébaud 65, 146
- Saint-Ylie (commune rattachée à Dole) 122, 168
- Salins (commune actuelle de Salins-les-Bains) 14, 18, 22, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 44, 45, 55, 56, 57, 81, 90, 91, 117, 135
- Sapois 76
- Sarrogna 153
- Saulçois (Le), hameau du Petit-Noir 76
- Savigna 32
- Sellières 146, 162
- Sézéria 113, 116
- Sirod 183
- Soucia 146
- Souvans 45
- Thoissia 135
- Vadans 54, 159
- Vaudrey 102, 170, 171, 172
- Vaugrenans (hameau de la commune de Pagnoz) 56
- Vernantois 114
- Vernois (Le) 185
- Vertamboz 35, 151
- Vescles 126
- Villangrette (commune rattachée à celle de Saint-Loup) 77
- Villerserine 76
- Villers-les-Bois 45
- Villers-Robert 181
- Villette (commune actuelle de Villette-lès-Arbois) 98
- Villette (La) (commune de Sarrogna) 153
- Vitreux 116
- Voiteur 27, 62, 129
- Vosbles 175
Landes (40)
- Dax 29
Loir-et-Cher (41) 116
- Avaray 138
- Azé 111
- Blois 63, 116
- Fréchines, château de la commune de Villefrancur 138
- Menaudière (La) 28
- Montrichard 28
- Saint-Lubin 152
- Vendôme 148
- Villefrancur 138
Loire (42) 87
- Châteaumorand, commune de Saint-Martin d'Estréaux 132
- Écotay l'Olme 66
- Montbrison 66
- Saint-Martin d'Estréaux 132
Loire (Haute-) (43)
- Borie en Velay (La) 166
- Cluzel-Saint-Éblé 44
Loire Atlantique (44)
- Nantes 152
Loiret (45) 74
- Audeville 97
- Changy 119
- Changy-les-Bois (château) 119
- Gien 125
- Orléans 150
- Ouchy 71
Lot (46) 116
Maine-et-Loire (49)
- Andigné 30
- Angers 45, 118, 133
- Boissière-sur-Èvre (La) 94
- Chalonge 94
- Chapelle-sur Oudon 118
- Châtelais (Le) 94
- Durtal 30
- Feuille (La) 80
- Grange (La), commune de Saint-Barthélemy Anjou 80
- Lorie (La), château, commune de Chapelle-sur-Oudon 118
- Marche (La) 80
- Saint-André de La Marche 80
- Saint-Barthélemy Anjou 80
- Saint-Georges-sur-Loire 138
- Saint-Mélaine-sur-Aubance 80
- Sainte-Gemmes d'Andigné
- Saumur 28, 115
- Séguinière (La) 80
- Serrant (château), commune de Saint-Georges-sur-Loire 138
- Torfou 140
- Treille (La) 80
Manche (50)
- Avranches 28
Marne (51)
- Challerange, commune de Taissy 135
- Reims 51, 79
- Taissy 135
- Troissy 158
Marne (Haute-) (52) 152, 153
- Arc-en-Barrois 36
- Bourbonne-les-Bains 41
- Bourmont 41, 80
- Châteauvillain 183, 185
- Chaumont-en-Bassigny 27
- Daillecourt 54
- Dammartin-sur-Meuse
- Dommartin 153
- Doulaincourt-Saucourt 97
- Dracy-les-Couches 135
- Éclaron 28
- Farincourt 151
- Fresnes-sur-Apance 80
- Heuilly-Cotton, commune de Longeau 154
- Langres 29, 39, 152, 154
- Longeau 154
- Melay 41
- Meuvy (commune de Breuvannes en Bassigny) 54
- Montier-en-Der 107
- Montsaugeon 37, 39
- Pailly (Le) 58
- Palaïseul 58
- Poinson 44
- Pressigny 58
- Rennepont 97
- Roche-Bettaincourt 97
- Roches-sur-Rognon 93, 96, 97
- Saint-Dizier 90
- Verseilles 31
- Villegusien 28, 29
Mayenne (53)
- Quelaines-Saint-Gault 30
- Saint-Gault : v. Quelaines-Saint-Gault
Meurthe (département n'existant plus) 133
Meurthe-et-Moselle (54)
- Bayonville sur Mad 148
- Brémoncourt 35
- Clayeures 54
- Deneuvre 160
- Friauville 147, 160
- Gerbeviller 100
- Gibeaumeix 147, 160
- Gondreville 55
- Hamonville (commune actuelle de Landres) 155
- Haroué 54, 103
- Haussonville 135
- Jallaucourt 173
- Landres-aux-Quatre-Tours (commune actuelle de Landres) 55, 155
- Lanfroicourt 50
- Lenoncourt 115
- Lunéville 28, 54, 80, 103, 106, 138
- Manoncourt 115
- Nancy 14, 28, 51, 54, 63, 80, 86, 94, 99, 103, 108, 112, 115, 129, 146, 147, 160, 173
- Neuville (La) 51
- Pompey 80
- Pont-à-Mousson 119
- Reillon 28
- Saint-Max 148
- Thionville 128
- Toul 172
- Vandeléville 50
- Veldenz 53
- Ville-sur-Yron 116
Meuse (55) 90
- Beaulieu en Argonne 115
- Bertheleville (commune actuelle de Dainville-Bertheleville) 43, 55
- Buzy-Darmont 148
- Dainville-Bertheleville 43
- Demange aux Eaux 90
- Genicourt 56
- Gondrecourt 56
- Ligny 90
- Mauvages 41, 90
- Montmédy 128
- Nettancourt 113
- Richecourt 27
- Saint-Mihiel 50
- Spincourt 147, 160
- Sponheim 53
- Treveray 90
- Vaucouleurs 41
- Verdun 89, 92, 113, 115
- Vignot 147
- Vouthon 56
Mont-Blanc (département) 137
Moselle (57)
- Amnéville 97
- Audun le Tiche 128
- Augny 161
- Bettange 162
- Boussange 97
- Clouange 97
- Coincy 153
- Étangs (Les) 35
- Forbach 53
- Justemont 116
- Metz 17, 35, 57, 78, 83, 109, 112, 115, 123, 125, 126, 128, 135, 148, 153, 156, 161, 162, 173
- Moyeuvre 96, 97
- Moyeuvre Grande 97
- Pouilly 156
- Saint-Jean-Rohrbach 82
- Sainte-Marie-aux-Chênes 97
- Saulny 160
- Thionville 161
- Villers 97
- Vitry-sur-Orne 116
Nièvre (58) 133
- Anlezy 130
- Bazoches 131
- Montagne (La) 51
- Nevers 130, 131, 132
Nord (59)
- Bavay 33
- Cambrai 131
- Cassel 103
- Douai 17, 103
- Dunkerque 59, 141
- Lille 103, 121, 141
- Malplaquet 32, 33
- Maubeuge 162
- Quesnoy (Le) 149
- Trélon 65
- Valenciennes 56
Oise (60)
- Bonnemain 84
- Breteuil 61
- Chantilly 164
- Compiègne 142
- Crillon 83
- Dieudonné 42
- Fayel (Le) 138
- Hautefontaine 84
- Marseille-en-Beauvaisis 42
- Mortefontaine 84
- Verberie 84
Orne (61) 87
- Alençon 138
- Aubry-en-Exmes 99
- Coulonges 133
- Saint-Maurice-du-Désert 139
Pas-de-Calais (62)
- Aire en Flandre : v. Aire sur la Lys
- Aire sur la Lys 36, 138
- Andres 131
- Arras 80, 100, 158, 172
- Béthune 80
- Boulogne 131
- Burbure 90
- Ligny sur Canche 38
- Marles-lès-Béthune 80
- Monchy-en-Artois 142
- Saint-Venant 35, 36
- Wavrans 80
Pyrénées Atlantiques (64) 92
- Bayonne 65
- Biarritz 65
- Pau 46, 74, 89, 91
- Saint-Jean-de-Luz 172, 175
Pyrénées (Hautes-) (65)
- Bagnères de Bigorre 74, 101
- Tarbes 116
-
Rhin (Bas-) (67) 180
- Barr 106
- Drusenheim 117
- Entheim 35
- Haguenau 116
- Krautergersheim 116
- Lauterbourg 117
- Strasbourg 24, 54, 91, 114, 116
Rhin (Haut-) (68)
- Bennwihr Gare 183
- Cernay 86
- Colmar 86, 98
- Heidwiller
- Hirsingue 68
- Schoppenwihr (château), commune de Bennwihr Gare 183
- Thann 86
Rhône (69) 97, 116
- Barbe (île) 115
- Caluire (commune actuelle de Caluire et Cuire) 115
- Écully 93, 97
- Lyon 68, 69, 79, 94, 96, 97, 98, 104, 111, 115, 128, 136, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 153, 173, 177, 181, 184
- Saint-Priest 47
- Vernay 115
Saône (Haute-) (70) 82, 118, 120, 165
- Aboncourt Gesincourt 163
- Achey 153, 185
- Amance 60, 156, 157
- Amblans (commune actuelle d'Amblans et Velotte) 28, 29, 30
- Andelarre 89, 92
- Andelarrot 18, 89
- Apremont 104
- Argillières 154
- Athésans (commune actuelle d'Athésans-Étroitefontaine) 41
- Aubigney (commune actuelle de Broye Aubigney Montseugny) 54
- Augicourt 163
- Avrigney (commune actuelle d'Avrigney Virey) 50
- Bard-les-Pesmes (commune actuelle de Broye Aubigney Montseugny) 54
- Baulay 71
- Bay 117
- Beaujeu (commune actuelle de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-Quitteur) 104
- Bétaucourt 70, 149
- Beveuge 45, 70, 164
- Blondefontaine 70, 149
- Bonboillon 150
- Bougnon 81
- Boulot 101
- Brotte 48
- Broye (commune actuelle de Broye Aubigney Montseugny) 54
- Bussières 46, 164, 166
- Buthiers 83, 85, 94, 95, 164, 165, 185
- Cecey : v. Essertenne et Cecey
- Cenans 44, 156
- Cendrecourt 71
- Champagney 104
- Champlitte 37, 176, 177, 178
- Champtonnay 54
- Chancey 151
- Charentenay (commune actuelle de Soing Cubry Charentenay) 88, 89
- Chargey 184
- Chariez 33, 38
- Chassey-(les-Montbozon) 137
- Chaumercenne 54, 150, 151
- Chauvillerain, écart de la commune de Faucogney et La Mer 88
- Chavanne 155
- Choye 18
- Citey 41
- Clairefontaine (abbaye) : v. Polaincourt et Clairefontaine
- Colombier 136, 161
- Combeaufontaine 150, 151
- Conflans-sur-Lanterne 107
- Courchaton 70
- Courcuire 118
- Cresancey 54
- Crevans (commune actuelle de Crevans et La Chapelle-les-Granges) 72, 83
- Cromary 153
- Cult 37
- Dammartin-lès-Pesmes 78
- Dampierre-sur-Salon 50, 184
- Deschaux (Le) 150, 178, 179
- Échenoz 170
- Essertenne et Cecey 92, 93
- Étang-des-Maisons (L') 50, 51
- Fallon 70, 148, 149, 179
- Farincourt 151
- Faucogney (commune actuelle de Faucogney et la Mer) 48, 87, 88, 166
- Filain 48, 49
- Flagy 37
- Fleurey 150
- Fondremand 153, 155
- Fontaine-lès-Luxeuil 66, 68
- Fougerolles 43
- Fouvent 36
- Franchevelle 87, 88, 117
- Frotey 170
- Genevrey 41, 163
- Gésincourt (commune actuelle d'Aboncourt-Gésincourt) 163
- Grachaux (commune actuelle d'Oiselay et Grachaux) 155
- Grande Résie (La) 58
- Granges 70
- Gray 49, 87, 120, 128, 185
- Guiseuil 43, 44, 156
- Gy 42, 185
- Héricourt 143, 179
- Igny 50, 51
- Jaquot, nom donné au village d'Andelarrot en 1777 18, 89
- Jasney 48
- Jussey 70, 149
- Lambrey 163
- Larians (commune actuelle de Larians et Munans) 40
- Lomont 60, 61
- Loulans (commune actuelle de Loulans Verchamp) 43, 44, 56
- Lure 28, 134
- Luxeuil (commune actuelle de Luxeuil-les-Bains) 28, 29, 35, 43, 49, 66
- Magnoncourt 87
- Magny (commune actuelle de Magny-Vernois) 52, 60, 70
- Mailley (commune actuelle de Mailley et Chazelot) 167, 169, 170
- Marast 70, 84
- Marnay 34, 37, 38, 80, 81, 106
- Mercey-sur-Saône 71
- Moimay 72
- Mollans 29
- Montagney 106
- Montboillon 59, 60
- Mont-le-Vernois 52
- Montureux (commune actuelle de Montureux-lès-Baulay) 71
- Montureux et Prantigny 101
- Morey 151
- Neuvelle 27, 60
- Neuvelle-lès-Cromary 155
- Noidans 170
- Oiselay (commune actuelle d'Oiselay et Grachaux) 54, 155
- Onay 54
- Oricourt 52
- Ormenans
- Pesmes 54, 99, 102, 159
- Pin-l'Émagny 50
- Polaincourt et Clairefontaine 45, 46
- Pont-de-Planches (Le) 27
- Prantigny (commune actuelle de Montureux et Prantigny) 101
- Purgerot 71
- Pusey 36
- Pusy et Épenoux 52
- Raincourt 100, 149
- Ray : voir Ray-sur-Saône
- Ray-sur-Saône 118, 120, 121, 139
- Renaucourt 150, 151
- Résie Saint-Martin (La) 54
- Rigny 127, 128
- Rochelle (La) 127, 175
- Rosey 89
- Rosières-sur-Mance 52, 96, 156
- Sainte-Marie 163
- Sainte-Reine 50, 51
- Saint-Rémy 153
- Saulx 161, 162
- Sauvigney 54
- Scey-sur-Saône (commune actuelle de Scey-sur-Saône et Saint-Albin) 33, 35, 37, 38, 39, 164
- Seveux 119
- Sorans (commune actuelle de Sorans-les-Breurey) 48, 154, 156
- They, commune de Sorans 154, 156
- Thiéffrans 63, 64
- Traves 35, 37
- Trésilley 156
- Tromarey 151
- Vadans 54
- Vallerois 163
- Vandelans 43
- Vaudey 10
- Vauvillers 97
- Vellechevreux (commune actuelle de Vellechevreux Courbenans) 72, 83
- Vellemoz 50, 51
- Vellexon, hameau de Vaudey 10
- Venère 54
- Venisey 71
- Vesoul 29, 38, 41, 43, 44, 48, 49, 58, 71, 88, 89, 96
- Villers 150
- Villers-Bouton 101
- Villers-Chemin et Mont-les-Étrel 41, 156
- Villers-la-Ville 70
- Villersexel 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 157
- Villers-sur-Port 70
- Villers Vaudey 150, 151
- Virey (commune actuelle d'Avrigney Virey) 37
- Voray 164
Saône-et-Loire (71) 177, 180
- Autun 64, 94
- Auxy 101
- Bourgneuf 111
- Bouton 180
- Buxy 99
- Chagny 77
- Chaintré 78
- Chalon-sur-Saône 179
- Chassey-le-Camp 144
- Châteaurenaud 117
- Cluny 180
- Couches 63
- Curbigny 83
- Damerey 181
- Digoine, ancien village sis dans l'actuelle commune de Palinges 63
- Dracy-les-Couches 81
- Fleury-la-Montagne 65
- Genouilly 66
- Gilly-sur-Loire 99
- Grand Taperey 146
- Joude 99
- Ligny-en-Brionnais : v. Saint-Rigaud
- Longepierre 122
- Lucenay-L'Évêque 79
- Lugny-les-Charolles 82, 83
- Mâcon 17, 84, 123
- Palinges : v. Digoine
- Remigny 39
- Rochebeaucourt (La) 151, 152
- Saint-Rigaud (abbaye), commune de Ligny-en-Brionnais 17
- Sassenay 145
- Sommant 94
- Terrans 65
- Valotte : v. Chassey-le-Camp
- Verdun-sur-le-Doubs 184
- Verdun-sur-Saône 183. V. aussi Verdun-sur-le-Doubs
Sarthe (72)
- Château-du-Loir 182
- Mans (Le) 96, 128
- Montabon 140
- Mont-Saint-Jean 83
- Noyen-sur-Sarthe 140
- Sablé-sur-Sarthe 134
Savoie (73) 87
- Chambéry 102
Savoie (Haute-) (74)
- Annecy 107
- Balme sur Cerdon (La) 45
- Bathie d'Albanais (La) 133
- Collonges-sous-Salève 58
- Évian-les-Bains 175
- Menthon (commune actuelle de Menthon-Saint-Bernard) 79, 176
- Veyrier du Lac 107
Paris (75) 16, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 63, 65, 66, 71, 72,
73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 128,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 161, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 180, 181, 182
- Batignolles Montceaux 175
- Bercy (village rattaché à Paris en 1860) 83
Seine Maritime (76)
- Arques-la-Bataille 127
- Eu 43
- Dieppe 47
- Havre (Le) 62
- Mans (Le) 96, 101, 116
- Marigny 127
- Mesnil 53
- Rouen 35
Seine-et-Marne (77)
- Baby 101
- Châtelet-en-Brie 172
- Diant 176, 177, 178
- Everly 139
- Evry Gregy sur Yerre 154
- Fontainebleau 30, 176
- Maurevert 56
- Meaux 92
- Melun 175
- Paroy 150
- Vaux-le-Penil 83
Yvelines (78)
- Marly-le-Roi 175
- Port-Marly 97
- Rambouillet 164
- Saint-Germain-en-Laye 80, 94
- Versailles 10, 13, 31, 34, 36, 38, 44, 47, 53, 54, 69, 93, 94, 96, 104, 111, 115, 128, 136, 137, 139, 143, 145, 149, 153, 173, 177, 181, 184
Sèvres (Deux-) (79) 143
- Pressigny 143
Somme (80) 115
- Amiens 80, 173
- Cayeux 142
- Davenescourt 74
- Monchy-Cayeux 142
- Péronne 163
- Ronssoy 42
- Saint-Acheul 173
Tarn (81) 119
- Saint-Amans-La-Bastide 119
- Saint-Amans-Soult 119
Tarn-et-Garonne (82)
- Montauban 105
Var (83)
- Montauroux 92
- Porquerolles (île) 46
- Sanary-sur-Mer 128
- Toulon 22, 114, 128, 136
Vaucluse (84)
- Apt 110, 165
- Avignon 47
- Caromb 102
- Saint-Hippolyte le Graveyron 102
- Suzette 102
Vienne (86)
- Ingrandes-sur-Vienne 105
- Marigny Brizay 105
- Poitiers 107
- Pressac 58
Vienne (Haute-) (87)
- Châtenet-en-Dognon (Le) 58
- Folles 142
- Limoges 172
- Morterolles 68
Vosges (88) 120
- Avranville 119
- Contrexéville 57
- Dainville-aux-Forges 119
- Épinal 64
- Poussay 77, 156
- Remicourt 173
- Remiremont 37, 103, 161, 162
- Savigny 103
Yonne (89) 150
- Ancy-le-Franc 139
- Auxerre 175
- Belliole (La) 150
- Blacy 125
- Bléneau 34, 38
- Cézy 34, 37, 38
- Dracy 72
- Looze 173
- Monéteau 110
- Saint-Valérien 150
- Sens 42
- Tharoiseau 87, 173
- Tonnerre 95
Territoire de Belfort (90)
- Belfort 143
Essonne (91)
- Draveil 147, 148
Hauts de Seine (92)
- Boulogne-Billancourt 141
- Levallois-Perret 94
- Neuilly-sur-Seine 166, 175
- Saint-Cloud 174
Val de Marne (94)
- Villejuif 28
Val d'Oise (95)
- Gonesse 134
- Lilas (Les) 165
- Sarcelles 45
Grande-Bretagne 19. V. aussi Angleterre.
- Brookland-Weybridge 120
- Londres 43, 65, 93, 113, 139
- Nottingham (Nottinghhamshire) 104
- Southsea, Hants 175
Grèce
- Athènes 173
Guadeloupe (971) 45
Hesse-Darmstadt (grand-duché) 89
Hongrie 83
- Duna-Pentele 181
Indonésie
- Java (île) 173
Irlande
- Karrickfergus 100
Israël
- Jérusalem 31
Italie 9, 19, 129. V. aussi Piémont.
- Alexandrie (Alessandria, Piémont) 69, 72
- Crémone (Cremona, Lombardie) 129
- Florence (Firenze, Toscane) 83, 94, 127
- Modène (Modena, Émilie-Romagne) 72
- Montenero (Livourne) 61
- Naples (Napoli, Campanie) 43, 58, 105, 140. V. aussi Naples (royaume).
- Pignerol (Pinerolo, Piémont) 102
- Porto Reale 40
- Palerme (Palermo, Sicile) 58
- Rome (Roma) 45, 68
- Tortona (Piémont) 160
- Turin (Torino, Piémont) 93, 160
- Venise (Venezia, Vénétie) 93, 182
Japon 19, 173
Luxembourg 184
- Oberkorn 162
Madagascar
- Tananarive 173
Malte (île) 90
Martinique (972) 42, 45
- Fort Saint-Pierre 42, 45, 132
Naples (Royaume de) 93, 140
Navarre 91
Nouvelle-Zélande
- Wellington 94
Palatinat 104
Pays-Bas 137, 157, 160
- Amsterdam 126
- Gueldre (province) 160
- Zevenbergen 158
Piémont 143
Portugal 19, 45, 140, 143
- Lisbonne 139
Prusse (Royaume de) 17, 23, 139, 140
Réunion (île de La) (974)
- Saint-Denis 166
Russie (Empire de)
- Kaliningrad (anciennement Königsberg) 82
- Königsberg : v. Kaliningrad
- Moscou 173
Saint-Domingue 42, 43, 105
- Cap Français 43
- La Croix-des-Bouquets 94
Sainte-Lucie 45
Sardaigne (Italie) 31, 68, 133
Savoie 183
Saxe 9
Souabe 171
Suisse (Confédération Helvétique) 43, 49, 112, 126, 138, 165
- Bâle (demi-canton de Bâle-Ville) 29, 43, 63
- Berne (canton de Berne) 165, 183
- Cerlier (Erlach, canton de Berne) 110
- Cerniat (canton de Fribourg), chartreuse de La Valsainte 181
- Erlach : v. Cerlier
- Fred'Aignuerière (indét.) 94
- Fribourg (canton) 181
- Fribourg (canton de Fribourg) 22, 105, 131
- Genève (canton de Genève) 64, 72, 118
- Landeron (Le) (canton de Neuchâtel) 110
- Lausanne (canton de Vaud) 124, 134, 166
- Loèche (canton de Fribourg) 170
- Lugano (canton du Tessin) 110
- Montreux (canton de Vaud) 74
- Neuchâtel (canton de Neuchâtel) 16, 113
- Porrentruy (Pruntrut, canton du Jura) 63
- Obersgösgen (canton de Soleure) 165
- Semsales (canton de Fribourg) 170
- Soleure (canton de Soleure) 58
- Valsainte (La), chartreuse : v. Cerniat.
Tchèque (République)
- Prague 32
Terre Sainte 173, 181
Thaïlande
- Bangkok 173
Transylvanie 33
Trêves (électorat) 138, 170
- Trêves 139
Trinidad (Antilles anglaises) 127, 128, 129
Tunisie
- Carthage 173
- Tunis 166
Turquie
- Constantinople (Istambul) 47, 139
Vent (îles du) 163
Vietnam
- Hué 173
Würtemberg 121
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les cinq gouverneurs français de la Franche-Comté (1674-1789)
I. - 16 juin 1674-12 octobre 1704 : Jacques Henri de DURFORT, 1er duc-pair de DURAS en 1689, o Duras le 09.10.1625, Paris le 12.10.1704, fils de Guy Aldonce de Durfort, marquis de Duras, comte de Rozan et de Lorges (1605-1665), maréchal des camps et armées du roi, et d'Elisabeth de La Tour d'Auvergne (sur d'Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne (1611-1675), plus connu sous le nom simplifié de Turenne, maréchal de France), fille du duc Henri de Bouillon et d'Elisabeth de Nassau. Le 15.04.1668, il épousa Marguerite Félicie de Lévis-Ventadour qui lui donna : 1) Jacques Henri de Durfort, 2e duc de Duras, qui épousa en 1689 Louise-Madeleine de La Marck dont un fils mort en 1792 ; 2) Jean Baptiste de Durfort, 3e duc de Duras, cité plus loin.
II. - 14 octobre 1704-30 mars 1728 : Camille, marquis de LA BEAUME, comte de TALLARD, duc d'HOSTUN, baron d'Arlan, o Lyon (69) le 14.02.1652, sur les bords du Rhin le 30.03.1728, fils de Roger d'Hostun et de Catherine de Bonne (mariés en 1648). Guidon des gendarmes, mestre de camp du régiment Royal-Cravate, brigadier en 1677, maréchal de camp en 1678, lieutenant général en 1693, ambassadeur extraordinaire auprès de Guillaume d'Orange, le nouveau roi d'Angleterre, maréchal de France le 14.01.1703, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de la Franche-Comté du 14.10.1704 (1) au 30.03.1728, il fut créé duc d'Hostun le 01.03.1712, duc-pair en 1715, et Louis XIV lui témoigna sa confiance en le désignant comme membre du conseil de régence dans son testament (document qui ne fut jamais exécuté). Il devint néanmoins membre du conseil de régence en 1717. Il fut élu membre de l'Académie royale des Sciences (membre honoraire le 02.09.1723), et président de cette compagnie en 1724, choisi comme ministre d'État sous Louis XV e 1726. "C'était, dit Saint-Simon, un homme de taille médiocre, avec des yeux un peu jaloux, pleins de feu et d'esprit, mais sans cesse battus du diable par son ambition, ses vues, ses menées et ses détours ; un homme enfin à la compagnie duquel tout le monde se plaisait, et à qui personne ne se fiait". Il épousa, le 28.12.1677, Marie Catherine de Grolée, comtesse de Viriville, fille de François de Grolée, marquis de Viriville, et de Jeanne de Monteynard, qui lui donna notamment : Marie Joseph de La Beaume d'Hostun et Catherine Ferdinande de La Beaume d'Hostun Son fils aîné, brigadier des armées mourut des blessures reçues aux côtés de son père à la bataille malheureuse d'Hochstett. Son fils cadet, Marie Joseph, duc d'Hostun (17.09.1684-06.09.1755), chevalier des ordres du Roi, lui succéda dans ses biens et titres (y compris comme gouverneur de la Franche-Comté) et épousa en 1713 Isabelle de Rohan qui lui donna un fils, Louis Charles, duc d'Hostun, mort sans laisser de postérité.
(1) Mais il ne put occuper aussitôt son nouveau poste car, battu à la bataille de Höchstaedt en 1704, il fut emmené en captivité en Angleterre où il demeura assigné à résidence pendant sept ans.
III. - 30 mars 1728-6 septembre 1755 (et déjà en survivance du 29.05.1720 au 30.03.1728) : Marie Joseph de LA BEAUME d'HOSTUN, 2e duc d'Hostun, 1er pair de France (mars 1715, lettres patentes enregistrées le 02.04.1715), seigneur de Silan, Saint-Etienne, Yseaux, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier Verigneux, Chambeon et Marelop, brigadier le 01.02.1719, o 17.09.1684, Paris le 06.09.1755, fils de Camille de La Beaume d'Hostun, cité ci-dessus. Le 14.03.1713, il épousa Marie Isabelle Angélique Gabrielle, o 17.01.1699, 1754, fille d'Hercule Mériadec, duc de Rohan-Rohan, o 08.05.1669, 26.10.1704, et d'Anne Geneviève, 1727, fille de Louis, duc de Ventadour, qui lui donna un fils : Louis Charles de La Beaume d'Hostun, o 15.02.1716.
IV. - 11 septembre 1755-8 juillet 1770 : Jean Baptiste de DURFORT, 3e duc de DURAS, o 28.01.1684, Paris le 08.07.1770, fils de Jacques Henri de Durfort, 1er duc de Duras, et de Marguerite Félicité de Lévis-Ventadour. Il se distingua en Allemagne, en Flandre et en Espagne et fut promu maréchal de France en 1774. Il épousa 1) le 06.01.1796, Marie Angélique Victoire de Bournonville (23.01.1686-29.09.1764), fille d'Alexandre de Bournonville et de Charlotte Victoire d'Albert, qui lui donna : a) Victoire Félicité de Durfort de Duras, o 1706, 17.10.1753, qui épousa, en premières noces, le 10.10.1720, Jacques de Fitzjames, o Saint-Germain-en-Laye le 15.11.1702, Paris le 13.10.1721, et, en secondes noces, le 23.04.1727, Louis Marie d'Aumont, duc d'Aumont, o Lyons-la-Forêt le 28.08.1709, ibid. le 13.04.1782 ; b) Emmanuel Félicité de Durfort, 4e duc de Duras qui suit ; 2) Louise Françoise Maclovie Céleste de Coëtquen, fille de Malo-Auguste de Coëtquen, marquis de Coëtquen, et de Marie Céleste Locquet de Granville, qui lui donna : a) Emmanuel Céleste de Durfort de Duras ; b) Charles Armand Fidèle de Durfort, comte de Duras, o Paris le 18.12.1743, Londres en 1804, maréchal de camp, qui épousa, le 02.05.1767, Marie Joséphine Rigaud de Vaudreuil, fille de Joseph Hyacinthe Rigaud, comte de Vaudreuil, et de Marie Claire Françoise Guyot de La Morande.
V. - 8 juillet 1770-05.09.1789 (et déjà en survivance depuis le 21 juin 1767) : Emmanuel Félicité de DURFORT, 4e duc de DURAS, 2e pair, o 19.12.1715, Versailles (78) le 05.09.1789, petit-fils du 1er gouverneur et fils du précédent. Membre de l'Académie Française. Il épousa, le 01.06.1733, Charlotte-Antoinette de la Porte Mazarin, fille de Paul de la Porte Mazarin, et de Louise-Françoise de Rohan, o 24.03.1719, Paris le 06 09.1735 à Paris.qui lui donna une fillr : une fille, Louise-Jeanne, o Paris le 01.09.1735, ibid. le 17.03.1781, qui ép., le 02.12.1747, son cousin germain Louis-Marie d'Aumont, o 05.08.1732, Guiscard le 20.10.1799
Sources : Jean Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs de province sous l'Ancien Régime, 1315-1791, Paris, éd. Christian, 2002 ; Jougla de Morenas, Le Grand Armorial de France t. IV, p. 307 ; L.-G. Michaud, Biographie Universelle ;Marie Nicolas Bouillet et Alexis Chastang (dir.), Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, 1878 (article "Jacques Henri de Durfort") ; notes généalogiques de l'auteur).
Ce texte a été publié dans "Généalogie Franc-Comtoise", bulletin du Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté", n° 109, 1er trimestre 2007, p. 63.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Sources : Jean Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs de province sous l'Ancien Régime, 1315-1791, Paris, éd. Christian, 2002 ; Jougla de Morenas, Le Grand Armorial de France t. IV, p. 307 ; L.-G. Michaud, Biographie Universelle ;Marie Nicolas Bouillet et Alexis Chastang (dir.), Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, 1878 (article " Jacques Henri de Durfort ") ; notes généalogiques de l'auteur).
Notes :
(1) Mais il ne put occuper aussitôt son nouveau poste car, battu à la bataille de Höchstaedt en 1704, il fut emmené en captivité en Angleterre où il demeura assigné à résidence pendant sept ans.
Histoire et Généalogie de la famille Frère de Villefrancon (16e-19e siècles) de Rochejean, Pontarlier, Besançon, Dole, Villefrancon
Docteur Jean-Marie Thiébaud
Notes :
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
SOURCES
Archives Départementales du Doubs, n° B - Chambre des Comptes-
666, fol. 159 ; 867 ; 1026 ; 1079, fol. 292 ; 1143.
Archives Départementales du Doubs, n° B - Présidial de Besançon -
10398, fol. 52 (testament de Claude Ambroise FRÈRE DE VILLEFRANCON, conseiller au Parlement) ; 10402, fol. 188 vicaire général) ; 10403, fol. 72 v° et 193 v° (testaments de Jean Baptiste Xavier FRÈRE DE VILLEFRANCON, chanoine, et de Marie Xavier FRÈRE DE VILLEFRANCON)
Archives Départementales du Doubs, n° E - Familles - 2902, 3018, 3019, 3020, 3435, 3676, 3892, 3956
Archives Départementales du Doubs, n° G 1280, 2038, 2058, 2059
Archives communales de Besançon, n ° GG 12, fol. 96 v°, 138 v°, 139 ; GG 30, fol. 36 ; GG 150, fol. 145, GG 189, fol. 24 ; GG 193, fol. 6 ; GG 195, fol. 6 ; GG 196, fol.6 v° ; GG 197, fol. 14, 15 ; GG 198, fol. 17 v° ; GG 200, fol. 3 v°,4 v°,9 ; GG 201, fol. 54 v° ; GG 319, fol. 19 v° ; GG 368, fol. 32
Archives communales de Besançon, Registres des décès, années 1819, 1828, 1846, 1869
Bibliothèque Municipale de Besançon,
Collection de l'Académie, Cartons 1 et 6
Collection Baverel, ms 45, fol. 80 et suivants
Fichier de Lurion
Archives communales de Pontarlier,
Registres paroissiaux n° GG 8 ; GG 28 ; GG 64 ; GG 71 ; etc.
Registres des délibérations municipales, BB 3. BB 7. BB 12
Fonds Michaud (Cartons Famille FRÈRE et communauté et seigneurie de ROCHEJEAN)
Registres paroissiaux de Rochejean (Doubs), Dole (Jura), Nozeroy (Jura)
BIBLIOGRAPHIE
ACADÉMIE DE BESANCON, Mémoires et Documents Inédits, Obit. Saint-Jean
ANNALES FRANC-COMTOISES, novembre 1868, p. 377
DICTIONNAIRE DES COMMUNES DE HAUTE-SAÔNE, VI,p.122, 123
GAUTHIER (Jules), Armorial de Franche-Comté, 1911
Inventaire des sceaux des archevêques de Besançon, in P. V. et Mémoires de l'Académie de Besançon, 1878, p. 158
GENEVOY (Robert), Armes Terrier de Santans et Frère de Villefrancon (sur deux tombes du cimetière des Chaprais à Besançon, 1846 et 1893), in Archivum Heraldicum 1979, a-93, n° 3-4, p. 53.
GRESSET (Maurice), Gens de Justice à Besançon (1674-1789), Paris, 1978, 2 vol.
HOZIER (Charles D'), Armorial Général, 1696
LOYE, Histoire de Rochejean
LOYE (abbé Léopold), Histoire de l'Église de Besançon, 1901-1903
LURION (Roger DE), Nobiliaire de Franche-Comté, Besançon, 1890
Notice sur la Chambres des Comptes de Dole, suivie d'un Armorial de ses Officiers, Besançon, Impr. Jacquin, 1892, p. 224, 240
MATHEZ Jules, Histoire de Pontarlier, 1930, p.318,428,429,440,455
MESNAY (Général T. de), Dictionnaire des anciennes familles de Franche-Comté, p. 1053-1057
SAGET Jules, Familles de hommes marquants de Pontarlier et du Haut-Doubs, Libr. Faivre-Vernay, Pontarlier, 1933, p. 78-79.
SUCHAUX Louis, Galerie héraldo-nobiliaire de Franche-Comté, 1878, I, p. 248.
THIEBAUD (Jean-Marie), Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté, 1981-1984, 2 vol.
TOURNIER (R.), Maisons et hôtels privés du XVIII° siècle à Besançon, p. 36, n. 49 + illustr.
TRUCHIS (A. DE), Généalogie, p. 247
65
INDEX DES NOMS DE PERSONNES
A
ARBEL Jeanne 26
ARTOIS (D') comte 54
AUTHIER Antonia 22
AUTHIER Françoise 17, 19, 20, 23, 55, 59, 60
AUTHIER Jacques 19, 20, 22
AUTHIER Marguerite 22,
B
BAULARD : voir aussi BOLARD
BAULARD Elisabeth 48
BAULARD Jean François 48
BEUVERAND DE LA LOYERE Jacques 50
BEUVERAND DE LA LOYERE Jeanne Baptiste Odette 50, 54
BLONDEAU Antoine 29
BLONDEAU Catherine 29
BLONDEAU Denise 17
BOISOT Claude 42
BOISOT Jean Antoine 42
BOISOT Jean Claude 43
BOISOT Jean Jacques Antoine 43
BOLARD : voir aussi BAULARD
BOLARD François Xavier 26
BOLARD D' ANGIREY Claude Françoise 32
BOREY Antoine Emmanuel Joseph Hyacinthe 42
BOUDRET François Ignace 5
BOUDRET François Joseph Philibert 42
BOUDRET Ignace 42
BOUDRET Jean Baptiste 42, 43
BOUDRET Jeanne Antoine Thérèse 41, 44, 47, 48, 50, 53, 61
BOUDRET Philibert Joseph 41, 45, 61
BOVAL F François Xavier 43
BOYVIN Claude 8
66
BOYVIN Claudine 9
BOYVIN Pierre 9
BRAILLARD André 30
BRESSAND Claude 16
BRESSAND Denis 16, 17
BRESSAND Perrenette 16, 17, 22
BROCCARD Jean Baptiste 17
BROCCARD Pernette 13
BROCCARD Pierre 8, 15, 19
BROCCARD Pierrette 19, 20, 22
BUISSERET (DE) comte 54
C
CAFFOD Aimée 8
CAFFOD Béatrix 33
CAMUS (DE) Antoine Ignace 42, 43
CAMUS (DE) Jean Maurice 42
CAMUS DE FILAIN (DE) François 42
CAMUS DE FILAIN (DE Gabrielle Antoine 41, 61
CARTIER Marie Anne 25
CHABOZ Marguerite 7
CHAILLET Anne Claude 32
CHAILLET Jacques 33
CHAMPION DE NANSOUTY Françoise Catherine Marie 50
CHAPUIS Pierre Augustin 42
CHARRETON Jeanne 9, 13, 14, 15, 16
CLERC Marguerite 16
CLERMONT Claude 24
CLERMONT Claude Joachim Ignace 24
CLERMONT Ignace 30
COLIN Claude 30
COMPAGNY Antoine 20
COQUILLARD François Xavier 36
CORTOIS DE PRESSIGNY (Mgr) 52
CORVOISIER Nicolas 10
COURLET Alexandre 29
D
DACLIN Antoine Claude 36
DAGUET Antoine François 41
DAGUET Jeanne Charlotte 35, 41, 45, 61
DAGUET Mathieu Charles 35
DEMONGENET Claude François Joseph 42
DEMONGENENT François Joseph 43
67
DENISET Jean 29
DESPOTOT Ferdinand Gaspard 43
DESTUTT D' ASSAY Louise Alphonsine 5, 54
DONANS (alias ONANS (D') ou DE DORNON) Marie Françoise 23
DORNON (DE) : voir DONANS
DOROZ Philippe Antoine 43
DROZ Charles 27
DROZ Nicolas 27, 33
DUMONT Jeanne Claude 31
DUMONT Pierre 31
DURAND Antoine Joseph 41, 42, 45
DURAND Gabriel Ignace 45
DURAND Jean Baptiste 27
DURAND Louis 42
DURAND Perrone 35
DURAND Simon 35
DURFORT (DE) (Mgr) 52
F
FAVIERE DE CHARMES Jeanne Claude 54
FAVROT Isabelle 18
FERREUX Antoine 7
FERREUX Claude 7
FERREUX Pierre 55
FRERE Aimé (alias Edmond) 15, 17, 19, 20, 23, 26, 55, 59, 60
FRERE Aimé François (alias Edme Françoise) 3, 15, 21, 29, 31, 39, 58, 59
FRERE Anne 9, 14
FRERE Anne Marie 20
FRERE Anne Thérèse Joseph 49
FRERE Antoine 2, 12, 15, 21, 29, 58, 59
FRERE Antoine Joseph 30
FRERE Antonia 6
FRERE Barthélémy 6
FRERE Benoît 13
FRERE Catherine 8
FRERE Charles François 4, 31
FRERE Charles Joseph 40
FRERE Clauda 9
FRERE Claude 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 33
FRERE Claude le Jeune 2, 8, 13, 14, 16, 18, 22, 55
FRERE Claude le Vieux 16, 55
FRERE Claude Antoine 23, 30
FRERE Claude Augustin 24
FRERE Claude François 31
FRERE Claude Françoise 26
68
FRERE Claude Guillaume 13
FRERE Claude Ignace 24, 33
FRERE Claude Joseph 39
FRERE Claude Nicolas 3
FRERE Claudine 17, 26
FRERE Denis 2, 16, 20, 22
FRERE Denise 9
FRERE Edme : voir FRERE Aimé
FRERE Edme François: voir FRERE Aimé François
FRERE Ferdinand Joseph 22
FRERE Françoise 6, 17
FRERE François Joseph 22
FRERE Guillaume 7
FRERE Hugues François 23
FRERE Hugues Ignace 22
FRERE Ignace François Xavier 3, 49, 59
FRERE Isabelle 18, 22
FRERE Jacques 2, 3, 4, 19, 22, 23, 60
FRERE Jacques Joseph 23
FRERE Jean le Jeune 8, 11
FRERE Jean le Vieux 8, 11,12, 14
FRERE Jean Antoine 19, 27
FRERE Jean Baptiste 8, 19
FRERE Jean Claude 55
FRERE Jean François 2, 3, 27, 31, 32, 34, 56, 60, 31
FRERE Jean Joseph 31
FRERE Jeanne 7, 9, 11, 12, 15
FRERE Jeanne Alexis 40
FRERE Jeanne Baptiste 30
FRERE Jeanne Catherine 27, 40
FRERE Jeanne Dauphine 40
FRERE Jeanne Françoise 33
FRERE Jeanne Marguerite 40
FRERE Jeanne Marie 20
FRERE Jeanne Pernette 30
FRERE Jeanne Thérèse Josèphe 39
FRERE Louise 28
FRERE Marguerite 12, 14, 16
FRERE Marguerite Ignace 31
FRERE Marie 27
FRERE Marie Agnès 24
FRERE Marie Angélique 34
FRERE Marie Anne Françoise 39
FRERE Marie Claude 24
FRERE Marie Elisabeth 24
FRERE Marie Ignace Joseph 33
FRERE Marie Joseph Ursule 26
FRERE Marie Marguerite 24
FRERE Marie Thérèse 27, 39, 49, 58, 59
FRERE Marie Thérèse la Jeune 28
FRERE Marie Ursule 25
FRERE Marie Victoire Charlotte 56
69
FRERE Mathieu 19
FRERE Nicole 10
FRERE Pernette (ou Perrenette) 9, 13
FRERE Philippa Gabrielle Jeanne Marguerite 40
FRERE Philippe Gabriel 3, 27, 30, 39, 49, 58, 59
FRERE Pierre 2, 7, 10, 19, 24, 26, 32, 35, 39, 59, 60
FRERE Pierre Augustin 32
FRERE Pierre Bonaventure 24
FRERE Pierre François 17
FRERE Pierre Joseph Emmanuel 35
FRERE Pierre Joseph Xavier 40
FRERE Pierrette 17, 22, 55
FRERE Simon 55
FRERE Ursule 33
FRERE Véronique 31
FRERE Vincente 14
FRERE dit DADY Claude le Jeune 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21
FRERE dit FRATER Claude le Vieux 2, 9, 12, 14, 19
FRERE DE VEZENAY Pierre Augustin 38
FRERE DE VILLEFRANCON Augustine 38
FRERE DE VILLEFRANCON Charles Augustin 4, 36, 37, 60
FRERE DE VILLEFRANCON Charles François Joseph 46, 60
FRERE DE VILLEFRANCON Charlotte Françoise 38
FRERE DE VILLEFRANCON Charlotte Joseph Monique 5, 45, 46, 47
FRERE DE VILLEFRANCON Charlotte Thérèse 46
FRERE DE VILLEFRANCON Charlotte Thérèse Monique 47
FRERE DE VILLEFRANCON Claude François Ambroise 4, 36, 37, 41, 44, 47, 50, 53, 60, 61
FRERE DE VILLEFRANCON François Ambroise Xavier 37, 50,54
FRERE DE VILLEFRANCON François de Sales Joseph 46
FRERE DE VILLEFRANCON François Joseph 50
FRERE DE VILLEFRANCON François Xavier 50
FRERE DE VILLEFRANCON Jean Antoine Xavier 5
FRERE DE VILLEFRANCON Jean Baptiste 38
FRERE DE VILLEFRANCON Jean Baptiste Xavier 36, 37, 41, 45, 60
FRERE DE VILLEFRANCON Joseph 46
FRERE DE VILLEFRANCON Joseph Augustin 35, 38, 41, 45, 46, 61
FRERE DE VILLEFRANCON Joseph Gabriel Augustin 45, 46, 47
FRERE DE VILLEFRANCON Marie Caroline 54
FRERE DE VILLEFRANCON Marie Xavier 45, 46
FRERE DE VILLEFRANCON Marie Xavier Thérèse 45, 47
FRERE DE VILLEFRANCON Paul Ambroise (alias Joseph Paul Ambroise)5, 37, 47, 52, 53, 60, 61
FRERE DE VILLEFRANCON Philiberte Charlotte Monique 45
FRERE DE VILLEFRANCON Pierre Emmanuel Joseph 41, 43, 45
FRERE DE VILLEFRANCON Rose 38, 47
FRERE DE VILLEFRANCON Thérèse Vernière 47
FRERE DE VILLEFRANCON Xavier 47
70
G
GILLET Marguerite 8
GIRARD Barbe Scolastique 49, 58
GIRARD François Joseph 49
GROSJEAN (dame) 49
GROSSIRE Claude 8, 10, 12
GROSSIRE Marguerite 8, 10
GUIGNARD Aimé (ou Edme)
GUIGNARD Charlotte 8
GUIGNARD (ou GUYGNARD) Pierre 15, 17
GUILLEMENT Jean 41
H
HOUASSE R.A. 5
HUGONET Antoine 30
J
JOBELOT Claude Antoine 43
JOUFFROY Claudine Gabrielle 31
JOURNOT Anne Marie 29
JOURNOT Jean 29
JOURNOT Pierre 29
JOURNOT Pierre Philippe 29
L
LABOUROT Anna 45
LA PORTE (DE) Marie Anne 45
LAUBEPIN (DE) marquise 38
LE MICHAUD 42
LE ROY DE LISA Charles Auguste 54
LOMBARDE Jeanne 55
LONCHAMPT Claude 8, 11
LONCHAMPT Denise 8, 12
LONCHAMP Antoine 9
LONGCHAMPT Antoine 10, 12
LONGCHAMPT Pernette 10, 11
LONGCHAMPT Pierrette 55
LONGCHAMPT dit BILLET Guillaume 10
71
LONGCHAMPT dit BILLET Simone 10
LOYS dit MARTIN Pierre 17
M
MAILLARD Jean 29
MAILLARD Mathieu 30
MARCHAND'ou MARCHANT) Claude 7, 13, 14, 17
MARESCAL Luc Joseph 42
MARMET Antoine François 24
MARQUIS DE FILAIN Jean Antoine 41, 42
MARTIN 28
MARTIN Catherine 8
MARTIN Guillaume 7, 8, 14
MATHIEU Françoise 6
MATHIEU Michel 6
MICHAUD Anna Claude 26, 32, 35, 39, 59
MICHAUD Claude François 26
MIGET Denis 29
MONGENET (DE) : voir DEMONGENET
MOUREAUD Léonard 17
MOURET DE CHATILLON Denis Ignace 42
MUSY Claude 9
MUSY Jeanne 12, 14
N
NASSAU (DE) Philippe Guillaume, prince D' ORANGE 18
NICOD Claude 10
O
ONANS (D') : voir DONANS
ORANGE (D') : voir NASSAU (DE)
P
PARGUEZ Danielle 27
PARREAU Anne 15
PARREAU Claude 10, 11, 22
72
PARREAU François 15
PARREAU Jean 9
PARREAU Pierre 9, 15
PARREAU Rose 11
PARREAUD Jean 17
PARREAUD Poncet 20
PERRIN DE SAUX François 49
PERRINOT Claude Joseph 42
PERRINOT François Etienne 42
PETING DE PAGNOZ Claude François 40
PETIT François 29
PETITBENOIT Pierre Bonaventure 25
PETITE Claude 12, 12, 15
PETITE Jeanne 10
PETITE Pierre 10
PETITHUGUENIN Barthélémy 10, 14
PETITHUGUENIN Claude 9
POCHET Françoise 37
PONE : voir POSNE
POSNE Anne Perrenette 21, 29, 58, 59
Q
QUARTIER Jacques 18
QUARTIER Jeanne Philiberte 18
R
RAGUIN 55
RAGUIN Claude 8, 12, 14
RAGUIN Claude le Jeune 8, 12, 14
RAGUIN Gilbert 9
RAGUIN Pierre 8
RAGUIN Pierre le Jeune 7
RAGUIN Pierre le Vieux 12
RANDAN (DE) duc 26
RANFER DE BRETENIERE (DE) Simon Paul 54
RATTIER Philippe 29
RICHARD Jean Félix 53
ROUSSEAU Claude 7
ROUSSEAU Jeanne 7
ROUSSELET Xavier 27
73
S
SAINT-MAURIS (DE) Ferdinand Mathieu 38
SALOMON (DE) Gratien 48
SIMON Claudine 17
SIMON Désiré Joseph Xavier 43
SIMON François Gayetan Fortuné 43
SIMON Parrenette 11
SIMON Pierre 17
SUTELET : voir SUTELOT
SUTELOT (ou SUTELET) Anne 13, 15
SYMONIN Charles 29
T
TERRIER Marie Jules 43
TERRIER Nicolas Joseph 43
TERRIER DE SANTANS Marie Antoine Charles 54
TERRIER DE SANTANS Marie Joseph Léonce 54
TOITOT Véronique 31
TRANCHANT Léopold Joseph 43
V
VAILLARD Jean 12
VALETON Jean 7
VANNOD 32
VANNOD Antoine 17
VANNOD Ferdinand Joseph 33
VANNOD Jeanne 7
VANNOD Marc 16
VANNOD Marie Anne 32
VANNOD Perrenon 7, 8
VANNOD Vincent 14
VANNOD (DE) Frédéric 32
VANNOD (DE) Marie Françoise 32
VANNOD dit D' ARGILLEY Jean 7
VAUCHIER (DE) Louis 54
VERMOD (ou VERMOT) Catherine 7, 14
74
VERMOT Anne 9
VERMOT Claude 26
VERMOT Claudine 9, 12
VERMOT Hugues 18
VERMOT Jacques 8, 9
VERMOT Jeanne 8, 12
Histoire et généalogie de la famille de Cuve (14e16e siècles) Une famille féodale de l'évêché de Bâle dans les duché et comté de Bourgogne
Jean de Cuve (14e - 15e siècles), écuyer, qui épousa Clémence de Grandfontaine qui lui donna un fils :
- Étienne de Cuve, écuyer, mort en 1456, qui fit une reprise de fief pour sa terre de Valoreille (25) des mains de messire Guillaume de Vienne, seigneur de Châtillon-sous-Maîche, le 15 mai 1429, et une seconde reprise de fief du même suzerain le 10 avril 1437. Il épousa Angeline de Vauclusotte, fille de Girard de Vauclusotte et de Simonette de Valoreille, fille de Henri de Valoreille, chevalier. De cette union naquit un fils :
- Jean Guillaume de Cuve qui obtint de Guillaume de Ray, chevalier, et de Charles de Neuchâtel, écuyer, tous deux coseigneurs de Châtillon-sous-Maîche, la concession d'un four à Valoreille (25) le 5 juin 1464. Il eut trois fils :
- Guillaume de Cuve, qui suit ;
- Pierre de Cuve ;
- Jean de Cuve, tous trois exemptés des droits de terrage le 20 décembre 1500, étant alors tous trois au service du chancelier de Bourgogne.
Guillaume de Cuve fut institué châtelain de la châtellenie de Véronnes (21) le 15 mai 1511 par Jean de Rochefort, chevalier, conseiller et chambellan du Roi et gouverneur de la chancellerie du duché de Bourgogne. Guillaume de Cuve épousa Jeannette N. avec laquelle il acheta, pour la somme de 90 francs, une maison à Valoreille (25) le 30 août 1515. En secondes noces, Guillaume de Cuve épousa Barbe de La Palud qui lui donna plusieurs fils dont :
- Jean (II) de Cuve, écuyer, seigneur de La Ferté et de Valoreille (25) en partie. Le 11 février 1553, il fit une reprise de fief pour un fief à Vauclusotte (25), cédé par Claude d'Orchamps, écuyer. Jean (II) de Cuve épousa Anne Le Moyne, fille de Jehan Le Moyne, docteur ès droits, conseiller et avocat fiscal au Parlement de Dole (39), qui lui donna une fille, Antoinette Jacque (alias Jacque Antoine) de Cuve qui épousa François Colin, écuyer, capitaine-châtelain de Pontarlier (25) et seigneur de Valoreille depuis son mariage, fils de Henry Colin, conseiller du Roi catholique, duc et comte de Bourgogne, et vice-président du Parlement de Franche-Comté, et de Nicole de Vers. Antoinette Jacque de Cuve donna une procuration à son mariage pour son devoir de reprise fief pour les biens qu'elle possède à Valoreille (25), Solemont (25) et Vauclusotte (25) le 7 mars 1584.
- Guillaume (II) de Cuve, clerc, qui avant de faire profession au monastère de Luxeuil (70), fit don de tous ses biens à son frère Jean par acte du 31 octobre 1549.
- François de Cuve, écuyer, seigneur de Valoreille en partie, qui céda tous ses biens à Jean (II) de Cuve, son frère aîné, par acte du 17 novembre 1556.
Signature :
Docteur Jean-Marie Thiébaud
Sources et bibliographie : Registres paroissiaux de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) ; Titres de famille et de noblesse des Colin de Valoreille, édités par Jean-Marie Thiébaud, Pontarlier, 1982 ; Jean-Marie Thiébaud, Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté, Marque-Maillard, Lons-le-Saunier, 1981-1983, 2 vol. ; " Les familles de Cuve (XIIe - XVIe siècles) - Essai généalogique ", in Actes de la Société Jurassienne d'Émulation, Porrentruy (Suisse), 1981.
Bourgeois de Clerval (Doubs) du 14e au 16e siècle
Les noms des bourgeois cités sont extraits des "Testaments de l'Officialité de Besançon" d'Ulysse Robert (Imprimerie Nationale, 1900-1903).
- Huguenin AYMONAT, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Perrin BAT-LES-HAS dont la femme, Isabelle de BOISSEY, testa en 1391 (Ulysse Robert, "Testaments de l'Officialité de Besançon", tome I, p. 75).
- Bernardin de BELMONT dont le fils, Bourquin de POMPIERRE, testa en 1318 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 21).
- Agnès BELOT, femme de Clément BOIHY, bourgeois de Clerval, testa en 1517 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 139).
- Huguenin BELOT testa en 1514 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 138).
- Jacques BELOT, prêtre, testa en 1510 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 137).
- Clément BRIAT, notaire, testa en 1454 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 112).
- Jean BRIOT alias de SAINT-GEORGES, curé de Montjustin (commune actuelle de Montjustin et Valotte, Haute-Saône), testa en 1444 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 107).
- BOISSEY (de) : v. BAT-LES-HAS.
- Pierre BONVALOT testa en 1393 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 76).
- Jeanne BOYS, de Clerval, femme de Richard MALARMEY, de Vercel (Doubs), testa en 1511 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 177).
- Jean BRIOT alias de SAINT-GEORGES, curé de Montjustin, qui testa en 1444 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 107).
- Othe BUEDEY, prêtre, vicaire à Orchamps-Vennes (Doubs), témoin du testament de Jean de Patornay, écuyer, le 1er juin 1458 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 109).
- Henri BULLATE, témoin du testament de Pierre Rougemont, de Baume-les-Dames (Doubs), le 8 septembre 1480 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 210).
- Vuillemin BULLATTE, notaire, testa en 1458 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 113).
- Guy BULLET, notaire de la Cour de Besançon, testa en 1400 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 82).
- Étienne CLÉMENT, curé d'Anteuil (Doubs), testa en 1543 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 148).
- Jehan CONVERT, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Odet COURVERET, curé de Branne, testa en 1400 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 82).
- Guillemette, veuve de Guy dit COUTHEREL, testa en 1399 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 80).
- Jehan CUCHET, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Jeanne CUDECARTE, femme de Jacques NAVARRET, de Besançon (Doubs), bourgeois de Clerval, testa en 1433 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 101).
- Béatrix, fille de Jeannin de DAMBELIN, veuve de PETITVUILLEMIN, testa en 1389 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 74.
- Pierre DIEULEFILS testa en 1477 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 123).
- Aymonin DAVIGNE dont la femme, Perrine CLÉMENT, testa en 1433 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 101).
- Huguette ÉVRARD, femme de Jean LIVET, testa en 1361 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 58).
- Étevenette N., veuve de Guyot FOURNET, testa en 1512 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 137).
- Claude, femme de Jean FRIAND, testa en 1541 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 147).
- Jean FUENET l'Aîné, clerc, notaire de la cour de Besançon (Doubs), testa en 1494 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 129).
- Étevenotte, fille de Vuillemin GATTEFROY, testa en 1509 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 136).
- Marguerite GEORGE testa en 1374 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 66).
- Pierre GIRARDIN, de Clerval, curé de Cour, testa en 1387 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 73).
- Jean GRISARD dont la veuve, Clémencette N., testa en 1424 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 96).
- Étienne GRUBILET, curé de Belmont, testa en 1412 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 88).
- Étevenin GUILLET (alias GUILLOT) testa en 1421 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 95).
- Jacque GUILLET (alias GUILLOT), femme de noble Bonnet de RAMERUPT, de Pontailler, testa en 1510 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 137).
- Jacques GUILLOT (alias GUILLOT) testa le 28 septembre 1482, demandant à être inhumé dans la chapelle qu'il a fondée dans l'église Saint-André de Clerval (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 184 ; t. II, p. 200 et suiv.).
- Jean JACQUELIN testa en 1524 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 142).
- Jean JACQUELIN dont la veuve, Perrine QUERLET, fille de Jean QUERLET, testa en 1527 (Ulysse Robert, "Testaments de l'Officialité de Besançon", tome I, p. 243).
- Symonet LANGELOT, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Catherine de L'ÉCLUSE, femme de Girard NIVEL, testa en 1410 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 87).
- Jehan Petit LOSCHARDET, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Jean MAÎTRE, de Clerval, curé de Saint-Georges près de Clerval, testa en 1418 ((Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 92).
- Perrin dit MIGAT testa en 1419 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 93).
- Perrin MILDIN, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Regnault MILDIN, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- NAVARRET : v. CUDECARTE
- Jean NICOLIN, de Clerval, curé dudit lieu, testa en 1549 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 150).
- NIVEL : v. L'ÉCLUSE (de)
- Henri NONNET, témoin du testament de Pierre Rougemont, de Baume-les-Dames (Doubs), le 8 septembre 1480 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 210).
- Huguenin dit PETETAT, de Rupt, bourgeois de Clerval, testa le 5 octobre 1397 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 181, 538).
- PETITVUILLEMIN : v. DAMBELIN (de)
- Thiébaud PITOUL, de Clerval, notaire, demeurant à Montbéliard (Doubs). Il reçut le testament de Marguerite des Bavans, femme de Henri, bâtard de Montbéliard, seigneur de Franquemont, le 29 avril 1427 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 56).
- Bourquin de POMPIERRE, fils de Bernardin de BELMONT, testa en 1318 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 21).
- Huguenin POUTHIER, témoin du testament de Thiébaud de Sagey, écuyer, le 22 août 1487 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 208).
- Guillaume, femme de Jean PRÉVÔT, testa en 1349 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 44).
- QUERLET : v. JACQUELIN
- Jean REBOURG, notaire, testa en 1455 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 112).
- Richard REBOURG (alias REBOUR), de Clerval, bourgeois de Luxeuil, dont la femme, Jeannette RIBODON, de Granges, testa en 1394 et testa à nouveau, veuve, en 1431 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 76, 100).
- Jehan REGNAULT, témoin du testament de Pierre Rougemont, de Baume-les-Dames (Doubs), le 8 septembre 1480 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 210).
- Jean RIVEY dit PERROTTE testa en 1546 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 149).
- Jehan RYVEL, témoin du testament de Pierre Rougemont, de Baume-les-Dames (Doubs), le 8 septembre 1480 (Ulysse Robert, op. cit., t. II, p. 210).
- SAINT-GEORGES (de) : v. BRIOT
- Jean de SAINT-JUSTE dont la femme, Marguerite de VELLEROT, testa en 1435 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 102).
- Girard VIGNIER, curé de Maîche (Doubs), testa en 1423 (Ulysse Robert, op. cit., t. I, p. 96).
Parmi les autres habitants de Clerval de cette époque, citons aussi Henry de Présentevillers, écuyer (mari de Jeanne de Hardegney) et de Jean de Présentevillers, frères, qui y possédaient une maison en indivision le 16 juin 1487 (Archives Nationales, n° K 2170).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les soldats inscrits sur le monument aux morts de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs)
Guerre 1914-1918 :
- Paul Astère Édouard (dit Paul) BEAUFILS, né à Fessevillers (Doubs) le 12.11.1884, soldat au 171e régiment d'infanterie, décédé de blessures de guerre à l'hôpital Desgenettes de Lyon le 06.10.1914.
- Henri Joseph (dit Henri) CALLERAND, né à Froidevaux (Doubs) le 2e classe au 2e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Sainte-Marie à Py (Marne) le 01.10.1918.
- Lucien CALLERAND dont le nom n'a pas été retrouvé dans les fiches du S.H.A.T.
- Marcel CHOGNARD, né à Belleherbe (Doubs) le 05.09.1888, soldat au 153e régiment d'infanterie, mort des suites de blessures de guerre à La Souterraine (Creuse) le 17.11.1915.
- Théophile Victor Alphonse (dit Victor) CHOGNARD, né à Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs) le 15.05.1886, 2e classe au 35e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Berthelainville (Meuse) le 14.11.1917.
- Jules Constant Adonis (dit Jules) COLER, né à Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), 2e classe au 176e régiment d'infanterie, mort d'une maladie contractée au service, le 11.12.1917, à l'hôpital temporaire n° 12 à Salonique (Grèce).
- Gaston CURTIT dont le nom n'a pas été retrouvé dans les fiches du S.H.A.T.
- Paul Alfred (dit Paul) FAVRE, né à Froidevaux (Doubs) le 23.08.1893, soldat au 172e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Marbotte, Apremont-la-Forêt (Meuse), le 10.10.1914.
- Camille Maxime Hubert (dit Camille) GARESSUS, né à Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) le 26.07.1888, sapeur mineur au 7e bataillon du génie, tué par l'explosion d'une mine allemande au ravin de Saint-Hubert (Argonne) le 19.11.1916.
- Charles GARESSUS, né à Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), dont le nom n'a pas été retrouvé dans les fiches du S.H.A.T.
- Auguste Paul Henri (dit Henri) GUIGNARD, né à Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs) le 08.12.1883, sergent au 5e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi à Souain ou Sonain ( ?) dans la Marne le 16.09.1915.
- Jules Victor (dit Jules) GUIGNARD, né à Peseux (Doubs) le 14.04.1883, 2e classe au 132e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à la cote 119 à Bernot (Aisne) le 16.10.1918.
- Xavier Léon Gustave (dit Xavier) PAGE, né à Branne (Doubs) le 20.09.1885, sergent au 372e régiment d'infanterie, mort des suites de blessures de guerre à Largitzen (Haute-Alsace, aujourd'hui Haut-Rhin) le 21.11.1914.
- Constant Aimable (dit Constant) PAHIN, né à Châtillon-sous-Maîche, Les Terres de Chaux (Doubs) le 27.01.1881, 2e classe au 15e bataillon de chasseurs à pied, tué à l'ennemi à Hartmanswillerkopf, Alsace (commune actuelle de Hartmanswillerkopf, Haut-Rhin) le 16.10.1915.
- Jules Eugène Adolphe (dit Jules) PÉCHIN, né à Froidevaux (Doubs) le 15.09.1895, 2e classe au 21e bataillon de chasseurs à pied, tué à l'ennemi à Notre-Dame de Lorette (indét., Pas-de-Calais) le 11.05.1915.
- Paul Augustin Aimé (dit Paul) PICARD, né à Provenchère (Doubs) le 13.10.1895, caporal à la 12e compagnie du 3e régiment de tirailleurs algériens, mort des suites de blessures de guerre à Glennes (Aisne) le 11.11.1914.
- Achille RAVENT, né à Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs) le 22.12.1886, 2e classe au 13e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi lors des combats dans la région de Soupir (Aisne) le 20.04.1917.
- Vital Alphonse (dit Vital) RAVENT, né à Neuvier, Les Terres de Chaux (Doubs) le 17.08.1885, 2e classe au 64e bataillon de chasseurs, disparu au combat à Craonne (Aisne) le 03.06.1917.
- Paul Léon (dit Paul) RÉRAT, né à Froidevaux (Doubs) le 06.11.1872, 2e classe au 49e régiment d'infanterie territoriale, tué à l'ennemi à Schaeffer (Alsace) (Schaeffersheim, Bas-Rhin) le 16.05.1917.
Guerre 1939-1945 :
- Alphonse FROËHLY (1912-1940)
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Note : L'ascendance des frères Achille et Vital Ravent, parents proches de l'auteur sont cités dans Jean-Marie Thiébaud, « Histoire et généalogie de la famille Thiébaud et de ses principales familles alliées ».
Généalogie de la famille Colin de Valoreille (16e-18e siècles)
- Sydrac Colin, prieur de Pontarlier (Doubs) puis prévôt de Saint-Maurice.
- Louis Colin, prieur commendataire de Lanthenans (Doubs)
- Anne Colin, femme de Jacques d'Anvers, écuyer, de Besançon (Doubs)
- Claudine Colin, décédée avant son père, femme de Louis Boutechoux, écuyer, clerc et contrôleur de la saunerie de Salins (Jura), auquel elle donna six enfants :
- Henry Boutechoux
- Louis Boutechoux
- Jérôme Boutechoux
- Sydrac Boutechoux
- Suzanne Boutechoux
- Anne Boutechoux
- Jérôme Colin, écuyer, seigneur de Valoreille (Doubs), Solemont (Doubs) et Valonne (Doubs), cité plus loin.
- François Colin, écuyer, capitaine et châtelain de Pontarlier (Doubs), seigneur de Valoreille (Doubs), mari d'Antoinette Jacques de Cuve.
- Maximilien Colin, écuyer, inhumé dans l'église Saint-Bénigne de Pontarlier (Doubs), ces trois derniers fils étant les héritiers universels de leur père.
Maximilien Colin, écuyer, testa devant le notaire Robert Labret, de Dole (jura) le 30 octobre 1577 et son testament fut publié le 13 octobre 1578.
Jérôme Colin (1), écuyer, seigneur de Valoreille, Solemont et Valonne, lieutenant au bailliage de Pontarlier (Doubs), testa le 1er septembre 1617 et son testament fut publié au bailliage de Baume-les-Dames (Doubs) le 4 décembre de la même année. Il épousa Denise d'Asuel qui lui donna deux fils :
- Philippe-Antoine Colin qui épousa, par contrat du 2 mars 1631, dame Claude Françoise de Laubespin, dame et baronne de L'Aigle, Ponchant en partie, etc., fille de généreux seigneur messire Charles de Laubespin, chevalier, baron et seigneur de L'Aigle, Chilly, Larnod, etc., et de Claudine Peronne d'Oiselay.
- Louis Colin, seigneur de Valoreille, qui épousa 1) par contrat passé devant le notaire Greuillet, de Besançon, le 7 octobre 1645, et religieusement à Besançon (Doubs) le 22 octobre 1645 (avec dispense de Quentin Roussel, curé de Chaux-les-Châtillon, paroisse dudit Louis Colin) demoiselle Anne Antoinette de Jouffroy, fille de feu généreux seigneur Thomas de Jouffroy, seigneurs de Novillars, Amagney, La Malmaison, cogouverneur de la cité impériale de Besançon, et de dame Jeanne Despotots, en présence de Claude de Jouffroy de Novillars et de Jean Jacquelin ; 2) Madeleine de Cointet de Châteauvert, de Baume-les-Dames (Doubs).
De l'union entre Louis Colin, seigneur de Valoreille, et demoiselle Anne Antoinette de Jouffroy, naquirent au moins six enfants :
- Denise Colin de Valoreille, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 19 octobre 1646 (parrain : noble François de Jouffroy, citoyen de Besançon (Doubs) ; marraine : demoiselle Denise d'Asuel). Elle entra au couvent des Annonciades de Pontarlier (Doubs) en 1663.
- Marguerite Colin de Valoreille, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 13 janvier 1648 (parrain : sieur Melchior Faber (Faivre), chanoine de Saint-Michel de Porrentruy (Suisse) ; marraine : demoiselle Marguerite Escarnot (Escarrot), femme du sieur de Buget, capitaine-châtelain de la seigneurie de Granges). Elle entra au couvent des Annonciades de Pontarlier (Doubs) en 1663.
- Anne Marie Colin de Valoreille, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 5 février 1649 (parrain : généreux seigneur Jean Charles de Saint-Mauris ; marraine : demoiselle Anne Marie Bassand, femme de noble Philibert Louis Magnin, de Lons-le-Saunier (Jura)), religieuse ursuline à Saint-Hippolyte (Doubs) puis supérieure des religieuses ursulines de Clerval (Doubs).
- Henry Colin de Valoreille, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 28 mars 1650 (parrain : généreux seigneur Henri de Lezay, marraine : dame Marguerite de Chaffois (de Chaffoy), femme du seigneur de Chastelvert (Cointet de Châteauvert), de Baume-les-Dames (Doubs)). En 1695, il était lieutenant au régiment de cavalerie de Saint-Maurice.- Claude François Colin de Valoreille, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 20 mai 1654 (parrain : le sieur Claude François Pelletier, remplacé par son frère, le sieur Jean Baptiste Pelletier, de Saint-Julien (Doubs) ; marraine : demoiselle Marguerite Denise de Casenat, de Besançon (Doubs)). Chanoine de l'église royale et collégiale Saint-Hippolyte de Poligny (Jura), il fut institué curé de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) le 22 avril 1695. Il testa devant le notaire Borrelet, de Peseux (Doubs) le 28 juin 1741 et son testament fut publié au bailliage de Baume-les-Dames (Doubs) le 10 mars 1749. Il fut inhumé dans la chapelle du Rosaire de l'église de Chaux-les-Châtillon.- Marie Brigide (dite Brigide) Colin de Valoreille, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) (Doubs) le 15 décembre 1654 (parrain : Ferdinand Faivre, procureur de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche, Les Terres de Chaux (Doubs) ; marraine : demoiselle Marie Antoinette Magnin) (2). Elle testa le 12 novembre 1692.- Jeanne Françoise Colin de Valoreille qui épousa, par contrat du 2 juin 1695, Philippe de Sonnet, chevalier, seigneur d'Auxon, fils de feu généreux seigneur Philippe François de Sonnet et de dame Jeanne Françoise de Salives.- Jeanne Baptiste Colin de Valoreille, femme de Philippe Monnot, procureur fiscal de la seigneurie de Vaucluse (Doubs).Henri Colin de Valoreille, né en 1650, épousa, par contrat passé à Florimont (Territoire de Belfort) devant le notaire Lajeanne, le 23 octobre 1703, demoiselle Catherine de Montguyon, fille de feu messire Charles de Montguyon et de Véronique de Ferrette, qui lui donna un fils, Claude Antoine de Valoreille, et six filles, Marie-Thérèse, Anne-Louise, Marie-Elisabeth, Anne Charlotte, Jeanne Baptiste et Marie Louise Colin de Cuve (3), dame de Valoreille (Doubs), Solemont (Doubs), Orgeans (Doubs), baptisée le 21 avril 1721 (parrain ; sieur Jean Baptiste Mathieu de Sagey). Cette dernière épousa, par contrat passé à Valoreille (Doubs) devant le notaire Joly, de Dambelin (Doubs), le 22 février 1755, messire Jacques Charles Richard, écuyer, seigneur de Beligny, Curtil et autres lieux. De cette union naquirent quatre enfants, deux demoiselles dont l'une fut chanoinesse, et deux fils : 1) Marie Jacques Charles Gustave Richard de Beligny, officier au régiment d'Orléans-Infanterie ; 2) Marie Louis Ignace Richard de Beligny, bénéficier.(1) Jérôme Colin, seigneur de Valoreille, obtint, le 27 avril 1604, d'Albert et Isabelle Claire Eugénie, archiducs d'Autriche, ducs de Bourgogne, etc., des lettres de grâce au sujet d'un coup de feu qu'il avait tiré sur Jacques et François d'Auxiron, de Valoreille (Doubs), sans les blesser, suite à une rixe relative à la garde du bétail audit Valoreille.(2) Noter l'étonnante proximité dans le temps des dates de baptême de Claude François et de Marie Brigide, séparés par seulement 214 jours. Elles ne correspondent probablement pas aux dates de naissance qui demeurent inconnues. La plupart des enfants sont nés à Valoreille (Doubs) où la famille Colin de Valoreille possédait un château et une petite seigneurie.(3) Voir Jean-Marie Thiébaud, "Les familles de Cuve (XIIe - XVIe siècles) - Essai généalogique", dans les Actes de la Société Jurassienne d'Émulation, Porrentruy (Suisse), 1981. La noble famille de Cuve s'est alliée à la famille féodale de Valoreille, première du nom.Sources et Bibliographie : Archives du Doubs, n° B - Bailliage de Baume-les-Dames ; E - Notaires ; "Titres de famille et de noblesse des Colin de Valoreille", édités par Jean-Marie Thiébaud, Pontarlier, 1982, 232 p. ; R.P. de Pontarlier (Doubs) et de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) ; Robert Genevoy, "Une famille franc-comtoise dans l'ancien évêché de Bâle : les Colin de Valoreille", dans les Actes de la Société Jurassienne d'Émulation, Porrentruy (Suisse), 1962, p. 151 à 170 ; Jean-Marie Thiébaud, Les Cogouverneurs de la Cité impériale de Besançon ; Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Sources et Bibliographie : Archives du Doubs, n° B - Bailliage de Baume-les-Dames ; E - Notaires ; "Titres de famille et de noblesse des Colin de Valoreille", édités par Jean-Marie Thiébaud, Pontarlier, 1982, 232 p. ; R.P. de Pontarlier (Doubs) et de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) ; Robert Genevoy, "Une famille franc-comtoise dans l'ancien évêché de Bâle : les Colin de Valoreille", dans les Actes de la Société Jurassienne d'Émulation, Porrentruy (Suisse), 1962, p. 151 à 170 ; Jean-Marie Thiébaud, Les Cogouverneurs de la Cité impériale de Besançon ; Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté.
Notes :
(1) Jérôme Colin, seigneur de Valoreille, obtint, le 27 avril 1604, d'Albert et Isabelle Claire Eugénie, archiducs d'Autriche, ducs de Bourgogne, etc., des lettres de grâce au sujet d'un coup de feu qu'il avait tiré sur Jacques et François d'Auxiron, de Valoreille (Doubs), sans les blesser, suite à une rixe relative à la garde du bétail audit Valoreille.
(2) Noter l'étonnante proximité dans le temps des dates de baptême de Claude François et de Marie Brigide, séparés par seulement 214 jours. Elles ne correspondent probablement pas aux dates de naissance qui demeurent inconnues. La plupart des enfants sont nés à Valoreille (Doubs) où la famille Colin de Valoreille possédait un château et une petite seigneurie.
(3) Voir Jean-Marie Thiébaud, "Les familles de Cuve (XIIe - XVIe siècles) - Essai généalogique", dans les Actes de la Société Jurassienne d'Émulation, Porrentruy (Suisse), 1981. La noble famille de Cuve s'est alliée à la famille féodale de Valoreille, première du nom.
Les impossibles féminins ou les noms de professions et les titres difficilement féminisables Aux limites du politiquement correct mais en plein cur d'un certain snobisme ambiant Pour en sourire (discrètement) puisque c'est encore permis
- chauffeur : chauffeuse (siège)
- chevalier : chevalière (bijou)
- dragon : dragonne (lanière)
- éclaireur (soldat) : éclaireuse (girl-scout)
- écumeur (des mers), pirate : écumeuse (qui n'existe d'ailleurs qu'à l'état restreint d'adjectif)
- écuyer : écuyère (de cirque)
- entraîneur : entraîneuse (patiquant des sports fort différents)
- glacier : glacière (pour conserver les aliments)
- jardinier : jardinière (de légumes)
- marin : marine (peinture et soldat d'un corps spécialisé américain)
- médecin : médecine
- plombier : plombière (glace)
- portier : portière
- recteur : rectrice (aile d'oiseau)
- routier : routière (voiture)
- soudeur : soudeuse (appareil)
Dans l'attente de néologismes sans double sens ni sans la moindre équivoque susceptible de prêter à rire ou à sourire, étonnons-nous cependant qu'en 2006-2007, des hommes puissent encore être astreints à passer des diplômes de sages-femmes, sans que cette anomalie linguistique plus qu'évidente ne déclenche le moindre petit cri d'orfraie de part et d'autre de la ligne bien fragile de l'antique séparation des sexes et des militantismes à géométrie variable mais toujours politiquement corrects, cela va de soi. Parallèlement, n'oublions pas que les hommes, sans le moindre complexe et depuis toujours, ont bien volontiers accepté l'idée d'être éminence (fût-elle grise), estafette, excellence, sentinelle, majesté, seigneurie, etc., tous titres et activités qui n'ont apparemment jamais souffert de leur grammaticale féminité. Jacques Prévert, lui-même, adorant jongler avec les mots et se faisant le valeureux chantre de cet art, s'étonnait déjà qu'on pût parler de "la" virilité mais sans avoir l'incongruité de demander aussitôt de la masculiniser, ce dont le sexe prétendu faible n'aurait assurément tiré aucun avantage. De leur côté, les femmes ont-elles jamais souffert d'avoir un utérus, un vagin, un clitoris, un et même deux ovaires, un et même deux seins, etc. ? Le lecteur (ou la lectrice), par souci du sacro-saint équilibre à respecter sous peine d'anathème, ne manquera pas de passer mentalement en revue tous les organes génitaux masculins (y compris sous leurs formes triviales) pour constater que, dans leur grande majorité, ils se sont rangés dans la catégorie des substantifs féminins. Sans davantage de complexes.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Parenté entre l'écrivain Raymond Radiguet (1903-1923) et Geneviève Guilloz, née en 1950
1) Jean-Baptiste Tisserand, 1767/, père d'Élisabeth Perron (ca 1746-1800), mère de François Tournier (1788-1845), père de Jean-Baptiste Tournier (1814-1902), père de Jean Baptiste Émile Tournier (1860-1890), père de Jeanne Marie Louise Tournier (1884-1958), mère de l'écrivain Raymond Radiguet (1903-1923), auteur de « Le Diable au Corps » et de « Le Bal du Comte d'Orgel ».
2) Pierre Joseph Tisserand (ca 1700-1782), père d'Élisabeth Tisserand, mère de Jean-Claude Guilloz (1770-1820), père de Pierre Melchior Guilloz (1813-1884), père de Gustave Guilloz (1886-1940), père de Lucien Guilloz (1897-1982), père de Geneviève Guilloz, née le 6 février 1950, femme de Jean-Marie Thiébaud
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les bourgeois de Saint-Hippolyte (Doubs) du 14e au 17e siècle dans les "Testaments de l'Officialité de Besançon" d'Ulysse Robert
- Hugues BABETAZ testa en 1549 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 150).
- Simonnette, femme de Huguenin BOUVERET, marchand, testa en 1490 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 128).
- Richard CHEMIN, de Saint-Hippolyte, religieux minime à Besançon (Doubs), testa en 1639 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 164
- Guillaume FAIVRE, de Saint-Hippolyte, curé de Soulce (Doubs, testa en 1454 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 112).
- Hugues, fils de FAIVRE, de Saint-Hippolyte, chanoine dudit lieu et curé de Vyt-lès-Belvoir (Doubs), testa en 1343 (Ulysse Robert, "Les Testaments de l'Officialité de Besançon", tome I, p. 37).
- Jean FAIVRE dit CHÂTELAIN testa en 1542 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 147).
- Simonne FAIVRE, veuve d'Antoine DU CLOZ, testa en 1560 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 153).
- Pierre FOLPOY, de Saint-Hippolyte, chanoine dudit lieu, testa en 1454 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 112).
- Nicolas MELLAND testa en 1541 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 147).
- Guyette ROUX, femme de Jean FAIVRE, testa en 1355 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 51).
- Jean RUHIER, testa en 1502 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 133.
- Étevenin SAUVAGEOT testa en 1537 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 146).
- Richard VIROT testa en 1542 (Ulysse Robert, op. cit., tome I, p. 147 ; bibliothèque du Chapitre de Besançon).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes généalogiques sur la noble famille Magnin (alias Maignin), de Lons-le-Saunier (Jura) Une famille d'officiers de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (Les Terres de Chaux, Doubs) au 17e siècle
Noble Pierre Magnin (alias Maignin), de Lons-le-Saunier (Jura), écuyer, épousa demoiselle Claudine Charreton qui lui donna deux fils :
1) - Noble Jean Ferdinand Magnin (alias Maignin), capitaine-châtelain du château de Châtillon-sous-Maîche (Les Terres de Chaux, Doubs) du 7 août 1617 à 1649 laissant alors son poste à Jean Baptiste Pelletier, de Saint-Julien (Doubs).
2) - Noble Philibert Louis Magnin (alias Maignin), chevalier, lieutenant de son frère, capitaine-châtelain de Châtillon-sous-Maîche (Les Terres de Chaux (Doubs), né à Lons-le-Saunier (Jura), demeurant à Fleurey (Doubs), épousa 1) demoiselle Othilie Hendel, de Porrentruy (Suisse) qui lui donna :
- Marie Antoine Magnin, née et baptisée en temps de guerre au château de Châtillon-sous-Maîche le 13 avril 1636 (parrain : noble Philippe-Antoine Colin, seigneur à Valoreille (Doubs) ; marraine : demoiselle Marie Anne Hendel, fille de noble Jean Thomas Hendel, de Porrentruy (Suisse), conseiller du prince-évêque de Bâle (Suisse)), qui épousa en l'église de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs), le 1er juin 1655, Jean Ferdinand Faivre de Courcelles, juge-châtelain de la seigneurie de Vaucluse (Doubs) et procureur fiscal de la seigneurie de châtillon-sous-Maîche.
Noble Philibert Louis Magnin épousa 2) en l'église de Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs), le 23 novembre 1638 (1), Anne Marie Bassand qui lui donna :
- Charles François Magnin, né et baptisé au château de Châtillon-sous-Maîche le 17 décembre 1639 (parrain : noble Jean Ferdinand Magnin, gouverneur du château de Châtillon-sous-Maîche ; marraine : Ligière Gurnel, veuve d'honorable Bénigne Bassand, de Dambelin (Doubs)), décédé à Fleurey (Doubs) le 17 mars 1696, inhumé dans l'église paroissiale de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs). Il épousa à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs), le 28 janvier 1672, honnête Claudine Farey, née à Fleurey (Doubs) le 9 novembre 1642, fille d'honorable Pierre Farey, de Fleurey, et de Jeannette Pommey, qui lui donna : a) Claude François Magnin, née à Fleurey (Doubs) le 9 août 1672, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs (parrain : Jean François Magnin; marraine : demoiselle Claudinette Faivre); b) Anne Catherine Magnin, née à Fleurey (Doubs) le 29 novembre 1674, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs) (parrain : Pierre Hyacinthe Magnin; marraine : Anne Etiennette Vesseaux). Elle fut marraine de Pierre François Miget, fils de Pierre Antoine Miget, de Fleurey (Doubs), et de Jeanne Ponsot (alias Ponceot), né à Fleurey (Doubs) le 09.09.1687, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs); c) Anne Baptiste Magnin, née à Fleurey (Doubs) le 26 janvier 1681, baptisée à Chaux-les-Châtilllon, Les Terres de Chaux, Doubs (parrain : Charles Ambroise Magnin; marraine : Jeanne Baptiste Faivre, de Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs); d) Charles Joseph (dit Joseph) Magnin, né à Fleurey (Doubs) le 28 février 1683, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs) le 28 février 1683 (parrain : Sieur Claude François Magnin, remplacé par le sieur Claude François Cugnottet, de Saint-Hippolyte (Doubs); marraine : Françoise Magnin, de Fleurey (Doubs), remplacée par Jeanne Marguerite Faivre, de Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs), décédé à Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), le 25 mars 1703, inhumé le lendemain à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs); e) Claude Alexis Magnin, né à Fleurey (Doubs) le 20 novembre 1686, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs (parrain : Jean Claude Farey, de Fleurey (Doubs); marraine : Jeanne Marguerite Faivre, de Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs), décédé le 6 avril 1696, inhumé dans l'église de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs); f) François Ambroise Magnin, frère jumeau du précédent, né à Fleurey (Doubs) le 20 novembre 1686, baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux, Doubs (parrain : François Robert, de Fleurey (Doubs); marraine : demoiselle Jeanne Petitot (de Clerval, Doubs))décédé le 6 avril 1696, inhumé dans l'église de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Sources et bibliographie : R.P. de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) ; Roger de Lurion, "Nobiliaire de Franche-Comté", p. 463-464 ; Jean-Marie Thiébaud, "Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté", tome I, p. 128, 301, 304.
Notes :
Armoiries familiales : d'argent à la bande de gueules chargée d'un lion rampant d'argent, armé et lampassé d'or, accompagné de deux flammes de gueules, l'une en chef, l'autre en pointe.
Timbre : une couronne d'or avec deux ailes d'argent chargées chacune d'une flamme de gueules.
(1) En présence de Claude d'Auxiron, greffier de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche, Simon Poutier, procureur au bailliage de Baume-les-Dames (Doubs), Servois Petitot, de Neuchâtel (Doubs) et Bernard Bersot.
Notice généalogique sur Richard de Reinach Seigneur de Vy, capitaine-châtelain de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche
- Simon Vandelin de Reinach, filleul de Simon Vandelin de Cusance et parrain de Simon Vandelin, fils de Blaise Laval, de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 22 février 1601.
- Pierre Melchior de Reinach, écuyer, baptisé à Chaux-les-Châtillon le 24 octobre 1590 (parrain : Pierre Melchior de Chantrans, écuyer ; marraine : demoiselle Françoise de Grammont, femme de Claude de Valangin, écuyer).
- Jeanne de Reinach, baptisée à Chaux-les-Châtillon le 24 mars 1593 (parrain : honorable Jacques dAuxiron, greffier de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche ; marraine : demoiselle Jeanne Chénier, femme de François du Tartre, écuyer, capitaine-châtelain du château de Châtillon-sous-Maîche).
Antoinette de Beaujeu, femme de Richard de Reinach fut la marraine dAntoine, fils de Jean Maige, de Chaux-les-Châtillon (Doubs), et de Catherine, baptisée à Chaux-les-Châtillon le 21 octobre 1587. Pour la cérémonie, elle fut remplacée par demoiselle Geneviève de Vy. Elle fut aussi la marraine dAntoinette, fille de Claude Boullard, de Fulle (Feule, Doubs) et de Claude, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 8 février 1600.
Une partie des bâtiments du château de Châtillon-sous-Maîche (Les Terres de Chaux, Doubs) portait le nom de « quartier Reinach ».
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Sources et bibliographie : Registres paroissiaux de Châtillon-sous-Maîche ; Archives du Doubs, n° B Chambre des Comptes 1399, 1400, 1402, 2390, 3068, 3106 ; Abbé Loye, « Histoire du comté de La Roche et de Saint-Hippolyte, sa capitale » ; Archives de la Grosse Maison de Neuvier ; Jean-Marie Thiébaud, « Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté », tome I.
Les huit filleuls de demoiselle Pierrette de La Verne Fille de Nicolas de La Verne, écuyer, et de Françoise de Blicterswick, et femme de Jacques dAuxiron, de Valoreille (Doubs)
- Pierrette, fille de Perrin Beurtelier, de Valoreille (Doubs), et de Marie, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 19 juin 1584.
- Pierrette, fille de Jean Oudrion, de Valoreille (Doubs), et de Jeanne, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 1er avril 1585.
- Etienne, fils de Jean Oudrion, de Valoreille (Doubs) et de Jeanne, baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 27 mars 1591.
- Jean Baptiste, fils de Jean Colard dit Mareschaulx, de Neuvier (Les Terres de Chaux, Doubs), et de Germaine, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 24 mai 1592.
- Pierrette, fille de François Farrey (Farey), de Fleurey (Doubs), et dAgathe, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 7 août 1592.
- Pierrette, fille dAdrien Joye, de Vauclusotte (Doubs), et de Françoise, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 25 janvier 1595.
- Mathieu, fils de Thomas de Cuve, de Valoreille (Doubs), et dAnne, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 3 octobre 1595. Le parrain de lenfant est Mathieu, fils de feu Thiébaud Colard, de Neuvier (Les Terres de Chaux, Doubs), procureur de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche.
Les quinze filleuls de Jacques d'Auxiron Notaire, greffier de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (Doubs)
- Anne, fille dAdrien Vessaux, de Bief (Doubs), notaire, baptisée à Saint-Hippolyte (Doubs) le 9 janvier 1577. La marraine de lenfant fut Anne dAroz, femme de Jehan de Saint-Mauris.
- Jacques, fils dHumbert Buessard, de Vauclusotte (Doubs), baptisé à Saint-Hippolyte (Doubs) le 2 janvier 1579.
- Barbe, fille de Richard Boissard, bourgeois de Saint-Hippolyte (Doubs) et dAgathe, baptisée à Saint-Hippolyte (Doubs) le 17 janvier 1579.
- Jacques, fils de Pierre Oudrion, de Valoreille (Doubs) et de Claude, baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 8 janvier 1580.
- Marguerite, fille dEtienne Barnard, dOrgeans (Doubs), baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 20 décembre 1581.
- Denise, fille de Claude Burtelier, de Valoreille (Doubs) et de Claude, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 23 janvier 1582.
- Jacques Antoine, fils de Jean Pernelle, de Valoreille (Doubs), et de Claude, baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 5 décembre 1588. La marraine de lenfant fut demoiselle Antoinette de Cueve (de Cuve), femme de noble François Colin de Valoreille, capitaine-châtelain de Pontarlier (Doubs).
- Jacques, fils dhonorablz Pierre de Villers (alias Devillers), de Vaucluse (Doubs), baptisé à Vaucluse (Doubs) le 24 août 1589.
- Jacques, fils de Claude de Cuve, de Valoreille (Doubs), et de Ligière, baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 10 février 1591.
- Jacque, fille de Jean Faivre, de Courcelles-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), et de Jeanne, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 10 octobre 1592.
- Jeanne, fille de noble Richard de Reinach, écuyer, seigneur de Vy, et de demoiselle Antoinette de Bauxjeulx (de Beaujeu), baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 24 mars 1593. La marraine de lenfant est demoiselle Jeanne Chénier, femme de François du Tartre, capitaine-châtelain du château de Châtillon-sous-Maîche.
- Marguerite, fille de N. (page déchirée), baptisée à Dampjoux (Doubs) le 9 février 1601. La marraine de lenfant est Marguerite, femme de Jacques Cuyer, de Villars-sous-Dampjoux (Doubs).
- Jacques, fils de Pierre Falot (de Fleurey, Doubs) et de Guillemette, baptisée à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 14 avril 1610.
- Claude, fille de maître Pierre Poulier, bourgeois de Saint-Hippolyte (Doubs), baptisée à Saint-Hippolyte le 25 mars 1612.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Sources : Registres paroissiaux de Chaux-les-Châtillon, Dampjoux, Saint-Hippolyte et Vaucluse.
Notes généalogiques sur la famille du Tartre aux 16e et 17e siècles
De cette union naquit un fils, Claude du Tartre, né en 1504, seigneur de Borrey, de Chamesol et de Montandon, chevalier de Saint-Georges, juge-châtelain du comté de La Roche-Saint-Hippolyte de 1530 à 1567.
Claude du Tartre épousa 1) Jeanne Merceret, fille de Nicolas Merceret, seigneur de Montmarlon et de Marguerite Pillot ; 2) Jeanne d'Orsans, fille de Pierre d'Orsans, écuyer, et de Catherine de Vaudrey. En 1567, Claude du Tartre fut inhumé dans la collégiale de Saint-Hippolyte aux côtés de sa première épouse qui lui avait donné plusieurs enfants dont François du Tartre, cité ci-dessous.
Noble homme François du Tartre, écuyer, capitaine-châtelain du château de Châtillon-sous-Maîche de 1569 à 1594, fut le parrain de François Boissard, fils d'honorable Boissard, de Saint-Hippolyte, notaire, châtelain, juge et gouverneur de la baronnie de Belvoir (3), et de Marguerite Michotey, baptisé à Saint-Hippolyte (Doubs) le 11 septembre 1570, de Claude, fils de Guillaume Babet, baptisée à Saint-Hippolyte le 6 août 1576, et d'Hippolyte, fils de François d'Auxiron, de Valoreille (Doubs) et d'Antoinette Bouhélier, baptisé à Chaux-les-Châtillon (Les Terres de Chaux, Doubs) le 29 janvier 1594.
François du Tartre épousa demoiselle Jeanne Chénier qui lui donna :
- Hippolyte, sergent-major à Gray.
- Jeanne Baptiste du Tartre, baptisée en l'église de Chaux-les-Châtillon le 29 mars 1579 (parrain : Vandelin de Cusance, seigneur de Belvoir, remplacé par François Michotey ; marraine : dame Jeanne de Breuille, femme dudit seigneur de Cusance). En 1606, elle épousa Gabriel de Bermont, de Sancey-le-Long. Déjà veuve en 1651, elle mourut le 6 juillet 1658 et fut inhumée dans la chapelle Saint-Nicolas de l'église de Sancey. Elle fut la marraine de Henri, fils de Jacques Mugnier, de Châtillon-sous-Maîche, et d'Ève, baptisée à Chaux-les-Châtillon le 16 décembre 1591.
- Thevenette du Tartre, baptisée en l'église de Chaux-les-Châtillon le 12 juin 1580 (parrain : noble homme Gabriel de Diesbach, prieur de Vaucluse ; marraine : Etiennette Lescot, femme de Thiébaud Colard, notaire).
- Philippe du Tartre, baptisé en l'église de Chaux-les-Châtillon le 29 avril 1584 (parrain : sieur François Ramasson, de Baume-les-Dames, homme de loi ; marraine : Claude, veuve de Claude Varin, de Belvoir).
- Françoise du Tartre, baptisée en l'église de Chaux-les-Châtillon le 30 juin 1586 (parrain : noble et révérend Maurice de Diesbach, (prieur) et seigneur de Vaucluse et official de la cour archiépiscopale de Besançon, remplacé par Jean Lavaux, curé de Chaux-les-Châtillon ; marraine : demoiselle Françoise de Belmont, femme de noble homme Jean de Valangin, remplacée par demoiselle Jeanne, fille du sieur Pierre Chénier, bourgeois de Saint-Hippolyte).
- Charles, baptisé en l'église de Chaux-les-Châtillon le 18 octobre 1589 (parrain : noble homme Bernard de Bermont, écuyer, seigneur à Bermont ; marraine : demoiselle N., femme de noble Françoise Bourguinet (Bourguignet), de Vesoul, écuyer).
François du Tartre donna le dénombrement du meix Perceval sis à Montandon et Vacheresse en 1584.C'est peut-être du second lit de Claude du Tartre qu'est issu Claude-Antoine du Tartre, écuyer, seigneur de Cendrey, Gouhelans, Arpenans, Montandon et Vacheresse, juge-châtelain du comté de La Roche-Saint-Hippolyte de 1583 à 1605. Par contrat du 16 octobre 1584, il épousa Françoise de Bressey, fille de François de Bressey, écuyer, seigneur de Cubry, Saint-Julien, Vyt-lès-Belvoir, et de Barbe de Jouffroy, qui lui donna six enfants :- Hippolyte du Tartre, docteur en médecine, seigneur à Saint-Hippolyte.- Jeanne Baptiste du Tartre- Charles du Tartre- Étiennette Philiberte du Tartre- Georges du Tartre, coseigneur de Borrrey, mari d'Anne d'Igny- Ferdinand du Tartre, coseigneur de Borrey.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
Sources et références : Archives du Doubs, n° B - Chambre des Comptes - 2233 ; Jean-Marie Registres paroissiaux de Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), de Sancey (Doubs) et de Saint-Hippolyte (Doubs); Thiébaud, "Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté", tomes I et II ; Jean-Marie Thiébaud, "Une pierre armoriée helvético-comtoise du début du XVIe siècle à Saint-Hippolyte", in Archivum Heraldicum, n° 1-2, 1982.
Les morts pour la France de Hauterive-la-Fresse (Doubs)
Guerre 1914-1918 :
- Louis Élisée BOSELLINI (BOSELLINI au S.H.A ?T., BOSSELLINI sur le monument aux morts de Montbenoît), né à Hauterive la Fresse (Doubs) le 24 octobre 1885, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Hautebraye (Oise) le 12 novembre 1914.
- Henri Léon Marius DROZ-VINCENT, né à Lièvremont (communa actuelle de Maisons-du-Bois Lièvremont) (Doubs) le 17 mai 1892, soldat au 149e régiment dinfanterie, mort à lhôpital n° 25 de Sens (Yonne) des suites de blessures de guerre, le 14 octobre 1914.
- Paul Jean Baptiste DROZ-VINCENT, né à La Longeville (Doubs) le 31 juillet 1891, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Harbonnières (Somme) le 29 août 1914.
- Marie Paul Armand MARGUET, né à Gilley (Doubs) le 16 janvier 1891, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Proyart (Somme) le 29 août 1914.
- Joseph Émile ROUSSEL, né à Hauterive-la-Fresse (Doubs) le 14 septembre 1890, 2e classe au 152e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Grand Charémont (Vosges) le 21 septembre 1914.
- Charles Émile VUILLEMIN, né à Hauterive-la-Fresse (Doubs) le 18 novembre 1894, 2e classe au 21e régiment dinfanterie coloniale, décédé des suites de blessures de guerre à lambulance 68 de LArbisseau (Belgique, province du Luxembourg) le 22 août 1914.
- Léon Aimable VUILLEMIN, né à Hauterive-la-Fresse (Doubs) le 13 janvier 1893, 2e classe au 11e régiment de dragons, tué à lennemi à Monchy au Bois (Pas-de-Calais) le 9 octobre 1914.
- Charles Émile CARREZ, né à Grand-Combe (Doubs) le 17 mai 1890, soldat au 60e régiment dinfanterie, 3e compagnie, tué à lennemi à Cuffies (Aisne) le 13 janvier 1915.
- Élisée CATTET, mort en 1915 (dossier non retrouvé au S.H.A.T.)
- Louis Joseph Émile SCHWEIZER, né à Lac ou Villers (commune actuelle de Villers-le-Lac) (Doubs) le 9 octobre 1886, sergent au 5e bataillon de chasseurs à pied, tué à lennemi à Hilsenfirst (Alsace) le 1er juillet 1915.
- Louis VERNIER, mort en 1915.
- Marcel VUILLEMIN, mort en 1915.
- Léon Gaston Ildefonse CARREZ, né à Montbenoît (Doubs) le 8 mai 1887, soldat au 53e régiment dinfanterie, tué au Bois de Courières (Meuse) le 14 septembre 1917.
- Alfred Florin VOYNNET, né à Hauterive-la-Fresse (Doubs) le 15 septembre 1888, ouvrier de 2e classe de la 2e section des chemins de fer de campagne, mort dans un accident en service commandé à Lyon 2e le 30 juin 1917.
- Max Camille GUINCHARD, né le 28 juin 1886, mort en 1918.
- Louis RACHEX, mort en 1918 (dossier non retrouvé au S.H.A.T.)
Guerre 1939-1945 :
- René FAVROT
Signature :
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Montbenoît (Doubs)
- Marie Joseph Alfred ROY, né à Montbenoît (Doubs) le 18 mai 1889, 2e classe au 152e régiment dinfanterie, tué à lennemi le 30 décembre 1914.
- Joseph François BOUCARD, né aux Fins (Doubs) le 27 décembre 1888, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Cuffies (Aisne) le 13 janvier 1915.
- Nestor Fénelon Sully (Lully sur le site Mémoire des Hommes du S.H.A.T.) DORNIER, né à Montbenoît (Doubs) le 11 février 1883, sergent au 26e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Ammertzwiller (Alsace) (actuellement Ammerzwiller, Haut-Rhin) le 27 janvier 1915.
- Marcel GAUTHIER, mort en 1915.
- Marcel Adrien MEUNIER, né à Montbenoît (Doubs) le 29 avril 1879, sergent au 44e régiment dinfanterie, tué à lennemi à la ferme des Wacques le 25 septembre 1915.
- Émile Aurèle Joseph BOBILLIER, né à Montbenoît (Doubs) le 4 avril 1893, 2e classe au 174e régiment dinfanterie, tué à lennemi au combat de Douaumont le 7 mai 1916.
- Louis Marie Charles Claude MORAND, né à Orléans (Loiret) le 7 février 1894, canonnier au 87e régiment dartillerie lourde, tué à lennemi à Feuillères (Somme) le 20 décembre 1916, médaille militaire, croix de guerre, fils de Louis Napoléon Alphonse Morand (1855-1914) (1) et de Marguerite Marie Thérèse Passand (1869-1918).
- Louis Régis BOUCARD, né à La Chaux de Noël-Cerneux (Doubs) le 23 mars 1894, 2e classe au 497e régiment dinfanterie, décédé en captivité au lazaret de Sagan (Allemagne) le 8 décembre 1918, fils de Claude Eugène Boucard et de Marie Eugénie Faivre-Chalon (Jean-Marie Thiébaud, Annie et Jean-Claude Boucard, « Généalogie des familles Boucard, Landry et Landry-Boucard, du Val de Morteau et de Montbenoît », 1982, p. 54).
- Abbé Paul Joseph DORNIER, né à Appenans (Doubs) le 20 août 1882, 2e classe de la IIe section dinfirmiers militaires, tué à lennemi aux Gobineaux, commune dAllemant (Aisne) le 27 mars 1918.
Guerre de 1939-1945 :
- René DAVID
- Michel BOLE-TRELY
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) Petit-fils de Charles Antoine Louis Alexis Morand (1771-1835), général de division, comte de lEmpire et pair de France.
Les morts pour la France de Montflovin (Doubs)
Guerre 1914-1918 :
- Marie Félicien Paul (dit Paul) CUCHE, né à Grandfontaine-Fournets (Doubs) le 12 mai 1883, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, mort de ses blessures à lhôpital de Villers-Cotterêts (Aisne) le 24 octobre 1914.
- René Alfred (dit René) BERTIN, né à Maisons-du-Bois (commune actuelle de Maisons-du-Bois Lièvremont) (Doubs) le 19 avril 1889, soldat de 2e classe au 51e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Maizeray (Meuse) le 11 avril 1915.
- César Gustave Pierre BAVEREL, né à La Longeville (Doubs) le 29 septembre 1890, sous-lieutenant au 44e régiment dinfanterie, tué à lennemi dans la région de Verdun (Meuse) le 18 avril 1916.
- Marie Ferdinand Albert CHAPUIS, né à Lièvremont (commune actuelle de Maisons-du-Bois Lièvremont) (Doubs) le 5 février 1891, 2e classe au 120e régiment dinfanterie, mort à lhôpital de Pontarlier (Doubs), le 1er décembre 1916, dune maladie contractée au service.
- Alfred Eusèbe Eugène (dit Alfred) BERTIN-MOUROT, né à Montflovin (Doubs) le 25 décembre 1886, caporal au 3e bataillon de chasseurs à pied, mort de blessures de guerre dans lambulance 231 à Guignicourt (Aisne) le 29 août 1918.
- Henri Joseph Auguste (dit Henri) POURCHET, né le 25 septembre 1891, mort rn 1918.
Guerre 1939-1945 :
- Joseph MOLLIER
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de La Longeville (Doubs)
Guerre de 1914-1918 :
- Longin Sévère (dit Sévère) ANDRÉ, né à La Longeville (Doubs) le 20 août 1889, soldat au 349e régiment dinfanterie, tué à lennemi au combat de Fréménil et de Benaménil (Meurthe et Moselle) le 29 septembre 1914. N.B. : sa fiche au S.H.A.T. indique par erreur La Longueville comme lieu de sa naissance.
- Fénelon Auguste Joseph (dit Fénelon) GUINCHARD, né à Montflovin (Doubs) le 1er mars 1889, soldat au 92e régiment dinfanterie, disparu à Zonnebecke le 29 novembre 1914, déclaré tué à lennemi à cette date par le tribunal de Pontarlier (Doubs) le 9 septembre 1920.
- Emile Aimé (dit Emile) POURCHET, né à Lièvremont (Doubs) le 19 décembre 1886, adjudant à la 11e compagnie du 8e Colonial dInfanterie, tué à lennemi à Massiges (Marne) le 6 octobre 1914.
- Marie Delphin Félix (dit Félix) BAVEREL, né à La Longeville (Doubs) le 29 octobre 1895, 2e classe au 407e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Neuville Saint-Vaast (Pas-de-Calais) le 29 septembre 1915.
- Ferréol BOLE, mort en 1915.
- Désiré Adonis (dit Désiré) DELACROIX, né à La Longeville (Doubs) le 20 août 1892, 2e classe au 174e régiment dinfanterie, porté disparu (tué à lennemi) à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) le 25 mai 1915.
- Aimable Henri (dit Aimable) FAIVRE-PICON, né à La Longeville (Doubs) le 27 juin 1879, 2e classe au 171e régiment dinfanterie, tué à lennemi dans le bois du Charmois (Meurthe-et-Moselle) le 23 mars 1915.
- Henri Emile (dit Henri) FAIVRE-PIERRET, né à La Longeville (Doubs) le 26 mai 1888, 2e classe au 152e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Steinbach (Alsace) (département actuel du Haut-Rhin) le 23 février 1915.
- Georges Marie Léon (dit Léon) LÉTONDAL, né à La Chaux-de-Gilley (Doubs) le 23 octobre 1892, sergent au 171e régiment dinfanterie, mort de ses blessures reçues à lennemi au combat de Champagne, ferme de Navarin (Meuse) le 28 septembre 1915.
- Constant MOUGIN, né le 18 janvier 1899, mort en 1915.
- Paul Gustave (dit Gustave) PELLETIER, né à La Longeville (Doubs) le 24 janvier 1876, 2e classe au 54e régiment dinfanterie territoriale, tué à lennemi à Cuperly (Marne) le 5 octobre 1915.
- Aimé Louis (dit Louis) QUERRY, né à La Longeville (Doubs) le 5 septembre 1892, mort en 1915.
- Marie Georges Louis (dit Georges) QUERRY, né à La Longeville (Doubs) le 24 février 1895, 2e classe au 23e régiment dinfanterie, disparu à Les Fontenelles (Vosges) le 22 juin 1915.
- Alfred Eugène (dit Alfred) BERTIN-MOUROT, né à La Chaux (Doubs) le 13 janvier 1915, 2e classe au 21e bataillon de chasseurs à pied, mort à Douaumont (Marne) du coup de feu reçu au combat le 9 mars 1916.
- Emile Fernand Humbert (dit Humbert) DELACROIX, né à La Longeville (Doubs) le 8 février 1891, 2e classe au 170e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Vaux (Meuse) le 2 mars 1916.
- Francis (François Jules au S.H.A T.) DROZ-BARTHOLET, né à La Longeville (Doubs) le 21 juillet 1886, soldat au 154e régiment dinfanterie, mort des suites de blessures de guerre à lhôpital Princesse Marie de Salonique (Grèce).
- Alfred Ernest (dit Alfred) LÉTONDAL, né à La Chaux (Doubs) le 23 mai 1896, 2e classe au 171e régiment dinfanterie, tué à lennemi à la Ferme de la Royat ( ?) (Aisne) le 5 mai 1917.
- Jules Auguste (dit Jules) BERTIN-DENIS, né à La Longeville (Doubs) le 3 juin 1888, 2nd canonnier au 68e régiment dartillerie, mort des suites de maladie contractée au service à lhôpital dOullins (Rhône) le 2 octobre 1918.
- Paul René Julien (dit René) BERTIN-MOUROT, né à La Longeville (Doubs) le 6 octobre 1896, 2e classe au 355e régiment dinfanterie, tué à lennemi au combat sur la souche sud de Marle (Aisne) le 26 octobre 1918.
- Henri Irénée (dit Henri) BEZ, né à La Longeville (Doubs) le 14 février 1885, soldat au 8e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Pont Saint-Mard (Aisne) le 29 août 1918.
- Victorin Emile Louis (dit Emile) CHABOD, né le 22 août 1895, mort en 1918.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Ville-du-Pont (Doubs)
Guerre 1914-1918 :
- Georges Marius (dit Georges) BARTHOD-TONNOT, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 18 juillet 1895, 2e classe au 35e régiment dinfanterie, tué à lennemi à la ferme de Wacques, Souain (Marne) le 17 septembre 1915.
- Joseph Émile (dit Émile) BELOT, né à La Chaux-de-Gilley (Doubs) le 9 mars 1882, 2e classe au 6e bataillon de chasseurs à pied, mort des suites de blessures de guerre au poste de secours de Thomasmsplatz (Alsace) le 24 janvier 1915.
- Jules Louis (dit Louis) BEZ, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 30 avril 1881, soldat au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Soissons (Aisne) le 14 janvier 1915.
- Ulysse Paul (dit Ulysse) Bourgeois, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 5 août 1879, caporal au 42e régiment dinfanterie, décédé à Souain (commune actuelle de Souain Perthes les Hurlus) (Marne) le 31 octobre 1915.
- Francis Donat COSTE DES COMBES, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 7 août 1892, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Cuffies (Aisne) le 14 janvier 1915.
- Luc JACQUET (inscrit sur le monument aux morts mais sa fiche na pas été retrouvée au S.H.A T. à Vincennes).
- Louis Alfred (dit Alfred) LIMAT, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 19 septembre 1882, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Cuffies (Aisne) le 13 janvier 1915.
- Emile Paul Nil (dit Nil) BOURGEOIS, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 24 janvier 1892, soldat au 405e régiment de ligne, tué à lennemi à Souchez (Pas-de-Calais) le 27 février 1916.
- Louis Fénelon (dit Fénelon) MARGUIER, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 31 juillet 1895, 2e classe au 28e bataillon de chasseurs, tué à lennemi au bois de Saint-Pierre Wast (Somme) le 8 novembre 1916.
- Alfred ROGNON (inscrit sur le monument aux morts mais sa fiche na pas été retrouvée au S.H.A T. à Vincennes).
- Louis Constant CLERC, né à Pontarlier (Doubs) le 16 janvier 1881, 2e classe au 60e régiment dinfanterie, décédé de blessures de guerre dans lambulance 6/7 à Trigny (Marne) le 22 avril 1917.
- Charles Louis CLERC, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 18 février 1879, 2e classe au 41e bataillon de chasseurs à pied, tué à lennemi dans le secteur dHurtebise (Aisne) le 3 juillet 1917.
- Léopold Léon (dit Léon) TOURNIER, né à Ville-du-Pont (Doubs) le 8 juillet 1887, caporal au 15e régiment dinfanterie, disparu à Bermericourt (Marne) le 19 avril 1917.
- Georges Lucien Alexandre (dit Georges) LAFFLY, né à Dompierre-les-Tilleuls (Doubs) le 14 août 1898, sous-lieutenant au 299e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Mareuil (Oise) le 12 août 1918.
Guerre de 1939-1945 :
- Emile BEZ
- Henri CERF
- Henri DROMARD
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les inscriptions de l'ancien cimetière de Montbenoît (Doubs)
1. - Ici repose Emile Jean-Baptiste Mussot, capitaine des douanes, chevalier de la Légion d'Honneur, décédé le 24 juin 1897 dans sa 58e année - "Daignez, mon Dieu, ne pas séparer dans le ciel, ceux que vous avez si étroitement unis sur la Terre" (Fénelon). Ce monument, le plus récent et le mieux conservé du cimetière, porte la signature "L. Vermot à Pontarlier". Il est orné d'une croix de la Légion d'Honneur finement sculptée dans la pierre (sous une couronne mortuaire traversée de branches de laurier).
2. - Famille Nicod - Marie Delphine Nicod, née Mourot, décédée le 7 février 1878. - Sylvain Nicod, décédé le 19 février 1885, à l'âge de 35 ans. - François Joseph Nicod, décédé le 18 septembre 1882 à l'âge de 79 ans. Ces inscriptions ont été gravées sur deux colonnes, deux à gauche et une à droite.
3. - Ici repose en attendant la résurrection Delphin Marie Francis Barthod enlevé subitement à l'affection des siens le 11 avril 1892 dans sa 29e année. Priez pour lui.
4. - A la mémoire de Mr l'Abbé Huot, né à Laviron le 10 août 1823, décédé à Montbenoît le 28 février 1887, curé de cette paroisse pendant 21 ans. La pierre tombale est ornée des symboles sacerdotaux (calice et croix).
5. - A Madame Vuillemin, bienfaitrice des pauvres, mère des orphelins, la paroisse reconnaissante. Prions pour elle. Décédée en septembre 1855.
6. - Adèle Jeunet femme Boillin, décédée le 11 mai 1885 dans sa 24e année, munie des sacrements de l'église. "Elle fut douce envers la mort comme elle était envers tout le monde. On a vu sur son visage après sa mort comme un doux reflet de la simplicité de son âme." - Henri Boillin, décédé le 25 avril 1885 à l'âge de 8 mois.
7. - F. Jh (François Joseph) Cressier, retraité des douanes, décédé à Ville du Pont le 10 février 1855, âgé de 66 ans. De profundis.
8. - M. A. Faivre née Laithier, décédée le 2 mai 1850 à 28 ans - J. F. G. W. Faivre née Crevat, décédée le 12 juin 1851 à 80 ans. - Ces deux inscriptions sont gravées côte à côte.
9. - Ici repose Marie Justine Gauthier épouse Baverel, décédée le 8 avril 1888 à l'âge de 66 ans. Priez pour elle. - Monument sculpté par Charles Prenel.
10. - Gilbert Rouxbeddat, décédé le 8 janvier 1889 à l'âge de 85 ans - Malthe (sic) Bonnet, son épouse, décédée le 28 octobre 1890 à l'âge de 82 ans. Sous ces deux noms gravés côte à côte, l'inscription latine "Requiescant in Pace".
11. - Ici repose Emile Faivre, décédé le 18 septembre 1885 dans sa 35e année. Priez pour lui. Son neveu reconnaissant. Le monument est signé Arnaud.
12. - [ ] (partie supérieure détruite) Faivre, épouse de André Maréchal, décédée le 11 mai 1883 dans sa 31e année. Priez pour elle.
13. - Claude Denis Ménétrier, ancien notaire, 1814-1870. "A notre bien aimé père, les enfants qui le pleurent et soupirent après le moment de la réunion".
14. - Le monument de la famille Morand orné, en son centre, d'une pyramide tronquée sur un socle carré de style Empire, et entouré d'une grille. La face antérieure de la pyramide porte l'inscription MOSKOVVA et les armoiries du comte Morand déployées dans un manteau et surmontée d'une couronne comtale. Sous l'écu pend l'insigne de grand officier de la Légion d'Honneur. Le socle est orné d'un bas-relief en marbre blanc montrant de profil la tête du général-comte Morand avec l'inscription "Au Général de Division Comte Morand, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, né à Largillat le 2 juin 1771, décédé à Paris le 2 septembre 1835". A l'arrière du monument, on peut lire : "Ici reposent à côté de son glorieux époux Marie Louise Saulet, vicomtesse Morand, décédée à Paris le 14 octobre 1888 à l'âge de 57 ans - Louis Marie Charles Claude Morand, né le 7 février 1894 à Orléans, canonnier au 87e Rt (Régiment) Artillerie Lourde, tué à l'ennemi le 20 décembre 1916 à Feuillères (Somme) - Médaille militaire - Croix de guerre. Sur les faces latérales du monument figurent les inscriptions : 1) "D'abord inhumées à Paris, les dépouilles mortelles du Général de Division CComte Morand, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, Pair de France, né à Largillat le 2 juin 1771, décédé à Paris le 2 septembre 1835, et d'Emilie Parys, son épouse (8 janvier 1808), née à Varsovie le 19 juin 1792, décédée le 10 novembre 1868, ont été ramenées ici le 12 août 1885 par leur fils Alphonse et leur petit-fils Louis Napoléon Morand ; 2) "Ci git le général de brigade Louis Morand, né à Montbenoît le 4 juin 1826, blessé à la bataille de Beaumont le 30 août 1870. Il a succombé le 9 septembre à Sommauthe (Ardennes). D'après son vu ferme, son corps a été rapporté ici. HONNEUR A QUI MEURT POUR LA PATRIE." Les faces latérales de la pyramide portent les noms de deux grandes batailles au cours desquelles le général-comte Morand s'est illustré : Pyramides et Waterloo.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) Charles Alexis Louis Antoine Morand, né à Largillat, La Longeville (Doubs) le 2 juin 1771, baptisé à Pontarlier (Doubs) le 4 juin 1771, décédé à Paris le 2 septembre 1835 (fils d'Alexis François Morand (1747-1829), avocat en Parlement, et de Jeanne Claude Marie Roussel, de Morteau), volontaire national en 1792, capitaine la même année au 7e bataillon du Doubs, général de division, fait comte de l'Empire le 22 juin 1808 et pair des Cent-Jours le 2 juin 1815, nommé pair de France à vie le 11 octobre 1832.
Mots russes d'origine française, anglaise et allemande
Аббат : abbé
Адрес : adresse (domicile)
Агроном : agronome
Аэродром : aérodrome
Аэропорт : aéroport
Африканец : Africain
Актёр : acteur
Актриса : actrice
Альбoм : album
Алфавит : alphabet
Алюминии : aluminium
Анализ : analyse
Ананас : ananas
Анархия : anarchie
Анатомия : anatomie
Анекдот : anecdote
Ангина : angine
Антенна : antenne (de télévision, de radio, etc.)
Апломб : aplomb (assurance)
Аппарат : appareil (photo, etc.)
Аппетит : appétit
Акварель : aquarelle
Аквариум : aquarium
Араб : Arabe
Артерия : artère
Артиллерия : artillerie
Аспирин : Aspirine
Астроном : astronome
Атлас : atlas
Атом : atome
Атташé : attaché (d'ambassade)
Автобус : autobus, autocar
Абтомат : automate
Абтомомобиль : automobile
Авангард : avant-garde
Баллада : ballade (musique, poésie)
Банан : banane
Бандит : bandit
Банк : banque
Банкет : banquet
Банкир : banquier
Барак : baraque
Баритон : baryton
Варвар : barbare
Батальон : bataillon
Берет : béret
Бетон : béton
Велосипед : bicyclette (vélocipède)
Билет : billet (de théâtre, de cinéma, etc.), ticket
Бис : bis
Бомба : bombe
Бульвар : boulevard
Бокс : boxe
Боксёр : boxeur
Брасс : brasse (nage)
Браво : bravo
Бюст : buste
Броня : cuirasse (le mot russe "bronia" est à rapprocher du vieux français, brogne,
broigne, cuirasse faite de pièces de cuir et de métal en usage de l'époque
carolingienne jusqu'au 13e siècle).
Буфет : buffet 1) meuble ; 2) restaurant
Кабинет : cabinet (de travail)
Кадр : cadre (profession)
Кальсон : caleçon
Камелеон : caméléon (aux sens propre et figuré)
Кандидатура : candidature
Капитал : capital (substantif)
Карбюратор : carburateur
Карнавал : Carnaval
Карп : carpe
Картон : carton
Католик : catholique
Сантим : centime
Танк : char (tank)
Шарлатан : charlatan
Шоколад : chocolat
Сидр : cidre
Сигара : cigare
Цирк : cirque
Климат : climat
Клиника : clinique
Kоньяк : cognac
Колера : choléra
Клиника : clinique
Кучер : cocher
Колосс : colosse
Комедия : comédie
Комета : comète
Комод : commode (meuble)
Комплимент : compliment
Конгресс : congrès (livresque)
Консул : consul
Контакт : contact (au sens figuré)
Контратака : contre-attaque
Контроль : contrôle
Контролёр : contrôleur
Коклюш : coqueluche
Катафалк : corbillard (et catafalque)
Корреспондент : correspondant
Куплет : couplet
Купол : coupole
Курс : cours
Кретин : cretin
Крокодил : crocodile
Кубизм : cubisme
Кюрé : curé (transcription du mot français)
Цилиндр : cylindre
Декрет : décret
Парад : défilé (parade)
Демон : démon
Депрессия : dépression (nerveuse)
Депутат : député
Катастрофа : catastrophe, désastre
Краб : crabe
Кретин : crétin
Велосипедист : cycliste (vélocipédiste)
Цилиндр : cylindre
Декрет : décret
Демагогия : démagogie
Демагог : démagogue
Дезертир : déserteur
Диабет : diabète
Диалог : dialogue
Диета : diète
Дифтерит : diphtérie
Диплом : diplôme
Директор : directeur
Диван : canapé (divan)
Диета : diète
Дипломат : diplomate
Диск : disque (sport de lancer)
Дольмен : dolmen
Драма : drame (littérature)
Эхо : écho
Экран : écran (de cinéma, de téléviseur)
Эгоизм : égoïsme
Эгоист : égoïste
Анкета : 1) enquête (sonage) ; 2) questionnaire
Антракт : entracte
Экватор : équateur
Эскалатор : escalator
Шпион : espion
Этаж : étage
Этап : étape
Евангелие : évangile
Экспресс : express (train)
Фабрика : fabrique (usine)
Фасад : façade
Факультет : ne vient pas du mot français "faculté" mais de l'allemand "Fakultät"
Фаянс : faïence
Фазан : faisan
Факир : fakir
Фанатик : fanatique (substantif)
Фашист : fasciste
Фатализм : fatalisme
Фаталист : fataliste
Феодализм : féodalisme
Фига : figue
Фильм : film (uvre cinématographique)
Фильтр : filtre
Фирма : firme
Флот : flotte (armée navale)
Фолклор : folklore
Формализм : formalisme
Формалист : formaliste
Формат : format
Форма : forme
Фреска : fresque
Фронт : front (à la guerre)
Галоп : galop
Гараж : garage (hangar pour voitures)
Газон : gazon
Жандарм : gendarme
Генерал : général
Геология : géologie
Геометрия : géométrie
Жест : geste (mouvement)
Жираф : girafe
Горилла : gorille (animal)
Гитара : guitare
Гитарист : guitariste
Гимнастика : gymnastique
Грек : Grec
Грипп : grippe
Гектар : hectare
Иероглиф : hiéroglyphe
Ипподрољ : hippodrome
История : histoire
Омар : homard
Ура ! : hourra !
Юмор : humour
Гигиена : hygiène
Гимн : hymne
Идеал : idéal (substantif)
Идеология : idéologie
Импрессионизм : impressionnisme
Импрессионист : impressionniste
Жаргон : jargon (sens actuel : argot)
Журналист : journaliste
Жюри : jury
Кепи : képi
Кило : kilo
Килограмм : kilogramme
Километр : kilomètre
Киоск : kiosque
Koмпас : boussole (et non compas)
Компот : fruits au sirop (et non compote)
Лаборатория : laboratoire
Лабиринт : labyrinthe
Лак : laque
Латинист : latiniste
Ликёр : liqueur
Магазин : magasin
Магнитофон : magnétophone
Мэр : maire
Мэрия : mairie
Мандарин : mandarine
Манёвр : manuvre (exercice militaire)
Макет : maquette
Флот : marine (flotte)
Марксизм : marxisme
Маска : masque
Математика : mathématiques
Мазут : mazout
Механизм : mécanisme
Mедаль : médaille
Мелодия : mélodie
Меню : menu (substantif)
Металл : métal
Метр : mètre
Метро : métro
Микроб : microbe
Микрофон : microphone
Миллиард : milliard
Миллион : million
Миниатюра : miniature
Мода : mode
Монархия : monarchie
Монолог : monologue
Мораль : morale
Мозаика : mosaïque
Motoцикл : motocyclette
Motoциклист : motocycliste
Негр : nègre
Нерв : nerf
Никел : nickel
Нигилизм : nihilisme
Нигилизт : nihiliste
Омлет : omelette
Опера : opéra
Оратор : orateur
Оркестр : orchestre
Орган : organe (anatomie)
Уф ! : ouf !
Пакт : pacte
Панорама : panorama
Парашют : parachute
Парадокс : paradoxe
Парк : parc
Пассажир : passager
Паспорт : passeport
Патриарх : patriarche
Патриот : patriote
Пейзбж : paysage
Педаль : pédale
Перспектива : perspective
Пессимизм : pessimisme
Пессимист : pessimiste
Фараон : pharaon
Фотограф : photographe
Фотография : photographie
Фраза : phrase
Физиономия : physionomie
Физика : physique
Пианист : pianiste
Пилюля : pilule
Пикник : pique-nique
Пистолет : pistolet
Пляж : plage
Планета : planète
Платан : platane
Поэма : poème
Пост : poste (emploi)
Пулсь : pouls
Проза : prose
Психология : psychologie
Пуловер : pull, pull-over
Пигмей : pygmée
Пижама : pyjama
Раса : race
Расизм : racisme
Радио : radio (radiodiffusion)
Реализм : réalisme
Реалист : réaliste
Реклама : réclame
Редактор : rédacteur
Референдум : référendum
Репортаж : reportage
Резина : résine (caoutchouc)
Револьвер : revolver
Рис : riz
Риск : risque
Ритм : rythme
Сабо : sabot (chaussure de bois)
Сардина : sardine
Соус : sauce
Саксофон : saxophone
Скандал : scandale
Скафандр : scaphandre
Скорпион : scorpion
Секретарь : secrétaire (homme)
Сенат : Sénat
Сенатор : sénateur
Сержант : sergent
Сигнал : signal
Силует : silhouette
Социализм : socialisme
Социалист : socialiste
Соло : solo
Суп : soupe
Сфера : sphère
Сфинкс : sphinx
Скелет : squelette
Стаж : stage
Стыль : style
Симбол : symbole
Симметрия : symétrie
Такт : tact
Тактика : tactique
Талант : talent
Тариф : tarif
Телеграмма : télégramme
Телеграф : télégraphe
Телефон : téléphone
Телескоп : téléscope
Телевизор : téléviseur
Тенор : ténor
Терраса : terrasse
Терроризм : terrorisme
Террориcт : terroriste
Tигр : tigre
Туризм : tourisme
Туризт : touriste
Трактор : tracteur
Трагедия : tragédie
Тротуар : trottoir
Трубадур : troubadour
Цыган : tsigane
Тиран : tyran
Вариант : variante
Велосиќед : vélo (vélocipède)
Вентилятор : ventilateur
Вето : veto
Вядук : viaduc
Вирус : virus
Виза : visa
Витамин : vitamine
Витрина : vitrine
Ксилофон : xylophone
Зебра : zèbre
Зигзаг : zigzag
II. - Mots russes d'origine anglaise :
Баскетбол : basket-ball
Бридж : bridge (jeu de cartes)
Кроль : crawl
Джаз : jazz
Флаг : flag (drapeau)
Футбол : football
Гангстер : gangster
Гол : goal (but)
Грейпфрут : grapefruit (pamplemousse)
Холл : hall
Хоккей : hockey
Интервью : interview
Мотель : motel
Регби : rugby
Скаут : scout
Шампунь : shampoo (shampooing). La présence d'un "n" à la fin du mot russe laisse
supposé que celui-ci vient du mot francisé.
Спорт : sport
Сквер : square
Стоп : stop
Тест : test
Трамвай : tramway
Туннель : tunnel
Утопия : utopia (utopie)
Волейбол : volley-ball
Вагон : wagon
Виски : whisky
III. - Mots russes d'origine allemande :
Ангел : Engel (ange). Ce mot russe peut aussi être d'origine anglaise.
Арфа : Harfe (harpe)
Буk : Buche (hêtre)
Фeйерверк : Feuerwerk (feu d'artifice)
Флигель : Flügel (aile). En russe, "fligel" désigne l'aile d'un bâtiment.
Фокус : Fokus (foyer en physique, exemple : foyer d'optique)
Форел : Forelle (truite)
Граф : Graf (comte)
Инфаркт : Infarkt (infarctus)
Институт : Institut (institut)
Идиш : Jiddisch (yiddish)
Календарь : Kalender (calendrier)
Майор : Major (commandant)
Мускул : Muskel (muscle)
Нуль : Null (zéro)
Oбъектив : Objektiv (objectif en photographie)
Офицер : Offizier (officier)
Проспект : Prospekt (perspective en allemand, perspective et grande avenue en russe)
Сталь : Stahl (acier)
Студент : Student (étudiant)
Signature :
par le docteur Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Valonne (Doubs)
- Alexandre Florentin PERREY (fils de François Xavier Perrey et de Louise Marie Josette Juillerot), né à Valonne (Doubs) le 30 octobre 1847, soldat au régiment des Grenadiers de la Garde, mortellement blessé au premier combat des Gravelotte (Moselle) le 16 août 1870, décédé à l'hôpital militaire du Génie à Metz (Moselle) le 17 août 1870.
Guerre de 1914-1918
- Auguste Henri BOILLOT, né à Valonne (Doubs) le 2 septembre 1891, soldat de 2e classe au 35e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à Mulhouse (Alsace) le 9 août 1914, fils d'Alphonse Joseph Boillot, né à Damprichard (25) le 22.11.1860, décédé à Valonne le 19.09.1935, et de Victorine Marie Thérèse Perrey, née à Valonne le 18.08.1858, décédée ibid. le 25.03.1944, fille de Pierre Joseph Perrey (1810-1865) et de Zénaïde Emélie Poisot (1832-1871).
- Louis Joseph Alphonse RAVEY, né le 16 avril 1894, mort le 16 juin 1915
- Alphonse Marie Joseph PERREY (fils de Joseph Perrey et de Lucia Louvet), né à Valonne (Doubs) le 15 mars 1891, séminariste puis sergent mitrailleur au 61e bataillon de chasseurs à pied, mort le 10 août 1916 à Munster (Allemagne), dans le camp de prisonniers n° II, des suites de blessures de guerre reçues lors d'une tentative d'évasion avec des prisonniers russes dont il portait également l'uniforme.
- Alphonse Victor LABEUCHE, né à Hyémondans (Doubs) le 19 janvier 1871, soldat de 2e classe au 250e régiment d'infanterie territoriale, mort le 20 septembre 1916 à Bessoncourt (Territoire de Belfort) dans l'ambulance n° 218, des suites de blessures de guerre
- Émile EVRARD, mort le 16 août 1918
(figure sur le monument aux morts de Valonne mais sa fiche n'a pas été retrouvée au S.H.A.T.)
- Alphonse BRIE, mort le 23 août 1918 (figure sur le monument aux morts de Valonne mais sa fiche n'a pas été retrouvée au S.H.A.T.)
Guerre de 1939-1945
- Jean CORBET, FFI, tué le 5 septembre 1944
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Chaux-lès-Clerval (Doubs)
- Ernest VIAN, 1915 (figure sur le monument aux morts de Chaux-lès-Clerval mais sa fiche na pas été retrouvée au S.H.A.T.)
- Georges Virgile Lucien GENEVOIS, né le 19 avril 1889, mort en 1915
- Jules Joseph MONNOT, né à Chaux-lès-Clerval (Doubs) le 24 septembre 1893, mort de blessures de guerre dans lambulance 4/54 à Sandrecourt (Meuse) le 6 mai 1916
- Joseph Séraphin GENEVOIS, né le 4 décembre 1881, mort en 1916
- Marie Joseph Charles CRÉTIEN, né à Chaux-lès-Clerval (Doubs) le 10 octobre 1878, 2e classe au 28e bataillon de chasseurs, mort à lhôpital dÉpinal (Vosges) des suites de maladie contractée au service le 18 février 1918
- Georges Charles Joseph LENOIR, né à Dampierre (Doubs) le 3 juin 1896, soldat au 44e régiment dinfanterie, mort de blessures de guerre le 13 mai 1918
Guerre 1939-1945 :
- Lucienne BREDIN 1944
- Marius LENOIR 1944
- Marcel THORIMBERG 1945
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Vellerot-lès-Belvoir (Doubs)
- Louis Edmond BOILLON (BOUILLON sur le monument aux morts de Vellerot-lès-Belvoir), né à Vellerot-lès-Belvoir (Doubs) (Billerot les Belloirs (Doubs) au S.H.A.T.) le 27 janvier 1895, 2e classe au 42e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Quennevières (Oise) le 16 juin 1915
- Louis Justin Victor PONÇOT, né à Valonne (Doubs) le 26 mars 1897, soldat de 2e classe au 110e régiment dinfanterie, mort à lhôpital de Roussbrugge ( ?) (Belgique) le 17 août 1917 (1er août 1917 sur le monument aux morts de Vellerot-lès-Belvoir)
- Joseph Maurice Eugène GALLEZOT, né à Vellerot-lès-Belvoir (Doubs) le 19 mars 1898, soldat au 26e régiment dinfanterie, mort de maladie contractée au service le 20 juillet 1918.
Guerre d'Algérie :
- Jean Marcel Eugène DODIVERS, né le 24 février 1937, maréchal des logis, mort en Algérie le 25 janvier 1960.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les morts pour la France de Vyt-lès-Belvoir (Doubs)
- Paul Eugène MALDINEY, né à Vyt-lès-Belvoir (Doubs) le 28 juin 1891, 2e classe au 42e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Bouillancy (Oise) le 7 septembre 1914.
- Marie Joseph Paul MAIRE, né à Vyt-lès-Belvoir (Doubs) le 16 avril 1883, 2e classe au 355e régiment dinfanterie, tué à lennemi à Douaumont (Meuse) le 26 mai 1916.
- Léon Joseph CHOFFAT, né à Glovelier (Suisse) le 14 avril 1888, 2nd canonnier au 59e régiment dartillerie, décédé à lhôpital de Troyes (Aube), des suites de maladie contractée au service, le 19 juin 1916.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La descendance de Jean d'Auxiron, de Valoreille (Doubs), né vers 1470 Huit premières générations
· Melchior d'Auxiron, décédé vers 1580 à Valoreille (Doubs), notaire, greffier et tabellion général de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (Doubs).
Marié avec Marie Babet, née à Saint-Hippolyte (Doubs), décédée vers 1577 à Valoreille (Doubs), dont
o Jacques, décédé en 1622 à Valoreille (Doubs), notaire audit lieu, juge-châtelain de la principauté de Mandeure (Doubs).
Marié avec Pierrette de La Verne, décédée en 1597 à Valoreille (Doubs), fille de Nicolas de La Verne, sieur de Vellechevreux (Haute-Saône) et de La Verne, seigneur à Mandeure, avant 1559, et de Françoise de Blicterswick, dont
§ Thibaut d'Auxiron, né avant 1578.
Marié avec Richarde Bouhélier, fille de Claude Bouhélier, de Blanchefontaine (Doubs).
§ François d'Auxiron, né le 15 février 1578 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Marié le 11 novembre 1590 à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), avec Antoinette Bouhélier, fille de Claude Bouhélier, dont
§ Claude d'Auxiron, né le 16 août 1604 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), notaire, résidant à Fleurey (Doubs), greffier de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche de 1636 à 1677.
Marié 1) le 3 mai 1626 en l'église Sainte-Madeleine de Besançon (Doubs), avec Clémence Delacour.
2) avec Barbe Bouhélier, fille de Nicolas Bouhélier et de Jeanne Vessaux, dont
§ Jean Ferdinand d'Auxiron, né le 13 février 1644 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), décédé le 5 avril 1696 à Fleurey (Doubs), inhumé dans l'église de Chaux-lès-Châtillon.
§ Claude d'Auxiron, née le 27 septembre 1646 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
3) Pierrette Guyot dont
§ Jean-Claude d'Auxiron, né le 29 octobre 1648 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Marié avec Jeanne Boucon dont
§ Pierre Louis Dauxiron, né en 1690, décédé le 16.11.1766 à Valoreille (Doubs).
Marié le 23 février 1713 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Anne-Marie Poëte, née le 1er juin 1694 à Valoreille (Doubs), décédée le 7 février 1756 à Valoreille, fille de Claude Poëte (1666-1711) et de Jeanne Françoise Ruhier (1672-1744), dont
§ Jeanne Ursule d'Auxiron, née le 20 juin 1724 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), décédée le 2 septembre 1794 à La Grange (Doubs).
Mariée avec Nicolas Xavier Clerc, né en 1724, décédé le 28 octobre 1800 à La Grange (Doubs).
§ Marie Antoine d'Auxiron.
§ Jeanne Agnès d'Auxiron, née le 15 septembre 1650, Valoreille (Doubs), baptisée le 3 octobre 1650 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Anne Françoise d'Auxiron, née le 17 décembre 1652 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Anne-Marie d'Auxiron, née en 1655 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Claude Joseph d'Auxiron, né le 11 novembre 1659 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Jeanne Baptiste d'Auxiron, née le 9 juillet 1665 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Mariée avec honorable Claude Joly.
Marié le 21 décembre 1626 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Henriette Vernier, de Charmoille (Doubs), dont
§ Jacque Claudine d'Auxiron, née le 25 février 1627 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs)
§ Guillemette d'Auxiron, née avant 1578.
Mariée le 20 février 1599, Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Pierre Fallot, de Fleurey (Doubs), dont
§ Germaine Fallot, née le 19 mars 1607 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs)
§ Jeanne d'Auxiron, née avant 1578.
Mariée, le 11 novembre 1590 à Chaux-les-Châtillon (Doubs), avec Richard Bouhélier.
§ Isabelle d'Auxiron, née le 24 novembre 1588 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Mariée le 27 mai 1608 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Etienne Fallot, fils d'Étienne Fallot, de Fleurey (Doubs), dont
§ Jean Fallot, né le 22 mai 1611 à Fleurey (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Marié le 30 octobre 1638, Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Foy Burthelier, dont
§ Jean Fallot, né le 13 décembre 1639 à Fleurey (Doubs), baptisé, Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Marguerite Fallot, née le 6 novembre 1641 à Fleurey (Doubs), baptisée, Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Nicolas Fallot, né le 30 septembre 1645 à Fleurey (Doubs), baptisé à Saint Hippolyte (Doubs).
Marié le 23 janvier 1667 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Claude Jeambrun, de Ferrières-le-Lac (Doubs), dont
§ Charles François Fallot, né le 21 octobre 1667 à Fleurey (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), décédé le 1er janvier 1749 à Fleurey, échevin de Fleurey.
Marié à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec honnête Marie Antoine Colard, née le 19 mars 1662 à Neuvier Les Terres-de-Chaux (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), fille d'honorable Claude Colard le Jeune, de Neuvier, Les Terres-de-Chaux (Doubs), et de Claudine Vuillier, dont
§ Jeanne Antoine Fallot, née le 9 juin 1697 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Anne Claude Fallot, née le 10 décembre 1698 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-les Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), décédée le 16 septembre 1779 à Valoreille (Doubs).
Mariée avec honorable Pierre Joseph Monnier, né le 19 mars 1693 à Les Reuchaules, Valoreille (Doubs), décédé le 27 décembre 1767 à Valoreille, fils d'honorable Antoine François Monnier et de Catherine Joly, dont
§ Claude Françoise Monnier, née le 22 février 1730 à Valoreille (Doubs), décédée le 23 décembre 1818 à Peseux (Doubs).
Mariée le 1er février 1752 à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Henry Vadam, né le 28 janvier 1725 à Peseux (Doubs), décédé le 23 février 1802 à Peseux (Doubs), laboureur, échevin de Peseux, fils de Claude Denis Vadam ((1682-1752) et de Jacqueline Carnet (1686-1759). De l'union de Henry Vadam et de Claude Françoise Monnier naquit une fille, Marie Angélique Vadam (1763-1843) qui épousa à Chaux-les-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), le 30 janvier 1787, François-Xavier Thiébaud (1768-1849), maire de Neuvier, Les Terres-de-Chaux (Doubs), le grand-père de l'arrière-grand-père de l'auteur.
§ Pierre François Monnier.
§ Jacques Joseph Monnier.
§ Jean Claude Alexandre Monnier.
§ Claude Ignace Monnier.
Marié en 1752 avec Jeanne Ursule Jeannin.
§ Jeanne Baptiste Fallot, née à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Nicolas Fallot.
§ Anne Eve Fallot, née le 15 avril 1669 à Fleurey, baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), décédée.
§ Jeanne Ursule Fallot, née le 8 juillet 1651 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Mariée le 31 janvier 1673, Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Pierre Antoine Farrey (Farey), fils d'Antoine Farrey, de Fleurey (Doubs).
§ Claude François Fallot, né le 27 février 1654 à Fleurey (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Marguerite Fallot, née le 25 août 1656 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Claude Antoine Fallot.
Marié le 5 octobre 1677 à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs) avec Pierrette Mesloye.
§ Foy Fallot, née le 14 septembre 1613 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Isabelle Fallot, née le 19 mars 1618 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ François Fallot, né le 2 avril 1621 à Fleurey (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Agathe Fallot, née le 17 mai 1623 à Fleurey (Doubs), baptisée à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Guillaume d'Auxiron, né le 22 octobre 1590 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
Marié avec Françoise Vuillin, dont
§ Isabelle d'Auxiron
Mariée avec Nicolas Fallot
§ Guillemette d'Auxiron
§ Pierre Matthieu d'Auxiron, né le 30 novembre 1603 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-les-Châtillon (Doubs), décédé à Besançon (Doubs), reçu docteur en médecine en Avignon le 19 avril 1627, citoyen de Besançon le 18 juin 1633, professeur de médecine à l'Université de Dole (Jura).
Marié le 17 avril 1630, Besançon (Doubs), avec Anne Galliot (alias Galiot), née le 28 février 1616 à Besançon (Doubs), fille d'honorable Jean Galliot et de Jeanne Sarragoz, dont
§ Françoise d'Auxiron, née le 28 mai 1633 à Besançon (Doubs), baptisée audit lieu
§ Anne d'Auxiron, née le 16 janvier 1635 à Besançon (Doubs).
§ Anne Marie d'Auxiron, née le 2 novembre 1636 à Besançon (Doubs).
§ Marguerite d'Auxiron, née le 6 août 1638 à Besançon (Doubs), baptisée dans l'église Saint-Marcellin.
§ Ignace François d'Auxiron, né le 24 août 1640.
§ Anne Marie II d'Auxiron, née le 4 août 1641 à Besançon (Doubs).
§ Françoise II d'Auxiron, née le 30 mars 1643 à Besançon (Doubs), décédée le 29 octobre 1724 à Besançon, inhumée dans l'entrée de l'église Saint-Marcellin, citoyenne de Besançon (Doubs).
§ Suzanne d'Auxiron, née le 29 août 1646 à Besançon (Doubs), baptisée en l' église Saint-Marcellin.
Mariée le 1er février 1681, église Saint-Marcellin de Besançon, avec Jean Renard, docteur en droit, citoyen de Besançon.
§ Luc d'Auxiron, né le 7 mars 1648 à Besançon (Doubs).
§ Claude Joseph François d'Auxiron, né le 20 juillet 1649 à Besançon (Doubs), décédé en 1714, docteur en médecine.
Marié le 30 juillet 1675 avec Élisabeth Caffod, fille de Pierre Caffod (1616-1696) et de Marie Anne Simon, dont
§ Claude François Joseph d'Auxiron, comte du Saint-Empire
§ Pierre François Joseph d'Auxiron, né le 18 juillet 1676 à Besançon (Doubs), baptisé dans l'église Saint-Marcellin.
§ Catherine Françoise d'Auxiron, née le 22 septembre 1677 à Besançon (Doubs), baptisée en l' église Saint-Marcellin, décédée le 24 janvier 1761 à Besançon.
§ Françoise Suzanne d'Auxiron, née le 31 décembre 1678 à Besançon (Doubs), baptisée en l' église Saint-Marcellin, décédée le 24 janvier 1761 à Besançon, inhumée dans l(église Saint-Marcellin.
§ Claude Gabriel d'Auxiron, né le 29 avril 1680, Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin.
§ Pierre Mathieu d'Auxiron, né le 26 février 1682 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin.
§ Denis d'Auxiron, né le 26 février 1682 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin.
§ Jeanne Baptiste d'Auxiron, née le 24 janvier 1683 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint-Marcellin, décédée le 4 octobre 1740 à Besançon.
§ Claude Marie d'Auxiron, née le 24 février 1685 à Besançon (Doubs).
§ Claude Reine d'Auxiron, née le 23 octobre 1686 à Besançon (Doubs).
§ Charles François d'Auxiron, né le 2 octobre 1689 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin.
§ Marguerite Monique d'Auxiron, née le 4 mai 1691 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint-Marcellin.
§ Jean-Baptiste d'Auxiron, né le 23 août 1692 à Besançon (Doubs), baptisé, audit lieu, décédé le 4 octobre 1740 à Besançon, inhumé, église des clarisses, docteur en médecine.
Marié le 12 juillet 1723, église des Ursulines de Poligny (Jura), avec Anne Elisabeth Maire, décédée le 1er avril 1767 à Besançon (Doubs), inhumée dans l'église des clarisses, propriétaire à Alaincourt (Haute-Saône) en 1749, fille de Jean Baptiste Maire, docteur en droit, conseiller au bailliage et présidial de Vesoul, gouverneur de Vauvillers (Haute-Saône), et d'Anne Philippe Moussu, dont
§ Jeanne Elisabeth d'Auxiron, née le 24 avril 1724, Besançon (Doubs), baptisée dans l' église Saint-Marcellin, décédée le 7 décembre 1730 à Besançon, inhumée dans le second caveau de la chapelle Saint-Pierre de l'église Saint-Marcellin.
§ Anne Gabrielle d'Auxiron, née le 24 mai 1725 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint-Marcellin.
§ Jean-Baptiste d'Auxiron, né le 30 juin 1726 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin de Besançon, décédé le 20 décembre 1800 à Besançon (Doubs), avocat en Parlement, professeur de droit français à l'Université de Besançon, premier échevin au magistrat de Besançon, juge-gouverneur de la vicomté et de l'ancienne mairie de Besançon, noble, chevalier de Saint-Louis. Dès 1753, il proposa une réforme de la confrérie Saint-Yves des avocats, préconisant notamment le vote secret aux assemblées et une réunion préalable des avocats par groupes de dix. Il rédigea aussi, pour poursuivre son idée d'une nécessaire mutation de la profession, un "Précis contenant la plupart des abus qui se sont glissés dans la manière d'instruire et de plaider les causes à l'audience" mais son initiative suscita la réprobation générale des procureurs car il proposait d'abréger les actes de procédure et, conséquemment, les revenus financiers de ces derniers (Maurice Gresset, "Gens de justice à Besançon, 1674-1789", t. II, p. 695). Le 22 juin 1759, il prononça l'éloge funèbre de Claude Nicolas Billerey, professeur de médecine à l'Université de Besançon, membre correspondant de l'Académie des Sciences, décédé à Besançon le 3 janvier 1758. Membre et officier de la loge maçonnique "La Sincérité" de Besançon en 1778 ("Historique de la Franc-maçonnerie à l'Orient de Besançon depuis 1764", Besançon, 1859, p. 10; B.N., F M2 164). En dehors de ses activités professionnelles, ses pôles d'intérêt étaient multiples. On lui doit notamment un Mémoire imprimé sur l'entretien et l'embellissement des fontaines, 1773 (Archives communales de Besançon, carton 190), un autre sur les juridictions de la ville, 1776 (Archives communales de Besançon, carton 193) et des "Notes de droit sur des questions de substitution" (Bibliothèque municipale de Besançon, ms 308; Fonds de l'Académie de Besançon, t. III, fol. 160; J.-M. Thiébaud, "Médecins et chirurgiens de Franche-Comté", p. 47-48). Son mariage est célébré par Jean Baptiste Marin d'Orival, chanoine de la métropole de Besançon, représentant Jean Charles Maire d'Hurecourt, chanoine de la métropole, vicaire général du diocèse de Besançon.
Marié le 28 octobre 1777, église Saint Jean-Baptiste de Besançon (Doubs), avec Anne Baptiste Françoise d'Orival de Miserey, née le 22 septembre 1747 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint Jean-Baptiste, fille de Nicolas d'Orival de Miserey et de Françoise Joseph Baulard de Rigny, dont
§ Cécile Françoise Gabrielle Marine d'Auxiron, née le 16 octobre 1778 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint-Marcellin. Elle épousa Jean Claude Agnus de Rouffanges.
§ Charles Joseph d'Auxiron, né le 12 mai 1781 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église Saint-Marcellin, décédé audit lieu le 17 janvier 1787.
§ Anne Gabrielle Eléonore d'Auxiron, née le 11 février 1784 à Besançon (Doubs), baptisée en l'église Saint-Marcellin, démente depuis 1802 et mise sous tutelle à Lyon (Rhône) en 1827.
§ Michel Jean Baptiste Marin Thérèse d'Auxiron, né le 22 décembre 1787, Besançon (Doubs), baptisé, église Saint Jean-Baptiste, décédé à Dijon (Côte d'Or) le 30 avril 1829.
§ Jeanne d'Auxiron ; née en 1727, décédée le 5 août 1731 à Besançon (Doubs), inhumée, second caveau de la chapelle Saint-Pierre de l'église Saint-Marcellin.
§ Pierre Claude d'Auxiron, né à Besançon (Doubs) le 8 août 1728, baptisé en l'église Saint-Marcellin, décédé à Besançon le 12 octobre 1789, docteur en médecine.Ce médecin érudit, qui exerça son art à Ornans (Doubs) puis à Besançon (Doubs), s'intéressait en particulier à l'hygiène et à la fabrication des vins. On lui doit notamment un "Projet d'une machine destinée à purifier les mauvaises eaux et à s'en procurer de meilleures et de plus saines" et une "Description d'un pressoir d'une nouvelle forme propre à pressurer les marcs de vendange... soumis au jugement de Messieurs les Académiciens des Sciences de Paris et présenté par M. d'Auxiron, exerçant la médecine à Besançon, 1786" (ms de la Bibliothèque municipale de Besançon).
§ Claude François Joseph d'Auxiron, chevalier, né le 19 décembre 1731 à Besançon (Doubs), baptisé dans l'église Saint-Marcellin, décédé le 27 mars 1778 à Paris, ingénieur militaire, capitaine de la légion de Lorraine. ancien élève de l'école d'artillerie de Metz, versé dans les mathématiques et les sciences, précurseur de l'invention de la navigation à vapeur. Auteur de "Principes de tout gouvernement, ou Examen des causes de la splendeur ou de la foiblesse de tout Etat considéré en lui-même et indépendamment de ses moeurs" (Paris, J. Th. Hérissant, fils, 1766), il fit paraître aussi une "Comparaison du projet de M. de Parieux de l'Académie des Sciences pour donner de l'eau à la ville de Paris", Muster fils, Amsterdam, 1769 (Bibliothèque du Prytanée militaire), opuscule d'une soixantaine de pages dans lequel il proposait notamment l'établissement d'une pompe à feu d'après le modèle qu'il avait vu fonctionner en Angleterre.
Le physicien Antoine Laurent Lavoisier lui répondit par un "Rapport sur la brochure de Monsieur d'Auxiron relative aux moyens de donner de l'eau à la ville de Paris". Dès décembre 1772, fermement convaincu de la possibilité de naviguer à vapeur, cet esprit inventif commença la construction de son bateau à Paris près de l'île des Cygnes, mais le bateau fut submergé le 8 septembre 1774 après que les ouvriers eussent laissé tomber au fond de la câle un contrepoids qui ouvrit une voie d'eau. Les actionnaires qui ont créé, le 21 mai 1772, un acte d'association "pour la mise à exécution du projet d'Auxiron"(dont le vicomte d'Harambure, Bernard de Bellaire et un Jouffroy d'Uzelles, oncle du marquis de Jouffroy d'Abbans, cité plus loin) voulurent abandonner le projet mais le chevalier d'Auxiron obtint qu'ils tinssent tous leurs engagements pris antérieurement et il alla développer ses conceptions sur la navigation à vapeur devant l'Académie des Sciences.
Avec Monnin de Follenay, il avait en effet obtenu de Berlin, ministre de Louis XV, la promesse d'un privilège exclusif de quinze ans pour faire remonter les bateaux sur les rivières au moyen de la pompe à feu mais uniquement, écrivait le ministre à Paris, le 22 mai 1772, lorsque l'Académie des Sciences aura jugé cette méthode "véritablement utile à la navigation". Nouvelle catastrophe le 8 septembre 1774. De retour d'exil, le jeune Claude François Dorothée, marquis de Jouffroy d'Abbans, lui aussi vivement intéressé par le problème de l'énergie nécessaire pour remonter les cours d'eau, devint l'ami et l'associé du chevalier d'Auxiron qui, épuisé, mourut en 1778 après avoir adressé plusieurs lettres au jeune marquis persuadé lui aussi que la navigation à vapeur pouvait ouvrir une voie nouvelle dans l'histoire de la marine. Une de ces lettres, écrite peu avant la mort du chevalier d'Auxiron, poussait Jouffroy d'Abbans à poursuivre le projet qu'ils avaient mené en commun : "Courage, mon ami, vous seul êtes dans le vrai" (il confirmait ainsi le calcul du marquis qui pensait, à juste titre, qu'il fallait que le moteur du bateau développât une force trois fois supérieure à celle du courant si l'on voulait pouvoir remonter rivières et fleuves). Le marquis de Jouffroy d'Abbans, devenu propriétaire de près de la moitié des actions d'une nouvelle société (les autres appartenant aux héritiers du chevalier d'Auxiron et, plus particulièrement à Jean Baptiste d'Auxiron, écuyer, professeur de droit français à l'Université de Besançon, frère du chevalier défunt, à Charles François Monnin de Follenay, lieutenant-colonel de la légion de Flandre (lui aussi bisontin et ancien élève de l'école d'artillerie de Metz), associé initial du chevalier d'Auxiron, et à Vedel), négocia avec les héritiers du chevalier d'Auxiron, obtint, dès 1781, de Monnin de Follenay tous les plans et documents laissés par le chevalier d'Auxiron (Maurice Gresset, "Gens de justice à Besançon 1674-1789", t. II, p. 659-660) et put enfin faire naviguer un bateau propulsé à la vapeur, d'abord sur le Doubs à Baume-les-Dames puis sur la Saône. C'est tout naturellement le nom de Claude François Dorothée, marquis de Jouffroy d'Abbans que l'histoire a retenu pour cette invention même s'il eût été logique d'associer les noms de ces deux inventeurs, le premier ayant assurément ouvert la voie au second. N.B. : c'est aussi à Claude François Joseph d'Auxiron qu'on doit la traduction en française de la Théorie des fleuves publiée en allemand (M. Prévost et Roman d'Amat, "Dictionnaire de biographie française", Paris, 1948, t. IV, p. 791, notice rédigée par C. Laplatte, conseiller à la cour de Colmar); Charles Paguelle, "Notice sur les premiers essais de la navigation à vapeur (1772-1774) in Annales franc-comtoises, Besançon, 1865, p. 267-279"; E. Fourquet, "Hommes célèbres et personnalités marquantes de Franche-Comté"; Sylvestre de Jouffroy, "Une découverte en Franche-Comté au XVIIIe siècle", 1881.
La Bibliothèque municipale de Besançon conserve de nombreux manuscrits de ce scientifique qui s'intéressait aussi à l'économie, à la politique, à l'éducation et surtout à la chose militaire : "Traitement de l'armement des troupes à pied, 1768"; "Mémoire sur la manière la plus avantageuse, au moyen de laquelle il paraît que l'infanterie peut résister à la cavalerie, dans la plaine rase"; "Plan de formation d'une nouvelle troupe tendant à rendre les soldats valeureux et à rendre leur feu aussi meurtrier que possible"; "Essai sur les armes des troupes à cheval"; "Projet pour ruiner la marine anglaise"; "Remarques sur les Commentaires de César"; "Sur le calibre des bombes"; "Moyen d'augmenter les revenus du Roy de quinze millions net chaque année"; "Sur l'éducation"; "Essai sur la théorie des passions"; "Principes de tous gouvernements".
Jeanne Marie d'Auxiron, née le 12 janvier 1733, Besançon (Doubs), baptisée, église Saint-Marcellin, décédée le 14 septembre 1734 à Besançon.
§ Jeanne Françoise Gaspard Thérèse d'Auxiron, née le 10 septembre 1734 à Besançon (Doubs), baptisée, église Saint-Marcellin, décédée le 19 septembre 1734, Besançon
§ Pierre Jacques d'Auxiron, né le 16 mars 1697 à Besançon (Doubs), baptisé en l'église de l'abbaye Saint-Vincent
§ Pierre François, né le 9 septembre 1652 à Besançon (Doubs).
o Jean, notaire à Baume-les-Dames (Doubs).
Marié avec Isabelle de La Goutte, dont
§ Jean, né le 17 février 1591 à Baume-les-Dames (Doubs), décédé en 1635 à Dole (Jura), jésuite.
§ Hugues, né le 24 janvier 1597 à Baume-les-Dames (Doubs).
§ Jean-François, né le 13 septembre 1598 à Baume-les-Dames (Doubs).
§ Claudine, née le 19 novembre 1605 à Baume-les-Dames (Doubs).
§ Isabelle, née le 8 juillet 1610 à Baume-les-Dames (Doubs).
o François
Marié avec Antoinette Bouhélier, dont
§ Hippolyte, né le 29 janvier 1594 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-lès-Châtillon, Les Terres-de-Chaux (Doubs).
§ Agathe, née le 28 septembre 1597 à Valoreille (Doubs), baptisée à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs).
§ Claude, né le 16 août 1604 à Valoreille (Doubs), baptisé à Chaux-les-Châtillon, Les Terres de Chaux (Doubs), décédé en décembre 1678 à Valoreille.
o Thiébaude
Mariée avec Nicolas de La Grange, né vers 1550 dont
§ François, né vers 1576.
Marié vers 1603 avec Catherine Flory.
Signature :
docteur Jean-Marie Thiébaud
La famille Socié, Socier, Sorcier, de Solemont (Doubs) Descendance de Pierre Sorcier (alias Socier ou Socié)
- Pierre, né le 27 décembre 1599 à Solemont (Doubs), décédé le 9 septembre 1679, à Solemont (Doubs).
Marié avec Élisabeth Darçot dont
- Claude Socier, né le 7 septembre 1642 à Solemont (Doubs), décédé le 12 novembre 1712 à Solemont (Doubs).
Marié avec Jeanne Cordier, née le 2 septembre 1647 à Rémondans (Doubs), décédée le 12 novembre 1712 à Solemont (Doubs), dont
- Pierre Antoine Socié, né vers 1672, décédé en 1744 à Solemont (Doubs).
Marié le 2 juin 1699, Dampjoux (Doubs), avec Anne Claudine Socier, née le 2 juin 1679 à Solemont (Doubs), dont :
- Jeanne Marguerite Socié, née le 9 juin 1700 à Solemont (Doubs), baptisée, Dampjoux (Doubs).
- Anne Marguerite Socié, née le 11 décembre 1701 à Solemont (Doubs), baptisée à Dampjoux (Doubs).
- Claude François Sorcier, né le 28 novembre 1703 à Solemont (Doubs), baptisé à Dampjoux (Doubs).
- Marie Antoine Socié, née le 22 décembre 1706 à Solemont (Doubs), baptisée à Dampjoux (Doubs).
- François Socié, né le 31 août 1711 à Solemont (Doubs), baptisé, Dampjoux (Doubs).
- Anne Claude Socié, née le 16 juin 1714 à Solemont (Doubs), baptisée à Dampjoux (Doubs).
- Claude Antoine Socié, né le 8 juin 1716 à Solemont (Doubs), baptisé à Dampjoux (Doubs), décédé le 14 juillet 1789 à Solemont (Doubs) (à l'âge de 73 ans), meunier, échevin à Solemont (Doubs).
Marié le 14 mai 1737 à Solemont (Doubs), avec Anne Françoise Donzelot dont
- Marie Anne Socié, née en 1737, décédée.
Mariée avec Jean Jacques Frédéric Vadam.
- Marguerite Ursule Socié, née le 15 avril 1743 à Solemont (doubs), décédée le 1er octobre 1815 à Neuvier Les terres-de-Chaux (Doubs) (à l'âge de 72 ans).
Mariée le 22 mai 1764 à Chaux-lès-Châtillon Les Terres-de-Chaux (Doubs), avec Jean Joseph Ligier Thiébaud, né le 12 novembre 1729 à Peseux (Doubs), baptisé en léglise de Chaux-lès-Châtillon Les terres-de-Chaux (Doubs), décédé le 13 octobre 1810 à Peseux (Doubs).
- Marie Agnès Socié
mariée avec Jean Claude Outhenot
- Marie Joseph Socié
mariée avec Pierre Mathias Roch
- Marie Ignace Socié (à confondre avec Marie Agnès citée plus haut ?)
- Jean Antoine François Xavier, décédé à Solemont (Doubs), inhumé à Solemont (Doubs), maire de la justice et seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (Doubs) à Solemont (Doubs).
Marié 1) avec Desle Geneviève Callerand, fille dAmbroise Callerand, huissier au bailliage de Baume-les-Dames (Doubs)
2) le 10 janvier 1781, avec Hélène Geneviève Perrey.
- Claude François, maire de Solemont (Doubs) pendant la Révolution.
- Pierre François Socié
marié avec Claudine Jeanmaire.
- Michel François Socié, chapelain de Chaux-les-Châtillon (Doubs), vicaire à Droitfontaine (Doubs) puis à Peseux (Doubs), chapelain à Voujeaucourt (Doubs), curé de Rosières-sur-Barbèche (Doubs) après la Révolution.
- Marie Thérèse Socié
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Song Kun-Ho (1926-2001) Un grand journaliste sud-coréen d'opposition
Il avait débuté sa carrière de journaliste au Korea Correspondence et au Hankook Ilbo avant de rejoindre le Dong-A Ilbo. Puis, on le trouva comme éditorialiste et rédacteur de plusieurs grands journaux sud-coréens : le « Chosun Ilbo », le « Hankook Ilbo » et le « Kyunghyang Shinmoun » avant son arrestation dans les années 1980 étant alors accusé de complicité dans la « rebellion de Kim Dae-jung ». Libéré, il fonda, dès le 19 décembre 1984, une association de coalition pour des media démocratiques dont il devint tout naturellement le premier président. Réélu à deux reprises président de ce mouvement, il jugea utile de faire passer ses idées dans un bulletin, le « Monthly Mal » dans lequel il dévoila le contrôle que les autorités militaires exerçaient sur la presse. Puis ce fut la création du « Hankyoreh Shinmoun » qui fit de lui la grande figure de lopposition sud-coréenne au pouvoir en place.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Petit dictionnaire de célébrités Leurs noms complets, leurs particules et titres oubliés
AGOULT (d') Marie de FLAVIGNY, comtesse d'AGOULT (écrivain, o Frankfurt-am-Main (Allemagne) le 31.12.1805, Paris le 05.03.1876, inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Elle est aussi connue sous le pseudonyme de Daniel Stern).
ALEMBERT (d') Jean LE ROND d'ALEMBERT (mathématicien et homme de lettres, secrétaire perpétuel de l'Académie française, o Paris le 16.11.1717, ibidem le 29.10.1783, fils naturel de Madame de Tencin et du chevalier Destouches-Canon, abandonné à sa naissance devant la chapelle de Saint-Jean Le Rond d'où le nom qui lui fut donné à son baptême).
ARSONVAL Jacques-Arsène (dit Arsène) d'ARSONVAL (physicien, o château de La Borie, Saint-Germain-les-Belles, La Porcherie (87) le 08.06.1851, ibid. le 31.12.1940)
BACON François BACON, Lord VERULAM, vicomte de St-Albans (chancelier d'Angleterre, o Londres le 22.01.1561, ibidem le 09.04.1626)
BADEN-POWELL Sir Robert STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL (o Londres, 6, Stanhope Street, le 22.02.1857, au Kenya le 08.01.1941, fils du Révérend H.G. Baden- Powell, professeur de mathématiques à l'Université d'Oxford (22.08.1796-11.06.1860), et d'Henriette-Grace Smyth (1824-1924), fille de l'amiral William Henry Smyth. Général Anglais et excellent officier d'espionnage, Baden-Powell est le fondateur du scoutisme. Sa pierre tombale au Kenya porte le signe " fin de piste).
BALZAC Honoré de BALZAC. N.B. : cet écrivain prolifique s'appelait en réalité BALSAA et ce patronyme de BALZAC ainsi que les armoiries qu'il s'est attribuées sont totalement usurpées.
BALZAC Jean-Louis GUEZ, seigneur de BALZAC (littérateur, historiographe, Conseiller d'Etat, o Angoulême (16) v. 1597, le 08.02.1654).
BARANTE Amable-Guillaume-Prosper BRUGUIÈRE, baron de BARANTE (historien, publiciste et homme politique, o Riom (63) le 10.06.1782, 1866) (J.-M. Thiébaud, " Français et Suisses francophones en Russie et en URSS ")
BARÈRE Bertrand BARÈRE de VIEUZAC (député à la Convention, o Tarbes (65) le 10.09.1755, ibidem le 15.01.1841)
BARRAS Paul-François-Jean-Nicolas, vicomte de BARRAS (député du Var à la Convention, o Fox-Amphoux (83) le 30.06.1755, Chaillot près de Paris le 29.01.1829).
BAYARD Pierre TERRAIL, seigneur de BAYARD (le Chevalier sans peur et sans Reproche, o v. 1470-1475, Romagnano (Lombardie) le 30.04.1524 après avoir été blessé la veille).
BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin CARON de BEAUMARCHAIS (écrivain et dramaturge, o Paris le 24.01.1732, le 18.05.1799, 7e enfant d'André Charles Caron, maître horloger et de Marie Louise Pichon).
BECCARIA Cesare BONESANA, marquis de BECCARIA (publiciste et économiste italien, auteur d'un traité intitulé " Des délits et des peines ", o Milan (Italie) le 15.03.1738, ibidem le 28.11.1794).
BÉRANGER Pierre-Jean de BÉRANGER (chansonnier, o Paris, rue Montorgueil, le 16.07.1780, Paris le 16.05.1857 dans une rue qui porte son nom depuis 1864. IL fut élevé par son grand-père tailleur).
BERTHOLLET Claude-Louis, comte BERTHOLLET (chimiste, membre de l'Académie des Sciences, professeur de chimie à l'Ecole Polytechnique, o Talloires (74) le 09.09.1748, Auteuil (75) le 06.11.1822, fils de Louis Berthollet, châtelain de Talloires, bourgeois d'Annecy, et de Philiberte Douyer. Il épousa Marie Marguerite Baur qui ne lui donna qui fils, Amédée Berthollet (1783-1811), sans alliance).
BIRON Charles de GONTAUT, duc de BIRON (pair et amiral de France, maréchal de France, o 1562, condamné à mort par le Parlement pour trahison le 29.07.1602, décapité le 31.07.1602, fils d'Armand de Gontaut-Biron).
BLAINVILLE Henri-Marie DUCROTAY de BLAINVILLE (naturaliste, o Arques-la-Bataille (76) le 12.09.1777, le 01.05.1850)
BLUCHER Gebhard Leberecht von BLUCHER, prince de WAHLSTATT (feld-maréchal des armées prussiennes, o port de Rostock (Allemagne) le 16.12.1742, Krieblowithz (Silésie) le 12.09.1819).
BOUGAINVILLE Louis-Antoine, comte de BOUGAINVILLE (navigateur, sénateur et comte sous l'Empire, o Paris le 11.11.1729, ibidem le 20.08.1811, fils d'un notaire et échevin de la ville de Paris)BOUILLON (Godefroi de) Godefroi de BOULOGNE (1061-1100) dit Godefroi de BOUILLON, fils d'Eustache II de BOULOGNE et d'Ide de LORRAINEBUFFON Georges-Louis LECLERC, comte de BUFFON (naturaliste, o Montbard (21) le 07.09.1797, Paris le 16.04.1788, créé comte de Buffin en 1773, fils de Benjamin Leclerc, conseiller au Parlement de Bourgogne).BUGEAUD Thomas-Robert BUGEAUD de LA PICONNERIE (maréchal de France, duc d'Isly, o Limoges (87) le 15.10.1784, Paris le 10.06.1849).BYRON George GORDON, Lord BYRON (poète anglais, o Londres, Holles street, le 22.01.1788, Missolonghi (Grèce) le 19.04.1824, fils du capitaine John Byron et de Catherine Gordon of Gight).CALONNE Charles-Alexandre de CALONNE (homme politique, o Douai (59) le 20.01.1734, Paris le 02.10.1802, fils d'un président à mortier au Parlement de Flandre).
CAMBACÉRÈS Jean-Jacques-Régis, duc de CAMBACÉRÈS (jurisconsulte et homme d'Etat, archichancelier de l'Empire, o Montpellier (34) le 20.10.1753, Paris le 08.03.1824)CAMPISTRON Jean GALBERT de CAMPISTRON (romancier et auteur dramatique, membre de l'Académie française, o Toulouse (31) le 03.08.1656, ibidem le 11.05.1723, victime d'une crise d'apoplexie).CANDOLLE Augustin-Pyrame de CANDOLLE (botaniste suisse, o Genève le 04.02.1778, ibidem le 09.09.1841).CASANOVA Jean Jacques CASANOVA de SEINGALT (pseudonyme de Casanova, aventurier italien, o Venise le 02.04.1725, Dux (Bohème) le 04.06.1798).CATINAT Nicolas de CATINAT de LA FAUCONNERIE (maréchal de France, o Paris le 01.09.1637, Saint-Gratien (95) le 22.02.1712, fils de Nicolas de Catinat, magistrat, et de Catherine Poille).CAULAINCOURT Armand-Augustin-Louis, marquis de CAULAINCOURT, duc de VICENCE (général et diplomate) (J.-M. Thiébaud, "Français et Suisses francophones en Russie et en URSS).CAVOUR Camille BENSO, comte de CAVOUR (homme d'Etat italien, o Turin le 10.08.1810, 06.06.1861).CAZALÈS Jacques-Antoine-Marie de CAZALÈS (officier de cavalerie puis homme politique, député aux Etats Généraux, émigré après le 10.08.1792, o Grenade-sur-Garonne (31) le 01.02.1758, Engalin (32) le 24.11.1805. Son fils Edmond de Cazalès est l'auteur d'études religieuses et philosophiques).CERVANTES Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (écrivain espagnol, o Alcalá de Henares le 29.09.1547, Madrid le 23.04.1616, fils de Rodrigo de Cervantes, chirurgien, et de Léonor de Cortinas).CHABANON Michel-Paul GUY de CHABANON (littérateur, membre de l'Académie Française (1780), o Saint-Domingue en 1730, Paris en juin ou juillet 1792).CHAPTAL Jean-Antoine CHAPTAL, comte de CHANTELOUP (né à Nojaret, commune de Badaroux (48) le 03.06.1756, à Paris dans la misère le 30.07.1832, chimiste puis ministre de l'Intérieur du 07.11.1800 au 08.08.1804)CHARETTE François-Athanase CHARETTE de LA CONTRIE (chef vendéen, o manoir de la Contrie à Couffé (44) le 02.05.1753, fusillé à Nantes (44) le 29.03.1796)CHE GUEVARA Ernesto Rafael GUEVARA DE LA SERNA, o Rosario (Argentine) le 14.06.1928, exécuté à La Higuera (Bolivie) le 08.10.1967, révolutionnaire marxiste, docteur en médecineCHÉNIER André-Marie de CHÉNIER (diplomate et poète, o Galata près de Constantinople le 30.10.1762, guillotiné à Paris le 7 thermidor an II (25.07.1794), fils de Louis de Chénier et d'Elisabeth Lomaca (1729-1808))CINQ-MARS Henri COIFFIER de RUZÉ, marquis de CINQ-MARS (o 27.03.1620, le 12.09.1642, favori et grand écuyer de Louis XIII, décapité après avoir comploté l'assassinat de Richelieu)CONDILLAC Etienne BONNOT de CONDILLAC (abbé de Mureau, philosophe, membre de l'Académie française (1768), o Grenoble (38) le 30.09.1715, Flux près de Beaugency (45) le 03.08.1780).CONDORCET Marie-Jean-Antoine-Nicolas de CARITAT, marquis de CONDORCET (philosophe, mathématicien et homme politique, député à la Convention, o Ribemont (02) le 17.09.1743, Bourg-la-Reine (92) dans la nuit du 28 au 29.03.1794, pendant sa première nuit de détention : suicide, empoisonnement, apoplexie, épuisement ?).CORDAY Marie-Anne-Charlotte CORDAY d'ARMONT (o la ferme de Ronceray aux Champeaux (61) le 27.07.1768,, guillotinée à Paris le 17.07.1793, fille de Jacques François de Corday d'Armont (arrière-petit-neveu de Pierre Corneille) et de Charlotte Gauthier des Authieux, jeune noble qui assassina Marat dans sa baignoire).CORMENIN Louis-Marie de LAHAYE, vicomte de CORMENIN (juriste, publiciste et homme politique, auditeur au Conseil d'Etat en 1810, o Paris le 06.01.1788, ibidem le 06.05.1868).CRÉBILLON Claude-Prosper JOLYOT de CRÉBILLON (auteur de contes licencieux, o Paris le 14.02.1707, ibidem le 12.04.1777, fils de Prosper Jolyot et de Marie Charlotte Péage).CRILLON Louis BALBIS de BERTON de CRILLON (homme de guerre français (o Murs (84) en 1543, Avignon (84) en 1615), surnommé "le brave Crillon").DUPLEIX Joseph-François, marquis de DUPLEIX (administrateur, directeur de comptoir aux Indes, gouverneur des ville et port de Pondichéry, commandeur de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, o Landrecies (59) le 01.01.1697, Paris le 11.11.1763, fils de François de Dupleix, contrôleur du Hainaut, et d'Anne Louise de Massac. Le 17.04.1741, il épousa Jeanne d'Albret, veuve).FABRE d'ÉGLANTINE (FABRE dit) Philippe François Nazaire (député de Paris à la Convention, guillotiné avec les dantonistes, o Carcassonne (11) le 28.12.1755, Paris le 16 germinal an II (05.04.1794), auteur de la célèbre chanson "Il pleut, il pleut, bergère ", fils d'un marchand drapier).FÉNELON François de SALIGNAC de LA MOTHE- FÉNELON (prélat et écrivain, o château de Fénelon (24) le 06.08.1651, Cambrai (59) le 07.01.1715, second enfant de Pons de Salignac, comte de La Mothe-Fénelon, et de sa seconde femme, Louise de La Cropte).FLERS Marie Joseph Louis Camille Robert PELLEVÉ de LA MOTTE-ANGO, marquis de FLERS (auteur dramatique, membre de l'Académie Française, président d'honneur de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, directeur littéraire du Figaro, commandeur de la Légion d'Honneur, domicilié à Paris (17e arrond.), 70, boulevard de Courcelles, o Pont-l'Evêque (14) le 25.11.1872, Grand Hôtel de l'établissement thermal de Vittel (88) le 30.07.1927), fils de Raoul Pellevé de La Motte-Ango, marquis de Flers, et de Marguerite de Rozières) (E.C. de Pont-l'Evêque et de Vittel).FLEURY André-Hercule de FLEURY (cardinal et homme d'Etat, premier ministre de 1726 à 1743, membre de l'Académie Française (1717), o Lodève (34) le 26.06.1653, Paris le 29.01.1743).FLORIAN Jean-Pierre CLARIS de FLORIAN (écrivain, fabuliste, membre de l'Académie Française (1788), o au château de Florian près de Sauve (30) le 06.03.1755, Sceaux (92) le 13.09.1794).FONTANES Jean Pierre Louis de FONTANES (littérateur et homme d'Etat, membre du Corps Législatif en 1803, admis à l'Académie Française en 1803, président du Corps Législatif en 1804, commandeur de la Légion d'Honneur, comte de l'Empire, sénateur, pair de France et grand cordon de la Légion d'Honneur (sous la Restauration), o Niort (79) le 06.03.1757, le 17.03.1821, inhumé au cimetière du Père Lachaise, fils de Marcellin Fontanes et de Jeanne de Sede, veuve Ferier. En 1792, il épousa Chantal Cathelin qui lui donna deux filles : 1) Imberthe (1793-1794) et Christine, o août 1801, 12.11.1873 sans postérité).FONTENELLE Bernard LE BOVIER de FONTENELLE (homme de lettres, membre de l'Académie Française, o Rouen (76) le 11.02.1657, 09.01.1757)FORBIN Claude, chevalier puis comte de FORBIN (marin, chef d'escadre, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, o Gardane (13) le 06.08.1656, au château de Saint-Marcel près de Marseille (13) le 04.03.1733)FOURCROY Antoine-François, comte de FOURCROY (chimiste et homme d'Etat, o Paris le 15.06.1755, ibidem le 16.12.1809, fils d'un apothicaire).FOURTOU Marie-François-César BARDY de FOURTOU (avocat et homme d'Etat).FREYCINET Charles-Louis de SAULCES de FREYCINET (ingénieur et homme politique, o Foix (09) le 14.11.1828, Paris le 14.05.1923).GALLIFET Gaston-Alexandre-Auguste, marquis de GALLIFET (général, ministre de la Guerre du 22.06.1899 au 20.05.1900, o Paris le 23.01.1830, ibidem le 24.07.1909).GASSION Jean de GASSION (maréchal de France, o Pau (64) le 20.08.1609, tué à Lens (62) le 02.10.1647).GOBINEAU Joseph-Arthur, comte de GOBINEAU (diplomate, littérateur et philosophe, o Ville d'Avray (92) le 14.07.1816, Turin (Italie) le 13.10.1882, chevalier de la Légion d'Honneur (1851), fils de Louis de Gobineau, capitaine d'infanterie, et d'Anne-Louise-Magdeleine de Gercy. Il épousa Clémence Monnerot qui lui donna une fille Diane, o Paris le 13.09.1848, laquelle épousa, le 08.04.1866, le baron Ove de Guldencrone, officier de la marine danoise).GOUVION-SAINT-CYR Laurent, marquis de GOUVION-SAINT-CYR (maréchal de France (1812), ministre de la Marine puis de la Guerre, o Toul (54) le 13.05.1764, Hyères (83) le 17.03.1830)GRÉCOURT Jean-Baptiste-Joseph WILLART de GRÉCOURT (poète, o Tours (37) en 1683, ibidem le 02.04.1743)GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste VAQUETTE de GRIBEAUVAL, général et ingénieur militaire, premier inspecteur de l'artillerie, o Amiens (80) le 15.09.1715, Paris le 09.05.1789)GROUCHY Emmanuel, marquis de GROUCHY (maréchal et pair de France, o Paris le 23.10.1766, Saint-Étienne (42) le 09.05.1847).GUICHEN Luc-Urbain DU BOUEXIC, comte de GUICHEN (marin, amiral, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (01.01.1784), o Fougères (35) le 21.01.1712, Morlaix (29) le 13.01.1790).JOINVILLE Jean de JOINVILLE (chroniqueur, o 1224, 24.12.1317, fils de Simon de Joinville et de Béatrice d'Auxonne).KEYSERLING Hermann, comte de KEYSERLING (philosophe et littérateur allemand, o Kvönno (Livonie) le 20.07.1880, Innsbrück (Autriche) le 26.04.1946).KITCHENER Lord Horatio-Herbert, comte KITCHENER de KHARTOUM (field-marshall anglais, commandant en chef lors de la guerre des Boers, o Bally Longford (comté de Kerry, G.-B.) en 1850, en 1916 sur le HMS Hampshire, coulé par une mine, alors qu'il se rendait en mission en Russie).KLEIST Heinrich von KLEIST (poète, journaliste et auteur dramatique allemand, o Frankfurt am Oder le 18.10.1786, fils de Joachim Friedrich von Kleist, officier, et de sa seconde femme, Ulrike. Il fut enfermé au château de Joux sous l'accusation d'espionnage. Il se suicida avec Henriette Vogel, sa maîtresse malade, au bord du lac de Wannsee, près de Potsdam, le 21.11.1811 à 4 heures de l'après-midi).KOCK Charles-Paul de KOCK (romancier et auteur dramatique, o Passy (Paris) le 21.05.1793, Paris le 27.04.1871, fils posthume d'un banquier hollandais mort en 1793 sur l'échafaud).LABOULAYE-MARILLAC Pierre-Charles-Madeleine LEFEBVRE deLABOULAYE-MARILLAC (chimiste, membre de l'Académie des Sciences (1813-1886))LA BOURDONNAIS Bertrand-François MAHÉ, comte de LA BOURDONNAIS (marin au service de la Compagnie des Indes, o Saint-Malo (35) le 11.02.1699, Paris le 10.11.1753).LA BRUYÉRE Jean de LA BRUYÈRE (moraliste, auteur des "Caractères", o Paris le 17.08.1645 (baptisé en l'église Saint-Christophe), Versailles (78) le 10.05.1696, fils aîné de Louis de La Bruyère, contrôleur général des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, et d'Elisabeth Hamonyn).LA CALPRENÈDE Gauthier de COSTES de LA CALPRENÈDE (romancier et dramaturge, o Salignac (24) en 1609, aux Andelys (27) le 22.10.1663)LACAZE-DUTHIERS Félix-Joseph-Henri de LACAZE-DUTHIERS (naturaliste, anatomiste et physiologiste, membre (1871) puis président (1893) de l'Académie des Sciences, o Montpezat (47) le 15.05.1821, Les Fons le 21.07.1901)LACÉPÈDE Bernard-Germain-Étienne de LA VILLE-SUR-ILLON, comte de LACÉPÈDE (naturaliste et écrivain, grand officier de la Légion d'Honneur, ministre, président du Sénat, o Agen (47) le 26.12.1756, Épinay-sur-Seine (93) dans la nuit du 05 au 06.10.1825, fils de Jean Joseph Médard de La Ville de Lacépède, lieutenant général de la sénéchaussée).LA CHAISE François d'AIX de LA CHAISE (jésuite, confesseur de Louis XIV, plus connu sous le nom de Père Lachaise, o Aix-la-Fayette (63) le 25.08.1624, Paris le 20.01.1709, fils de Georges d'Aix, seigneur de La Chaise, et de Renée de Rochefort).LA CHALOTAIS Louis-René de CARADEUC de LA CHALOTAIS (avocat général au Parlement de Bretagne puis procureur général, exilé, o Rennes (35) le 06.03.1701, ibidem le 12.07.1785).LA CHAUSSÉE Pierre-Claude NIVELLE de LA CHAUSSÉE (auteur dramatique, membre de l'Académie Française (1736), o Paris le 14.02.1692, ibidem le 14.03.1754).LA CHESNAYE-DESBOIS François-Alexandre AUBERT de LA CHESNAYE-DESBOIS (héraldiste et généalogiste (1699-1784))LA CHÉTARDIE Jacques-Joachim TROTTI, marquis de LA CHÉTARDIE (ambassadeur en Russie, o 03.10.1705, Hanau (Hesse-Kassel, Allemagne) le 01.01.1759) (J.-M. Thiébaud, "Français et Suisses francophones en Russie et en URSS" ; "Les ambassadeurs et représentants de la France en Russie et en URSS").LA CRESSONNIÈRE Louis-Charles-Adrien LESOT de LA PENNETERIE dit LA CRESSONNIÈRE (acteur).LACRETELLE Jean-Charles-Dominique de LACRETELLE (historien et publiciste, membre de l'Académie Française, o Metz (57) le 03.09.1766, Mâcon (71) le 26.03.1855).LACROIX Jean-François de LACROIX (écrivain, compilateur de la seconde moitié du 18e s.).LA CROPTE François DAILLON de LA CROPTE (capitaine tué à Ravenne en 1512)LACROSSE Jean-Baptiste-Raymond, baron de LACROSSE (marin, contre-amiral, o Meilhan (40) le 05.09.1760, ibidem le 09.09.1829).LADMIRAULT Louis-René-Paul de LADMIRAULT (général de division (14.01.1853), sous-gouverneur de l'Algérie, gouverneur de Paris, vice-président du Sénat, grand-croix de la Légion d'Honneur (1867), médaillé militaire (18.06.1871), o Montmorillon (86) le 17.02.1808, 1898).LA FAYETTE Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert MOTIER, marquis de LA FAYETTE (général, héros de l'indépendance américaine, o Chavaniac (devenu Chavaniac-Lafayette) (43) le 06.09.1757, Paris le 20.05.1834).LA FAYETTE (Madame de) Marie-Madeleine PIOCHE de LA VERGNE, comtesse de LA FAYETTE (femme de lettres, auteur de "La Princesse de Clèves", o Paris le 16.03.1634, le 26.05.1693, fille de Marc Pioche de la Vergne, écuyer du Roi)LA FOLLIE Louis-Guillaume de LA FOLLIE (chimiste et écrivain (1739-1780))LA FOUCHARDIÈRE Georges de LA FOUCHARDIÈRE (de son vrai nom DELAFOUCHARDIÈRE, littérateur et journaliste, o Châtellerault (86) en 1874, Saint-Brieuc (22) en 1946)LAGAILLE Abbé Nicolas-Louis de LAGAILLE (astronome)LA GARAYE Claude-Toussaint MAROT, comte de LA GARAYE (chimiste et philanthrope, né à Rennes (35) le 30.10.1675, baptisé en l'église Saint-Germain, le 02.07.1755, fils de Guillaume Marot de La Garaye et de Jeanne Françoise de Marbeuf. En 1701, il épousa Marguerite de La Motte-Piquet).LA GARDE Philippe BRIDARD de LA GARDE (1710-1767) (littérateur)LAGARDE Augustin-Marie-Balthazar-Charles (alias Auguste Balthazar Charles) PELLETIER, comte de LAGARDE (général et diplomate. En 1825, il épousa Marie Elisabeth Urbaine Antoinette Henriette de Beaumont).LA GARDE-ADHÉMAR Antoine-Escalin des AYMARS, baron de LA GARDE-ADHÉMAR (marin surnommé "Le Polin")LA GRANGE Dom Antoine RIVET de LA GRANGE (historien et bénédictin, né à Confolens (16) le 30.10.1683, à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans le 07.02.1749)LA GRANGE Adélaïde-Blaise-François LE LIÈVRE, marquis de FOURILLES et de LA GRANGE (général de division le 29.06.1809, baron de l'Empire le 13.02.1811, né à Paris le 21.12.1766, le 02.07.1833)LAGRENÉ Théodore-Marie-Melchior Joseph de LAGRENÉ (diplomate,représentant de la France en Chine) (J.-M. Thiébaud, "La Présence française en Corée")LA GUÉRONNIÈRE Louis-Etienne-Arthur DUBREUIL-HÉLION, vicomte de LA GUÉRONNIÈRE (1816-1875) (publiciste et homme politique)LA GUETTE Catherine de MEURDRAC de LA GUETTE (née en 1613, v. 1680, personnage de la Fronde)LA HALLE Adam de LA HALLE dit aussi Adam le Bossu (poète, né v. 1245, v. 1288)LA HAYE Jacob BLANQUET, chevalier de LA HAYE (soldat et marin qui prit possession de l'île Bourbon, vice-roi des Indes, gouverneur de Madagascar du 04.12.1670 au 26.06.1671)LA HIRE Philippe de LA HIRE (mathématicien, physicien et astronome, né àParis le 18.03.1640, ibidem le 21.04.1718, fils de Laurent de La Hire (1606-1656), artiste)LA HITTE Jean-Ernest DUCOS, vicomte de LA HITTE (1789-1878) (général et homme politique, ministre des Affaires étrangères du 17.11.1849 au 09.01.1851)LA HONTAN Louis-Armand de LOM d'ARCE, baron de LA HONTAN (voyageur et écrivain, né en juin 1666, en 1715, cité dans "Le Baron Perché" d'Italo Calvino)LA JONQUIÈRE Pierre-Jacques de TAFFANEL, marquis de LA JONQUIÈRE (1685-1752) (marin, gouverneur de la Nouvelle France de 1749 à 1752)LALANDE Joseph-Jérôme LE FRANÇOIS de LALANDE (astronome, auteur de l'histoire de la comète de Halley, né à Bourg-en-Bresse (01) le 11.07.1732, à Paris le 04.04.1807)LALIVE de JULLY Ange-Laurent de LALIVE de JULLY, baron du CHÂTELET, marquis de RENOUVILLE (peintre, graveur, diplomate, introducteur des ambassadeurs, né à Paris le 12.10.1725, ibidem le 18.03.1779)LA LANDELLE Guillaume-Joseph-Gabriel de LA LANDELLE (né à Montpellier (34) en 1812, à Paris en 1886)LAMARCK Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de MONET, chevalier de LAMARCK (naturaliste, né à Bazentin (80) le 01.08.1744, à Paris le 28.12.1829)LA MARE Nicolas de LA MARE (magistrat, né à Noisy-le-Grand (93) en 1639, à Paris en 1723)LAMARQUE François, chevalier de LAMARQUE (1753-1839) (avocat, député àl'Assemblée Législative puis à la Convention, président du Conseil des Cinq-Cents en 1797)LA MARTINIÈRE Antoine-Augustin BRUZEN de LA MARTINIÈRE (littérateur, né à Dieppe en 1683, à La Haye en 1743)LAMARZELLE Gustave-Louis-Edouard de LAMARZELLE (homme politique, né à Vannes (56) en 1852, à Paris en 1929)LA MAZELIÈRE Antoine-Camille-Louis-Victor ROUS, marquis de LA MAZELIÈRE (voyageur et écrivain né à Paris en 1864)LA LAURENCIE Lionel de LA LAURENCIE (1861-1933) (musicographe, auteur d'une biographie de Lully)LA MAISONFORT Louis DUBOIS-DESCOURS, marquis de LA MAISONFORT (1763-1827) (général et écrivain)LAMARCK Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de MONET, chevalier de LAMARCK (naturaliste, né à Bazentin (80) le 01.08.1744, le 28.12.1829)LAMARTINE Alphonse-Marie-Louis de PRAT de LAMARTINE (poète et homme politique, né à Mâcon (71) le 21.10.1790, à Paris le 28.02.1869)LA MEILLERAYE Charles de LA PORTE, duc de LA MEILLERAYE (maréchal de France, né à Paris en 1602, ibidem le 08.02.1664)LAMENNAIS Félicité Robert de LAMENNAIS (théologien, né à Saint-Malo (35) le 19.07.1782, à Paris le 27.02.1854)LAMERVILLE Jean-Marie, vicomte d'HEURTAULT de LAMERVILLE (agronome, député de la noblesse aux Etats généraux de 1789, président du Conseil des Cinq-Cents en 1799, né à Rouen en 1740, à La Périsse (18) en 1810) (M. Talin d'Eyzac, "Jean Marie Heurtault de Lamerville, un physiocrate en Berry",dans les Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du Berry, n° 110, juin 1992, p. 17 - 24).LA MÉSANGÈRE Pierre-Antoine LEBOUX de LA MÉSANGÈRE (polygraphe, né à Pontigné (49) en 1761, à Paris en 1831)LA MESNARDIÈRE Hippolyte-Jules PILET de LA MESNARDIÈRE, médecin, poète et critique, né à Le Loroux-Bottereau (44) en 1610, à Paris le 04.06.1663)LA METTRIE Julien OFFROY de LA METTRIE (médecin et philosophe, né à Saint-Malo (35) le 25.12.1709, à Berlin (Prusse) le 11.11.1751).LA MILLETIÈRE Théophile BRACHET de LA MILLETIÈRE (controversiste, né à Paris en 1596, à Paris en 1665).LAMOIGNON François-Chrétien de LAMOIGNON (président à mortier au Parlement de Paris, né à Paris en 1644, ibidem en 1709, fils de Guillaume (I) de Lamoignon).LAMOIGNON Guillaume (I) de LAMOIGNON (premier président au Parlement de Paris en 1658, né à Paris en 1617, ibidem en 1677).LAMOIGNON Guillaume (II) de LAMOIGNON, seigneur de Blancmesnil et de Malesherbes (chancelier de France du 10.12.1750 au 14.09.1768, né à Paris en 1683, ibidem en 1772, inhumé le 13.07.1772, second fils de François-Chrétien de Lamoignon).LAMORICIÈRE Louis-Christophe-Léon (alias Christophe-Léon-Louis) JUCHAULT de LAMORICIÈRE (général et homme politique, né à Nantes (44) le 05.09.1806, au château de Prouzel, près d'Amiens (80), le 11.09.1865).LA MORLIÈRE Charles Jacques Louis Auguste ROCHETTE, chevalier de LA MORLIÈRE (littérateur, aventurier et libertin, né à Grenoble (38) le 22.04.1719, à Paris en 1785).LA MORVONNAIS Hippolyte MICHEL de LA MORVONNAIS (poète, né à Saint-Malo (35) le 11.03.1802, à Pleudihen-sur-Rance (22) le 04.07.1853 après avoir fait construire l'église de Notre-Dame de l'Arguenon où il repose aux côtés de sa femme et cousine, Marie Macé de la Villéon, au Val le 23.01.1835).LAMOTHE Pierre LAMBERT de LAMOTHE (évêque missionnaire, prêtre de la Société des Missions étrangères de Paris, né à Bucherie (14) le 16.01.1624, au Siam le 15.06.1679)LA MOTTE Emmanuel-Auguste de CAHIDEUC, comte du BOIS de LA MOTTE (marin, né à Rennes (25) en 1683, baptisé le 01.04.1684, ibidem le 23.10.1764, inhumé dans l'église de Sainte-Colombe, gouverneur de Saint-Domingue, vice-amiral du Ponant en 1762, lieutenant-général, décoré de la grand-croix de l'Ordre de Saint-Louis le 04.07.1761)LA MOTTE-PICQUET Toussaint-Guillaume, comte de LA MOTTE-PICQUET (marin, lieutenant-général des armées navales, né à Rennes (35) le 01.11.1720, à Brest (29) le 10.06.1791)LANESSAN Jean-Marie-Antoine de LANESSAN (médecin, naturaliste, homme politique, ministre de la Marine, né à Saint-André-de-Cubzac (33) le 13.07.1843, à Écouen (95) le 07.11.1919)LA PALICE Jacques de CHABANNES, seigneur de LA PALICE (capitaine français né vers 1470, à Pavie le 24.02.1525).LA PEYRÈRE Isaac de LA PEYRÈRE (littérateur, ambassadeur de France au Danemark, né à Bordeaux (33) en 1596, en 1676)LA PEYRONIE François GIGOT de LA PEYRONIE (chirurgien, né à Montpellier (34) le 15.01.1678, à Versailles (78) le 25.04.1747, premier chirurgien de Louis XV qui l'anoblit. La maladie de la Peyronie est une induration plastique des corps caverneux).LAPLACE Pierre-Simon, marquis de LAPLACE (mathématicien, physicien et astronome, né à Beaumont-en-Auge (14) le 23.03.1749, à Paris le 05.03.1827).LA QUINTINIE Jean Baptiste (dit Jean) de LA QUINTINIE (agronome, né à Chabanais (16) le 01.03.1626, à Versailles le 11.11.1688, anobli le 25.08.1687).LA ROCHEJAQUELEIN Henri du VERGIER, comte de LA ROCHEJAQUELEIN (chef Chouan, né au château de la Durbelière à Saint-Aubin de Baubigné près de Mauléon (79) le 30.08.1772, tué à Nuaillé le 28.01.1794, inhumé dans l'église de Saint-Aubin de Baubigné).LASTEYRIE du SAILLANT Charles Philibert, comte de LASTEYRIE du SAILLANT (publiciste, né à Brive-la-Gaillarde (19) le 02.11.1759, à Paris le 03.11.1849, fils de Charles de Lasteyrie, chevalier, dit le vicomte du Saillant, seigneur de La Vergne, capitaine de dragons, et d'Elisabeth Bodineau de Meslay. Il épousa Marie de Lasteyrie du Saillant).LASTEYRIE du SAILLANT Ferdinand-Charles-Léon, comte de LASTEYRIE du SAILLANT (ingénieur des Ponts et Chaussées, archéologue et homme politique, né à Paris Le 15.06.1810, ibidem le 12.05.1879, fils de Charles Philibert cité ci-dessus. Il épousa Mademoiselle Seabrock).LASTEYRIE du SAILLANT Robert-Charles, comte de LASTEYRIE du SAILLANT (archéologue, né à Paris le 15.11.1849, au château du Saillant d'Allassac (19) en 1921, fils de Ferdinand cité ci-dessus).LASTEYRIE du SAILLANT Charles de LASTEYRIE du SAILLANT (diplômé de l'Ecole des Chartes, financier et homme politique, né à Paris le 27.04.1877, ibidem le 26.01.1936, fils de Robert cité ci-dessus).LA TAILHÈDE Raymond-Pierre-Joseph GAGNABÉ de LA TAILHÈDE (poète, né à Moissac (82) en 1867, à Montpellier (34) en 1938). Arm. : d'argent à un trèfle d'azur accompagné de trois curs de sable.LA THORILLIÈRE François LE NOIR de LA THORILLIÈRE (1626-1680) (acteur et auteur).LA THORILLIÈRE Pierre LE NOIR de LA THORILLIÈRE (1659-1731) (acteur, fils aîné de François, cité ci-dessus).LAUDERDALE John (dit parfois James) MAITLAND, 8e comte de LAUDERDALE (économiste et homme politique anglais (membre du Parlement dès 1780 puis de la Chambre des Lords à la mort de son père), né près de Ratho (Midlothian) le 26.01.1759, château de Thirlestane (comté de Berwick) le 15.09.1839, inhumé dans la crypte l'église St-Mary de Haddington. Le 15.08.1782, à Walthamstow (Essex), il épousa Eleanor Todd, o 05.08.1762, château de Thirlestane le 16.09.1856 et fut l'arrière-grand-père du Premier Ministre Arthur Balfour (1848-1930)).LAUTREC Odet de FOIX, vicomte de LAUTREC (né en 1485, à Naples le 15.08.1528, fils aîné de Jean de Foix, vicomte de Lautrec et Villemur, et de Jeanne d'Aydie de Lescun, maréchal de France (01.03.1511), chevalier de Saint-Michel. Il épousa Charlotte d'Albret, 3e fille de Jean d'Albret, sire d'Orval, et de Charlotte de Bourgogne, comtesse de Nevers et de Rethel).LAUZUN Antonin-Nompar de CAUMONT, duc de LAUZUN (né à Lauzun (47) en 1633, en 1723, maréchal de France, créé duc en 1692, mari de Geneviève de Durfort).LA VALLIÈRE Françoise-Louise de LA BAUME LE BLANC, duchesse de LA VALLIÈRE (née à Tours (37) le 06.08.1644, au monastère des Dames de la Visitation de Paris le 06.06.1710, favorite de Louis XIV depuis l'âge de 17 ans).LAVARDIN Jean de BEAUMANOIR, seigneur puis marquis (04.07.1601) de LAVARDIN (maréchal de France (19.10.1595), né en 1551, à Paris en novembre 1614, fils de Charles de Beaumanoir, seigneur de Lavardin, tué en 1572 lors de la Saint-Barthélemy, et de Marguerite, fille de Félix de Chourses, seigneur de Malicorne. Le 27.12.1578, il épousa Catherine de Charmain, comtesse de Négrepelisse et baronne de Launac, fille de Louis de Charmain).LAVARDIN Charles Henri de BEAUMANOIR, marquis de LAVARDIN (lieutenant général, né en 1644, à Paris le 29.07.1701, fils de Henri II, marquis de Lavardin et comte de Beaufort, maréchal de camp, et de sa seconde épouse, Marguerite, fille de Charles, marquis de Rostaing. Il fut excommunié pour ses brutalités à Rome lors de l'affaire des franchises. Il épousa 1) le 03.02.1667, Françoise de Luynes, 1670, fille de Louis, duc de Luynes ; 2) le 01.06.1680, Louise, fille d'Anne, duc de Noailles).LAVEAUX Jean-Charles THIBAULT de LAVEAUX (humaniste et lexicographe, né à Troyes (10) le 17.11.1749, à Paris le 15.03.1827).LA VILLEBOISNET Henri ESPIVENT de LA VILLEBOISNET (général et homme politique, né à Londres en 1813, à Paris en 1908).LA VILLEHERVÉ Robert LE MINIHY de LA VILLEHERVÉ (littérateur, o Ingouville (76) le 15.11.1849, Le Havre (76) le 14.08.1919, fils d'Adolphe Le Minihy de La Villehervé et de Marie Victoire Lemonnier).LA VILLEMARQUÉ Théodore-Claude-Henri HERSART, vicomte de LA VILLEMARQUÉ (érudit, élève de l'Ecole des Chartes, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, o Quimperlé (29) le 07.07.1815, au château de Keransker-en-Nézou près de Quimperlé le 08.12.1895). LA VRILLIÈRE Louis PHÉLYPEAUX, comte de SAINT-FLORENTIN, marquis de CHÂTEAUNEUF et de LA VRILLIÈRE (homme d'Etat, o 1672, à Paris en 1725, fils de Balthazar Phélypeaux, secrétaire d'Etat chargé de la R.P.R. (religion prétendue réformée), auquel il succéda du 07.11.1715 à 1718. En 1700, il épouse Françoise de Mailly-Nesle).LAW John LAW de LAURISTON (banquier et économiste, né à Edimbourg le 21.04.1671, à Venise le 21.03.1729).LE PAYS René LE PAYS, sieur du PLESSY-VILLENEUVE (poète, o Fougères (35) en 1636, Paris en 1690).LEPELLETIER Edmond-Adolphe de BOUHÉLIER-LEPELLETIER (littérateur, o Paris en 1846, Vittel (88) en 1918)LESDIGUIÈRES François de BONNE, duc de LESDIGUIÈRES (maréchal et connétable de France, o Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) le 01.04.1543, Valence (26) le 28.091626, fils de Jean de Bonne et de Françoise de Castellane).LE SÉNÉCHAL de KERDRÉORET Gustave Édouard LE SÉNÉCHAL de KERDRÉORET (peintre officiel de la Marine dès 1890, o Hennebont (56) en 1840, 1920).LEZAY-MARNÉSIA Charlotte-Antoinette de BRESSEY, marquise de LEZAY-MARNÉSIA (femme de lettres, o v. 1705, château de Condé-sur-Risle (27) en 1785, épouse de François Gabriel, marquis de Lezay-Marnésia, o 22.02.1699, fils de Claude Hubert de Lezay-Marnésia et de Claude Françoise de Poligny) (J.-M. Thiébaud, "Les Députés des Villes et Villages de Franche-Comté en 1789", p. 79).L'HÔPITAL Guillaume-François-Antoine de L'HÔPITAL, marquis de SAINT-MESME et comte d'AUTREMONT (géomètre, membre de l'Académie des Sciences, o Paris en 1661, ibidem le 02.02.1704, fils d'un officier).LIBERTAT Pierre de BAYON de LIBERTAT (patriote d'origine corse qui libéra la ville de Marseille de la tyrannie de Cazeaux, o v. 1550, Marseille (13) en 1597. Henri IV l'anoblit avec ses deux frères en 1596, le nomma viguier perpétuel de Marseille et lui permit de porter trois fleurs de lis d'or dans ses armoiries qui sont : coupé : au 1, d'azur à la tour d'argent accompagnée de trois fleurs de lis d'or ; au 2, de gueules au lion léopardé d'or).LIEBIG Justus, baron de LIEBIG (chimiste et éducateur allemand, né à Darmstadt le 12.05.1803, à Munich le 18.04.1873, professeur à l'Université de Munich de 1852 à 1873)LINDENAU Bernhard-Augustus, Freiherr (baron) von (de) LINDENAU (docteur en droit et astronome allemand, o Altenburg le 11.06.1780, ibidem le 21.05.1854, fils d'un conseiller à la Cour d'Appel de Dresde).LINDSAY Alexandre LINDSAY, 23e comte de CRAWFORD et 6e comte de BALCARRES (général anglais originaire d'Ecosse, o 18.01.1752, 27.03.1825, commandant de l'île de Jersey (1793) puis de l'île de la Jamaïque où il se réprima cruellement une révolte de nègres marrons, fils de James Linsay, 5e comte de Balcarres) (Larousse du XXe siècle, t. IV, p. 465 ; notes généalogiques de l'auteur).LINNÉ Carl LINNAEUS (Carl von LINNE après son anoblissement), Charles de LINNÉ en français (naturaliste et médecin suédois, né à Rashult le 23.05.1707, à Uppsala le 10.01.1778).LINOIS Charles-Alexandre-Léon DURAND, comte de LINOIS (marin, amiral, gouverneur de la Guadeloupe, vainqueur des Britanniques à la bataille d'Algésiras, o Brest (29) le 27.01.1761, Versailles (78) le 02.12.1848)LISFRANC Jacques LISFRANC de SAINT-MARTIN (chirurgien, membre de l'Académie royale de Médecine, o Saint-Paul-en-Jarrez (42) le 18.04.1787, Paris le 13.05.1847, fils de Pierre Lisfranc de Saint-Martin et de Charlotte de La Roue).LISLE Georges-Constant LE BOURGUIGNON du PERRÉ de LISLE, o Caen (14) en 1711, Villons-les-Buissons en 1853).LONGUEMAR Alphonse-Pierre-François LE TOUZÉ de LONGUEMAR (archéologue, officier d'état-major, général, membre de la Société géologique de France, o Saint-Dizier (52) le 03.10.1803, Poitiers (86) le 22.02.1881).LOUVOIS François-Michel LE TELLIER, sieur de CHÂVILLE puis marquis de LOUVOIS (homme d'Etat, secrétaire d'Etat à la guerre (succédant à son père), o Paris le 18.01.1641, subitement à Versailles (78) le 16.07.1691, fils du chancelier Michel Le Tellier, membre du Conseil du Roi, secrétaire d'Etat à la guerre, o en 1603, en 1685).LUXEMBOURG François-Henri de MONTMORENCY-BOUTEVILLE, duc de PINEY-LUXEMBOURG, maréchal de France, surnommé (par le prince de Conti) "le tapissier de Notre-Dame" en raison des nombreux drapeaux pris à l'ennemi et accrochés sous la voûte de la cathédrale de Paris, o Paris le 08.01.1628, Versailles (78) le 04.01.1695, fils posthume du comte de Bouteville, décapité en 1627 pour s'être battu en duel avec François d'Harcourt, place royale et en plein jour. François-Henri de Bouteville épousa Madeleine de Clermont-Tonnerre, fille de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre et de Marguerite-Charlotte de Luxembourg, fille et héritière d'Henri, 2e duc de Luxembourg et de Madeleine de Montmorency-Thoré).MABLY Gabriel BONNOT de MABLY (philosophe, o Grenoble (38) le 14.03.1709, Paris le 02.04.1785)MAC-MAHON Edme Patrice, comte de MAC-MAHON, duc de MAGENTA, o Sully (71) en 1808, château de La Forêt (45) en 1893, maréchal de France, président de la République.MAINTENON Françoise d'AUBIGNÉ, marquise de MAINTENON (seconde épouse (secrète) de louis XIV, o prison de Niort (79) le 27.11.1635, Saint-Cyr (78) le 15.04.1719, fille de Constant Agrippa d'Aubigné, fils du célèbre capitaine et poète protestant, Agrippa d'Aubigné (1552-1630)).MALEBRANCHE Nicolas de MALEBRANCHE (philosophe, o Paris le 06.08.1638, ibidem le 13.10.1715, ordonné prêtre en 1664, fils d'un secrétaire du Roi).MALESHERBES Chrétien-Guillaume de LAMOIGNON de MALESHERBES (juriste, homme politique et écrivain, membre de l'Académie des Sciences puis de l'Académie française, o Paris le 06.12.1721, guillotiné avec sa fille à Paris le 22.04.1794, fils du chancelier Guillaume de Lamoignon).MARIVAUX Pierre CARLET de CHAMBLAIN de MARIVAUX (auteur dramatique et romancier, né à Paris le 04.02.1688, ibidem le 12.02.1763, fils de Nicolas Carlet et de Marie Bullet. Il prit le nom de Marivaux en 1717 et épousa la même année Colombe Bologne, originaire de Sens (89), fille d'un avocat et riche d'une dot de 40 000 livres).MARMONT Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de MARMONT, duc de RAGUSE (maréchal de France, o Châtillon-sur-Seine (21) le 20.07.1774, Venise (Italie) le 22.03.1852).MARNI Jeanne Manoel de GRANDFORT dite Jeanne MARNI (auteur dramatique et romancière, o Toulouse (31) en 1854, Cannes (06) en 1910).MARNIX Philippe de MARNIX, baron de SAINTE-ALDEGONDE (militaire, littérateur, poète et diplomate, o Bruxelles en 1538, Leyde le 15.12.1598).MARSY Claude-Sixte SAUTEREAU de MARSY (littérateur et publiciste, o Paris en 1740, ibidem en 1815).MARTIGNAC Jean-Baptiste-Sylvère GAY, vicomte de MARTIGNAC (homme politique, o Bordeaux (33) le 20.06.1778, Paris le 03.04.1832).MAS-LATRIE Jacques-Marie-Joseph-Louis, comte de MAS-LATRIE (historien, ancien élève de l'Ecole des Chartes, chevalier de la Légion d'Honneur, o Castelnaudary (11) le 09.04.1815, Paris en 1897).MIRABEAU Honoré-Gabriel-Victor RIQUETI, comte de MIRABEAU (orateur et homme politique, o Le Bignon (aujourd'hui Le Bignon Mirabeau) (45) le 09.03.1749, Paris le 02.04.1791).MOLEVILLE Bernard de MOLEVILLE (ministre de Louis XVI, inventeur du Sécateur en 1810).MOLINARI Gustave de MOLINARI (économiste, o Liège le 03.03.1819, Andikerque le 28.01.1912, fils du baron de Molinari, officier des armées napoléoniennes puis médecin installé à Liège).MONTALEMBERT Charles FORBES, comte de MONTALEMBERT (publiciste et homme politique).MONTAIGNE Michel EYQUEM de MONTAIGNE (écrivain et philosophe, o château de Saint-Michel de Montaigne (24) le 28.02.1533, ibidem le 13.09.1592, fils de Pierre Eyquem de Montaigne (1496-1568) et d'Antoinette Louppes, descendante des Lopez, juifs d'origine espagnole).MONTESQUIEU Charles de SECONDAT, baron de Brède et de MONTESQUIEU (philosophe, o La Brède (33) le 18.01.1689, Paris le 10.02.1755, second fils de Jacques de Secondat de Montesquieu (1654-1713) et de Marie Françoise de Pesnel, baronne de La Brède (1665-1696). En 1715, il épousa Jeanne de Lartigue).MONTCALM Louis Joseph, marquis de MONTCALM, seigneur de Saint-Véran, Candiac, Tournemine, Vestric, Saint-Julien et Arpaon, baron de Gabriac (grand nom de l'histoire coloniale française au Canada, o château de Candiac près de Nîmes (30) le 14.09.1712, Québec le 14.09.1759, fils de Louis Daniel de Montcalm et de Marie-Thérèse-Charlotte de Lauris de Castellane).MONTESPAN Françoise-Athénaïs de ROCHECHOUART, marquise de MONTESPAN, o château de Tonnay-Charente (17) le 05.10.1641, Bourbon-L'Archambault (03) le 27.05.1707, seconde fille de Gabriel de ROCHECHOUART, premier duc de MORTEMART. En février 1663, elle épousa Louis de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan (qui lui donna une fille (Marie-Christine de Gondrin de Montespan), puis maîtresse de Louis XIV qui lui donna plusieurs enfants, tous reconnus par le souverain).MONTGAILLARD Maurice-Jacques ROQUES, connu sous le nom de comte de MONTGAILLARD (titre usurpé vers 1794, à une époque où l'on ne battait guère pour les ramasser), aventurier politique, agent secret et espion politique sous Napoléon 1er, o Montgaillard-Lauragais près de Toulouse (31) le 16.11.1761, Chaillot le 08.02.1841).MONTLUC Blaise de LASSERAN-MASSENCOME, seigneur de MONTLUC (capitaine et écrivain, maréchal de France sous quatre rois, o Saint-Gemme (32) en 1501 ou 1502, château d'Estillac (Agenais) le 26.07.1577).MONTROSE James GRAHAM, 5e comte puis 1er marquis (1644) de MONTROSE (général royaliste écossais, o Montrose en octobre1612, (pendu) Edimbourg le 21.05.1650).MONTYON Jean-Baptiste-Antoine (alias Antoine Jean Baptiste Robert AUGET, baron de MONTYON (juriste, philanthrope et économiste, o Paris le 23.12.1733, ibidem le 29.12.1820, fils d'un maître des comptes).MORATIN Nicolas-Fernandez de MORATIN (écrivain et poète dramatique espagnol, o Madrid le 20.07.1737, ibidem le 14.05.1780).MOTTEVILLE Françoise BERTAUT, dame LANGLOIS de MOTTEVILLE (mémorialiste, o v. 1621, 29.12.1689). Elle épousa Nicolas Langlois de Motteville, premier président de la Chambre des Comptes de Normandie.NÉGRIER François-Oscar de NÉGRIER (général de division (1887), membre du Conseil Supérieur de la Guerre (1895-1904), grand-croix de la Légion d'Honneur, médaillé militaire, o Belfort (90) le 02.10.1839, sur les côtes de Norvège en 1913, héros de la guerre de 1870-1871).NEPER (ou NAPIER) Jean NEPER (ou NAPIER), baron de MERCHISTON (théologien et mathématicien écossais, inventeur des logarithmes, o château de Merchiston près d'Edimbourg en 1550, ibidem le 04.04.1617).NESLE (de) v. VINTIMILLE (de)NEUVILLE Alphonse Marie de NEUVILLE (peintre de scènes de bataille, o Saint-Omer (62) le 31.05.1836, Paris le 20.05.1885, inhumé au cimetière de Montmartre. On a donné son nom à une rue du 17e arrondissement de Paris).NEWCASTLE William CAVENDISH, duc de NEWCASTLE (général, o 1592, Londres le 25.12.1676, fils de sir Charles Cavendish et de Catherine Ogle. Il fut créé duc en 1665).NIVERNAIS) Louis-Jules MANCINI MARAZINI, duc de NIVERNAIS (ou de NIVERNOIS), militaire, ambassadeur et hommes de lettres, membre de l'Académie Française (élu en 1742), o Paris en 1716, ibidem en 1798. En 1731, il épousa Mademoiselle de Pontchartrain devenant ainsi le beau-frère de Maurepas).NOLHAC Anet-Marie-Pierre GIRAULD de NOLHAC (poète, historien et érudit, o Ambert (63) le 15.12.1859, Paris le 30.01.1936).O'DONNELL Léopold O'DONNELL, comte de LUCENA, duc de TÉTUAN (général et homme d'Etat espagnol, ministre de la Guerre, président du Conseil, recevant le titre de duc de Tétuan après la prise de cette ville marocaine en 1859, o Sainte-Croix-de-Ténériffe en 1809, Bayonne (64) en 1867), fils du général Joseph-Henri O'Donnell, comte de la Bisbal, o Andalousie en 1769, Montpellier (34) en 1884).OLIVARES Gaspar de GUZMÁN Y PIMENTEL, comte d'OLIVARES, duc de SANLUCAR LA MAYOR (créé duc de SANLUCAR DA LUCIA par le roi Philippe IV d'Espagne mais souvent appelé comte-duc d'OLIVARES) (homme d'Etat espagnol, o Rome (où son père était ambassadeur) le 06.01.1587, Toro le 22.07.1645, fils d'Enrique de Guzmán, comte d'Olivares, général (1502-1562)).OLIVET Pierre-Joseph THOULLIER, abbé d'OLIVET (grammairien, membre de l'Académie Française (1723), o Salins (39) le 01.04.1682, Paris en 1768. Une école de Salins porte le nom de celui qui eut Voltaire pour élève. L'abbé d'Olivet a publié des traités de grammaire et une histoire de l'Académie Française).ORBIGNY Alcide DESSALINES d'ORBIGNY (naturaliste, professeur de paléontologie au Muséum (dès 1853), président de la Société géologique de France, o Couëron (44) le 06.09.1802, Pierrefitte-sur-Seine (93) le 30.06.1857, fils d'un médecin de la marine).PARNY Evariste-Désiré de FORGES, chevalier puis vicomte de PARNY (poète, o L'Hermitage, commune de Saint-Paul, Île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, le 06.02.1753, Paris le 05.12.1814. Lamartine fut son élève). Arm. : échiqueté d'argent et de gueules.PASTORET Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre, comte puis marquis de PASTORET (pair de France (1814), ministre d'Etat (1826), chancelier de France (1829), nommé membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, o Marseille (13) en 1756, Paris en 1840. Un fils connu : Amédée-David, o Paris 1791, ibidem en 1857, historien romancier, poète et sénateur sous le Second Empire).PAUL Paul de SAUMUR, connu sous le nom de chevalier PAUL (marin, chevalier de Malte, commandant de marine à Toulon en 1666, o sur le bateau d'une lavandière entre Marseille (13) et le château d'If en 1598, Toulon (83) en 1669. Il a tenté sans succès la conquête de l'Algérie après avoir écrasé une division algérienne à Cherchell en 1665).PERSIGNY Jean-Gilbert-Victor FIALIN, comte puis duc de PERSIGNY, à titre héréditaire par patentes du 07.11.1863 (homme politique, ministre de l'Intérieur (22.01.1852-1854), sénateur (31.12.1852), ambassadeur à Londres (1855-1858 et 1859-1860), à nouveau ministre de l'Intérieur en 1860, o Saint-Germain-Lespinasse (42) le 08.01.1808, Nice (06) le 14.01.1872, fils d'Antoine-Henri Fialin et de Marie-Anne Girard de Carbonières. Le 27.05.1852, il épousa, à Paris, Albine-Marie-Napoléonne-Églé Ney de la Moskowa, Cannes (06) le 30.05.1890, fille de Joseph-Napoléon, prince de la Moskowa, et d'Albine-Etienne-Marguerite Laffitte, qui lui donna quatre enfants dont Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, o 15.05.1855, Paris le 18.11.1885, sans alliance).PEYRONNET Charles-Ignace, comte de PEYRONNET (ou PEYRONET) (avocat, homme politique, ministre de la Justice de 1821 à 1827, ministre de l'Intérieur du 19.05 au 31.07.1830 (dans le ministère Polignac), o Bordeaux (33) en 1778, château de Montferrand (33) en 1854, fils d'un secrétaire du roi, guillotiné en 1793).PIBRAC Guy du FAUR de PIBRAC (magistrat (avocat général au Parlement), homme politique (chancelier du duc d'Anjou élu roi de Pologne puis de Henri III, roi de France), diplomate (ambassadeur au concile de Trente) et poète, o Toulouse (31) en 1529, Paris en 1584, 4e enfant de Pierre du Faur, seigneur de Pibrac, président du Parlement de Toulouse).PIGAULT-LEBRUN Charles-Antoine-Guillaume PIGAULT de l'ÉPINAY dit PIGAULT-LEBRUN (romancier, o Calais (62) en 1753, La Celle-Saint-Cloud (78) en 1835, grand-père d'Emile Augier, auteur de théâtre, et oncle de Paul Déroulède, connu pour ses talents de poète).POINTIS Jean-Bernard-Louis de SAINT-JEAN (alias DESJEAN), baron de POINTIS (marin, o Bretagne en 1645, Champigny-sur-Marne (94) le 24.04.1707).POMBAL Sebastião José de CARVALHO e MELLO, comte d'OEYRAS, marquis de POMBAL à partir de 1770 (diplomate et homme d'Etat portugais, o Lisbonne le 13.05.1699, Pombal le 08.05.1782).POMPADOUR Jeanne-Antoinette POISSON, marquise de POMPADOUR (favorite de Louis XV, o Paris le 29.12.1721, Versailles (78) le 14.04.1764, fille naturelle présumée de Lenormand de Tournehem, syndic des fermes et la femme volage d'un munitionnaire aux armées. En 1741, elle épousa le fermier général Charles Le Normant d'Étiolles).POMPIGNAN Jean-Jacques LEFRANC, marquis de POMPIGNAN (poète, élu membre de l'Académie Française (1759), o Montauban (82) le 17.08.1709, Pompignan le 01.11.1784).PONSON du TERRAIL Pierre Alexis Joseph Ferdinand, vicomte PONSON du TERRAIL (romancier, o Montmaur (05) le 08.07.1829, Bordeaux (33) le 10.01.1871, victime de la variole, inhumé à la chartreuse de Bordeaux puis exhumé et transféré à Paris en 1878, chevalier de la Légion d'Honneur, fils de Ferdinand de Ponson et de Mademoiselle Toscan du Terrail. Il épousa Mademoiselle Jarry Morand). Arm. : d'azur au pont de deux arches d'or, maçonné de sable, surmonté d'une cloche d'argent, bataillée de sable, accostée de deux épées hautes d'argent, montées d'or.PONTÉCOULANT Louis-Adolphe LE DOULCET, comte (parfois dit le marquis) de PONTÉCOULANT (officier et littérateur, émigré au Brésil après avoir servi sous Napoléon, o Paris en 1794, Bois-Colombes (92) en 1882, fils de Louis-Gustave Le Doulcet, comte de Pontécoulant, commandeur de la Légion d'Honneur, o Caen (14) le 17.11.1764, Paris le 03.04.1853, homme politique, député du Calvados à la Convention, comte de l'Empire (1808), pair de France (1814) (fils de Léon Armand Le Doulcet, chevalier, dit le marquis de Pontécoulant, page de la Grande Ecurie du Roi en 1740, lieutenant général, grand-croix de Saint-Louis, et de Marie-Anne Pajot d'Hardivilliers), et d'Elisabeth Marais. Philippe-Gustave, comte de Pontécoulant, o 1795, Villers-sur-Mer (14), ancien élève de Polytechnique, colonel d'état-major, officier de la Légion d'Honneur, était membre de l'Académie des Sciences. Louis Adolphe Le Doulcet, comte de Pontécoulant, épousa Honorine Gros qui ne lui donna que des filles). Arm. :d'argent à la croix fleurdelysée de sable.PONTON d'AMÉCOURT Gustave, vicomte de PONTON d'AMÉCOURT (président de la Société Française de Numismatique et d'Archéologie, o Paris en 1825, 1888. C'était un ami de Nadar et de Jules Verne).PORTO-RICHE Georges de PORTO-RICHE, poète et auteur dramatique, membre de l'Académie Française (1923), grand officier de la Légion d'Honneur, o Bordeaux (33) le20.05.1849, Paris le 15.09.1930, fils d'un armateur bordelais).PRONY Gaspard-Clair-François-Marie RICHE, baron de PRONY (ingénieur, membre de l'Académie des Sciences, o Chamelet (69) le 22.07.1755, Paris le 29.07.1839).RACAN Honorat de BUEIL, marquis de RACAN (poète, membre de l'Académie Française (1635), o château de Champmarin, commune actuelle d'Aubigné-Racan (72) le 05.02.1589, Paris le 21.01.1670).RAMBUTEAU Claude-Philibert BARTHELOT, comte de RAMBUTEAU (homme politique, préfet de la Seine, o Mâcon (71) le 09.11.1781, à Champgrenon près de Charnay (71) le 11.04.1869. Il a donné son nom à une voie parisienne).RÉAUMUR René-Antoine FERCHAULT de RÉAUMUR (physicien et naturaliste, o La Rochelle (17) le 28.02.1683, château de la Brémondière, Saint-Julien-du-Terroux (53) le 17.10.1757
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, 24 juin 2006
Le marquis de Flers (1872-1927), auteur dramatique
On lui doit notamment :
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Les Travaux dHercule, Paris, 1891.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Le Sire de Vergy, opéra-bouffe (1903), musique de Claude Terrasse.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Les Sentiers de la Vertu, Paris, 1904.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Miquette et sa mère, Paris, 1906.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Pâris ou le Bon Juge, Paris, 1906.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Le Roi, comédie en quatre actes (représentée pour la première fois en 1908).
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Le Bois Sacré, Paris, 1910.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Primerose, 1911.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, LHabit Vert, comédie en quatre actes (satire de lAcadémie Française, représentée pour la première fois en 1912).
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Monsieur Brotonneau, comédie en trois actes, Paris, 1914.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Les Merveilleuses, Paris, 1914.
- Robert de FLERS & Gaston Arman de CAILLAVET, Ma Tante dHonfleur, Paris, 1914.
- Robert de FLERS & Francis de CROISSET, Le Retour, comédie en trois actes (représentée pour la première fois en 1920).
- Robert de FLERS & Francis de CROISSET, Les Vignes du Seigneur, comédie en trois actes (représentée pour la première fois en 1923), avec cette réplique fameuse : « C'est drôle, vous autres Anglais, quand vous êtes à côté d'une jeune fille, c'est vous qui avez l'air d'être vierge. »
- Robert de FLERS, Les Nouveaux Messieurs, comédie en quatre actes, Paris, 1925.
Le marquis de Flers était ami de Marcel Proust depuis 1892. Tout le début de sa carrière fut marqué par sa collaboration avec Gaston Arman de Caillavet (1869-1915), fils dAlbert Arman de Caillavet et de Léontine Lippmann.
Consulter aussi : Emmanuel Chaumie, « La belle aventure de Robert de Flers », Paris, Firmin-Didot, 1919.
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Les francs-comtois de la révolution (1789-1799) Dictionnaire patronymique et notices biographiques détaillées Présentation - Dos de couverture
Avec de très nombreuses références bibliographiques et archivistiques, Les Francs-Comtois de la Révolution offrent aux chercheurs et aux généalogistes 1414 pages de renseignements biographiques et généalogiques fort détaillés. Aux côtés des Francs-Comtois de souche, on découvrira en outre, dans cet ouvrage de référence, des personnages de la France entière (tous les départements de lépoque révolutionnaire y étant représentés), de la Suisse voisine et de divers pays européens.
Lauteur a commencé à dresser une liste alphabétique des noms de famille contenus dans Les Francs-Comtois de la Révolution sur le site Internet http://www.jeanmariethiebaud.com
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Daprès lHistoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de Jules Sauzay, et lHistoire de la persécution révolutionnaire dans le département du jura, dE. Chamouton.
Avec de très nombreux compléments de sources diverses, archivistiques et bibliographiques.
Les supérieurs généraux des jésuites (1541-2006) Les papes noirs
La Compagnie de Jésus a été fondée par Ignace de Loyola (1491-1556) et six autres étudiants (François Xavier (1), Navarrais, le futur évangélisateur des Indes et du Japon, Pierre Favre (2), Savoyard, premier prêtre ordonné de la compagnie depuis le 30 mai 1534, Simon Rodriguès, Portugais, Diego Laynez, Alphonse Salmeron et Nicolas Bobadilla, tous trois Espagnols), qui se retrouvèrent à Montmartre dans la chapelle des martyrs, le 15 août 1534, pour faire vu de pauvreté et de chasteté. Pour faire reconnaître leur société qu'ils avaient baptisée Societas Jesu (S. J.), ils se rendirent à Rome en 1537, furent reçus par le pape Paul III en novembre 1538 et obtinrent le 27 septembre 1540 du Souverain Pontife la bulle Regimini militantis qui officialisait leur ordre.
Le 24 décembre 1594, Jean Châtel, ancien élève des jésuites, commet un attentat contre Henri IV en le blessant d'un coup de couteau. Jean Châtel sera écartelé, le Père Guignard, bibliothécaire des jésuites de Paris, exécuté en place de Grève. Le 29 décembre 1594, les jésuites sont expulsés de France par arrêt du Parlement de Paris. L'édit de Rouen, signé par Henri IV, rétablit la Compagnie de Jésus en France en 1604.
La Compagnie de Jésus est supprimée par un arrêt du Parlement de Paris le 6 août 1762. Les jésuites y sont dits coupables d'avoir enseigné "la simonie, le blasphème, le sacrilège, la magie et le maléfice, l'astrologie, l'irréligion de tous les genres, l'idolâtrie et la superstition, l'impudicité, le parjure, le faux témoignage, les prévarications des juges, le vol, le parricide, l'homicide, le suicide, le régicide" et, le 18 novembre 1764, Louis XV dissout par décret l'Ordre des jésuites, expulsés de France en 1767. Le 8 juin 1773, le pape Clément XIV, sous la pression des Bourbons, dissout la Compagnie de Jésus par le bref Dominus ac Redemptor noster (publié le 16 août). L'Ordre ne subsistera désormais qu'en Prusse et en Russie (dont ils seront bannis en 1820), grâce à la bienveillance de deux souverains éclairés, Frédéric II de Prusse et de Catherine II de Russie qui refusent d'obéir à la décision du pape.
En 1799, le pape Pie VI autorisé l'ouverture d'un noviciat en Italie mais la Compagnie ne se releva qu'après l'abdication de Napoléon 1er.
Le 7 août 1814, par la bulle Sollicitudo omnium Ecclesiarum, le pape Pie VII rétablir la Compagnie de Jésus. En 1828, les jésuites se voient dépossédés de la possibilité d'enseigner, suite à une décision du ministère Martignac. En 1830, les jésuites sont proscrits et doivent à nouveau quitter la France. Toutefois, certains reviennent peu à peu et, en 1845, Thiers demande au gouvernement un nouvel arrêt d'expulsion. La loi Falloux du 15 mars 1850 ayant instauré la liberté de l'enseignement secondaire, les jésuites ouvrent seize collèges en France entre 1850 et 1854. La revue Études, fondée par les Pères Charles Daniel et Jean Gagarine (de la famille des princes russes Gagarine) paraît pour la première fois en 1856 et tend à vouloir rapprocher l'église de Rome et les orthodoxes.
En 1880, Jules Ferry obtient un décret interdisant "aux Jésuites le droit d'enseigner la jeunesse française". Le 30 juin 1880, les forces de police expulsent les jésuites de leurs établissements.
Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que les jésuites retrouveront une totale liberté pour enseigner en France.
LISTE DES SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX, LES 29 "PAPES NOIRS" (3)
- Ignace de LOYOLA, né au château de Loyola en 1491, blessé au siège de Pampelune par les troupes de François 1er (1521), arrivé à Paris en 1528, ordonné prêtre à Venise en juin 1537, 1er supérieur général ("préposé général") du 19.04.1541 à sa mort le 31 juillet 1556. Il sera canonisé avec François Xavier, Louis de Gonzague, Philippe de Néri, Stanislas Kotska et Thérèse d'Avila en 1622 par le pape Grégoire XV (J.M.S. Dautignac, "Vie de Saint Ignace de Loyola, Fondateur de la Compagnie de Jésus", Paris, Bray et Retaux, 1877), ouvrage paru en espagnol sous le titre "Vida de Santo Inacio de Loiola, fundator da Companhia de Jesus" ; Herman Muller, Les origines de la Compagnie de Jésus - Ignace et Lainel, Paris, Fichbacher, 1898).
- Diego LAYNEZ né en Castille en 1512, 19.01.1565), cofondateur de l'Ordre, vicaire général de 1556 à 1558, 2nd supérieur général du 02.07.1558 au 19.01.1565 (Herman Muller, Les origines de la Compagnie de Jésus - Ignace et Lainel, Paris, Fichbacher, 1898).
- Francisco de BORGIA, 4e duc de Gandie depuis 1542 (à la mort de son père), né à Gandia (royaume de Valence, Espagne) en 1510, Rome le 30.09.1572 (fils aîné du duc Jean Borgia), vice-roi de Catalogne, père de huit enfants, entré chez les jésuites après son veuvage, à l'âge de 40 ans, provincial d'Espagne de 1554 à 1561, 3e supérieur général du 02.07.1565 à sa mort le 30.09.1572, canonisé par le pape Clément X en 1671 (Otto Karer, Der heilige Franz von Borja : General der Gesellschaft Jesu 1510-1572, Freiburg : Herder, 1921).
- Everard LARDINOIS de MARCOURT dit MERCURIAN, né à Marcourt (Luxembourg) v. 1514, 01.08.1580, ordonné prêtre en 1546, entré dans l'ordre des jésuites en 1548, principal collaborateur d'Ignace de Loyola à Rome dès 1551, provincial pour la Rhénanie et les Pays-Bas de 1558 à 1564, assistant du général de Borgia à Rome à partir de 1565, 4e supérieur général du 23.04.1573 à sa mort le 01.08.1580 (Tony Severin, Un grand Belge, Mercurian, 1514-1580. Curé Ardennais, général des Jésuites, Liège, H. Dessain, 1946).
- Claudio ACQUAVIVA (AQUAVIVA) (1543-1615), Italien originaire de Naples, 5e supérieur général du 19.02.1581 au 31.01.1615.
- Muzio VITTELESCHI, 6e supérieur général du 15.11.1615 au 09.02.1645.
- Vincenzo CARAFA né à Naples (Italie) le 07.01.1585, le 08.06.1649, Italien, 7e supérieur général du 07.01.1648 à sa mort le 08.01.1649.
- Francesco PICCOLOMINI, né le 21.12.1582, Rome le 17.06.1651, professeur de théologie au collège romain puis 8e supérieur général du 21.12.1649 au 17.06.1651.
- Luigi (alias Aloysius) GOTTIFREDI, né à Rome, Rome le 12.03.1652, professeur de théologie et recteur du collège romain, secrétaire de la Compagnie de Jésus puis 9e supérieur général du 21.01.1652 au 12.03.1652. N.B. : la date de naissance de ce supérieur général demeure inconnue. Gottifredi ne resta à la tête des jésuites que pendant 50 jours.
- Goschwin NICKEL, né à Jülich en 1582, Rome le 31.07.1664, 10e supérieur général du 17.03.1652 au 31.07.1664, obtenant, en raison de son grand âge, Giovanni Paolo Oliva comme vicaire général dès le 07.06.1661 pour l'assister dans sa tâche.
- Giovanni Paolo OLIVA, né à Gênes (Italie) le 04.10.1600, à Rome (Saint-André du Quirinal) le 26.10.1681, entré dans la Compagnie de Jésus en 1616 à l'âge de 16 ans, vicaire général dès le 07.06.1661, 11e supérieur général du 31.07.1664 au 26.10.1681.
- Charles de NOYELLE, né à Bruxelles le 28.07.1615, Rome le 12.12.1686, 12e supérieur général du 05.07.1682 au 12.12.1686.
- Tirso (Thyrsus) GONZALES de SANTALLA, théologien, 13e supérieur général du 06.07.1687 au 27.10.1705, auteur de "Fundamentum Theologiae moralis id est,tractatus théologicus de recto usu opinionum probabilium in quo ostenditur.. Romae, J J Komarek 1694", ouvrage dans lequel il critique le probabilisme.
- Michelangelo TAMBURINI, né à Modène (Italie) le 27.09.1648, à Rome le 16.01.1730, professeur de philosophie à Bologne et de théologie à Mantoue, provincial des jésuites de Venise en 1697, 14e supérieur général du 03.01.1706 au 28.02.1730.
- Frantzek RETZ, né à Prague (Bohème) en 1673, 19.11.1750, Tchèque, entré dans la Compagnie de Jésus en 1689 à l'âge de 16 ans, recteur de la Karls-Universität (Université Charles de Prague, en tchèque, Univerzita Karlova z Praze et, en latin, Universitas Carolina) en 1723, vicaire général puis 15e supérieur général du 07.03.1730 au 19.11.1750.
- Ignazio VISCONTI, né à Mailand le 31.07.1682, 16e supérieur général du 04.07.1751 à sa mort à Rome le 04.05.1755 (L.J. Buß, Die Gesellschaft Jesu, ihr Zweck, ihre Satzungen, Geschichte, Aufgabe und Stellung in der Gegenwar", t, 2. Abtlg. (Mainz 1853), 1114, 1184) ;
- Luigi CENTURIONE, né à Gênes (Italie) le 29.08.1686, le 02.10.1757, 17e supérieur général du 30.11.1755 au 02.10.1757.
- Lorenzo RICCI, né à Florence (Italie) le 02.08.1703, château Saint-Ange à Rome le 24.11.1775, inhumé dans l'église de Gésu à Rome aux côtés de ses précédesseurs, professeur de théologie à l'université grégorienne du Vatican dès 1743, 18e supérieur général du 21.05.1758 au 24.11.1775.
- Tadeusz BRZOZOWSKI, né à Malbork (Marienbourg, Pologne) le 21.10.1749, Rome le 05.02.1820, réfugié en Russie après l'interdiction des jésuites, 19e supérieur général du 07.08.1814 au 05.02.1820.
- Luigi FORTIS, né à Vérone (Italie) le 26.02.1746, à Rome le 27.01.1829, inhumé dans la crypte de l'église de Gésu, directeur du collège des nobles à la demande de Ferdinand, duc de Parme (après la suppression de l'Ordre des Jésuites), 20e supérieur général du 18.10.1820 au 20.01.1829.
- Jan ROOTHAAN, né le 23.11.1785, le 08.05.1853, inhumé à Rome sous un autel de l'église de Gésu, originaire d'Amsterdam (Pays-Bas), né de parents émigrés de Francfort (Allemagne) ayant abjuré la calvinisme pour se convertir au catholicisme. Professeur au lycée jésuite de Dunaburg de 1806 à 1809 avant d'étudier la philosophie et la théologie à Polotsk et d'être ordonné prêtre en 1812, professeur de rhétorique à Brigue (Suisse) après l'xpulsion des jésuites de Russie, recteur du collège de Turin (Italie), 21e supérieur général du 09.07.1829 au 08.05.1853.
- Pieter Jean BECKX, né à Sichem (Belgique) le 08.02.1795, 1887, entré au noviciat de la Compagnie à Hildesheim en 1819, procureur pour la province d'Autriche en 1847, 22e supérieur général du 02.08.1853 à sa mort le 04.03.1887. Anderledy avait commencé à le remplacer dès 1883.
- Anton Maria ANDERLEDY, né à Berisal (comm. Ried -Brigue, Suisse) le 03.03.1819, Fiesole (Italie) le 18.01.1892, fils d'Anton Anderledy, postier, et de Genovefa Seiler, entré chez les jésuites à Brigue en 1839, assistant général de la Compagnie à Rome à partir de 1870, 23e supérieur général du 05.03.1887 au 18.01.1892.
- Luis MARTIN Y GARCIA, né à Melgar de Fernamentel, Burgos (Espagne) le 19.08.1846, Fiesole (Italie) le 18.04.1906 (victime d'un sarcome pour lequel il dut être amputé d'un bras), étudiant au séminaire de Burgos, entré chez les jésuites en 1864, recteur du séminaire de Salamanque, supérieur du collège de Deusto Bilbao, provincial de Castille, 24e supérieur général du 02.10.1892 à sa mort le 18.04.1906.
- Franz Xavier WERNZ, né à Rottweil (Würtemberg, actuellement en Allemagne) le 04.12.1842, 19.08.1914 (quelques heures avant la mort de Pie X), inhumé dans le mausolée des jésuites au cimetière romain de Campo Verano, aîné de huit enfants, professeur de droit canon à Ditton Hall puis à St-Bueno au Pays de Galles et enfin, de 1882 à 1906, à l'université grégorienne, 25e supérieur général du 08.09.1906 au 19.08.1914.
- Comte Wlodomir LEDÓCHOWSKI, noble polonais, né à Loosdorf près de Saint-Polten, le 07.10.1866, Rome le 13.12.1842, étudiant en droit à Vienne en 1884-1885, recteur du collège des jésuites à Krakau en 1900, vice-provincial de Galicie en 1901 puis provincial en 1902, 26e supérieur général du 11.12.1915 au 13.12.1942. N.B. : il eur deux surs, les comtesses Maria Theresia Ledóchowska et Ursula Ledóchowska.
- Johann (Jean-Baptiste) JANSSENS, né à Mecheln (Belgique) en 1889, Rome (Italie) dans la maison des jésuites le 05.10.1964 après avoir été opéré dune tumeur de l'il, 27e supérieur général du 15.09.1946 au 05.10.1964. Le pape Paul VI vint en personne lui donner la bénédiction apostolique dans l'heure qui précéda sa mort (J.-M. Thiébaud, "Theodor Geppert, S.J. 1904-2002", document électronique sur le site Internet de la fiche de l'auteur aux éditions de L'Harmattan)
- Pedro ARRUPE, né à Bilbao (Pays basque espagnol) le 14.11.1907, Rome dans la maison des jésuites le 05.02.1991, étudiant en médecine à Madrid, entré dans la compagnie de Jésus en janvier 1927 après avoir été témoin de plusieurs miracles à Lourdes. En 1938, il partit pour le Japon à Hiroshima et sera amené à soigner les victimes de la bombe atomique du 6 août 1945. Il devint le 28e supérieur général le 22.05.1965 pendant le concile de Vatican II et le demeura jusqu'au 03.09.1983. Il était resté paralysé et muet depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 1981.
- Peter Hans KOLVENBACH, né à Druten (Pays-Bas) le 30.11.1928, 29e supérieur général depuis le 03.09.1983.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) François Xavier (Francisco Javier en Espagnol), né château de Javier près de Pampelone (Navarre) le 07.04.1506, île de Sancian au large de Canton (Chine) le 03.12.1552, inhumé dans l'église jésuite de Goa. Il fut ordonné prêtre en 1537 (J.M.S. Daurignac, "Histoire de Saint François-Xavier", 2 vol., Paris, 1862 ; ouvrage paru en espagnol sous le titre "Vida de S. Franceso Xavier, Apóstolo das Indias").
(2) Pierre Favre, né au Villaret, commune actuelle de Saint-Jean-de-Sixt (74) le 13.04.1506, Rome le 01.08.1546, étudiant à Paris dès 1525, béatifié par le pape Pie IX en 1872.
(3) Le supérieur général, dit plus communément le général des jésuites, est aussi appelé le pape noir comme s'il disposait dans l'église catholique d'une importance égale à celle du pape blanc, le Souverain Pontife.
Les supérieurs généraux des assomptionnistes (augustins de l'assomption) Des origines à nos jours
Neuf supérieurs généraux (et un vicaire général), dont deux Américains, se sont succédés à la tête des Assomptionnistes depuis 1845.
Emmanuel Marie Joseph Maurice DAUDÉ d'ALZON dit d'ALZON, né au Vigan (30) le 30.08.1810, Nîmes (30) le 21.11.1880, fils d'André Henri Daudé, vicomte d'Alzon, propriétaire foncier, et de dame Marie-Jeanne-Clémence Faventine, ordonné prêtre, fondateur des Assomptionnistes dont il fut le premier supérieur général de 1845 à 1880. Il fonda aussi une congrégation féminine, les Oblates de l'Assomption. Le pape Pie IX demanda au Père Emmanuel d'Alzon d'envoyer des religieux en Bulgarie pour prendre en charge les orthodoxes désirant rejoindre l'église catholique. L'Espace d'Alzon, qui doit son nom au Père fondateur, est un lieu de rencontres animé par les Assomptionnistes, 10, rue François 1er, Paris 8e. Voir Père Jean-Paul Perrier-Muzet, "Emmanuel d'Alzon, fondateur des Assomptionnistes", Nouvelle Cité.
François PICARD, né à Saint-Gervasy (30) le 01.10.1831, Rome le 16.04.1903, ordonné prêtre le 25.05.1856 alors qu'il poursuivait des études de théologie à Rome. Il prit la tête de la nouvelle communauté créée rue François 1er à Paris en mai 1862. Premier assistant de 1861 à 1880, il devint le second supérieur des Assomptionnistes de 1880 à 1903. Il fonda les Orantes de l'Assomption le 08.12.1896 avec Isabelle de Clermont-Tonnerre, comtesse d'Ursel. La cause de sa canonisation a été introduite en Cour de Rome.
Emmanuel BAILLY, né à Paris le 04.08.1842, ibidem le 23.11.1917, inhumé au cimetière Montparnasse, ordonné prêtre à Nîmes (Gard) le 28.10.1865 après trois années d'études à Rome, maître des novices dès 1880, troisième supérieur des Assomptionnistes du 19.06.1903 à sa mort en 1917. Il eut pour assistants, Vincent de Paul Bailly de 1903 à 1912 et Ernest Baudouy de 1906 à 1917.
- [Joseph Maubon, 1918-1922 vicaire général], né à Lunel (34) le 21.01.1849, à Jérusalem le 13.02.1932.
Gervais Jean Claude QUENARD, né à Chignin (73) le 11.01.1875, à Rome le 06.02.1961, inhumé au Campo Verano, ordonné prêtre à Jérusalem le 20.08.1899, envoyé en Russie (Vilna) de 1905 à 1908 puis en Bulgarie, supérieur de la Mission d'Orient de 1920 à 1923, 4e supérieur général des Assomptionnistes de 1923 à 1951, date à laquelle il donna sa démission. Après avis du Saint-Siège, il demeura néanmoins vicaire général jusqu'en 1952.
Wilfrid Joseph DUFAULT, né à Spencer (Massachusetts, USA) le 11.12.1907, ordonné prêtre à Rome le 24.01.1934, licencié en théologie, docteur en philosophie (à l'Université Laval de Québec), premier provincial d'Amérique du Nord de 1946 à 1952, chevalier de la Légion d'Honneur, 5e supérieur général des Assomptionnistes de mai1952 à 1969, date de sa démission.
Paul Pierre Louis CHARPENTIER, né à Bury (60) le 23.01.1914, ordonné prêtre le 24.03.1946 (vocation tardive), 6e supérieur général des Assomptionnistes du 29.05.1969 à 1975
Hervé STÉPHAN, né à Henvic (29) le 03.10.1925, ordonné prêtre le 17.02.1951, 7e supérieur général des Assomptionnistes du 18.04.1975 à 1987
Claude MARÉCHAL, né à Cramans (39) le 03.05.1935, ordonné prêtre le 30.03.1963, 8e supérieur général des Assomptionnistes du 30.05.1987 à 1999.
Richard Edward LAMOUREUX, né à Worcester (Massachusetts, USA) le 03.09.1942, ordonné prêtre le 27.03.1971, 9e supérieur général des Assomptionnistes depuis le 11.05.1999.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les enfants de Claude de Violaine, ingénieur ordinaire du roi en chef de la cité de Besançon Des naissances rapprochées au début du 18e siècle
Avant d'arriver à Besançon (25), Claude de Violaine, ingénieur ordinaire du Roi en chef de la cité de Besançon, épousa dame Anne Damoiseau qui lui donna plusieurs enfants baptisés dans les églises Saint-Jean-Baptiste, Saint-Maurice, etc. (ce qui tend à prouver qu'il déménagea à plusieurs reprises) :
- Jean Claude, né le 08.08.1701 (A.C. de Besançon, n° GG 11, fol. 82 v°)
- Claudine Gabriel, née le 07.12.1702 (A.C. de Besançon, n° GG 150, fol. 198, le 23.08.1703 (A.C. de Besançon, n° GG 151, fol. 49)
- Joseph Daniel, né le 07.11.1703 (A.C. de Besançon, n° GG 150, fol. 172)
- Ferdinand Alexandre, né le 09.10.1704 (A.C. de Besançon, n° GG 150, fol. 162), 13.12.1704 (A.C. de Besançon, n° GG 151, fol. 59)
- Anne Marguerite, née le 07.01.1706 (A.C. de Besançon, n° GG 316 (A.C. de Besançon, n° GG 316, fol. 37 v°)
- Charles Denis, né le 01.02.1707 (A.C. de Besançon, n° GG 316, fol. 48 v°)
- Humbert Antoine, né le 24.02.1709, 25.05.1709 (A.C. de Besançon, n° GG 12, fol. 87, 92)
- Marguerite Françoise, née le 26.08.1710, 08.06.1711 (A.C. de Besançon, n° GG 12, fol. 115 et 133 v°)
- Hippolyte, né le 03.12.1711, 05.12.1712 (A.C. de Besançon, n° GG 12, fol. 141, 155)
Soit neuf enfants nés en l'espace de 10 ans 2 mois 25 jours (1). Les naissances des 2e, 3e et 4e enfants ne sont espacées que d'onze mois. C'est dire que la mère n'a probablement pas eu le temps de revoir ses règles avant d'être à nouveau enceinte. Cinq des neuf enfants meurent âgés de quelques mois à peine.
Ces naissances si rapprochées conduisent aussi à s'interroger sur la fertilité du 18e siècle et celle que nous connaissons aujourd'hui. Les couples contemporains des pays occidentaux n'utilisant pas de contraception ont des enfants dont les naissances sont nettement plus espacées. De plus, sur le plan médical, on ne commence généralement un bilan de stérilité que deux ans après le mariage d'un couple ayant des rapports sexuels réguliers mais sans toutefois obtenir la grossesse souhaitée. Tout ceci mériterait d'être quantifié avec précision avant de conclure à une baisse récente de la fertilité pourtant hautement probable. Notons que les chiffres considérés comme normaux pour le nombre de spermatozoïdes/cm³ de sperme dans les spermogrammes réalisés en laboratoire ont déjà été revus à la baisse au cours de ces dernières décennies. Il en est de même pour la vitalité et la mobilité des spermatozoïdes.
Notes :
(1) Rien ne prouve que le couple n'a pas eu d'enfant avant 1701 et après 1711, ces deux dates correspondant peut-être uniquement à la période pendant laquelle Claude de Violaine était en garnison à Besançon.
L'abjuration de Gédéon Béranger de Montaigu Capitaine à la citadelle de Besançon et du régiment du Maine (26 juin 1700)
Le registre paroissial de Saint-Maurice de Besançon (Doubs), conservé à la Bibliothèque municipale de cette ville, renferme un cahier d'abjurations. Les protestants convertis étaient pour la plupart originaires de la Suisse voisine et notamment du canton des cantons de Berne et de Lausanne. Toutefois, quelques Français abjurèrent également l'hérésie de Calvin, peut-être sous la pression de leurs amis ou pressentant que leur confession pouvait constituer un obstacle dans leur carrière, quelques années après la révocation de l'édit de Nantes.
C'est ainsi, par exemple, que, le 26 juin 1700, Gédéon Béranger de Montaigu, capitaine à la citadelle de Besançon et du régiment du Maine, abjura l'hérésie devant le curé de Saint-Maurice, en présence de Jean Baptiste de Vaubourg (1), intendant de la Franche-Comté, Pierre de Rommecourt, lieutenant de roi à la citadelle, Jean Valentin de Viencellot, commissaire des guerres, Jean de La Prade, major de la citadelle, et Pierre d'Aligny, brigadier et colonel d'infanterie.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Source : Archives communales de Besançon, n° GG 150.
Notes :
(1) Jean Baptiste Desmarets de Vaubourg, ancien intendant de Lorraine et du Barrois de 1691 à 1697, intendant de Franche-Comté de février 1698 à août 1700.
Les trois premiers prélats de l'Opus Dei Josemaria Escrivá de Balaguer, Alvaro del Portillo et Javier Echevarria Rodriguez
Mgr Josemaria ESCRIVÁ de BALAGUER, né à Barbastro, province de Huesca (Espagne) le 09.01.1902, à Rome le 26.06.1975, fils de José ( 1924) et de Dolores, ordonné prêtre le 28.03.1925, docteur en théologie à l'université de Latran (Rome), fondateur de l'Opus Dei le 02.10.1928. Il fut béatifié le 17.05.1992 et canonisé par le pape Jean-Paul II le 06.10.2002, 27 ans après sa mort. À la mort de son fondateur, l'Opus Dei regroupait alors déjà 60 000 membres de 80 nationalités différentes.
Réf. :
Salvador Bernal, Mgr Josémaria Escrivá de Balaguer. Portrait du fondateur de l'Opus Dei, SOS Éditions, Paris, 1978.
Xavier Echevarria Rodríguez et Salvador Bernal Fernández, Memoria del Beato Josemaría Escrivá, Madrid 2000.
Alvaro del Portillo: Entretien sur le fondateur de l'Opus Dei (réalisé par Cesare Cavalleri), Le Laurier, Paris 1996 (t.o.: Intervista sul fondatore dell'Opus Dei, Milan, 1992).
Francisco Ponz, Mi encuentro con el Fundador del Opus Dei. Madrid, 1939-1944, Pamplona, 2000.
Andrés Vázquez de Prada, Le Fondateur de l'Opus Dei. Vie de Josémaria Escriva. Vol 1 Seigneur, que je voie! Le Laurier Paris, Wilson & Lafleur ltée Montréal 2001.
Peter Berglar, L'Opus Dei et son fondateur Josémaria Escriva, Éditions Mame, 1992 (t.o.: Opus Dei. Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá de Balaguer, Salzbourg, 1983).
François Gondrand, Au pas de Dieu. Josémaria Escrivá de Balaguer, Fondateur de l'Opus Dei, Éditions France-Empire. Paris 1986.
Ana Sastre, Tiempo de caminar: semblanza de Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, Madrid, 1989.
Pilar Urbano: El hombre de Villa Tevere: los años romanos de Josemaría Escrivá, Barcelona, 1995.
Mgr Alvaro del PORTILLO, né à Madrid (Espagne) le 11.03.1914, troisième de huit enfants d'une famille très chrétienne, diplômé ingénieur civil, docteur en philosophie et en droit canon, ordonné prêtre le 25.06.1944, établi à Rome en 1946 auprès de Mgr Josemaria Escrivá de Balaguer. Il fut élu second prélat de l'Opus Dei le 15.09.1975 et le demeurant jusqu'à sa mort survenue à Rome le 23.03.1994, quelques heures après son retour d'un pèlerinage en Terre Sainte. Il fut inhumé dans la crypte de l'église prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix. Mgr Alvara del Portillo avait activement participé aux travaux de Vatican II. Le 28 novembre 1982, érigeant l'Opus Dei en prélature personnelle, le pape Jean-Paul II l'avait nommé prélat de l'Opus Dei ; il devait lui conférer l'ordination épiscopale le 6 janvier 1991.
Mgr Javier ECHEVARRIA RODRIGUEZ, né à Madrid (Espagne) le 14.06.1932 (fils d'un ingénieur industriel), docteur en droit canon à l'université pontificale de Saint Tomas (1953) et en droit civil à l'université pontificale de Latran (1955), ordonné prêtre le 07.08.1955, secrétaire de Mgr Josemaria Escrivá de Balaguer de 1953 à 1975, membre du conseil général de l'Opus Dei depuis 1966 et son secrétaire général dès 1975, nommé évêque titulaire de Cilibia par le pape Jean-Paul II et consacré le 06.01.1995, élu troisième prélat de l'Opus Dei le 21.11.1994, actuel grand chancelier de l'université de la Sabana.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Les victimes d'Ivan IV le Terrible, tsar de Russie, et leurs supplices
ADACHEV Alexeï Fédorovitch, ex-officier, ex-voïévode, emprisonné à Dorpat en 1560, décédé de froid deux mois plus tard dans sa cellule.
ADACHEV Daniel, frère d'Alexeï Fedorovitch, héros militaire, exécuté en 1560 avec son fils âgé de 12 ans.
ALEKSANDRA, nonne, veuve du prince IOURI (frère d'IVAN IV), noyée en 1581 à Biélozersk.
BASMANOV Fedor, contraint de tuer son père en prison en juillet 1570 puis exécuté comme parricide.
BOMELIUS Elisée, médecin du tsar et fournisseur en poisons. En 1581, il eut les jambes désarticulées sur un chevalet, le corps lacéré avec un fouet en fil de fer, avant d'être rôti sur une broche en bois. Ramené ensuite dans son cachot, il y mourut presque aussitôt.
CHEREMETIEV Ivan, grand voïévode, terreur des Tatars de Crimée, enchaîné et torturé en 1560.
CHEREMETIEV Nikita, frère d'Ivan, plusieurs fois blessé sur les champs de bataille, pacificateur de la région de Kazan, étranglé en 1560.
CHOUÏSKI Aleksandr, prince, héros de la prise de Kazan puis gouverneur de cette ville, décapité à la hache à Moscou devant l'église de l'Intercession de la Vierge (actuelle basilique Basile le Bienheureux sur la Place Rouge) le 04.02.1565. Son fils, Petr, âgé de 17 ans, ramassa sa tête, l'embrassa tendrement et se livra ensuite à la main du bourreau.
CHOUÏSKI Andreï, arrêté fin 1543 en plein banquet et livré aux piqueurs qui, en pleine rue, le firent dévorer vivant par des chiens de chasse. Ce fut la première victime humaine d'IVAN IV ; auparavant, il s'était "contenté de crever les yeux des oiseaux, de leur ouvrir les entrailles et de balancer des jeunes chiens par dessus les murailles du Kremlin pour jouir de leurs cris d'agonie tandis qu'ils essayaient de se relever les pattes ou l'échine brisées".
CHOUÏSKI Petr Aleksandrovitch, décapité à Moscou à la hache le 04.02.1565 (voir plus haut).
CHYBANOV, écuyer d'Andreï KOURBSKI, torturé, tenaillé et tué en 1562.
CHYCHKINE, exécuté en 1560 avec sa femme et ses enfants.
CORNELIUS, abbé de Psok, écrasé lentement sous une meule en 1577.
EUDOXIE, princesse, tante éloignée du tsar, nonne, noyée à Biélozersk en 1581.
EUPHROSINE, princesse : voir VLADIMIR ANDREÏEVITCH.
FEDOROV, grand écuyer de la Cour depuis 19 ans, poignardé par IVAN IV vers 1568, achevé par les opritchniks. Son cadavre fut abandonné aux chiens. Sa femme fut égorgée.
Femmes de boyards et de négociants violées à mort par IVAN et ses officiers en juillet 1568.
FOUNIKOV, trésorier, arrosé alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, "si bien que la peau se détacha comme celle d'une anguille", le 25.07.1570. Sa veuve, sur du prince Athanase VIAZEMSKI, fut mise nue devant sa fille âgée de 15 ans puis placée à califourchon sur une corde tenue pour subir le lent supplice du frottement. Le même jour, il y eut quelque 200 exécutions capitales.
GLINSKI Iouri, accusé d'avoir par sorcellerie mis le feu à Moscou. Il fut assommé le 26.06.1547 dans la cathédrale de l'Assomption, puis étranglé et son corps fut traîné hors du Kremlin jusqu'à la place réservée aux exécutions capitales. Tous les proches de la famille et tous les serviteurs d'Iouri GLINSKI.
GOLOKHVASTOV, voïévode, réfugié dans un monastère sur la rive de l'Oka. Les opritchniks le dénichèrent et IVAN le fit sauter en le plaçant sur un baril de poudre.
Habitants de Novgorod. Les religieux furent assommés à coups de massue. Les autres habitants furent amenés à raison d'un millier par jour à compter du 07.01.1570 devant IVAN IV et son fils IVAN. Ils furent tirés dans l'eau glacée du Volkhov avec des traîneaux auxquels ils étaient attachés par la tête ou par les pieds. Les mères étaient noyées avec leurs enfants au sein, les maris mouraient dans les bras de leurs femmes. Des opritchniks, montés sur des barques, achevaient ceux qui surnageaient et tentaient de survivre à coups de lances, de pieux et de haches. En cinq semaines, le nombre des victimes fut de 15 à 60.000 selon les auteurs.
IVAN, tsarévitch, grièvement blessé d'un coup de pique à la tête par son propre père lors d'un accès de fureur de celui-ci, décédé après quatre jours d'agonie le 19.11.1581.KACHINE Iouri, prince, membre du Conseil, et son frère, exécutés tous deux en 1560.KOUBENSKI Ivan, décapité en 1546.
KOURLIATEV, prince, ami d'Alexeï ADACHEV (voir plus haut), contraint dans un premier temps à devenir moine puis condamné à mort avec toute sa famille en 1560.LEONIDE, archevêque de Novgorod, cousu dans une peau d'ours en 1577 et livré à des chiens affamés qui eurent tôt fait de le déchiqueter.Marie, amie polonaise d'Alexeï ADACHEV, et ses cinq fils, tous exécutés en 1560.MARIA, la seconde tsarine, probablement assassinée le 01.09.1569.MARIA, sur (ou femme ?) de son cousin germain VLADIMIR, nonne, noyée en 1581 à Biélozersk.Moines qui avaient refusé un inventaire exhaustif de leur trésor. En 1581, devant le tsar et son fils Ivan, on enferma les religieux dans une cour bordée de hauts murs et on leur donna à chacun un chapelet et un épieu avant de les livrer à des ours affamés. Les moines furent étripés comme des souris déchirées par des chats en furie. Un seul frère parvint à tuer un ours sauvage à coups d'épieu avant de mourir. On le canonisa plus tard pour cet acte de courage.MOROZOV Mikhaïl, torturé avec sa femme et ses deux fils en 1577.
MOUROMTZEV Vassiane, disciple de CORNELIUS, abbé de Psok (voir plus haut), écrasé lentement sous une meule en 1577.ODOÏEVSKI Nikita, exécuté en 1577.
OVTCHINA-OBOLENSKI, prince, poignardé en 1560 par IVAN IV pour avoir osé traiter le jeune Fédor BASMANOV, favori du tsar, de sodomite.PHILIPPE, métropolite, exécuté le 08.11.1568. D'abord enfermé au couvent de l'Epiphanie, condamné à la prison perpétuelle, enchaîné et finalement étranglé par MALIOUTA-SKOURATOV, favori d'IVAN IV. Il fut canonisé en 1652 et ses restes furent alors ramenés à la cathédrale de l'Assomption à Moscou.PRONSKI Ivan, général, noyé vers 1568.PROSOROVSKI Nikita, contraint de poignarder son frère en prison en juillet 1570 puis exécuté comme fratricide.REPNINE, prince, assassiné sur ordre quelques jours après avoir refusé un masque qu'IVAN IV voulait lui appliquer de force sur le visage.
ROSTOVSKI, trois princes exécutés vers 1568, dont Simeon et Nikolaï. L'un d'eux, voïévode à Nijni Novgorod, fut déshabillé avant d'être décapité, puis son corps fut jeté dans la Volga.SATINE, trois frères, exécutés en 1560. N.B. : Une de leurs surs a épousé Alexeï Fédorovitch ADACHEV (voir plus haut).TCHENIATOV Petr, prince, d'abord conduit dans un monastère puis torturé (grillé sur un plat à rôtir) vers 1568.TCHEVIREV Dimitri, prince, empalé le 04.02.1565.TELEPNEV, prince, empalé le 25.07.1570. Des soldats violèrent sa mère devant lui.THEODORITE, archimandrite, noyé en 1577.TIOUTINE, trésorier d'Etat, haché en morceaux vers 1568, ainsi que sa femme, ses deux fils et ses deux filles en bas âge. L'exécution fut assurée par le prince circassien, frère de la tsarine. VIAZEMSKI Athanase, mort au cours de supplices préliminaires en juillet 1570.Victimes moscovites du 28.07.1570 dont 80 femmes noyées dans la Moskva. Les corps découpés de leurs maris furent laissés à pourrir dans les rues et pendant plusieurs jours les chiens traînèrent des morceaux de chair humaine à travers Moscou.VISKOVATI Ivan, prince, pendu par les pieds, bâillonné avant d'avoir la peau tailladée en lanières le 25.07.1570.VLADIMIR ANDREÏEVITCH, prince cousin d'IVAN IV, sa femme Evdokia et leurs deux fils convoqués à Alexandrovskaïa Sloboda. Tous étaient accusés d'avoir empoisonné la tsarine MARIE.. Les suivantes de la princesse furent dénudées et fusillées. La princesse EUPHROSINE, religieuse, fut noyée sur ordre du tsar.VORONTZOV Fédor, ex-favori, décapité en 1546.VORONTZOV Vassili, frère de Fédor, décapité en 1546.VOROTYNSKI Mikhaïl, prince, héros de la conquête de Kazan, banni à Biélozersk en 1560 avec tous les siens. Rentré en grâce en 1565. Il fut attaché sur une poutre entre deux brasiers ardents en 1577. Détaché, grièvement brûlé, il mourut lors de son transport au monastère de Biélozersk.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Avocats en parlement en Franche-Comté 17e-18e siècles Ébauche de catalogue
d'après "les Francs-comtois pendant la révolution" (1)
La quasi totalité des avocats en Parlement de Franche-Comté, contemporains de la Révolution de 1789, ont joué un rôle politique essentiel et même décisif dans cette période charnière de l'histoire. Enthousiasmés par les idées nouvelles, solidaires à travers les liens de la franc-maçonnerie, certains fondèrent ou présidèrent des Sociétés Populaires, des Sociétés des Amis de la Constitution, voire des comités révolutionnaires. Élus ou nommés maires, officiers municipaux, membres de conseils de districts, officiers de la garde nationale, juges de paix, administrateurs (conseillers généraux) des départements comtois (Doubs, Jura, Haute-Saône) et souvent membres du directoire de ces assemblées, ils ont aussi été appelés à siéger aux Etats Généraux, à l'Assemblée Législative, à la Convention et au Conseil des Cinq-Cents.
Si quelques-uns de ces avocats en Parlement pouvaient afficher une noblesse toute récente, les autres n'étaient le plus souvent que de simples propriétaires de fiefs, s'empressant d'adjoindre les noms de ceux-ci à leurs patronymes pour se donner toutes les apparences du second ordre.
La Révolution constitua pour beaucoup d'entre eux un véritable tremplin social tandis que quelques-uns, rares il est vrai, émigrèrent ou durent présenter leurs têtes sous le couperet de la guillotine.
AMIOT Claude François, d'Étalans (25)
AMIOT François Joseph, d'Étalans (25)
AMOUDRU Anatoile (1739-1812), avocat, géomètre et architecte, maire de Dole (39)
ANDRÉ Louis Ignace, de Dole (39)
ANGRER Claude François, de Dole (39)
ARNOUX Bon Ignace, maire de Besançon (25)
AUXIRON (d') Jean Baptiste (1726-1800), franc-maçon, professeur de droit à l'Université de
Besançon (25)
AVENNE François Hilaire (1738-1807), de Gy (70), administrateur du département de la
Haute-Saône
BABEY Pierre Athanase Marie (1743-1815), d'Orgelet (39), député du département du Jura à
la Convention
BAILLY Alexis, de Besançon (25)
BAILLY Joseph, d'Ornans (25), conseiller au magistrat d'Ornans
BAILLY-BRIET Jean Baptiste, de Besançon (25), substitut du procureur général au
Parlement de Franche-Comté
BAILLY-FAIVRE Charles François, officier municipal de Vesoul (70), membre du directoire
du département de la Haute-Saône
BANGUE Jean Bonaventure (1749-1840), commissaire du Directoire exécutif près
l'administration municipale du canton de Dampierre (39), maire de Dampierre
BARBAUD, conseiller municipal de Besançon (25) en 1789-1790
BARBAUD Jean Baptiste Xavier, écuyer, de Pontarlier (25), président du club
révolutionnaire de Pontarlier, président du canton de Pontarlier en 1797
BARBAUD de CUENOT Jacques, écuyer, de Pontarlier (25)
BARBEROT Claude Alexandre, ancien capitaine d'infanterie
BASSAND, de Besançon (25), conseiller municipal de Besançon puis commissaire du
Directoire pour le canton de Rougemont (25)
BAUD Pierre François (1749-1821), de Poligny (39), administrateur du département du Jura
BAVILLEY Jean Louis, de Port Lesney (39)
BAVOUX Claude Antoine, de Septmoncel (39), président de l'administration municipale du
canton de Saint-Claude (39)
BELAMY Nicolas Joseph, de Besançon (25), né en 1740, secrétaire de la municipalité de
Besançon
BERGERET Jean Etienne (noble)
BERGERET Jean François, second avocat général au Parlement de Franche-Comté
BÉSUCHET
BÉVALET Jean François, né en 1748, président du club des jacobins de Pontarlier (25),
président du canton de Pontarlier en 1798
BILLARD François Gabriel (1764-1824), administrateur du département de la Haute-Saône
BILLON Claude Joseph, président du canton de Saint-Vit (25)
BILLOT Antoine François, de Besançon (25)
BILLOT Antoine François, de Besançon (25), administrateur puis procureur général syndic
du département du Doubs
BINÉTRUY de GRANDFONTAINE René Philippe Louis (1723-1795), de Besançon (25),
secrétaire du Roi, audiencier en 1730, sgr de Grandfontaine en 1743, intendant du duc de
Randan
BLANC Jean Denis Ferréol (1743-1789, de Besançon (25), député à l'Assemblée
Constituante pour le tiers état du bailliage de Besançon, mort à Versailles pendant les Etats
Généraux. On lui fit des obsèques nationales.
BLONDEAU Jean Baptiste, maire de Baume-les-Dames (25)
BOISSARD Théodore Joseph, de Pontarlier (25), ancien officier au régiment de Picardie
BOLARD Xavier
BÔLE, fondateur du club révolutionnaire de Vuillafans (25)
BOLOT Claude Antoine (1742-1810), maire de Vesoul (70), député du département de la
Haute-Saône à la Convention (régicide)
BONARD David, de Besançon (25), membre du directoire du district de Besançon,
administrateur du département du Doubs
BONMARCHAND, de Salins (39)
BONNEFOY cadet, d'Ornans (25)
BONOT, de Lons-le-Saunier (39)
BOUHÉLIER d'AUDELANGE Hippolyte (1757-1841), avocat général au Parlement de
Besançon (25)
BOULY François Joseph, de Saint-Loup-sur-Semouse (70), administrateur du département de
la Haute-Saône
BOUQUET Claude François, de Vesoul (70)
BOURGON Gabriel François, de Besançon (25)
BOURQUENEY Claude Étienne, de Crosey-le-Grand (25), membre du directoire du
département du Doubs
BOUSSAUD Claude François (1759-1837), maire de Lons-le-Saunier (39) en 1792-1793
BOUVENOT Pierre, officier municipal de Besançon (25), député à l'Assemblée Législative
BOUVENOT Pierre Charles, échevin d'Arbois (39)
BOUVERET Nicolas Bonaventure, de Parcey (39), juge-châtelain de plusieurs seigneuries
BOUVIER, de Dole (39), nommé préfet du Doubs en 1800 mais refusant le poste
BRESSAND Jean François
BRESSAND Nicolas, de Raze (70)
BRESSAND Nicolas Alexis Thomas, de Baume-les-Dames (25)
BRESSAND Pierre François, de Raze (70), député suppléant du tiers état du bailliage
d'Amont aux Etats Généraux en 1789
BRIOT Pierre Thérèse Joseph, d'Orchamps-Vennes (25)
BRUET François Joseph, maire d'Arbois (39)
BRUSSET Paul François Joseph, de Gray (70)
CALF Claude Etienne, de Besançon (25)
CANTOR Jean François, de Besançon (25), inscrit en 1711
CHAFFIN Etienne, de Poligny (39)
CHAMPION Louis François, de Charnod (39)
CHAMPREUX Claude Joseph François, de Salins (39)
CHEVILLARD Jean Joseph, de Lons-le-Saunier (39)
CHOUPOT Claude François Xavier, conseiller au bailliage-présidial de Vesoul (70)
CHRISTIN Charles Antoine, de Saint-Claude (39)
CLAUDET Marie Antide (1753-1812), né à Pontarlier (25), Besançon, accusateur public au
tribunal du district de Salins (39) en 1790-1792, député au Corps Législatif de 1803 à 1809
CLERC, de Vesoul (70), seigneur d'un fief à Villersexel (70) en 1788
CLERC Jean Baptiste Joseph, d'Orgelet (39)
CLERC Pierre Michel Dorothée (1762-1848), né à Fallon (70), Besançon (25)
CLERMONT Claude Ignace Joachim, de Salins (39)
CLERMONT Ignace, de Salins (39)
COCHARD Claude Alexis (1743-1815), avocat au baill.-présidial de Vesoul (70), maire de
cette ville en 1784, deuxième échevin en 1789, député du tiers état du bailliage d'Amont
aux Etats Généraux en 1789 et à l'Assemblée Constituante
COLIN Ferdinand François (1754-1817), de Pontarlier (25)
COLOMBOT Jean, de Grattery (70)
COMBETTE Augustin Ferdinand, bailli de Nozeroy (39)
CONVERS François (1733-1807), de Vernantois (39), maire de Vernantois puis membre du
conseil général du district de Lons-le-Saunier (39), juge de paix
COPEL Jean François, de Besançon (25), né en 1738, intendant de l'archevêque de Besançon
CORDIER Laurent, d'Orgelet (39)
CORNET André François, membre de la municipalité de Besançon (25) sous le Directoire,
nommé sous-préfet de Baume-les-Dames (25) mais refusant ce poste
COSTE L., de Besançon (25), secrétaire du club des jacobins de Besançon (25), procureur de
la commune de Besançon, bibliothécaire de la ville
COURLET de BOULOT Claude François (1723-1807), émigré, maire de Boulot (70)
COUTHAUD Antoine Pierre (noble) (1742-1826), de Besançon (25), secrétaire général du
département du Doubs
CRESTIN Jean François (1745-1830), de Vellexon (70), vicomte maïeur de Gray (70), maire
de Gray, président du département de la Haute-Saône
CUPILLARD Charles François (alias Claude François), de Montlebon (25), juge de paix,
président du tribunal correctionnel de Morteau (25)
DALLOZ Jean Philippe Laurent, de Saint-Claude (39)
DEFUANS François Ignace (1753-1831), membre du conseil du district de Dole (39), juge de
paix du canton de Rochefort (39) en 1790
DELAPORTE Claude Etienne (1757-1807), d'Ounans (39)
DELAROCHE Claude Etienne, d'Augicourt (70), membre du directoire du département de la
Haute-Saône
DENISET Étienne, de Lons-le-Saunier (39)
DESBIEZ Marie François Xavier (1749-1815), second avocat du Roi au Parlement de
Besançon (25)
DESBIEZ de SAINT-JUAN, de Besançon (25), né v. 1748, avocat général au Parlement de
Besançon
DEVILLERS, membre du conseil général de la commune de Besançon (25)
DIDELOT Thérèse Nicolas (1760-1813), de Baume-les-Dames (25)
DONNEUX Joseph, d'Orgelet (39)
DORMOY, de Besançon (25)
DROUHARD Alexis ( 1783), de Fallerans (25), lieutenant particulier au bailliage et
présidial de Besançon (25)
DROUHARD François (alias Jean François) (1732-1814), administrateur du département du
Doubs
DROZ Jean Baptiste Yves Antoine
DROZ Pierre Alexis, de Pontarlier (25), avocat du roi de la ville de Pontarlier (25)
DUBUISSON Claude François Charles, de Vauvillers (70), administrateur du département de
la Haute-Saône
DUMAS Jean François, vice-président du directoire du département du Jura, frère de
DUMAS le Rouge
DUMONT de SANDON Claude Joseph, de Pontarlier (25), juge-châtelain de la seigneurie de
Joux. Sa fille sera guillotinée.
DUMONTET de LA TERRADE François Simon Augustin (1746-1821), de Scey-sur-Saône
(70), maire de Vesoul (70), juge, député au Conseil des Anciens, baron de l'Empire
DUNAND Claude François, de Bletterans (39)
DUNAND Pierre François, de Bletterans (39), administrateur du département du Jura
DUNOD de CHARNAGE François Joseph (1705-1765), maire de Besançon (25), chevalier
de l'Ordre de Saint-Michel
DUPUIS
DURGET Pierre Antoine (1745-1817), de Vesoul (70), député du tiers état du bailliage
d'Amont aux Etats Généraux, anobli, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur,
chevalier de Malte
DURNEY, de Besançon (25), juge de paix du district de Besançon
DUTAILLY Claude Antoine (1741-1794), de Besançon (25), agent du marquis de Choiseul,
guillotiné
DUVOY Jean François (1752-1837, de Melincourt (70), maire de Chazelle-lès-Saint-Rémy
(70) pendant la Révolution
ÉBRARD Pierre Gabriel, de Lons-le-Saunier (39), franc-maçon, président du département du
Jura
ÉPAILLY Antoine
FAIVRE Jean Claude
FAIVRE Marie Alexis, de Baume-les-Dames (25)
FAIVRE d'ARCIER Claude Antoine Denis, de Besançon (25)
FALQUE, de Vuillafans (25), fondateur du club révolutionnaire de Vuillafans (25)
FATON de FAVERNEY Jacques François Hyacinthe, de Quingey (25), ancien officier des
gardes du corps du prince de Conti
FEBVRE François Joseph (1763-1838), d'Arinthod (39), administrateur du département du
Jura, membre du Conseil des Cinq-Cents
FEBVRE Marie Adrien, d'Arinthod (39)
FENOUILLOT de FALBAIRE Jean (1748-1826), né à Salins (39), Besançon (25), émigré,
écrivain
FLAVIGNY Jean Claude, de Vesoul (70)
FLEURY, de Vercel (25), membre du directoire du district d'Ornans (25)
FOBLANT Hugues L., né à Bulle (25) en 1752, administrateur du département du Doubs
FOILLENOT Charles Gabriel (1711-1789), écuyer, seigneur d'Attricourt (70)
FORAISSE, administrateur du département du Doubs
FORNO, officier municipal de Besançon (25), élu fin 1792
FRANCHET de RANS Charles Marie François Joseph (1721-1799), né à Besançon (25),
Alexandrie en Piémont (Italie), avocat puis conseiller au Parlement de Franche-Comté
FRANSQUIN Antoine, demeurant à Dole (39), juge-châtelain de plusieurs seigneuries
FROIDOT Marc, ancien bailli de Faucogney (70) en 1789, administrateur du département de
la Haute-Saône
GACON Claude Étienne, de Lons-le-Saunier (39)
GACON Claude Claire Étienne (1755-1832), de Lons-le-Saunier (39), président du tribunal
criminel du Jura de 1804 à 1811
GALMICHE Jean Baptiste (1751-1798), de Vesoul (70), administrateur du département de la
Haute-Saône
GARNIER, de Besançon (25)
GARNIER Antoine (1750-1816), avocat puis conseiller au bailliage-présidial de Vesoul (70),
administrateur du département de la Haute-Saône
GARNIER Joachim, de Salins (39), conseiller du Roi, contrôleur des bois et salines
GARNIER Pierre Gabriel, maire de Gy (70), administrateur du département de la Haute-
Saône
GARNISON Nicolas Ignace, noble, avocat en Parlement en 1759
GASTEL François Xavier, né à Luxeuil (70) en 1752
GASTEL Pierre François,, maire de Luxeuil (70) en 1763
GAUDION Claude François, né au Bizot (25) en 1748, administrateur du département du
Doubs
GAUDION Étienne Joseph, du Bizot (25)
GAY Jean Baptiste (1748-1804), de Dole (39), président de la Société Populaire de Dole,
membre du directoire du district de Dole, juge
GENEAUD Georges François (1761-1821), demeurant à Orgelet (39)
GERMAIN Jean François (1762-1825), né à Censeau (39), administrateur du département du
Jura, député à l'Assemblée Législative puis membre du Conseil des Cinq-Cents
GERRIER Pierre François Désiré (1765-1843), de Lons-le-Saunier (39), membre du
directoire du département du Jura puis maire de Lons-le-Saunier (39)
GIRARDE Philibert (1756-1821), de Saint-Aubin (39), membre du directoire du district de
Dole (39)
GIRARDET Daniel Gabriel Ferréol, à Besançon (25) en 1843, administrateur du
département du Jura en 1791, puis juge à la cour d'appel de Besançon
GIRARDOT Pierre François, administrateur du département de la Haute-Saône
GOISSET, né vers 1755, commissaire du roi près le tribunal criminel du départ. du Doubs en
1792
GOUX de VELLEGUINDRY, officier municipal de Besançon (25) en 1790
GRAND Claude Ambroise, demeurant à Gray (70)
GRAND Joseph Désiré, avant 1788, demeurant à Lons-le-Saunier (39)
GRANDVAUX Hyacinthe Alexis (1739-1817), de Poligny (39), juge-châtelain de plusieurs
seigneuries, premier adjoint au maire de Poligny
GRANDVAUX Jean, 1797, maire de Baume-les-Messieurs (39), administrateur du
département du Jura
GRANDVOINET Claude Antoine, de Ronchaux (25), président du canton de Ronchaux,
maire de Ronchaux, juge au tribunal de Quingey (25), fondateur du club révolutionnaire de
Quingey
GRAPPE Pierre Joseph (1756-1825), né à Trébief (39), professeur de droit romain,
administrateur du département du Doubs, député aux Cinq-Cents, député et secrétaire au
Corps Législatif sous le Consulat, puis professeur de droit civil à la Faculté de Droit de
Paris
GRÉAT Claude François Augustin, de Rotalier (39)
GRENOT Antoine (1748-1808), député aux Etats Généraux pour le tiers état du bailliage de
Dole (39)
GRESSET Richard François, secrétaire et trésorier de l'Université de Besançon (25)
GRIMONT Antoine Joseph
GROSEY Louis Denis Catherin (1750-1817), juge-châtelain de la seigneurie de Rahon (39),
accusateur public près le tribunal criminel du Jura
GROSJEAN Claude François Joseph, de Mollans (70), avocat, juge, président du club
révolutionnaire de Baume-les-Dames (25)
GROSJEAN Thomas Jean Baptiste, membre du directoire du département de la Haute-Saône
GUELIN, de Lons-le-Saunier (39)
GUENOT Philippe, commandant de la garde nationale de Lure (70), maire de Genevreuille
(70) sous le Consulat et conseiller de préfecture en 1810
GUÉRILLOT Claude Étienne, de Poligny (39)
GUÉRILLOT Jean Adrien (1734-1801), de Poligny (39), officier municipal de Poligny,
membre du conseil du district de Poligny
GUICHARD Jean Baptiste (1747-1831), juge-châtelain de la baronnie de Ruffey (39) en 1773
et de la baronnie de Chevreaux (39) en 1782, maire de Lons-le-Saunier de 1783 à 1786,
membre du conseil général du Jura de 1800 à 1804 et dès 1809
GUILLAUME père (1725-1793), de Besançon (25), officier municipal de Besançon, mort en
prison à Dijon (21)
GUILLAUME de GEVIGNEY Charles Marie Joseph, seigneur de la baronnie de Percey en
1784
GUIRAND Denis Grégoire (1740-1809), de Saint-Claude (39), capitaine de la 2e compagnie
de la légion nationale de Saint-Claude en 1789, président du directoire du district de St-
Claude (39) en 1791, nommé administrateur du département du Jura
GUY, de Besançon (25), émigré
GUYE Charles Louis Joseph (1765-1805), de Salins (39), président de l'administration
municipale de Salins (39)
GUYON Joseph Hyacinthe (1732-1813), de Poligny, président du conseil du district de
Poligny
HUGON Xavier Joseph (1754-1843), de Vesoul (70), administrateur du district de Vesoul
puis procureur syndic puis juge au tribunal du département de la Haute-Saône
HUGUENOT J. L. Benoît, administrateur du département du Doubs
HUMBERTJEAN Hugues Étienne, né en 1753, administrateur du département du Jura
ISABEY Antoine Joseph Théophile
JACQUEMIN Jean Joseph (1747-1799), de La Tour du Meix (39), membre du conseil du
district d'Orgelet (39)
JALOUX Henri Ferdinand (dit Ferdinand), de Besançon (25), né en 1711, franc-maçon
JANNIN Pierre Ignace, subdélégué de l'Intendant de Franche-Comté, ancien maire de Lons-
le-Saunier (39) en 1736
JANOD Jean Joseph Joachim (1761-1836), membre du directoire du département du Jura, élu
membre du Conseil des Cinq-Cents mais refusant le poste
JARRY, de Besançon (25), juge de paix du canton de Beure (25), administrateur de la
commune de Besançon (25)
JEANGÉRARD Denis, de Vy-lès-Lure (70), administrateur du département de la Haute-
Saône
JOLIET Vincent (1712-1782), de Vesoul (70)
JOURNOT Jean Guillaume (1671-1725), bailli de St-Hippolyte, Maîche et de la Franche-
Montagne
LABBEY de BILLY Nicolas Antoine (1753-1825), de Besançon (25)
LABOREY Pierre François Marie, d'Ormoy (70), député à l'Assemblée Législative, maire
d'Ormoy
LACHICHE Jean Baptiste
LAMBERT Mathieu, de Mouthier (25), membre du directoire du département du Doubs
LAMBOLEY Jean-Baptiste, de Saint-Hippolyte (25), juge au tribunal du lieu
LANCHAMP Jean Baptiste Xavier
LANGE, de Besançon (25)
LAPOULE Jean Louis (1737-1796), de Besançon (25), député du Tiers état aux Etats
Généraux, secrétaire des Jacobins en 1790
LAURENCEOT Claude Louis, né en 1757, maire d'Arbois (39)
LAURENCEOT Jean Claude, d'Arbois (39)
LAURENT Jean François, de Besançon (25)
LAURENT Louis Thomas (1733-1812), avocat de Besançon (25), secrétaire du club des
jacobins à Besançon, administrateur du département du Doubs
LEBEAUX Jean Claude
LÉCUREL Claude Louis Salomon (1756-1803), né à Besançon (25), Luxeuil (70)
LÉCUREL des CORAUX Jean Baptiste, de Besançon (25)
LEREBOURS Pierre René, né à Paris en 1754, demeurant à Pontarlier (25), directeur des
postes, commandant de la garde nationale de Pontarlier
LESCOT, de Lombard (25), conseiller municipal de Besançon (25) en 1790
LOMBARD, officier municipal de Besançon (25) en 1790
LOUVOT Claude Étienne Joseph, de Besançon (25), administrateur du département du Doubs
LOUVRIER Jean Baptiste, de Dole (39), procureur du roi en la maîtrise des eaux et forêts de
Dole
MAGDELEINE Jean Nicolas, de Dole (39)
MAILLARD Claude Bonaventure (25)
MAILLARD François Bonaventure Flavien, de Pontarlier (25)
MAILLARD François Joseph
MAILLOT Claude Antoine, demeurant à Vuillafans (25)
MAILLY de QUINTIGNY (de) Michel François Gabriel Raphaël Xavier, second président de
la Chambre des Comptes de Dole (39)
MAIRE Jean François, d'Ornans (25)
MAIRE Pierre Xavier Thérèse, de Pontarlier (25)
MARCHAND Alexis Jean Charles, de Baume-les-Dames (25), administrateur du département
du Doubs
MARCHAND Charles Étienne, de Baume-les-Dames (25), président du district de Baume-
les-Dames, juge au tribunal criminel du Doubs
MARCHAND Claude Simon, de Baume-les-Dames (25), juge au tribunal civil du Doubs
MARCHAND Jean Baptiste Alexis, de Baume-les-Dames (25)
MARGUET Sébastien Augustin Eléonor, de Sancey-le-Long (25), commandant en chef des
gardes nationales du canton de Sancey
MARMET Claude François, de Salins (39)
MARQUIS de TALLENAY Nicolas Charles Bonaventure (1761-1819), avocat général au
Parlement de Besançon (25)
MARSOUDET, de Salins (39)
MARTIN François, né à Dampierre-sur-Salon (70), député du tiers état aux Etats Généraux,
maire de Gray, membre du Corps Législatif de 1807 à 1811
MARTIN Jean François, de Besançon (25), officier municipal de Besançon
MASSON J. Joseph, président du district de Pontarlier (25), administrateur du département du
Doubs
MASSON Pierre François, de Besançon (25)
MATHELOT Claude François, seigneur de Bourbévelle (70)
MATHEROT Jean Baptiste, de Besançon (25)
MATHEROT Jean Baptiste Ignace, de Besançon (25)
MAUVAISET Richard Victor (1740-1805), de Pontarlier (25), juge de paix
MERLE Jean Nicolas (1724-1800), de Saint-Amour (39), maire de Saint-Amour,
administrateur du département du Jura
MICHAUD de DOUBS Jean Baptiste (1759-1819), de Pontarlier (25), administrateur du
département du Doubs, député à la Convention (régicide)
MICHEL Jean François, juge de paix du canton de Nancray (25), administrateur du
département du Doubs
MILLOT Nicolas Benoît, de Besançon (25)
MIROUDOT Jean Baptiste, maire de Vesoul (70)
MONIOTTE Claude François, de Besançon (25)
MONNET Jean Nicolas, né à Moirans (39)
MONNIER Basile, de Sirod (39)
MONNIER Basile Joseph (1732-1814), de Sirod (39)
MONNIER Jean François Balthazar, seigneur de Savigna
MONNIER Marie Étienne (1764-1849), né aux Planches en Montagne (39), Poligny (39),
procureur syndic du district de Poligny
MONNOT Jacques François Charles (1743-1825), né à Quingey (25), officier municipal de
Besançon, vice-président du conseil général du Doubs
MONNOT Modeste, de Besançon (25), officier municipal de Besançon en 1792, membre du
comité révolutionnaire de Besançon, maire de Besançon en 1794-1795
MORAND Alexis François (1747-1829), de Montbenoît (25), administrateur du département
du Doubs, juge de paix du canton de Montbenoît
MOREL René (1734-1814), de Légna (39), administrateur du département du Jura
MORIVAUX Anatoile François Antoine (1745-1816), d'Arbois (39)
MOUGENOT François Bruno, maire de Cléron (25), fermier du château de Cléron
MOURCET Jean François Gabin, de Levier (25), juge de paix du canton de Levier, membre
du conseil général du district de Pontarlier (25)
MUGNIER Jacques, membre du directoire du département du Doubs
MUNIN Antoine Marie Joseph, maître de forges, président de l'administration municipale du
canton de Vernantois (39)
MUYARD de VOUGLANS Pierre Antoine, avocat en 1760
NARÇON Claude François, maire de Gray (70)
NICOD Jean Baptiste Antoine Gabriel (1748-1824), président du district de Saint-Claude
(39)
NICOD Pierre Aimé, de Saint-Claude (39)
NICOD de RONCHAUD Claude Ignace Emmanuel, procureur fiscal de la Grande Judicature
de Saint-Claude (39)
NODIER Antoine Melchior (1738-1708), de Besançon (25)
NOIROT Jean Gabriel, d'Arbois (39)
NOUVOT Claude Étienne, de Gray (70), président de la Société Populaire de Gray,
administrateur du département de la Haute-Saône
NYCOLLIN P. Ant., officier municipal de Besançon (25), administrateur du département du
Doubs, juge au tribunal criminel du Doubs
ORDINAIRE Jacques, de Besançon (25)
ORDINAIRE Jean Jacques (1770-1843), de Besançon (25), premier recteur de l'Académie de
Besançon (25)
ORDINAIRE Pierre François (1731-1804), de Salins (39)
OUTHENIN, de Mouthier-(Hautepierre) (25)
PAJOT, de Besançon (25)
PANISSET Joseph Emmanuel, né à Saint-Claude (39), maire de Charchillat (39)
PARREAU Antoine Pierre, de Rochejean (25)
PARREAU Pierre Joseph (1744-1816), de Rochejean (25), juge-châtelain des seigneuries de
Chapois, Chissey et Germigney, Goailles, Lemuy, Port-Lesney et Saint-Thiébaud, président
du tribunal du district de Salins (39) de 1790 à 1795 puis administrateur du département du
Jura
PARGUEZ Nicolas Ambroise, de Pontarlier (25)
PAUTHIER, de Baume-les-Dames (25)
PELAY Joseph André
PERRECIOT Claude Joseph Bonaventure (1728-1798), de Roulans (25), franc-maçon, député
suppléant du tiers état aux Etats Généraux, administrateur du département du Doubs, juge
de paix du canton de Roulans, président du canton de Verne (25)
PERRECIOT François Joseph
PERRIN Antoine Hyacinthe, de Lons-le-Saunier (39)
PERRIN Antoine Ignace (1748-1821), de Lons-le-Saunier (39), député à l'Assemblée
Législative, président du tribunal criminel du Jura
PERTUSIER Jean Claude (1755-1822), de Besançon (25)
PETITCOLAS de PURY, conseiller de la République de Mandeure (25), agent national du
district de Montbéliard (25)
PETITJEAN Charles François Anne (1766-1848), d'Arbois (39)
PETITJEAN Claude Étienne, d'Arbois (39)
PIARD Jean Hubert
PICOT Étienne Gaspard, né à Cuisia (39), président de l'administration municipale du canton
de Cousance (39)
PITHOU Pierre
PLUSQUIN Laurent, de Pesmes (70), juge au tribunal du Jura, maire de Dole (39) en 1797 et
à nouveau en 1808
PONCELIN Jean François
POUHAT Joseph
POUPON Marie Gabriel (1736-1792), d'Orgelet (39), administrateur du département du Jura,
député suppléant à l'Assemblée Législative
POURCELOT Claude Joseph Marcel (1759-1829), de Besançon (25), franc-maçon (orateur
de sa loge), élu membre du directoire du département du Doubs mais exclu comme proche
parent d'émigré
POURCELOT Louis Charles Bonaventure, de Besançon (25)
POURCHERESSE Thomas François
POURTIER Jacques Philippe Désiré
PROST Claude Charles, de Dole (39), juge de paix à Dole, député du Jura à la Convention
PROUDHON Jean Baptiste Victor (1758-1838), né à Chasnans (25), professeur de
l égislation, administrateur du département du Doubs
QUETAUD Claude Antoine, maire de Pontarlier (25)
QUIROT Claude Louis, à Besançon (25), officier municipal de Besançon
QUIROT Claude Louis le Jeune, de Besançon (25)
QUIROT Jean Baptiste (1757-1820), de Besançon (25), membre du directoire du département
du Doubs, député à la Convention puis président du Conseil des Cinq-Cents
RABUSSON Claude Pierre (1752-1802), de Dole (39), président du directoire du département
du Jura
RACINE, de Besançon (25)
RAILLARD de GRANDVELLE Jean François, seigneur de Gevigney, Mercey, Grandvelle et
Lieffrans, maire de Vesoul (70)
RANCE DE GUISEUIL François Joseph Colomban, né à Besançon (25) en 1748
RECEVEUR Jérôme Ambroise, de Bonnétage (25), président du district de Saint-Hippolyte
(25)
REGNAUD, de Pontarlier (25), receveur du district de Pontarlier
REGNAULT d'ÉPERCY Charles Antoine François (1731-1805), lieutenant maïeur d'Arbois
(39), dernier seigneur engagiste des Planches (39), député du département du Jura à
l'Assemblée Législative
REGNAULT d'ÉPERCY Pierre Ignace, d'Arbois (39), député du tiers état pour le bailliage
de Dole (39) aux Etats Généraux
REGNAULT-MAULMIN Jean Claude (1745-1822), de Conliège (39)
RENAUD, de Saint-Amour (39), "avocat aux Parlement des duché et comté de Bourgogne"
RENAUD (alias REGNAUD) Claude François (1732-1806), né à Saint-Amour (39), à
Besançon (25), capitaine de la garde nationale et maire de Saint-Amour, président de
l'administration municipale du canton de Saint-Amour
RICHARDIN Claude François, officier municipal d'Ornans, vice-président puis président du
district d'Ornans (25)
ROBERT, de Poligny (39), acquéreur de biens nationaux
ROBERT Pierre Joseph (1765-1800), né à Champvans (39), à Dole (39), administrateur du
département du Jura
ROCHET François Joseph, demeurant à Faucogney (70), président du directoire du
département de la Haute-Saône
ROCHET Joseph Laurent, de Vosbles (39), membre du conseil du district d'Orgelet (39),
maire de Vosbles
ROUSSEL DE BRÉVILLE, de Besançon (25), né en 1729, après 1793, avocat puis
journaliste
ROUX de RAZE Claude François Xavier Thérèse (1758-1834), de Besançon (25)
ROUX de RAZE Jean François, de Besançon (25)
ROY, procureur de la commune d'Ornans (25)
SAULNIER Pierre Ignace
SAVOUROT Jean-Baptiste, de Port-Lesney (39), 1803, administrateur du département du
Jura
SEGUIN Charles Antoine, de Besançon (25)
SEGUIN Charles Claude Antoine, président du district de Besançon (25) en 1791
SEGUIN François Ignace (1713-1795), de Besançon (25), avocat puis greffier en chef du
Parlement de Franche-Comté
SIBAUD Joseph, membre du directoire du district de Dole (39)
SIMON, de Pontarlier (25), avant 1776
SOMBARDE Guy François Baptiste (1753-1814), de Pontarlier (25), agent national du
district de Saint-Hippolyte (25)
SPICRENAEL Claude François, né à Saint-Loup (70), à Besançon (25) en 1823, membre
du conseil de la commune de Besançon, juge du tribunal d'appel de Besançon en 1799-1801
TAVERNIER Denis François
TAVERNIER Désiré François, de Poligny (39)
THIÉBAUD Claude Philippe, secrétaire de l'Intendance de Franche-Comté
THIÉBAUD Jean Marie Joseph, originaire de Franche-Comté, greffier en chef du trib. de 1re
instance de Florence (départ. de l'Arnô)
THOMAS Jean Etienne Désiré (1756-1854), de Lons-le-Saunier (39)
THOMAS Jean Claude Joseph, de Lons-le-Saunier (39), maire de Lons-le-Saunier, administrateur
du département du Jura
THONNET Marie Nicolas, de Besançon (25), né v. 1751
THOUVEREY Jean Étienne Désiré (1756-1854), membre du directoire du district de Poligny (39)
THOUVEREY Pierre Joseph
TONNET Marie Nicolas, né en 1751, commissaire provisoire du Directoire dans le canton de
Pouilley-les-Vignes (25)
TRAVAILLOT, de Besançon (25)
TROUILLET Jacques François, d'Ornans (25)
TYRODE, de Besançon (25), né v. 1743
VANNOD de MONTPERREUX Pierre Philippe Xavier, de Pontarlier (25), guillotiné
VAUCHER, de Lons-le-Saunier (39), cité en 1788
VÉJUX, secrétaire du club des jacobins de Besançon (25), juge au tribunal civil
VERNEREY Charles Baptiste François (1750-1798), de Baume-les-Dames (25), administrateur du
département du Doubs, président du club des jacobins de Besançon, député à la Convention
(régicide)
VERNIER Théodore (1731-1798), de Lons-le-Saunier (39), député du département du Jura à la
Constituante et à la Convention
VERNY Jean Nicolas (1713-1797), de Besançon (25)
VIGNERON Claude Bonaventure (1750-1832), administrateur du département de la Haute-Saône,
procureur général syndic du département de la Haute-Saône, député à la Convention
VILLEVIEILLE Jean Baptiste, né à Petit-Noir (39), membre du conseil du district de Dole (39)
VIOLAND Jacques Xavier (1755-1843), de Pontarlier (25), officier municipal puis procureur
syndic du district de Pontarlier, juge au tribunal de Pontarlier
VOISARD Rodolphe, juge de paix à Indevillers (25), administrateur du département du Doubs
VUILLERMOZ cadet, de Lons-le-Saunier (39)
VUILLERMOZ Claude Félix Benoît, de Lons-le-Saunier (39), membre du conseil du district de
Lons-le-Saunier
VUILLERMOZ Claude Pierre, maire de Lons-le-Saunier (39)
VUILLERMOZ François Joseph Désiré, de Lons-le-Saunier (39), président de l'administration
municipale du canton de Voiteur (39)
WEY Jean Claude
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) du même auteur, à paraître en juin 2006
Le Musée historique de la prison de Seodaemun (1) Séoul, Corée du Sud
Parmi les lieux qui perpétuent le souvenir de l'occupation de la Corée par le Japon, il en est un que les Séoulites ont tenu à conserver à titre de témoignage pour les nouvelles générations (comme l'a voulu le maire de Seodaemun-gu, un des quartiers de la métropole coréenne) : la prison de Seodaemun, ouverte depuis le 21 octobre 1908 sous le nom initial de Gyeongseong Gamok. Cet établissement pénitentiaire porta successivement les noms de Seodaemun Gamok (3 septembre 1912), Seodaemun Hyonhmuso (prison de Seodaemun) (5 mai 1923) avec érection cette même année de tours de guet en brique pour empêcher toute tentative d'évasion, Seoul Hyonhmuso (prison de Séoul) (21 novembre 1945), Seoul Gyodoso (23.12.1961) et Seoul Guchiso (7 juillet 1967).
Seodaemun Guchiso fut transféré à Uiwang-si dans la province de Gyeonggi le 15 novembre 1987 et, dans les murs de l'ancienne prison de Séoul, on ouvrit, le 5 novembre 1998 un musée de la résistance à l'envahisseur japonais.
Les locaux actuels semblent encore enfermer les cris de ceux, dont de nombreux étudiants de l'université nationale, qu'on torturait et qu'on exécutait. Les bâtiments 10, 11 et 12, construits en 1915, ont été classés site historique n° 324.
Pour accéder à la prison de Seodaemun, le plus simple est d'emprunter la ligne 3 du métro, de descendre à la station Dongnimmun et de prendre la sortie fléchée qui mène au parc de l'indépendance de Seodaemun. Non loin, se dresse la vieille porte de Dongnimmun, elle-même surplombée de nos jours par des voies expresses, le béton étant l'une des caractéristiques de la ville de Séoul (rappelons, pour mémoire, que la Corée du Sud, est le pays qui, au monde, utilise le plus de béton par habitant).
Le musée présente diverses expositions et notamment des lettres de prisonniers adressées à leurs familles avec leurs exécutions. Des projections vidéos tentent de nous faire revivre les heures tragiques de la prison. Pour faire plus vrai, on entend en fond sonore les rires, les ordres et les insultes des gardiens japonais. Des dessins montrent les divers types de tortures qu'on pratiquait (supplice de l'eau par entonnoir ; aiguilles plantées sous les ongles, etc.) tandis que des cellules étroites étaient réservées à des prisonniers qui devaient garder la position debout.
La salle des exécutions par pendaison possède une trappe où on laissait tomber les cadavres après avoir sectionné la corde de leur supplice. On les évacuait ensuite par un souterrain jusqu'au cimetière voisin.
Certains pourront trouver qu'on fait preuve dans cette prison-musée d'une volonté démagogique trop marquée de démontrer la résistance du peuple coréen aux colonisateurs japonais. Une façon peut-être de faire oublier des points historiques douloureux ou particulièrement sensibles relatifs non seulement à la collaboration (plus ou moins forcée) de nombreux Coréens avec l'occupant mais aussi au fait que c'est le premier ministre de Corée, des hauts fonctionnaires et des membres de la famille impériale qui ont purement et simplement livré le pays à l'empire du Japon entre les années 1905 et 1910.
Dernier point et pas des moindres : les Japonais ont quitté la Corée après leur défaite de 1945 et la prison de Seodaemun est cependant restée ouverte jusqu'en 1987. Pendant ces 42 années, quid de son utilisation par le pouvoir politique pour réduire au silence ses opposants et tous ceux qui aspiraient à davantage de démocratie ?
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Notes :
(1) Prononcer So - dè - moun.
Les trois premiers évêques de l'église anglicane de Corée : Corfe, Turner et Trollope
Charles John CORFE (1889-1905), né dans la banlieue de Salisbury (Grande-Bretagne) le 14.05.1843, fils aîné de C. W. Corfe, organiste de la cathédrale de Salisbury et ami de Haendel, fut ordonné diacre en 1866, prêtre en 1867, sacré évêque de Corée dans l'abbaye anglaise de Westminster le 01.11.1889. Il arriva dans le port d'Incheon (royaume de Chosun) le 29.09.1890. Parmi les premiers baptisés coréens en 1897, on remarque Mark Kim, premier prêtre anglican coréen qui sera ordonné en 1915. Sa biographie, écrite par Right Reverend bishop Montgomery, D.D., D.C.L., sous le titre "Charles John Corfe, Naval chaplain - bishop", avec une préface du Rt Rev. Mark Napier Trollope, bishop in Korea, a été publiée en 1927 par The Society for the Propagation of the Gospel in the Foreign Parts.
Arthur Beresford TURNER (1905-1910), né à Farlay dans le Wiltshire le 24.08.1862, ordonné prêtre en 1887, curé de Watlington (Oxfordshire) de 1887 à 1889, de Downtown, Salisbury, de 1889 à 1892, de la cathédrale Saint-Nicolas de Newcastle On Tyne de 1892 à 1896, missionnaire en Corée de 1896 à 1905, sacré évêque en 1905, évêque de Corée de 1905 à 1910.
Mark Napier TROLLOPE (Cho en coréen) (1911-1930), né en 1862, ordonné prêtre en 1888, arrivé en Corée en 1891, sacré évêque de Corée le 25.07.1911. Il mourut à bord d'un bateau dans le port de Kobe (Japon) le 06.10.1930. Ses restes sont inhumés dans la nef de la crypte de la cathédrale anglicane de Séoul (voir du même auteur, "La cathédrale de Séoul de l'église anglicane de Corée"). À sa mort, on comptait vingt prêtres coréens anglicans. On doit au Rt Rev. Trollope un ouvrage fort bien documenté, "The Church in Corea", édité en 1915 par les ed. A.R. Mowbray & Co, Ltd, London, 28 Margaret Street, Oxford Circus, W, Oxford, 9 High Street, et Milwaukee, USA, The Young Churchman Co.
N.B. : L'église anglicane de Corée eut à sa tête des prélats anglais jusqu'en 1965 : Alfred Cecil COOPER (1882-1964) de 1931 à 1954 et John Charles Sydney DALY de 1955 à 1965 (après qu'il eût été évêque du diocèse d'Accra au Ghana de 1951 à 1955). En 1955, c'est un Coréen, Paul Ch'on-Hwan Li (Paul Lee), qui devint évêque de Séoul tandis que John Charles Sydney DALY se voyait confier le nouvel évêché de Daejon. Un troisième évêché fut créé à Busan en 1974. Le 16 avril 1993, l'église anglicane de Corée cessa d'être sous la dépendance de l'archevêque de Canterbury et devint une province autonome de la communauté anglicane.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
La cathédrale de Séoul de l'église anglicane de Corée
De style néo-roman et la première du genre en Extrême-Orient, la cathédrale de Séoul de l'église anglicane de Corée (1) a été construite le 2 mai 1926 par Mark Nappier Trollope (Cho en coréen), le 3e évêque de cette communauté chrétienne (qui avait célébré sa première messe au Pays du Matin Calme le 21 décembre 1890). Sa construction, interrompue pour des raisons financières, n'a pu être achevée que le 2 mai 1996 (après la découverte fortuite dans la petite bibliothèque de la ville anglaise de Lexington, trois ans plus tôt, du plan original dessiné par l'architecte, ce qui permit la poursuite des travaux que les autorités séoulites avaient jusqu'alors refusés car l'édifice était classé monument historique). Cette cathédrale, flanquée de tours carrées (auquel on ne peut accéder) et couverte d'une toiture en harmonie avec l'architecture locale, est aujourd'hui inscrite au patrimoine national de la Corée du Sud. Bâtie en forme de croix, la nef prenant appui sur douze piliers symbolisant les apôtres, elle possède un baptistère octogonal (2). La voûte du chur est entièrement recouverte d'une grande mosaïque représentant le Christ portant, dans sa main gauche un livre ouvert portant l'inscription EGO SUM LUX MUNDI ("Je suis la lumière du monde"). Elle a été offerte par un Anglais, George Jack.
Le grand autel en granit est un don collectif de quatorze évêques britanniques et écossais.
La chapelle de la Vierge Marie, dans la partie nord de l'édifice, abrite les portraits de cinq religieuses et prêtres (les prêtres Hong Gallo, Lee Do-am, Lee Won-chang, Yoon Da-lyoung et sur Mary Clare), abattus pendant la guerre de Corée ou morts lors de la terrible marche conduisant les prisonniers vers les camps de la Corée du Nord par une température qui descendit fréquemment jusqu'à - 30° C (voir du même auteur, "La Présence française en Corée", éd. de L'Harmattan, 2005).
La crypte de la cathédrale, construite pour commémorer la mémoire du Révérend Arthur Beresford Turner, le second (3) évêque de Corée de l'église anglicane, possède quatorze colonnes disposées en fer à cheval tout autour de l'autel et la grande nef au sol de laquelle on remarque une superbe plaque de cuivre gravée par Francis Cooper en 1932. Ornée aux quatre coins des symboles des quatre évangélistes (l'ange, l'aigle, le taureau et le lion), du portait en pied, grandeur nature, d'un évêque mitré portant dans la main gauche sa crosse et, dans sa main droite, une maquette de la cathédrale pour rappeler qu'il en fut le constructeur, et d'une inscription en lettres gothiques, elle recouvre les restes du Révérend Mark Nappier Trollope. Depuis 1985, cette crypte possède ses propres orgues.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Notes :
(1) 3 Chong-dong, Jung-ku, Seoul 100-120. Tél. : 82-2-730-6611.
(2) L'octogone est symbole d'éternité.
(3) Le premier évêque de l'église anglicane de Corée fut le Révérend John Corfe.
Voir aussi : Les trois premiers évêques de l'église anglicane de Corée, Corfe, Turner et Trollope.
Les premiers degrés de la généalogie de la famille de Blicterswick
I. - WILHELM (I) de BLICTERSWICK, né au 14e siècle.
II. - WILHELM (II) de BLICTERSWICK, chevalier, échevin de Bruxelles (sénateur du souverain Sénat de Bruxelles) en 1421, chef d'une des sept pairies du pays, épousa Wilhelmine Bonne, baronne de BERLOO, qui lui donna :
III. - ARNOLD (dit parfois ARNOULD) de BLICTERSWICK, chevalier de Saint-Georges de 1487 à 1506 (date de son décès à Besançon), attaché au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. En 1450, il épousa Alix de GRAMMONT, fille de Guyot de GRAMMONT, seigneur de Vellechevreux (25), et d'Agnès de DOMPREL, dame d'Essert (90) en partie (qui testa le 27.03.1453 (= 1454), qui lui donna :
IV. - THIERRY de BLICTERSWICK, coseigneur de Mandeure (25), chevalier de Saint-Georges, capitaine-châtelain du comté de la Roche-Saint-Hippolyte (25) en 1497 et de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (25) en 1504. En 1521, il épousa Charlotte de TRÉVILLERS, fille de Jean de TRÉVILLERS dit le MONTAGNON, seigneur de Contréglise (70) et de Mandeure (25), et d'Henriette de GRAMMONT, qui lui donna :
V. - ANTOINE de BLICTERSWICK dit de MANDEURE, écuyer, avant 1544 (A.N., n° K 2131). Il épousa Anne FRIANT, fille de François FRIANT (fils de Jean II de FRIANT et de Barbe d'AUBONNE, Jean II de FRIANT étant lui-même fils de Charles II de FRIANT) et de Denise de BYANS (fille de Louis de BYANS et d'Antoinette GUILLET (fille de Jean GUILLET alias GUILLOT alias GUILLOZ de CLERVAL, de Clerval (25), et d'Anne de VY) qui lui donna :
a. - Françoise de BLICTERSWICK, qui épousa Nicolas (II) de LA VERNE, écuyer, sieur de Vellechevreux (70) et de La Verne, seigneur à Mandeure (25), avant 1559
b. - Gaspard de BLICTERSWICK, qui épousa Claude Marguerite de MANTOCHE, d'où une fille : Marie Albertine de BLICTERSWICK, qui épousa Jean Claude, comte de SCEY-MONTBÉLIARD, fils de Louis, comte de SCEY-MONTBÉLIARD, et d'Antoinette de PILLOT.
Armoiries :
1. Famille de BLICTERSWICK : "d'or au chef émanché de trois pièces de gueules (alias : coupé émanché de gueules et d'or)"
2. Famille de GRAMMONT : "écartelé : aux 1 et 4, de gueules au sautoir d'or (qui est Granges) ; aux 2 et 3, d'azur à trois bustes de reine de carnation, couronnés d'or (qui est Grammont)".
3. Famille de DOMPREL : "de sable à la fasce ondée d'argent".
4. Famille de TRÉVILLERS : "d'azur à deux bars adossés d'argent, brisé en chef d'une croisette du même". Cette brisure semble indiquer que la famille de Trévillers serait une branche cadette de la maison de MONTBÉLIARD.
5. Famille FRIANT : "d'azur à la bande engrêlée d'argent".
6. Famille de BAUMOTTE : "de sable au sautoir d'argent".
7. Famille d'AUBONNE : "d'azur au chevron d'argent accompagné de deux étoiles en chef et d'un croissant du même en pointe".
8. Famille de MANTOCHE : "de gueules à trois bandes engrêlées d'argent".
9. Famille GUILLOT/GUILLET, de Clerval (25) : "d'azur à trois quilles d'or, deux et une" (écu encore visible sur une pierre tombale dans la nef de l'église prieurale de Chaux-les-Clerval (25).
10. Famille de BYANS : "de gueules au sautoir d'or cantonné de douze billettes du mêle".
11. Famille de VY : "d'or à la bande de sable chargée de trois tours d'argent".
12. Famille de SCEY-MONTBÉLIARD : "écartelé : au 1, de sable au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules, l'écu semé de neuf croisettes recroisetées au pied fiché d'or (Scey moderne) ; au 2, de gueules à deux bars adossés d'or (Montbéliard) ; au 3, d'or à trois raisins de pourpre, les queues en haut (Brun) ; au 4, de vair plein (Scey ancien)".
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Conseils aux étudiants et aux lycéens pour augmenter leurs chances de réussite aux examens
A. - DANS LES SEMAINES QUI PRÉCÈDENT LES EXAMENS
1. - Ne jamais se doper. En cas de fatigue, n'hésitez pas à consulter votre médecin qui saura vous prescrire ce qui sera le plus adapté au cas de chacun. N'essayez surtout pas les "fortifiants" et autres cocktails vitaminiques donnés par un copain. Ce qui est indiqué chez l'un peut être inutile voire nuisible chez l'autre.
2. - Avoir une nourriture équilibrée.
3. - Ne pas abuser du café.
4. - Ne pas changer brutalement de mode de vie. Par exemple : les semaines ou les jours qui précèdent un examen ne sont pas les périodes idéales pour prendre la décision d'arrêter de fumer. Remettez cette bonne et sage décision aux jours qui suivent l'examen. L'arrêt brutal de la consommation de tabac peut engendrer une sensation de fatigue, une irritabilité, voire de sérieux troubles de la mémoire (ce n'est vraiment pas le moment à l'approche d'un examen).
5. - Ne pas trop rogner sur le capital sommeil, celui-ci contribuant à mieux assimiler et stocker les connaissances. Surtout pas de nuits blanches dans les jours qui précèdent un examen. On a vu des étudiants rester "secs" devant leur copie alors que, quelques jours plus tôt, ils auraient répondu avec facilité aux mêmes questions posées. Mais des nuits blanches successives peuvent littéralement effacer des banques de données de la mémoire. Et c'est alors le trou, le blanc
6. - Sentir sa fatigue et savoir doser son travail. Si l'on sent que ça ne rentre plus (ou, pire, que plus on essaie d'apprendre, plus on est en train de désapprendre), il est urgent de stopper. Continuer ne sert en effet alors plus à rien. Au contraire, cela peut aller jusqu'à la confusion de notions jusque là bien assimilées). Le fait d'arrêter d'étudier - même pendant une courte durée (une heure ou deux) - peut engendrer un sentiment de culpabilité et surtout raviver la peur de l'échec à l'examen. Pour estomper ces sensations, il est souhaitable de remplir ce vide (en allant faire un footing, voir un bon film, partager un goûter sympa avec des copains de travail car, pour beaucoup, travailler à plusieurs est stimulant à condition toutefois de bien choisir ses partenaires d'étude et de fixer des règles précises - une sorte de petite discipline interne du groupe - afin de tous rester concentrés sur l'objectif commun).
7. - Établir un véritable planning ainsi qu'une sorte de compte à rebours : ex : Lundi, de 14 à 16 h : maths - de 16h à 17 h : anglais - 17 h - 17 h 30 : goûter - 18 h - 19 h 30 : physique/chimie, etc. Mardi : de 9 h à 11 h : philosophie ; de 11 h à midi : révision de formules mathématiques insuffisamment apprises la veille. Ceci veut dire que chaque soir, avant le coucher, il faut préparer le planning du lendemain (avec des breaks pour aller courir, nager, rire ou se défouler sur un jeu vidéo car, pendant ces temps de loisirs, le cerveau "récupère"). Il faut aussi estimer le nombre de jours nécessaires pour réviser telle ou telle matière. De toute façon, un planning n'est pas fait pour être respecté à la lettre (pas plus qu'un plan de bataille). L'intelligence, c'est une fois de plus la faculté de s'adapter. Vous ajouterez ou vous retirerez un ou deux jours de révision pour une matière selon le stade où vous en serez de l'acquisition et de la maîtrise de vos connaissances. Il faudra ensuite repenser le nombre de jours disponibles pour les autres matières.
8. - Varier les révisions : ne pas passer une journée entière sur des maths, par exemple. Une heure et demie ou deux heures sur une même matière, c'est un grand, très grand maximum. Au-delà, le cerveau sature. Changer de matière le repose.
POUR LES JOURS DE L'EXAMEN
1. - La veille de chaque journée d'examen, ne pas se coucher trop tard (ni trop tôt d'ailleurs dans l'espoir d'être davantage en forme : le fait de se coucher trop tôt risque même d'engendrer des difficultés pour s'endormir). Ne pas changer ses habitudes et son rythme personnel de sommeil.
2. - Les jours d'examen, mettre au moins deux réveils en place (les piles, ça s'use). Se faire en outre réveiller par sa famille ou un ami sûr. Rater un examen pour une "panne de réveil" est l'une des choses les plus stupides qui puissent arriver dans la vie. VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉ À PÉNÉTRER DANS UNE SALLE D'EXAMEN SI VOUS ÊTES EN RETARD. Partez donc de votre domicile beaucoup plus tôt qu'habituellement : une panne de métro est toujours possible (voire une grève surprise), un léger accident sur la route, etc. Inversement, ne pas arriver non plus 2 heures avant le début des épreuves : une attente trop longue dans la cour ne pourra qu'user vos nerfs.
3. - Ne pas introduire dans la salle d'examen un document quelconque. Même si vous ne l'utilisez pas, on pourrait croire que vous vouliez copier et cela peut être suffisant pour vous faire exclure aussitôt de la salle et même vous faire interdire de tout examen officiel pendant plusieurs années. Vérifiez donc le contenu de vos poches, de votre trousse, etc. avant d'entrer dans la salle d'examen. Ne prenez que les objets autorisés (dont plusieurs stylos au cas où un ou deux tomberaient en panne) et, au moindre doute (sur les calculatrices, par exemple, parfois autorisées, parfois interdites), n'hésitez pas, à questionner un surveillant avant d'entrer dans la salle
4. - Si vous avez besoin d'un renseignement (ou de quoi que ce soit d'autre) pendant l'épreuve, levez la main et attendez qu'un surveillant de salle vienne à vous. Ne demandez rien à votre voisin, pas même l'heure Il y a souvent des pendules dans les salles d'examen mais une montre, posée sur la table devant vous, est hautement souhaitable pour bien planifier votre temps.
5. - Relisez votre copie (considérez cela comme obligatoire et gardez toujours un peu de temps pour le faire. Remplacez les blancs que vous aviez pu laisser. Corrigez les fautes les plus flagrantes (les pluriels, les accords de verbes). VÉRIFIEZ QUE CHAQUE PHRASE VEUT BIEN DIRE CE QUE VOUS VOULIEZ EXPRIMER (Il peut arriver que l'on pense "A", que l'on écrive "B" et même parfois, hélas, que "B" soit exactement le contraire de "A".
6. - À 30 minutes de la fin, relisez le texte de l'épreuve. Aviez-vous bien compris chaque question ? N'AVEZ-VOUS PAS OUBLIÉ DE RÉPONDRE À UNE QUESTION ? (ce qui serait vraiment dommage ). NE QUITTEZ JAMAIS UNE SALLE D'EXAMEN AVANT LA FIN DE L'ÉPREUVE : une idée peut revenir en tête ; on peut aussi s'apercevoir qu'on n'avait pas très bien compris une question ; etc. etc.
7. - AÉREZ VOTRE TEXTE. Un professeur qui corrige n'est pas une machine, c'est un être humain qui, comme vous, voudrait souvent déjà être en vacances et qui constate qu'avant d'aller s'ébattre dans l'océan ou d'arpenter les pentes du Jura, il a une grosse, très grosse pile de copies à corriger. Lui aussi, il fatigue Alors, une copie claire, bien écrite, bien structurée avec des titres soulignés, des chapitres, des sous-chapitres, etc., le met d'emblée de meilleure humeur. Les paragraphes doivent être nombreux et séparés par de DOUBLES INTERLIGNES, ce qui rend le texte plus aéré et plus clair. Des professeurs, même les plus consciencieux et les plus objectifs du monde, reconnaissent bien volontiers que deux copies de candidats présentant exactement les mêmes réponses peuvent voir leur notation finale varier d'un point (voire de deux points) selon la qualité de la présentation. Multipliez 1 ou 2 points par un fort coefficient (et, en plus peut-être sur 2 ou 3 matières) et vous aurez vite compris l'intérêt à mettre les correcteurs dans de bonnes dispositions. Vos chances de réussite s'en trouveront vite multipliées. Cela est prouvé.
8. - LES ÉPREUVES ORALES : a. - être à l'heure et, pour cela, aller repérer la salle une heure avant ou même la veille pour ne pas courir comme un fou, à la dernière minute, dans des couloirs déserts à la recherche de la salle 217 B où vous attend le professeur de chinois (qui n'appréciera guère que vous le mettiez en retard).b. - ne choquez pas - au nom de la sacro-sainte "liberté" - avec votre tenue vestimentaire. Certains professeurs n'en tiennent pas compte, d'autre si, même s'ils s'en défendent. Soyez propres, naturels, polis (dire "Bonjour, Monsieur" ou "Bonjour, Madame" : "Merci. Au revoir.", etc. n'a jamais tué personne).c. - quand vous avez le sujet en main, préparez votre épreuve orale en n'écrivant pas tout sur une feuille de papier. Un simple plan, quelques mots repères suffiront à vous faire retrouver le fil de votre pensée. Un petit truc : ne déversez pas d'emblée sur le professeur la totalité de vos connaissances. Gardez quelques notions en réserve sur les points où - à coup sûr - il va vouloir vous questionner Et il sera pleinement satisfait que vous savez des choses au-delà de votre exposé.d. - hypothèse peu souhaitable mais toujours possible : vous ne savez rien, mais ce qui s'appelle rien, sur la question que vous venez de tirer au sort. De grâce, ne restez pas muet comme une carpe en vous rongeant le sang ou les ongles. Le professeur essaiera toujours avec une ou deux questions de vous mettre sur la piste puis, excédé si vous demeurez obstinément silencieux, risque de vous renvoyer dans vos foyers jusqu'à l'année prochaine. Car si vous ne connaissez pas du tout la question, il vous sera impossible de l'inventer ou alors vous débiterez des séries d'inepties. Le professeur, c'est certain, ne va pas apprécier du tout. Alors, soyez courageux : avouez, d'entrée, que vous ne connaissez pas du tout cette question (vous avez, par exemple, pu être absent le jour où ce sujet a été traité). La plupart des professeurs (plus sympas, en général, que vous l'imaginez et dont le but n'est jamais de vous "couler") tenteront alors de vous donner une seconde chance et de vous racheter en vous posant carrément une autre question (en espérant que vous aurez plus de chance ). Le fait de ne pas avoir su la première question ne vous assurera sûrement pas la moyenne mais vous pouvez espérer vous en tirer avec une note aux alentours de 8 ou 9/20 si vous avez bien su répondre à la seconde. Ce qui est de loin préférable aux 0 et aux 1 qui récompensent les carpes qui s'obstinent à se murer dans un silence pénible. Vos chances de réussite restent ainsi à peu près intactes si vous vous en sortez dans les autres matières.e. - quelques ultimes conseils (valables aussi pour les épreuves écrites) : MONTREZ QUE LE SUJET VOUS INTÉRESSE même si ce n'est pas du tout le cas. Sortez des sentiers battus : CHERCHEZ DES IDÉES QUE VOS CAMARADES N'AURONT PAS TROUVÉES. Fouillez, cherchez dans votre cerveau, donnez des exemples, battez-vous avec vous-même, à fond, comme si c'était une épreuve sportive dont vous voulez à tout prix sortir vainqueur. CAR LES EXAMENS, C'EST AUSSI DU SPORT. COMME LA VIE Mais cela, vous le savez déjà !
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
Le saint-suaire de Besançon
Le Saint Suaire aurait été offert à l'église de Besançon par l'empereur Théodose mais ceci ne repose sur aucune base historique. Cette relique n'était peut-être qu'une simple copie du Saint Suaire de Turin qui séjourna pendant 34 ans en Franche-Comté (de 1418 à 1452) dans la collégiale de Saint-Hippolyte (25) avant d'être offerte au duc Louis de Savoie et à son épouse, Anne de Chypre, par Marguerite de Charny, veuve du comte Humbert de la Roche.
Pour exposer au public le Saint Suaire de Besançon, conservé habituellement dans un précieux coffret (dont les trois clefs étaient, par exemple, confiées au chanoine Raillard, à l'archidiacre de Salins et à l'écolâtre le 25 juin 1523) (A.D.D., n° G 192).
Le 23 juin 1529, on organisa une grande procession pour aller montrer le Saint Suaire aux Clarisses (A.D.D., n° G 230).
L'official, archidiacre de Salins (39), raconta que s'étant voué au Saint Suaire il a échappé, à Gy, à un péril mortel et qu'il désirait qu'on pût trouver dans la cathédrale Saint-Étienne un lieu convenable pour y déposer cette précieuse relique (octobre 1531) (A.D.D., n° G 193).
Depuis le 7 janvier 1531, le Saint Suaire était conservé dans le tabernacle qu'on venait de lui construire dans la chapelle de saint Maimbuf. Pour répondre à la demande de l'official, on demanda au chanoine Jean Garnier d'enlever du retable de cette chapelle les statues de pierre qu'y avait fait placer son oncle Henri Garnier et de les placer contre un mur de la chapelle (7 décembre 1531) (A.D.D., n° G 193). On avait déjà formulé cette demande auprès du chanoine Jean Garnier, le 19 juin 1528 mais ce dernier avait vivement protesté (A.D.D., n° G 193). Cette attitude indignée semble confirmer que le Saint Suaire de Besançon ne devait être qu'une simple copie puisqu'il n'était pas considéré, par le clergé lui-même, comme un objet de grande valeur. Les grandes reliques vénérées dans la cathédrale Saint-Étienne étaient, depuis des siècles, des ossements des saints Ferréol et Ferjeux (les premiers martyrs de Besançon), enfermées dans une châsse en or.
Les textes n'évoquent plus que deux clefs du reliquaire du Saint Suaire déposées dans le coffre du trésor de la cathédrale le 21 juin 1542 (A.D.D., n° G 194). Pour présenter la relique, on confectionna un théâtre en mars 1539 (A.D.D., n° G 193) puis on recouvrit de soie rouge la châsse du Saint Suaire depuis le 4 mai 1612 (A.D.D., n° G 201). Un peu plus tard, le 5 avril 1619, on avait décidé de faire installer une grille autour de l'autel du Saint Suaire (A.D.D., n° G 202). Le 21 mai 1621, à la demande du comte de Saint-Amour, on construisit un petit théâtre à côté du grand pour faire mieux voir le Saint Suaire au prince de Condé (A.D.D., n° G 202).
Le Saint Suaire était déroulé devant les fidèles les jours de Pâques, dans le cadre d'un mystère (sauf en cas de risque de peste (A.D.D., n° G 194) et de l'Ascension (parfois le dimanche qui suivait cette dernière fête comme le chapitre le décida le 11 mai 1547) (A.D.D., n° G 195).
Le 20 décembre 1579, le pape Grégoire XIII accorda un privilège à l'autel du Saint Suaire (A.D.D., n° G 198).
La relique faillit quitter Besançon lorsqu'un soldat de Tremblecourt projeta de l'enlever en 1595.
Le 25 août 1599, le chapitre métropolitain de Besançon décida qu' "on ne montrera plus, exceptionnellement, le Saint Suaire qu'aux rois, ducs et princes de sang royal" (A.D.D., n° G 200) mais cette résolution, décidément trop restrictive et fort dommageable pour les finances du chapitre (comme on le verra plus loin), ne sera jamais appliquée et, six mois plus tard, M. de Lux, simple baron, aura droit à une ostension du Saint Suaire.
Cette ostension était toujours confiée aux deux plus anciens chanoines du chapitre et ce ne sera que lors de la venue de Louis XIV que l'archevêque de Besançon daigna procéder lui-même à cette cérémonie. Le cérémonial de l'ostension avait été décidé avec précision dans un document du 8 mai 1592 (A.D.D., n° G 199).
Béatrix de Cusance fonda une messe du Saint Suaire et fit de nombreux dons pour l'ornementation de la chapelle abritant la relique.
Au début de la guerre de Dix Ans, le 19 novembre 1636, le chapitre métropolitain de Besançon envoya aux Dolois cinq images du Saint Suaire contre la peste. Les habitants les ont affichées aux quatre coins et au milieu de la ville - M. de BASSOMPIERRE, officier du duc de Lorraine - juillet 1634 (A.D.D., n° G 203) puis, le 30 avril 1637, on porta le Saint Suaire en procession pour "l'heureux succès des armes impériales" (A.D.D., n° G 203). Deux ans plus tôt, le duc de Lorraine avait fait suspendre deux drapeaux dans la chapelle du Saint Suaire tandis qu'on faisait réaliser pour l'empereur d'Allemagne une copie grandeur nature de la relique, sur laquelle on fit inscrire : VERA SYNDONIS BISUN. EFFIGIES.
Le 26 octobre 1644, le chapitre célébra une messe au Saint Suaire pour remercier de la guérison du duc de Lorraine et demander le succès des armes de la maison d'Autriche (A.D.D., n° G 205).
Le 5 juillet 1662, la confrérie de Saint-Claude à Rome (qui regroupait des milliers de Francs-Comtois ayant trouvé refuge dans la ville éternelle pendant la guerre de Dix Ans) demanda un portrait sur soie du Saint Suaire pour son église, récemment bâtie. Le chapitre de Besançon répondit favorablement à cette demande a condition que la reproduction ne sera pas de la grandeur de l'original et qu'elle portera l'indication que ce n'est qu'une copie (A.D.D., n° G 206).
Après la première conquête de la Franche-Comté par les troupes de Louis XIV, les chanoines du chapitre métropolitain de Besançon décidèrent, le 11 octobre 1669 de transférer le Saint Suaire de la cathédrale Saint-Étienne à la cathédrale Saint-Jean qui abrita aussi désormais les restes des comtes palatins de Bourgogne. Sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne, Vauban dressa une citadelle destinée a fortifier les hauteurs qui dominent la boucle du Doubs.
Peu avant la seconde conquête, on adressa des prières solennelles au Suaire pour le salut de la province. C'était le 28 février 1674. La Franche-Comté tomba néanmoins définitivement aux mains des Français ce qui n'entama nullement la foi des Bisontins dans leur précieuse relique. Les Français, nouveaux maîtres de la province, s'employèrent mettre tout en uvre pour préserver la relique : c'est ainsi que le ministre Michel de Chamillard invita le chapitre à ne pas montrer le Saint Suaire pendant la guerre (lettres des 17 et 23 février 1705), "crainte de surprise" (A.D.D., n° G 216).
Le 16 octobre 1697, on fait état d'un miracle dû à l'intervention et l'invocation du Saint Suaire de Besançon (A.D.D., n° G 214).
Le 31 octobre 1699, des actions de grâce sont rendues au Saint Suaire à cause du beau temps revenu pour les récoltes (A.D.D., n° G 214). Plus tard, le 27 juin 1749, on fera une procession avec la relique "pour la cessation des pluies" (A.D.D., n° G 223).
Mais on l'implore aussi et surtout pour les maladies des yeux : c'est ainsi qu'une femme fut autorisé en février 1700 à baiser le coffre du Saint Suaire dans l'espoir d'obtenir sa guérison. De même, Monsieur de Romecourt, lieutenant de la citadelle de Besançon et souffrant lui aussi des yeux vint baiser la relique le 2 mai 1704.
Le 12 septembre 1714, le Père Varin, minime, raconte qu'il a trouvé dans la bibliothèque de son couvent un antique manuscrit, apportant que le Saint Suaire donné à l'église de Besançon par l'empereur Théodose était resté 753 ans caché dans le mur de la cathédrale Saint-Étienne, où Hugues II le retrouva. Le chapitre métropolitain nomme aussitôt une commission pour vérifier cette assertion (A.D.D., n° G 217).
Le 6 décembre 1730, on déposa le Saint Suaire sous l'autel de Prime, muni a cet effet de fortes serrures et de barreaux (A.D.D., n° G 219).
En mai 1748, Pierre Antoine de Grammont, archevêque de Besançon posa la première pierre d'une nouvelle chapelle pour abriter le Saint Suaire et, sur cette pierre, on mit une lame de plomb avec l'inscription suivante :
HUNC PRIMARIUM LAPIDEM MARMORUM
HUJUSCE SANCTISSIMÆ SYNDONIS SACELLI
POSUIT ANTONIUS PETRUS DE GRAMMONT
ARCHIEPISCOPUS BISUNTINUS SEPTIMO IDUS
MAII ANNO DOMINI MDCCXLVIII
La décoration des quatre murs de cette chapelle fut confiée à Charles André (dit Carle) Vanloo (1705-1765). L'artiste accepta cette mission moyennant 1600 francs par peinture et une reproduction du Saint Suaire brodée en perles sur drap d'or par les Visitandines de Besançon pour sa femme (A.D.D., n° G 223). Les travaux ayant été achevés, on transféra le Saint Suaire dans sa nouvelle chapelle le 17 mars 1756 (A.D.D., n° G 224) et, deux semaines plus tard, on transporta le Saint Sacrement de la chapelle de Saint-Denis à celle du Saint Suaire.
Le Saint Suaire de Besançon fut lacéré pendant la Révolution de 1789. Les patriotes bisontins l'avaient envoyé à Paris. On l'y transforma aussitôt en charpie pour bander et panser les soldats blessés de la République.
Le chapitre métropolitain perdait ainsi une source non négligeable de revenus. Pendant des siècles, la présence du Saint Suaire avait fait pleuvoir les donations en argent (60 francs par le duc de Bellegarde le 24.04.1631 ; une promesse de 10 000 francs par une Bisontine, Suzanne d'Orchamps, décédée le 2 février 1626 en échange du droit d'inhumation dans la chapelle de la relique (ce qui ne manqua pas de créer de sérieuses difficultés avec son héritier) ; une somme de 1000 francs et divers autres dons par Béatrix de Cusance, quatre doublons d'or d'Espagne par la marquise de Ruffey, deux philippes-thaler d'or par l'abbesse d'Épinal, le 30 mars 1602, 56 francs 6 gros par le marquis d'Havré le 23 mars 1619, 60 francs plus un ex-voto en or, représentant deux yeux (1), par Béatrix de Reinach en 1621, quatorze sequins d'or par M. d'Aumont le 16 octobre 1624, 4500 livres par le sieur Besse le 26 juin 1625, dix doublons d'or par le prince de Condé 19 juin 1626, 20 patagons par la princesse de Phalsbourg le 26.07.1628 (avec promesse d'envoyer des ornements), 600 francs par le baron de Balançon, 60 francs par le duc de Bellegarde le 14 avril 1631, 1000 francs pour la fondation d'une messe des Cinq Plaies le 27 septembre 1634, 100 francs légués par le chanoine d'Orival le 13 mai 1699, 3000 livres pour une nouvelle chapelle par le chanoine Monnier le 29 novembre 1749, 1500 francs par un anonyme le 22 juillet 1772, etc., etc.) ou en nature (une chaîne d'or en décembre 1531, deux chandeliers d'argent par Louis François de Choiseul, baron de Beaupré, et Madame de Malpierre, sa mère, le 1er juin 1601. deux autres par Cléradius de Vergy, baron de Vaudrey, et Madeleine de Bauffremont, sa femme, le 7 décembre 1601, un ornement de soie par Madame de Rollwiller le 20 juillet 1619, des tentures par la comtesse de Sales en 1619, un bassin et une aiguière d'argent doré par la princesse de Condé le 2 juin 1621, une lampe d'argent par le comte de Champlitte, gouverneur du pays, le 10 septembre 1621, une lampe d'argent et une somme de 300 francs (pour acheter un cens destiné a l'huile qui brûlera devant le Saint Suaire) par Claude de Bauffremont, abbé de Balerne, le 18 février 1626, une chasuble et de la soie par la marquise de Berghes le 16 juillet 1637, une chasuble, deux tuniques et un devant d'autel par l'abbesse de Remiremont) et les fondations diverses (comme celle du chanoine du Pin La Chasnée au début du 17e siècle ou celle de plusieurs offices par le duc Charles IV de Lorraine le 12 février 1638 mais aussi une messe perpétuelle fondée par Monsieur Martin, professeur de Fribourg, une autre par une Française nommée Mouret en juin 1623), sans oublier des messes solennelles comme celle célébrée en 1641 aux intentions de la marquise de Saint-Martin et pour l'âme du marquis de Saint-Martin, son mari, gouverneur de Franche-Comté, mort à Gray (70) le 20 décembre 1641.
Les chanoines tiraient aussi grand profit d'images et de rosaires qui avaient touché le Saint Suaire. Ils autorisaient en outre la reproduction sur soie de la relique et en attendaient bien évidemment des heureux acquéreurs de ces petites uvres d'art des marques tangibles de reconnaissance. Le 24 juillet 1668, ils en envoyèrent un ou deux exemplaires (valant 3 ou 4 doublons) au chanoine Jobelot, négociant à Paris (A.D.D., n° G 207). Le 24 octobre, ils recevaient une somme de 80 francs pour paiement de ces images ayant trouvé rapidement acquéreurs.
(1) On implorait surtout le Saint Suaire de Besançon pour la guérison des yeux. Les archives du chapitre métropolitain citent aussi le cas d'une fillette de Besançon, malade des yeux et guérie miraculeusement le 15 mai 1614 (A.D.D., n° G 201).
Signature :
Jean-Marie Thiébaud
ANNEXE I
Certificats de faveurs ou miracles obtenus par l'invocation du Saint Suaire de Besançon au 17e siècle :
- par Larme Aubert, femme de Pierre Darausy, tanneur et bourgeois de Verdun (1631)
- par Odelin Le Maistre, médecin ordinaire du Roi et premier médecin de Monsieur, frère du Roi (1631) (avec deux lettres du même, datées de Besançon et annonçant sa guérison)
- par Sebastien Marye, bourgeois d'Auxerre (89) 1632)
- par Nicolas Bouton, comte de Chamilly, sur ouï-dire du maréchal de Grammont (1658)
- par différentes personnes embarquées sur mer entre Marseille et Gênes (dont était le chanoine Borrey, de Besançon), certifiant qu'au milieu d'une tempête épouvantable, le calme reparut dès qu'une image ayant touché le Saint Suaire de Besançon eut été jetée dans les flots (1655)
- donation faite à la confrérie du Saint Suaire par Anne Marie Liebe, de Fribourg en Suisse, pour avoir part dans ses prières (1661)
- Attestations de faveurs par :
- Catherine Odinot, femme de Charles Clerc, bourgeois et marchand de Besançon (1664)
- Madame Orry, femme de l'avocat Vaillant, de Verdun (1671)
- Fondation d'une messe solennelle du Saint Suaire avec collecte "pro navigantibus" par le chanoine Borrey (1672)
- Déclaration de François Laffitte, garde du roi de France, blessé au bras et à la mâchoire au siège de Besançon par Louis XIV, guéri par l'intercession du Saint Suaire (1674)
- Autre de Huberte Françoise Poly, de Salins (39), fille de M. Poly de Saint-Thiébaud (1677) (A.D.D., n° G 261).
ANNEXE II
Liste des hautes personnalités françaises et européennes qui ont eu droit à son ostension particulière du Saint Suaire de Besançon :
- M. de BEAUJEU et autres gentilshommes - 11.05.1524 à la sacristie de la cathédrale Saint-Étienne (A.D.D., n° G 192).
- la maréchale de BOURGOGNE (mère de l'archevêque) - 25.05.1540 (A.D.D., n° G 193).
- Madame d'IGNY, veuve du maréchal de LA BAUME - 06.06.1543 (A.D.D., n° G 194).
- des gentilshommes de Nozeroy (39), parents du chanoine Jean TORNON - 13.01.1546 (A.D.D., n° G 194).
- M. de POITIERS - 13.01.1546 (A.D.D., n° G 194).
- la maréchale de BOURGOGNE - 22.08.1548 (A.D.D., n° G 195).
-Jean FRANCOLIN, citoyen de Besançon, serviteur de la maison de l'empereur Ferdinand - 25.02.1563 (A.D.D., n° G 196).
- M. de VIENNE, seigneur de Ruffey - 29.11.1565 (A.D.D., n° G 196).
- le comte de VAUX et Madame de MONTBY - 07.07.1574 (A.D.D., n° G 197).
- la duchesse de PARME - 18.05.1580 (A.D.D., n° G 198).
- Madame de LIGNÉVILLE-CLERVANS - 13.10.1581 (A.D.D., n° G 198).
- la comtesse de PONT-DE-VAUX, sur de l'archevêque de Besançon - 05.08.1583 (A.D.D., n° G 198).
- les ambassadeurs suisses de Fribourg et de Soleure (Suisse) - 07.06.1584 (A.D.D., n° G 198).
- Madame d'OSTENDE, fille du comte d'EGMONT - 05.10.1587 (A.D.D., n° G 199).
- la princesse de BRUNSWICK, sur du duc de Lorraine - 11.03.1589 (A.D.D., n° G 199).
- la comtesse de CHAMPLITTE - 12.06.1591 (A.D.D., n° G 199).
- Madame de TORPES - 20.11.1591 (A.D.D., n° G 199).
- le baron de LUX - 12.04.1600 (A.D.D., n° G 200).
- le cardinal d'AUTRICHE qui remercia le chapitre le 17.05.1600 (A.D.D., n° G 200).
- un groupe de gentilshommes comtois, à la demande de MM. de VELLECLAIRE et de NANCRAY - 26.05.1600 (A.D.D., n° G 200).
- Madame de GÂTEY - 17.04.1602 (A.D.D., n° G 200).
- la mère du chanoine POURTIER - 02.06.1604 (A.D.D., n° G 201)
- le baron de POLLWILLER, envoyé de l'empereur - 23.06.1604 (A.D.D., n° G 201).
- la comtesse de CANTECROIX - 21.07.1608 (A.D.D., n° G 201).
- MM. BRUN et MARTIN, ambassadeurs et négociateurs - 11.02.1609 (A.D.D., n° G 201).
- la comtesse de DUNC - 01.06.1609 (A.D.D., n° G 201).
- Madame de VILLEPERROT - 02.06.1610 (A.D.D., n° G 201).
- Monsieur de LIMBERCH et Madame de BALANÇON, sa femme - 09.10.1610 (A.D.D., n° G 201).
- la comtesse de DUNC - 01.06.1611 (A.D.D., n° G 201).
- Monsieur de BOURBONNE - 13.07.1611 (A.D.D., n° G 201).
- l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre, neveu de Monsieur "Le Grand", gouverneur du duché de Bourgogne - juillet 1611 (A.D.D., n° G 201)
- le comte de FURSTEMBERG, député par l'empereur pour assister aux élections des nouveaux gouverneurs de Besançon - 25.06.1614 (A.D.D., n° G 201).
- le provincial des Frères prêcheurs - 13.05.1615 (A.D.D., n° G 201).
- le comte et la comtesse "d'AUC" - 18.05.1615 (A.D.D., n° G 201).
- le vicomte de GAND - 22.06.1615 (A.D.D., n° G 201).
- la marquise de RUFFEY - 22.06.1616 (A.D.D., n° G 201).
- la marquise d' "AVRÉ" - 13.09.1616 (A.D.D., n° G 201).
- Madame d'AUMONT - 09.10.1617 (A.D.D., n° G 202).
- l'abbesse de Remiremont - 26.07.1618 (A.D.D., n° G 201).
- le marquis d'HAVRÉ - 23.03.1619 (A.D.D., n° G 202).
- la marquise d'AUTRICHE - 31.07.1619 (A.D.D., n° G 202).
- le président PARFAICT, de Paris, gendre de Madame Le Gros, venu a Besançon dans l'espoir d'obtenir la guérison de sa fille - 02.09.1620 (A.D.D., n° G 202).
- le prince et la princesse de CONDÉ - 1621 (A.D.D., n° G 202).
- le prince et le duc de LORRAINE - 27.04.1622 (A.D.D., n° G 202).
- Jean Jacques CHIFFLET, docteur en médecine, co-gouverneur de Besançon, né à Besançon le 21.01.1588, à Bruxelles le 05.05.1673 - 26.05.1623 (A.D.D., n° G 202). Il avait obtenu le droit de voir de près le Saint Suaire et de le faire reproduire à la condition de soumettre son ouvrage au chapitre et à l'archevêque avant de le mettre sous presse. Jean Jacques Chifflet enverra son livre imprimé à Anvers et ayant pour titre "De linteis sepulchralibus" (décembre 1624).
- Madame de LORRAINE - 30.08.1623 (A.D.D., n° G 202).
- Madame de VIGNIER, Francaise, - 13.10.1623 (A.D.D., n° G 202).
- le prince de NEVERS - 08.11.1623 (A.D.D., n° G 202).
- Monsieur d'AUMONT - 16.10.1624 (A.D.D., n° G 202).
- le maréchal [François] de BASSOMPIERRE, né au château d'Haroué (54) en Lorraine en 1579, à Provins (77) en 1646, nommé colonel-général des Suisses et des Grisons en 1614, fait maréchal de France en 1622, ambassadeur du roi de France en Suisse - 03.12.1625 (A.D.D., n° G 202).
- les chevaliers de l'Arquebuse venus à Besançon de toute la province pour tirer le grand prix (un superbe vase d'argent) - 20.08.1625 (A.D.D., n° G 202).
- le comte de RITBERG, chanoine de Cologne - 29.08.1627 (A.D.D., n° G 202).
- le marquis de VARAMBON [Christophe de RYE de LA PALUD, marquis de VARAMBON, comte de La ROCHE et de VARAX, baron et seigneur de Balançon, Villersexel (70), Saint-Hippolyte (25), Rougemont (25), Amance (70) et autres lieux] - 29.08.1627 (A.D.D., n° G 202).
- la duchesse de CHEVREUSE, épouse du prince de JOINVILLE - 04.09.1627 (A.D.D., n° G 202).
- la princesse de PHALSBOURG, sur du duc de Lorraine - 26.07.1628 (A.D.D., n° G 202).
- le général des Capucins - 06.01.1630 (A.D.D., n° G 202).
- le duc de BELLEGARDE - 05.04.1631 (A.D.D., n° G 202).
- le comte de ROANÈS - 07.04.1631 (A.D.D., n° G 202).
- Madame de FARGY - 03.09.1631 (A.D.D., n° G 202).
- les religieuses Ursulines de Vesoul (70), réfugiées à Besançon à cause de la guerre - 28.02.1633 (A.D.D., n° G 203).
- le comte de CANTECROIX, ambassadeur d'Espagne auprès de l'Empereur - 20.04.1633 (A.D.D., n° G 203).
- le marquis de BADE - 21.04.1634 (A.D.D., n° G 203).
- M. de BASSOMPIERRE, officier du duc de Lorraine - juillet 1634 (A.D.D., n° G 203).
- la comtesse de NASSAU - 19.08.1634 (A.D.D., n° G 203).
- le prince de CANTECROIX et Béatrix de CUSANCE, sa femme - 27.04.1635 (A.D.D., n° G 203).
- le marquis de TERNON, Belge - 10.10.1635 (A.D.D., n° G 203).
- M. de VILLE, envoyé de l'Empereur - 21.05.1636 (A.D.D., n° G 203).
- le duc de FLORENCE - novembre 1636 (A.D.D., n° G 203).
- le duc de BRAGANCE - novembre 1636 (A.D.D., n° G 203).
- les co-gouverneurs de Besançon - 14.05.1638 (A.D.D., n° G 203).
- le marquis de VARAMBON lors de son retour de Belgique - 20.07.1644 (A.D.D., n° G 205).
- le chartreux BRISEGEON, venu accomplir un vu au nom de la reine de France (sur germaine du roi d'Espagne) dont il était confesseur - 10.05.1645 (A.D.D., n° G 205). N.B. : on demanda à Jean Maillot de réaliser une copie du Saint Suaire pour la reine (mais moins grande que l'original, seule l'empereur ayant eu droit à une copie à l'identique). C'est le P. dominicain Tramu qui remit la copie du Saint Suaire à la jeune reine de France. Celle-ci adressa ses remerciements par l'intermédiaire du P. Brisegeon, du comte de Nogent et de l'abbaye du Val de Grâce.
- le marquis de LULLIN -16.05.1646 (A.D.D., n° G 205).
- le comte de NASSAN - 15.06.1646 (A.D.D., n° G 205).
- l'intendant d'Alsace qui a demandé à voir la relique en secret (promettant d'agir auprès du roi de France pour procurer au chapitre bisontin la relâche des dîmes de Belfort et Porrentruy) - 31.07.1647 (A.D.D., n° G 205).
- le général des Capucins - 28.08.1647 (A.D.D., n° G 205).
- Madame BRUN, femme de l'ambassadeur Antoine BRUN (1600-1654) - 20.12.1647 (A.D.D., n° G 205).
- M. de LA BALDE, ambassadeur du roi de France en Suisse - 11.01.1648 (A.D.D., n° G 205).
- l'évêque de Genève - 14.04.1648 (A.D.D., n° G 205).
- l'abbé de Cîteaux - 20.07.1648 (A.D.D., n° G 205).
- l'évêque de Belley [Mgr Jean de PASSELAIGUE, né à Sancoins (18) à Belley (01) le 12.08.1663] - 12.07.1650 (A.D.D., n° G 205).
- Madame de LA BAUME-[SAINT-AMOUR], marquise de SAINT-MARTIN, "ayant perdu son il et désirant accomplir un vu fait avant son départ pour les Flandres" - 19.10.1652 (A.D.D., n° G 205).
- le comte de LANSBERG - 16.04.1653 (A.D.D., n° G 205).
- le duc d'ÉPERNON, gouverneur de Bourgogne - 04.07.1653 (A.D.D., n° G 205).
- le général des Carmes déchaussés - 19.08.1654 (A.D.D., n° G 205).
- le duc de PONT-DE-VAUX (frère de Charles Emmanuel de GORREVOD, archevêque de Besançon) - 28.02.1659 (A.D.D., n° G 206).
- le chapitre provincial des Carmes de la province de Narbonne réuni à Besançon - 06.05.1659 (A.D.D., n° G 206).
- le prince François de LORRAINE - 01.10.1660 (A.D.D., n° G 206).
- le comte de PETINGUE (PETING ?), ambassadeur de l'empereur auprès du roi Philippe IV d'Espagne - 16.10.1662 (A.D.D., n° G 206).
- le prince et la princesse de LILLEBONNE, le prince de VAUDÉMONT - 5.06.1663 (A.D.D., n° G 206).
- le prince d'AREMBERG -15.02.1669 (A.D.D., n° G 207).
- le prince de BADE - 23.12.1669 (A.D.D., n° G 207).
- le prince de VAUDÉMONT - 05.04.1672 (A.D.D., n° G 207).
- l'internonce - 09.05.1672 (A.D.D., n° G 207).
- les ambassadeurs suisses (sur la demande de Monsieur ARDOM) - 30.03.1674 (A.D.D., n° G 208).
- l'évêque de Bâle (Suisse) - 14.04.1674 (A.D.D., n° G 208).
- Monsieur de LORGES, fils du prince d'ELBEUF - 16.11.1675 (A.D.D., n° G 208).
- le duc de MORTEMART - 06.07.1679 (A.D.D., n° G 208).
- LOUIS XIV, roi de France, et MARIE-THÉRÈSE, reine de France - 02.06.1682 (l'ostension étant alors faite par l'archevêque en personne) (A.D.D., n° G 210).
- le marquis de COURTANVAUX - 26.11.1682 (A.D.D., n° G 210).
- le fils du duc d'AUMONT - 11.06.1683 (A.D.D., n° G 210).
- la sur du marquis de MONTAUBAN - 07.05.1683 (A.D.D., n° G 210). N.B. : le marquis de Montauban sera inhumé dans la chapelle Saint-Denis ou des Fonts le 16.07.1687.
- l'intendant de la province de Franche-Comté - 28.03.1684, dans le chur de la cathédrale (A.D.D., n° G 210).
- une députation du magistrat de Besançon - 02.06.1685 (A.D.D., n° G 210).
- le général des Oratoriens -12.08.1687 (A.D.D., n° G 212).
- M. de VENTADOUR - 06.12.1687 (A.D.D., n° G 212).
- le général des Antonins français - 27.07.1688 (A.D.D., n° G 212).
- P. de LA TOUR, général de l'Oratoire - 24.04.1699 (A.D.D., n° G 214).
- le cardinal d'ESTRÉES - 02.10.1699 (A.D.D., n° G 214).
- l'intendant de la province de Franche-Comté, Monsieur d'HAROUIS [d'HAROUYS] - 20.04.1701 (A.D.D., n° G 215).
- l'évêque de Senlis (60) [Jean-François CHAMILLARD, né a Paris en 1657, ibid. le 16.04.1714, inhumé dans la cathédrale de Senlis], abbé de Baume-(les-Messieurs) (39), frère de M. [Michel] de CHAMILLARD [(1652-1721). Secrétaire d'Etat à la Guerre] - 12.07.1702 (A.D.D., n° G 215).
- le comte d'AYEN - 13.12.1702 (A.D.D., n° G 215).
- le chanoine de DÉLEMONT et M. de ROMECOURT, lieutenant de la citadelle de Besançon, souffrant des yeux, autorisé à baiser le Saint Suaire le 02.05.1704 (A.D.D., n° G 215).
- l'intendant de la province de Franche-Comté [Monsieur LE GUERCHOIS alias LE GUERCHOYS] - 15.10.1708 - (A.D.D., n° G 216).
- le roi JACQUES III, détrôné, d'Angleterre, voyageant sous le nom de chevalier de SAINT-GEORGES - 25.06.1711 (A.D.D., n° G 217).
- le général des Carmes déchaussés - 01.09.1726 (A.D.D., n° G 219).
- M. BILLEREY, professeur de médecine à l'Université de Besançon, qui fait toucher au Saint Suaire trois images en soie destinées à l'électeur de Bavière
- l'intendant de la province de Franche-Comté - 10.03.1732 (A.D.D., n° G 219).
- le marquis de NESLE - 17.03.1734 (A.D.D., n° G 220).
- l'archevêque de Reims [Armand Jules de ROHAN-GUÉMÉNÉ, né à Paris le 10.02.1695, à Saverne (1767) le 28.08.1762, inhumé dans la cathédrale de Reims] et l'évêque d'Embrun [Pierre GUÉRIN de TENCIN, né à Grenoble (38) le 22.08.1679, à Lyon (69) le 02.03.1758] - 17.10.1738 (A.D.D., n° G 220).
- l'intendant de la province de Franche-Comté [MAIGRET de SÉRILLY] - 12.10.1746 (A.D.D., n° G 221).
- le général des Antonins - 11.08.1748 (A.D.D., n° G 221, 222).
- les évêques de Chalon [Henri Louis de ROCHEFORT d'AILLY, né à Vergezac (43) en 1710, à Dijon (21) le 13.06.1772], de Dijon [Claude Marc Antoine d'APCHON, nee à Montbrison (42) le 05.06.1721, à Auch (32) le 21.05.1783] et de Lausanne (Suisse) - mai-juin 1756 (A.D.D., n° G 224).
- Mgr Claude Ignace François Xavier Alexis FRANCHET de RANS, évêque de Rhozy (alias Rhosy), né le 07.01.1722, le 21.02.1819 - 26.09.1756 (A.D.D., n° G 224).
- M. de BOYNES - 16.06.1760 (A.D.D., n° G 224).
- le général des Minimes - 13.08.1760 (A.D.D., n° G 224).
- Emilio LANTE, prélat domestique du pape - 27.08.1762 (A.D.D., n° G 225).
- Mgr de BOURDEILLE [Henri Joseph Claude de BOURDEILLES, né à Paizay-Naudouin (16) le 07.12.1720, à Paris le 12.12.1802], évêque de Tulle (19) et non de Toul (54) comme écrit par erreur dans l'Inventaire de la série G des Archives du Doubs) - 18.10.1763 (A.D.D., n° G 225).
- les officiers de la garnison de Besançon - 05.04.1766 (A.D.D., n° G 225).
- la princesse polonaise JABLONOSKA - 09.06.1771 (A.D.D., n° G 226).
- le prince polonais SANGUIZNO [SANGUSZKO-LUBARTOWICZ, descendant de la race dynastique de Lituanie] - 13.07.1771 (A.D.D., n° G 226).
- la duchesse de CHÂTILLON, femme d'un pair de France - 21.08.1773 (A.D.D., n° G 227).
- Mgr François Gaspard de JOUFFROY de GONSANS, né à Gonsans (25) le 15.08.1723, à Pederborn (Allemagne) le 23.01.1799, évêque de Gap (05) - 29.05.1776 (A.D.D., n° G 227).
- la duchesse de MAZARIN - 07.10.1776 (A.D.D., n° G 226, 227).
- Mgr Marie Joseph de GALARD de TERRAUBE, né à Terraube (32) le 20.05.1736, à
Ratisbonne (Allemagne) le 08.10.1804, évêque du Puy (43) - 13.06.1778 (A.D.D., n° G 227)
- l'abbé de BOURBON - 03.08.1784 (A.D.D., n° G 229).
Notes :
Abréviation :
A.D.D. : Archives Départementales du Doubs.
(1) On implorait surtout le Saint Suaire de Besançon pour la guérison des yeux. Les archives du chapitre métropolitain citent aussi le cas d'une fillette de Besançon, malade des yeux et guérie miraculeusement le 15 mai 1614 (A.D.D., n° G 201).
Le cimetière missionnaire historique de Sam-Ho-Tjyang (alias Yong-San) à Séoul
Ancienne propriété des Missions Étrangères de Paris depuis le milieu des années 1880 (1), il faut pour avoir une idée de ce qu'était alors Yong-san (2) se pencher sur une photographie jaunie montrant côte à côte l'église primitive néogothiques et la façade du bâtiment imposant du séminaire, percée de douze grandes verrières en plein cintre au premier étage et sept au second, sous une toiture agrémentée de deux lucarnes.achevant de rythmer la symétrie de l'ensemble. En contrebas, des toitures coréennes étroitement intriquées les unes dans les autres, toitures d'un Séoul non encore frappé de gigantisme ni envahi par le béton, sur des façades traditionnelles en torchis comme on peut encore en voir dans l'intérieur du pays.
De la première église, de l'école de théologie et de la résidence principale des Missions Étrangères, il ne reste rien. On a posé la première pierre d'une nouvelle église en 1941 et un rocher placé devant l'entrée porte une inscription en hangeul avec le chronogramme du 13 octobre 2002 pour commémorer le 60e anniversaire de sa consécration officielle (3). Le reste du terrain a été vendu à la congrégation du Sacré-Cur qui y a bâti un vaste complexe scolaire.
Alors rien, vraiment plus rien ?
Si, pourtant, en contrebas, derrière un rideau d'arbres : les Coréens connus pour leur profond respect des morts ont pieusement conservé le cimetière de Sam-ho-tjyang, construit en 1890 près de l'église et de l'ancien séminaire de Yong-san. Pieusement, c'est bien le terme idoine : ils ont élevé tout en haut de cette nécropole dont les rangées constituent autant de marches descendant en pente douce le flanc de la colline, un ensemble de statues toutes plus blanches les unes que les autres : le Père André Kim, le premier prêtre coréen, martyrisé en 1846 et canonisé en 1984, omniprésent sur tous les sites religieux du pays (4), une Immaculée Conception (la Vierge de Lourdes dans sa grotte), un Saint-Joseph portant Jésus, un Christ et une Vierge à l'enfant, cette dernière statue de plus petite taille et de facture plus moderne.
Un long mur de marbre fait défiler, dans des rectangles numérotés et disposé en plusieurs rangées parallèles, des noms de paroissiens et de bienfaiteurs avec des dates de naissance s'échelonnant de la fin du 19e siècle à 2002.
Ce cimetière, restauré en 1982, devrait abriter 78 tombes mais, le 10 septembre 1900, les corps de six missionnaires furent exhumés pour leur transfert dans la crypte de la cathédrale Myeong-dong de Séoul :
- Pierre AUMAÎTRE (1837-1866)
- Louis Bernard BEAULIEU (1840-1866)
- Marie Nicolas Antoine DAVELUY (1818-1866)
- Pierre DORIE (1839-1866)
- Martin HUIN (1836-1866)
- Just RANFER de BRETENIÈRES (1838-1866)
Ces six prêtres, torturés et décapités, ont été canonisés à Séoul par le pape Jean-Paul II le 6 mai 1984.
Dans son état actuel, le cimetière contient 72 tombes : une d'archevêque, trois d'évêques, deux de provicaires apostoliques, 63 de prêtres, deux de séminaristes et une d'un personnage anglo-saxon dont l'activité exacte n'a pu être retrouvée avec certitude mais qui semble être un missionnaire venu de Maryknoll (USA)..
Les quatre évêques sont Français et, parmi les prêtres, on recense une majorité de Coréens, un Japonais et plusieurs Français.
Chaque pierre tombale porte en idéogrammes chinois le nom, les fonctions et surtout le surnom coréen monosyllabique du défunt. En dessous, les inscriptions les plus anciennes sont en latin tant pour les prêtres français que pour leurs collègues coréens et japonais. Les plus récentes demeurent en latin pour les Français mais en caractères hangeul pour les Coréens.
Pour l'histoire des familles, on a relevé les noms de tous les prêtres étrangers :
- Jules BLANC, évêque, + le 21.02.1890, âgé de 46 ans [sa tombe est la plus ancienne du cimetière]
- Joseph BODIN, + le 19.03.1945, âgé de 59 ans
- Pierre BOUYSSOU, + le 14.03.1949, âgé de 77 ans
- Barthélemy BRUGUIÈRE, premier vicaire apostolique de Corée, + en Mandchourie le 19.10.1835 sans avoir pu entrer dans le pays pour lequel il avait été nommé. Sa tombe porte l'inscription latine :
BARTHOLOMÆS BRUGUIERE
DIOCES. CARCASSONEN.
EPUS (EPISCOPUS) TIT. CAPSEN
PRIMUS VIC. APOST. COREÆ
OBIIT IN MONGOLIA
A. ÆTATIS 44
TRANSLATUS A. (ANNO) DOM. (DOMINI) 1931
N.B. : ses restes ont été ramenés à Séoul lors des cérémonies du centenaire de l'église de Corée.
- Jules Edmond Gustave CHABOT, + le 29.06.1953, âgé de 71 ans
- Jean COSTE, surnommé Ko, provicaire apostolique, + le 28.02.1896, âgé de 54 ans
- Vincent COUDERC, + le 15.05.1892, âgé de 34 ans
- Victor DEGUETTE, surnommé Tché, + le 29.04.1889, âgé de 41 ans
- Camille DOUCET, surnommé Tchang, + le 20.04.1917, âgé de 64 ans
- Émile DEVRED, surnommé Yu, évêque coadjuteur, + le 18.01.1926, âgé de 49 ans
- Petrus (Pierre) KUROKAWA, Japonais, + le 10.12.1944, âgé de 37 ans
- Lucien LIOUVILLE, + le 26.04.1893, âgé de 38 ans
- Moïse JOZEAU dont la tombe porte l'inscription latine :
MOYSES JOZEAU
DIOC. PICTOVIEN.
MISS. AP (OSTOLICUS)
DIE 26 JULII 1894
A MILITIBUS SINEN CRUCIDATUS
A. ÆTATIS 29
N.B. : ce jeune prêtre fut le seul missionnaire français victime de la guerre sino-japonaise (1894-1895). Arrêté près de Kong-tjyou (actuellement Kongju), capitale de la province du Tchyung-Tchyeng, par un général chinois dont les troupes venaient d'être battues par les Japonais, il fut passé aussitôt par les armes. On l'enterra sur place mais son corps a été transféré dans ce cimetière le 27.04.1895.
- Louis LEGENDRE, surnommé Tché, + le 21.04.1928, âgé de 62 ans.
- Louis LE MERRE, surnommé Lee, + le 25.12.1928, âgé de 71 ans
- Gustave MUTEL, archevêque, vicaire apostolique de Corée, + le 23.01.1933, + âgé de 79 ans
- Léon PICHON, surnommé Song, + le 25.02.1945, âgé de 52 ans.
- Victor POISNEL, surnommé Pak, provicaire apostolique, + le 26.12.1925, âgé de 70 ans
- Edward RICHARDSON (1931-1973), Américain (?), MM (Missionnaire de Maryknoll ?)
- Prosper ROUQUETTE, surnommé Do, + le 25.12.1914, âgé de 23 ans
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD, le 1er mai 2004
Notes :
(1) L'acquisition du terrain a dû s'opérer dans les mois qui suivirent la signature du traité de commerce entre la France et la Corée (5 juin 1886), une de ses clauses autorisant expressément la venue de missionnaires français et leur apostolat.
(2) Mis en chantier en mars 1887, ouvert en 1889, connu sous le nom de Ryong-san dans la plupart des ouvrages français consacrés aux Missions Étrangères de Paris et aux missionnaires envoyés en Corée. Dix ans avant la construction de la cathédrale Myeong-Dong, Yong-San représentait le pôle rayonnant du catholicisme dans la capitale coréenne, à l'ouest de la vieille ville, sur une hauteur (d'où son nom, san en coréen signifiant montagne) dominant le fleuve Han.
(3) C'est le cardinal Étienne Kim, archevêque de Séoul, qui a présidé la cérémonie en dévoilant cette inscription lapidaire commémorative.
(4) Au point que c'est à n'en pas douter le personnage qui possède le plus de statues en Corée, la Vierge Marie exceptée. La seule présence de celle-ci permet d'affirmer que l'on est dans une église catholique. Plus austères, les temples protestants ne tolèrent que de grandes croix parfaitement dépouillées le jour et étonnamment rougeoyantes de néon, dressées la nuit à l'assaut du firmament. Ce qui étonne toujours le voyageur non averti.
Conseils aux étudiants et aux lycéens pour apprendre avec plus de facilité et d'efficacité
Un petit conseil au passage qui, de plus, vous prouvera l'activité bienfaisante du cerveau pendant la nuit : avant de vous endormir, relisez un court texte (histoire, SVT, etc.) ou une question non résolue d'un problème mathématique, vous pourrez parfois être agréablement surpris de trouver tout cela beaucoup plus facile le lendemain matin. C'est que notre cerveau continue à travailler pour nous pendant la nuit et en utilisant d'autres circuits (en particulier ceux du cerveau droit, le cerveau de la synthèse et de l'intuition) que ceux qui ne fonctionnaient pas la veille et sur lesquels pourtant nous nous obstinions à vouloir rester.
AVANT LE COURS : Un cours, cela se prépare en le lisant au moins une fois la veille (ou encore le matin, si vous en avez le temps, soit à l'étude, soit dans le bus ou le métro). Cela vous permettra de mieux comprendre le cours du professeur, de reconnaître dans ce qu'il vous dit des idées et des mots qui vous seront déjà un peu familiers. Un peu comme si vous aviez déjà ouvert un nouveau fichier dans votre ordinateur central. Le cours vous paraîtra nettement moins difficile, vous pourrez y participer pleinement, poser des questions que vous aurez déjà en tête et l'apprendre ensuite sera vraiment plus facile. Une partie du travail de mémoire aura déjà été effectuée. Lire un cours avant le cours n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné.
PENDANT LE COURS : Prenez des notes. Pendant que le professeur explique, tout paraît simple, vous pensez avoir tout compris. C'est le résultat de l'efficacité de notre mémoire superficielle, de notre mémoire immédiate. En réalité, le cerveau n'a souvent enregistré qu'une partie des données et pas toujours les plus importantes, celles qu'il faudra justement restituer lors d'un contrôle ou d'un examen. Donc, prenez des notes, surtout des définitions et de tout ce qui n'est pas dans les livres. Le professeur insiste visiblement sur certains points (cela se remarque au son de sa voix, à la façon dont il insiste sur telle ou telle partie de son cours, au fait qu'il juge utile d'écrire une phrase au tableau, de dessiner un croquis, etc.). C'est cela qu'il faut impérativement noter.
Ne jamais hésiter à poser une question : ce qui est évident pour les professeurs ne l'est pas forcément pour vous, Un seul mot d'explication du professeur suffit souvent à produire un petit déclic et à remettre votre cerveau sur la voie. N'ayez pas peur de ce que pourraient penser vos camarades en vous entendant poser une question : souvent, ils seront bien contents que vous ayez posé la question qu'eux-mêmes avaient aussi en tête en attendant que quelqu'un d'autre ose se lancer. Rappelez-vous ce théorème inspiré d'un proverbe chinois : CELUI QUI POSE UNE QUESTION POURRA PEUT-ÊTRE AVOIR L'AIR IDIOT PENDANT UNE MINUTE, MAIS CELUI QUI NE LA POSE PAS RESTERA IDIOT TOUTE SA VIE.
APRÈS LE COURS
C'est le soir même du cours, pendant que la mémoire récente est encore toute fraîche, qu'il faut rédiger soigneusement l'enseignement reçu pendant la journée. Les notes prises à la volée ne suffisent pas. Pire : plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, elles sont parfois devenues totalement incompréhensibles car la mémoire récente a depuis longtemps disparue (ce type de mémoire s'efface au fur et à mesure que de nouvelles données, de nouveaux souvenirs viennent s'y superposer). La mémoire récente ne sert que pour ce qui est provisoire. Elle est donc fort utile le jour même. Quand vous écrirez sur le cahier de chaque matière votre cours en faisant une synthèse du livre et des notes que vous avez prises, vous aurez l'impression de réentendre ce cours et vous trouverez cela très facile. C'est déjà beaucoup plus difficile deux ou trois jours plus tard. D'autres souvenirs sont venus encombrer la mémoire récente et votre cours commence à devenir plus flou.
LE FAIT D'ÉCRIRE, DE RÉDIGER AVEC SOIN VOTRE COURS, C'EST LE DÉBUT DU TRAVAIL DE MÉMOIRE. CELA FAIT TRAVAILLER LES YEUX, LE CERVEAU, LES MAINS, donc plusieurs types de mémoire.
DANS LES JOURS ET LES SEMAINES QUI SUIVENT
C'est alors qu'il faut vraiment apprendre en faisant appel à toutes les techniques de la mémoire (mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire par associations d'idées, moyens mnémotechniques, etc.). On peut additionner les différents types de mémoire.Le fait de lire un cours peut donner l'illusion qu'on le sait. Pour s'assurer qu'il est vraiment assimilé, un seul moyen : le vérifier, Pour cela, prendre par exemple, un titre de paragraphe, cacher celui-ci avec une feuille blanche et écrire ce qu'on sait sur le sujet. Puis, le travail fini, comparer votre texte avec celui du livre ou du cahier. Écrire ce que vous aviez oublié. Et recommencez aussitôt en cachant à nouveau le texte et comparez une fois encore. Si les oublis ou les fautes persistent, faites une fiche sur le sujet avec uniquement ces oublis ou ces fautes car votre cerveau aura une fâcheuse tendance à récidiver et à trébucher toujours sur les mêmes écueils (rappelez-vous vos jeunes années : vous vous trompiez toujours sur le même mot ou vous aviez toujours un trou de mémoire en arrivant à tel ou tel passage d'une poésie, comme si vous aviez quelque part dans votre tête un CD rayé ou possédant un satané petit défaut. L'idée est donc de n'apprendre que ce que nous avons tendance à oublier systématiquement. Ne retenir que l'on croit impossible à retenir. Le reste, le facile, le cerveau le retrouvera toujours à travers le dédale de ses circuits.Une leçon apprise une seule fois ne l'est pas encore définitivement. Il est nécessaire de rafraîchir sa mémoire de temps à autre en la relisant. Ce n'est parfois qu'au 5e, 6e, 7e passage dans les neurones et à travers les protéines mémoires que le message est enfin définitivement enregistré et souvent même à vie.
DANS LA JOIE
Travailler est un plaisir. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de savoir, le plaisir de surmonter une difficulté (par exemple : résoudre un problème de mathématiques ou de physique alors qu'il paraissait difficile), le plaisir d'avoir de bonnes notes, le plaisir d'être toujours meilleur, le plaisir de se surpasser Tous ceux qui ont réussi leurs études et leur vie professionnelles vous le diront : sans un maximum de plaisir, ils n'auraient jamais pu accomplir leur trajectoire.Vous avez tous testé qu'il vous est facile de retenir les paroles d'une chanson, les noms des acteurs d'un film (et même parfois, au mot près, des phrases entières, de celui-ci) alors que vous vous imaginiez avoir une mémoire très moyenne (voire pire). C'est que vous avez entendu la chanson ou vu le film avec beaucoup de plaisir. Le plaisir rend le cerveau totalement réceptif, totalement ouvert. C'est l'apprentissage sans fatigue, Inversement, si vous vous dites avant de commencer un travail : "Je n'aime pas ça" ou "C'est trop difficile", etc., vous fermez votre cerveau comme vous fermeriez votre estomac devant un plat que vous n'avez vraiment pas envie de manger. Il est donc inutile de tenter de travailler si vous commencez à le faire avec des idées négatives en tête.
POUR LIMITER LA FATIGUE
Variez les plaisirs en changeant de matière à étudier toutes les 45 minutes environ, même et surtout si vous aviez envie de continuer la matière en cours avec une belle énergie. Profitez donc de cette énergie pour vous lancer dans l'étude d'une nouvelle matière. En revenant bien évidemment plus tard sur la matière précédente pas encore terminée. Changer d'activité représente des vacances pour notre cerveau. De courts breaks sont tout aussi possibles : en poursuivant, par exemple, pendant quelques minutes la lecture d'un livre, en allant vous laver les mains, vous rafraîchir le visage et boire un peu d'eau (l'eau neuve de nos cellules ), en faisant quelques exercices physiques, voire en marchant un petit km (= 10 minutes), etc. Ces breaks ne sont pas du temps perdu mais du temps gagné car, dans l'heure qui suivra, votre travail sera nettement plus rapide et plus efficace.Si, malgré tous vos efforts, ça ne rentre plus et que vous avez la désagréable sensation de désapprendre ce que vous saviez déjà (cela arrive dans des périodes d'examen), offrez-vous une vraie pause-détente, plus ou moins longue selon votre état de surmenage, dû peut-être aussi à une alimentation déséquilibrée ou à un manque de sommeil. N'attendez jamais la dernière minute pour faire un travail. Car, à la dernière minute, vous ne serez peut-être plus en super forme (mal de tête, début de grippe) ou c'est alors qu'un imprévu surviendra (style une perceuse vous vrillant les tympans pendant deux heures, ou la voisine en pleurs criant : "Le petit chat est mort" et qu'il faut bien quelque peu consoler alors qu'un devoir de maths n'attend plus que vous pour trouver une solution ou que vous avez devant vous la joyeuse perspective d'une dissertation de français ou de philo à terminer, voire à commencer alors qu'il est onze heures du soir).Dr Jean-Marie Thiébaud
Séoul, le 27 septembre 2005
P.S. : La deuxième partie s'intitulera : COMMENT METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ POUR RÉUSSIR UN EXAMEN.
Signature :
Dr Jean-Marie Thiébaud (Séoul, le 27 septembre 2005)
P.S. : La deuxième partie s'intitulera : "Comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir un examen."
Pharmaciens et apothicaires de Franche-Comté du Moyen-Âge au début du 20e siècle
ABRY (alias AUBRY) Girard, apothicaire et bourgeois de Montbéliard (Doubs) qui testa en 1539, léguant une somme de 40 livres estevenantes aux pauvres de l'hôpital de cette ville (Arch. hospit. de Montbéliard, n° B 1).
ABRY Loys, apothicaire et docteur en médecine de Montbéliard (Doubs), maître bourgeois en chef de cette ville en 1544 et 1547 (Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, 1910, p. 332).
ACHINTRE Guillaume Auguste, né à Caderousse (Vaucluse) v. 1797, à Besançon (Doubs), 13, grande-rue, le 17.03.1836, fils d'Étienne A., propriétaire, et d'Angélique Madeleine Guerrin, pharmacien. Il épousa Anne Marie Duprey, née v. 1804 (E.C. de Besançon, registre des décès 1836).
AGNUS Claude, apothicaire de Gray (Haute-Saône) en 1526 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 2409, fol. 50 bis).
ANDRÉ Jean, apothicaire de Besançon (Doubs), mari de Jeanne, veuve d'Étienne Perrucet en 1400. Cette dernière testa devant l'Officialité de Besançon en 1427 (Arch. du Doubs, n° G 323, 329 ; Testaments de l'Officialité de Besançon, t. I, p. 98).
ARBILLEUR Jacques, apothicaire de Besançon (Doubs), paroisse Sainte-Mzarie-Madeleine, mari d'Anne Perron (alias Parron) qui lui donna au moins dix enfants :
- Jean, né le 18.04.1599 (p. : Jean Chifflet, docteur en médecine ; m. : Anne Cabet)
- Anne, née le 02.07.1601 (p. : Nicolas Nazey ; m. : Anne Cabet)
- Claude, née le 24.11.1603 (p. : Jacques Plantamour, docteur en médecine ; m. : Claude Perron)
- Jean (II), né le 01.06.1605 (p. : Jean Bonnot, chirurgien ; m. : Marguerite Brocard, femme de Claude Grandmougin)
- Jacques, né le 18.10.1606 (p. : Pierre Lochard ; m. : Anne Parron)
- Catherine, née le 21.07.1610 (p. : Jacques Garnier ; m. : Catherine Garnier)
- Jacquette, née le 13.09.1612 (p. : Désiré Vieille ; m. : Jacquette Gonnet)
- Jeanne, née le 22.08.1616 (p. : Pierre Doroz, bénédictin ; m. : Jeanne Sarragoz)
- Antonia, née le 25.07.1618 (p. : Didier Jaquelin (alias Jacquelin), notaire ; m. : Antonia Dagnez)
- Jean Baptiste, né le 12.07.1622 (p. : Jean Cabet, prêtre ; m. dlle Jeanne Baptiste Varin (Arch. comm. de Besançon, n° GG 1, fol. 12 (baptême de Jean (II) à la cathédrale Saint-Jean) ; GG 49 (église Sainte-Madeleine), fol. 4 v°, 22, 30, 54 v°, 67 v°, 77, 103, 132 v°, 151 v°)
ARNAULT Nicolas, apothicaire et citoyen de Besançon (Doubs) en 1544 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 1417, fol. 102).
AUBRY : v. ABRY.
BACHELET Gaspard, apothicaire exerçant à Vesoul (Haute-Saône) en 1548-1559, avant 1571. Il épousa Claudine Collette, veuve en 1571. Son héritier universel fut Gaspard Bachelet di le Mercier (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 1422, fol. 7 v° ; 1429, fol. 133 ; 1437, fol. 82 ; 2423, fol. 54 v° ; 2434, fol. 153 ; Arch. de Haute-Saône, n° 550 E Dépôt ; Arch. comm. de Vesoul, n° GG 23, p. 3.
BAILLY François Joseph, pharmacien major à l'hôpital militaire de Besançon (Doubs), né v. 1779, témoin du mariage dans cette ville, le 07.08.1821, entre Charles Nicolas Cochard, peintre en bâtiment, et Antoinette Étiennette Chalon, marchande (E.C. de Besançon, registre des mariages, 1821).
BÂLE (de) Estevenin, médecin et apothicaire à Besançon (Doubs), mari de Guyette, veuve vers 1500 (Arch. du Doubs, n° G 1918, fol. 121).
BALLAND Mathieu, apothicaire, joailler et garde des château et prisons de Lons-le-Saunier (Jura) en 1521-1531 (Arch. du Doubs, n° B - Chambre des Comptes - 2650).
BARATTE Joseph, apothicaire de Besançon (Doubs). Il consentit un bail à loyer à la fin du 18e siècle à Thérèse Talbert, dans sa maison, place Saint-Quentin, où naîtra Victor Hugo en 1802 (Arch. du Doubs, n° E - Familles - 3348).
BARBIER Claude Nicolas, ancien pharmacien demeurant à Vesoul (Haute-Saône), membre du jury du département de la Haute-Saône en 1842 (Annuaire de la Haute-Saône, 1842).
BARTHELET Gaspard, apothicaire de Vesoul (Haute-Saône) en 1557 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 2424, fol. 23 v°).
BARTHIER François, apothicaire de Besançon ((Doubs) au 16e siècle (Arch. du Doubs, n° G 1920, fol. 104 v°).v BAUDIN E., né à Besançon (Doubs) le 17.01.1857, pharmacien de 1re classe, expert chimiste assermenté et juge au tribunal de commerce en 1898 (Dictionnaire biographique de Besançon, 1898).v BAUME (de) Étienne, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1320 (Testaments de l'Officialité de Besançon, I, p. 22).v BEAU Étienne, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1582 (Arch. du Doubs, n° G 1925, fol. 78 v°).v BEAUTHIAS (alias BAUTHIAS) François Xavier Emmanuel, né à Besançon (Doubs) le 25.12.1751, reçu pharmacien "d'après les formes nouvelles" en 1810, membre du jury médical du département du Doubs en 1828-1838 et de la société d'Agriculture, Sciences Naturelles et Arts du Doubs en 1838-1842. Le 03.09.1821, il déclara la naissance à Besançon de Charles Antoine, fils de Jean François Arbey, professeur de médecine, et d'Anne Victoire Poinsot, et il fut témoin, le 29.01.1834, du mariage à Besançon entre sa cousine, Jeanne Jouan, cuisinière, et Jean Claude Matouillot, cultivateur. Il épousa Jeanne Anne Victoire Guyon, née vers 1792 à Villars-Saint-Georges (Doubs), qui lui donna une fille, Jeanne Louise Pélagie, née à Besançon le 21.10.1825. En 1843, il était retiré à Villars-Saint-Georges où, semble-t-il, il finit ses jours (E.C. de Besançon, n° GG 30, fol. 65 v° ; naissances 1825 ; mariages 1834).v BÉJEAN Aimé Joseph, né à Mignafans (Haute-Saône) le 06.03.1840, fils de Ferjeux Béjean, né en 1806, propriétaire, et de Marie Claire Tousset, née vers 1813. Ce pharmacien, installé à Besançon (Doubs), épousa dans cette ville, le 03.03.1875, Marie Étiennette Bidermann, née à Besançon le 10.10.1849, demeurant 18, rue du Chateur, fille de Louis Joseph Bidermann, propriétaire, né vers 1813, et d'Agathe Demontrond, née vers 1826, en présence de françois Nicolas Eugène Lebon, âgé de 48 ans, docteur en médecine, Jean Pierre François Petey, âgé de 78 ans, docteur en médecine, Jean Jacques Péquignot, âgé de 75 ans, greffier à la Cour, et Léon Péquignot, âgé de 50 ans, avocat, tous de Besançon. De 1868 à 1886, Aimé Joseph Béjean tint une officine, 87, grande-rue (l'actuelle pharmacie des Carmes) (E.C. de Besançon ; Annuaires du Doubs, 1868, p. 198 ; 1869, p. 288 ; 1870, p. 310 ; 1879, p. 225 ; 1882, p. 238 ; 1883, p. 226 ; 1886, etc.v BELIN Deniset, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1490 (Arch. du Doubs, n° G 1923, fol. 42 v°).v BELIN Ponce (alias Poncelet), apothicaire de Besançon (Doubs), mari de Bonaventure Rivel (alias Guiel) qui testa en 1546 (ou 1547), fondant son anniversaire en l'église des Cordeliers de Besançon (Bibliothèque de Besançon, ms 2320, fol. 134 ; J.T. de Mesmay, op. cit., t. II, p. 243).v BELON Frédéric, né à Besançon (Doubs) le 06.11.1627, audit lieu le 12.02.1698, inhumé dans l'église Sainte-Madeleine (en présence de Jean Baptiste d'Orival, chanoine, et du sieur Michel Quegain), fils d'honorable Jean Belon, marchand et d'Anne Amidey. Cet apothicaire exerçant à Besançon épousa demoiselle Denise Broche, fille du sieur Charles Broche, docteur en médecine, exerçant lui aussi à Besançon. Dix enfants naquirent de cette union :- Frédéric, né le 24.06.1664, avocat en Parlement, mari de Claudine Élisabeth d'Orival, fille de Richard d'Orival, écuyer, conseiller au Parlement, et de Françoise Billerey.- Antoine François, né le 17.01.1666, mort en bas âge.- Charles Joseph, né le 26.04.1669 (p. : hon. Charles Joseph Riboux ; m. : dlle Jeanne Françoise Fallon), mort en bas âge.- Claude Antoine, né le 29.05.1673, audit lieu le 05.12.1713.- Thomas, frère jumeau du précédent, né le 29.05.1673, religieux dominicain- Anne Charlotte, née le 16.10.1675 (p. : Charles Broche, docteur en médecine ; m. : Anne Oudette Varin)- Claude François, né le 15.07.1677 (p. : Claude Guillemin, docteur en médecine ; m. : dlle Suzanne Pétremand)- Jeanne Marguerite, née le 19.08.1678, audit lieu le 23.06.1758 (p. : hon. Jean Baptiste Varin ; m. : honnête Marguerite Nayme). Elle épousa Ignace du Chesne.- Jeanne Françoise Catherine, religieuse visitandine.Arm. : de gueules au sautoir dentelé d'or ; alias : cantonné de quatre étoiles d'argent (A.C. de Besançon, n° GG 4, fol. 2 v° ; GG 50, fol. 121 v° ; GG 51, fol. 182 v°, 192 v°, 210, 211; GG 52, fol. 52, 52 v°, 84 v°, 112 v°, 135 v°, 220 v°; GG 60, fol. 48; GG 321, fol. 204; Bibliothèque de Besançon, ms 2320, fol. 155 et suiv. ; R. de Lurion, "Nobiliaire de Franche-Comté", p. 75-76 ; J.-M. Thiébaud, "Médecins et Chirurgiens de Franche-Comté" ; J.-J. Lartigue et J.-M. Thiébaud, "Répertoire héraldique de Franche-Comté".v BERNARD Anthoine, apothicaire de Poligny (Jura), cité devant le Parlement de Dole (Jura) en 1593 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 1595, fol. 232 v°.v BERNARD Georges, pharmacien, trésorier de la Société d'Émulation de Montbéliard (Doubs) en 1902 (Bulletin de la Société d'Émulation de Montbéliard, 1902-1903, p. XXVIII).v BERNARD Jules, pharmacien à Montbéliard (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v BERNARD Julien, né vers 1855, pharmacien exerçant à Pontarlier (Doubs) où il fut témoin, le 18.12.1887, de la naissance de René Paul Marie, fils de Désiré Ernest Gindre, âgé de 26 ans, professeur au collège de Pontarlier, et de Marie Marcelle Martenot (E.C. de Pontarlier).v BERTHIER Alphonse, pharmacien de Belfort (Territoire de Belfort), membre de la Société d'Émulation de Montbéliard (Doubs) en 1902 (Bulletin de la Société d'Émulation de Montbéliard, 1902-1903, p. XXVIII).v BERTHIER François, apothicaire de la peste à Besançon (Doubs), remplacé en 1567 par Jacques Maçon (Arch. du Doubs, n° B 31, fol. 221 v°).v BÉVALET Victor, né vers 1821, élève en pharmacie, témoin du mariage à Besançon (Doubs), le 12.07.1850, entre Jean Joseph Mathias BOILLON, meunier, et de Jeanne Françoise Sophie Maire, tailleuse (E.C. de Besançon).v BICHELET Étienne, né v. 1803, témoin du mariage à Besançon (Doubs), le 21.02.1842, entre Jean Christophe Besancenet, coiffeur, et Anne Legros, fille de boutique (E.C. de Besançon).v BIDAUX, pharmacien tenant une officine à Vesoul (Haute-Saône), 3, place du Palais, en 1885 (Annuaire de Haute-Saône, 1885, p. 415).v BIDEY Pierre, apothicaire de Poligny (Jura), tuteur de Guillaume, fils de feu Jehan Thumerey, dudit lieu, marchand, en 1578 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 1583, fol. 12 v°).v BILLOT Paul Émile, né à Rambervillers (Vosges) vers 1824, pharmacien exerçant à Besançon (Doubs). Il épousa Caroline Anne Clémentine Predigam, née à Strasbourg (Bas-Rhin) vers 1830, qui lui donna une fille, Cécile Clémence Virginie, née à Besançon, 69, rue des Granges, le 4 juin 1858. Il était membre de la Société d'Émulation du Doubs en 1855-1857 (E.C. de Besançon ; Annuaires du Doubs, 1855-1857).v BOICHARD, maître apothicaire de Besançon (Doubs), reçu à ses examens les 13 août et 12 novembre 1767. Il épousa Élisabeth Ronot qui lui donna une fille, Jeanne Catherine, née dans le domicile familial, grande-rue, le 19 juin 1769 (parrain : Jean Denis Ronot, aïeul maternel ; marraine : Catherine Faivre, femme de Jean Guillaume Boichard, aïeul paternel (A.C. de Besançon, n° GG 107, fol. 46 v° ; HH 32).v BONGARÇON Renaud (I), apothicaire de Besançon (Doubs) dont l'épouse, Henriette Bourgeois, testa devant l'Officialité de Besançon en 1402. Il fut témoin du testament de Béraud d'Andelot, chevalier, seigneur de Cressia, le 03.08.1410 (U. Robert, "Testaments de l'Officialité de Besançon", t. I, p. 83 ; t. II, p. 26).v BONGARÇON Renaud (II), apothicaire de Besançon (Doubs) cité dès 1429, mari de Thiébaulde Bouveret qui testa à cette date. Lui-même rédigea son testament devant l'Officialité de Besançon en 1450 (Arch. du Doubs, n° G 1915, fol. 159 ; J. T. de Mesmay, "Dictionnaire des anciennes familles de Franche-Comté", t. II, p. 335).v BONNARD Andrey, apothicaire d'Arbois (Jura), cité dès 1585, mort vers 1597, mari de Perrenette Mairot qui moi donna un fils, Jean, cité en 1597 (Arch. du Doubs, n° 2 B - Parlement de Dole - 1471, fol. 378 v° ; 1599, fol. 29, 322 ; 1600, fol. 185 v° ; 2448, fol ; 63 v° ; 2450, fol. 14).v BONNARD Jean, apothicaire de Dole (Jura), en procès devant le Parlement du lieu en 1647 contre le chapitre de la collégiale au sujet d'un cens (Arch. du Jura, n° G 295).v BONNET Charles, pharmacien à Besançon (25), 6, rue des Chambrettes, trésorier de la Société des Pharmaciens de Franche-Comté en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238, 512).v BORREY Antoine, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1563 (Arch. du Doubs, n° G 1924, fol. 273).v BOUR (alias BOURG) André, né à Besançon (Doubs) le 10.02.1758, fs de Jean Laurent Bourg (signe Bour), teinturier, et de Jeanne Claude Fraichot (parrain : André Bourg (signe Bour) ; marraine : Jeanne Françoise Vigneron, ép. de Claude Joseph Franchet - A.C. de Besançon, n° GG 96, fol. 15), pharmacien, condamné à mort, guillotiné à Lyon (69) le 26.12.1793 (J. Sauzay, "La Persécution révolutionnaire dans le département du Doubs", t. V, p. 456).v BOURGEAU Jules, pharmacien à Besançon (25), 128, grande-rue, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v CALLET Jacques, apothicaire de Besançon (Doubs) dont la veuve, Catherine Thomas, est citée en 1695 (Arch. du Doubs, n° E - Familles - 3788).v CAMUS Barthélemy, né à la fin du 16e siècle, apothicaire de Vesoul (Haute-Saône). Il épousa Antoinette Cuchet qui lui donna un fils, Jean François Camus, né à Vesoul le 03.08.1622, docteur ès droits, vicomte maïeur de Vesoul, conseiller au Parlement de Franche-Comté, anobli en 1672 par lettres Charles II et Anne-Marie d'Autriche, régente, confirmant celles déjà données par Philippe IV en 1660 ("Dictionnaire biographique de la Haute-Saône", Salsa, t. I, p. 154)v CHARNAUX, apothicaire de Pontarlier (Doubs), incarcéré au château de Joux (commune de La Cluse-et-Mijoux) (Doubs) le 3 août 1793 (Jules Mathez, Annales du château de Joux, 1932, p. 320).v CHASSIGNET Jacques, apothicaire de Besançon (Doubs), avant 1571. Il épousa Odile Recy qui lui donna un fils, Jean Chassignet, prêtre (Arch. du Doubs, n° G 1920, fol. 288).v CHASSIGNET Jean, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1616 (Arch. du Doubs, n° G 1921, fol. 215).v CHEVANNEY Jean-Baptiste, apothicaire de Besançon (Doubs) qui épousa Claudine Vauderet en 1635 (Arch. du Doubs, n° E - Familles - 3807).v CLERC Jacques, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1490 (Arch. du Doubs, n° G 1923, fol. 41).v CORVOISIER Désiré, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1624 (Arch. du Doubs, n° G 1921, fol. 322).v CUENIN E., pharmacien à Besançon (25), 35, rue des Granges, en 1882. IL vendait aussi des produits chimiques, des objectifs et des chambres noires (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v DANIEL Étienne, pharmacien de Besançon (Doubs) au 17e siècle (Arch. du Doubs, n° G 1898, fol. 89).v DAUJEA, pharmacien à Saint-Amour (Jura), propriétaire des ruines du château de Montagna-le-Reconduit (Jura) au milieu du 19e siècle (A. Rousset, "Dictionnaire des communes du Jura", t. IV, p. 258).v DELACROIX, pharmacien à Pontarlier (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 307).v DEVAUX, pharmacien de Gy (70), président de la Société des Pharmaciens de Franche-Comté en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 512).v DEVILLERS Thomas, apothicaire de Besançon (Doubs), mari de Marie Françoise Volard qui lui donna un fils, Claude Alexis Denis Devillers, né à Besançon v. 1717-1718, audit lieu le 13 nivôse an II (02.01.1794), mari de Jeanne Françoise Tupin (E.C. de Besançon).v DIJON (de) Thierry : v. FRAIGNOT (de) alias DIJON (de) Thierryv DORNIER L., pharmacien à Morteau (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 307).v DUMONT Joseph, pharmacien à Quingey (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 264).v EHRHART, pharmacien à Besançon (25), 5, rue Battant, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v EUVRARD, pharmacien, officier municipal de Besançon (25), suspect placé sous le poids de l'ajournement le 25.09.1793, nommé mb. du directoire du district de Besançon par le représentant SALADIN en mai 1795, élu réélu administrateur (président) de la municipalité de Besançon sous le Directoire (Sauzay, "Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs", I, 218, 220; II, 79; IV, 701 ; V, 336; VII, 29, 352, 690; VIII, 9, 627, 662, 686, 696, 699, 702).v FAGOT Charles Pierre François, pharmacien à Dole (Jura), né dans cette ville le 15.07.1847, fils de Jean Ferdinand Fagot, négociant, et de Joséphine Protet. Le 27.09.1871, il épousa à Besançon (Doubs) Catherine Marie Antoinette Gouillard, née audit lieu le 22.02.1852, fille de Claude François Gouillard (né vers 1814), voiturier par eau, et d'Anne Claude Cellard (E.C. de Besançon).v FAIVRE E., pharmacien à Baume-les-Dames (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 278).v FAIVRE Ernest, pharmacien né à Besançon (Doubs) le 17.11.1852, exerçant à Baume-les-Dames (Doubs) en 1898, année où il était notamment membre du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement ("Dictionnaire biographique du Doubs, 1898").v FALLOT Charles, pharmacien à Montbéliard (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v FALLOT Pierre François Charles dit FALLOT père, pharmacien de Montbéliard (Doubs) de l'an IX à 1835, qualifié d'ancien pharmacien en 1859-1862. Conseiller municipal de Montbéliard en 1830, il fut vice-président de la société de patronage en faveur des enfants orphelins en 1859 et président de cette société en 1861. Il fut aussi membre du conseil de salubrité et d'hygiène de l'arrondissement de Montbéliard en 1862 et président d'honneur du comice de Montbéliard en 1862-1864 ("Annuaires du Doubs", an IX ; 1830, p. 400 ; 1859, p. 508 ; 1861, p. 576 ; 1862, p. 626 ; 1864, p. 632).v FELLETET Jacques, apothicaire de Baume-les-Dames (Doubs), parrain d'Anne, fille de François Daguet, chirurgien, et de Marguerite Ramasson, baptisée audit lieu le 26.09.1620 (R.P. de Baume-les-Dames).v FIERECK Charles, pharmacien à Pont-de-Roide (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v FLORY (alias FLEURY) Léonard, apothicaire de Besançon (Doubs) qui épouse en l'église Saint-Pierre dudit lieu, le 26.08.1631, Magdeleine Julin (dite quelquefois Gelin), de Montbozon (Haute-Saône) qui lui donna au moins huit enfants, tous nés à Besançon :- Claudine, née le 03.06.1633 (p. : honorable Jean Richard, notaire, "attestateur de la cour archiépiscopale" ; m. : Claudine, fille de François Julin, de Montbozon)- Suzanne, née le 31.12.1634 (p. : honorable Claude Bruno Garinet, étudiant ; m. : Suzanne Privelz (Privé ou Privey))- Anne, née le 06.01.1636 (p. : honorable Pierre Antoine Nicolas, notaire ; m. : demoiselle Anne Talebert (Talbert))- Jeanne, née le 12.01.1638 (p. : Pierre Mathieu d'Auxiron, docteur en médecine ; m. : Jeanne Flory)- Dominique, né le 31.07.1639 (p. : Dominique Chassignet, orfèvre ; m. : demoiselle Marguerite Jannet)- Antoinette, née le 05.09.1640 (p. : honorable Jean Paris ; m. : demoiselle Antoinette Montagu)- Claude, né le 13.11.1644 (p. : Claude Guilloz, docteur en médecine ; m. : honnête Anne Boisot)- François, né le 11.08.1647 (p. : François Phisalix ; m. : Guyonne Flory)Madeleine Julin fut marraine de Madeleine, fille de Jean Lardois, forgeron, baptisée à Besançon le 28.05.1644.Léonard Flory était encore apothicaire à Besançon en 1653 (Arch. du Doubs, n° G 1798 : A.C. de Besançon, n° GG 51, fol. 27 v°, 32 v°, 53 v°, 71 v° ; GG 175, fol. 37 v° ; GG 176, fol. 66 v°, 79, 89 ; GG 177, fol. 18 ; GG 264, fol. 94).v FLORY Nicolas, apothicaire de Granges (Haute-Saône), père de :- Pierre Nicolas Flory, né à Granges le 23.02.1618 (p. : Nicolas, fils de maître Jean Clerc, de Granges ; m. : dlle Bonne Françoise Vernerey, fille de Guillaume Vernerey, capitaine-châtelain de la seigneurie de Granges) (A.D. de Haute-Saône, n° 276 dépôt 4 (R.P. de Granges-la-Ville).v FRAIGNOT (de) alias DIJON (de) Thierry, apothicaire de Besançon (Doubs) au 16e siècle (Arch. du Doubs, n° G 1897, fol. 54).v GAUTHEROT Laurent, maître apothicaire à Besançon (Doubs), parrain de Charlotte Laurence, fille de Jacques Philippe Jussy, professeur de médecine, baptisée à Besançon le 31.07.1757 (R.P. de Besançon).v GÉRARDE, pharmacien à Saint-Hippolyte (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v GOY, apothicaire de Besançon (Doubs), reçu membre associé de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Franche-Comté en 1760 (P.V. et Mémoires de l'Académie de Besançon, vol. 195, spécial, 250e anniversaire, Besançon, 2002, p. 56).v GROSRICHARD, pharmacien à Besançon (25), 12, place Labourée (actuelle place de la Révolution) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v GROSRICHARD Paul, né vers 1876, pharmacien à Besançon (Doubs), 12, place de la Révolution, chevalier de la Légion d'Honneur losqu'il déclara le décès de Jean Bouchot, conservateur des musées, le 6 mai 1932 (E.C. de Besançon).v GUICHARD Albert, pharmacien à Besançon (25), 3, rue d'Anvers et 13, rue des Chambrettes, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v JACQUES, pharmacien à Besançon (25), 140, grande-rue, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v JACQUET, phamacien à Arc-et-Senans (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 264).v JANSON Claude François, maître apothicaire de Besançon (Doubs), né à Marnay (70) v. 1721, à Besançon le 29 vendémiaire an III (20.10.1794). Il représenta la corporation des pharmaciens à l'assemblée générale de la ville de Besançon en 1789. Il épousa Jeanne Françoise Rousselet, native de Pesmes (Haute-Saône), qui lui donna deux fils : 1) Jean Louis, né à Besançon le 26.08.1749, audit lieu le 07.04.1794, docteur en médecine, membre du conseil général de la commune de Besançon, officier municipal en 1792, secrétaire du club des jacobins de Besançon, juge au tribunal criminel de Besançon, administrateur de l'hôpital du Saint-Esprit ; 2) Charles François Xavier, né à Besançon le 14.02.1756, membre du directoire du département du Doubs en 1792 (destitué en 1793), renommé membre de ce directoire en 1795 puis administrateur du département en 1799 (démissionnaire le 24.04.1799) (R.P. et E.C. de Besançon ; J. Sauzay, "Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs ; J.-M. Thiébaud, "Les Francs-Comtois de la Révolution").v JEANNOT, pharmacien à Rougemont (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 278).v KUCSKOWSKI, pharmacien à Besançon (25), 13, grande-rue, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v LANTERNIER, pharmacien à Besançon (25), 1, rue des Boucheries, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v MAGINET Pierre (1575-1629), apothicaire, écrivain et membre du magistrat de Salins (Jura), auteur de "La Thériaque française". Il mourut victime de la peste (A. Rousset, "Dictionnaire des communes du Jura", t. VI, p. 587).v MAGNIEN G. F., pharmacien à Besançon (25), 10, rue de la Madeleine, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v MARCHAND Louis, maître juré en pharmacie à Salins (Jura), fils de Simon Marchand et de Claude Françoise David, cités ci-dessous. Il épousa 1) par contrat du 17.09.1678 et, religieusement, en l'église Saint-Anatoile de Salins, le 09.10.1678, demoiselle Catherine Françoise Quirot, née le 09.04.1659, Salins, fille de feu Alexandre Quirot, marchand, bourgeois de Salins, et de Catherine Regalier ; 2) par contrat du 09.07.1697 et, religieusement, en l'église de Buffard (Doubs), Alexise Thérèse Flocard, fille du feu sieur Étienne Flocard et d'Alexise Baudier. Du premier lit sont issus plusieurs enfants : 1) Claude Ignace, baptisé à Saint-Anatoile de Salins le 30.07.1679 ; 2) Claude Françoise, baptisée à Saint-Anatoile de Salins le 17.09.1680, 1766, qui épousa Simon Joseph Deschard, avocat à Salins et subdélégué, fils de Ferdinand Deschard, procureur et notaire, mayeur de Salins, et de N., et veuf de Marguerite Henriette Jobelot. Il testa le 21.10.1731 et son testament fut publié le 15.12.1731 (Arch. de Salins, n° FF 28, fol. 46). Claude Françoise Marchand testa le 08.01.1766 et son testament fut publié le 31.01.1766 (Arch. de Salins, n° FF 36, fol. 88). Elle choisit pour héritier son neveu, le sieur Hugues Joseph Cavaroz, capitaine de cavalerie au service du roi de Portugal ; 3) Denise Françoise, baptisée à Saint-Anatoile de Salins le 12.12.1681, Salins, paroisse Saint-Jean-Baptiste, le 03.02.1754, qui épousa en l'église Saint-Jean-Baptiste de Salins, le 25.02.1713, Jean Baptiste Pierre François Cavaroz, o v. 1686, Salins le 19.03.1765, bourgeois de Salins, avocat en Parlement, trésorier de la ville de Salins ; 4) Jeanne Thérèse, baptisée à Saint-Anatoile de Salins le 03.10.1683 ; 5) Pauline, baptisée à Saint-Anatoile de Salins le 28.05.1685 ; 6) Pierre Ignace, baptisé à Saint-Anatoile de Salins le 01.09.1687, Salins le 13.07.1748, docteur en médecine, qualifié de noble, mayeur de Salins en 1741-1748. Il épousa demoiselle Thérèse Alexise Donneux qui lui donna : a) Claude François, baptisé à Saint-Maurice de salins le 13.05.1726, écuyer, lieutenant en 1751, capitaine en 1766 au régiment de Forez, chevalier de Saint-Louis ; b) Jeanne Josèphe, baptisée à Saint-Maurice de Salins le 20.02.1729 ; 7) Marie Denise, baptisée à Saint-Anatoile de Salins le 28.09.1688 ; 8) Marie Josèphe, religieuse hospitalière à Salins (39) puis à Pont-de-Vaux (01) ; 9) Claude, baptisé à Saint-Anatoile de Salins le 08.02.1691, Salins le 07.07.1751 après avoir testé le 16.07.1748 (testament publié le 07.07.1751) (Arch. de Salins, n° FF 33, fol. 37) ; 10) Étienne Joseph, baptisé à Saint-Anatoile de Salins le 25.01.1693, bourgeois de Salins (R.P. de Saint-Anatoile, de Saint-Maurice et de Saint-Jean-Baptiste de Salins ; R.P. de Buffard ; B.M.B., fichier de Lurion, ms 2323).v MARCHAND Simon, apothicaire à Salins (Jura) en 1663 (A.D.D., n° G 2326) et en 1668, en 1686, fils de Louis Marchand, écuyer, et d'honnête Denise Romand. Il épousa 1) par contrat du 19.04.1627 et, religieusement, à Saint-Jean-Baptiste de Salins (Jura), le 27.04.1627, Marguerite Moutenet, 1637, fille d'honorable Pierre Moutenet et de feue Gabrielle Gallet, de Salins ; 2) Claude Françoise David, 12.09.1676, fille de Jean David, écuyer, et de Jacqua Marrelet. Du premier lit sont issus : a) Éléonore, baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 01.04.1630, 11.12.1652 ; b) françoise, baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 20.01.1632 ; c) Antoine, baptisé à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 11.03.1635 ; d) Claudine, baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 06.07.1636. Du deuxième lit : e) Louis, maître juré en pharmacie, cité plus haut ; f) Marguerite, baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 22.06.1644, qui épousa Charles de La Tour, de Paris, maître à danser, établi plus tard à Mâcon (Saône-et-Loire) puis à Chambéry (Savoie) ; g) Denise, baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 10.01.1647, qui épousa en l'église Saint-Jean-Baptiste de Salins, le 03.02.1670, Anatoile Girod, docteur en médecine, installé à Poligny (Jura) ; h) Antoine, baptisé à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 11.01.1650 ; i) Claude, prêtre, chanoine de Notre-Dame d'Arbois (Jura), 1710 ; j) Simon Joseph, baptisé à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 11.05.1657 ; k) Clauder François, baptisé à Saint-Jean-Baptiste de Salins le 28.10.1660 ; l) Suzanne qui épousa Georges Raclet, de Salins, veuf de Pétronille Charpy, fils de Pierre Raclet, de Port-Lesney (Jura), et de Jeannette Parregaud (R.P. de Saint-Jean-Baptiste de Salins ; B.M.B., fichier de Lurion, ms 2323).v MATHEY G., pharmacien à Ornans (25), vice-président de la Société des Pharmaciens de Franche-Comté en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 264, 512).v MERCIER L., pharmacien à Pontarlier (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 307).v MONNIER Louis, pharmacien à Besançon (25), 23, rue Ronchaux, secrétaire général de la Société des Pharmaciens de Franche-Comté en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238, 512).v MOOCH Philippe, pharmacien à Audincourt (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v MOOK, pharmacien à Montbéliard (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v MORFAUX Ernest, pharmacien à L'Isle-sur-le-Doubs (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 278).v MORIZOT Albert, pharmacien à Clerval (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 278).v MOUQUIN L., pharmacien à Baume-les-Dames (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 278).v NARDIN, pharmacien à Hérimoncourt (25) (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v PAGNY J., pharmacien à Pontarlier (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 307).v PAILLOT, pharmacien à Besançon (25), route de Baume, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v PANIER François, apothicaire, nommé suppôt du magistrat de Pontarlier (Doubs) le 20 août 1724 (A.C. de Pontarlier, n° BB 6).v PARRAND Eugène, pharmacien à Montbéliard (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v PASSARD Jean, pharmacien de Besançon (Doubs) dans la première moitié du 17e siècle (Arch. du Doubs, n° G 1899, fol. 51 v°).v PERRECIOT Hugues, apothicaire à Besançon (Doubs) en 1585, fils de Jean Perreciot, notaire (Arch. du Doubs, n° G 1920, fol. 142 v° ; 1925, fol. 107).v PERRENOT, apothicaire, élu membre du conseil général de la commune de Besançon (Doubs) fin 1792 (J. Sauzay, "Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs", t. III, p. 222).v PERRON Étienne, apothicaire à Besançon (Doubs), parrain de Joseph Étienne, fils de Claude Pierre Rolin, baptisé à Besançon le 21.07.1700 (A.C. de Besançon, n° GG 150, fol. 106).v PRUDENT François Joseph, pharmacien, mort à Besançon (Doubs) le 3e jour complémentaire de l'an II (A.C. de Besançon, n° E 56, fol. 11 v°, cahier 3).v RABACON Jacques, pharmacien, mort à Besançon (Doubs) le 25 mai 1691 (A.C. de Besançon, n° GG 58, fol. 53).v RAVILLARD, pharmacien à Ornans (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 264).v RICHARD, pharmacien à Besançon (25), 16, rue du Chateur, secrétaire adjoint de la Société des Pharmaciens de Franche-Comté en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238, 512).v ROCH, pharmacien à Saint-Vit (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 264).v ROLIN Claude Pierre, apothicaire à Besançon. Il épousa Anne Marguerite Guillaume qui lui donna un fils, Joseph Étienne, baptisée en l'église Saint-Maurice de Besançon (Doubs) le 21.07.1700 (p. : Étienne Perron, apothivaire ; m. : dlle Marguerite Rolin) (A.C. de Besançon, n° GG 150, fol. 106).v ROMAND, pharmacien à Lons-le-Saunier (Jura), propriétaire au milieu du 19e siècle du prieuré de Vernantois (Jura) (A. Rousset, "Dictionnaire des communes du Jura", t. VI, p. 173).v ROY, pharmacien à Besançon (25), 2, rue de la Madeleine, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v SAGET Denis, apothicaire de Besançon (Doubs), propriétaire de trois prés à Larnod (Doubs) et d'une vigne à Arguel (Doubs) en 1530 (Arch. du Doubs, n° G 1910).v SERRÈS, pharmacien à Besançon (25), 6, place Saint-Pierre, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v SERRETTE, pharmacien à Besançon (25), 67-69, rue des Granges, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v STEINER, pharmacien à Maîche (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v TAILLEUR J. P., pharmacien à Besançon (25), 99, grande-rue, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).v TARTARIN Deniset, apothicaire de Besançon (Doubs) en 1554 (Arch. du Doubs, n° G 1897).v TRAVAILLOT F., pharmacien à Pontarlier (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 307).v VERMOT, pharmacien au Russey (25) en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 293).v VINOT (ou VINON) Claude, apothicaire de Luxeuil (70). Il épousa Catherine Urbain qui lui donna une fille, Anne Françoise, o v. 1660, épouse d'Etienne (ou Thomas Louis) Rance, o Dambenoît-les-Colombe (70) le 05.01.1664, fils de Jean Rance et de Jeanne Roland (R.P. de Dambenoît).v VOIRIN, pharmacien à Besançon (25), 1, quai de Strasbourg, en 1882 (Annuaire du Doubs, 1882, p. 238).© Jean-Marie Thiébaud, 2006-2007.
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD
Notes :
Abréviations :
A.C. : Archives communales
Arch. : Archives
E.C. : état civil
fol. : folio
m. : marraine
p. : parrain
P.V. : Procès-Verbaux
R.P. : registres paroissiaux
: décédé(e)
Le parc marronnier de Séoul, quartier de Daehangno
À quelques mètres à gauche de la sortie 2 de la station Hyehwa, sur la ligne bleue du métro (ligne n° 4, station 420), on découvre le Parc Marronnier qui donne sur la rue Daehangno.
Ce parc tire son nom d'un arbre jadis inconnu en Corée, un marronnier venu specialement de France pour apporter une touche supplémentaire qui rappelle ce pays, symbole de la cuilture. L'arbre s'est acclimaté au pays en changeant un peu de forme, devenant plus large, plus trapu et un peu moins grand pour résister à la secheresse de l'air et à la rigueur de l'hiver et ses vents sibériens. Ce premier arbre s'est d'ailleurs si bien adapté qu'il a fait des petits devenus grands et, de nos jours, on ne compte pas moins d'une douzaines de marronniers français dans le parc qui porte ainsi un nom français puisque le mot marronnier était encore inconnu dans la langue coréenne.
Après le départ de l'Université Nationale en mars 1975, le lieu a conservé une vocation culturelle et les amateurs de théâtre d'art et d'essai peuvent chaque jour découvrir des spectacles offerts par des troupes de théâtre ou de danse qui se présentent pour la première fois au public. Quelques peintres y exposent aussi leurs tableaux. Enfin, des concerts et divers spectacles en plein air contribuent à faire du parc Marronnier un haut lieu culturel qui se veut un peu le Montmartre de Séoul.
Pour rappeler l'ancienne université inaugurée en août 1946, donc peu de temps après la fin de la seconde guerre mondiale et l'indépendance de la Corée, on peut voir de nos jours au centre du parc, une maquette montrant tous les anciens bâtiments des facultés de lettres et de droit aujourd'hui rasés. Seuls subsistent de l'autre côté de la rue Daehangno ceux de l'ancienne faculté de médecine, devant le Centre Hospitalier Universitaire National de Séoul. La maquette montre un petit pont qui enjambe le ruisseau qui serpentait encore à l'epoque le long de Daehangno et que les étudiants devaient franchir pour accéder aux bâtiments de l'Université. Ce pont portait le nom de pont Mirabeau pour rappeler le nom d'un fameux pont de Paris qui enjambe la Seine non loin du quartier latin, au cur de l'université de Paris, de cette université ou, après la guerre, les étudiants français et étrangers retrouvaient le goût de la liberté en découvrant l'existentialisme et des auteurs comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus. Le pont Mirabeau avait aussi été immortalisé par Guillaume Appolinaire :
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Et, pour que Daehangno ait vraiment un parfum parisien, l'idéal était de donner des noms "à la française"
Le ruisseau a disparu mais on peut suivre encore sa trace puisque les urbanistes ont eu la bonne idée de le représenter par une bande verte qui serpente tout au long du trottoir de Daehangno depuis 2004.
Dans le parc se dresse aussi la statue grandeur nature d'un jeune patriote coréen, Kim Sangok (1890-1923) qui avait trouvé refuge à Shanghai apres plusieurs attentats contre les occupants japonais. Revenu clandestinement dans son pays natal, il lança une bombe dans le commissariat de Jongno et tua aussi une dizaine de Japonais dans des combats de rue. La police ne tarda pas à decouvrir son refuge dans la maison d'un ami. Quand la maison fut cernee, il préféra se suicider et devint dès lors pour les Coréens un martyr de l'indépendance.
Signature :
Dr Jean-Marie Thiébaud
La cathédrale Myeong-Dong de Séoul (Corée du Sud)
La cathédrale Myeong-Dong de Séoul a été bâtie sur l'emplacement où s'installa en 1784 la première communauté catholique de la ville. Ce quartier portait alors le nom de Myeong-Nae-Bang et le terrain où s'élèvera la cathédrale appartenait à Kim Num-wu, baptisé sous le nom de Thomas. Ce personnage, arrêté en 1785, banni, torturé, mourut l'année suivante des suites de ses blessures. Son portait est accroché à l'un des murs de la cathédrale. Mgr Jean-Marie Gustave Blanc (1844-1890), 6e évêque de Corée sous le nom d'évêque d'Antigone (sacré à Nagasaki le 9 juillet 1883), et vicaire apostolique de Corée depuis le 20 juin 1884, fera l'acquisition de ce terrain et c'est le père Eugène Jean Coste qui l'utilisera pour y installer le centre administratif et religieux de l'archevêché de Séoul.
Eugène Jean Coste (né à Montarmaud dans le département de l'Hérault le 17 avril 1842), surnommé "le bon père Coste" et "Ko" en coréen, missionnaire français des Missions Étrangères de Paris, quitta la France le 15 juillet 1868 en qualité de sous-procureur à Hong-Kong. Plus tard, il remplaça le procureur de Singapour du 30 décembre 1870 au 22 juin 1872 avant d'être nommé procureur à Shanghai. Ayant demandé à servir dans une mission évangélique, il fut agrégé au vicariat apostolique de Corée en septembre 1875 mais, bloqué à la frontière de la Mandchourie, il ne parvint à Séoul que le 8 novembre 1885. Peu après son arrivée, il fit construire une imprimerie, les bâtiments de l'évêché, une chapelle provisoire à l'emplacement de la future cathédrale et une résidence pour les religieuses de Saint-Paul-de-Chartres dont il était l'aumônier. C'est lui qui, en 1892, posa la première pierre de la cathédrale de Séoul dont il avait conçu les plans. L'inauguration officielle de l'édifice, construit en forme de croix latine et dominé par un clocher s'élevant à 43 mètres, se déroula le 22 mars 1897 en présence de M. Collin de Plancy, consul général de France. Mais la mort du Père Eugène Jean Coste, survenue le 28 février 1898, empêcha ce missionnaire bâtisseur de voir l'achèvement des travaux qui furent dès lors supervisés par son successeur, le Père Victor Poisnel. L'église fut enfin consacrée le 29 mai 1898 sous le vocable de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Cette cathédrale, la première en Corée de style néo-gothique, construite à l'aide d'une main-d'uvre essentiellement chinoise, s'apparente, sur le plan architectural, aux édifices religieux qu'on élevait en France à la même époque. Classée trésor national n° 258, elle est faite de briques alternant le gris et l'ocre pour accentuer, rythmer et mettre en valeur les reliefs du bâtiment.
En 1900, on transféra les reliques des martyrs tués lors des persécutions de 1839 et 1866 du séminaire de Yong-san à la crypte de la cathédrale.
La cathédrale, à présent quelque peu noyée dans un carré de buildings en contrebas de Nam-san et la tour de la télévision de Séoul, possède un autel élevé en juin 1926 pour commémorer les 79 martyrs béatifiés l'année précédente. Des orgues avaient été installées en 1927 à l'occasion du jubilé d'or de Mgr Charles Mutel mais elles furent remplacées par des orgues électriques en 1960 et, enfin, par des orgues allemandes Bosch le 3 avril 1985.
Un grand tableau peint en Italie par Jusutanian (1926) représente les 79 Français et Coréens (évêque, prêtres et fidèles) béatifiés par le pape Pie XI le 5 juillet 1925. La plupart d'entre eux ont été martyrisés en 1839 et 1846. Le pape Jean-Paul II les a canonisés le 6 mai 1984, lors de sa venue à Séoul, en ajoutant à cette première liste, 24 victimes de la grande persécution de 1866.
Les vitraux, représentant des épisodes de la Bible et les mystères du Rosaire, ont été restaurés en 1982 par Lee Nam-gyu. Ceux d'origine avaient été réalisés dans des monastères français bénédictins.
La crypte contient les reliques de Mgr Laurent Marie Joseph Imbert, second évêque de Corée, de Jacques Honoré Chastan, de Pierre Philibert Maubant (tous trois membres des Missions étrangères de Paris), de Kim Sung-woo (Antoine), de Choi Gyung-hwan (François) et de deux autres martyrs anonymes. Ces sept personnages ont été exécutés à Sae-Nam-To lors de la persécution de 1839. D'abord inhumés sur la colline dite Sam-synong-san de la montagne Koan-ak-san au district de Koa-tchyen jusqu'à leur exhumation le 21 octobre 1901, leurs restes reposent dans le caveau de la cathédrale de Séoul depuis le 2 novembre 1911 (avec le feu vert des autorités japonaises qui venaient d'annexer la Corée). La crypte renferme aussi les reliques des Pères Jean Antoine Pourthié et Michel Alexandre Petitnicolas, martyrisés en 1866. Une messe est célébrée dans la crypte tous les jours de la semaine à 10 heures du matin.
Comme aux abords de la plupart des églises catholiques de Corée, une réplique de la grotte de Lourdes (avec des statues de la Vierge de l'Immaculée Conception et de Bernadette Soubirous) a été consacrée par l'archevêque Rho Ki-nam, le 27 août 1960 en action de grâce pour la paix retrouvée dans la péninsule coréenne. Une première statue de la Vierge de l'Immaculée Conception, sculptée en France en 1948, avait érigée à l'occasion du 50e anniversaire de la construction de la cathédrale. Cette statue subsiste derrière l'édifice, près de ma maison des religieuses de Saint-Paul de Chartres.
Dans les années 1970 et 1980, la cathédrale Myeong Dong servit de point de ralliement du mouvement pour la démocratisation du pays et des défenseurs des droits de l'homme. Elle connaîtra même des moments cruciaux lorsqu'elle servira d'abri à des étudiants et des militants faisant la grève de la faim pour contraindre le pouvoir à céder et à offrir au pays davantage de démocratie.
De nos jours, sur les grandes marches qui conduisent jusqu'à l'esplanade de l'édifice, ce sont des travailleurs émigrés, Philippins pour la plupart (mais aussi Pakistanais, Thaïs, Cinghalais, Africains, Chiliens, etc.) qui pratiquent quotidiennement des sit-in en brandissant affiches et banderoles pour tenter d'obtenir la régularisation des travailleurs clandestins et autres sans-papiers.
Pour les curieux et autres amoureux de l'histoire, conseillons la Galerie de la Paix (dans l'enceinte du Centre Catholique) et le musée des religieuses de Saint-Paul de Chartres.
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD
Mots d'origine étrangère dans la langue anglaise et américaine
Mots français (288)
Les mots français sont, parmi les mots étrangers, ceux que les Anglais et surtout les Américains utilisent le plus dans leur propre langue.
à bientôt : "see you soon" (expression française d'usage fort rare)
adieu : utilisé comme "farewell" pour quelqu'un qu'on ne reverra pas
agent provocateur : idem dans les deux langues
aide-de-camp : idem dans les deux langues
aide-mémoire : 1. petit papier pense-bête ; 2. moyen mnémotechnique, 3. carnet de notes diverses
à la : "in the manner of"
à la carte : expression utilisée au restaurant (comme en France)
à la mode : 1. "in fashion", style (G.-B.) ; 2. "with ice cream" (U.S.A.)
amateur : idem dans les deux langues
amour propre : "self respect"
après : after
après-ski : activité du soir après le ski
apropos (écrit aussi "à propos") : 1. idem dans les deux langues (with regard to) ; 2. être bien dans un vêtement ; 3. "on the subject of" ; 4. "by the way", incidentally" ; 5. "appropriate"
arriviste : "social climber"
art deco : idem dans les deux langues. Noter l'absence d'accent aigu lorsque le mot "deco" est utilisé en anglais.
attaché : d'ambassade, terme diplomatique (entendu notamment dans le film"Mission Impossible")
attaché case : idem dans les deux langues
au contraire : to the contrary
au courant : up-to-date, abreast of current affairs
au fait : 1. être au fait de ; 2. être en harmonie avec
au gratin : terme culinaire
au jus : terme culinaire
au naturel : idem dans les deux langues
au pair : idem dans les deux langues
auteur : a film director, specifically one who controls most aspects of a film, or other controller of an artistic situation.
avant garde : terme artistique
bagatelle : chose sans valeur
barre : terme de danse
beaucoup : "a lot of" (ex : "beaucoup bucks" en slang)
beau idéal : "an idealized type"
Beaux-Arts : style of architecture
belle époque : an era of cultural refinement
belles lettres : literary works valued for their aesthetic qualities
bête noire : something or somebody which is detested or avoided
billet-doux : idem dans les deux langues, (syn. de l'anglais "love letter")
bistro : small restaurant. Noter l'absence de "t" final.
blanch, du verbe blanchir : terme de cuisine
blasé : syn. de l'anglais "jaded"
blond(e) : syn. de l'anglais "fair haired"
bonhomie : idem dans les deux langues
Bonjour ! : "Hello !"
Bon mot : syn. de l'anglais "witticism"
Bonne chance ! : syn. de l'anglais "Good luck !"
Bon vivant : syn. de l'anglais "an epicure"
bon voyage : idem dans les deux langues que "Enjoy your trip" mais avec une plus grande distinction
bouffant : terme utilisé pour désigner un type de coupe de cheveux
bouillabaisse : terme culinaire (plat méridional français)
bouillon : idem dans les deux langues
bourgeois : idem dans les deux langues
bourgeoisie : idem dans les deux langues
boutique : magasin pour marchandises de luxe
Braille : idem dans les deux langues
Brasserie : small restaurant
bric-a-brac : idem dans les deux langues. On trouve par exemple ce mot dans la nouvelle "A Glowing Future" de Ruth Rendell (née en 1930). Noter l'absence d'accent grave sur le "a" liant "bric" et "brac".
bricolage : syn. de l'anglais "construction from bits and pieces on hand".
brunette : petite femme aux cheveux noirs
buffet : prononcé à la française s'il s'agit du buffet servi lors d'une réception
cachet : avoir une certaine qualité ; "a distinctive quality"
café : lieu où l'on vend des boissons non alcoolisées. Ne s'applique jamais à la boisson du même nom.
can-can : danse. Noter que seuls les Français utilisent l'expression "french- cancan", les Anglo-Saxons se contentant de "can-can".
carte blanche : au sens d'avoir carte blanche (free hand, ability to do want we want)
cause célèbre : procès, personne, etc., qui attirent l'attention du grand public
cerise : couleur
C'est la vie : expression dite avec le même sens qu'en français. Équivalent de l'anglais "That's life".C'est magnifique ! : Équivalent de l'anglais "That's great". Rare.chaîné : terme de dansechaise longue : parfois écrite "chaise loungue"champagne : idem dans les deux langueschapeau : a hatcharabanc : idem dans les deux langueschargé d'affaires : diplomatechassé : terme de dansechef : chef cuisiniercheval de frise : barbelés, piques, morceaux de verre, etc., disposés au sommet d'une clôture pour empêcher l'accès à une propriété et la protégerchic : idem (syn. de "stylish" en anglais)chignon : idem ("a hairstyle worn in a roll at the nape of the neck")cinéma d'auteur : idem dans les deux languesciné vérité : film réalisé comme un documentairecliché : idem (entendu notamment dans la version américaine du film "Syriana" de Stephen Gaghan, 2005)clientele : idem (noter l'absence d'accent grave lorsque le mot est utilisé en anglais)coiffureComment allez-vous ? : Équivalent de l'anglais "How are you ?" (formule de politesse)Comment vas-tu ? : Équivalent de l'anglais "How are you ?" (cette formule, plus familière que la précédente, est réservée aux amis, aux copains et à la famille)concierge : hotel desk managercor anglais : instrument de musiquecotte d'armes : coat of arms. En français, on utilisera plutôt le mot armoiries.coup de grâce : syn. de l'anglais "death blow"coup de main : syn. de l'anglais "a surprise attack"coup d'état (ou coup) : idemcoupé : voiturecrème brûlée : terme de gastronomiecrème caramel : syn. de flancrème de cacao : alcoolcrème de la crème : élite sociale ou le meilleur dans un domaine, the best of the bestcrème de menthe : alcoolcrème fraîche : idem dans les deux languescrêpe de Chine : variété de soiecritique : article relatif à un ouvrage, un spectaclecroissant : viennoiseriecroquette : pomme de terre + poisson (frit)cuisine : type de nourriture. Ex : western cuisinecul-de-sac : syn. de l'anglais "dead-end street"d'accord : syn. de l'anglais : "agreed" ou "OK". Rare.déclassé : syn. de l'anglais "of inferior class status"debutante : jeune femme qui fait son entrée dans la sociétédécolletage : syn. de l'anglais "low-cut neckline" ou "cleavage" (nom pour la forme donnée au niveau du cou à un vêtement féminin).décolleté : plus volontiers utilisé comme adjectif pour un vêtement féminindécoupage : syn. de l'anglais "decoration with cut paper"dégustation : syn. de l'anglais "tasting event or party"déjà vu : idem dans les deux langues. "The experience or illusion of having seen or experienced something before".de luxe : idem dans les deux languesdemimonde : 1. groupe social marginalisé ; 2. femmes prostituées ou entretenuesdemitasse : petite tasse, terme utilisé par exemple pour des boissons bues en petite quantité (ex : expresso)démodé : syn. de l'anglais "out of fashion"dénouement : syn. de l'anglais "the end result"de rigueur : syn. de l'anglais "required", "necessary" (especially with reference to fashion), obligatoire, une chose à laquelle on est tenudernier cri : syn. de l'anglais "the newest fashion"derrière : syn. de l'anglais "rear", "buttocks"détente : syn. de l'anglais "easing of diplomatic tension"de trop : superfludéveloppé : terme de dansediablerie : syn. de l'anglais "withcraft", "deviltry"dossier : mot entendu notamment dans la version anglaise du film "Mindhunters" de Renny Harlin (2004)double entendre : jeu de mots basé sur une similitude phonétique. Cette expression correspond aussi au "double sens" français.douceur de vivre : syn. de l'anglais "sweetness of life". Rare.doyenne : syn. de l'anglais "the senior female member of a group"du jour : ex : un plat "du jour"eau de toilette : perfumeéclat : syn. de l'anglais "conspicuous achievment"effacé : terme de danseélan : syn. de l'anglais "a distinctive flair"embonpoint : syn. de l'anglais "fat (euphemistically)"émigré : idem dans les deux langueséminence grise : équivalent de "a powerful advisor or decision-maker who operates secretly or otherwise unofficially"en banc : expression qui indique que tous les membres d'une juridiction ont maintenant pris placeen bloc : en groupe, tous ensembleenfant terrible : marginal dans un groupe social, surtout dans le milieu des artistes, des penseurs, etc.en garde : pour signifier qu'on se tient prêt pour riposter à une attaque éventuelleen masse : syn. de l'anglais "all together", en groupe, tous ensembleencore : "bis" au théâtre et au spectacle, pour féliciter les acteurs et leur demander de revenir sur scèneennui : syn. de l'anglais "boredom"en passant : syn. de l'anglais "in passing". Ex : dire quelque chose en passant (au passage)en route (expression entendue notamment dans la version anglaise du film "Mission Impossible")en suite : syn. de l'anglais "as a set", partie d'un tout, d'un plat, etc. (accompagnement)entente : syn. de l'anglais "diplomatic agreement or cooperation"entourage (entendu notamment dans la version anglaise du film "Spy Game")entrée ou entrée (avec ou sans accent aigu) : "the main dish or course of a meal" (US). En français, au contraire, désigne seulement le premier plat (assez léger) d'un repas.entre nous : syn. de l'anglais "confidentially"escargots : snails as food, a delicacyesprit de corps : a feeling of solidarity among members of a groupexpose : a published exposure of a fraud or scandalfaçadefait accompli : syn. de l'anglais "something that has happened and is unlikely to be reversed"faux : faux diamants, faux pearls, etc. Mot entendu notamment dans la version anglaise du film "Cletis Tout" de Chris Ver Wiel (2001)faux amis : "used to refer to words in two different languages that have the same etymology, but different meanings"faux pas : "an embarrassing social error"femme : "a stereotypically effeminate gay man or lesbian" (slang)femme fatale : "an alluring, mysterious woman"fiancé(e) : "a man (a woman) engaged to be married"film noir : "a genre of dark-themed movies"finale : terme sportif pour désigner la dernière partie d'un championnatfin de siècle : s'applique à la fin du 19e siècleflambé(e) : terme de cuisinefleur-de-lis, fleur-de-lysfolie à deux : désordres mentaux simultanés chez deux personnes (amis, etc.) agissant de concertfondue : terme de cuisineforce majeure : idem dans les deux languesfrisson : "a thrill"gaga : sénilegamine : jeune fille souvent peu sérieusegarçon : terme utilisé pour attirer l'attention d'un serveur; used to summon the attention of a male waitergauche : syn. de l'anglais "tactless", maladroit, empruntégaucher : syn. de l'anglais "left-handed". Mot français entendu notamment dans la version anglaise du film "Cletis Tout" de Chris Ver Wiel (2001)gaucherie : syn. de l'anglais "boorishness"gendarme : a police officer (slang, irreverent)genre : sert à désigner une catégorie d'art, de films, etc.gigolo : idem dans les deux languesglacé : recouvert de sucre glace ; fruit glacé = fruit confitgrand : adjectif principalement utilisé dans des compétitions sportives : voir Grand Open, Grand Prix, grand slam, grand tour. On retrouve cet adjectif français lors de cérémonies officielles de prestige. Ex : "Grand Opening of National Museum".grande dame : "a venerable woman"Grand Open : variété de Grand Prix.Grand Prix : "a type of motor racing", nom de courses, de compétitionsgrand slam : réussite de toutes les plus grandes épreuves dans un sport (ex : le tennis). Équivalent du "grand chelem".grand tour : voyage dans les principales villes d'Europe par des jeunes gens de familles américaines fortunées qui voulaient ainsi autrefois parachever leur éducation.habitué : "one who regularly frequents a place"haute couture : idem dans les deux langueshaute cuisine : a manner of preparing food, grande cuisine (restauration de grande qualité)hauteur : arroganceHonni soit qui mal y pense : "Shame on him who thinks ill of it" or something translated in english as "Evil be to him who evil thinks", the motto of the most noble Order of the Garterhors de combat : idem dans les deux langueshors d'uvre : idem dans les deux languesidée fixe : syn. de l'anglais "a leitmotiv", "an obsession"ingénue : syn. de l'anglais "an innocent young woman". Mot entendu notamment dans la version anglaise du film "Cletis Tout" de Chris Ver Wiel (2001)j'accuse : The (generally untranslated) title of Emile Zola's expose of the Dreyfuss affair, also used generally in allusion to a political or social indictmentje ne sais quoi : "an indefinable, usually compelling quality (charisma)", ex : elle avait un "je ne sais quoi" qui faisait tourner la tête à tous les hommesjoie de vivre : syn. de l'anglais "joy of living"journal : journal (intime) et uniquement dans cette acception. Ne pas confondre avec "Newspaper".l'affaire : a cause célèbre, in allusion to "l'Affaire Dreyfus"laissez-faire : politique de non-interventionnisme de l'Étatlamé : tissu avec des fils d'argent ou d'orlayette : "a set of clothing and accessories for a new baby"l'esprit de l'escalier : "thinking of the right comeback too late". Originally a witticism of Denis Diderot (1713-1784), in his "Paradoxe sur le Comédien"L'état c'est moi : the (generally untranslated) remark attributed to Louis XIV, also used in allusion to a overweening ego.lieu : dans l'expression "in lieu of" ("au lieu de") entendue notamment dans le film "Mindhunters" de Renny Harlin (2004)longueur : "a tedious passage in drama or literature"louche : syn. de l'anglais "of questionable taste", "shady"maître d'hôtel : idem dans les deux languesmal de mer : syn. de l'anglais "sea sickness"mardi-gras : signifie carnaval aux USA où l'on peut lire des annonces de ce type : "mardi-gras next friday" ce qui pourrait a priori surprendre le francophone non averti.matinée : 1. première d'un film, d'un spectacle ; 2. rencontre amoureuse de jourménage à trois : "a sexual arrangement between three people" (not used if all three are of the same sex)Merci beaucoup ! : traduction de l'anglais "Thank you very much !"milieu : syn. de l'anglais "environment", "setting"Moi ? : often used in english as an ironic reply to an accusation, for example : "Pretentious ? Moi ?"mot juste (le) : terme idoine, le mot parfaitement appropriénée : pour indiquer le nom de jeune fille d'une femme mariée. S'écrit parfois "né" en anglais.N'est-ce-pas ? : Isn't it ?noblesse oblige : honorable behavior expected in high ranknom de plume : a pseudonymnom de guerre : a pseudonymnon : nonouveau riche : "newly rich"objet d'art : "a piece of art"objet trouvé : "a found object"oui : yesoutré : bizarre, eccentricpamphlet : brochure (et non avec le sens de pamphlet en français)papier mâché : utilisé en artpar excellence : quintessentialparole : liberté conditionnelle. L'expression "to make parole" est entendue notamment dans la version anglaise du film "Cletis Tout" de Chris Ver Wiel (2001)parvenu : idem dans les deux languespas de deux : 1. terme de danse ; 2. "a close relationship between two people"passé : syn. de l'anglais "out of fashion"patisserie : magasin (remarquer l'absence d'accent circonflexe dans le mot anglais)peau de soie : idem dans les deux languespeignoir : "a woman dressing's gown", "a negligee"petard : a metaphorical trap, as in "hoist by one's own petard", or "caught in one's own trappetite : idem dans les deux languespetit-four : terme de gastronomiepièce de résistance : 1. plat ou objet principal ; 2. projet le plus importantpied-à-terre : syn. de l'anglais "a second home"plat de résistance : "the main dish of a meal"plié : terme de danseplus ça change : équivalent de la formule anglaise "the more things change, the more they stay the same".poseur : "a person who pretends to be something he is not", "a phony"précis : "a concise summary"prix fixe : "a fixed-price meal"prêt-à-porter : "ready-to-wear clothing"protégé : idem dans les deux languesprud-homme : "a up-standing citizen", "skilled workman"purée : terme de cuisineQuelle horreur ! : a usually sarcastic phrase meaning "What an horrible thing !"Qu'est-ce que c'est ? : "What is this ?"raconteur : équivalent de l'anglais "a conversationalist"raison d'être : "justification for existence"rapprochement : "the establishment of cordial relations"recherché : obscure, pretentious, sophistiquérelevé : terme de danserendezvous : rencontre (souvent secrète) (entendu notamment dans la version anglaise du film "Mission Impossible"). Noter l'écriture en un seul mot mais ce terme s'écrit parfois aussi en anglais avec un trait d'union.repartee : transcription phonétique anglaise du mot français "répartie"restaurateur : "a restaurant owner"résumé : a document listing one's qualifications for employment (US). Équivalent de C.V. (entendu notamment deux fois dans le film "Die Hard 2").Ricochet : titre d'une nouvelle d'Angela Noel (née en 1931).risqué : "sexually suggestive", provocantroman fleuve : idem dans les deux languesroué : "a hedonist"rouge : cosmétiqueRSVP : Répondre, s'il vous plaîtsang froid : contrôle des émotionssans : terme d'art pour indiquer une absence de fiorituressauté : terme de cuisinesavoir-faire : idem dans les deux languessoi-disant : idem dans les deux languessoigné : 1. élégant ; 2. raffinésoirée (s'écrit aussi parfois soiree) : "elegant party"sorbet : terme de gastronomiesoupçon : une toute petite quantité dans un mets (ex : un soupçon de poivre)souvenir : 1. memento ; 2. objet : ex : casque rapporté comme "souvenir" d'une campagne militairesuccès de scandale : success through scandal"tableau vivant : scène dans laquelle les acteurs se tiennent immobiles et silencieuxtable d'hôte : 1. table où tous les convives peuvent s'asseoir ensemble ; 2. table où l'on peut se servir librement de tous les platstête à tête : conversation privée avec quelqu'untoilette : s'applique en anglais à tout ce qui touche le maquillage, la coiffure, etc. mais, pas, comme en français, les vêtements.touché : synonyme de "you got me", acknowledgment of an effective counterpointtour de force : 1. action brillante ; 2. performance théâtraletrès : "very" (slang, generally ironic)trompe-l'il : technique artistiquevis-à-vis : utilisé en anglais et en américain dans le sens de "compared to" ou "in relation with"Vive la différence ! : "Long live the difference", generally referring to difference between male and female.Vive la France ! : exclamation parfois dite de façon sarcastique.Voilà ! ou Et voilà ! : "There you go !" or "There you have it !"Voir dire : "jury selection" (Law French)vol-au-vent : terme de gastronomie.volte-face : "a complete reversion of opinion or position"voyeur : "peeping tom"Zut (ou plutôt, zut, zut, zut, ou zut alors ou zut et rezut). Plus correct et nettement plus édulcoré que le trop classique "merde". V. aussi ci-dessous Zut alors !Zut alors ! : "Darn it !"Mots allemandsAblaut : terme de linguistiqueAngst : "distress", angoisseAnsatz : approche élémentaireBauhaus : terme d'architectureBildungsroman : roman-photosBlitzkrieg : guerre éclairBratwurst : terme culinaireBremstrahlung : terme de physiqueDelicatessen : terme culinaireDoberman Pinscher (Dobermann en allemand)Doppelganger (Doppelgänger en allemand)Dreimorengesetz : terme de linguistiqueEntscheidungsproblem : problème de décisionErsatz : substitutFestFestschrift : book prepared by colleagues to honor a scholarFlak (FlugAbwehrKanone) : canon anti-aérien, DCAFrankfurter : saucisse de FrancfortFreigeld : terme d'économieFreiherr : baronFreiwirtschaft : terme d'économieFürst : princeGesundheit : only use as an exclamation used after somebody has sneezedGlockenspiel : instrument à percussionGraf : comteGrenzsignal : terme de linguistiqueHammerklavier : ancienne appellation du piano/ nom d'une sorte de pianoHeldentenor : ténor (héros)Hinterland : terme de géographieInselberg : terme de géographieJunker : nobleKaiser : empereurKappelmeister : maître de chapelle, chef de musiqueKaput (kaputt en allemand)KarabinerKindergarten : jardin d'enfants. Terme très utiliséKirchwasser : alcool, alcoholKitschKraut : terme culinaireKriegspiel : wargameKulturkampf : idem dans les deux languesKünstlerroman : terme de littératureLager (beer)Landflucht : exode ruralLandgraf : comte avec des pouvoirs souverainsLeitfaden : illustration of the interdependence between chapters of a bookLeitmotiv : terme de linguistique (un thème récurrent)Lied : chantLiedermacher : compositeur de chantsLumpenproletariat : terme de sociologie et d'économieMeistersingerMethodenstreit : disagrement on methodologyMinnesinger (Minnesänger en allemand) : troubadourMittelschmerz : terme de médecineMuesli : idem dans les deux languesNihilartikel : terme de littérature. Article volontairement fictif dans un dictionnaire ou une encyclopédieOktoberfest : idem dans les deux languesOstflucht : idem dans les deux languesOstpolitik : idem dans les deux languesPils, Pilsner, PilsenerPlattenbau : terme d'architecturePoltergeist : idem dans les deux languesPretzel (Bretzel en allemand)Privatdozent : idem dans les deux languesRealpolitik : idem dans les deux languesReichstag : idem dans les deux languesRucksack : sac à dosSauerkraut : choucrouteSchadenfreude : happiness at the misfortune of othersSchlagerSchmalz : musique (ou toute autre forme d'art) sentimentaleSchnapps (N. B. : avec un seul "p" en allemand)Schnautzer : chienSchuhplattler : danse folklorique de Bavière et d'AutricheSchuss : terme désignant au ski une descente rapideSingspiel : drame musical allemand (musique et paroles)Sitz im Leben : terme de linguistique (biblique)Spinnbarkeit : terme de médecineSpitz : chienSprechgesang : mode d'expression musicale (entre la parole et le chant)Spritzer (communément appelé "Schorle" en Allemagne)Strudel : idem dans les deux languesSturm und Drang : mouvement littéraireThalweg : terme de géographie. De nos jours, s'écrit "Talweg" en allemand.uber, über : used to indicate that something is better or greaterÜbermensch : terme de philosophie emprunté à Nietzsche ("surhomme")U-Boot : abréviation de UnterseebootUmlaut : terme de linguistiqueUrtext : texte originalVerboten : forbidden or prohibitedVernichtungsgedanken : thoughts of destructionVölkerwanderung : migration périodiqueVolksmusic (Volksmusik en allemand) : musique populaireWaltz (Waltzer en allemand)Wanderlust : the yearning to travelWeltanschauung : terme de philosophie ("vision du monde")Weltschmerz : terme de philosophie (angoisse, désespoir du monde). En Allemagne, ce mot n'est plus utilisé que de façon ironique.Wiener, pour Wiener Würstchen (saucisse de Vienne)Wille zur Macht : terme de philosophie emprunté à F. Nietzsche ("volonté de pouvoir")Wunderkind : a prodigy. Mozart was a Wunderkind.Wurst : idem dans les deux languesZeitgeist : "spirit of the times"Zeppelin : type of airship named after its inventorZwieback : idem dans les deux languesZugzwang : idem dans les deux languesZwischenzug : idem dans les deux languesMots espagnolsdesperado : idem dans les deux langueslasso (esp : lazo, lacet) : idem dans les deux languesmatador : idem dans les deux languesplaza : "open square in Spain"poncho : idem dans les deux languesMots italienscontralto imbroglio libretto/librettiloggiamacaronimezzomezzo-sopranopatiopianofortepiazzapiccolopizzapizzicatoprima ballerinaprima donaraviolisopranospaghettiN.B. : Les mots italiens utilisés en anglais sont des termes musicaux ou gastronomiques.Mots latins - Expressions latinesad hocad infinitumad nauseamaffidavita prioribonafide/bona fidescontinuumde juredeliriumdelirium tremensegoex gratiaexit visaex officiofacsimilegratishabeas corpus : terme juridiquehomo sapiensimpedimenta : équipement transporté par un soldatincognitoin extremisinter alia : parmi d'autres choseslaudanummaximummemorandum : aide-mémoireminimummodicumpassim : dans les index et les notes pour renvoyer à une référence déjà plusieurs fois citéeper annumper capita : "per head" existe aussipost-mortemprima facie : à première vueproscenium : avant-scène de théâtrequantum/quantaquid pro quoquorumquotaratioreferendum/referendarequiemsicsolariumsolar plexus : plexus solairespectrum/spectrastratum/stratasyllabusultimatum+ de très nombreux termes médicaux et biologiques (bronchitis, femur, gastro-enteritis, geranium, neuralgia, plexus, pneumonia, tibia, prognosis, sciatica, sclerosis, spina bifida, tetanus, uterus, etc)+ corps chimiques (calcium, sodium, titanium) Dr Jean-Marie ThiébaudN.B. : Tous les mots latins utilisés en anglais conservent leur sens d'origine.
Signature :
Dr Jean-Marie Thiébaud
Notes :
N.B. : Tous les mots latins utilisés en anglais conservent leur sens d'origine.
Inscriptions tumulaires du cimetière de Clerval (Doubs)
Ces relevés, effectués le 1er novembre 2003, se limitent à quelques dizaines de tombes dont les plus anciennes. L'auteur a ajouté à cette liste quelques brèves notices biographiques et généalogiques.
Abréviations :
o : né(e)
+ : décédé(e)
v. : vers
Eugène ARDIOT, + 24.03.1921, âgé de 54 ans [o v. 1867], mari d'Augusta BERTHOZ
- Louis BASSENNE (1858-1938), général de brigade, commandeur de la Légion d'Honneur, croix de guerre
- BÉLIARD : v. CORDELIER
- Augusta BERTHOZ (1865-1938), femme d'Eugène ARDIOT
- Georges BILLIANT (29.04.1851-01.10.1916), mari d'Émilie FAIVRE
- Jenny-Marie BLÉTRY, née VERNIS (1895-1965)
- Jules BLÉTRY, + 12.06.1939, âgé de 55 ans [o v. 1884], conseiller à la Cour d'Appel
- Marie Joséphine Thérèse BLONDEAU, o 25.12.1795, + Clerval le 16.04.1860 [fille du général d'Empire et femme de Charles François Noël VUILLIER cité plus loin]. Cette tombe se situe à droite de l'entrée du cimetière.
- BOBILLIER (1825-1912), docteur en médecine
- Angélique BOBILLIER, née TISSERAND (1789-1879)
- Hippolyte BOBILLIER (1822-1905)
- Melchior BOBILLIER (1775-1855), capitaine [Melchior Joseph Marie Bobillier, o 07.03.1775, chevalier de la Légion d'Honneur]
- Olympe BOBILLIER (1819-1903)
- Philibert BOBILLIER (1782-1867)
- BOILLOT : v. CORDELIER
- Albert BOURGEOIS (1875-1931) (chapelle OUDRY)
- BOURQUENEY : v. Marie-Françoise GUILLOZ.
- Alexandre BOUVARD (10.05.1838-21.10.1891), capitaine d'artillerie, chevalier de la Légion d'Honneur
- Germaine BOUVARD, o 17.06.1885-26.03.1894
- BRIOT : v. GAUDERON, GUILLOZ
- Charles CORDELIER (01.08.1828-16.10.1903)
- Joséphine CORDELIER, née BÉLIARD (1857-1944)
- Marie Thérèse Eulalie CORDELIER, née BOILLOT, + Clerval le 21.04.1901 dans sa 76e année [o v. 1825]
- François CORNEILLE (09.11.1842-16.03.1907)
- Barbe Louise Mélitine COTTARD, + 09.04.1874, âgée de 85 ans [o v. 1789], femme de Joseph PINAIRE
- Alfred DELACOUR (1884-1944)
- Mélanie DELACOUR, née MOUCHET (1852-1943)
- Louis DELACOUR (1881-1964), docteur en médecine
- Paul DELACOUR, + 02.12.1893 dans sa 48e année [o v. 1845], docteur en médecine, conseiller général du Doubs.
- Paul DELACOUR (1889-1968), docteur en médecine
- Émilie FAIVRE (01.05.1851-14.11.1931), femme de Georges BILLIANT
- Félix FOURNIER (1840-1910), mari d'Augustine LOUISON
- Charles GAMOZ (03.06.1847-01.07.1911)
- abbé Jean GARNERET, o 20.04.1907 à Clerval, + 20.02.2002, curé de Lantenne-Vertière (25) de 1936 à 1982 et de Lavernay. Il est inhumé dans la première chapelle à droite de l'entrée du cimetière (L'abbé Garneret, dessinateur de talent, est connu pour avoir été le créateur et le conservateur du musée Populaire Comtois à la citadelle de Besançon. On lui doit aussi le musée des Maisons comtoises dont les édifices ont été démontés et remontés pierre par pierre et poutre par poutre depuis 1983 sur le site de Nancray à une quinzaine de kilomètres de Besançon). En outre on lui doit ainsi qu'à Charles Culot toute une compilation de chants populaires de la région comtoise en 3 volumes, éd. du Folklore Comtois, 1971, 1972 et 1985. L'abbé Garneret a écrit et dessiné plusieurs ouvrages dont La Maison rurale en Franche-Comté (1968), Petites Villes de Franche-Comté (1991) et Vie et Mort du Paysan, publié à Paris aux éd. de L'Harmattan. Avec Pierre Bourgin et Bernard Guillaume, il a illustré La Maison du Montagnon, grand et bel ouvrage paru en 1980. Après un article paru sur sa vie et son uvre dans la revue Barbizier, n° 26 spécial 2002, p. 115-116, un hommage lui est rendu par la ville de Besançon du 17.09.2005 au 29.10.2006.
- Louise Félicité GAUDERON, née GUILLOZ, + 08.08.1903 dans sa 88e année [o v. 1815] (Louise-Félicité Guilloz, née à Clerval le 11.12.1815, était la fille d'André Guilloz (17.03.1778-08.10.1850), négociant, et de Marie Françoise Joseph dite Françoise Briot (fille de François-Michel Briot, notaire royal, procureur d'office et contrôleur des acres de la seigneurie de Clerval, et de Jeanne Françoise dite Françoise Roussel, fille du procureur fiscal de la baronnie de Belvoir). Le 15.09.1841, elle épousa à Clerval Clément Gauderon, né vers 1819, fils de Jean-Claude Gauderon et de Jeanne-Thérèse Tisserand).- François GINDRE (1827-1909)- GUENOT : v. OUDRY- GUILLOZ : voir aussi BRIOT, GAUDERON- Lucien GUILLOZ (1897-1982), lieutenant-colonel d'infanterie, commandeur de la Légion d'Honneur, commandeur du Ouissam Alaouite, croix de guerre 14-18, 39-45 et T.O.E., membre de la Légion des Mille [Lucien Gaspard dit Lucien Guilloz, né à Frasne (Doubs) le 6 mars 1897, + à Clerval le 13.11.1982, était le fils de Gustave-Octave Guilloz et d'Augusta Bretillot. Conseiller municipal de 1947 à 1963 puis premier adjoint au maire de Clerval de 1964 à 1970. Président de la section locale des Anciens Combattants de 1948 à 1981 et président du Souvenir Français de sa création à 1982. Il a épousé à Belfort le 7 février 1946 sa cousine Marie Émilie Augustine dite Augustine Page, fille d'Auguste Page (1878, + 16.10.1958 à Clerval) et de Mathilde Tisserand, qui lui a donné trois enfants : Jean-Claude, né à Belfort le 31 mars 1947, cadre supérieur de l'INSEE ; Jérôme, né à Clerval le 10.03.1948, général de division, officier de la Légion d'Honneur, membre du cabinet du ministre de la Défense, et Geneviève, née à Clerval le 06.02.1950, élève des Maisons d'Éducation de la Légion d'Honneur, institutrice, qui a fini sa carrière comme directrice de l'école Granvelle maternelle de Besançon].- Marie Françoise GUILLOZ, née BRIOT, + 16.03.1865, âgée de 88 ans [o v. 1777] (Marie Françoise Joseph dite Françoise Briot, fille de François-Michel Briot, notaire royal, procureur d'office et contrôleur des acres de la seigneurie de Clerval (fils de Nicolas Briot, notaire royal, et d'Anne Françoise Ursule Poirelle alias Poirel), et de Jeanne Françoise dite Françoise Roussel (de Sancey-le-Grand, fille de Jacques-Joseph Roussel, greffier à la baronnie de Belvoir, et d'Anne Marie Bourqueney), épousa André Guilloz. - Voir Louise Félicité GAUDERON).- Melchior GUILLOZ, "le meilleur des pères" (selon l'inscription sur le monument), mari de Mathilde TIROLE, et leurs jeunes frères Octave et Joseph. Melchior Guilloz est le père de Lucien Guilloz cité ci-dessus. (La famille Guilloz est déjà citée à Clerval dans le recensement de 1657 sous le nom de GUILLO. Pierre-Melchior dit Melchior Guilloz, né à Clerval le 6 janvier 1813, + à Clerval le 18.07.1984, serrurier-charron, était le fils de Jean-Claude Guilloz et de Pierrette Boillon. Le 28.11.1840, il épousa Mathilde Tirole qui lui donnera dix enfants).- Françoise ISABEY (1845-1922), femme d'Auguste JOBIN- Auguste JOBIN (1843-1903), mari de Françoise ISABEY- Anne Marie KLEBOTH, + 1928, âgée de 83 ans [o v. 1845]- LAUDE : v. aussi OUDRY- Thérèse LAUDE, née RASSAT (1822-1911) (dans la chapelle OUDRY)- Augustine LOUISON (1843-1928), femme de Félix FOURNIER- Gustave MACHABEY, o Clerval, + Mont le 05.02.1886 à l'âge de 36 ans, conducteur des Ponts et Chaussées, agent voyer d'arrondissement [o v. 1850].- Jean MACHABEY (1821-1901), mari de Mélanie PICARD- Caroline MASSON, née ROSIER, + 25.12.1897, âgée de 57 ans [o v. 1835]- Marguerite METTRA, femme de Louis GARNERET, o Villersexel (70) le 13.04.1881, + Montagney (70) le 14.02.1875. Elle est inhumée dans la première chapelle à droite de l'entrée du cimetière.- MOLARD : v. aussi PAGE- Alfred MOLARD (16.01.1868-28.07.1930)- Françoise MOLARD (née MACHABEY), + 06.01.1864, âgée de 73 ans [o v. 1791]- Marie-Louise MOLARD (08.11.1902-21.09.1908)- Albert MORIZOT (27.08.1847-29.06.1916), mari de Marthe MORIZOT, née TISSERAND- Marthe MORIZOT, née TISSERAND (29.07.1852-14.12.1907), femme d'Albert MORIZOT- MOUCHET : v. aussi DELACOUR- Adèle MOUCHET, née CHARDONNET, + 24.04.1896, âgée de 76 ans [o v. 1820]- Joseph MOUCHET (1824-1885), mari de Mathilde OUDRIOT- Marguerite MOUCHET, + 01.02.1896, âgée de 16 ans [o v. 1880]- Mathilde OUDRIOT (1831-1912), femme de Joseph MOUCHET- Charles OUDRY (1848-1931) (chapelle OUDRY)- Charles OUDRY (1883-1911 (chapelle OUDRY)- Jean OUDRY, o 1822 (chapelle OUDRY)- Joseph OUDRY (1828-1871) (chapelle OUDRY)- Marie OUDRY, née LAUDE (1850-1934) (chapelle OUDRY)- Sylvie OUDRY, née GUENOT (1822-1896) (chapelle OUDRY)- Louise PAGE, ép. MOLARD (11.02.1872-13.01.1933) (dans la même tombe que Alfred MOLARD cité plus haut).- PASSERELLE : voir DIDIER.- Faustin PERRIN (1860-1946)- Mélanie PICARD (1830-1900), femme de Jean MACHABEY- Éléonore PINAIRE née RENAUD, + 16.08.1900, âgée de 65 ans [o v. 1835, mère de Henri PINAIRE cité ci-dessous].- Henri PINAIRE, + 08.12.1890, âgée de 26 ans [o v. 1864], licencié en droit- Joseph PINAIRE, + 20.02.1870, âgé de 87 ans [o v. 1783], vétérinaire, mari de Barbe Louise Mélitine COTTARD.- Jules PINAIRE, + 13.03.1894, âgé de 66 ans [o v. 1828], juge de paix.- POIRELLE (alias POIREL) : v. Marie-Françoise GUILLOZ.- Émile PREDINE (1860-1920)- Marie Élisa PUTOT, veuve SUJET, + Clerval le 19.02.1896- RASSAT : v. LAUDE- J.-G.-Bernard RÉMY (1886-1966), docteur en droit, magistrat.- Madeleine Marie RÉMY, née VERNIS (1896-1969)- RENAUD : v. PINAIRE- ROSIER : v. MASSON- ROUSSEL : v. Marie-Françoise GUILLOZ.- SUJET : v. PUTOT- Adèle TIROLE (28.03.1869-19.04.1913).- Augustine TIROLE, décédée le 07.04.1901, "regrettée de toute sa famille".- Emile TIROLE, décédé le 29.02.1924 à l'âge de 57 ans.- Eugène TIROLE, décédé le 22.05.1886 à l'âge de 18 ans.- Joséphine TIROLE, née OUDRY, décédée le 23.11.1923 à l'âge de 89 ans.- Mathilde TIROLE, "la plus douce des mères" (selon l'inscription sur le monument), femme de Melchior GUILLOZ (née le 3 avril 1820, + 11.11.1871, fille de Jacques Tirole (+ 07.02.1828), de Soye (Doubs), et de Marie-Joseph Tisserand).- TISSERAND : v. BOBILLIER, MORIZOT, TIROLE.- Auguste TRIPARD, + 11.12.1926, âgé de 77 ans [o v. 1849]- Augustine TRIPARD, + 19.12.1932, âgée de 80 ans [o v. 1852]- Louise TRIPARD, + 09.02.1928, âgée de 44 ans [o v. 1884]- VERNIS : v. aussi BLÉTRY, RÉMY- Eugène VERNIS (1859-1935), président de Cour d'Appel, mari de Jeanne VERNIS- Jeanne VERNIS (1867-1945), femme d'Eugène VERNIS- Charles François Noël VUILLIER, o Clerval le 19.05.1789, + ibid. le 18.04.1883 [mari de Marie Joséphine Thérèse BLONDEAU citée plus haut]. Cette tombe se situe à droite de l'entrée du cimetière (notaire, né à Clerval, fils de Jacques Joseph Vuillier, notaire royal, juge-châtelain des seigneuries de Clerval, Passavant et Rang-les-L'Isle, secrétaire-greffier du magistrat de la ville de Clerval dès 1783, né à Sancey-l'Église (Doubs) le 28.04.1754 (fils du sieur Joseph Vuillier, de Sancey-l'Église, et de demoiselle Jeanne Françoise Grenot, de Belvoir (Doubs) et de demoiselle Françoise Angélique Marchand, + le 11.08.1824 (fille du sieur Gaspard Marchand et de demoiselle Marie-Antoine Vautherin, de Dambelin (Doubs).
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD
Le Monument du médecin-commandant Jean-Louis à Hongcheon Province du Gangwon-do, Corée du Sud
À 32 km au nord-est de Hongcheon, à droite et en retrait de la route 44 (qui mène à Inje et Seokcho), jouxtant en pleine nature le Green Country Camp, s'élève un important monument : une gerbe de blocs de béton sommée d'une statue en bronze, grandeur nature et fort réaliste, d'un officier français en treillis, béret, ceinturon et rangers, semblant marcher sans crainte vers son destin. Son visage encore juvénile, sculpté finement dans le métal, porte des lunettes qui rendent le personnage encore plus étonnamment présent.
Sous la statue, l'insigne en losange du bataillon français de l'ONU et, plus bas encore, une plaque rectangulaire qui indique :
MONUMENT A LA MEMOIRE DU MEDECIN-COMMANDANT J. JEAN-LOUIS²
Le dos du monument porte deux autres plaques portant l'une, un texte rédigé en coréen, l'autre, sa traduction en français :
La guerre de Corée a commencé le 25 juin 1950, lorsque les armées communistes envahirent le Sud par surprise. Répondant à un appel pour la sauvegarde de la liberté, la France envoie des forces combattre en Corée. Arrivé le 29 novembre 1950, le médecin-commandant Jules Jean-Louis était chef du service de santé du bataillon français de l'O.N.U.
Le 8 mai 1951, à l'âge de 34 ans, le médecin-commandant Jules Jean-Louis tombait au champ d'honneur, en sauvant la vie de soldats coréens blessés dans le combat de Jang Nam Ri.
Son sacrifice héroïque pour la liberté et l'idéal humanitaire qu'il a incarné dans l'exercice de sa mission et notamment au service des populations civiles rencontrées pendant la progression du bataillon, resteront dans la mémoire des habitants de ce pays.
Alors que se commémore le centenaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, ce monument est édifié, à l'endroit même de sa mort, grâce à l'appui du gouverneur de la province de Kangwon (Gangwon-do), pour immortaliser à jamais le souvenir de cette âme généreuse.
Le 25 octobre 1986
Le chef du district communal de Hongch'on (Hongcheon)
Près de la route et à droite du monument, une plaque signale un
ARBRE COMMEMORATIF PLANTE
PAR M. JEAN-BERNARD OUVRIEU³
AMBASSADEUR DE FRANCE EN COREE
LE 25 OCTOBRE 1986.
Par souci de symétrie et aussi volonté du diplomate français d'être compris par la population locale, elle possède son pendant coréen à gauche, sur un socle placé au pied d'un second arbre.
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Notes :
1- La région du Gangwon-do est coupée en deux par la DMZ du 38e parallèle sur une longueur de 145 km. Elle fut le théâtre de combats meurtiers pendant la guerre de Corée (1950-1953).
2- Jules Édouard Jean-Louis, né à Sanary-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 28.10.1916, était le fils d'un capitaine de marine mort en 1919 de suites de maladies contractées pendant la première guerre mondiale, chevalier de la Légion d'Honneur. Entré à l'École de Santé Navale à Lyon en 1933, Jules Jean-Louis en sortit docteur en médecine en juin 1939, dans sa vingt-troisième année, avec une thèse apportant une Contribution à l'étude des lepto-méningites et à leur traitement chirurgical. Promu lieutenant au 3e bataillon du 69e régiment de la ligne Maginot en juin 1940, il mérita la Croix de Guerre avant d'être fait prisonnier le 21.06.1940 et envoyé au stalag IV. Libéré le 17.04.1945 et nommé capitaine, il fut muté au Maroc à l'hôpital de Casablanca. Puis il demanda à servir en Extrême-Orient. Il demeura en poste en Indochine de 1946 à 1950 et y fut breveté parachutiste. Il servit au 2e régiment d'infanterie puis à la 2nde brigade de parachutistes dans laquelle il obtint ses deuxième et troisième citations à l'ordre de l'Armée en septembre 1947 et en juillet 1948. On le proposa pour l'Ordre de la Légion d'Honneur le 30.12.1948. Promu médecin-major le 01.01.1950, il se porta volontaire pour la Corée le 10.09.1950 et arriva dans ce pays en octobre de la même année. Il prit part aux batailles de Tapon-ni, de Twin-Tunnels, de la cote 1037 et son attitude courageuse lui valut d'être cité une quatrième fois à l'Ordre du Corps d'Armée. Ce médecin-chef tomba le 8 mai 1951 en allant porter secours à deux soldats coréens blessés. Sa dépouille a été inhumée à Sanary-sur-Mer, ville qui s'est jumelée avec Hongcheon pour rappeler l'acte courageux de ce médecin militaire et à l'instigation du docteur Kim Jong-Hi, consul honoraire de Corée en Normandie, fait chevalier de la Légion d'Honneur le 27.06.2000 au titre du ministère des Anciens Combattants. Le nom du commandant Jean-Louis est également gravé sur la façade intérieure du monument de Suwon qui recense tous les Français tombés pendant la guerre de Corée (voir Jean-Marie Thiébaud, "La Présence française en Corée", Paris, éd. de l'Harmattan, 2005).
3- Jean-Bernard Ouvrieu, né à Creil (Oise) le 13.03.1939, fils de René Ouvrieu, universitaire, et de Renée Franchet, étudiant à la Faculté de Droit et à l'Institut d'Études Politiques de Paris, élève de l'ENA de 1964 à 1966, deuxième conseiller à Bagdad en 1975-1977 puis à Washington en 1977-1979, directeur des relations internationales au Commissariat à l'Énergie atomique en 1980-1985, gouverneur pour la France de l'Agence Internationale de l'Énergie atomique de Vienne de 1981 à 1985, ambassadeur de France en Corée du 13.05.1985 à 1987 puis au Brésil (1989-1993) et au Japon dès 1993 avant d'être chargé auprès du ministre Alain Richard des dossiers d'armement. Officier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite.
Le cimetière international d'Hapjeong dong (alias Hyang hwa jin) à Séoul (Corée du Sud)
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD
Notes :
(1) Et non douze comme l'indique le panneau de présentation du cimetière qui oublie le Danemark et la Suède. Il est vrai qu'il ne prétend pas à l'exhaustivité.
(2) Horace H. Allen, de l'église presbytérienne américaine et médecin de la mission diplomatique, arriva en Corée en septembre 1884. Il devint presque aussitôt médecin personnel et confident du roi Kojong à la suite de circonstances des plus fortuites : le prince Min Yung Ik, neveu de la reine Min, fut victime d'un attentat le 4 décembre 1884 à quelques dizaines de mètres à peine de sa maison. Il entendit la déflagration et se précipita. Le prince perdait tout son sang et Horace Allen parvint à arrêter l'hémorragie. Pour lui témoigner sa reconnaissance, le roi l'attacha à sa personne et lui permit de créer dans le royaume de Choson le premier hôpital occidental. Quelques années plus tard, Horace Allen fonda à Séoul une université médicale et, en 1904, le premier hôpital moderne qu'il baptisa tout naturellement Severance puisqu'il les devait à la générosité de Louis H. Severance, mécène américain, originaire comme lui-même, de la ville de Rockefeller, et qui avait fait fortune dans le commerce du pétrole en 1895. En décembre 1901, Horace H. Allen fut nommé ministre résident et consul général des États-Unis dans le royaume de Choson. Il conserva ce poste jusqu'en juin 1905, laissant alors la place à Edwin V. Morgan contraint de fermer l'ambassade américaine le 08.12.1905 après la décision des Japonais de prendre le contrôle des affaires étrangères du pays et d'en chasser tous les diplomates (US Embassy, Seoul, Information Resource Center ; Fred Harvey Harrington, God, Mammon and the Japanese: Dr. Horace N. Allen and Korean-American Relations, 1884-1905, Madison, University of Wisconsin Press, 1966 ; George Coleman, American Images of Seoul, p. 43, 48).
(3) Il faudra bien que cesse cette regrettable manie de confondre Américains et Occidentaux. Si les premiers sont bien, du moins quant à leurs origines et à leur culture, des Occidentaux, tous les Occidentaux ne sont pas des Américains. Un simple regard sur les chiffres de la démographie confirme que, pour importants qu'ils soient, les habitants des États-Unis d'Amérique du Nord sont numériquement inférieurs et de loin à l'ensemble formé par les autres pays constituant ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident.
(4) Dix d'entre eux et 93 Coréens martyrs ont été canonisés à Séoul par le pape Jean-Paul II le 6 mai 1984. Ce fut la première fois dans l'histoire de l'église catholique qu'une cérémonie de canonisation était organisée hors de l'enceinte du Vatican.
(5) Owen Nickerson Denny (o à Athens (Ohio, USA) le 04.09.1838, + à Portland (Oregon, USA) le 30.06.1900, fils de Christian Nickerson Denny et d'Eliza, consul à Tientsin (Chine) depuis 1876, devint, dix ans plus tard, le premier représentant officiel des USA en Corée. Il se maria à Vancouver le 23.12.1865 (voir Robert R. Swartout, Mandarins, Gunboats and Power Politics : Owen Nickerson Denny and the International Rivalries in Korea, Honolulu, Asian Studies Program, University of Hawaii, 1980).
(6) Quelques inscriptions sur des tombes d'enfants ne comportent qu'un patronyme ou un prénom. Ce manque de précision a empêché d'inclure quelques-unes d'entre elles dans la liste qui suit.
(7) Alias William B. SCRANTON, arrivé à Incheon en mai 1885 avec sa mère,
Mrs Mary SCRANTON venue elle aussi en Corée comme missionnaire méthodiste. William SCRANTON et sa mère travaillèrent dans l'hôpital gouvernemental fondé et dirigé par le Dr Horace ALLEN.
(8) Stephen K. Roney, "Hard-boiled newsman became a hero in Choson's final years", in Korea Herald, 19.05.2001.
(9) Il avait publié des articles mettant en cause les violences exercées par l'armée japonaise sur la population civile coréenne comme le tir d'un soldat tirant dans raison sur une famille en promenade dans la rue de Yong-san, tuant sur le coup la femme touchée à la poitrine, et blessant grièvement son enfant à la main.
L'ancienne légation de Russie à Séoul (royaume de Corée) Бывшее пуское посольство
À quelque 200 mètres de l'actuelle ambassade de la Fédération de Russie, les restes de l'ancienne légation de l'Empire de Russie en Corée se dressent en surplomb d'un jardin public gardé par des policiers coréens en raison de la proximité de bâtiments appartenant à l'ambassade des États-Unis.
De cette première construction érigée en 1890 par l'ingénieur civil A. J. Scredine-Sabatine et classée site historique n° 253, il ne reste qu'une tour blanche carrée à trois niveaux, le second n'étant percé que d'une fenêtre unique tandis que le dernier étage s'ouvre sur huit fenêtres bigéminées en arcade. Les bâtiments principaux, bombardés pendant la guerre de Corée (1950-1953), ont été entièrement rasés. La tour n'a été restaurée qu'en 1973.
Le sous-sol de la tour abrite une chambre secrète qui débouche sur un souterrain de 45 cm de large et de 20,3 m de long. Ce dernier reliait la tour et le reste des constructions. Au milieu de cet étroit tunnel, une courte section s'élargit sur cinq mètres afin de permettre la croisement de personnes circulant dans des directions opposées.
C'est dans cette ancienne légation de Russie que le roi Kojong et le prince héritier Sunjong trouvèrent refuge le 1er février 1896 pour échapper aux menaces des Japonais. Ils y furent accueillis et protégés par l'ambassadeur russe Karl Waeber et y demeurèrent jusqu'en février 1897, s'installant alors dans un petit palais proche des légations étrangères. Sécurité obligeait.
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Henry Gerhard APPENZELLER (1858-1902) Premier missionnaire méthodiste en Corée
Henry Gerhard APPENZELLER
Né le 06.02.1858, mort près de Mokpo (où il venait participer aux travaux d'un groupe biblique) le 11.06.1902, noyé en tentant de sauver une fille coréenne après que son bateau en eût heurté un autre, Henry Gerhard Appenzeller fut le premier missionnaire méthodiste en Corée. Il avait grandi à Lancaster, Pennsylvanie (USA) et, après avoir été diplômé du Drew Theological Seminary, il avait servi comme pasteur dans le New Jersey. Le 5 avril1885, le samedi de Pâques, il débarqua à Chemoulpo (Incheon) via San Francisco et le Japon. La légation américaine s'opposa à son entrée dans le pays et il se trouva avec sa femme dans l'obligation de retourner au Japon pour y attendre l'autorisation qui leur parvint enfin en juin de la même année. Dès son arrivée, il devint l'adjoint du surintendant et, en 1886, surintendant de la mission méthodiste en Corée (Craig S. Coleman, American Images of Korea, p. 50, 52). Dès août 1885, il avait créé une école de garçons à laquelle le roi Kojong donnera plus tard le nom de Baejae (Pai Chai) et qui est devenue de nos jours la Pai Chai University. Dans cet établissement destiné à former les futures élites du pays, Appenzeller eut pour élève Syngman Rhee (26 mars 1875-19 juillet 1965) qui devint le premier président de la jeune République de Corée fondée officiellement le 15.08.1948. En 1887, il construira aussi au cur de la ville de Séoul la première église méthodiste Chung dong qui devint plus tard un centre de ralliement pour les opposants à l'occupation japonaise. De nos jours, à gauche en entrant dans le jardin de cette église (bâtie en 1916) qui affiche à l'entrée l'inscription "First Methodist Church" (qui a succédé à la "Bethel Church" fondée par Appenzeller), située face au musée municipal (ancienne Cour de Cassation) et à quelques dizaines de mètres de l'ancienne école Pai Chai, on peut voir son buste d'excellente facture avec une inscription soulignant que ce pateur fut un "homme de vertu". Appenzeller a laissé plusieurs ouvrages dont The Korean Repository et The Korean Christian Advocate. Son monument funéraire a été élevé par The Pai Chai Alumni (Ki-Baik Lee, A New History of Korea, Séoul, Ilchokak, 2002, p. 334; Edward W. Poitras, "The Legacy of Henry Appenzeller", in International Bulletin of Missionary Research, n° 18:4 (octobre 1994), p. 177-180 ; Griffis, William Elliot. A Modern Pioneer in Korea: The Life Story of Henry G. Appenzeller, Saryo ch'ongso; 7-chip. Soul: Han'guk Kidokkyosa Yon'guhoe, 1984; Daniel M. Davies, "The Life and Thought of Henry Gerhard Appenzeller (1858-1902)", rev. by Donald N. Clark, in Korean Studies, vol. 17, p. 127-128); Daniel M. Davies, "Henry Gerhard Appenzeller: His Contribution to Korean Independence, Democracy, and Modernization", in Tongbang hakchi 57 (1988:3), p. 197-230; Daniel M. Davies, The Life and Thought of Henry Gerhard Appenzeller (1858-1902), Missionary to Korea. Lewiston, NY: E. Mellen Press, 1988).
Henry Gerhard Appenzeller eut deux enfants, une fille et un garçon :
- Alice Rebecca, née à Séoul le 09.11.1885, mort audit lieu le 20.02.1950. Première Américaine née en Corée, elle fut diplômée en 1905. Elle devint présidente du Ewha College en octobre 1922 avant d'être ordonnée pasteur en 1932 et nommée à la première école méthodiste à Séoul. En 1935, elle reçut la médaille du Ruban Bleu (la plus haute distinction honorifique donnée à une femme en Corée). Alice Rebecca Appenzeller fut reçue docteur honoris causa en pédagogie de l'Université de Boston en 1937. Évacuée aux USA en 1940, elle partit pour Hawaï en 1942 et regagna Séoul et l'université Ewha après la guerre. Son monument funéraire dans le cimetière international Hapjeong dong (alias Hyang hwa jin) au sud-ouest de la ville de Séoul, aux côtés de celui de son père, a été élevé par la Ehwa Woman's University.
- Henry Dodge, né à Séoul le 06.11.1889, mort audit lieu le 01.12.1953. Il épousa Ruth Noble (née le 14.06.1894, mort à Séoul le 25.11.1986). Leurs monuments funéraires (dans le même cimetière) ont, comme celui du pasteur Henry Gerhard Appenzeller, été élevés par The Pai Chai Alumni.
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Noms géographiques étrangers dans l'ancienne Corée Français, latins, allemands, américains, britanniques, espagnols, italiens, portugais, hollandais, japonais, chinois et russes
Signature :
Dr Jean-Marie Thiébaud, Séoul 2004
Notes :
On pourra aussi consulter :
- Archives Nationales de la Marine Russe, fonds 417 et 1331.
Bicentenaire du Voyage de Lapérouse : Actes du colloque d'Albi, mars 1985, Albi, Association Lapérouse, 1988.
- B.N. Bolgourtsev, Morskoï biografitcheskii spravotchnik. Dal'nego Vostoka Rossii i Roussskoï Ameriki, XVII-ytch. XX vv. (Recueil biographique maritime pour la Russie d'Extrême-Orient et l'Amérique Russe), du 17e au début du 20e siècle), Vladivostok, Izvo Oussouri, 1998).
- Craig S. Coleman, Ph. D., American Images of Korea, Hollym, Elizabeth (New Jersey, USA) & Seoul, 1997.
- R. Ch. Dzarylgassinova & A. V. Zagoroulko, Iz istorii naimenovanii koreiskikh posselenii na rousskom Dalnem Vostoke// Toponymya Rosssii, Moscou, 1993.
Istoriia Guidrografitcheskoï sloujby Rossiiskogo Flota (Histoire du Bureau hydrographique de la Marine Russe), Saint-Pétersbourg, 1996-1997.
- Captain Basil Hall, Voyage of Discovery to the West Coast of Corea and the Great Lot-Chot Island, 1818.
- Homer Hulbert, History of Korea, Part II.
- Ueda Katsuo, "The Korea-Japan Controversy Relating to the Sovereign Title of Takeshima", in The Hitotsubashi NonSo, The Journal of Hitostubashi University, vol. 54, n° 1, 1965.
- Kawakami Kenjo, A Historical and Geographical Study of Takeshima, Tokyo, Koshishoten, 1966.
- Young Koo Kim, A Pursuit of Truth in the Dokdo/Takeshima Island Issue - Letters to a Young Japanese Man, Préface du Dr Hak-Joon Kim, ancien président de l'Université d'Incheon, Seoul, Bub Young Sa Publishing Co, 2003, Korean National Library CIP 2003000632 - ISBN 89-7032-177-2-93300 [N. d. A. : l'auteur est professeur à la Faculté de Droit de l'Université Maritime de Corée à Pusan. Cet ouvrage est actuellement le plus documenté sur cette question].
- Gari Ledyard, The Dutch Come to Korea, 1971.
- John McLeod, Voyage of His Majesty's Ship Alceste Along the Coast of Korea to the Island of Lew Chew, 1818.
- Nihonkainai Takeshima hoka itto chiseki hansan kata ukatai (Enquête basée sur la compilation du cadastre de Takeshima et d'une autre île dans la mer du Japon), Documents Officiels, Section du Ministère de l'Intérieur, 1877, Tokyo, Archives Nationales du Japon.
- Philippe Pelletier, "Tumulte des flots entre Japon et Corée - À propos de la dénomination de la mer du Japon", in Annales de Géographie, Paris, n° 613 (mai-juin 2000), p. 279-305.
- Plan of the Part of the Korea Peninsular between Pont Tikhmenev and Point Konsul by surveys of skipper of whaler ship "Nadezhda" Fridolf Gek in 1891, 1893 (N.B. : cette carte a été établie sur la base des relevés de Gek, complétés par ceux du capitaine de 2nd rang Adolf I. Enqvist, commandant du Bobr en 1893).
- Alexei V. Postnikov, "The History of Russian Names to Sears, with the Special Reference on the Development of the Korean (Japan) Sea. Presentation on Maps (Seventeenth through nineteenth centuries)", The International Seminar on the Geographical Name "East Sea", Seoul, 1995, p. 35-57.
- Daijudo Tei, "The Takeshima Dispute", in The Journal of International Law and Foreign Affairs, vol. 64, n° 4 & 5 (Tokyo, 1966), p. 128-129.
- Jean-Marie Thiébaud, La Russie, l'URSS, la Biélorussie, la Biélorussie, les Pays baltes... et l'Ukraine. Dictionnaire encyclopédique bibliographique, biographique, généalogique, historique..., Paris, 2001, 3 vol., rééd., augmentée, 2004, 4 vol., 2455 p.
- Treaty of Peace with Japan, signed at San Francisco September 8th, 1951, with related documents [Conference for Conclusion and Signature of Treaty of Peace with Japan, San Francisco, 1951]. [Washington] Dept. of State [Division of Publications. Office of Public Affairs, 1952]. United States. Dept. of State. Publication 4561.
- U.S. Army Map Services, Place Names Index for Korea. Washington, Army Map Service, 1943, XI, 63 p., 27 cm.
- United States, Office of Geography, Korea: official standard names approved by the United States Board on Geographic Names. Washington, Central Intelligence A
Peintres, sculpteurs et céramistes d'art au musée des Beaux-Arts de Samarkand (Ouzbékistan)
AGRIYAN L.S. (1911-2001), peintre
AKHEMEDOV R.A., peintre ("Portrait de Maître Tachtemirov", 1950; "Fleurs des montagnes", 1958)
AKHOUNOV V., peintre ("Oiseaux qui volent", 1947)
BENKOV P. (Pavel) P. (1866-1939), peintre
BOTOUROV Kh., né en 1943 à Samarkand, peintre
BOURMAKINE Vladimir, peintre
BURE Lev (Leon) Leonardovitch (1887-1943), peintre
CHIRIEV R. Ch., peintre
DEGTIARIOV Vassilii Ivanovitch (1938-1994), sculpteur.
Ousto Oumarkoul DJOURAKOULOV, céramiste et potier d'art
DOUDINE S.M. (1863-1929), peintre ("Derviche", 1900)
DOVATS L.I., peintre
IOUSSOUNOV A.V., peintre
ISSAEV A., peintre
KACHINA N.V. 1896-1977, peintre
KALONTAROV M.L. (1908-1994), peintre
KARAKHAN (alias KARAKHON) N.G. (1900-1970, peintre
KARAVAY E.L. (1901-1974), peintre
KAZAKOV L.S. (1873-1935), peintre
KHAKBERDIEV Kh., né en 1943 à Samarkand, peintre
KOURZINE Mikhaïl I. (1888-1964), peintre
KOVALEVSKAÏA Z.A. (1902-1978), peintre
KRAMARENKO I. Iou. (1888-1942), peintre
KRIKIS A. (1950-1994), peintre
MIRZAEV A., peintre
MOUKHTAROV A., né en 1931 à Samarkand, céramiste et potier d'art
NIKITINE G.N. (1898-1969)
OUFIMTSEV Viktor Ivanovitch (1899-1964), peintre
OULKO G.I. (1925-1999)
RAKHMOV M.K. (1903-1984), de Tachkent, peintre
REDKINE S.V. (1912-2001), peintre
ROZIGOV A. (1910-1976), peintre
ROZIGOVA Kh. ("Portrait d'une jeune fille de Samara", 1958)
SAMATOV N., peintre
SOMMER R.K. (1866-1939), peintre
SOUTLTONOV N.T., peintre
TATEVOSSIAN Ovanes K. (1889-1974), peintre
TEMOUROV R.M. (1912-1991)
VAKHIDOV I., peintre
VASSILIEVA I.M., peintre
VOLKOV Aleksandr N. (1886-1957), peintre
YELIZAROV Iou. I. (1920-1974), peintre
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
La France et les postes coréennes
Parmi les nombreux conseillers français qui vinrent à la cour du royaume de Corée pour accélérer la modernisation du pays, il en est un dont le nom devrait figurer dans le petit musée postal de Séoul situé près de la station Hanguk et l'entrée d'Insadong : Clémencet qui favorisa un accord postal entre la Corée et la France signé en 1900 peu après l'adhésion de la Corée à l'Union Postale Universelle. C'est ce même Clémencet qu'on avait fait venir au Pays du Matin Calme dès 1898 pour créer le réseau téléphonique et télégraphique.
En 1902-1903, des timbres postaux coréens étaient imprimés en France par l'entremise des administrateurs français des postes coréennes et portaient en français les mentions "POSTES DE CORÉE" (mars 1902) et "POSTES IMPÉRIALES DE CORÉE" (1903).
Cette collaboration cessa malheureusement lors de la mainmise des Japonais sur le pays.
Signature :
Jean-Marie THIEBAUD
Peintres et sculpteurs au musée Savitskii de Noukous République autonome de Karakalpakie, Ouzbékistan
Igor Vitalievitch SAVITSKII (alias SAVITSKY), né à Kiev le 04.08.1915, mort dans un hôpital de Moscou le 27.07.1986, fils de Vitalii Savitskii, juriste, et petit-fils de Timofei Dmitrievitch Florinski, slaviste remommé, professeur à l'Université de Kiev, membre correspondant de l'Académie des Sciences de Russie, et de V. Florenskaïa qui contribua grandement à l'excellente éducation du jeune Igor et à son éveil aux disciplines artistiques. Igor Vitalievitch SAVITSKII débuta sa formation simultanément auprès des peintres R. Mazel et E. Sakhnovskaïa et au collège d'apprentissage de l'usine "Серп и Молот" ("Faucille et Marteau") où il s'initia aux installations électriques. Il étudia aussi à la section graphique de l'Institut polygraphique puis à l'École d'Art "1905". Enfin, dès 1941 à 1946, il étudia à l'Institut Sourikov de Moscou, échappant à la guerre pour raison de santé.
Ce peintre et collectionneur d'oeuvres d'art, évacué à Samarkand en 1942, arriva à Noukous en 1963.
Le fonds qu'il a constitué représente 82.000 pièces dont 2500 sont exposées au premier étage du musée des Beaux-Arts de Noukous, dans la République autonome de Karakalpakie (Ouzbékistan), les autres étant conservées dans les réserves de ce musée qu'il dirigea à partir de 1966. Il a également amassé tout l'art populaire régional après qu'il eût découvert le Khorezm avec l'explorateur Sergueï Tolstov et compris qu'une civilisation de nomades était en train de mourir sous ses yeux (Ouz SSR, p. 420, 497; Le Figaro, 30.12.2002, p. 18, sous la plume de Patrick de Saint-Exupéry). La richesse de la collection a conduit à l'ouverture d'un second musée début mai 2003. L'auteur a eu le privilège de visiter aussi celui-ci en avant-première dès le 14 avril 2003 sur la route qui le menait de Boukhara à la mer d'Aral.
Les 85 peintres et sculpteurs recensés ci-dessous et dont la plupart appartenaient à l'avant-garde russe des années 1920-1930 sont ceux dont les oeuvres étaient présentées en avril dans l'un des deux musées.
Signature :
Jean-Marie Thiébaud, Tachkent, avril 2003
ABDOURAKHMANOVA [АБДУРАХМАНОВА] Adelina, peintre qui a représenté la mer d'Aral
sous la forme d'une jeune fille
ALEKSANDROVA [АЛЕКСАНДРОВА] T. (1907-1989), peintre
ANDREEV (alias ANDREÏEV) [АНДРЕЕВ] Nikolaï Andreïevitch (1873-1932), peintre, qui s'est rendu célèbre par les dessins qu'il fut autorisé à faire dans le cabinet de travail de Lénine et d'après lesquels il réalisa ensuite toute une série de bustes. Plusieurs de ses uvres sont également conservées dans la galerie Tretiakov de Moscou dont un buste de Tolstoï et "Lénine écrivant" (bronze, 1920).
ANTONOV [АНТОНОВ] A., peintre
AVETOV [АВЕТОВ] M. (1894-1943), peintre
BABICHEV [БАБИШЕВ] Alexeï Vassilievitch (1887-1963), sculpteur
BAIBOSSINOV [БАЙБОСИНОВ] S. B., né en 1954, peintre
BARTO [БАРТО] Rotislav, né à Moscou (Empire de Russie) en 1902, mort à Moscou (U.R.S.S.) en 1974, peintre. Le musée possède deux de ses uvres : une "Daghestanienne" et une "Pêcheuse" (1930).
BISLOV [БИСЛОВ], peintre
BOGDANOV [БОГДАНОВ] S. (1888-1967), peintre
BOM-GRIGORIEVA [БОМ-ГРИГОРИЕВА] Nadejda Sergueïevna (1884-1974), peintre
BOUSLOV [БУСЛОВ], peintre
BURE Lev (Leon) Leonardovitch (1887-1943), peintre. Une de ses peintures représente Samarkand en 1934.
CHERKES [ШЕРКЕС] Daniil Yakovlevitch (1899-1971), peintre
CHEVTCHENKO [ШЕВЧЕНКО] Aleksandr, né à Kharkov en 1883, mort à Moscou le 28.08.1948, admis à l'École de peinture, sculpture et architecture de Moscou en 1907, peintre et graphiste
CHIGOLEV [ШИГОЛЕВ] Sergueï Ivanovitch, peintre ("Composition sur un poème de Blok", 1927)
CHOUKHAEV [ШУХАЕВ] V. (1887-1973), peintre
CHOUKINE (alias SHUKIN en transl. angl.) [ШУКИН] J. (1904-1935), peintre
CHPADE [ШПАДЕ] A.A., peintre
DENISSOV [ДЕНИСОВ]Vassilii Ivanovitch, né le 01(13).1862 dans la forteresse de Zamostie (actuellement Zamosc), province de Lublin (Pologne), mort à Moscou (U.R.S.S.) en 1921, d'abord élève au Conservatoire de Musique de Varsovie, musicien dans le régiment lituanien de l'armée russe avant de commencer à étudier la peinture à l'âge de 30 ans. Peintre symboliste (E. Benezit, "Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs", tome IV, p. 449).
ECHASTOV [ЕШАСТОВ] G. (1897-1946), peintre
EGOROV [ЕГОРОВ] E. (1901-1942), peintre
EISENSTADT M. (1895-1961), sculpteur
ERIMBETOV [ЕРИМБЕТОВ] A., né en 1931, peintre
ERMOLENKO [ЕРМОЛЕНКО] A. (1889-1971), peintre
ESSENGALIEV [ЕСЕНГАЛЬЕВ] F., né en 1941, peintre
ETCHEISTOV [ЕЧЕЙСТОВ] Gueorguii Aleksandrovitch (1897-1948), peintre
FALK [ФАЛК] Robert Rafailovitch, né à Moscou (Empire de Russie) en 1886, à Moscou (U.R.S.S.) en 1958, peintre. Il avait d'abord étudié la musique. Il fut l'un des membres fondateurs du groupe du "Valet de Carreau" révélé au public par une exposition en 1912. Cette même année, il prit part à la création du "Monde de l'Art". De 1918 à 1928, il fut professeur de peinture et membre du Collège Pan-Russe des Arts Plastiques. Il eut une exposition personnelle à la galerie Tretiakov en 1924 et fut nommé en 1928 doyen de la Faculté de peinture. Il séjourna à Paris de 1928 à 1937. De retour à Moscou en 1937, il y vécut jusqu'en 1944 avant d'être évacué sur Samarkand. Les politiques lui reprochaient de ne pas travailler dans la ligne du "réalisme socialiste" et il avait continué à peindre dans la clandestinité ("Dictionnaire universel de la peinture", Le Robert, Paris, 1975 ; E. Benezit,
"Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs", tome V, p. 280). N.B. : une de ses toiles s'est vendue 48 600 francs en 1994 ("Quid 2000", p. 438).
GAN [ГАН] P. (1894-1966), peintre
GLAGOLEVA-OULIYANOVA [ГЛАГОЛЕВА-УЛИЯНОВА] A. (1874-1943), peintre
GOLOPOLOSSOV [ГОЛОПОЛОСОВ] Boris Aleksandrovitch (1900-1983), peintre
IBRAGUIMOV [ИБРАГИМОВ ]M., peintre (encore vivant en 1986)
ISTOMINE [ИСТОМИН] Konstantin N., né à Koursk en 1887, à Samarkand en 1942
IZENTAEV [ИЗЕНТАЕВ] J., né en 1943, peintre
JOLTKEVITCH [ЖОЛТКЕВИЧ] A. (1872-1943), sculpteur
KACHINA [КАШИНА] N. (1896-1977)
KALANOV [КАЛАНОВ] N., peintre
KARAKHAN [КАРАХАН] N. (1900-1970), peintre
KODJINE [КОДЖИН] P. (1904-1959), peintre
KOROVAÏ [КОРОВАЙ] Elena Loudvigovna (1901-1974), peintre ("Les menuisiers de Boukhara", 1932)
KOURZINE [КУРЗИН] Mikhaïl Ivanovitch (1887-1957), peintre ("Acteur en pantalon rouge", "Femme à l'enfant")
KOUZNETSOV [КУЗНЕЦОВ] N. (1876-1970), peintre.
KOVALEVSKAÏA [КОВАЛЕВСКАЯ] Z., née à Volsk en 1902, à Samarkand en 1972, peintre
KOZLOV [КОЗЛОВ] Aleksandr (1902, à Moscou en 1946), peintre
KOZOCHKINE [КОЗОШКИН] N. (1899-1961), peintre
KRAMARENKO [КРАМАРЕНКО] I. (1888-1942), peintre, mari d'Irina JDANKO (sur de Tatiana JDANKO, ethnographe)
KVON [КВОН] A. K. (1934-2000), peintre
LARKO [ЛАРКО], peintre
LOPATNIKOV [ЛОПАТНИКОВ] D. (1899-1975), peintre
LYSSENKO Evguenii (1903-1977 ?), peintre
MALYCHEVA [МАЛЫШЕВА] Olga (1920-1983), sculpteur animalier
MARKOVA [МАРКОВА] V. (1907-1942), peintre
MAZEL I. (1890-1967), peintre
MAZEL Roufim Moisseievitch M. (1890-1967), peintre ("Le montage de la yourte", "Famille turkmène sous la yourte")
MORGOUNOV [МОРГУНОВ] A. (1886-1969), peintre
NEDBAYLO M. (1901-1943), peintre
NIKOLAEV Aleksandr (dit OUSTO-MOUMINE), peintre ("Le Chemin de la Vie", 1924)
NOVOJILOV [НОВОЖИЛОВ] V. (1887-1959)
NURENBERG A. (1887-1979), peintre
OSMERKINE [ОСМЕРКИН] Aleksandr (1892-1953)
OUFIMTSEV [УФИМЦЕВ]Viktor Ivanovitch (1899-1964), peintre
OULYANOV (alias OULIANOV) Nikolaï Pavlovitch, né à Eletsk (Empire de Russie) en 1875, à Moscou (U.R.S.S.) en 1949, peintre, ancien élève à Moscou de 1888 à 1889 dans l'atelier de V. Mechkov puis en 1889-1890 à l'Institut de peinture, de sculpture et d'architecture et dans l'atelier de V. Serov. Il séjourna en Italie en 1907 puis à Paris de 1909 à 1917 et enfin en Allemagne. Il participa en 1912 aux expositions de la Toison d'Or et de la Rose Bleue (Goloubaïa Roza) (qui regroupait les symbolistes russes depuis 1907). Il était membre correspondant de l'Académie des Arts d'U.R.S.S.
On peut voir une de ses uvres à la galerie Tretiakov ("Femmes dans une galerie de peintures", 1923). Son nom est cité dans le catalogue de l'exposition Paris-Moscou du Centre Pompidou de Paris en 1979.
OUSTO-MOUMINE [УСТО-МУМИН] : voir NIKOLAEV
OUTEGUENOV [УТЕГЕНОВ] A., peintre
POPOVA [ПОПОВА] Lioubov Sergueïevna, née à Ivanoskoie (Empire de Russie) en 1883, à Moscou (U.R.S.S.) le 25.05.1924, peintre, élève des ateliers de Joukovski, de Youon et de I.
Doudine. Elle séjourna en Italie puis à Paris en 1912-1913 avant de rentrer en Russie en 1914 au début de la première guerre mondiale. Elle enseigna à Moscou aux Ateliers nationaux en 1918. On peut voir aussi une de ses uvres ("Homme + Air + Espace", 1913) au Musée d'État Russe à Saint-Pétersbourg.
PROKOCHEV [ПРОКОШЕВ] N. (1904-1938), peintre.
REDKO [РЕДКО] Kliment Nikolaevitch, né à Kholm (Ukraine, Empire de Russie) le 15.09.1897, en 1956, étudiant à l'École d'Art de Kiev, peintre suprématiste (1) puis figuratif ("le boxeur", 1929, au musée de Noukous)
RIAZOUINSKAÏA [РЯЗУЙНСКАЯ] M. (1877-1946), sculpteur
RODIONOV [РОДИОНОВЬ] Mikhaïl (1885-1956), peintre
RODIONOV [РОДИОНОВЬ]Piotr Sergueïevitch, né à Khlopovo près de Toula en 1914, en 1981, peintre. Il a étudié à l'Institut Sourikov des Beaux-Arts de Moscou dans l'atelier de S. Guerassimov. Membre de l'Union des Artistes de l'U.R.S.S. depuis 1944, il a créé des décors et des costumes pour le Bolchoï de 1945 à 1970.
ROJDESTVENSKII Vassilii (1897-1949), peintre
ROUDNEV [РУДНЕВ] A. (1896-1975), peintre
SAFRONOVA [САФРОНОВА] A. (1892-1966), peintre
SAIPOV [САЙПОВ] K. (1939-1972), peintre
SEREKEEV [СЕРЕКЕЕВ] V., né en 1942, peintre
SOKOLOV [СОКОЛОВ] Mikhaïl Xenofontovitch, peintre
SOTNIKOV [СОТНИКОВ] Aleksei, né à Stanitza Mikhaïlovskaïa en 1904, en 1989, peintre. Son nom est cité dans le catalogue de l'exposition Paris-Moscou du Centre Pompidou de Paris en 1979.
STERENBERG [ШТЕРЕНБЕРГ] David Petrovitch (1881-1948), peintre, fondateur à Moscou de l'association d'artistes OST
TANSYKBAIEV Oural Tansykbaievitch, né à Tachkent (Turkestan) en 1904, peintre. Il a peint le lac Issyk-Koul en 1951.
TARASSOV [ТАРАСОВ] N. T. (1896-1969), peintre ("A.S. Pouchkine à table")
TATEVOSSIAN Oganes (1889-1974), peintre qui, en 1921, a dirigé la fabrication des porcelaines commémoratives du 3e congrès du Komintern (Bénézit, op. cit., XIII, p. 485).
VOLKOV [ВОЛКОВ] Aleksandr Nikolaevitch, né à Fergana (Turkestan russe) en 1886, à Tachkent (République Socialiste Soviétique d'Ouzbékistan, URSS) en 1957, inhumé au cimetière Botkine de Tachkent, peintre, étudiant à l'Académie de Saint-Pétersbourg de 1908 à 1910 puis à l'École de Kiev de 1912 à 1916, un des organisateurs de la première école de peinture en Ouzbékistan en 1919 et professeur à l'Institut d'Art de Tachkent, artiste du Peuple de la République Socialiste Soviétique d'Ouzbékistan en 1946. Parmi ses principales uvres, citons un "Kholkozien" (1933), un portrait de Lénine (1952), "Paysage d'automne" (1957) (Jean-Marie Thiébaud, "Personnages marquants d'Asie Centrale, du Turkestan et d'Ouzbékistan", p. 483. Son nom est cité dans le catalogue de l'exposition Paris-Moscou du Centre Pompidou de Paris en 1979.
ZAKHAROV [ЗАХАРОВ] I. (1886-1969), peintre
ZEFIROV [ЗЕФИРОВ] Konstantin Klavdianovitch (1879-1960), peintre
ZERNOVA [ЗЕРНОВА] Ekaterina Sergueïevna (1900-1995), peintre
Les réserves du musée abritent aussi des uvres de A.ISSOUPOV, M. VOLOCHINE, etc.
(1) Le suprématisme avait été lancé à Moscou en 1913 par Kasimir Malévitch (1878-1935) ("Carré noir sur fond blanc").
Notes :
(1) Le suprématisme avait été lancé à Moscou en 1913 par Kasimir Malévitch (1878-1935) ("Carré noir sur fond blanc").
Theodor GEPPERT S.J. (1904-2002)
Né en Westphalie (Allemagne) le 8 mars 1904, le 13 juillet 2002, admis dans la Société de Jésus en 1923, fut ordonné prêtre à Dublin (Irlande) en 1933, reçu docteur en économie à l'Université de Bâle (Suisse) en 1940. Fondateur de l'Université de Sogang (1) à Séoul en octobre 1954, président de cette université de 1954 à 1961, docteur honoris causa de l'université Sophia (2) du Japon en 1972, il fut reçu docteur honoris causa ès lettres de l'Université de Sogang en 1985.
En 1948, des catholiques coréens avaient sollicité du Vatican la création à Séoul d'un établissement d'études supérieures et le pape Pie XII avait demandé aux jésuites de répondre à cette demande. Le Père Johan Janssens (3), général des jésuites, donna alors à la province du Wisconsin (4) la mission de créer un collège au Pays du Matin Calme. Le Père Leo Burns vint en Corée et entama des négociations avec le gouvernement de l'époque. En décembre 1955, les Pères Kenneth Killoren (5) et Arthur Dethlefs débarquèrent à Incheon et ils furent rejoints en octobre 1956 par le Père Clarence A. Herbst et, en novembre 1957, par le Père Basil Price (6). C'est ainsi que se constitua la première communauté de jésuites en Corée.
En janvier 1957, les jésuites acquirent à Séoul un terrain de 217 323 m² à Nogo San, Sinsu dong, Mapo-gu pour y construire l'université actuelle.
Theodor GEPPERT est inhumé dans l'enceinte de l'université à gauche d'une statue d'Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus. Sa tombe blanche, en forme d'autel, porte en lettres noires son nom, sa qualité de jésuite, ses dates de naissance et de mort.
Depuis le 13 juillet 2003, sa statue monumentale en pied se dresse face à l'entrée de l'Université qu'il a fondée. Le socle du monument retrace en coréen les principales étapes de sa carrière. À quelques mètres, une flèche en béton rappelle la devise latine de cet établissement : OBEDIRE VERITATE (OBÉIR À LA VÉRITÉ).
Les différents bâtiments portent les noms de jésuites illustres : ARRUPE (7) HALL, EMMAUS HALL, LOYOLA (8) LIBRARY, RICCI (9) HALL, SAINT IGNATIUS HOUSE, XAVIER (10) HALL
Notes :
(1) Sogang signifie littéralement "fleuve de l'ouest" ou "à l'ouest du fleuve".
(2) C'est dans cette université japonaise que Geppert enseigna jusqu'à sa venue à Séoul.
(3) Johann (Jean-Baptiste) Janssens, né à Mecheln (Belgique) en 1889, à Rome (Italie) dans la maison des jésuites le 05.10.1964 après avoir été opéré dune tumeur de l'il, général des jésuites ("pape noir") du 15.09.1946 au 05.10.1964. Le pape Paul VI vint en personne lui donner la bénédiction apostolique dans l'heure qui précéda sa mort.
(4) La province du Wisconsin de la Société de Jésus regroupe les états américains suivants : Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wisconsin et Wyoming.
(5) Kenneth E. Killoren S.J., premier président du collège de Sogang, auteur de "Catholic Church and Martyrdom" in Korea Journal, 2-6 (juin 1962), p. 10-13.
(6) Basil M. Price, né à Amelia (Nebraska, USA) le 18.06.1923, à Séoul au Saint Mary Hospital de Kang Nam le 29.09.2004, victime d'un cancer du colon, fils d'Ernest Price et de Mary Nachtman. Ordonné prêtre en 1954, il fonda à Séoul en 1966 un Institut du Travail et du Management.
(7) Pedro Arrupe, né à Bilbao (Pays basque espagnol) le 14.11.1907. à Rome (Italie) dans la maison des jésuites le 05.02.1991 (après avoir été visité la veille par le pape Jean-Paul II). D'abord étudiant en médecine à Madrid, il entra chez les jésuites en 1927. Il était missionnaire dans la banlieue d'Hiroshima (Japon) lors de l'explosion de la bombe nucléaire lancée sur la ville par les Américains le 6 août 1945. Il se consacra alors aux soins à donner aux survivants. Nommé supérieur de la province des jésuites du Japon, il fut élu président de l'Union des Supérieurs généraux en 1965 (pendant le concile de Vatican II) et devint ainsi le 28e supérieur général des jésuites ("pape noir") de 1965 à 1983.
(8) Ignace (en espagnol Inigo, issu du latin "ignis", feu) de Loyola, né au château de Loyola (pays basque espagnol), à Rome le 31.07.1556, grand jouisseur de la vie et militaire "possédé d'un vain et grand désir de gagner de l'honneur" (comme il l'écrit lui-même), fondateur des jésuites (comptant déjà plus de 1000 membres à la mort d'Ignace de Loyola. Il fut canonisé le 12.03.1622.
(9) Matteo Ricci, né à Macerata (Italie) le 06.10.1552, à Pékin le 11.05.1610, jésuite depuis 1571, astronome et mathématicien, arrivé en Chine en 1583. Il est connu en Chine sous le nom de Li Ma Tseu.
(10) François Xavier dit Xavier à Séoul (saint), Francisco de Jaxu (alias Jaso ou Jasu) puis Francisco de Jasu y Javier, né au château de Xaberri (Javier) le 07.04.1506, 03.12.1552 dans une cabane de la plage de l'île de San Chan, à moins de 10 kilomètres des côtes chinoises. Son arrière-grand-père Jasu fut "bayle" (maire) de Saint-Jean-Pied-de-Port (pays basque français) Au cours de ses études, il fit la connaissance d'Ignace de Loyola qui ne cessa de lui répéter : "Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?". Tous deux et cinq de leurs camarades se retrouvèrent le 15.08.1534, fête de l'Assomption, dans une chapelle souterraine de l'église de Montmartre où ils prononcèrent trois vux : chasteté, pauvreté et promesse d'un pèlerinage en terre sainte, fondant ainsi la compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Venise (Italie) le 24.06.1537, il débarqua à Goa le 06.05.1542, le roi Jean III de Portugal ayant demandé en 1541 l'envoi de missionnaires aux Indes. Ce n'est que le 15.08.1549 qu'il mit le pied au Japon en débarquant avec deux compagnons portugais, Cosme de Toves et Juan Fernandez, à Kagoshima au sud de Kyûshû (après une traversée faite à bord d'un bateau chinois). Puis il résida d'octobre à décembre 1550 à Yamaguchi, ville où résidait le plus puissant daimyo du Japon qui le reçut et que François Xavier s'obstina à appeler duc, préférant peut-être réserver le titre de roi à son seul souverain. Il commença à prêcher la religion nouvelle au coin des rues mais, il faut bien le reconnaître, sans grand succès. Un évènement frappa alors l'imagination de quelques membres de la cour : un samouraï ayant craché au visage d'un des compagnons de François Xavier, le missionnaire s'essuya le visage sans colère. Frappé par ce manque de volonté de vengeance, le noble japonais voulut en savoir plus sur le christianisme et se convertit. D'autres l'imitèrent et, au départ de François Xavier, le Japon comptait quelque 2000 baptisés. Le pape Paul VI déclara ce missionnaire bienheureux le 25.10.1619 puis celui qu'on surnomma bientôt "l'évangélisateur des Indes et du Japon" fut canonisé par le pape Grégoire XV le 12.03.1622 (en même temps qu'Ignace de Loyola).alors qu'il avait déjà été choisi comme patron de la Navarre depuis l'année précédente. En 1927, Pie XI en fit le saint patron de toutes les missions catholiques. Saint François Xavier est aussi le patron du tourisme depuis le 14.06.1952.
Sergueï Vissarionovitch Tchirkine Сергей Висарионович ЧИРКИН (1875-1943)
Il accueillit à Séoul des milliers de réfugiés. Sa famille se réfugia ensuite à Shanghai puis à San Francisco.
D'origine russe, inhumé à Séoul (Corée) au cimetière international Hapjeong dong alias Hyang-hwa jin), Serguei Vissarionovitch Tchirkine, consul de l'Empire de Russie dans les premières années de l'annexion de la Corée (Empire de Choson) par l'Empire du Japon en 1910-1911 (après avoir occupé des postes en Perse et aux Indes). Puis il quitta Séoul pour une mission à Boukhara (Turkestan, ancien émirat placé sous protectorat russe). À Tachkent, capitale du Turkestan (aujourd'hui Ouzbékistan, ex-République de l'URSS), il fit la connaissance de Natalia Efremova, fille du gouverneur civil, et l'épousa à la veille de la Révolution de 1917. Lors de la prise du pouvoir par les Bolcheviks et de l'entrée des "Rouges" à Tachkent, le couple partit pour les Indes et se plaça sous la protection des Anglais. Serguei Tchirkine retrouva dans ce pays un diplomate allemand avec lequel il jouait fréquemment au billard du Seoul Club. Les Tchirkine revinrent en bateau à Séoul et Sergueï et Natalia eurent des fils jumeaux, Vladimir et Cyril (Kyrille) Sergueïevitch, nés à Séoul en 1924, qui, après s'être livrés a une véritable guerre des pierres contre le fils de l'ambassadeur soviétique à Séoul, devaient plus tard être diplômés ingénieurs de l'Université de Berkeley (Californie, USA) et travailleront leur vie durant pour la Pacific Gas & Electric in San Francisco (N.B. : Cyril était encore en vie en 2002). Pour fuir la guerre civile de 1950-1953, Natalia Tchirkina rejoignit ses fils en Californie et y vécut jusqu'à l'âge de 96 ans. Quant à l'ancien consul du tsar, il exerça à Séoul différents métiers pour faire vivre sa famille : il travailla dans une banque puis au bureau de tourisme avant d'enseigner les langues à la Keijo Imperial University (Keijo était le nom japonais de Séoul) et à la Seoul Foreign School ce qui lui permit de pouvoir rester à la tête des Russes blancs de Corée (dont une bonne centaine à Séoul, ville qui avait certes reçu des milliers de réfugiés mais presque aussitôt émigrés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, etc., tandis que d'autres répartis dans les autres villes du pays exerçaient toutes sortes de petits métiers pour survivre). Sa femme Natalia ouvrit un salon de coiffure dans le quartier de Chongdong. Les Russes anti-communistes avaient formé une petite communauté évoluant en milieu strictement fermé (au sens étymologique du terme, c'est-à-dire à l'abri derrière de solides enclos en compagnie des prêtres de la paroisse orthodoxe Saint-Nicolas dont l'église avait été construite en 1903, à Chongdong, dans le quartier de l'ancien consulat, afin d'éviter tous heurts avec les "Rouges"). En 1922, un flot de réfugiés russes (2500 militaires et 2800 civils dont 1600 femmes et enfants), venus de Vladivostok, arrivèrent a Wonsan et repartirent pour la plupart au printemps suivant pour Shanghai, Harbin, le Mexique, le Brésil ou le Chili. Natalia Efremova, la veuve du consul, fut incarcérée en août 1945 et elle put entendre les cris de ses camarades de prison que l'on battait dans des cellules voisines. Quant aux enfants Tchirkine, ils avaient pu trouver refuge à Shanghai. La tour blanche de l'ancien consulat russe subsiste. Classée monument historique, elle paraît à présent bien petite au milieu des buildings de Séoul qui l'entourent de toutes parts, non loin de l'actuelle ambassade de la Fédération de Russie (Donald N. Clark, "Vanished Exiles : The Prewar Russian Community in Korea", ed., Dae-sook Suh, Korean Studies: New Pacific Currents, Centre for Korean Studies, University of Hawaii, 1994 pp.41-57).
Signature :
Dr Jean-Marie Thiébaud
Le cimetière international d'Incheon (Corée du sud)
Après l'ouverture au commerce international du port d'Incheon en 1883, il a fallu penser un lieu pour les étrangers décédés sur le sol de Corée. Il est connu sous le nom de cimetière international (ou cimetière pour les étrangers) de Chemulpo (1).
Le 30 mars 1914, sans doute en raison des travaux du port ou de l'urbanisation croissante, on transféra les tombes à Buksung-dong, Chung-gu. Sérieusement endommagé par les troupes du Nord le 25 juin 1950 au cours de la première année de la guerre de Corée, le cimetière demeura à l'abandon pendant plusieurs années. Puis, le 25 mai 1965 décida de le déplacer une fois encore, à la place qui est sienne aujourd'hui, 53, Cheonghak-dong, Yeonsu-gu. Depuis longtemps, il ne possède plus de gardien et ses grilles sont hermétiquement fermées par une barre transversale de fer et un solide cadenas insensible au désir du voyageur d'en savoir davantage sur ces étrangers qui furent parmi les premiers à fouler le sol du royaume de Choson et à y laisser leur vie.
En voyant l'état des tombes, la disparition des allées sous des couches d'humus et de végétation alourdies par la pluie tiédasse de début mai, l'épaisseur des mousses et surtout des poussières qui recouvrent les pierres et les stèles et rendent quasi impossible la lecture de leurs inscriptions russes, américaines, françaises, allemandes, chinoises, etc., on comprend vite que ce lieu est à présent abandonné, livré à lui-même et à la corrosion de l'oubli, plus féroce que celle qui ne peut s'empêcher de ronger les pierres. Ici, beaucoup de petites croix blanches anonymes pour recouvrir des corps dont l'artillerie de campagne a effacé jusqu'aux noms, là les pierres tombales de deux prêtres missionnaires français accrochées côte à côte à une carcasse de chapelle (2) et commençant par la sacro-sainte formule Ici repose, souvent des ancres de marine pour signer à coups sûrs des sépultures de marins. Ce sont ces dernières qui font peut-être monter les plus grandes bouffées d'émotion : souvent il s'agit de jeunes matelots morts en rade d'Incheon ou alors que leurs bateaux s'approchaient des côtes de Corée. Des dates rapprochées de décès laissent supposer que certains d'entre eux furent victimes d'épidémies ou d'accidents survenus sur leurs bâtiments. Et solidarité entre marins oblige, les monuments funéraires ont été élevés grâce à la générosité de leurs compagnons, comme le rappellent plusieurs inscriptions encore lisibles. Avant d'abandonner quelques-uns des leurs en terre lointaine, ils avaient à cur de leur élever des stèles ornées d'ancres et de cordages, les ancres pour montrer où la course de ces enfants de la mer s'était brusquement arrêtée et les cordages pour rappeler les liens qui unissent les marins, quelles que soient leurs nationalités.
Noms et nationalités des bateaux cités :
· RNI Marco Polo (Italie)
· Manjour (Empire de Russie)
· USS F.S. Baltimore (USA)
· USS Enterprise (USA)
Pour saisir cette corde tendue que les générations passées ne semblent pas avoir eu l'idée de glisser dans les archives du pays, il nous a paru indispensable de relever les rares noms qui subsistent et qui constituent autant de connections reliant la Corée au reste du monde
(1) De l'ancien nom d'Incheon, à ne pas confondre avec la station de métro du même nom au sud-ouest de la métropole de Séoul.
(2) Le plus imposant monument du cimetière mais il est aujourd'hui impossible de connaître le nom de celui qui l'a érigé.
Abréviations
o : né(e)
+ : décédé(e)
Les textes entre crochets sont des notices biographiques ajoutées par l'auteur.
INSCRIPTIONS
· Hana Glover BENNETT (1873-1938) · Hatsu BRUCKMEIER, o à Kudo le 18.03.1856, + le 03.08.1937. · F. Warren BUGLER, AB (sans date). · Robert Hans Carl BRUCKMEIER, o à Wolfenbutted, Braunsweighth (Wolfenbüttel, Braunschweig) le 06.10.1840, + à Chemulpo le 24.04.1930 (mari de la précédente). · C.H. COOPER, o à New York (USA), + le 13.12.1889. · Reubena FULLER, engineer yeoman USN, + à bord de l'U.S.S. F. S. Baltimore à Chemulpo en août 1894. Son nom est écrit à côté de celui de Jamers Kelly (voir plus loin) et le monument a été édifié par leurs camarades. · Gumna Fuore FUOGHISTA, RNI Marco Polo (navire italien), + le 09.09.1904. · Scelto d'Ippoli Angelo FUGHISTA, RNI Marco Polo (navire italien), + le 10.09.1904. · Andrei GORRAS, matelot du bâtiment russe Manjour, + le 15.10.1895. · Charles H. GRAY, ships'corporal USS Juniata, o à Concord (Washington, USA) le 30.04.1843, + à Chemulpo le 19.08.1888. · HENKEL (sans autres précisions) · Charles Albert HUTCHINSON, o le 01.11.1907, + le 08.03.1950, consul américain à Séoul de 1948 à 1950. N.B. : cette tombe est la plus récente du cimetière). · F. A. KALITZKY, o à Königsberg le 10.09.1872, + à Keijo le 18.03.1904. Son monument a été érigé le 10.09.1938 par Emily Kalitzky. Il est orné d'une ancre de marine et d'une croix latine portant un cur sculpté en relief à l'intersection de ses branches. · James KELLY, de l'US Navy. + à bord de l'U.S.S. F. S. Baltimore à Chemulpo le 06.09.1894 (voir ci-dessus Reubena FULLER).· Eli Bar LANDIS, o en Pennsylvania (USA) en 1865, + en 1899, premier missionnaire de l'église anglicane américaine à Incheon où il fonda un temple en 1891 (inscription en coréen). · Amandus LODAGE, o à Hambourg (Allemagne) le 06.02.1858, + à Chemulpo le 07.08.1886, du service des douanes coréennes. · Justin Harry MacCARTHY, + le 21.01.1902. · P.B. MALCOLM, M.D. (docteur en médecine), + le 03.01.1897. · Anne Louisa MALET, veuve d'Arthur MALET, o le 15.01.1836, + le 03.09.1900 (inscription en anglais). · Jean [Baptiste] MARAVAL, o à Castres (Tarn, France) le 14.11.1866, + à Ouen-San, missionnaire apostolique [+ à Tek-ouen, à quelques kilomètres au nord de Ouen-san (Wonsan, actuellement en Corée du Nord), le 24.10.1890, victime de la phtisie, inhumé audit lieu sur la colline Tjak-eum-kol, exhumé et rapporté à Chemulpo (In-tchyon, Incheon) en 1901, inhumé avec son frère le 15.01.1916 au cimetière international de Chemulpo, fils de Jean Maraval et d'Élisabeth Bonnéry, élève du petit séminaire de Castres, ordonné prêtre aux Missions étrangères de Paris le 27.11.1889, parti pour la Corée, arrivé à Séoul le 02.02.1890], frère du suivant (inscription en français). · [Gabriel Edmond] Joseph MARAVAL, o à Castres (Tarn, France) le 21.11.1860, + à Chemulpo (Incheon) le 13.01.1916, missionnaire apostolique [ordonné prêtre aux Missions étrangères de Paris le 20.09.1884, parti pour la Corée le 19.11.1884, entré dans ce pays le 05.05.1885, sorti de la mission et de la Société le 01.05.1904], frère du précédent (inscription en français). · Cuomo Francesco MARINAIO, RNI Marco Polo (navire italien), + le 19.09.1904. · James MARTYN, AB (sans date). · George Burt MOTT, o à New York (USA) le 03.03.1836, + en Corée le 10.07.1883. · Lancelot Ingleby PELLY, + le 20.03.1906, à l'âge de 36 ans. · André PHILIPPE, + le 11.07.191(7 ?) à l'âge de 48 ans (inscription en français). · A. RWEIGALL, + le 28.02.1931. La tombe porte une inscription en français : Avec tout mon cur - Denise. · Francis J. SHEARMAN, de l'USS Enterprise, o à Chicago (Illinois, USA), + le 06.12.1884, âgé de 20 ans. Le monument porte l'inscription : erected to his memory by his ship mates. · Arthur SMITH, AB, + le 22.01.1898 à l'âge de 27 ans. · Wo Li TANG, o à Changghu (Chine) en 1843, + âgé de 69 ans, le 22.06.1912, à Chemulpo après avoir vécu 30 ans dans cette ville. · Maximilian TAUBLES, o à Prague (Bohème) le 17.04.1845, demeurant à San Francisco (Californie, USA), + à Séoul le 15.03.1886. Le monument a été élevé par ses frères et surs. · Joseph TIMMONS, USS Marion (sans date). · Walter Davis TOWNSEND, o à Boston (Massachusetts, USA) le 09.02.1856, + à Chemulpo le 10.03.1918 après avoir vécu 34 ans dans cette ville [un des trois ingénieurs américains qui mirent en chantier la petite ligne de chemin de fer reliant Séoul à Incheon en 1896 mais ce sont les Japonais qui rachetèrent la concession et finirent les travaux]. · Amalia Amador C. WOO, o le 10.07.1863, + le 11.01.1939. · Bradford E. YERGIN, o dans le Michigan (USA) le 08.03.1923, + le 17.07.1962, SFC - US Army - Korea.
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD
La première école française publique à Séoul
Neuf ans après le traité d'amitié, de commerce et de navigation signé entre la 3e République et le royaume de Corée le 4 juin 1886, Collin de Plancy, chargé d'affaires de la France à Séoul, demanda à Émile Martel (né le 4 décembre 1874, à Séoul le 19 septembre 1949, inhumé au cimetière international de Hapjeon Dong), ancien élève de l'École des Mines, de fonder une école dont le jeune consul italien Carlo Rossetti dira le plus grand bien, précisant : "elle est assurément une des mieux organisées et on en tire les meilleurs résultats" (Carlo Rossetti, "La Corée et les Coréens", 1905, p. 360).
Les cours de français écrit et parlé (dictée, analyse grammaticale, composition française, syntaxe, conversation et traduction de textes français en coréen et de textes sino-coréens en français), d'arithmétique et de géographie, dispensés le matin de 10 heures à midi trente en français, se poursuivaient l'après-midi avec deux heures de chinois (données par un professeur coréen désigné par le ministère de l'Instruction publique), sans oublier une heure de gymnastique sous les ordres d'un officier de la garnison de Séoul.
Quelques années à peine après l'ouverture de l'école, celle-ci avait déjà fourni une quarantaine de hauts fonctionnaires à l'administration coréenne dont deux interprètes de la maison impériale, un interprète du ministère des Affaires étrangères, des cadres des Mines et de la direction des Chemins de fer, ainsi que des secrétaires de trois légations coréennes à Paris, Berlin et Saint-Pétersbourg.
Pleinement satisfait de ce brillant palmarès, Émile Martel pouvait affirmer : "Ce n'est pas sans un légitime orgueil qu'il nous est permis de constater que la Corée est un des rares pays de ces régions où la langue française, et par conséquent aussi un peu l'esprit latin, a pu pénétrer avec succès" ("La Corée et les Coréens", p. 362).
Charles Martel, né à Séoul en 1909, fils d'Émile et d'Amelia Eckart, deviendra secrétaire du consulat général de France. Fait prisonnier par les Nord-Coréens le 13 juillet 1950, il a décrit avec le consul Charles Georges Perruche (1916-1984) ses trois années de détention dans les camps communistes sous le titre "Prisonniers français en Corée" dans les Cahiers d'Histoire Sociale, n° 3, Paris, Albin Michel, 1994.
Quant à la première école laïque française fondée à Séoul par son père, elle avait fermé ses portes en 1910 lors de l'annexion du pays par les Japonais. Les bâtiments de Chongdong, dans la rue qui mène à l'ancienne Cour de Cassation (devenue musée municipal), ont été entièrement rasés. Seule une plaque de marbre, en face du couvent des franciscains, rappelle son emplacement. Son texte écrit en coréen et en chinois peut se traduire ainsi :
"Site de l'École publique française. Lors de l'ouverture du pays, le français y était enseigné (1895-1910)".
Signature :
Dr Jean-Marie THIEBAUD