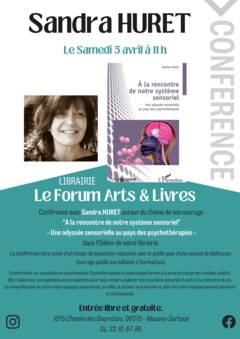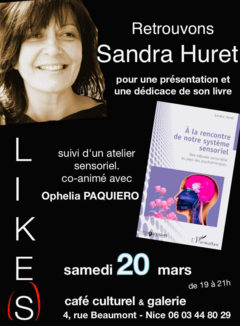Sandra Huret
ContacterSandra Huret
Structure professionnelle : Cabinet libéral et entreprise (Qualisocial)
Titre(s), Diplôme(s) : Spécialiste en santé mentale, en psychologie, en psychothérapie et sophrologie
Fonction(s) actuelle(s) : Psychothérapeute, spécialiste psychotraumatologie, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des troubles auditifs et formatrice
Vous avez vu 11 livre(s) sur 3
AUTRES PARUTIONS
DES ETOILES DANS LA TETE
Approche psychologique de la créativité chez les artistes et les scientifiques.
Connaissances et Savoirs. Éditeur Universitaire. France-Québec, Octobre 2014
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
BALADE ARTISTIQUE AU PAYS DE LA NEUROPSYCHOLOGIE
Sandra Huret s'intéresse à l'étude du mécanisme cérébral dans les processus créatifs (principalement pour la perception musicale).
Cet article est le résumé d'un exposé qui fait partie d'un prochain cycle de conférences dont le thème concernera les rapports entre les modélisations et énoncés de la neuropsychologie et les processus créatifs.
Ce présent article est divisé en deux parties : Une première, synthèse théorique, et une seconde, essai d'illustration.
I - Synthèse théorique
" Une pomme est posée sur la table. Mon cortex occipital la voit. Mon cortex temporal associatif dit : "elle a l'air bonne". Mon cortex pariétal associatif conclut : "je vais la manger". Mon cortex préfrontal dit alors : " Je vais la porter à ma bouche et la croquer", ce que fait mon cortex moteur, sous contrôle vigilant de mon cortex somesthésique. Et tout mon cerveau se régale". (Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, p. 136, 1986) (1)
Les différentes interventions du néocortex, cerveau cognitif, illustrées par l'évocation d'une pomme et la prise de décision la concernant permettent de mettre en évidence la finalité latente du cerveau humain : Se régaler.
Les recherches en neurosciences, notamment en neuropsychologie puisqu'elles concernent essentiellement l'étude de la mémoire, des émotions et de l'apprentissage, soulignent d'une manière ou d'une autre que l'affect reste le moteur pour le système limbique, cerveau sentimental, dans lequel l'hypothalamus latéral héberge le centre du plaisir. Le cerveau humain stocke au fil du temps et de l'expérience des mémoires sous forme d'images polysensorielles et affectives.
L'être humain apprend, retient, agit, se passionne, crée car il aspire à "se régaler ". Sa mémoire reste une mémoire essentiellement affective. Les émotions mènent la danse de façon considérable dans un cerveau dans lequel "le passionnel et le cognitif sont toujours coextensifs " (J.D. Vincent, Biologie des passions, 1986)
Les investigations de la neuropsychologie suivant la modélisation neurobiologique des trois cerveaux (le primitif, - pulsionnel et sensoriel -, le sentimental, - émotionnel et affectif - et le cognitif,- rationnel, représentatif et perceptif -) permettent de mieux cerner la manière dont nous agissons en interaction avec le milieu dans un but toujours homéostatique et passionnel.
C'est très certainement dans le comportement passionnel que l'acte créatif prend vie mais comme chacun le sait l'expression d'un art comme la musique par exemple passe par l'apprentissage et sous-tend donc que le cerveau se mette entièrement à l'action (cognitif et émotionnel aussi bien que pulsionnel et instinctif).
Les recherches actuelles révèlent d'ailleurs que le cerveau possèderait des régions exclusivement dédiées à la perception musicale. Que ce soit la perception des intervalles, du contour d'une mélodie, de la consonance et de la dissonance d'une pièce, et même les émotions que la musique suscite, le cerveau musical est à l'uvre. Bien que beaucoup de questions sur la musique et le traitement musical restent non résolues, des données scientifiques suggèrent que les habiletés musicales dépendent en partie de traitements cérébraux spécialisés reposant sur des prédispositions musicales. Ce qui sous-entend qu'il y aurait une prédisposition initiale pour la musique.
Cette argumentation suggère parallèlement que l'apprentissage musical mais aussi les prédispositions ainsi que l'intérêt passionné à pratiquer cet art ne seraient pas exclusivement culturel, bien au contraire
L'approche des neurosciences souligne de façon considérable la nature biologique de l'investissement musical et artistique au sens large.
Les fondements biologiques du comportement musical ont donc toutes les raisons d'être accueillis positivement car s'il n'est pas possible d'améliorer la manière dont le cerveau humain est construit, il est possible en revanche de mieux comprendre son fonctionnement afin d'adapter les méthodes d'enseignement et les pratiques musicales à notre biologie et à nos limites. Le rôle des universités et des sciences en général, est de prendre conscience de ces implications.
Pourtant le fondement biologique sur lequel reposent les comportements et apprentissages humains soulève peut-être une précision majeure.
Si les études et énoncés de cet axe de recherche semblent à la fois fondés, judicieux et passionnants, il ne faudrait pas pour autant ériger les sciences neurologiques comme un dogme recélant La Vérité.
En effet, une science n'est qu'une construction de modèles susceptibles d'évoluer ou d'être remis en question par le progrès et les futures expérimentations. Ainsi, il n'existe pas de vérité mais simplement un désir de connaissances ainsi que des modèles de compréhension et cela vaut aussi bien dans l'univers scientifique que clinique ou humaniste. Modèles neurobiologiques, métapsychologiques ou psychiatriques restent des modélisations nous permettant simplement de mieux comprendre l'Homme et ses comportements.
A ce sujet, François Jacob (2), explique dans son ouvrage, La logique du vivant (Gallimard 1970, p.24) que :
"Comme les autres sciences de la nature, la biologie a perdu aujourd'hui grand nombre de ses illusions. Elle ne cherche pas la vérité. Elle construit la sienne. La réalité scientifique apparaît comme un équilibre toujours instable."
C'est en ce sens que nous devons envisager les sciences, un peu d'ailleurs de la même façon que nous observons et aimons l'art.
Paul Klee (3) disait que "l'art ne rend pas le visible, plutôt, il rend visible". Les recherches scientifiques sont comparables en ce sens qu'elles ne rendent pas compte d'une vérité dogmatique mais elles permettent une ouverture possible de compréhension de l'homme et de son comportement lié à son activité cérébrale.
Les sciences autant que l'art doivent donc faire preuve d'un grand sens créatif car tous deux savent qu'ils tentent de rendre visible la face cachée des choses.
Qu'il s'agisse de science ou d'art, c'est bien cette face cachée qui nous intéresse, nous passionne, nous fait frissonner et nous fait rêver.
Comme le disait encore Charles Baudelaire (4) : "il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière". Ce rayon de lumière, métaphore de l'esprit créatif, est bel et bien présent autant dans la recherche que dans l'expression artistique et s'exprime sous l'égide du comportement passionnel qui propulse l'être dans une volonté de créer pour mieux comprendre.
La passion, comme l'expliquait Jean-Didier Vincent, à propos de son ouvrage, Biologie des Passions, est donc une "passion-intelligente". Nous n'avons alors plus besoin d'opposer systématiquement la passion et la raison. De la même façon, nous pouvons trouver cette grande similitude existante entre l'art et les sciences : La volonté passionnée de comprendre ou tout au moins de saisir subtilement cette fameuse face cachée des choses. Ce qui permet alors de régaler son cerveau et c'est ce qui reste de surcroît, la plus grande finalité présente chez l'être humain.
C'est donc ainsi que l'Homme se régale au contact des arts mais aussi des sciences et laisse parallèlement tout son esprit créatif se libérer car
il aime.
L'affectif prend alors toute sa dimension, permettant la manifestation de l'inventivité humaine.
****
En regardant un catalogue des uvres d'Yves Tanguy (5), je sens très vite que celles-ci réveillent en moi des images archaïques qui se sont associées à la réception des messages traités par mon néocortex par l'intermédiaire des aires réceptrices. Puis, décidée à laisser se régaler mon cerveau, je me laisse immerger par le rêve et les émotions que ses peintures inspirent.
Ce n'est pas tant pour moi le dessin surréaliste qui ouvre la voie au rêve. Il me semble que c'est davantage le milieu marin, aquatique dont les couleurs suggèrent une douceur rare tout comme la lumière lunaire à la fois pure et précise. Je suis dans le monde de la latence. L'inanimé vibre délicatement et attire mon attention. Régression mystérieuse dans les premiers temps de vie. Partage d'un instant de silence. Vestiges du passé dont les formes embryonnaires, archéologiques ne sont que des prétextes pour révéler la face cachée des choses, pour transmettre leur essence et laisser enfin les émotions s'exprimer de façon authentique, lavée.
Je suis dans l'expression de l'indicible et j'ai pourtant l'impression de m'exprimer
sans mots, sans pensées rationnelles non plus. J'exprime le non-visible de moi-même.
J'ai partagé un rêve à la fois mélancolique et passionné. J'aurais voulu flotter, habiter ce milieu marin et puis je me suis éveillée et j'ignore véritablement pourquoi mais j'ai pensé au cerveau et à ses mécanismes complexes. J'ai pensé à la chimie des substances neuronales et hormonales qui se déplacent, selon le modèle du circuit électrique, entre les différents organes et différents centres cérébraux.
Aurais-je associé le milieu marin des uvres de Tanguy au milieu intérieur cérébral, espace liquidien occupé par de l'eau ?
Peut-être
D'autant que le milieu intérieur du cerveau est un océan, d'ailleurs salé, dans lequel baigne les cellules nerveuses.
Peut-être aussi que le rêve nonchalant et mystérieux vécu grâce à l'uvre de ce merveilleux artiste m'a renvoyée quelque part au cerveau et ses arcanes mais aussi au désir passionné que je conserve à mieux le connaître, à mieux le comprendre.
D'un coup, je prends conscience de l'apparente raison de cette association :
Toute la finesse, toute la fragilité émotionnelle présente dans l'uvre de Tanguy s'est peut-être simplement substituée, dans mon esprit, à la fragilité de la vie-même. Je saisis alors combien la connaissance du cerveau et de l'être humain tout entier est tellement délicate et subtile. Nous sommes un peu dans l'étude du non-visible mais très certainement au sein même de l'infiniment fragile
Et je pense à présent aux délicates et subtiles peintures de l'artiste Zao Wou-Ki (6)
C'est dans l'abstraction qu'il exprime ses pensées et ses émotions mais c'est aussi par ce moyen qu'il cherche à saisir le non-visible de la nature comme le murmure du vent.
Dans l'uvre de Zao Wou-Ki, le murmure du vent devient vrai, visible, palpable mais toujours fragile, subtil et mystérieux
Signature :
Sandra Huret, Juillet 2008
BIBLIOGRAPHIE
BELZUNG Catherine, Biologie des émotions, Editions de Boeck, Bruxelles, 2007
JACOB François, La logique du vivant, Editions Gallimard, Paris, 1970
KLEE Paul, Théorie de l'art moderne, Editions Gonthier, Paris, 1975
LECHEVALIER B., PLATEL H., EUSTACHE F., Le cerveau musicien, Editions de Boeck, Bruxelles, 2006
PERETZ I., LIDJI P., Une perspective biologique sur la nature de la musique, Revue de Neuropsychologie, Vol. 16, n°4, p. 361-413, Université de Montréal, 2006.
VINCENT Jean-Didier, Biologie des passions, Editions Odile Jacob, Paris, 1986
Notes :
NOTES
1 - Jean-Didier Vincent, né en 1935. Professeur de neurophysiologie. Auteur de plusieurs ouvrages dont Biologie des passions (1986) et Voyage extraordinaire au centre du cerveau (2007).
2 - François Jacob, né en 1920. Prix Nobel de Physiologie et de Médecine pour ses travaux sur la génétique (1965)
3 - Paul Klee (1879-1940). Peintre suisse. Il grandit dans une famille de musiciens. Sa peinture rejoint la musique. Il imagine une peinture polyphonique et considère d'ailleurs que la terminologie du registre lexical commune aux deux arts ne constitue pas un hasard. (Ton, gamme, harmonie, composition, rythme, fugue, accord
)
4 - Charles Baudelaire (1821-1867). Poète français. uvres complètes chez Gallimard, 1976, Volume 2 p. 425. Baudelaire fait siennes des paroles écrites initialement par E.T.A. Hoffmann dans Kreisleriana :
"Ce n'est pas seulement en rêve (
), c'est encore éveillé, lorsque j'entends la musique, que je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière."
5 - Yves Tanguy (1900-1955). Peintre français, naturalisé américain. Dans "L'histoire de la peinture surréaliste", Marcel Jean dira de son uvre : "La peinture de Tanguy est tout entière nourriture".
André Breton écrira enfin à son sujet : "(
) C'est avec lui un horizon nouveau, celui sur lequel va s'ordonner en profondeur le paysage non plus physique mais mental (
) les êtres-objets qui peuplent ses toiles jouissent de leurs affinités propres qui traduisent de la seule heureuse manière - la manière non littérale - tout ce qui peut être objet d'émotions dans l'univers."
6 - Zao Wou-Ki. Né en 1921 à Pékin. Peintre chinois naturalisé français en 1964. Élu en 2002 à l'Académie des beaux Arts.
Du désir musical
Citation :
"C'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être
créatif et d'utiliser sa personnalité toute entière. C'est seulement en étant créatif
que l'individu découvre le soi." D.W. Winnicott
Auteur et conférencière en psychologie et sophrologie, Sandra Huret est spécialisée dans le travail auprès des artistes, notamment des musiciens. Elle prépare actuellement un ouvrage sur l'expérience musicale.
Cet article propose une petite réflexion sur la naissance du rapport si particulier qui se crée entre le musicien et le sonore d'une part et d'autre part sur l'intérêt que peut revêtir une meilleure connaissance du monde intérieur du musicien au regard des recherches menées sur la perception musicale.
Dans toute étude relative à la musique, la question du désir musical, dans le sens d'une volonté évidente de "faire de la musique" se pose inévitablement.
Afin d'apporter une ou plusieurs ouvertures à sa compréhension, il est important de centrer la réflexion, non pas sur la musique mais sur le musicien.
En effet, la vie intérieure du musicien se révèle fondamentale pour qui veut mieux saisir le rapport existant entre l' être humain et le sonore, entre le musicien et son instrument.
S'attacher à se questionner sur l'apprentissage instrumental au regard de la psychologie cognitive, de la pédagogie et des sciences de l'éducation est essentiel car, étoffé d'une connaissance plus grande et plus juste de l'élève, cela nous permet de mieux apprendre à l'enfant, à l'adolescent puis l'adulte en respect de son âge et de ses aptitudes. Pourtant, cela ne nous renseigne guère sur l'atelier intérieur du musicien (1), en ce sens que la résonance que crée le rapport au sonore demeure toujours un peu mystérieuse
Si la musicothérapie permet de mieux comprendre les possibilités et bénéfices certains qu'offrent la musique sur l'être humain d'un point de vue relativement thérapeutique -
la musique peut soigner, peut aider à se sentir mieux
-, elle nous offre aussi la possibilité de saisir combien la pertinence de l'écho en soi qu'offre la musique est capitale dans la structuration psychique de l'individu.
En ce sens, mieux comprendre la vie intérieure du musicien revient surement à réfléchir sur l'ébauche de la construction de soi en rapport avec le sonore. Pour ce faire, il est nécessaire, non pas de partir des premiers temps de l'apprentissage musical mais des premiers temps de vie.
Si il est souvent difficile de bien comprendre les premiers temps de vie, sachant que le nouveau-né n'exprime pas verbalement son ressenti nous savons pourtant déjà beaucoup grâce aux recherches récentes menées sur les bébés en neuropsychologie (2) mais aussi grâce aux travaux plus lointains du pédiatre D.W.Winnicott (3) qui a ouvert la voie à l'importance capitale que revêt l'ouïe et le sonore dès la naissance, expliquant que, si durant la vie embryonnaire, tout est perçu sous forme vibratoire (ces vibrations préparant déjà la sensibilité sensorielle ultérieure), une fois né, le nourrisson, aura besoin de repères afin de s'assurer d'une sécurité affective nécessaire à son bon développement. Ces repères seront, bien entendu, les bruits de l'environnement, les voix des familiers et surtout le lien puissant qui l'unit à sa mère dont il reconnaitra l'odeur, la chaleur de la peau, le goût du lait et la modulation de la voix.
Ces repères, si intimement liés à la relation maternelle, assurent une continuité même dans la séparation grâce à ce que Winnicott a nommé les espaces transitionnels.
Les espaces ou aires transitionnels dont nous parle ce pédiatre sont là pour permettre au bébé d'être toujours relié à la mère, à son environnement, même dans la séparation, et ce, grâce au son.
Le monde du sonore est en effet dans cet espace de transition le seul élément qui lui permet cette sécurité affective lorsqu'il ne ressent plus le contact de sa mère.
Ce qu'il est important de retenir c'est que quelque soit notre histoire, elle est construite dans notre sécurité par rapport au son. En ce sens que c'est l'ouïe qui permet au nourrisson cette sécurité. C'est la seule possibilité pour lui d'être relié à la mère et c'est ainsi que cet espace de sécurité est garanti par l'aire et le son et c'est sur ce postulat de base que l'être humain se construit. Le son est donc fondamental, vital car il assure la sécurité si essentielle à l'être humain.
Comme tout être humain, le musicien a donc bâtit ses premières relations au sonore sous l'angle de la sécurité affective. Nous pouvons donc fort bien imaginer que le contact privilégié qu'il entretient avec la musique par l'intermédiaire de l'instrument pour le musicien ou par le papier à musique pour le compositeur, va permettre d'ouvrir cet écho en soi, un écho en soi porteur de sens puisqu'il s'inscrit dans une sécurité qui construit, le musicien en jouant se construit, le compositeur en écrivant se construit, et la construction est, comme nous allons le voir, toute proche de la création
Pour l'instant, revenons au lien que peut avoir les premiers échanges avec le sonore et le désir de faire de la musique.
Il n'est bien entendu pas envisageable d'établir des rapports uniques de causalité entre les premières expériences liées au son et le désir de faire de la musique mais ce qu'il est intéressant de souligner est la question suivante :
Dans la mesure où tous les bébés vivent cette expérience structurante liée à l'ouïe et au son, pourquoi certains d'entre eux vont tisser plus tard un lien plus profond, quasi - viscéral avec le monde du sonore ?
Je pense que cette réflexion, pilier de la compréhension du monde intérieur du musicien, doit aller au-delà du débat inné/acquis, au-delà également des recherches neuropsychologiques sur la perception musicale sachant que celles-ci ne tiennent pas compte des caractéristiques individuelles, elle doit être un mode de réflexion personnelle pour chacun des musiciens qui se questionne car elle est révélatrice de sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans une histoire.
Un travail d'introspection parait donc judicieux.
Néanmoins, certains autres éléments peuvent également aider à mieux comprendre le rapport au sonore que lie le musicien.
Effectivement, si la sécurité affective des premiers temps est le postulat de base à la relation exclusive et privilégiée au son, (et, pour mieux saisir la pertinence de ces propos je renvoie le lecteur à l'excellent travail qu'effectue Emmanuelle Lizère (4) auprès des bébés), il existe aussi d'autres éléments permettant de mieux comprendre le désir musical qui va s'installer chez l'enfant.
En discutant récemment avec le compositeur Eric Tanguy (5), j'ai pris conscience que chez le jeune enfant la vocation à la musique et même à la composition peut être déjà présente dès le début de l'apprentissage, se manifestant très vite sous forme d'une nécessité évidente, d'un besoin vital.
Les débuts de l'apprentissage se situant entre cinq et huit ans, il est évident que cela correspond à la phase chez l'enfant de symbolisation par le jeu. Le rapport avec le fait de jouer de la musique se fait inévitablement : on joue en premier lieu par plaisir, mais aussi pour se structurer car cela permet l'accès à la symbolisation, à l'apprentissage de règles et enfin à l'autonomie et à la socialisation. Apprendre la musique entre inévitablement dans cette maturation psychique et cette constatation nous amène à nous positionner tout naturellement sur les raisons évidentes qui plaisent à l'enfant : faire de la musique, c'est jouer, manipuler un instrument par plaisir de contact, du toucher
, c'est apprendre des règles, c'est symboliser des états affectifs en leur donnant une valeur, c'est donner naissance à des sentiments, à des images parfois, c'est aussi communiquer, partager.. Si l'enfant apprécie le jeu musical, il s'épanouira normalement dans cette voie, mais au delà de cette évidence, nombre de musiciens devenus professionnels, se souviennent, comme le violoncelliste Marc Coppey (6), du besoin relativement précoce de s'isoler comme pour mieux mesurer l'importance de ce contact inédit à l'instrument permettant l'expression musicale qui s'instaurera chez certains alors que d'autres, ressentiront davantage le besoin d'écrire la musique comme le confiait Eric Tanguy.
Ainsi le besoin de jouer de la musique ou le besoin de l'écrire est l'accès à cette dynamique précieuse qui va permettre l'échange non pas exclusif au sonore (car il existe déjà quelque part) mais plutôt inédit et peut être déjà sensiblement conscient. De là, va croitre, d'une façon quasi -intuitive, une nécessité de se structurer dans la musique mais aussi se révéler par elle
même si très jeune, elle correspond davantage à un besoin diffus qu'à un désir conscient.
Il est intéressant de se demander justement à quel moment peut-on parler de désir de faire de la musique plutôt que de besoin ?
Il existe très certainement plusieurs composantes l'expliquant mais elles ne seront pas développées dans cet article, en revanche nous pouvons supposer de façon générale que le besoin peut se transformer en désir à partir de l'instant où l'enfant grandissant prend conscience de son choix de poursuivre la musique dans une optique professionnelle, considérant, non plus la musique comme un besoin nourrissant sa vie psychique et sensorielle mais comme une nécessité consciente correspondant à un désir assumé dont le choix de vie serait que la musique demeure pour toujours de la partie.
Une relation privilégiée, qui est née dans la sécurité affective des premiers temps de vie, qui s'est nourrie par la suite d'expériences constructives avec le sonore devenant un objet symbolique de plaisir et de jeu grâce à l'instrument et au travers de la pratique instrumentale puis qui, en s'enracinant dans la vie psychique et dans l'histoire de l'être humain va transformer un besoin vital en désir assumé de faire de la musique (en jouant ou en composant). La relation privilégiée deviendra donc objet de désir, rencontre fusionnelle entre le musicien et l'instrument ou entre le compositeur et sa feuille blanche, rencontre dont l'idée cachée de gagner de l'amour (7) en serait aussi la trame. Cette rencontre, normalement structurante et constructive pour le musicien, pourra permettre l'élan créatif (ou l'inspiration) et, parfois, aussi, l'acte de création proprement dite que ce soit pour l'instrumentiste ou le compositeur.
Effectivement, il est intéressant dans cette réflexion sur la naissance du désir musical d'intégrer également les notions essentielles si chères au musicien que peuvent être l'élan créatif, l'inspiration et la création.
Concernant le compositeur ces notions semblent évidentes à saisir car elles renvoient immédiatement au processus créateur lui étant propre, celui-ci mettant ses compétences au service de la création d'une uvre, un peu comme l'artiste-peintre devant sa toile avec ses couleurs et ses outils, sauf que la toile du compositeur, c'est le papier à musique, ses couleurs, les timbres instrumentaux, ses outils, le crayon investi d'une quantité certaine de compétences, qui dessinera sur le papier le langage musical comme support écrit à ce qu'il vit déjà mentalement et physiquement.
Eric Tanguy m'expliquait que la création était une participation entière de l'être et non simplement un travail mental mêlant un savoir faire technique et théorique. Les sens, l'imaginaire, l'intuition
participent aussi à l'élaboration de l'uvre, à l'énergie créatrice qui dans une concentration introspective, se déploient et rayonnent portant le compositeur vers un élan pulsionnel, vecteur d'inspiration et de création.
Concernant l'interprète, il est judicieux de se demander dans quelle mesure peut-on parler de création ?
Rémy Droz (8) dans son passionnant article sur la musique nous précise un point essentiel à la compréhension musicale :
Il n'y a pas à dire, le professeur bien plus que le musicologue, évoque là un aspect évident de la musique que de nombreux psychologues de la musique paraissent négliger : une composition n'existe pas, ou du moins, elle est très fâcheusement incomplète sans son interprète!
Cette constatation ouvre la voie à l'importance que revêt l'interprétation dans le discours musical qui est évidemment liée à l'aspect créatif normalement propre à chaque interprète et qui s'alimente de ce qu'on nomme l'inspiration.
La pianiste Valérie Bautz (9) répondant à une question relative à l'aspect créatif chez l'interprète disait qu'elle "le situerait dans cette part de subjectivité, celle qui n'appartient qu'à moi, celle, où bien que je lise la même chose que mon voisin, que je connaisse les mêmes codes, ils résonnent en moi différemment et s'expriment donc différemment." Effectivement, les interprètes situent leur part de création dans cet instant, à la fois inédit et fugace, où ils se sentent inspirés, où, de la même façon, que pour les compositeurs, ils ressentent cette participation entière de l'être qui les porte et par laquelle la musique résonne d'une certaine façon et en accord avec soi. L'expression musicale au travers de l'instrument parlera en écho à cette résonance.
La musique, porteuse de sens pour qui la joue, (et aussi pour qui l'écoute !) s'extériorise en adéquation avec le musicien et son monde intérieur mais aussi dans le moment, l'aspect temporel étant bien sur complètement inscrit dans le propos. Il est donc important de ne pas le négliger pour qui veut saisir la pertinence du jeu d'un musicien et de son interprétation. L'inspiration peut en effet varier selon le jour, le moment, l'humeur, les motivations, l'histoire que vit le musicien
Néanmoins, si l'inspiration est d'une certaine manière saisie par l'instant, l'élan pulsionnel qui n'est pas sans rapport avec l'énergie libidinale, cet "en deçà du Désir"(10), qui guide et nourrit l'inspiration et en écho l'aspect créatif d'une interprétation ou la création d'une uvre, reste un principe constructif pour le musicien qui s'exprime ou qui compose.
L'énergie libidinale, contenue dans le désir de s'exprimer musicalement, est toujours liée à l'idée d'une construction propre à l'artiste. C'est pourquoi nous pouvons parler de désir musical comme symbolique d'une construction de soi.
Pour le compositeur, l'uvre issue de cette fusion du corps et de l'esprit, au service de l'inspiration artistique sera le fruit d'une nouvelle étape de la construction psychique.
Pour l'interprète, l'instrument, dont la portée symbolique peut se situer, au delà d'un prolongement de soi, comme un garant du désir, désir d'expression, désir de réalisation, désir de construction de soi en recherchant un timbre, une couleur, une sonorité propre. A ce moment là, l'inspiration permettra l'interprétation et en extension une nouvelle étape dans la construction de soi.
Dans son ouvrage, Le corps de l'uvre (page 86), Didier Anzieu (11) définit ainsi le fait d'être inspiré :
"Etre inspiré, c'est renouveler sa naissance (
) quitter une existence souterraine ou sous marine pour passer à une vie aérobie, relativement indépendante, c'est voler de ses propres ailes, c'est opérer une rupture avec la vie à ras de terre, avec le milieu imposé, avec les habitudes de pensées et d'expression."Nous comprenons bien combien, au-delà des exigences techniques et esthétiques propres à l'artiste dans l'expression musicale, une volonté latente de se construire, de renaitre (ou de naitre autrement) existe et se manifeste dans un désir d'inspiration artistique, vecteur de création et de réalisation personnelle.
En guise de conclusion, voici de nouveau un extrait de l'article de Rémy Droz s'interrogeant sur la musique et précisant :
"Le discours de la psychologie de la musique ne permet pas de cerner des interrogations qui paraissent fondamentales. J'aimerais, par exemple qu'on m'explique, ce que sont des activités musicales, et quelles pourraient être leur spécificité. J'aimerais tellement savoir pourquoi je fais de la musique, comment je fais pour apprendre la musique, que veut dire "comprendre" la musique, comment et pourquoi la musique agit sur mes états d'esprit. Et ainsi de suite."Nous réalisons que seules les compétences musicales inhérentes à la pratique instrumentale analysées avec la psychologie de la musique ne suffisent pas à comprendre la totalité des processus présents dans l'expérience musicale et il demeure évident que d'autres paramètres entrent également en considération.
Si je n'ai dans ce petit article malheureusement pas répondu à toutes ces interrogations, j'ai essayé, en tous cas, de montrer, au travers de la réflexion sur la naissance du désir musical, que les questions relatives à la musique ne sont pas tout pour accéder à une meilleure compréhension de celle-ci et que le musicien -et son monde intérieur -mérite aussi un intérêt de qualité.
Afin de clore cet article je dirai que, le désir, moteur de l'expression musicale, dont les sources ou les origines remontent aux premiers temps de vie et aux premières expériences avec le sonore reflète non seulement la couleur personnelle du musicien mais aussi son histoire symbolisée et sublimée grâce au savant dosage des sens, de l'émotion, de l'imaginaire parfois et souvent de l'intuition.
Le fait de s'exprimer musicalement demeure une richesse, un bien précieux mais qui mérite un éclairage particulier de façon à aider le musicien à mieux se comprendre et peut être aussi à préserver un équilibre épanouissant au travers de ce mode d'expression et de construction de soi.
***
Pour répondre à la notion de créativité dans la façon de concevoir la musique Claude Di Benedetto (12) précisait :
Nietszche a dit :
"Sans la musique, la vie serait une erreur." En écho : Sans être en permanence en situation de créativité, l'interprétation n'existerait pas. Et, en écho à Monsieur Di Benedetto, j'ajouterai :
Sans le désir comme garant de l'expression artistique, l'inspiration dans ce qu'elle recèle de constructif en soi n'existerait pas!
Signature :
Sandra Huret, Nice, Juillet 2007
Bibliographie :
ANZIEU Didier, Le corps de l'uvre, Paris, Gallimard, 1981
ANZIEU Didier, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995
CELESTE B., DELALANDE F., DUMAURIER E., L'enfant du sonore au musical, Paris, INA /GRM, Buchet-Chastel,1982
DROZ Rémy, Musique et émotions, Actualités psychologiques, 2001, 11, 1-25. Institut de psychologie, Université de Lausanne
GRAF Max, L'atelier intérieur du musicien, Paris, Broché, 2000
JACQUES Alexia, LEFEBVRE Alex, La création artistique
Un au deçà du désir, Revue : Cahiers de psychologie clinique, n° 2005/1, De Boeck Université
LECHEVALIER B., PLATEL H., EUSTACHE F., Le cerveau musicien, Bruxelles, De Boeck, 2006
LECOURT Edith, L'expérience musicale, résonances psychanalytiques, Paris, l'Harmattan, 1994
LIZERE Emmanuelle, Tigouli : La création à inventer, article paru dans le magazine Circuit, Faculté de musique -Université de Montréal, pages 57 à 67, volume 16, numéro 2, 2006.
WINNICOTT Donald Woods, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975
WINNICOTT Donald Woods, L'enfant et le monde extérieur, Paris, PBP, 1982
ZENATTI Arlette, Psychologie de la musique, Paris, PUF, 1994
Notes :
1 - Référence au titre de l'ouvrage de Max Graf, L'atelier intérieur du musicien, publié en 1910, et qui peut être considéré comme le premier ouvrage tentant de rapprocher la musique et la psychanalyse.
Max Graf, né en 1876, est un musicologue viennois. Il est aussi le père du petit Hans, dont Freud parle dans sa fameuse étude "Cas de phobie d'un petit garçon de cinq ans" publié en 1908. Max Graf et Sigmund Freud se sont effectivement rencontrés en 1900 et le contact régulier entre ces deux hommes s'est prolongé pendant plus d'une dizaine d'années. Freud exerça une forte influence auprès de Graf. Cette influence se révèle évidente dans ses écrits sur la musique où la théorie psychanalytique semble être au principe de toutes ses réflexions esthétiques.
2 - Les recherches concernant la psychologie de la musique chez le nourrisson sont relativement récentes. Un panorama intéressant de ces recherches forme un chapitre dans l'ouvrage collectif Le cerveau musicien chez De Boeck intitulé La perception de la musique chez les bébés, pages 197 à 205.
L'article d'Emmanuelle Lizère dans la revue Circuit, musiques contemporaines, de l'Université de Montréal, nous offre également la possibilité de mieux saisir les processus en jeu dans la perception du sonore chez le bébé et le petit enfant.
3 - Winnicott a beaucoup travaillé sur les relations mère-enfant, sur l'état de dépendance du nourrisson et sur les phénomènes transitionnels et leur genèse, montant combien le sentiment continu d'exister doit être préservé chez le bébé pour l'amener de sa situation de dépendance des premiers temps, qu'il nomme "dépendance absolue" à une situation de dépendance dont il a conscience et dont l'idée latente est de tendre ensuite vers l'indépendance.
4 - Diplômée de musique, de musicologie et de musicothérapie, Emmanuelle Lizère est actuellement professeur de musique d'ensemble, de formation musicale et d'éveil musical à l'école nationale de musique de Blanc-Mesnil. Elle donne également des conférences et anime des ateliers. Co-créatrice de l'association L'Enfant Phare, qui développe une approche multi sensorielle de la musique, et qui s'est produite notamment au festival du printemps des arts de Monaco et au festival Agora à l'Ircam. En 2002, elle crée la collection de disques Tigouli, s'adressant aux enfants dès 12 mois. (Collection récompensée par les ffff de Télérama.)
5 - Eric Tanguy est un compositeur français, (Victoires de la Musique Classique 2004)
6 - Violoncelliste et professeur de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Marc Coppey assure également la direction artistique du festival "les Musicales " de Colmar.
7 - Citation empruntée au musicien Maciej Pikulski, s'exprimant sur les motivations profondes de l'interprète à exercer cette profession. Pianiste et professeur, Maciej Pikulski enseigne au Centre Supérieur de Musique du Pays Basque à San Sebastian en Espagne.
8 - Professeur honoraire, Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne. Rémy Droz est également flûtiste.
9 -Pianiste, Valérie Bautz enseigne également la musique de chambre au Conservatoire de Nice.
10 - Reprise de l'expression titre de l'article d'Alexia Jacques et d'Alex Lefebvre traitant du désir dans la création artistique propre à la peinture et à ses processus créatifs. Les auteurs ont questionné chacune des fonctions du Moi-Peau, concept développé, lui-même, par le psychanalyste Didier Anzieu (1985). Ces fonctions sont la maintenance, la contenance, la pare-excitation, l'individuation, la consensualité, le soutien à l'excitation sexuelle, la recharge libidinale et l'inscription de traces. Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure ces fonctions peuvent s'appliquer à la création dans l'expression musicale.
11 - Psychanalyste français, il a travaillé sur les envel