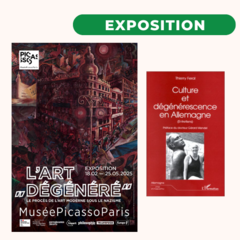13
livres
Vous avez vu 11 livre(s) sur 13
LES Collections dirigées
LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Pour un regard différent sur les Allemands
" De nombreuses erreurs, dit Monsieur Keuner (in Histoires de Monsieur Keuner de Brecht), proviennent du fait que l'on n'interrompt pas ou trop peu ceux qui détiennent la parole. De cette façon se met en place un tout trompeur qui, en raison de son indubitable homogénéité, donne l'impression d'être vrai dans ses différentes parties, alors que ce ne sont que les différentes parties qui s'alignent sur le tout ".
Ainsi en va-t-il du discours historique officiel tel que le conçoivent certes nos responsables politiques (par exemple la légende d'une France globalement résistante forgée par le Général de Gaulle par souci de réconciliation nationale), mais aussi les programmes scolaires comme la " littérature " et la presse de masse au service de l'idéologie dominante.
Ce qui taraude tout chercheur par-delà la laborieuse plongée dans les archives, la minutieuse mise en forme de ses découvertes, l'inévitable discussion à laquelle conduira forcément la réception de ses révélations, c'est la lutte qu'il sait d'emblée devoir mener contre les mythes dont la société est saturée, et dont il assumera désormais la responsabilité de faire justice.
Brecht l'a alerté par son Galilée : " La vérité ne peut s'imposer que si on l'impose, la victoire de la raison ne peut être que la victoire de ceux qui parlent raison ".
Condamné par essence à se situer en hérétique vis-à-vis des dogmes communautaires, ou si l'on préfère, à la façon de l'inoubliable Oskar Matzerath avec son tambour en fer blanc et sa voix vitricide, en " trouble-fête ", en " requin dans un banc de sardines ", en " culbuteur de tabous ", le voici embarqué dans une redoutable aventure : la mise à nu - contre le carcan consensuel et les aliénations multiples qui oblitèrent tout progrès spirituel - des mystifications déshumanisantes dans lesquelles le social engineering - vectorisé par ce nouvel " opium du peuple " que sont depuis Goebbels et " l'instrumentalisation soviétique " (L. Marcuse) les formes modernes de médiatisation - a englué le mouvement historique (cf. G. Orwell).
Ergo : la recherche est passion et - mon ami le philosophe Jean Bardy y a insisté dans un ouvrage récent (Bergson professeur, L'Harmattan) - " la pente est rude et escarpée qui va de la caverne où l'opinion est reine jusqu'au soleil qui est lumière ".
Or s'il existe un domaine où prend tout son sens la célèbre formule de Marx, " la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants ", c'est bien celui des relations franco-allemandes.
Toujours profondément marquée - quoi que l'on puisse en dire - par la défaite de Leipzig qui sonna en 1813 le glas de l'épopée napoléonienne et le coup de grâce de Blücher à Waterloo, par la folle guerre de 1870, par le conflit de 14-18 et ses images d'Épinal (voir le dossier dirigé par G. Raulet in Allemagne d'aujourd'hui, 105/1988), et évidemment l'occupation des années 40 avec son cortège d'exactions et de souffrances, l'opinion hexagonale n'a toujours pas réussi à rompre avec les clichés manichéens et les élaborations fantasmatiques qui lui ont été inculquées et qu'on lui ressert au moindre éternuement entre Berlin et Paris.
Le " Boche " a la vie dure, et tenter de nuancer le propos en évoquant ces admirateurs et amis de la France que furent entre autres Friedrich Schiller, Ludwig Börne, Heinrich Heine, Georg Büchner, Goerg Herwegh, Rainer Maria Rilke, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank, Alfred Döblin, laisse toujours quelque part perplexes nos contemporains.
Quant à célébrer ceux qui, fuyant délibérément le troisième Reich, se mobilisèrent pour dénoncer Hitler, s'engagèrent dans l'armée française tel l'écrivain chrétien Hans Habe, furent internés dans des camps où ils moururent accablés par le désespoir (le dramaturge expressionniste Walter Hasenclever aux Milles) ou livrés à la Gestapo par la police de Vichy (le responsable socialiste Rudolf Breitscheid), mieux encore rejoignirent les maquis où ils payèrent un lourd tribut (massacre du 28 mai 1944 à La Parade en Lozère), voilà qui relève du défi, de la provocation, sinon de la trahison.
Et pourtant, comment ne pas être impressionné - et ému - par le grand nombre d'Allemands dont le nom peut être associé aux heures les plus sombres, mais aussi les plus glorieuses, de notr
Pour enrichir sa réflexion sur les rapports franco-allemands et la construction européenne, on pourra se reporter aux ouvrages suivants parus chez L'Harmattan :
- E. Bowien, Heures perdues du matin, journal d'un artiste peintre (texte rédigé dans la clandestinité).
- M.N. Brand-Crémieux, Les Français face à la réunification allemande.
- D. Cohen, Lettre à une amie allemande.
- G. Connes, L'autre épreuve (un livre pionnier en la matière qui date de 1925 et refusé à l'époque par sept éditeurs).
- E. Julien, Les Rapports franco-allemands à Berlin. 1945-1961.
- S. Lorrain, Des pacifistes français et allemands, pionniers de l'entente franco-allemande.
- S. Martens et al., L'Allemagne et la France, une entente unique pour l'Europe.
- S. Möllenkamp, La Coopération franco-allemand pour la protection du Rhin.
- B. Mrosowski, Savoir vivre avec les Allemands.
- C. von Petersdorff, Dans ma France, c'était bien autrement.
- M.A. zu Salm-Salm, Échanges artistiques franco-allemands.
- H. Stark, Kohl, L'Allemagne et l'Europe.
- A. Wattin, Les 1001 Raisons d'apprendre l'allemand.
- A. Wattin, La Coopération franco-allemande en matière de défense et sécurité.
- M. Weinachter, Valéry Giscard d'Estaing et l'Allemagne.
- H. Wunderlich, Marseille vue par les écrivains de langue allemande.
Lire plus
Ainsi en va-t-il du discours historique officiel tel que le conçoivent certes nos responsables politiques (par exemple la légende d'une France globalement résistante forgée par le Général de Gaulle par souci de réconciliation nationale), mais aussi les programmes scolaires comme la " littérature " et la presse de masse au service de l'idéologie dominante.
Ce qui taraude tout chercheur par-delà la laborieuse plongée dans les archives, la minutieuse mise en forme de ses découvertes, l'inévitable discussion à laquelle conduira forcément la réception de ses révélations, c'est la lutte qu'il sait d'emblée devoir mener contre les mythes dont la société est saturée, et dont il assumera désormais la responsabilité de faire justice.
Brecht l'a alerté par son Galilée : " La vérité ne peut s'imposer que si on l'impose, la victoire de la raison ne peut être que la victoire de ceux qui parlent raison ".
Condamné par essence à se situer en hérétique vis-à-vis des dogmes communautaires, ou si l'on préfère, à la façon de l'inoubliable Oskar Matzerath avec son tambour en fer blanc et sa voix vitricide, en " trouble-fête ", en " requin dans un banc de sardines ", en " culbuteur de tabous ", le voici embarqué dans une redoutable aventure : la mise à nu - contre le carcan consensuel et les aliénations multiples qui oblitèrent tout progrès spirituel - des mystifications déshumanisantes dans lesquelles le social engineering - vectorisé par ce nouvel " opium du peuple " que sont depuis Goebbels et " l'instrumentalisation soviétique " (L. Marcuse) les formes modernes de médiatisation - a englué le mouvement historique (cf. G. Orwell).
Ergo : la recherche est passion et - mon ami le philosophe Jean Bardy y a insisté dans un ouvrage récent (Bergson professeur, L'Harmattan) - " la pente est rude et escarpée qui va de la caverne où l'opinion est reine jusqu'au soleil qui est lumière ".
Or s'il existe un domaine où prend tout son sens la célèbre formule de Marx, " la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants ", c'est bien celui des relations franco-allemandes.
Toujours profondément marquée - quoi que l'on puisse en dire - par la défaite de Leipzig qui sonna en 1813 le glas de l'épopée napoléonienne et le coup de grâce de Blücher à Waterloo, par la folle guerre de 1870, par le conflit de 14-18 et ses images d'Épinal (voir le dossier dirigé par G. Raulet in Allemagne d'aujourd'hui, 105/1988), et évidemment l'occupation des années 40 avec son cortège d'exactions et de souffrances, l'opinion hexagonale n'a toujours pas réussi à rompre avec les clichés manichéens et les élaborations fantasmatiques qui lui ont été inculquées et qu'on lui ressert au moindre éternuement entre Berlin et Paris.
Le " Boche " a la vie dure, et tenter de nuancer le propos en évoquant ces admirateurs et amis de la France que furent entre autres Friedrich Schiller, Ludwig Börne, Heinrich Heine, Georg Büchner, Goerg Herwegh, Rainer Maria Rilke, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank, Alfred Döblin, laisse toujours quelque part perplexes nos contemporains.
Quant à célébrer ceux qui, fuyant délibérément le troisième Reich, se mobilisèrent pour dénoncer Hitler, s'engagèrent dans l'armée française tel l'écrivain chrétien Hans Habe, furent internés dans des camps où ils moururent accablés par le désespoir (le dramaturge expressionniste Walter Hasenclever aux Milles) ou livrés à la Gestapo par la police de Vichy (le responsable socialiste Rudolf Breitscheid), mieux encore rejoignirent les maquis où ils payèrent un lourd tribut (massacre du 28 mai 1944 à La Parade en Lozère), voilà qui relève du défi, de la provocation, sinon de la trahison.
Et pourtant, comment ne pas être impressionné - et ému - par le grand nombre d'Allemands dont le nom peut être associé aux heures les plus sombres, mais aussi les plus glorieuses, de notr
Pour enrichir sa réflexion sur les rapports franco-allemands et la construction européenne, on pourra se reporter aux ouvrages suivants parus chez L'Harmattan :
- E. Bowien, Heures perdues du matin, journal d'un artiste peintre (texte rédigé dans la clandestinité).
- M.N. Brand-Crémieux, Les Français face à la réunification allemande.
- D. Cohen, Lettre à une amie allemande.
- G. Connes, L'autre épreuve (un livre pionnier en la matière qui date de 1925 et refusé à l'époque par sept éditeurs).
- E. Julien, Les Rapports franco-allemands à Berlin. 1945-1961.
- S. Lorrain, Des pacifistes français et allemands, pionniers de l'entente franco-allemande.
- S. Martens et al., L'Allemagne et la France, une entente unique pour l'Europe.
- S. Möllenkamp, La Coopération franco-allemand pour la protection du Rhin.
- B. Mrosowski, Savoir vivre avec les Allemands.
- C. von Petersdorff, Dans ma France, c'était bien autrement.
- M.A. zu Salm-Salm, Échanges artistiques franco-allemands.
- H. Stark, Kohl, L'Allemagne et l'Europe.
- A. Wattin, Les 1001 Raisons d'apprendre l'allemand.
- A. Wattin, La Coopération franco-allemande en matière de défense et sécurité.
- M. Weinachter, Valéry Giscard d'Estaing et l'Allemagne.
- H. Wunderlich, Marseille vue par les écrivains de langue allemande.
Antisémitisme et racisme " L'illusion d'être-là "
Citation :
" Hier sera ce qu'a été demain ".
G. Grass, Une Rencontre en Westphalie, Seuil, 1981.
LE RACISME : TÉNÈBRES DES CONSCIENCES, un ouvrage du psychiatre Alain AMAR (membre du comité d'éthique du CHU de Lyon, conseiller régional et membre du bureau national de l'Association française de psychiatrie), en collaboration avec le germaniste Thierry Feral, Paris, L'Harmattan, 2004.
[L'article qui suit reprend sous un titre nouveau et une forme légèrement modifiée l'introduction de la contribution de T. Feral.]
Comme l'a montré Adolf Leschnitzer(1), la quête du bouc émissaire est une constante inévitable des sociétés modernes. De fait, les systèmes générés par le capitalisme et ce de quelque nature qu'ils puissent être se caractérisent par leur incapacité à apporter des solutions efficaces au " malaise dans la culture " que ne peuvent qu'éprouver tous les laissés-pour-compte et exclus qu'ils produisent, mais aussi tous ces ouvriers, artisans, employés, petits paysans, commerçants et fonctionnaires taraudés par les incertitudes d'un avenir qui semble inexorablement s'enliser dans la décadence. C'est pourquoi lesdits systèmes, impuis-sants à concilier impératifs économiques et épanouissement de la personnalité, course au profit et dignité humaine, spéculation et sécurité existentielle, n'ont à terme d'autre issue que d'adopter des stratégies de dérivation : leur souci primaire étant de se préserver de la colère de ceux dont ils sont producteurs de l'agressivité, ils émasculent la pensée de sa dimension dialectique et érigent des superstructures à fonction hypnotique et omniexplicative qui frustrent l'homme de sa réalité pour l'aliéner à un univers fictif (cf. Robert Musil, L'Homme sans qualités, 1930-1932), le somnambulisent (cf. Hermann Broch, Les Somnambules, 1931-1932), le contraignent à rechercher ce que, dans Effi Briest (1895), Theodor Fontane appelait fort judicieusement des " constructions de fortune " (Hilfskonstruktionen). L'éminent sociopsychanalyste Gérard Mendel l'a bien résumé(2) : " Placé entre l'écorce et la cognée, la tendance naturelle du moi [est] d'aimer à s'illusionner. [ ] La société l'a beaucoup aidé dans cette voie. Cette voie, elle est celle de l'occultation du conflit. Et il existe une telle complicité
entre le moi individuel et la société qu'il est souvent bien difficile de démêler ce qui revient à l'un et à l'autre. L'individu, inconsciemment, refoule, projette (ce n'est pas moi, c'est l'autre), et idéalise ; et la société pousse au refoulement et à la répression, désigne sur qui l'on doit projeter l'ennemi , et qui l'on doit idéaliser le père social, le grand, le chef , tout en majorant, exploitant et pérennisant ce processus. "
Sans identité et sans historicité, enfermé dans une vie silencieuse et muette, l'individu en est réduit à exaspérer ses rancoeurs et à exorciser ses angoisses au gré d'une partition sans cesse réécrite pour lui. Ceci n'est pas sans évoquer le Berlin Alexanderplatz (1929) du psychiatre Alfred Döblin, Et maintenant, mon bonhomme (1932) de Hans Fallada, ou encore le très remarquable texte du sociologue Siegfried Kracauer consacré à la classe moyenne de l'Allemagne du tournant des années trente, Les Employés.
Cependant, les " constructions de fortune " sont marquées du sceau de l'aléatoire. Leur vacuité désespérante ne saurait compenser durablement les carences narcissiques de l'individu qui, à moins d'assumer la logique ultime de la médiocrité, voire de la déchéance à laquelle le condamne le système, c'est-à-dire la mort, n'a d'autre recours que de se donner une raison de vivre malgré tout. Pour cela, il n'entrevoit dans le tumulte qui l'agite qu'un seul dénouement à sa portée immédiate : focaliser sur un objet-poubelle(3)", un dépotoir(4). Pour se réaliser illusoirement comme sujet de droit, il transfère la somme de ses ressentiments sur une figuration mythique en laquelle il peut selon l'expression sartrienne " localiser tout le mal de l'univers "(5).
Il est évident que, dans un tel contexte, le cogito n'est plus de mise. À lui se substitue désormais un " ça pense en moi " régression sur un fonds archaïque comme ersatz à la dépersonnalisation qui déleste l'individu de toute implication rationnelle et responsable dans la maîtrise de sa destinée et l'édification d'une société meilleure, le libère encore Sartre de sa " peur devant la
Ces problèmes vous intéressent ?
N'hésitez pas à consulter sur notre site www.editions-harmattan.fr le catalogue des collections " Allemagne d'hier et d'aujourd'hui ", " Mémoires du XXe Siècle " et " Chemins de la mémoire ". Vous y trouverez un résumé des ouvrages, ainsi qu'une visualisation de la couverture et de la quatrième de couverture.
Thierry FERAL enseigne à Clermont-Ferrand, auteur de très nombreux ouvrages et articles sur le national-socialisme, directeur de la collection " Allemagne d'hier et d'aujourd'hui " aux éditions L'Harmattan, Paris.
Notes :
Notes et références
1. A. Leschnitzer, The magic background of modern antisemitism, New York, International Universities Press, 1956.
2. G. Mendel, Pour décoloniser l'enfant, Paris, Payot, 1971, pp. 9-10.
3. P. Dubor, " Structure psychotique ", in Abrégé de psychologie pathologique, Paris, Masson, 1974.
4. P.C. Racamier, " Esquisses d'une clinique de la paranoïa ", in Rev. franç. psychan. , 1/1996.
5. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Idées/NRF, 1954, p. 47.
6. Ibid., p. 64.
7. Ibid., p. 181.
8. W. Benjamin, uvres 1, Paris, Folio essais, 2000.
9. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit., p. 26.
10. Politzer contre le nazisme, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1984, p. 99.
11. H. Hesse, Narcisse et Goldmund, (1930), Paris, Livre de Poche, 1991, pp. 269-272.
12. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit., pp. 47, 48, 50, 51, 52.
13. G.A. Goldschmidt, Quand Freud voit la mer, Paris, Buchet-Chastel, 1988, pp. 204, 192, 214.
14. Voir à ce propos Die Geächteten (Les Réprouvés) et Der Fragebogen (Le Questionnaire) de Ernst von Salomon (1902-1972), qui participa à l'assassinat.
15. S. Freud, L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Folio essais, 1991, p. 262.
16. J. Eisenberg, Une Histoire des Juifs, Paris, Livre de Poche, 1986, p. 483.
17. Cit. in Impact. Revue du cinéma direct, 10-11, 1979, p. 31.
18. Cf. P. Weiss, Die Ermittlung (L'Instruction) , Reinach/Hamburg, Rowley, 1965, p. 30.
19. Voir E.E. Kisch, Histoire de sept ghettos, préface de J.M. Palmier, Grenoble, Presses Universitaires, 1992, p. 24.
20. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit. , P. 64.
21. R. Loewenstein, Psychoanalyse des Antisemitismus, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1968, ch. I.
22. G. Mendel, De Faust à Ubu, La Tour d'Aigues, L'Aube, 1996, pp. 129-131.
23. A. Camus, La Chute, Paris, Gallimard, 1956, p. 12.
24. Voir le documentaire vidéo de D. Danquart, Le Regard de Pannwitz, Internationes, 1991.
25. A. Camus, La Chute, op. cit., p. 128.
26. Qu'il me soit permis de dire ici ce que je pense de la querelle à propos du nombre des morts de la déportation qui revient sans cesse sur le tapis. Poser le problème sous cet angle revient tout simplement à admettre comme moralement acceptable de massacrer des innocents pour peu que l'on se cantonne dans des limites " raisonnables ", donc de concevoir sans aucun état d'âme que la raison puisse légitimer le crime alors que sa fonction est précisément de permettre à l'homme de contrôler ses passions, ses pulsions, son animalité et que, pour reprendre la sentence de Goya, c'est justement sa mise en sommeil qui conduit l'homme à commettre des actes incontrôlés et horribles (" El sveño de la razon produce monstruos ", Les Caprices, 1799, gravure n° 23, musée de Castres).
27. F. Raphael, interview in Impact. Revue du cinéma direct, op. cit. , p. 73.
28. Voir à ce propos G. Raulet, Aufklärung, Paris, GF-Flammarion, 1995, pp. 25-28.
29. C'est-à-dire rejeter sans concession toute conception et pratique fondées sur l'exaltation des passions, des instincts, de l'arrivisme. Cf. Georges Politzer, Écrits 1, - La Philosophie et les mythes, Paris, Éditions sociales, 1973, p. 178 : " Le rôle de la philosophie n'est pas de forger à l'usage de qui que se soit des mythes, pas plus des mythes d'abdication que les mythes barbares de la négation de l'homme. Le rôle de la philosophie n'est pas d'obscurcir mais d'éclaircir. Il n'est pas d'aider les ennemis de l'homme à le duper, mais d'aider l'homme à réaliser son être effectivement. "
30. Cf., W. Kolbenhoff, Les Sous-Hommes, Paris, L'Harmattan, 2000, ainsi que Morceaux choisis, Paris, L'Harmattan, 2004.
31. Voir " Des paysans fr
Lire plus
" Hier sera ce qu'a été demain ".
G. Grass, Une Rencontre en Westphalie, Seuil, 1981.
LE RACISME : TÉNÈBRES DES CONSCIENCES, un ouvrage du psychiatre Alain AMAR (membre du comité d'éthique du CHU de Lyon, conseiller régional et membre du bureau national de l'Association française de psychiatrie), en collaboration avec le germaniste Thierry Feral, Paris, L'Harmattan, 2004.
[L'article qui suit reprend sous un titre nouveau et une forme légèrement modifiée l'introduction de la contribution de T. Feral.]
Comme l'a montré Adolf Leschnitzer(1), la quête du bouc émissaire est une constante inévitable des sociétés modernes. De fait, les systèmes générés par le capitalisme et ce de quelque nature qu'ils puissent être se caractérisent par leur incapacité à apporter des solutions efficaces au " malaise dans la culture " que ne peuvent qu'éprouver tous les laissés-pour-compte et exclus qu'ils produisent, mais aussi tous ces ouvriers, artisans, employés, petits paysans, commerçants et fonctionnaires taraudés par les incertitudes d'un avenir qui semble inexorablement s'enliser dans la décadence. C'est pourquoi lesdits systèmes, impuis-sants à concilier impératifs économiques et épanouissement de la personnalité, course au profit et dignité humaine, spéculation et sécurité existentielle, n'ont à terme d'autre issue que d'adopter des stratégies de dérivation : leur souci primaire étant de se préserver de la colère de ceux dont ils sont producteurs de l'agressivité, ils émasculent la pensée de sa dimension dialectique et érigent des superstructures à fonction hypnotique et omniexplicative qui frustrent l'homme de sa réalité pour l'aliéner à un univers fictif (cf. Robert Musil, L'Homme sans qualités, 1930-1932), le somnambulisent (cf. Hermann Broch, Les Somnambules, 1931-1932), le contraignent à rechercher ce que, dans Effi Briest (1895), Theodor Fontane appelait fort judicieusement des " constructions de fortune " (Hilfskonstruktionen). L'éminent sociopsychanalyste Gérard Mendel l'a bien résumé(2) : " Placé entre l'écorce et la cognée, la tendance naturelle du moi [est] d'aimer à s'illusionner. [ ] La société l'a beaucoup aidé dans cette voie. Cette voie, elle est celle de l'occultation du conflit. Et il existe une telle complicité
entre le moi individuel et la société qu'il est souvent bien difficile de démêler ce qui revient à l'un et à l'autre. L'individu, inconsciemment, refoule, projette (ce n'est pas moi, c'est l'autre), et idéalise ; et la société pousse au refoulement et à la répression, désigne sur qui l'on doit projeter l'ennemi , et qui l'on doit idéaliser le père social, le grand, le chef , tout en majorant, exploitant et pérennisant ce processus. "
Sans identité et sans historicité, enfermé dans une vie silencieuse et muette, l'individu en est réduit à exaspérer ses rancoeurs et à exorciser ses angoisses au gré d'une partition sans cesse réécrite pour lui. Ceci n'est pas sans évoquer le Berlin Alexanderplatz (1929) du psychiatre Alfred Döblin, Et maintenant, mon bonhomme (1932) de Hans Fallada, ou encore le très remarquable texte du sociologue Siegfried Kracauer consacré à la classe moyenne de l'Allemagne du tournant des années trente, Les Employés.
Cependant, les " constructions de fortune " sont marquées du sceau de l'aléatoire. Leur vacuité désespérante ne saurait compenser durablement les carences narcissiques de l'individu qui, à moins d'assumer la logique ultime de la médiocrité, voire de la déchéance à laquelle le condamne le système, c'est-à-dire la mort, n'a d'autre recours que de se donner une raison de vivre malgré tout. Pour cela, il n'entrevoit dans le tumulte qui l'agite qu'un seul dénouement à sa portée immédiate : focaliser sur un objet-poubelle(3)", un dépotoir(4). Pour se réaliser illusoirement comme sujet de droit, il transfère la somme de ses ressentiments sur une figuration mythique en laquelle il peut selon l'expression sartrienne " localiser tout le mal de l'univers "(5).
Il est évident que, dans un tel contexte, le cogito n'est plus de mise. À lui se substitue désormais un " ça pense en moi " régression sur un fonds archaïque comme ersatz à la dépersonnalisation qui déleste l'individu de toute implication rationnelle et responsable dans la maîtrise de sa destinée et l'édification d'une société meilleure, le libère encore Sartre de sa " peur devant la
Ces problèmes vous intéressent ?
N'hésitez pas à consulter sur notre site www.editions-harmattan.fr le catalogue des collections " Allemagne d'hier et d'aujourd'hui ", " Mémoires du XXe Siècle " et " Chemins de la mémoire ". Vous y trouverez un résumé des ouvrages, ainsi qu'une visualisation de la couverture et de la quatrième de couverture.
Thierry FERAL enseigne à Clermont-Ferrand, auteur de très nombreux ouvrages et articles sur le national-socialisme, directeur de la collection " Allemagne d'hier et d'aujourd'hui " aux éditions L'Harmattan, Paris.
Notes :
Notes et références
1. A. Leschnitzer, The magic background of modern antisemitism, New York, International Universities Press, 1956.
2. G. Mendel, Pour décoloniser l'enfant, Paris, Payot, 1971, pp. 9-10.
3. P. Dubor, " Structure psychotique ", in Abrégé de psychologie pathologique, Paris, Masson, 1974.
4. P.C. Racamier, " Esquisses d'une clinique de la paranoïa ", in Rev. franç. psychan. , 1/1996.
5. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Idées/NRF, 1954, p. 47.
6. Ibid., p. 64.
7. Ibid., p. 181.
8. W. Benjamin, uvres 1, Paris, Folio essais, 2000.
9. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit., p. 26.
10. Politzer contre le nazisme, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1984, p. 99.
11. H. Hesse, Narcisse et Goldmund, (1930), Paris, Livre de Poche, 1991, pp. 269-272.
12. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit., pp. 47, 48, 50, 51, 52.
13. G.A. Goldschmidt, Quand Freud voit la mer, Paris, Buchet-Chastel, 1988, pp. 204, 192, 214.
14. Voir à ce propos Die Geächteten (Les Réprouvés) et Der Fragebogen (Le Questionnaire) de Ernst von Salomon (1902-1972), qui participa à l'assassinat.
15. S. Freud, L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Folio essais, 1991, p. 262.
16. J. Eisenberg, Une Histoire des Juifs, Paris, Livre de Poche, 1986, p. 483.
17. Cit. in Impact. Revue du cinéma direct, 10-11, 1979, p. 31.
18. Cf. P. Weiss, Die Ermittlung (L'Instruction) , Reinach/Hamburg, Rowley, 1965, p. 30.
19. Voir E.E. Kisch, Histoire de sept ghettos, préface de J.M. Palmier, Grenoble, Presses Universitaires, 1992, p. 24.
20. J.P. Sartre, Réflexions sur la question juive, op. cit. , P. 64.
21. R. Loewenstein, Psychoanalyse des Antisemitismus, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1968, ch. I.
22. G. Mendel, De Faust à Ubu, La Tour d'Aigues, L'Aube, 1996, pp. 129-131.
23. A. Camus, La Chute, Paris, Gallimard, 1956, p. 12.
24. Voir le documentaire vidéo de D. Danquart, Le Regard de Pannwitz, Internationes, 1991.
25. A. Camus, La Chute, op. cit., p. 128.
26. Qu'il me soit permis de dire ici ce que je pense de la querelle à propos du nombre des morts de la déportation qui revient sans cesse sur le tapis. Poser le problème sous cet angle revient tout simplement à admettre comme moralement acceptable de massacrer des innocents pour peu que l'on se cantonne dans des limites " raisonnables ", donc de concevoir sans aucun état d'âme que la raison puisse légitimer le crime alors que sa fonction est précisément de permettre à l'homme de contrôler ses passions, ses pulsions, son animalité et que, pour reprendre la sentence de Goya, c'est justement sa mise en sommeil qui conduit l'homme à commettre des actes incontrôlés et horribles (" El sveño de la razon produce monstruos ", Les Caprices, 1799, gravure n° 23, musée de Castres).
27. F. Raphael, interview in Impact. Revue du cinéma direct, op. cit. , p. 73.
28. Voir à ce propos G. Raulet, Aufklärung, Paris, GF-Flammarion, 1995, pp. 25-28.
29. C'est-à-dire rejeter sans concession toute conception et pratique fondées sur l'exaltation des passions, des instincts, de l'arrivisme. Cf. Georges Politzer, Écrits 1, - La Philosophie et les mythes, Paris, Éditions sociales, 1973, p. 178 : " Le rôle de la philosophie n'est pas de forger à l'usage de qui que se soit des mythes, pas plus des mythes d'abdication que les mythes barbares de la négation de l'homme. Le rôle de la philosophie n'est pas d'obscurcir mais d'éclaircir. Il n'est pas d'aider les ennemis de l'homme à le duper, mais d'aider l'homme à réaliser son être effectivement. "
30. Cf., W. Kolbenhoff, Les Sous-Hommes, Paris, L'Harmattan, 2000, ainsi que Morceaux choisis, Paris, L'Harmattan, 2004.
31. Voir " Des paysans fr